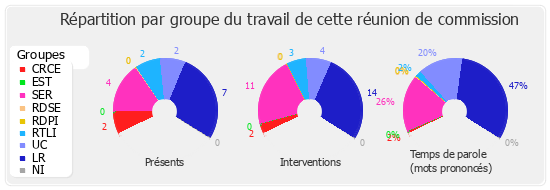Commission des affaires sociales
Réunion du 3 avril 2019 à 9:5
Sommaire
- Audition commune sur la stratégie thérapeutique face à la borréliose de lyme : pr christian perronne dr raouf ghozzi dr pierre tattevin mme sarah bonnet pr olivier lesens et pr yves hansmann (voir le dossier)
- Proposition de loi relative à l'interdiction de la vente des drapeaux des associations d'anciens combattants et à leur protection
- Financement de la dépendance
- Examen du rapport d'information fait au nom de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (voir le dossier)
- Désignation d'un rapporteur (voir le dossier)
La réunion
Audition commune sur la stratégie thérapeutique face à la borréliose de lyme : pr christian perronne dr raouf ghozzi dr pierre tattevin Mme Sarah Bonnet pr olivier lesens et pr yves hansmann
Audition commune sur la stratégie thérapeutique face à la borréliose de lyme : pr christian perronne dr raouf ghozzi dr pierre tattevin Mme Sarah Bonnet pr olivier lesens et pr yves hansmann

Nous poursuivons ce matin nos travaux sur la maladie de Lyme, avec une troisième table ronde, consacrée à la stratégie thérapeutique. Notre réunion est retransmise en direct sur le site du Sénat et consultable en vidéo à la demande.
Le Gouvernement a lancé fin 2016 un plan national de prévention et de lutte contre la maladie de Lyme et la Haute Autorité de santé (HAS) a réuni un groupe de travail pluridisciplinaire avec l'objectif de réactualiser les lignes directrices du consensus de 2006.
Publiée en juin 2018, la recommandation de bonne pratique de la HAS propose un cadre de prise en charge diagnostique et thérapeutique rénové. Elle n'a cependant pas emporté le consensus dans la communauté médicale. Certaines questions, telles l'existence éventuelle d'une forme chronique et la durée pertinente des traitements antibiotiques, continuent de cristalliser les tensions.
Nous avons donc souhaité approfondir le débat en conviant des spécialistes de ce problème de santé publique autour de quatre tables rondes. Après un cadrage épidémiologique et biologique de la maladie, notre deuxième réunion a porté sur les outils d'aide au diagnostic. La troisième se penche sur la stratégie thérapeutique et la quatrième nous permettra de faire le point sur les enseignements tirés de ces rencontres avec les représentants des autorités sanitaires, en présence d'un représentant de l'équivalent britannique de la HAS.
En évoquant la semaine dernière les outils d'aide au diagnostic, nous avons eu un premier exposé des différentes positions en présence. Je rappelle que notre objectif n'est pas de déterminer ce que doit être le diagnostic ou la prise en charge, pas plus pour la maladie de Lyme que pour tout autre maladie ; mais de comprendre comment se construit ce processus de prise en charge, comment se forge le consensus et comment il se diffuse auprès des médecins, au bénéfice des patients.
Nous accueillons ce matin le professeur Christian Perronne, infectiologue ; le docteur Raouf Ghozzi, médecin interniste, président de la Fédération française des maladies vectorielles à tiques ; le docteur Pierre Tattevin, président de la société de pathologie infectieuse de langue française (Spilf) ; Mme Sarah Bonnet, directrice de recherche au sein de l'unité mixte de recherche biologie moléculaire et immunologie parasitaires de l'Inra, coordinatrice du projet « Visions » ; le professeur Olivier Lesens, chef du service des maladies infectieuses du CHU de Clermont-Ferrand, et le professeur Yves Hansmann, spécialiste des pathologies infectieuses et tropicales au CHU de Strasbourg.
Professeur Christian Perronne, infectiologue. - J'exerce la médecine tous les jours et je vois des milliers de malades en grande souffrance, nombre d'entre eux ayant été rejetés par le corps médical, alors que nous pouvons guérir 80 % des personnes atteintes de la maladie de Lyme. Quelque chose ne tourne pas rond ! On prétend que les traitements ont seulement un effet placebo : pas du tout ! Des gens qui, du fait de la maladie, avaient tout perdu, famille, travail, et se déplaçaient parfois en fauteuil roulant ont été guéris. Alors ils abandonnent les associations de malades, bien sûr, car ils pensent surtout à revivre. Il y a deux ans d'attente à ma consultation, je reçois des personnes désespérées, et je remercie les centaines de médecins généralistes qui continuent à prendre en charge ces patients, malgré les persécutions qu'ils encourent de la part des caisses d'assurance maladie. Il y a peut-être quelques charlatans, mais les praticiens sont honnêtes en grande majorité et ils aident les malades quotidiennement.
Les recommandations de la HAS sont très utiles. Soit dit en passant, je ne comprends pas que des professionnels qui ont participé à l'écriture du texte s'en soient désolidarisés ensuite...
Les recommandations prévoyaient clairement que les centres de référence comprendraient des comités de pilotage, où seraient représentés les malades, via leurs associations, et les médecins qui soignent cette pathologie. Or, lorsque j'ai fait la demande pour constituer un centre de référence, j'ai constaté que les médecins et les associations ne figuraient plus dans la rédaction : c'est une entrave à la démocratie sanitaire. L'Agence nationale de recherche sur le sida comprenait dès le début, dans son conseil scientifique, ces catégories. Dans le cas de Lyme, les malades n'existent plus ! Ils sont pourtant en grande souffrance.
Dans les hôpitaux, seules 10 % à 20 % des personnes venues consulter pour des symptômes correspondant à la maladie sont diagnostiqués comme souffrant du syndrome persistant polymorphe après une possible piqûre de tique (SPPT) ; les autres reçoivent un diagnostic bizarre, ou sont envoyées en psychiatrie, ou se voient prescrire trois semaines d'antibiotiques. Ma boîte mail regorge de courriels de détresse ! Je connais même des cas de suicide.
On m'oppose qu'il n'existe pas de données scientifiques en faveur du traitement. Tout de même ! Nous avions publié une étude menée sur dix ans, avec Jérôme Salomon, à présent directeur général de la santé, et Juliette Clarissou. Il y a eu plusieurs études. On invoque contre elles l'absence de groupe témoin, de tirage au sort avec administration de placebo, pour disqualifier mes résultats. Je veux bien faire des études, si l'on me donne des crédits !
Du reste, sur la fièvre Q chronique ou la maladie de Whipple, jamais la moindre étude n'a été publiée, cela n'empêche pas la société de pathologie infectieuse d'accepter l'administration d'antibiotiques pendant un an et demi, voire des traitements à vie. Pourquoi la maladie de Lyme est-elle regardée différemment ? Pas d'étude randomisée, me reproche-t-on, pour prouver que le traitement prolongé est utile. Si ! Deux études randomisées ont été publiées, qui en montrent le bénéfice ; mais elles sont validées sur des critères précis. Elles sont publiées dans des revues internationales, je vous en donnerai les références. Certes, les traitements n'ont pas été très prolongés et les malades ont rechuté.
Vous m'opposerez deux études publiées dans le prestigieux New England Journal of medicine, affirmant que les traitements prolongés n'ont pas d'efficacité : mais ces études sont entachées de graves biais méthodologiques. Il est vrai que la revue appartient à l'université de Boston, qui héberge aussi la société américaine des maladies infectieuses, celle qui a la main sur les recommandations sur Lyme. Ce qui est choquant, c'est que l'observation est située à une très mauvaise date, trois mois après le début du traitement, et qu'elle ne tient pas compte de tous les signes cliniques, articulaires, cardiaques, neurologiques. Il s'agit d'un simple score de qualité de vie, une simple question posée aux patients sur leur état... Or à trois mois, 20 % des patients sont ravis, 20 % estiment qu'ils vivent une catastrophe (le traitement commence par aggraver les symptômes) et les autres sont indécis, mais ils seront guéris après encore un mois ou deux de traitement. À ce jour il n'existe aucune étude randomisée de qualité, à quatre mois. Et je n'ai jamais obtenu les crédits de recherche que je demandais.
Or, s'il est démontré que tel médicament fonctionne sur la Borrelia en laboratoire sur des petites séries, nous avons maintenant besoin d'avancer. C'est pourquoi la HAS souhaite la constitution de centres de référence afin de créer des bases de données et de pouvoir évaluer des pratiques jugées peu orthodoxes. La fédération est d'accord, nous sommes ravis que les autorités évaluent nos résultats au quotidien. Nous demandons aussi des études scientifiques. On prétend parfois que la guérison intervient en trois semaines, mais les signes persistent parfois - j'ai six références en ce sens, ainsi que sept références de persistance de la Borrelia au plan microbiologique sur le singe, et quatorze références chez l'homme dans la phase tardive de traitement. Il y a des preuves scientifiques sur les rechutes.
Le syndrome de persistance polymorphe après possible piqûre de tiques, le SPPT, a été redéfini par la HAS ; il avait été défini pour la première fois en 2014 par le rapport du Haut Conseil de la santé publique. Je ne comprends d'ailleurs pas qu'un membre éminent du groupe qui avait porté le SPPT sur les fonds baptismaux se répande à présent en propos contre lui, parlant d'un concept bizarre, franco-français, promu par des médecins qui font des choses peu sensées... Les médias propagent ces idées, alors que les Américains ont pareillement établi un post treatment Lyme disease syndrom (PTLDS), avec des publications scientifiques et une description clinique des anomalies. La persistance de la bactérie malgré les traitements est considérée comme une des causes possibles, parmi d'autres, de ces évolutions dans le temps.
Le rapport de la HAS (qui n'est pas unanimement reconnu) a marqué des avancées : les tests sérologiques ne sont pas fiables systématiquement, le SPPT exige un diagnostic clinique par réponse à un traitement antibiotique ; et traiter plus longtemps les patients est autorisé à présent, en se mettant en relation avec un centre de référence, pour que ces pratiques non reconnues aujourd'hui soient validées.
Docteur Raouf Ghozzi, médecin interniste, président de la Fédération française des maladies vectorielles à tiques. - Je suis interniste de formation mais j'ai effectué une formation de deux semestres au CHU de Toulouse en maladies infectieuses ; puis je suis devenu chef de clinique dans le service de Jacques Reynes au CHU de Montpellier. À Toulouse, j'avais été impressionné par les faits suivants : la chef de clinique reçoit un patient pour lequel le tableau de la radiculite s'impose, sans autre explication que la Borrelia. Après trois semaines d'antibiotique, le patient va mieux, mais un mois après il rechute. Autre antibiotique, autre phase d'amélioration. Mais il rechute à nouveau et revient en consultation. La réponse fut : nous ne pouvons rien faire de plus pour vous.
On dit qu'il y a peu de tiques dans le bassin méditerranéen, mais j'ai déjà vu, à Montpellier, des érythèmes migrants, avec des tableaux similaires à celui de Toulouse. Je les ai traités plus longtemps, avec succès.
Je venais d'arriver à l'hôpital de Lannemezan lorsque des associations de patients sont venues voir le directeur pour lui demander que l'hôpital s'occupe de la maladie de Lyme. C'est ainsi que les choses ont commencé et j'ai pu constater par la suite que certaines personnes répondaient à des traitements un peu différents de ce qui était recommandé classiquement. Les résultats ne sont pas toujours probants, mais ces expériences sont intéressantes.
J'ai fait partie du groupe de travail du Haut Conseil, en 2012, puis de celui de la HAS. Deux choses m'avaient surpris en 2012 : sur les tests, on avait constaté, avec l'ANSM, que beaucoup de réactifs n'étaient pas aux normes - entretemps, il y a eu réactualisation ; et dans l'étude conduite au même moment par Muriel Vayssier-Taussat avec des médecins sensibilisés à la maladie de Lyme, sur 70 patients, le résultat était positif dans 55 cas, avec une bartonnelle dans l'ADN en PCR (polymerase chain reaction) ; et seulement six de ces patients avaient une culture positive pour la bartonnelle. Ces patients ont été traités, avec une nette amélioration - les résultats ont été publiés en 2016 dans une revue de niveau très correct, Emerging infectious diseases. On constatait la disparition de la bactérie, après traitement. C'est ce qui a conduit à poser un diagnostic de SPPT qui pouvait couvrir la bartonnelle, une Borrelia mal traitée, ou d'autres agents pathogènes - en forêt de Sénart, on a trouvé 40 % de génomes bactériens, de parasites et de virus non connus. Le SPPT a l'avantage d'être beaucoup plus large.
Le PTLDS correspond à des patients correctement traités, qui n'avaient plus de symptômes cliniques, chez qui la présence de la bactérie n'était pas mise en évidence, et pour lesquels un retraitement n'était pas efficace. Un éminent infectiologue de l'hôpital de Baltimore-John-Hopkins a publié début 2018 les conclusions de sa recherche sur ce syndrome, or la plupart des symptômes se recoupent fortement avec le fameux SPPT.
J'ai vu moi aussi des suicides, par exemple celui d'un jeune de 20 ans, atteint depuis quatre ou cinq ans. Je l'avais reçu en août 2018 - il y a deux ans d'attente pour ma consultation. En fin d'année, alors que des résultats commençaient à apparaître, de nouveau hospitalisé, las d'être incompris, traité d'hystérique, il a mis fin à ses jours.
Tout n'est pas une maladie de Lyme, on parle de microbiote intestinal, plus large. Mais Lyme et les autres maladies vectorielles à tiques posent un vrai problème. L'étude conduite par Mme Vayssier-Taussat et le service de bactériologie de Marseille n'a pas eu de suites. Pourquoi ? D'autres recherches ont été menées, sur Borrelia miyamotoi par exemple, mais il y a très peu de publications sur les maladies vectorielles sur lesquelles s'appuyer.
Docteur Pierre Tattevin, président de la société de pathologie infectieuse de langue française (Spilf). - Je parle au nom de la société de pathologie infectieuse qui avait coordonné les recommandations de 2006, mais aussi des 25 sociétés savantes engagées dans ce travail, car la maladie de Lyme touche beaucoup d'organes : il y avait donc les dermatologues, les rhumatologues, la médecine générale, etc. Les recommandations ont donné des repères aux médecins : c'est une bonne chose, dans ces difficiles parcours. Aujourd'hui, la prise en charge médicale est devenue beaucoup plus compliquée en raison du « bruit », des polémiques et affrontements : les patients ne savent plus que penser.
Dans les établissements, par exemple le CHU où je travaille, les patients qui demandent une consultation pour une suspicion de Lyme sont adressés à des praticiens expérimentés, capables de traiter des dossiers complexes et à même de rassurer les patients, et l'on prévoit un rendez-vous long. L'idée du centre de référence vient de là, car un centre dédié, multidisciplinaire est nécessaire. Comme nous y invitent trois études récentes, lorsque des patients sont accueillis pour des symptômes de Lyme, il convient de faire le tri, afin d'établir le bon diagnostic et prescrire le bon traitement.
Lorsque le texte final du groupe de travail a été présenté, toutes les sociétés savantes - et pas uniquement les infectiologues - ont considéré qu'il ne répondait pas aux besoins : trop long, trop compliqué. Et sur 400 pages (du jamais vu !) il était mentionné seulement à la page 396 que les membres du groupe n'étaient pas d'accord avec les recommandations. Après quelques mois difficiles, Jérôme Salomon a donc confié à la Spilf la mission de coordonner l'élaboration de nouvelles recommandations, tenant compte des besoins des patients et des médecins. Nous avons travaillé avec les 25 sociétés savantes, et avec des patients - maintenus anonymes, pour leur éviter les cartes postales d'insultes que nous adressaient les associations, avec lesquelles il est difficile de travailler.
Nous avons bien avancé et avons pu adopter en réunion plénière des recommandations qui seront très prochainement disponibles. Nous avons voulu retravailler avec la HAS, mais cela n'a pas été possible : finalement, nos recommandations ne seront pas reconnues par elle, pour des raisons de méthodologie et parce que la Haute Autorité a préféré s'en tenir à son texte. C'est un problème, pour les patients, et cela ne va pas calmer la polémique, mais les choses sont éclaircies pour les sociétés savantes, pour la clinique, les traitements - identiques à ceux qui sont en cours dans les autres pays... Les Américains parviennent aux mêmes résultats. Il est dommage que la HAS ne soit pas à nos côtés ; mais les données, la science, les études cliniques sur les traitements confortent notre position.
S'agissant des associations de patients, on voit bien dans le film Cent-vingt battements par minute combien, dans les débuts de la recherche sur le sida, les relations étaient compliquées entre les sociétés savantes et les associations ; puis les traitements ont été découverts, se sont affinés, et les relations se sont apaisées. Il en ira de même ici. La réticence à l'égard des vaccins n'a rien arrangé, mais la ministre a pris l'an dernier une position claire et ferme et depuis, la couverture vaccinale des enfants s'est améliorée. L'intérêt des politiques est important. La recherche doit progresser, les centres de référence faciliteront le suivi et des fonds seront débloqués pour la recherche fondamentale, notamment confiée à l'Institut national de la recherche agronomique (Inra). Nous sommes dans une phase un peu difficile, mais cela va aller mieux !
Je suis chercheur, parasitologue et entomologiste animale et vétérinaire. Je travaille donc sur le vecteur, c'est-à-dire sur la tique. Les tiques sont capables de transmettre de nombreux agents pathogènes, virus, bactéries, parasites. Ce sont des vecteurs, non des seringues ; et parmi les nombreuses espèces de tiques, toutes ne transmettent pas la bactérie responsable de la maladie de Lyme. En France ce sont les tiques de l'espèce Ixodes ricinus qui sont en cause. Toutes ne sont pas infectées par un agent pathogène. La bactérie responsable de la maladie montre une prévalence d'infection - chez Ixodes ricinus, dans les différentes régions de France - située entre 0 % et 20 % des tiques infectées. Une tique infectée ne transmet pas forcément l'agent pathogène. Quand il y a transmission, cela se fait avec un délai - contrairement à ce qui se produit avec un virus - d'où la recommandation de retirer les tiques rapidement. Précisons également que nous avons un système immunitaire efficace ; et que la transmission d'un agent pathogène ne se traduit pas forcément par le développement de la maladie correspondante chez l'homme ou chez l'animal. Selon une étude récente conduite aux Pays-Bas, une personne piquée par une tique infectée qui n'est pas retirée avant la fin de son repas sanguin a 14 % de risque d'être atteinte par la maladie.
Il n'en reste pas moins que la tique est en Europe le premier vecteur d'agents pathogènes pour la santé humaine et animale, car ses repas sanguins sont très longs, parfois plus de dix jours pour certaines espèces, et ces repas sont très volumineux, ce qui augmente la possibilité d'acquisition et de transmission. En outre la tique peut se nourrir sur de nombreuses espèces, ce qui favorise les maladies zoonotiques. Les tiques se dispersent peu mais sur leurs hôtes - oiseaux, grands mammifères - elles peuvent parcourir de grandes distances. Une espèce présente en Corse, mieloma marginalus, est maintenant arrivée dans le sud de la France - elle transmet le virus hémorragique de Crimée-Congo. On en a relevé trois cas dont un mortel en Espagne.
À Maisons-Alfort, le laboratoire commun à l'Inra, l'Anses et l'École vétérinaire travaille sur l'épidémiologie des tiques et sur des agents pathogènes qu'elles transmettent. Des études sont menées sur le terrain pour évaluer la densité des populations de tiques et les agents pathogènes qu'elles portent. Un suivi de huit années sur la forêt de Sénart n'a pas révélé d'évolution de la densité, et les variations météorologiques ne sont pas le facteur principal - l'évolution de la population dépend surtout de la présence de populations d'hôtes. Nos travaux sont à la fois fondamentaux et appliqués, visant à développer de nouvelles méthodes de lutte contre les tiques. L'intérêt de cibler le vecteur, plutôt que l'agent pathogène, est de lutter contre tous les agents pathogènes en même temps.
Nous étudions le microbiote des tiques : le cibler permettrait d'agir à la fois sur la viabilité des tiques et sur leur capacité à transmettre des agents pathogènes. Nous cherchons également à identifier les molécules indispensables au gorgement ou à la transmission, pour bloquer l'un ou l'autre de ces mécanismes, par des stratégies vaccinales ou par de nouveaux acarides plus acceptables pour l'environnement que ce qui existe actuellement.
Je coordonne le projet « Visions », qui vise à évaluer l'efficacité vaccinale de certaines molécules sur le gorgement ou la transmission d'agents bactériens - les résultats seront publiés l'an prochain ; et l'Inra, la Cirade et le CNRS ont ensemble répondu à l'appel à projets de l'ANR : nous nous proposons de chercher à identifier les molécules impliquées dans le gorgement et la transmission ; et de mettre en évidence les molécules qui permettraient d'évaluer l'exposition des personnes aux tiques, ou des antécédents de piqûre de tiques.
Professeur Olivier Lesens, chef du service des maladies infectieuses du CHU de Clermont-Ferrand. - Sommes-nous au Sénat pour discuter d'un problème de médecine ? Non, nous sommes ici parce que le sujet est devenu un problème de société. Il est normal qu'il y ait des désaccords entre professionnels, c'est ainsi que la médecine progresse, grâce aux études. Nous pratiquons une médecine basée sur des preuves, elle exige des études, souvent plusieurs pour parvenir à des conclusions solides - mais c'est le meilleur moyen de parvenir à des conclusions non erronées.
Pour la maladie de Lyme, des hypothèses sont présentées comme des faits avérés, sans confirmation par des études : c'est cela qui pose problème. La preuve est remplacée par le témoignage de médecins qui relatent des expériences, ce qui nous ramène loin en arrière, lorsque l'expérience seule fondait les conclusions médicales. J'ajoute que les témoignages, dans les médias, sont souvent issus d'organisations militantes. Un discours qui n'est pas exempt d'un certain complotisme se développe : « Cette maladie qu'on vous cache » a titré Le Nouvel Observateur... Ce discours est à la fois anti-establishment, anti-médecine, anti-science, anti-sociétés savantes... C'est l'avènement d'une médecine que je qualifierais presque de populiste. En ce sens la question devient un problème de société. Et nous demeurons démunis, nous, les médecins qui travaillons chaque jour sur ces pathologies, pour répondre aux attaques médiatiques.
Il est nécessaire de clarifier les termes du débat et d'instiller un peu de transparence. On a d'abord parlé de maladie de Lyme, puis de co-infection d'autres bactéries transmises par les tiques, puis de crypto-infections qui déboucheraient sur un syndrome persistant polymorphe après une possible piqûre de tique - tout un programme ! - puis d'autres pathologies encore. On nous dit que la maladie de Lyme serait à l'origine de la sclérose latérale amyotrophique, ou de l'autisme : ce sont des affirmations graves... Nous demandons donc une transparence sur les examens réalisés - beaucoup le sont dans des cliniques vétérinaires, ce qui est scandaleux - et sur leurs interprétations, comme sur les protocoles thérapeutiques appliqués, qui utilisent de très nombreuses molécules, des dizaines, anti-infectieuses ou non, pendant des mois ou des années, parfois en mettant en jeu la vie des patients. Des traitements par voie veineuse emploient des antibiotiques de dernière génération qui ne sont pas validés. La revue Emerging infectious diseases rapporte des cas de décès à la suite de traitements par voie veineuse. La science a produit des études valables en toute transparence. Que ceux qui ont une opinion différente - je la respecte - fassent la transparence sur leurs protocoles. Il n'est pas compliqué de publier une série ! On ne peut se contenter d'affirmer que « 80 % des patients sont guéris », surtout quand les patients témoignent de rechutes successives, demandent une prise en charge d'affection longue durée, ne guérissent jamais, voire se suicident.
Les centres de référence peuvent apporter un progrès. Il est possible de mener une recherche scientifique sur tous ces cas, qui relèvent pour certains de la maladie de Lyme, pour d'autres sans doute de la médecine interne.

Professeur Hansmann, le respect que j'ai pour votre profession et le fait que vous vous soyez déplacé jusqu'ici m'obligent à vous donner quelques instants la parole.
Professeur Yves Hansmann, spécialiste des pathologies infectieuses et tropicales au CHU de Strasbourg. - Je m'inscris en faux contre ce qui a été dit sur les publications scientifiques. Il n'y a pas de débat scientifique, mais une polémique sociétale. Dans un débat scientifique, on oppose des idées, issues des publications scientifiques, c'est-à-dire des travaux reposant sur une méthodologie ; la méthode scientifique est garante du sérieux des conclusions.
S'agissant des recommandations de la HAS, son argumentaire reprend plus de 500 publications scientifiques réalisées sur la maladie de Lyme, grâce à quoi ces recommandations ont été soutenues pour leur plus grande part - sauf sur le SPPT, c'est pourquoi elles ne disent rien sur ce syndrome.
Nous avons tous une expérience importante, nous traitons beaucoup de patients atteints de la maladie de Lyme, et nous en voyons beaucoup qui évoluent très bien avec le traitement, y compris à distance ; ils ne sont pas en souffrance. Certains sont en grande souffrance, mais aucun test ne confirme un diagnostic de maladie de Lyme. Quel intérêt y a-t-il à leur faire croire qu'ils sont atteints par la maladie de Lyme ? Nous appliquons quant à nous une médecine moderne, qui consiste à établir un diagnostic le plus précis possible et, lorsque l'on n'y parvient pas, à proposer une prise en charge la plus adaptée.
Il n'est pas aisé de comprendre les débats de spécialistes, mais si l'on s'intéresse à ce problème, il faut aller à la source des informations, aux publications scientifiques. Ce sont elles qui fondent nos arguments et notre positionnement.

Merci au président Milon d'avoir accepté l'organisation de ces tables rondes, sur un sujet de société plus que de santé publique. Les patients, les associations nous interpellent, et nous ne savons que leur répondre. La polémique est sans doute propice à certaines divagations... Merci à tous, par conséquent, de vos interventions sincères et franches. Nous sommes sensibles aux difficultés de certains malades, et si nous pouvions favoriser de meilleures relations entre les sociétés savantes, les différentes professions et tous ceux qui s'intéressent à la maladie, si nous pouvions contribuer à une meilleure compréhension de la maladie, nous en serions satisfaits.
Je voudrais évoquer une thérapie qui peut actuellement être utilisée dans certains cas. Une association américaine, Ilads, plaide pour une reconnaissance d'une forme chronique de la maladie de Lyme, et prétend qu'il est scientifiquement démontré que la Borrelia peut demeurer dans les tissus même après le traitement antibiotique, et peut développer un film qui la rend résistante aux antibiotiques. Qu'en pensez-vous ?
Quels risques comportent les traitements prolongés, pour le patient, pour la santé publique ? Existe-t-il un risque d'antibiorésistance face à la maladie de Lyme?
Enfin, les traitements antibiotiques de long terme, comme le séquentiel, qui alterne les molécules, ont-ils un intérêt pour traiter la maladie de Lyme, même en l'absence de sérologie positive ? Enfin, y a-t-il des solutions thérapeutiques qui, sans être référencées dans les recommandations de la HAS, sont expérimentées par les médecins qui s'occupent de cette maladie ? Lesquelles mériteraient de faire l'objet d'études scientifiques sérieuses ?
Docteur Christian Perronne. - Les recommandations de cette société américaine, Ilads, composée de médecins qui soignent depuis longtemps la maladie de Lyme, ne sont pas d'une grande qualité scientifique, faute de crédits de recherche. Mais des centaines de milliers de personnes ont été sauvées grâce à son action, et ces recommandations ont été longtemps les seules officielles car Donald Trump a, pour des raisons budgétaires, supprimé le site qui hébergeait toutes les recommandations, concernant toutes les pathologies. Les recommandations de la société américaine des maladies infectieuses, auxquelles se sont référés mes collègues tout à l'heure, n'ont plus cours aux États-Unis, seules demeurent les recommandations Ilads.
Sur le risque d'antibiorésistance, poser des cathéters pour administrer des antibiotiques durant des mois est un non-sens dans la maladie de Lyme. On a dénombré douze cas de décès en vingt ans. Et ce ne sont certainement pas les antibiotiques qui tuent, ils ont sauvé des millions de patients atteints de cette affection !
Beaucoup de traitements ne sont pas validés aujourd'hui. Selon les recommandations de la HAS, le médecin généraliste doit proposer un traitement antibiotique pendant un mois. Toute prolongation d'antibiothérapie au-delà de 28 jours devra être documentée, dans le cadre de protocoles de recherche définis en lien avec un centre de référence. Toutes les étapes doivent être enregistrées dans des bases de données. Le terme « recherche » dans le texte de la HAS, ne signifiait pas étude randomisée en double aveugle mais suivi des cohortes de patients. Je suis un ardent défenseur de la médecine basée sur les preuves mais on a oublié qu'elle repose sur un trépied : les données publiées dans les grands journaux scientifiques, l'expérience du médecin et l'avis du malade quand on lui expose toutes ces données. Or, comme le reconnaissent tous les spécialistes, dans de nombreux domaines de la médecine, les données scientifiques publiées ne sont pas bonnes ou sont insuffisantes, pour des raisons diverses. L'expérience du médecin et l'avis du malade sont donc irremplaçables.
Sur les co-infections, les craintes selon lesquelles la maladie de Lyme provoquerait d'autres maladies, ne sont pas fondées. On n'a jamais dit que la maladie de Lyme était la cause de toutes les maladies de la terre...
Il faut cesser de critiquer les laboratoires vétérinaires. Lorsque Muriel Vayssier-Taussat a réalisé ses études sur les bartonnelles, elle a utilisé des technologies vétérinaires qu'elle a appliquées aux humains. Elle avait d'ailleurs demandé l'aide de Didier Raoult pour confirmer ces résultats sur l'homme. En effet, on utilise exactement les mêmes techniques pour les hommes ou les singes. Je ne comprends pas qu'on attaque les laboratoires vétérinaires alors que l'OMS prône l'initiative « One health », « une seule santé ». Les animaux partagent le même environnement que les hommes, y compris l'environnement microbien ; il est donc pertinent de mener une politique globale. Je souhaite que les vétérinaires et les entomologistes soient complètement associés à la recherche. C'est d'ailleurs ce que commence à faire l'Inra.
Enfin, je n'ai jamais eu le sentiment que le ministère avait chargé la Spilf de faire des recommandations ! J'ai plutôt eu les échos inverses... La présidente de la HAS a d'ailleurs dit qu'elle ne validerait pas ces recommandations qu'elle qualifiait de recommandations de sociétés savantes non basée sur les preuves.
Docteur Raouf Ghozzi. - La Borrelia a une croissance lente. Le traitement séquentiel, ce qui est un peu atypique dans le cas des maladies infectieuses, consiste à administrer un traitement de 10 jours, 14 jours, voire un peu plus, avec des coupures pour préserver le microbiote intestinal. Mais ces traitements n'éradiquent pas toujours la maladie.
Une étude de 2004 montrait que des patients atteints de la maladie de Lyme, avec une sérologie positive, qui avaient été traités par antibiotiques, avaient une persistance des symptômes. Après traitement au Fluconazole, un antifongique, pendant 21 jours, quasiment tous les patients ont bien répondu au traitement, sans récidive pendant un an. Le professeur Zhang de l'hôpital Johns Hopkins de Baltimore explique aussi qu'in vitro le Fluconazole, a une action sur Borrelia. Donc il y a une corrélation entre l'étude empirique et le constat in vitro. C'est une piste à creuser mais ça ne cautionne pas forcément l'utilisation de toutes les molécules
Certains praticiens préconisent l'utilisation de dix antibiotiques ou de dix traitements en même temps. Nous ne sommes pas du tout d'accord avec cette méthode. On fait des choses beaucoup plus simples, c'est plus la monothérapie, voire de la bithérapie. Je suis d'accord avec M. Lesens, il faudrait cadrer les choses et mettre en place des protocoles fondés sur des corrélations.
Lorsqu'une personne est piquée par une tique, le corps se défend grâce au système immunocompétent. En Alsace, la séroprévalence est de parfois de 20 %, mais les patients sont asymptomatiques. Des études chez les forestiers de l'ONF ont révélé une séroprévalence de 14 %, sans symptômes. En fait on se rend compte, et j'ai quelques exemples très concrets, que parfois le stress ou le burn-out peut affaiblir le système immunitaire et favoriser la réactivation de la Borrelia, alors que la personne était asymptomatique. Des études sont en cours pour comprendre le mécanisme au niveau lymphocytaire. Peu d'études ont été réalisées sur ce sujet. M. Gascan, que vous avez auditionné la semaine dernière, a bien montré que les souris, co-infectées à la Borrelia et à la grippe, ne produisaient pas les anticorps contre la grippe, parce que la Borrelia agissait au niveau des centres germinatifs, sur les lymphocytes B. Un état d'immunodépression peut donc être provoqué par la Borrelia.
Enfin, monsieur Hansmann, quand je disais que l'on manquait beaucoup de publications, je ne visais pas la maladie de Lyme, mais des études sur les co-infections, ou sur des agents co-infectants, tels que la Bartonella ou la Babesia.
Certains patients contaminés par la Borrelia vont présenter un syndrome persistant après la piqûre de tiques, pour des raisons génétiques ou des raisons liées aux souches. Mais 80 % des patients auront une bonne réponse immunologique après un traitement antibiotique court.
Docteur Pierre Tattevin. - Les États-Unis sont dans la même situation que nous. Ils disposaient de recommandations qui, avec la polémique, ont été finalement retirées. Leurs nouvelles recommandations seront bientôt publiées.
La plupart des scientifiques dans le monde considèrent qu'il n'y a pas de preuve du caractère chronique de la maladie de Lyme. Des études de grande qualité, sur des centaines de patients, ont été réalisées pour déterminer si la prise, pendant une longue durée, de différents antibiotiques apportait un bénéfice aux patients, avec les hypothèses de crypto-infection ou d'action sur les bactéries en phase de dormance. Elles montrent que des patients qui conservent des symptômes après un premier traitement n'ont pas d'intérêt à reprendre un traitement antibiotique. Ces études ont inspiré les recommandations dans tous les pays ; ceux qui vont se faire soigner en Allemagne vont dans des cliniques parallèles privées mais les recommandations allemandes sont les mêmes que les chez nous.
La consommation massive d'antibiotiques est une catastrophe annoncée : on voit parfois des ordonnances avec six ou sept antibiotiques prescrits pendant plusieurs mois... Le risque en utilisant à tort et à travers les antibiotiques est l'apparition d'antibiorésistances. Il deviendra impossible de traiter les otites des enfants, les infections urinaires, etc.
En matière de recherche, je crois que le plus important est de suivre des cohortes de patients, comme l'ont fait les collègues de Nancy ou de Besançon que vous avez entendus la semaine dernière, pour déterminer le mode de prise en charge le plus bénéfique aux patients, car, vous l'avez compris, nous ne sommes pas tous d'accord sur la façon de procéder. Les patients ont souvent des tests négatifs, des symptômes que l'on peut rencontrer dans de nombreuses maladies - ils sont fatigués, ils ont des douleurs, ils n'ont pas le moral - et ils n'ont pas répondu au traitement de la maladie de Lyme : c'est qu'il ne s'agit donc pas, la plupart du temps, de maladies de Lyme.
Sur les tests vétérinaires, vous auditionnerez l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). On ne remet pas en cause les laboratoires vétérinaires, mais il faut que l'on ait la certitude que les tests que l'on prescrit aux patients soient fiables. La Spilf a bien été mandatée par la direction générale de la santé pour faire des recommandations, comme le prouve la lettre du directeur général de la santé du mois de septembre que j'ai avec moi. M. Péronne a parlé des recommandations de la Spilf : j'insiste, il s'agit des recommandations des sociétés françaises de neurologie, de rhumatologie, de dermatologie, de médecine interne, de médecine générale, de pédiatrie, de microbiologie, etc. On peut toujours les critiquer, mais cela revient à dire que toute la médecine française ne sait pas travailler ! Nos conclusions sont les mêmes qu'en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre ou aux États-Unis. Elles sont scientifiques. On a le droit d'avoir d'autres opinions mais il faut les démontrer !
Je ne suis pas médecin. Je préciserai juste que les travaux de l'Inra sur les bartonnelles n'ont pas été réalisés dans un laboratoire vétérinaire de diagnostic mais dans un laboratoire de recherche, en collaboration avec la faculté de médecine de Marseille. En ce qui concerne les travaux sur les pourcentages d'organismes inconnus découverts dans les tiques (virus, parasites, bactéries), il ne faut pas confondre la découverte de morceaux de génomes inconnus et la découverte d'organismes inconnus. Les petits morceaux d'ADN détectés peuvent potentiellement appartenir au même organisme. En effet, on ne connaît pas le génome de tous ces organismes, il est donc normal de trouver des morceaux de génomes inconnus. En outre, lorsque l'on détecte un organisme dans une tique, cela ne signifie pas nécessairement que la tique sera capable de transmettre cet organisme.
En ce qui concerne l'étude que je mentionnais, selon laquelle on a 14 % de chances de contracter une maladie après une piqûre de tique infectée, je précise que ce pourcentage tient compte de la réponse du système immunitaire et du pourcentage de risque de transmission de la tique à l'individu.
Professeur Olivier Lesens. - Les International League of Dermatological Societies (ILDS) ont publié des recommandations, mais elles sont difficilement compréhensibles. Finalement, on conseille aux médecins de commencer par une antibiothérapie assez prolongée, puis d'aviser en fonction de l'expérience du médecin, en prescrivant éventuellement des traitements séquentiels. Quant à la durée, elle dépend de la réponse du patient. Je n'appelle pas cela un protocole thérapeutique...
Qui prescrit ces antibiothérapies séquentielles de longue durée ? Il faut parler des Lyme doctors qui sont des médecins généralistes. J'ai regardé qui avait signé la pétition du Nouvel Observateur : 80 % sont des homéopathes qui ont dans leur cabinet un certificat, portant la signature de Christian Perronne ou de M. Montagnier, qui les autorise à prescrire les examens et les traitements prolongés de la maladie de Lyme.
Professeur Christian Perronne. - Il s'agit d'un cas !
Professeur Olivier Lesens. - On connaît des cas similaires dans toutes les villes ! Les antibiothérapies donnent manifestement lieu à des dérives car elles sont données comme traitement à de nombreuses pathologies. C'est un mésusage de traitements qui risque d'accroître encore les risques d'antibiorésistance. Tout cela doit donc être encadré.
Des cas de traitements par voie veineuse, malheureusement, existent. Il faut les condamner, car ils sont dangereux pour les patients.
Professeur Yves Hansmann. - Certains propos qui viennent d'être tenus sont très éloignés de la démarche scientifique. On se base sur des hypothèses ou des théories, qui sont sans doute très intéressantes intellectuellement et qui méritent qu'on les examine, mais on en tire des déductions qui ne sont étayées par aucune étude. On fait des comparaisons avec la grippe ou la tuberculose, mais on ne sait pas si la maladie de Lyme est identique. Comment tirer des conclusions rigoureuses et scientifiques sur cette base ?
Il est exceptionnel de retrouver la présence de la Borrelia après un traitement. Il y a peu de comparaison possible entre l'homme et le singe. De plus, dans les études sur le singe, il n'est pas précisé si les Borrelia retrouvées étaient vivantes, ni si elles ont provoqué des symptômes particuliers. De même, on ne sait pas si un lien de cause à effet a été établi entre la présence de la bactérie et des symptômes cliniques. Pour ces raisons, on ne peut pas titrer d'interprétation des données qui ont été publiées. Quant à la présence d'un biofilm, elle a été prouvée in vitro, non chez les patients mais en laboratoire. Or beaucoup de bactéries ont des comportements différents en laboratoire et dans les êtres vivants parce que les conditions ne sont pas les mêmes.
Le PTLDS et le SPPT ne sont pas très bien définis. Il est difficile de les distinguer et les indications de la HAS ne sont pas très claires. Quant aux études sur les co-infections, il en existe plusieurs ! L'analyse de la littérature ne doit pas viser à trouver uniquement les articles qui confortent l'idée que l'on a. À Strasbourg, nous avons publié sur Babesia, sur Anaplasma, sur Borellia, sur Bartonnella, sur les encéphalites à tiques. Réduire les publications à ce qui nous intéresse est la meilleure manière de se tromper !
Docteur Raouf Ghozzi. - Je ne visais que les publications sur la Babesia, non les autres co-infections.

La Food and Drug Administration (FDA) vient d'autoriser la poursuite des tests cliniques de phase 2 d'un vaccin mis au point par Valneva, société franco-autrichienne. Pensez-vous que la mise au point d'un vaccin contre la maladie de Lyme constitue une piste sérieuse ? L'industrie pharmaceutique s'intéresse-t-elle à cette maladie ?
Les médecins qui proposent une prise en charge qui s'écarte du consensus de 2006 ou des recommandations de la HAS s'exposent-ils à des risques de poursuites ou de radiation de l'ordre des médecins ?
La maladie de Lyme devrait-elle être reconnue comme une affection de longue durée (ALD) par l'assurance maladie en cas de formes chroniques ou persistantes ? Enfin, est-il vrai que la maladie peut engendrer des incapacités à long terme , si elle n'est pas diagnostiquée ou prise en charge dans les six premiers mois ?

Comment arriver à identifier la maladie de Lyme face à un patient qui n'a pas le souvenir d'avoir été piqué par une tique et qui présente des signes cliniques polymorphes, très courants dans d'autres pathologies difficiles à identifier comme la fibromyalgie ? Constate-t-on des lésions spécifiques en anapathologie : a-t-on découvert, par des prélèvements synoviaux, des granulomes ou des lésions caractéristiques ? Peut-on faire un rapprochement entre la syphilis tertiaire et la phase tardive du SPPT ? Enfin, je voudrais savoir si des études ont été réalisées pour évaluer les dégâts dus à certains traitements abusifs appliqués par certains Lyme doctors ?

Merci pour toutes vos explications. Il semble très difficile de diagnostiquer la maladie et les avis divergent sur les traitements. La détresse des patients est importante et peut conduire malheureusement au suicide. Pour éviter l'errance de ces patients, que pourriez-vous leur recommander ? La HAS est favorable à la création de centres spécialisés pour éviter l'errance des patients et permettre une prise en charge personnalisée avec des équipes expérimentées. Qu'en pensez-vous ?

Les traitements antibiotiques ont-ils la même efficacité contre toutes les souches de bactéries responsables de la borréliose ? Il semble que 80 % des patients traités par antibiotiques n'ont pas de rechute. Existe-t-il une littérature scientifique et médicale solide qui plaide pour des traitements antibiotiques et confirme l'absence de la chronicité de la maladie de Lyme ? Les centres dédiés à la maladie de Lyme proposant des consultations pluridisciplinaires se multiplient ; il en existe au moins trois dans la région Grand Est et un vient de s'ouvrir au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges. Quel bilan dressez-vous de ces initiatives ? Est-il opportun de généraliser ces centres pluridisciplinaires sur le territoire ? On ne sait pas toujours si les patients sont bien atteints de de la maladie de Lyme. Cette maladie est-elle plus patient-dépendante que d'autres maladies provoquées par d'autres agents pathogènes ? Enfin, l'un d'entre vous a évoqué l'intérêt du Fluconazole. La HAS envisage-t-elle de l'intégrer dans ses recommandations ?
Professeur Christian Perronne. - On note le retour de l'industrie pharmaceutique. Le gouvernement américain a tapé du poing sur la table en mettant de côté la société américaine de maladies infectieuses car ses recommandations n'étaient pas basées sur les preuves, comme l'ont montré des experts indépendants et la justice américaine. La maladie de Lyme cesse d'être un sujet tabou et intéresse à nouveau l'industrie pharmaceutique. Le gouvernement américain a mis 300 millions de dollars sur la table, c'est la première fois depuis 30 ans. Plusieurs laboratoires aux États-Unis, comme Abbott, veulent développer de nouveaux tests de diagnostic.
Je suis plus pessimiste pour les antibiotiques : peu de nouvelles molécules sont lancées malheureusement. Les poursuites contre les médecins généralistes restent assez rares mais elles existent toujours. S'il est vrai que certains médecins sont déviants, qui inscrivent de nombreux antibiotiques sur l'ordonnance, pratique que je condamne, la majorité des médecins sont excellents. Il n'est pas juste qu'ils soient traînés dans la boue alors qu'ils ont sauvé des vies. J'ai connu un médecin qui avait guéri des gens paralysés qui étaient en hôpital psychiatrique.
La reconnaissance comme ALD a été évoquée lors de la discussion à la HAS. Elle me semble légitime pour les formes les plus graves. Beaucoup de formes de la maladie sont bénignes : certains patients guérissent tout seuls, d'autres guérissent après trois semaines d'antibiotiques. Mais les incapacités à long terme peuvent être énormes : certaines personnes n'ont pas pu travailler pendant des années, toutefois quand elles retournent au travail, elles sont guéries.
On n'a plus le droit de dire qu'il faut absolument avoir été piqué par une tique pour développer une maladie à tiques. Trois fois sur quatre, une personne qui a une maladie à tiques avérée n'a pas le souvenir d'avoir été piquée car les larves qui mesurent deux ou trois millimètres sont contaminantes. Si elles vous piquent dans les cheveux, dans le dos, dans un pli, vous ne les voyez pas et vous êtes contaminé.
La comparaison avec la syphilis est pertinente. On appelle la maladie de Lyme « la grande simulatrice », comme on appelait la syphilis. Quand j'étais interne, toute personne arrivant à l'hôpital avec un corps au pied ou n'importe quel bobo était soumis à un test de dépistage de la syphilis parce cette maladie était très fréquente. La différence avec la maladie de Lyme, c'est que le test était fiable.
Je n'ai jamais vu les dégâts des traitements abusifs, à l'exception de ces 12 morts en 20 ans dans le monde entier à la suite de traitements par voie veineuse centrale que je condamne sans ambiguïté.
Les centres de référence et les consultations multidisciplinaires fleurissent en France. Pour les malades, ces consultations constituent un vrai scandale. Demandez aux associations de malades ! Soit on leur dit : « vous n'avez pas la maladie de Lyme, vous êtes fous, allez en psychiatrie ! », soit on les traite pendant trois semaines et on considère qu'ils sont guéris alors qu'ils sont encore malades. Au final, on récupère tous ces malades. On ne peut pas continuer comme ça.
Je peux citer 14 références dans la littérature scientifique qui prouvent la persistance de la bactérie après les traitements. Cessons de faire comme si cela n'existait pas.
Le Fluconazole a été testé sur de petites séries. On ne peut donc pas dire que c'est un traitement efficace pour tout le monde. Il faut mener des études plus approfondies.
Dans l'esprit de la Haute Autorité de santé, un centre de référence doit enregistrer tout ce que font les médecins pour pouvoir procéder à des évaluations, voir si les malades sont guéris, au bout de quel délai, etc. L'essentiel est de s'inscrire dans une démarche scientifique et rationnelle.
Docteur Raouf Ghozzi. - Le vaccin de Valneva semble prometteur mais il est encore trop tôt pour se prononcer. Il ne protégera que contre la Borrelia.
Sur l'ALD, je me suis rendu à la Cnam, début mars, pour comprendre pourquoi certains protocoles étaient acceptés et d'autres refusés. On est sur du hors liste. Si tous les critères requis sont respectés, le médecin conseil doit accepter l'ALD. Mais, et c'est logique, celle-ci peut être remise en question au bout d'un certain délai, en fonction de l'évolution du patient.
Au Centre national de référence de Strasbourg, lorsque l'on a un doute après une évolution non favorable sous traitement antibiotique, y compris pour des lésions typiques comme les lymphocytomes on n'hésite pas à faire des prélèvements. L'histologie est souvent typique, voire compatible, ce qui permet d'asseoir le diagnostic.
On a découvert en France la présence chez la tique de Borrelia myamotoi, qui est classée parmi les souches de fièvres récurrentes, non de maladie de Lyme. Or, au vu du tableau clinique dressé par différentes publications internationales, il semblerait que cette Borrelia se classe un petit peu à part. Il ne faut donc pas tout ramener à la maladie de Lyme. Il existe peut-être des souches particulières.
Docteur Pierre Tattevin. - Un vaccin contre la maladie de Lyme avait été commercialisé il y a quelques années avant d'être retiré de la circulation à cause des effets indésirables. Il conviendra donc de dresser le rapport bénéfices-risques du nouveau vaccin. Sur l'antibiothérapie prolongée, nous manquons encore d'études qui prouvent que ce protocole est efficace. Pour l'instant, les données semblent indiquer que cela ne fonctionne pas.
Pour les affections de longue durée, on en revient au débat sur le caractère chronique de la maladie de Lyme. Il est vrai que les personnes qui ont été traitées trop tard, notamment pour des formes neurologiques, peuvent conserver des séquelles pendant longtemps et dans ces cas-là, il ne serait pas aberrant de prévoir des indemnisations ou des aménagements des postes de travail. Ces cas restent rares. Une étude réalisée au Danemark montre que les personnes traitées finissent par guérir, mais cela est d'autant plus long qu'elles ont été prises en charge tardivement.
Je rejoins Christian Perronne : la plupart du temps les patients ne se rappellent pas avoir été piqués. Il ne faut donc pas faire de la piqûre de tique un critère obligatoire des diagnostics de la maladie de Lyme.
Des études américaines, reposant sur des grosses bases de données, prouvent que les patients qui reçoivent des traitements alternatifs ont plus de chances d'être admis aux urgences dans les semaines qui suivent ! Une autre étude très importante, parue dans le Journal of the American Medical Association, illustrait les catastrophes dues aux erreurs de diagnostic. Trois patients atteints de lymphome ou de sclérose en plaques, avaient été maintenus pendant des mois dans le circuit des Lyme doctors qui changeaient les traitements, à mesure que la situation du patient s'aggravait jusqu'à ce qu'un autre médecin repose la question du diagnostic. Mais il était trop tard !
Le rapprochement avec la syphilis est intéressant. La bactérie provoquant la syphilis et la leptospirose sont les bactéries les plus proches de la Borrelia, que l'on peut rencontrer en France. Toutes les deux ne sélectionnent pas de résistance et la pénicilline est aussi efficace en 2019 qu'en 1940. Ensuite si ces maladies sont bien traitées, les bactéries meurent et la maladie ne dégénère pas sous une forme chronique. Cette comparaison devrait plutôt nous rassurer à l'égard de la maladie de Lyme.
Nous soutenons fortement les centres de références. Il est nécessaire de constituer des équipes organisées pour mieux prendre charge la borreliose de Lyme. Il importe que ces équipes soient pluridisciplinaires et non centrées autour des infectiologues afin de pouvoir orienter le patient vers la spécialité adaptée : la neurologie, la rhumatologie, les centres de traitement de la douleur, la médecine interne, etc. Je tiens aussi à saluer ce qui a été mis en place par les équipes de Nancy ou de Besançon et qui vous a été présenté la semaine dernière.
Je pense que toutes les maladies sont patient-dépendantes. Nous consacrons un chapitre entier à la manière d'aborder les consultations. Nous préconisons de passer la première partie de la consultation à écouter le patient décrire ses symptômes, raconter son parcours, afin de définir une réponse individualisée.
Professeur Olivier Lesens. - Je veux revenir sur les centres de référence. On a trop tendance à laisser les patients dans une situation d'errance médicale. Les centres de référence constituent l'occasion de replacer le patient dans un parcours de soins où il n'est pas vu que par un infectiologue. Les syndromes polymorphes sont vieux comme la médecine. On entend parler de fibromyalgie ou de fatigue chronique depuis des années. Ces pathologies ont des causes multiples. Il est donc bon de croiser les regards, entre infectiologue et internistes. Il n'y a pas non plus que les antibiotiques, il y a aussi la rééducation fonctionnelle. Je n'ai pas peur de dire qu'il m'arrive d'orienter des patients vers des médecines douces. Il convient de travailler en réseau et les pratiques doivent être évaluées. Je ne suis pas opposé à l'évaluation des traitements séquentiels dès lors qu'elles sont réalisées dans le cadre d'une étude sérieusement menée.
Professeur Yves Hansmann. - L'examen des lésions ne permet pas, à lui seul, d'identifier une borréliose de Lyme car cette maladie ne provoque pas des lésions caractéristiques en histologie. Seul un examen bactériologique pour découvrir l'agent infectieux responsable de la maladie permet de poser diagnostic avec certitude.
Un mot aussi sur les Lyme doctors. Christian Perronne a utilisé tout à l'heure le terme de « persécution », ce terme est choquant. En Alsace, les seuls médecins qui ont été radiés l'ont été à cause de dérives accompagnées d'erreurs de diagnostic. Je suis favorable aux centres de référence qui permettront de proposer les meilleurs traitements à leurs patients, y compris pour ceux qui ne sont pas atteints de la maladie de Lyme. Au service des maladies infectieuses et tropicales de Strasbourg, nous faisons une évaluation des patients qu'on voit en consultation. Beaucoup sont passés par les mains des Lyme doctors et n'ont pas été satisfaits. Plus de 95 % de nos patients se déclarent satisfaits de la consultation, selon une évaluation que nous avons réalisée et qui est publique. M. Péronne évoquait des milliers de témoignages. Où sont les publications. Pourquoi ces données ne sont-elles pas partagées ? Comment les patients sont-ils traités ? Je ne comprends toujours pas s'ils guérissent ou non...Si les patients guérissent pourquoi reviennent-ils régulièrement consulter ?
Professeur Christian Perronne. - J'ai publié des données sur 100 malades. Réaliser une grosse étude randomisée coûte plus d'un million d'euros, et je n'ai pas de sponsors. Je suis prêt à faire ce genre d'études, mais j'ai besoin de crédits.
Professeur Yves Hansmann. - Notre évaluation ne nous a rien coûté car nous avons demandé à nos étudiants en thèse de s'y consacrer. Je vous invite à relire la publication de 2009 de Juliette Clarissou dans Médecine et maladies infectieuses : vous verrez si le taux de réponse est bien de 80 % sur les signes neurologiques et articulaires...

Merci d'être venus et d'avoir essayé de nous éclairer.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.

Nous en venons maintenant à l'examen des amendements de séance sur la proposition de loi relative à l'interdiction de la vente des drapeaux des associations d'anciens combattants et à leur protection.
Article unique

L'amendement n° 1 désigne les musées comme de potentiels dépositaires et exposants des drapeaux d'associations d'anciens combattants. Avis défavorable car il est satisfait. Le texte de la commission laisse à la commune le soin d'apprécier le lieu mémoriel le plus adapté pour recueillir ces objets emblématiques.

Il existe toutes sortes de musées : publics, municipaux, voire privés. Cet amendement est donc très large. Mieux vaut laisser aux communes la charge de choisir le lieu approprié.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 1.
- Présidence de M. Alain Milon, président, puis de M. Gérard Dériot, vice-président -

Mes chers collègues, nous passons à l'examen du rapport d'information fait au nom de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (MECSS), dont je salue le président Jean-Noël Cardoux, par M. Bernard Bonne et Mme Michelle Meunier sur le financement de la dépendance.
Dès l'examen du rapport de notre collègue Bernard Bonne sur les Ehpad, en mars 2018, le président de la MECSS avait souhaité que des travaux soient conduits sur le financement des Ehpad et plus largement de la dépendance.
Comme notre collègue Jean-Noël Cardoux, je pense que les questions de financement, même si elles ne sont pas seules en cause, sont déterminantes alors que le projet de création d'un cinquième risque de la sécurité sociale a été mis à mal par la crise de 2008.
Ce point a donc été inscrit au programme de travail de la MECSS en même temps que le Gouvernement lançait une consultation sur le grand âge et l'autonomie pilotée par M. Dominique Libault qui a rendu ses conclusions la semaine dernière et que nous entendrons demain.
Nous verrons si la crise des gilets jaunes a laissé une place au financement de la dépendance.
Je laisse donc la parole à nos rapporteurs.

Monsieur le président, mes chers collègues, je suis très heureux de vous présenter, aux côtés de ma collègue Michelle Meunier, le fruit d'un travail passionnant et stimulant que nous avons mené ensemble sur le financement de la dépendance des personnes âgées.
Jeudi dernier, M. Dominique Libault, coordonnateur de la concertation sur le grand âge et l'autonomie a rendu ses conclusions à la ministre des solidarités et de la santé. Notre commission aura à cet égard l'occasion d'entendre M. Libault demain après-midi sur l'ensemble de ses préconisations.
Nous nous sommes entretenus à plusieurs reprises avec lui et il nous paraît important de préciser d'emblée que le rapport que nous vous présentons n'est pas concurrent, mais complémentaire de celui de M. Libault, qui propose une redéfinition systémique de l'accompagnement des personnes âgées. Il définit plusieurs objectifs que notre commission ne peut qu'approuver, pour les avoir déjà formulés et défendus dans un rapport de l'an dernier sur la crise des Ehpad :
- mettre l'autonomie de la personne âgée au coeur de la stratégie à venir ;
- améliorer les conditions de vie de la personne âgée par la revalorisation des métiers de l'accompagnement ;
- aider les proches aidants et lutter contre l'isolement de la personne âgée ;
- assurer une continuité de la prise en charge.
Notre approche a volontairement privilégié les aspects financiers de l'accompagnement de la dépendance. Ce choix s'explique pour deux raisons :
- d'une part, le mandat que nous avons reçu de la mission d'évaluation des comptes de la sécurité sociale de notre commission nous a naturellement aiguillés en priorité vers l'examen des dépenses couvertes par l'assurance maladie, qui demeure le premier financeur public de la dépendance ;
- d'autre part, les orientations de la mission Libault sur la question particulièrement délicate du financement de la dépendance dans les années à venir ne nous semblaient pas toujours prendre les directions les plus adéquates. Nous aurons l'occasion d'y revenir.

La concentration de notre travail sous l'angle financier nous a menés à privilégier la rencontre des principaux acteurs de la couverture du risque dépendance, parmi lesquels les fédérations d'assurances, de mutuelles et d'instituts de prévoyance, mais également d'économistes et d'acteurs indépendants du monde assurantiel qui nous ont aidés à faire mûrir notre réflexion sur ce sujet, dont les aspects stratégiques ne sont pas toujours pris en compte.
Dans le cadre de nos travaux, nous nous sommes également rendus en Allemagne et au Royaume-Uni, dont les modèles financiers de la prise en charge de la dépendance présentent de grandes différences par rapport au nôtre. Parmi les enseignements tirés de ces déplacements, nous voudrions vous en livrer principalement deux :
- premièrement - et c'est un trait qui semble caractériser la plupart des grandes économies du monde occidental - la mise en place d'un accompagnement financier de la dépendance se trouve être la grande oubliée des réformes sociales qui ont animé les législateurs d'après-guerre. Ce n'est qu'une fois le vieillissement de la population bien installé, et bien identifié comme problème structurant des décennies à venir, que les pouvoirs publics se sont, souvent dans l'urgence, attelés au sujet pourtant déterminant de son financement.
Conçus dans des périodes de restriction budgétaire, contraints par des budgets publics déjà largement engagés, ces schémas financiers, qui tiennent parfois plus du bricolage d'expédients que de la réforme systémique, se montrent rarement à la hauteur des enjeux en présence ;
- deuxièmement, bien que de nombreux acteurs se montrent légitimement prompts à dénoncer les carences de la France en matière d'accompagnement de la dépendance, l'examen des modèles allemand et britannique nous a utilement rappelé que nous n'avions nullement à rougir d'un modèle qui, actuellement, assure à nos personnes âgées l'une des couvertures dépendance les plus favorables d'Europe.
Nous ne nierons bien évidemment pas les grandes difficultés auxquelles sont confrontées les personnes âgées elles-mêmes, leurs familles et les personnels chargés de les accompagner. Pour autant, n'oublions pas que, même à leur égard, la qualité du modèle social français trouve à s'appliquer.

Ces postulats étant posés, nous vous présenterons à présent les principaux constats auxquels nous sommes parvenus. Tout part d'un vocable, désormais fort répandu, mais qui nécessite une définition très soigneuse : le reste à charge des personnes âgées dépendantes. À ce stade, deux points de méthode doivent être précisés :
- le reste à charge désigne logiquement la différence entre les dépenses effectivement mises à la charge des personnes âgées pour les frais résultant de leur dépendance et les dépenses couvertes par les pouvoirs publics, qui sont en la matière nombreux à intervenir. D'un point de vue strictement global, les statistiques montrent que pour un besoin général en frais de dépendance évalué à 30 milliards d'euros par an, les pouvoirs publics en couvrent environ 23 milliards. Le reste à charge global est donc estimé à environ 7 milliards d'euros par an, pour une population d'à peu près 1,2 million de personnes âgées dépendantes ;
- la politique publique de la dépendance ne présentant pas, à l'instar de la politique publique de la santé, de caractère intégré ou unifié, le reste à charge des personnes âgées dépendantes n'est qu'une donnée brute dont il convient de bien distinguer les composantes.
Il recouvre d'abord les dépenses non couvertes au titre des soins reçus par les personnes et très majoritairement financés par l'assurance maladie au titre des crédits de l'ONDAM médico-social que nous votons chaque année en loi de financement de la sécurité sociale. Ce « reste à charge soins » est relativement peu élevé.
Il recouvre ensuite les dépenses non couvertes au titre des aides à l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, qui constituent le coeur véritable - bien que non majoritaire en termes de masse financière - de la prise en charge de la dépendance. Ces dépenses sont en très grande partie assurées par les conseils départementaux via le versement de l'allocation personnalisée à l'autonomie (APA). Cette composante du reste à charge s'élève pour sa part à environ 3 milliards d'euros.
Il recouvre enfin les dépenses non couvertes au titre de l'hébergement des personnes âgées dont les ressources ne leur permettent pas d'assurer l'intégralité de leur accueil en Ehpad. Cette dimension-là du reste à charge, également financée par le conseil départemental mais selon une logique distincte de celle de l'APA, est celle qui pèse le plus lourd pour les ménages : 4 milliards d'euros.
Le reste à charge ne doit donc pas être abordé comme une donnée « en bloc ». Bien que le conseil départemental soit le principal financeur de l'ensemble des dépenses publiques donnant lieu à des besoins non couverts, son intervention auprès de la personne âgée revêt deux logiques fortement distinctes :
- au titre de la dépendance stricto sensu, il agit d'abord comme un acteur de la compensation du besoin. Son action ne dépend pas directement du niveau de ressources de la personne aidée, mais du degré d'autonomie ou de dépendance de cette dernière ;
- en revanche, lorsqu'il finance une aide à l'hébergement, il redevient acteur de solidarité et n'accorde d'aide que sous condition de ressources.
Cette distinction est fondamentale. Elle illustre la nature profondément composite de la politique publique de la dépendance. Elle guidera les propositions que nous vous soumettrons, qui s'efforceront d'apporter à chaque intervention de la puissance publique la réponse que commande sa logique intrinsèque.

Deux grandes séries de remarques s'imposent néanmoins avant d'en venir à nos préconisations.
Un reste à charge global de 7 milliards d'euros pour une population de 1,2 million de personnes donne un résultat moyen mensuel de 490 euros. Ce chiffre cache néanmoins de très importantes disparités entre les personnes suivies à leur domicile et les personnes accueillies en établissement : 80 euros par mois en moyenne pour les premières et près de 950 euros pour les secondes. Permettez-moi d'insister un moment sur ce dernier chiffre, dont on trouve quantité d'estimations différentes, souvent maximalistes : il s'agit du reste à charge mensuel moyen global d'un résident d'Ehpad après intervention de l'ensemble des financeurs publics. Bien que d'autres estimations plus élevées, privilégiant le reste à charge médian ou le reste à charge avant versement de l'aide à l'hébergement, soient abondamment diffusées au sein du grand public, nous préférons nous fonder sur ce chiffre qui nous paraît plus à même d'illustrer la réalité financière de la dépendance d'une personne âgée.
Cette profonde disparité entre le domicile et l'établissement n'est pas due, à notre sens, qu'aux frais mécaniquement plus élevés qu'engendre un accueil hôtelier en Ehpad. Elle trouve également sa source dans deux anomalies particulières, que nous préconisons de corriger au plus vite :
- les modalités différentes de calcul par le conseil départemental d'une APA à domicile et d'une APA en établissement. Dans le premier cas, les besoins particuliers de la personne sont précisément pris en compte, mais le taux de sa participation financière atteint rapidement des niveaux dissuasifs. Dans le second cas, le versement à l'Ehpad par le conseil départemental d'un forfait global à l'autonomie atténue certes la participation financière des personnes mais ne tient qu'imparfaitement compte des besoins exprimés par chacun ;
- en découle un phénomène que nos pouvoirs publics n'ont que peu identifié jusqu'à présent : le renoncement de la personne âgée suivie à domicile à une partie du plan APA auquel elle a pourtant droit sur la seule base de ses ressources financières. Ce phénomène n'est pas aisément quantifiable, mais il serait très intéressant de savoir la part effectivement consommée par les ménages des plans d'aide APA construits par les équipes médico-sociales des départements. Nous sommes persuadés que les résultats de cette enquête révèleraient d'importants taux de non-recours à l'APA à domicile pour motifs financiers.
L'autre grande remarque que nous voulions formuler a trait à la compétence du conseil départemental pour la politique publique de la dépendance, qui serait, selon certaines voix, à l'origine d'une hétérogénéité territoriale particulièrement dommageable. Souvenez-vous à cet égard des débats particulièrement houleux qui avaient émaillé le début d'année 2018, avec la parution d'un décret autorisant les présidents de conseils départementaux de verser les forfaits globaux dépendance aux Ehpad en fonction d'un « point GIR départemental ».
Force est néanmoins de constater que l'exercice par le département de la compétence dépendance ne s'est en réalité nullement traduit par un approfondissement des inégalités entre territoires. Nous avons diligenté une enquête fouillée auprès de l'ADF, qui nous a fait parvenir des résultats particulièrement représentatifs : la part des plans d'aide APA pris en charge par le département tourne autour d'une moyenne de 400 euros mensuels, dont très peu de départements s'éloignent significativement. La même conclusion s'impose pour la pratique des fameux « points GIR départementaux », tous concentrés autour d'une moyenne de 7 euros.
À nos yeux, le risque d'une couverture inégalitaire de la perte d'autonomie doit d'abord être imputé aux contraintes budgétaires qui s'exercent sur l'ensemble des départements et non sur une tendance naturelle qu'auraient ces derniers à s'écarter d'une épure globale. Nous sommes très conscients de la séduction qu'opèrent les solutions faciles qui envisagent la reprise de la compétence dépendance par l'échelon national : le totem récurrent de l'uniformité - parente nécessaire de l'efficacité - n'a jamais été autant brandi comme le remède miracle aux niveaux préoccupants de reste à charge.
Nous souhaitons inciter à la plus grande prudence en ce domaine. Outre qu'il traduirait, sur la base de postulats théoriques contestables, une grave erreur de diagnostic, le retrait au conseil départemental de la compétence en matière d'autonomie priverait les personnes âgées d'un acteur public de proximité, plus que jamais nécessaire.

Venons-en maintenant au financement proprement dit. Deux questions primordiales se poseront à nous dans les années à venir :
- les financements tels qu'actuellement définis sont-ils suffisants ?
- les modalités de versement des aides à la dépendance, principalement l'APA, sont-elles satisfaisantes ?
Si nous sommes parfaitement tombés d'accord pour répondre à ces deux questions par la négative, nous vous exposerons dans quelques instants la divergence de vues qui sépare nos préconisations quant au modèle futur à dessiner. Il ne faut rien y voir de plus que la marque distinctive du Sénat de poser des diagnostics sur des bases indiscutables, pour laisser ensuite s'exprimer l'ensemble des sensibilités.
La première question tout d'abord. Nous serons à cet égard à l'unisson : la trajectoire financière tracée par le rapport Libault ne nous paraît pas réaliste. Ce dernier affiche en effet la conviction que les financements publics dégagés par l'extinction de la dette sociale suffiront, dès 2024, à combler l'ensemble des besoins aujourd'hui exprimés par les personnes âgées dépendantes.
Notre désaccord avec cette hypothèse a deux raisons principales :
- s'il est tout à fait exact que le rendement annuel de la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS), soit environ 8 milliards d'euros, une fois libéré de sa destination actuelle, suffirait mathématiquement à couvrir le reste à charge global de 7 milliards que nous avons initialement identifié, il n'est absolument pas assuré que, d'une part l'intégralité de la dette sociale sera effectivement apurée en 2024, et d'autre part que son produit, fortement convoité, ira totalement au financement de la dépendance. C'est faire un pari dangereusement optimiste que de gager le financement d'une dépense aussi stratégique et pérenne que la dépendance sur une source financière dont la fin programmée a connu depuis sa création plus d'un prolongement ;
- par ailleurs, fonder la couverture du reste à charge sur le chiffre de 7 milliards d'euros nous ferait passer à côté de toute la partie non consommée des plans d'aide APA et ne ferait que maintenir entier le problème du renoncement à certaines aides des personnes âgées dépendantes suivies à domicile. Disons-le tout net : la solution préconisée par le rapport Libault, conçue dans les limites de finances publiques largement amputées, n'impacterait en réalité que les résidents d'Ehpad, qui seuls alimentent les statistiques du reste à charge effectif.
Si nous nous contentons de raisonner à partir du reste à charge observé, nous occultons le véritable problème, autour duquel l'accord est pourtant unanime : une vraie politique de la dépendance ne doit pas se limiter à la baisse des tarifs de l'hébergement en établissement, au prétexte qu'elle diminuerait heureusement le reste à charge, mais doit favoriser la prévention et le maintien à domicile.
Soyons donc très attentifs à ne pas résumer la question du financement de la dépendance à la seule résorption du reste à charge observé : celui-ci n'épuise pas l'ensemble des problèmes rencontrés, notamment celui de la dissuasion à consommer l'intégralité du plan d'aide APA.
Nous vous faisons donc part d'une conviction forte : le modèle financier dans lequel le Gouvernement semble résolument engagé en matière de dépendance, qui se cantonne au fléchage de ressources existantes, nous semble mener directement à l'impasse.
Il nous faut donc imaginer un mode de financement alternatif et ressusciter les débats qui, il y a maintenant plus de dix ans, avaient véritablement identifié l'urgence d'une réforme systémique.

Nous l'avons vu, toute la complexité du financement de la dépendance vient de ce que plusieurs logiques de solidarité y sont à l'oeuvre.
Le plan d'aide élaboré par l'équipe médicale du conseil départemental dans le cadre d'une demande d'APA est prioritairement évalué en fonction du degré de dépendance de la personne âgée ; lui est ensuite soustrait un montant proportionnel aux ressources de la personne. Prestation universelle en principe, dans le sens où le droit naît du seul besoin, l'APA fait intervenir en second plan un critère de ressources qui module dans les faits son attribution aux personnes en fonction d'une participation financière qui leur est demandée.
Deux axiomes régissent ainsi l'attribution de l'APA : l'un, parfaitement admissible à nos yeux, veut qu'à même degré de dépendance, la participation financière de la personne augmente à due concurrence des ressources de son foyer ; selon l'autre, moins facilement défendable, à même niveau de ressources du foyer, la participation financière de la personne augmente à due concurrence du degré de dépendance.
Cet écueil vient d'une contradiction intrinsèque à l'APA : elle est un droit mobilisable au titre de la solidarité nationale, fondé sur un besoin indépendant du niveau de richesse, et assure donc une couverture proportionnelle à la dépendance du bénéficiaire. Mais cette couverture se révélant nécessairement plus coûteuse à raison que le besoin augmente, le biais financier ne manque pas d'intervenir là où on avait précisément voulu le tenir à l'écart.
C'est pourquoi nous avons ensemble convenu qu'avant l'intervention de la solidarité nationale, la couverture financière de la dépendance devait prioritairement faire appel à un mécanisme assurantiel, dont la dimension solidaire ne serait pas seulement assurée par l'universalité du droit, mais aussi par la mutualisation préalable du risque.
Outre le niveau structurellement insuffisant de la couverture actuellement assurée par l'APA, deux raisons principales nous conduisent à préconiser, dans le prolongement des débats de 2007-2008 relatifs au « cinquième risque », la mise en place d'une assurance dépendance obligatoire :
- l'incapacité du secteur assurantiel facultatif à remplir simultanément l'objectif d'une couverture large et efficace. En effet, soit la couverture est mutualisée mais trop rigide, soit elle est individualisée mais trop onéreuse ;
- le maintien des phénomènes de sélection adverse, qui écartent une grande partie des classes moyennes de la couverture dépendance.

Quels caractères cette assurance devra-t-elle revêtir ?
Ce devra être un système d'assurance obligatoire dépendance par répartition, bien plus cohérent lorsque l'aléa du risque couvert ne dépend pas directement du revenu. Un système par capitalisation renforcerait en effet la couverture des bénéficiaires les plus aisés - sans que leurs besoins s'en trouvent par ailleurs mieux couverts -, mais n'aurait probablement qu'un effet marginal sur la couverture des bénéficiaires des classes moyennes - dont les besoins resteraient imparfaitement couverts.
Ce devra être un système favorisant l'entrée en cotisation le plus tôt possible dans la vie active. Les estimations les plus récentes de la Fédération française des assurances nous ont appris qu'une cotisation moyenne mensuelle de 28 euros dès l'âge de 40 ans permettrait le versement d'une rente viagère mensuelle d'environ 500 euros pour toute personne dépendante dès le GIR 4. Si la cotisation intervenait dès le début de la vie active, elle serait de 12 euros moyens mensuels. Nous rappelons que ce chiffre couvrirait a minima le reste à charge moyen de 490 euros actuellement observé. Je précise également qu'il ne s'agit pas d'un montant forfaitaire par individu, mais bien d'un montant moyen : la cotisation serait bien entendu assise sur le revenu de la personne.

C'est sur la nature de l'acteur à qui incombera la gestion de cette couverture dépendance que vos rapporteurs doivent maintenant faire état d'une légère divergence. À mes yeux, les caractères d'une assurance dépendance préconisée la rendent tout à fait compatible avec une intégration au système public de sécurité sociale. En effet, la construction d'un « cinquième risque » qui serait en fait une « cinquième branche » pleinement intégrée me paraît plus souhaitable en raison des pratiques tarifaires discriminantes qu'un marché assurantiel privé risque de faire émerger. Nous connaissons tous les dérives auxquelles sont exposés nos concitoyens contraints de recourir à des produits très techniques, et dont les éléments de prix ne sont pas toujours exposés de façon claire ou transparente.

Selon moi, la gestion du risque dépendance doit revenir au secteur privé, non seulement pour des raisons d'efficience, mais aussi parce que je souhaite éviter les risques d'exclusion mutuelle des prestations maladie et des prestations dépendance que ne manquerait pas d'engendrer leur intégration dans le même système public. Je m'explique : l'avancée en âge faisant autant appel à des interventions de soins qu'à des prestations d'aide à l'autonomie, si nous faisons relever les deux risques d'un même décideur public, par ailleurs contraint dans ses financements, il y a de fortes chances pour que l'un des deux risques se substitue entièrement à l'autre, au détriment de l'accompagnement d'ensemble. C'est par exemple le cas en Allemagne, où la consécration d'une cinquième branche dépendance a eu comme conséquence regrettable la difficulté que rencontrent les personnes âgées accueillies en établissement de voir leurs frais médicaux couverts au titre de l'assurance maladie !
Je rejoins néanmoins ma collègue sur le danger de pratiques divergentes qu'elle a pointé. On doit, à mon sens, pouvoir y parer en imposant à tous les assureurs privés chargés de la couverture dépendance le recours à un seul et même outil d'évaluation pour la définition du besoin : la grille AGGIR offre à ce jour dans ce domaine le plus fiable instrument.
Vos deux rapporteurs s'accordent néanmoins pour préconiser l'avènement d'un modèle fondé prioritairement sur les recettes issues de la contribution dépendance, et subsidiairement par la solidarité nationale.
Un premier étage assuré par la mutualisation des risques, un second étage pris en charge par la solidarité nationale dont l'intervention diminuerait en fonction des revenus. Voici qui réconcilierait les deux grands impératifs qui structurent depuis plus de soixante ans notre système de protection sociale : efficacité de la couverture et justice sociale.

La proposition que nous faisons d'un système assurantiel obligatoire ne nous fait tout de même pas oublier qu'au sein de la dépendance subsistent des dépenses qui doivent continuer de relever d'une logique purement solidaire, et non de la seule couverture d'un risque auquel tout le monde est exposé indépendamment de ses revenus.
C'est pourquoi nous faisons nôtre une des propositions émises par la Fédération nationale des mutuelles de France de l'établissement d'un « surloyer solidaire » entre résidents d'un même Ehpad, pour la seule couverture des dépenses liées aux prestations hôtelières délivrées par l'établissement.
De même, sans préconiser qu'elles se substituent dès à présent à la solidarité nationale, nous évoquons également quelques pistes visant à favoriser la liquidité des patrimoines privés afin de financer la dépendance de leur propriétaire. Ces pistes proposent une réactualisation intéressante de produits existants, comme les viagers ou les prêts viagers hypothécaires, mais qui restent peu mobilisés. Le développement de ces instruments de liquidation ne relève pas que d'un enjeu strictement financier : il interroge l'attachement profond que les Français maintiennent à la transmission de leur patrimoine. Bien que la sollicitation accrue des avoirs mobiliers et immobiliers, particulièrement concentrés sur les tranches d'âge les plus concernées par la perte d'autonomie, recueille l'adhésion de nombreux économistes et de plusieurs acteurs publics, elle nous semble pour l'heure difficilement compatible avec la volonté toujours profondément ancrée de léguer un héritage intact aux descendants.
Elle doit pourtant être mise sur l'ouvrage des propositions qu'il nous faudra tôt ou tard examiner. Au-delà de la question qui nous occupe aujourd'hui du financement de la dépendance, c'est de la redistribution générale du patrimoine, dont nous savons qu'il est actuellement très inégalement détenu, qu'il s'agit...
Voici, Monsieur le président, mes chers collègues, le fruit d'une réflexion partenariale dont nous espérons, mon collègue corapporteur et moi-même, qu'elle se joindra utilement aux travaux adressés au Gouvernement pour l'accomplissement de cet important mais passionnant chantier.
Nous vous remercions.

Je voudrais vous rappeler les événements de Toulouse.
Selon ses déclarations, l'un des directeurs de l'établissement concerné était obligé d'assurer chaque année un bénéfice de 600 000 euros, ce qui est considérable pour un Ehpad. De plus, les dépenses qu'il a été autorisé à engager concernant la nourriture étaient de 4 euros par jour et par personne âgée. C'est dire s'il y a beaucoup de travail à faire sur ces différents sujets !
La parole est au président de la Mecss.

Je remercie les deux rapporteurs, même si certains de leurs principes sont divergents. C'est un travail intéressant qui arrive à point nommé. Ceci démontre, s'il en était besoin, l'utilité de la Mecss et des travaux qu'elle entreprend.
Mes questions seront techniques. Je suis tout à fait partisan de financer une partie de la dépendance par une assurance. En 2011, Mme Marie-Anne Montchamp, alors secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités, avait réalisé un tour de France pour interroger les uns et les autres sur le cinquième risque et ses modes de financement. J'étais à l'époque chargé des affaires sociales dans le département du Loiret. J'avais alors participé à ce débat, que l'on ouvre à nouveau aujourd'hui. Il n'étonnera personne que ma préférence aille vers une démarche assurantielle privée.
Vous avez évoqué une cotisation de 12 euros, ce qui correspond à ce que l'ancien président de la Fédération française de l'assurance (FFA), M. Spitz, avait expliqué il y a quelques années. Vous pourriez indiquer dans le rapport que cette cotisation serait bien entendu déductible du revenu net imposable. Il me paraît important de l'affirmer.
En second lieu, vous avez indiqué les problèmes liés à l'augmentation des prix de journée en Ehpad. À une certaine époque, un des gros problèmes était le glissement progressif, à la charge du département, du volet sanitaire dans le prix de journée.
On a toujours eu un volet hébergement et un volet sanitaire. Beaucoup de directeurs d'Ehpad faisaient progressivement glisser le volet sanitaire vers le volet hébergement, au détriment des départements. On a ensuite introduit le volet dépendance qui a lui aussi glissé dans le prix de journée, ce qui permettait de « jongler ».
Comment pourrait-on déterminer la juste part de l'hébergement et de la dépendance dans le prix de journée par rapport au sanitaire, qui relève de l'assurance maladie ?

Merci de ce rapport de fins connaisseurs.
Une remarque par rapport au reste à charge de l'APA à domicile. N'est-il pas dû notamment au tarif horaire des aides à domicile, inférieur à la réalité des coûts ? C'est ce qui explique qu'une partie seulement en soit consommée. L'enveloppe accordée par les départements, même si elle a changé avec la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement (ASV), était forfaitaire. Avec l'augmentation du coût de l'heure, les demandeurs limitaient les heures pour ne pas engendrer de dépenses supplémentaires. Il y a peut-être là quelque chose à régler.
Par ailleurs, le système d'assurance obligatoire par répartition fait penser au système de retraite. Ce sont deux chantiers importants de systèmes universels par répartition qui partent sur les mêmes bases mais que n'ont pas choisis les autres pays européens, qui ne mettent pas « tous leurs oeufs dans le même panier ».
En effet, en Suède notamment, il existe des complémentaires obligatoires en plus du système de base par capitalisation. Je ne dis pas que ce système est le bon, mais ne faut-il pas envisager également un système par capitalisation collective ? C'est un mécanisme intermédiaire qui permet, me semble-t-il, de placer de l'argent dans l'économie sans remettre en cause le système de solidarité par répartition. C'est peut-être une piste qui mérite d'être explorée...
Il en va de même du viager mutualisé. En France, le viager individuel comporte un risque et ne fonctionne pas. Il faut inventer un système de viager collectif. Des travaux prospectifs ont été menés dans ce domaine autour de la notion de patrimoine.
Les divergences entre mutuelles et assurance maladie rejoignent nos réflexions à propos des mutuelles...

Un système plus collectif de répartition des bénéfices-risques entre l'assurance maladie et les mutuelles - qui, rappelons-le, ne couvrent que 36 milliards d'euros contre 150 milliards d'euros pour l'assurance maladie, sur des risques moins avérés, l'assurance maladie couvrant l'ALD - pourrait être intéressant dans le cadre d'un rapprochement avec le privé.
Enfin, un regret : il est dommage de ne pas avoir consacré un chapitre aux débouchés en matière de troubles neurodégénératifs. Le jour où l'on aura réussi à prévenir ces pathologies, la charge sociétale sera nettement moindre et on améliorera le confort des personnes âgées. Il faut consacrer davantage de crédits à l'innovation, notamment en matière de recherche européenne. Ce sera l'un des thèmes de la prochaine campagne pour les élections européennes.

Tout d'abord, le gain en espérance de vie est un véritable progrès pour toute la société, mais je pense que nous n'avons pas su anticiper les choses.
De grandes promesses avaient été faites en matière d'autonomie, englobant le handicap, la dépendance et l'invalidité. Elles se sont malheureusement réduites comme peau de chagrin, et la loi ASV n'a permis de dégager que 650 millions d'euros. C'est bien peu par rapport à ce que nécessite la dépendance.
Nous pensons que la création d'un cinquième risque n'est pas une bonne solution. Nous réclamons l'intégration de la dépendance dans le régime général de la sécurité sociale et l'arrêt des exonérations patronales, dont les sommes pourraient financer la dépendance.
En plus des cotisations sociales, nous proposons depuis de nombreuses années que l'État finance l'APA et la prestation de compensation du handicap (PCH) au moyen d'une dotation compensatoire pour les départements.
Nous proposons également, au niveau départemental, un pôle public de l'autonomie regroupant les services publics, afin de favoriser la promotion des activités sociales en faveur des personnes âgées et en situation de handicap.

S'agissant de Toulouse, il ne faut pas simplement parler d'établissement privé, mais d'établissement privé à but lucratif. Beaucoup d'établissements privés associatifs remplissent en effet parfaitement leurs missions et n'ont pas pour but de faire gagner de l'argent à des actionnaires. Cela étant, certains établissements privés lucratifs remplissent aussi leur rôle.
Je suis d'accord avec M. Cardoux concernant la déduction du revenu imposable. La cotisation moyenne pourrait être de 28 euros à partir de 40 ans. Elle serait de 10 à 12 euros si elle prenait effet au début de l'activité. C'est un chiffre moyen : la cotisation individuelle serait fonction des revenus. Elle serait donc bien inférieure pour les petits salaires.
Pour ce qui est du prix de journée dans les Ehpad, nous proposons un seul tarificateur, tout comme le rapport Libault. Aujourd'hui, l'ARS prend en charge la médicalisation, et le département s'occupe de la dépendance, ainsi que de fixer le prix de la journée d'hébergement. Nous proposons de réunir le forfait dépendance et la médicalisation, et que le tarif hôtelier soit fixé par le département. Le rapport Libault propose quant à lui que ce soit l'État qui traite du sujet.
Nous voudrions que, dans une ou deux régions, la moitié des départements arrête le tarif, qui serait dans l'autre moitié fixé par l'ARS, les sommes allouées auparavant aux uns et aux autres étant bien entendu transférées. Cela permettrait de voir qu'il n'existe pas beaucoup de différences entre les départements en matière de point GIR départemental, qui est en moyenne à environ 7 euros - même si des différences subsisteraient concernant le prix de la journée hôtelière.
Les différences, comme en Corse ou ailleurs, sont en train de se réduire. Les départements se sont engagés à uniformiser les points GIR afin qu'il n'y ait pas de différence entre les territoires en matière de prise en charge de la dépendance. Il en existera cependant toujours sur le plan immobilier. On ne peut l'empêcher.

Concernant l'APA, nous préconisons un versement assez inédit, tout ou partie en espèces, inspiré du modèle allemand. Les retours sont intéressants. Cela correspond à la volonté et aux besoins des personnes.

Il pourrait s'agir d'un système de chèque-service.
Par ailleurs, nous proposons également de faire coexister un système obligatoire par répartition et un système optionnel par capitalisation. Cela permettrait à ceux qui le souhaitent d'avoir un peu plus que 500 euros mensuels.
Enfin, nous avons proposé le système de cinquième risque sous forme assurantielle ou par branche.

Vous avez évoqué de manière assez pudique le lien des Français avec la transmission de leurs biens, qu'ils ne souhaitent pas utiliser pour financer une partie de la dépendance.
Je trouve curieux que l'on récupère l'aide sociale à l'hébergement sur le montant de la succession et non sur l'APA, alors que cette dernière coûte parfois bien plus cher. Je pense que le débat doit être posé. Il n'est pas compréhensible, lorsqu'on dispose d'un patrimoine important, que les ayants droit en récupèrent l'intégralité et que la solidarité nationale paye le reste à charge en matière de dépendance !
Par ailleurs, nous allons ouvrir dans les Landes, au mois d'octobre, le premier village Alzheimer de France. J'invite la commission des affaires sociales à venir le visiter en début d'année prochaine. Ce village, Laurence Rossignol l'avait porté sur les fonds baptismaux avec Henri Emmanuelli, il y a trois ans de cela. Ce site sera entièrement consacré à des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Deux professeurs, l'un bordelais, l'autre toulousain, y mèneront une recherche sur les maladies neurodégénératives, ce qui n'existe nulle part ailleurs.
La semaine dernière, nous avons également lancé une opération appelée « vieillir à domicile » par le biais d'Internet. Marie-Anne Montchamp a eu la gentillesse de nous dire que notre département mériterait de jouer le rôle de laboratoire dans le cadre du travail sur la dépendance que va engager le Gouvernement. Elle a aussi vanté notre système d'Ehpad entièrement public dont les tarifs ne dépassent pas 65 euros par jour.

Je rappelle aux rapporteurs qu'à l'heure où l'on recherche 7 milliards d'euros pour la dépendance, on vient de faire le choix de dépenser 24 milliards d'euros avec la suppression de la taxe d'habitation.

On peut penser que la sécurité sociale sera à l'équilibre en 2024 et que la somme correspondant à la CRDS pourrait en partie être attribuée à la dépendance.
Je suis d'accord avec Bernard Bonne et Michelle Meunier au sujet de la question de l'assurance. Il est important qu'il n'y ait qu'un seul financeur pour les soins et la dépendance. Le ticket modérateur GIR 5 et 6 en Ehpad serait-il inclus dans la dépendance ? Ceci économiserait 6 euros environ par jour.
Par ailleurs, le département s'occuperait-il toujours de l'hébergement ?
Enfin, pouvez-vous donner quelques explications complémentaires concernant le surloyer solidaire ?

Le sujet d'aujourd'hui, c'est le financement de la dépendance. Nous sommes bien loin des ambitions d'il y a plus d'une dizaine d'années, lorsque la question portait sur la perte d'autonomie, quelle qu'en soit la cause et quel que soit l'âge de la personne. En clair, on tenait à la fois compte des personnes âgées et de celles en situation de handicap. Ces grands projets ont été abandonnés au moment de la crise et n'ont pas été repris par les différents gouvernements, de droite ou de gauche, qui se sont succédé depuis.
L'enjeu financier, on l'a dit, est de 7 milliards d'euros. Rappelons qu'ici même, peu avant Noël, nous avons dégagé 10 milliards d'euros à la quasi-unanimité ! L'objectif n'est donc pas hors de portée. Il reste à la mesure des capacités financières de notre pays.
Par ailleurs, qu'en est-il de l'appétence des assurances privées pour la dépendance ? J'ai souvenir que les assurances avaient autrefois des produits prêts à être mis en circulation. Un grand groupe d'assurance français avait invité le président de l'Association des départements de France (ADF), ainsi que le vice-président chargé des affaires sociales, pour faire la promotion de ce produit, qui n'a finalement pas été mis en circulation...
Quant à la question du patrimoine, elle reste sous-jacente. On en connaît les différentes données...
Enfin, je voudrais insister sur ce qu'a dit Monique Lubin à propos de l'intérêt que pourrait représenter ce que fait le département des Landes, qui recourt à des outils novateurs dont nous pourrions tirer des bénéfices.

S'agissant de la remarque pertinente de Monique Lubin à propos de la récupération sur succession, j'ai bien dit, à la fin de ma présentation qu'il s'agit de revoir toute la redistribution générale du patrimoine.
S'agissant du surloyer solidaire, l'idée est de s'inspirer des crèches, où tous les parents, en fonction de leurs ressources, ne paient pas le même tarif journalier pour un même service.

Je n'ai pas répondu à René-Paul Savary au sujet des actions de prévention. On a bien dit qu'il convenait de prendre les personnes en charge avant qu'elles ne soient dépendantes. C'est tout l'intérêt des plans d'aide à domicile, qui devraient permettre de développer la prévention.
S'agissant de la CRDS, on ne sait pas quand la dette sociale sera apurée ni comment son produit va être utilisé. Il vaut donc mieux tenir que courir, plutôt que d'en utiliser tout ou partie.
Concernant les GIR 5 et 6, on propose en effet de fondre le ticket modérateur dans la tarification globale.

Le PLFSS 2019 a été voté à l'équilibre mais, à la suite des manifestations des gilets jaunes, le déficit s'élève à 2,8 milliards d'euros.

On cherche à résoudre depuis plusieurs années une équation impossible ! Je crois me souvenir que l'annonce d'une grande loi sur le vieillissement remonte à trois quinquennats !
Les résultats législatifs n'ont pas été à la hauteur des engagements, et on court deux lièvres à la fois, d'une part la baisse globale des prélèvements et des cotisations sociales, de l'autre la prise en charge socialisée de la dépendance.
On ne sait pas non plus vraiment faire d'économies, la limite de l'exercice consistant à dire qu'il faut prendre l'argent là où il est - mais ce n'est pas si facile... Il faut assumer l'idée que la prise en charge de la dépendance va provoquer un prélèvement supplémentaire. Il s'agit d'un risque assurantiel de plus.
Le bilan est mitigé concernant le privé lucratif et la dépendance, jusqu'en matière d'assurance. À chaque fois que l'on essaie de faire appel aux assurances en matière de dépendance, on s'aperçoit que les grilles sont différentes de la grille AGGIR.
En toute logique, on pourrait penser que lorsque quelqu'un est éligible à l'APA, cela fonctionne aussi pour l'assurance. Pas du tout, car l'assurance dispose de ses propres critères ! La perception qu'en ont les assurés n'est donc pas bonne.
Quant aux Ehpad privés lucratifs - et sans pointer du doigt qui que ce soit -, il est très choquant de constater qu'ils constituent un des placements financiers les plus rentables !
Cela pose la question de la place du privé lucratif. J'ai connu les repas à moins de 2 euros dans certains établissements ! J'avais pour habitude de considérer qu'un Ehpad était un établissement de qualité quand on y cuisinait sur place. Or la majorité externalise les chaînes de froid, etc. : on mouline tout, on le donne aux résidents, et les gens ne savent même plus ce qu'ils mangent !
Concernant la question des successions, les héritiers cherchent un Ehpad dont les tarifs n'entament pas l'héritage, ce qui pose un véritable problème. Quand on fait des économies pour ses vieux jours, il faut savoir y recourir le moment venu ! Je crains que les reprises sur succession n'aggravent encore la situation, d'autant que nombre d'enfants mettent leurs parents sous tutelle. C'est alors eux qui décident...
Certes, le domicile reste formidable tant que les gens sont en bonne santé. J'ai cependant vu trop de personnes âgées en mauvais état maintenues à domicile pour des raisons économiques. C'est là aussi de la maltraitance, mais on n'en parle jamais. Il faut avoir un discours équilibré en matière de durée et de parcours concernant la prise en charge du vieillissement. Le placement en établissement est parfois inéluctable.
Enfin, je rappelle que fort heureusement seul un tiers des plus de 85 ans sont dépendants. On pense toujours au grand âge comme s'il entraînait à coup sûr la dépendance, mais ce sont moins de 20 % des personnes âgées qui perçoivent l'APA. Cela permet de décrisper la discussion !

Merci de ce rappel toujours utile.
Nous savons tous, en tant qu'élus, que le maintien à domicile est momentanément la meilleure des solutions, mais la pire quand la dépendance arrive. Il est très compliqué de maintenir quelqu'un chez lui si l'on veut qu'il soit pris en charge correctement.
Quant au problème de restauration dans les maisons de retraite privées, il est tout à fait anormal de connaître les problèmes auxquels on a assisté. Ce sont les gouvernements successifs qui y ont poussé pour des raisons d'économie. On n'est pas sûr que ce soit moins cher, mais on est certain que les repas sont de bien moins bonne qualité.

Je n'ai pas rencontré beaucoup de refus concernant l'APA à domicile pour cause de revenus...
S'agissant des Ehpad, il faut distinguer les établissements privés à but lucratif des Ehpad à but non lucratif gérés par des associations.
Par ailleurs, le maintien à domicile présente ses limites. C'est la solution que choisissent certaines familles du fait du coût trop élevé du prix de journée. C'est parfois à la limite de la maltraitance, je le reconnais...
Enfin, quand on veut actionner les assurances, les critères ne sont jamais les bons. Il faudra donc faire très attention à la rédaction des textes.

Ce sujet vient à point et les perspectives sont fort intéressantes.
J'aurais cependant aimé que l'on puisse avoir une réflexion sur la prise en charge de la dépendance dans les collectivités d'outre-mer, où le décalage est prégnant en matière de politiques publiques.
Même si je ne vis pas dans ces territoires, la dépendance y est souvent traitée d'une autre façon sur le plan familial et intergénérationnel. Je pense qu'il conviendrait qu'un de nos collègues étudie la façon dont peut y prospérer le sujet que vous avez abordé.

Madame Rossignol, certaines personnes âgées ne connaîtront en effet jamais la dépendance. A contrario, la perte d'autonomie peut survenir très rapidement.
Nous ne parlons pas de refus de prise en charge à domicile, monsieur Chasseing, mais de renoncement. Ce sont les personnes âgées elles-mêmes - ou leur entourage proche - qui ne recourent pas à la totalité de l'APA à domicile.

J'ai vu pour ma part des personnes renoncer à un plan d'aide lorsqu'on leur annonçait le montant de leur participation. C'est un refus de leur part et non du département.
Quant au système assurantiel, on ne l'a pas défini. S'il était privé, il faudrait bien entendu un cahier des charges très précis, avec une application très contrôlée de la grille AGGIR, qui devrait être commune à tout le monde. Il n'est pas question de refuser des prestations dans la mesure où la personne doit pouvoir en bénéficier. Il ne s'agira donc pas d'une assurance privée optionnelle, mais une assurance privée obligatoire et contrôlée. C'est indispensable.
Quant aux successions, il n'y a pas de raisons que les personnes qui ont accumulé un certain patrimoine ne participent pas aux dépenses. Je parle ici des dépenses d'hébergement davantage que de celles liées à l'APA.
On a beaucoup parlé du privé lucratif. Il ne faut pas jeter la pierre à tout le secteur, mais il faut que les établissements acceptent les contrôles inopinés. C'est ce que font beaucoup de départements. Cela permet d'éviter bien des écueils.

Les orientations qu'ont données les rapporteurs sur la compensation et la solidarité sont pour moi les critères qui peuvent définir les orientations en matière de vieillissement et de perte d'autonomie.
Je pense par ailleurs que le rapport devrait également traiter des innovations en matière assurantielle, mais aussi des modes d'accueil qui peuvent exister dans les territoires d'outre-mer, où les gens n'ont pas la capacité d'être hébergés dans un établissement sans l'aide du département.
Je suis plutôt favorable à la préconisation de M. Libault, qui estime que l'État doit être acteur de la construction des établissements médico-sociaux, les départements n'ayant plus la capacité financière d'investir pour construire des Ehpad sans aides publiques.
La Réunion, par exemple, intègre l'investissement réalisé par l'associatif dans le prix de la journée, ce qui revient plus cher dans beaucoup de cas. Outre-mer, l'APA à domicile est utilisée entre 70 % à 80 %. 20 % de ceux qui touchent l'APA sont en établissement, mais avec un prix de journée très important pour le département, 90 % des personnes accueillies n'ayant pas la possibilité de payer un reste à charge. C'est l'aide sociale qui assume la totalité des personnes qui sont accueillies dans les Ehpad. C'est quasiment le cas de tous les territoires ultramarins. Mayotte va connaître le problème de la prise en charge des personnes âgées et de la perte d'autonomie dans les années qui viennent.
L'accueil intermédiaire semi-collectif est donc intéressant. Nous l'avons fait pour des maisons d'assistantes maternelles qui connaissent un gros succès chez nous, les mairies n'ayant pas la possibilité de construire des crèches ou de faire face à leur fonctionnement. Les maisons d'accueil familial sont pour nous une possibilité intermédiaire entre le maintien à domicile et l'accueil en établissement.
Le code de l'action sociale et des familles définissant l'accueillant familial, je souhaiterais que notre commission puisse en faire évoluer les critères.

La prise en charge des personnes âgées est en effet très différente dans les territoires d'outre-mer. L'accueil familial est bien plus important que dans l'hexagone.
Quant à l'investissement immobilier, la plupart des départements n'y participent plus. Il ne représente pourtant qu'environ 20 % au maximum du prix de journée. Les établissements eux-mêmes participent à leur propre rénovation. Il faut que le département puisse tarifer, continue à suivre les établissements et à traiter de la dépendance des personnes dont il a la charge.
La commission autorise la publication du rapport d'information.
La commission désigne M. Michel Amiel, rapporteur sur la proposition de loi n° 417 (2018-2019) relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé.
La réunion est close à 12 heures 15.