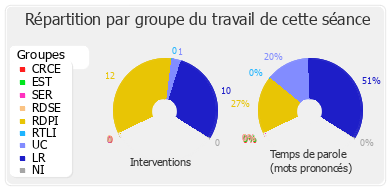Séance en hémicycle du 6 novembre 2008 à 9h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Conférence des présidents (voir le dossier)
- Programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 et prélèvements obligatoires (voir le dossier)
- Discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence et débat sur une déclaration du gouvernement (voir le dossier)
- Souhaits de bienvenue à une délégation de sénateurs du cambodge
La séance
La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

La conférence des présidents a établi comme suit l’ordre du jour des prochaines séances du Sénat :
Jeudi 6 novembre 2008 :
Ordre du jour prioritaire
À 9 heures 30, à 15 heures et, éventuellement, le soir :
- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, après déclaration d’urgence, de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 (n° 55, 2008-2009) et déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat, sur les prélèvements obligatoires ;
La conférence des présidents a décidé de joindre le débat sur les prélèvements obligatoires à la discussion générale de ce projet de loi ;

Mercredi 12 novembre 2008 :
À 16 heures et le soir :
1°) Sous réserve de l’entrée en application de la résolution, adoptée par le Sénat le 29 octobre 2008 et soumise au Conseil constitutionnel, modifiant l’article 3 du règlement du Sénat afin de renforcer le pluralisme dans l’organe dirigeant du Sénat, élection de deux vice-présidents du Sénat ;
Le scrutin secret pour l’élection de deux vice-présidents du Sénat se déroulera dans la salle des conférences et sera ouvert pendant une heure ;

Ordre du jour prioritaire
2°) Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (n° 80, 2008-2009) ;
La conférence des présidents a fixé :

Au plus tard à 19 heures : Désignation de secrétaires du Sénat
Jeudi 13 novembre 2008 :
À 9 heures 30 :
Ordre du jour prioritaire
1°) Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;
La conférence des présidents a décidé d’organiser un débat thématique sur « L’hôpital en question », avant le début de la troisième partie du projet de loi « Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour 2009 » ;

À 15 heures et le soir :
2°) Questions d’actualité au Gouvernement ;
Ordre du jour prioritaire
3°) Suite de l’ordre du jour du matin.
Lundi 17 novembre 2008 :
À 10 heures :
1°) Quatorze questions orales :
L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.
- n° 289 de Mme Anne-Marie Payet à M. le secrétaire d’État chargé de l’outre-mer ;
Conditions d’accès à l’activité de transporteur public routier de personnes

- n° 292 de M. Roland Courteau à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ;§;
- n° 315 de M. René-Pierre Signé à M. le ministre de l’agriculture et de la pêche ;
Fièvre catarrhale ovine

- n° 316 de M. Yannick Bodin à M. le ministre de l’éducation nationale ;
Réforme de la formation des maîtres

- n° 317 de M. Michel Teston à M. le ministre de l’éducation nationale ;
Avenir du réseau des GRETA

- n° 320 de M. Christian Cambon à M. le secrétaire d’État chargé des transports ;
Déviation de la RN 19

- n° 321 de M. Jean-Claude Peyronnet à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;
Régime indemnitaire des membres de la commission nationale de déontologie et de sécurité

- n° 322 de M. Jean-Pierre Godefroy à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; §;
- n° 326 de M. Alain Anziani à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi ; §(Avenir de l’usine Ford Aquitaine Industrie de Blanquefort) ;
- n° 329 de Mme Christiane Demontès à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
Avenir de la gynécologie médicale

- n° 331 de M. Michel Billout à M. le secrétaire d’État chargé de l’industrie et de la consommation ; §;
- n° 335 de Mme Nicole Bricq à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi ; §;
- n° 337 de Mme Odette Terrade à M. le secrétaire d’État chargé des transports ;
Réalisation urgente et effective des travaux de déviation de la RN 19

- n° 341 de Mme Dominique Voynet à Mme la garde des Sceaux, ministre de la justice ;
Instructions judiciaires impliquant des agents des forces de police

Ordre du jour prioritaire
À 15 heures et le soir :
2°) Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.
Mardi 18 novembre 2008 :
À 9 heures 30 :
Ordre du jour prioritaire
1°) Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;
À 16 heures et le soir :
2°) Éloge funèbre d’André Boyer ;
Ordre du jour prioritaire
3°) Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;
À partir de 18 heures :
- Désignation des 36 membres de la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes ;
Mercredi 19 novembre 2008 :
Ordre du jour prioritaire
À 15 heures et le soir :
- Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.
Du jeudi 20 novembre au mardi 9 décembre 2008 :
Ordre du jour prioritaire
- Sous réserve de sa transmission, projet de loi de finances pour 2009 (A.N., n° 1127) ;
Le calendrier et les règles de la discussion budgétaire figurent en annexe.

En outre,
Jeudi 27 novembre 2008 :
À 9 heures 30 :
Ordre du jour prioritaire
Sous réserve de leur dépôt :
1°) Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;
2°) Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion ;
3°) Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif aux revenus du travail ;
À 15 heures :
4°) Questions d’actualité au Gouvernement ;
Mardi 9 décembre 2008 :
Ordre du jour prioritaire
Le soir :
- Déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat, préalable au Conseil européen ;
La conférence des présidents a également retenu les dates des séances de questions d’actualité au Gouvernement et de questions orales, ainsi que les dates des séances mensuelles réservées pour les mois de janvier et février 2009.
Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances ?…
Ces propositions sont adoptées.

L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 (nos 55, 78 et 71) et une déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat, sur les prélèvements obligatoires et leur évolution.
Sur la proposition de la commission des finances et de la commission des affaires sociales, la conférence des présidents a décidé de joindre le débat sur les prélèvements obligatoires à la discussion générale de ce projet de loi.
Dans la discussion commune, la parole est à Mme la ministre.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, monsieur le rapporteur pour avis, mesdames et messieurs les sénateurs, pour la première fois, le Gouvernement présente au Sénat un projet de loi de programmation des finances publiques. Annoncée par le Président de la République et votée par le Parlement, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a consacré cette nouvelle catégorie de loi appelée à définir « les orientations pluriannuelles des finances publiques ».
Mon collègue Éric Woerth évoquera dans quelques instants l’effort sans précédent sur la dépense que le Gouvernement entend mettre en œuvre au cours des prochaines années pour assainir les comptes publics. Il ne s’agit pas seulement d’un exercice que nous devons à nos partenaires européens ; seul un rétablissement de nos finances publiques nous évitera de continuer à vivre à la charge de nos enfants et de nos petits-enfants, et de leur transférer une charge budgétaire de plus en plus lourde.
J’aimerais concentrer mon intervention sur le contexte macroéconomique actuel et à venir. Ce contexte, par la force des choses, va affecter profondément les modalités d’assainissement des comptes publics. Avec une croissance à deux chiffres, il est bien sûr beaucoup plus facile de rétablir les comptes publics.
Notre économie traverse une période historiquement difficile. Ce projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 est un texte de crise. La crise financière actuelle – même si chacun a son appréciation et que vous n’êtes peut-être pas tous d’accord avec moi – est une crise des abus, des excès. Je n’y reviendrai pas : excès de crédit, excès d’endettement, excès de complexité, excès de cupidité, excès de volatilité, excès d’irrationalité.
La mobilisation et la rapidité des pouvoirs publics pour y répondre, partout en Europe, ont été exceptionnelles. Grâce notamment à l’implication forte du Président de la République, la France, qui assure la présidence de l’Union européenne, a joué tout son rôle et assumé toutes ses responsabilités en mobilisant toutes les énergies.
Dès la mi-octobre, cette mobilisation a pris en France la forme d’un plan de soutien pour sauvegarder l’accès au crédit des entreprises, donc pour sauvegarder l’emploi. C’est un plan de soutien non pas des banques mais de l’économie.
Des plans du même type ont été mis en œuvre dans plus de quatorze pays européens, notamment en Espagne, en Grande-Bretagne, en Allemagne. Les premiers effets de ces plans sont visibles : le niveau des désordres et de la méfiance sur le marché des prêts a commencé doucement à refluer, comme en témoigne l’examen des taux d’intérêt, de l’Euribor, des variations de spread.
Avant de vous indiquer très précisément la révision à la baisse des perspectives officielles de croissance pour 2009 et 2010, je voudrais vous exposer l’analyse de la situation macroéconomique réalisée par le Gouvernement.
La croissance a déjà été négative au deuxième trimestre de l’année 2008 dans toute la zone euro, avec un taux de moins 0, 2%. Elle s’établit à moins 0, 3% en France. C’est le prix de l’envolée du cours du pétrole et de l’ensemble des matières premières, ainsi que de la variation de l’euro au cours de l’hiver 2007-2008. L’activité s’est aussi repliée en Allemagne – moins 0, 5 % –, en Italie – moins 0, 3 % – et au Japon - moins 0, 7 %. Au troisième trimestre, les États-Unis ont aussi enregistré une croissance négative de moins 0, 1 %.
Au début du mois de septembre, notre hypothèse de croissance du produit intérieur brut de 1 % pour 2009 était déjà la plus basse hypothèse de croissance depuis vingt-quatre ans : c’est dire que nous n’étions alors pas particulièrement optimistes ! Depuis lors, nous le savons, les événements se sont précipités et la crise financière internationale a considérablement affecté l’économie de tous les pays, mais plus particulièrement, dans un premier temps, celle des pays développés.
Les effets de cette crise financière internationale commencent déjà à se faire sentir. Ils devraient perdurer pendant plusieurs trimestres. Même si la réponse de l’ensemble des pays européens – entraînant d’ailleurs une révision de la réponse américaine – a été prompte, pertinente et pionnière, ramenant graduellement la confiance, cette crise laissera des séquelles durables sur nos économies réelles.
Face à ce choc d’une ampleur et d’une nature inédites, la situation économique et financière de l’Europe n’est pas assimilable, loin s’en faut, à celle des États-Unis.
Le dire n’est pas faire preuve d’optimisme béat. C’est simplement ce qui résulte de l’analyse de la réalité des faits. Les désordres interbancaires sont plus élevés aux États-Unis et, à un moindre degré, en Grande-Bretagne. Cela tient, on le sait, à la structure du système bancaire et au mode de régulation qui s’y applique.
En Europe, les agents restent solvables et, surtout, ils sont endettés à taux fixe, contrairement à la situation d’endettement des ménages américains.
Le taux d’endettement des Européens est inférieur en moyenne à 100 % ; celui des ménages français s’élève à 93, 6 % selon les derniers chiffres connus pour 2007Le taux d’endettement dans le continent nord-américain est proche de 130 %.
L’ajustement immobilier, dont on sait très bien qu’il a joué un rôle très important dans le déclenchement et l’amplification des effets de la crise financière, est beaucoup plus graduel en France et en Allemagne qu’outre-Atlantique et dans certains pays de l’Union européenne, qui avaient fondé leur développement économique en particulier sur celui du secteur immobilier.
Compte tenu de leur modèle d’activité, les banques européennes – même si elles ont dû enregistrer des pertes importantes - sont moins exposées aux activités de marché, leurs revenus provenant majoritairement d’activités de clientèle.
Tout cela suggère une meilleure capacité à résister au choc financier majeur auquel sont soumises toutes nos économies.
Par ailleurs, des éléments favorables sont aussi intervenus dans l’ensemble de nos économies, mais plus particulièrement dans les économies européennes. Une analyse non partisane ne peut pas les passer sous silence, quoi qu’on en pense. Il suffit d’examiner les chiffres.
Le prix du baril de Brent a chuté en deçà de 70 dollars, soit moins de la moitié du pic de 148 dollars atteint en juillet. Au moment de la finalisation du projet de loi, en septembre, le baril était encore à 100 dollars, un cours qui a servi d’hypothèse à la constitution du texte transmis à l’Assemblée nationale.
Cette hypothèse doit être revue aujourd’hui à 72 dollars, le cours moyen du baril en octobre.
Le texte du projet de loi de finances tablait sur une inflation de 2, 0 % en 2009, ce qui semblait tout à fait raisonnable à l’époque où nous avons établi ces prévisions.
Compte tenu de ces reflux en termes de prix des matières premières, notamment du baril, le Gouvernement va devoir amender le projet de loi qui vous est soumis en retenant une hypothèse d’inflation ramenée de 2 % à 1, 5 % pour 2009.
L’euro est passé au-dessous de 1, 30 dollar, après avoir atteint un pic de 1, 60 dollar à la mi-juillet. Le texte du projet de loi de finances tablait sur un taux de change de 1, 45 dollar. L’hypothèse de change du projet de loi de finances doit être revue.
De la même manière que nous revoyons l’inflation, nous revoyons l’hypothèse concernant le taux de change de l’euro par rapport au dollar, en le ramenant de 1, 45 à 1, 33 dollar, cours moyen de l’euro en octobre. Il ne s’agit pas, en matière de prévision, de faire du mark to market, mais il est évident que nous devons nous adapter à la réalité des faits.
Cette évolution va contribuer à soutenir les exportations et donc, nous l’espérons, la croissance au cours des prochains mois.
Après avoir révisé certains des paramètres retenus pour la construction de nos prévisions – l’inflation, le taux de change–, venons-en maintenant à la révision à la baisse des hypothèses de croissance pour 2009 et 2010.
Le texte du projet de loi de finances, qui a été transmis début octobre au Parlement et dont le volet relatif aux recettes a été arrêté début septembre, a été bâti sur une hypothèse de croissance du produit intérieur brut de 1 % en 2009, hypothèse la plus basse depuis vingt-quatre ans.
Si l’on prend en compte lesde l’autre, au total les effets sur la croissance des bouleversements récents seront clairement défavorables.
Je l’avais déjà annoncé à l’Assemblée nationale le 20 octobre ; je le confirme devant la Haute Assemblée : la croissance en 2009 sera établie sur la base d’une fourchette qui nous paraît réaliste compte tenu des faits. Je suis confortée dans cette appréciation par les échanges que j’ai pu avoir lors de la réunion de l’Écofin avec l’ensemble de mes partenaires européens qui représentent, je vous le rappelle, plus de 60 % de nos échanges.
J’annonce donc que la croissance en 2009 pourrait s’établir dans une fourchette comprise entre 0, 2 % et 0, 5 % du produit intérieur brut.
Exclamations sur les travées du groupe CRC.
Nous avions une prévision très faible, à 1 %, la plus faible depuis vingt-quatre ans. Nous la révisons pour la situer, je le répète, entre 0, 2 % et 0, 5 %.
Certains apôtres nous indiqueront que ce sera moins.
Par contrecoup, puisque, vous le savez, nous travaillons sur une base pluriannuelle, nous révisons également notre prévision de croissance pour l’année 2010, en la ramenant de 2, 5 % à 2 %.
Le Gouvernement a souhaité que cette révision à la baisse intervienne un peu avant la mi-novembre, comme initialement prévu, par respect pour votre Haute Assemblée, …
… afin qu’elle puisse disposer de l’ensemble des données nécessaires à son examen, avec un regard réaliste sur la situation économique et les prévisions que l’on peut en tirer.
Le Gouvernement soumettra les amendements à ce projet de loi qu’implique cette hypothèse.
Je souhaite tout particulièrement le souligner, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement considère que, dans la situation actuelle, les anticipations des agents ont plus que jamais un effet sur la croissance. Tous les économistes, qu’ils soient de droite, de gauche, libéraux, conservateurs, keynésiens, friedmaniens et autres le disent, les anticipations sont déterminantes.
À cet égard, le rôle que nous jouons est important.
Il faut donc bien réfléchir avant de suivre certains instituts de sondages dans leur course effrénée à la révision des hypothèses de croissance, avec des estimations modifiées toutes les semaines et dans de grandes proportions, évoquant ces mécanismes de mark to market appliqués aux actifs d’un certain nombre de bilans. Il faut raison garder.
Des experts brûlent en effet aujourd’hui ce qu’ils adoraient encore hier, compromettant ainsi leur crédibilité.
Dans le contexte actuel, qui n’a pas de précédent dans l’histoire, ce gouvernement se doit d’être particulièrement responsable dans la fixation de son hypothèse de croissance, et ne pas se laisser guider par ceux qui cèdent à la mode du négativisme.
Ma prévision de croissance, que je viens de vous exposer, mesdames, messieurs les sénateurs, est lucide. Elle est la plus basse jamais retenue par un gouvernement en France. À situation exceptionnelle – ce que chacun s’accorde à reconnaître –, prévision exceptionnelle.
Cette prévision de croissance ne se laisse pas aveugler par la technique des modélisateurs de tout poil. La situation actuelle n’est comparable à aucune autre. Les leçons du passé ne sont pas d’un grand secours aujourd’hui.
Je vois surtout, à ce stade, deux certitudes économiques.
En premier lieu, la zone euro est structurellement mieux placée que les États-Unis pour traverser la crise. C’est d’ailleurs ce que pensent les marchés financiers : le niveau de méfiance sur le marché des prêts entre banques est nettement plus élevé aux États-Unis qu’en Europe.
Et je peux vous dire, pour avoir participé à la réunion de l’Écofin avant-hier, que de nombreux pays européens à qui l’on aurait proposé de rentrer dans la zone euro voilà quelques mois et qui, avec un œil ironique, auraient probablement dit non, …
…sont aujourd'hui beaucoup plus lucides, estimant que, finalement, l’appartenance à la zone euro procure un certain nombre d’avantages en matière de stabilité.
Donc, la zone européenne et la zone euro en particulier présentent des caractères structurels de meilleure solidité, ce que les marchés eux-mêmes apprécient.
En second lieu, la France a mis en œuvre d’importantes réformes structurelles dès l’été 2007 pour réhabiliter le travail et renforcer l’investissement. Ces réformes s’inscrivent parfaitement dans la stratégie de Lisbonne à laquelle nous adhérons.
Les deux axes de notre politique économique continueront de dicter les réformes à venir et leurIl s’agit, je le rappelle, de réhabiliter le travail et de renforcer l’investissement, dans une démarche d’amélioration de la productivité et de la compétitivité de l’économie française.
J’aborderai brièvement deux points concernant notre réponse de politique économique.
Tout d’abord, en réponse à la crise financière, la réponse d’urgence a consisté à rétablir le mécanisme de financement de l’économie.
À cette fin, nous avons pris des mesures pour réouvrir les circuits qui étaient bloqués et mettre fin à cette situation de thrombose qui risquait d’étouffer l’économie, en empêchant les entreprises d’investir et en les amenant à avoir une appréciation négative sur leur avenir.
Ce plan comportait deux volets, dont le premier visait à alimenter les banques en liquidités pour que l’économie continue à être financée.
Il s’agissait pour l'État, d’une part, d’engager sa signature pour aller emprunter sur un marché où les liquidités sont nombreuses, mais rétives et méfiantes à l’égard des acteurs traditionnels et, d’autre part, de prêter ces liquidités en répercutant l’ensemble des coûts et des taux supportés par l'État lorsqu’il emprunte, et au-delà puisqu’il doit également faire rémunérer sa garantie.
Ce dispositif de refinancement par le biais de la Société française de refinancement de l’économie vient compléter le refinancement bancaire de court terme qui n’a cessé d’être assuré par les interventions de la Banque centrale européenne.
Le second volet de notre plan de soutien consistait à renforcer les fonds propres des organismes financiers. Une société détenue par l’État pourra souscrire à des émissions de titres subordonnés ou d’actions de préférence des banques pour renforcer leurs fonds propres, dans la limite, que vous avez votée, mesdames, messieurs les sénateurs, de 40 milliards d’euros.
À cet égard, je souhaite préciser la raison pour laquelle l'État français n’est pas intervenu dans le capital des banques françaises. L’intervention d’un État pour participer au capital d’une banque est indispensable lorsqu’une banque se trouve en situation de détresse totale et sur le point de déposer son bilan, afin de redresser l’établissement, comme cela a été le cas dans un certain nombre d’États. En Grande-Bretagne, le gouvernement s’est trouvé dans l’obligation de le faire pour certaines banques britanniques, mais pas pour toutes.
Puisque les banques françaises disposent d’un capital de solidité suffisante, l’intervention de l'État à ce niveau n’est pas utile. Les titres subordonnés permettront de renforcer les quasi-fonds propres – – des organismes financiers et de développer le financement de l’économie au-delà même de leur contribution jusqu’à présent, puisque nous leur avons demandé de prendre des engagements à plus 3 %, voire plus 4 % du financement de l’économie.
Après avoir consolidé les circuits financiers et permis la réouverture de ces conduits, il nous faut prendre des mesures pour que les secteurs de l’économie, tels que les PME, continuent d’avoir accès au crédit.
C’est la logique des prêts de la Banque européenne d’investissement, à qui nous avons demandé d’augmenter de 50 % ses prêts aux petites et moyennes entreprises. Ce dispositif, qui résulte d’une initiative française, a été mis en œuvre en l’espace de trois semaines. C’est une performance qui illustre la mobilisation de toute l’Europe au service des PME.
À l’échelon national, nous avons mis en placeannoncé dès le début du mois d’octobre par le Président de la République, et qui est maintenant opérationnel.
Ce plan comprend un montant de 17 milliards d’euros correspondant à un surcroît d’épargne collectée par les livrets d’épargne populaire et les livrets de développement durable et 5 milliards d’euros mis à disposition par la Caisse des dépôts et consignations ou levés par OSEO dans le cadre des mécanismes de garantie ou de cofinancement.
Ensuite, la réponse de politique économique à la crise financière ne se limite pas aux mesures d’urgences. Elle a aussi amené le Gouvernement à approfondir les réformes structurelles introduites depuis l’été 2007 et, surtout, à accélérer leur mise en œuvre.
Les mesures annoncées par le Président de la République au cours des dernières semaines s’inscrivent dans la droite logique de notre politique économique, qui consiste toujours, je le rappelle, à renforcer la compétitivité de notre économie, en mobilisant les deux facteurs de production fondamentaux, le travail et l’investissement.
Il s’agit, d’abord, deréhabiliter la valeur travail. Nous nous y sommes attelés dès juillet 2007.
Je vous passe l’ensemble des mesures concernant le travail, l’emploi, et le pouvoir d’achat, mesures que vous connaissez bien pour les avoir, pour certains, soutenues ardemment et, pour d’autres, vilipendées en les caractérisant de manière souvent abusive.
J’évoquerai la mise en œuvre du revenude solidarité active, l’accélération de la mise en place de Pôle Emploi, vérifiée par des indicateurs quantitatifs indiscutables, avec une mobilisation de tous les acteurs, des 40 000 agents de Pôle Emploi, pour lutter contre le chômage et ramener au plus vite ceux qui s’y trouvent vers l’emploi.
Je voudrais rappeler les 100 000 contrats aidés supplémentaires pour les publics les plus fragiles, avec – il s’agit de la nouvelle génération de contrats aidés – un mécanisme de soutien en termes de formation professionnelle et d’insertion dans l’entreprise pour le secteur non marchand.
Je voudrais parler également de l’extension du contrat de transition professionnelle à tous les bassins d’emploi en difficulté.
Je voudrais enfin mentionner la réforme de la formation professionnelle.
Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, ce que nous faisons pour le facteur travail.
En ce qui concerne le facteur capital, nous avons renforcé l’investissement grâce à la mise en œuvre du dispositif de validation fiscale du crédit d’impôt recherche.
Nous avons également mis en place, à partir du 23 octobre 2008, l’exonération de la taxe professionnelle pour les nouveaux investissements, et ce jusqu’au 1er janvier 2010.
Enfin, nous avons annoncé, et j’y travaille actuellement ardemment, la création d’un fonds stratégique d’investissement avant la fin de l’année.
Au service de ces politiques, la politique fiscale s’inscrit sous le signe de la stabilité du taux des prélèvements obligatoires.
En ce qui concerne les recettes, nous n’augmenterons pas le poids global des impôts si les recettes publiques venaient à fléchir du fait de la situation économique.
Le Gouvernement a choisi de poser comme cadre de travail la stabilité du taux de prélèvements obligatoires à 43, 2 % du produit intérieur brut à compter de 2008 et jusqu’en 2012.
Le rapport sur les prélèvements obligatoires vous fournit l’ensemble des données sur les mesures nouvelles du Gouvernement en matière de prélèvements obligatoires.
Sans les mesures déjà décidées, qui figurent dans le document à votre disposition, le taux de prélèvements obligatoires aurait été de 43, 5 % du produit intérieur brut en 2009. Avec les mesures déjà décidées et incorporées, il passe de 43, 5 % à 43, 2 %. Nous maintiendrons ce taux jusqu’en 2012.
Ces mesures nouvelles déjà décidées se traduiront par une baisse nette de plus de 10 milliards d’euros des prélèvements sur l’ensemble de la législature.
Les baisses d’impôts sont ciblées sur nos priorités politiques : le travail, l’innovation, la participation des salariés aux résultats. Vous trouverez le détail de ces baisses et les éléments chiffrés dans le rapport sur les prélèvements obligatoires.
Outre ces baisses, un certain nombre de dépenses sont assurées par des prélèvements obligatoires ; je pense notamment au financement du RSA, de l’audiovisuel public, de la fiscalité environnementale et des mesures de redressement de la sécurité sociale.
Nous aborderons également lors du débat sur le projet de loi de finances le principe et le concept du plafonnement global des niches fiscales actuellement non plafonnées, ce que notre majorité avait proposé, mais qui n’a malheureusement pas pu, en raison d’un recours de l’opposition devant le Conseil constitutionnel, trouver son chemin dans le droit fiscal français.
J’espère que nous pourrons cette fois mettre la mesure en place.
Mesdames, messieurs les sénateurs, avec l’épisode de la crise financière aiguë des mois de septembre et d’octobre, nous sommes entrés très clairement dans une nouvelle ère, qui nécessite une approche neuve, un peu exceptionnelle, du traitement de l’hypothèse de croissance.
J’ai annoncé à la Haute Assemblée, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, que les hypothèses de croissance pour 2009 et pour 2010 étaient sensiblement revues à la baisse.
Je vous ai expliqué en quoi cette révision était responsable : elle est exceptionnelle comme la situation l’exige, mais elle est lucide, comme doit l’être le Gouvernement à l’heure où les agents économiques manquent de repères clairs et où même les experts se laissent parfois un peu affoler et régir par des principes d’urgence plutôt que de réalité.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, monsieur le rapporteur pour avis, mesdames, messieurs les sénateurs, face à l’incertitude de l’environnement économique et financier, l’État doit rétablir la confiance.
Pour lutter contre la crise, le Président de la République et le Gouvernement ont mis en place des mesures puissantes que Mme Christine Lagarde vient de détailler.
Cependant, rétablir la confiance, ce n’est pas seulement agir aujourd’hui, c’est également dire ce que l’on fera demain.
Dans la tourmente que traverse la planète, il faut que l’action du Gouvernement soit clairement définie à moyen terme pour pouvoir servir de repère, de point d’appui, de point fixe.
Le projet de loi de programmation des finances publiques, que nous vous présentons aujourd’hui avec Mme Christine Lagarde pour la première fois, répond à ce besoin.
J’avais souhaité cette innovation pour nos finances publiques dès notre arrivée, dans un souci de bonne gouvernance. Le Sénat la souhaitait également depuis longtemps.
Cette initiative se révèle aujourd’hui absolument indispensable : plus c’est difficile, plus il faut essayer de prévoir. Elle donne enfin une vision globale, non sur le seul périmètre de l’État, non pour une seule année, mais pour toute la sphère publique et sur toute la législature.
Pour jouer pleinement son rôle, il faut naturellement que cette loi soit la plus précise et la plus informée possible.
C’est pourquoi, comme nous l’avions promis avec Mme Christine Lagarde, nous vous présentons ce matin à la fois des hypothèses de croissance révisées et une trajectoire de recettes modifiées en conséquence.
Comme je m’y étais engagé, les dépenses n’ont pas été modifiées au-delà de l’incidence mécanique des hypothèses révisées sur la charge d’intérêt et les dépenses indexées. Ces dépenses traduisent donc toujours, et plus que jamais, une volonté de maîtrise dans la durée de la dépense publique. Cependant, nous ne coupons pas à l’aveugle pour compenser les plus faibles recettes.
Cela nous conduit donc de manière totalement transparente à afficher des déficits plus importants. Que contient en fait ce projet de loi de programmation des finances publiques ?
Il contient une trajectoire prenant en compte les effets de la crise, une maîtrise des dépenses sans précédent, détaillée par missions sur trois ans pour l’État et des principes de gouvernance forts, qui clarifient ce que nous ferions si les évolutions macroéconomiques et financières étaient différentes de ce que nous prévoyons aujourd’hui. Le chemin est ainsi balisé et les règles sont fixées. Dans la situation d’incertitude actuelle, c’est évidemment un élément très primordial.
Enfin, vous allez désormais voter un programme qui auparavant était envoyé directement à Bruxelles, sans passer par le Parlement. C’est une avancée majeure dans l’association du Parlement à la gestion des finances publiques et au respect de nos engagements.
Dès la présentation du projet de loi de programmation des finances publiques et du projet de loi de finances à l’Assemblée nationale, j’ai dit que nous ferions tout, si le besoin s’en faisait sentir, pour tenir compte de l’évolution de la situation économique, car la crédibilité et la sincérité ne se négocient pas.
Ces projets de loi étaient d’une parfaite sincérité lorsqu’ils ont été déposés : 1 % de croissance en 2009 était alors, Mme Christine Lagarde l’a rappelé, une hypothèse partagée par tous les économistes.
J’entends naturellement que, au cours des débats, ces textes de loi conservent leur sincérité et leur réalisme.
Cependant, il ne s’agit pas d’une tâche facile. La sincérité, cela ne signifie pas changer de prévisions tous les matins en fonction du cours de la Bourse. Je l’ai déjà dit à l’Assemblée nationale, le budget n’est pas marked to market.
Nous nous étions engagés, et nous le faisons aujourd’hui, à prendre quelques semaines de recul pour tenir compte des données nombreuses et souvent contradictoires, et en dégager la tendance la plus raisonnable.
Comme vient de vous l’expliquer Mme Christine Lagarde, après des analyses détaillées et précises, le Gouvernement revoit aujourd’hui sa prévision de croissance pour 2009. La loi de programmation est donc révisée sur la base de 0, 5 % de croissance en 2009, de 2 % en 2010 et de 2, 5 % en 2011 et 2012.
J’en ai bien évidemment tiré toutes les conclusions en termes de recettes et de déficits. Je vous l’avais annoncé très tôt, notre choix est de ne pas modifier la progression réelle des dépenses et de ne pas chercher à compenser par des augmentations de recettes la faiblesse de la conjoncture.
La volonté de vous apporter le plus vite possible les conclusions les plus récentes de nos travaux m’empêche de vous fournir dès aujourd’hui jusqu’aux derniers détails. Nous en sommes au stade de la programmation et nous aurons l’occasion d’entrer dans le détail lors du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Tout cela sera fait dans les meilleurs délais.
En tout état de cause, la vingtaine d’amendements que nous présenterons dès aujourd'hui vous permettra d’avoir une idée très précise de notre approche et de la situation.
Je veux dire maintenant un mot sur 2008. Crise financière ou pas, le mois de novembre est traditionnellement le mois du collectif budgétaire, qui permet de faire le point sur les recettes effectivement rentrées et les dépenses réellement effectuées. Il sera présenté au conseil des ministres le 19 novembre prochain.
Compte tenu des dernières données dont je dispose, je serai probablement amené à revoir les recettes fiscales de l’État à la baisse d’environ 2 milliards d’euros, notamment au titre de l’impôt sur les sociétés et de la TVA.
Le ralentissement de la masse salariale pèse également sur les recettes sociales. Au total, c’est un peu plus de 3 milliards d’euros de recettes en moins, soit un peu moins de 0, 2 point de PIB.
Le déficit initialement prévu à 2, 7 points de PIB est donc revu à 2, 9 points de PIB. Cette révision s’explique intégralement par une prévision de recettes la plus juste et honnête possible.
En ce qui concerne les dépenses, elles reposent sur le strict respect des dépenses votées par le Parlement, à l’exception – je le dis maintenant depuis de nombreuses semaines – des charges de la dette qui ont subi puissamment l’évolution de l’inflation au cours de l’année 2008.
Pour 2009, la révision de la croissance et de certains impôts qui sont particulièrement affectés par les évolutions récentes, comme l’impôt sur les sociétés – le rapport n’est pas totalement linéaire entre la croissance et l’impôt sur les sociétés –, me conduit à une révision du solde public d’environ 9 milliards d’euros, soit environ 0, 4 point de PIB.
La prévision initiale de déficit public de 2, 7 points de PIB est donc revue à 3, 1 points de PIB.
Il ne s’agit nullement de s’affranchir du pacte de stabilité et de croissance. La Commission européenne a d’ailleurs répété qu’elle tiendrait compte des circonstances exceptionnelles que l’ensemble de l’Europe connaît pour examiner la situation. C’est un débat qui a lieu depuis plusieurs semaines. Il s’agit simplement de laisser les recettes s’adapter à la crise.
L’important est de maintenir l’effort sur la dépense non seulement aujourd’hui, mais aussi quand la croissance sera revenue, pour ne pas retomber dans les mauvaises habitudes du passé. C’est la clé pour assainir durablement nos finances publiques.
Ce dépassement du seuil des 3 points de PIB doit naturellement être temporaire. Notre effort sur la dépense nous permettra de retourner sous ce seuil dès 2010 pour atteindre 2, 7 points de PIB.
C’est aussi cet effort dans la durée qui nous permettra de rétablir graduellement la situation : avec un retour, après 2 % en 2010, à une croissance de l’activité à 2, 5 % en 2011 et 2012 – modification globale de la prévision pluriannuelle –, la maîtrise de la dépense permettrait une nette amélioration du déficit à 1, 9 point de PIB en 2011 et à 1, 2 point de PIB en 2012.
Vous le voyez, comme nous l’avions promis, nous tirons en toute transparence, avec vous, les conséquences de la crise que nous vivons.
Ces révisions confortent la sincérité du projet de loi de programmation des finances publiques, ce qui est particulièrement important pour l’avenir.
Projetons-nous un instant l’année prochaine. Compte tenu de l’incertitude actuelle, nul ne peut prétendre que les hypothèses retenues seront vérifiées au dixième de pourcentage près pour la croissance ou pour l’inflation, à la centaine de millions d’euros près pour l’impôt sur les sociétés et la TVA.
Je continuerai donc, après le vote des lois de financement, à avoir, plus que jamais, un dialogue étroit avec la commission des finances du Sénat sur les évolutions en cours d’année. L’année 2009 sera très importante.
Les révisions effectuées étaient nécessaires, mais il est bien évident qu’elles ne remettent absolument pas en cause les engagements forts en termes de dépense et de gouvernance qui sont inscrits dans ce projet.
Soyons très clairs, la colonne vertébrale de ce projet de loi, quelle que soit la conjoncture du moment, est de réaffirmer la nécessité de réduire le poids exorbitant de la dépense.
Pourquoi devons-nous nous concentrer sur la maîtrise de la dépense ?
C’est la maîtrise de la dépense qui nous mettra en position de profiter d’un retour à meilleure fortune de l’économie internationale. Tout regain de croissance – à l’horizon de 2010, c’est le moins que l’on puisse espérer ! – aura alors des effets positifs, puissants et rapides sur nos finances publiques.
La maîtrise de la dépense garantit la solvabilité de l’État. Nous avons eu l’occasion de l’expliquer devant vous, le plan de financement de l’économie présenté par Mme Christine Lagarde fonctionne essentiellement via des emprunts garantis par l’État. En situation de crise, comme aujourd’hui, l’État est le seul à qui les marchés acceptent de prêter, le seul en qui les marchés ont confiance.
Or cette confiance se justifie par le rétablissement structurel de nos finances publiques, que seule une action déterminée sur la dépense peut garantir. La lutte contre les dépenses inefficaces et le plan de refinancement de l’économie ne se contredisent donc pas, bien au contraire. Pour que l’État soit solvable et puisse jouer tout son rôle, il faut accepter de le réformer et d’être économe de l’argent public.
On nous reproche aussi de ne pas être cohérents puisque nous aurions trouvé 360 milliards d’euro pour les banques – voire pour les banquiers, comme le veut la caricature trop souvent répétée – alors que nous réaffirmons sans arrêt la nécessité des économies. Je me permets de le dire à nouveau, le plan de refinancement de l’économie ne se résume en aucun cas à un renflouement des banques à fonds perdus, …
… il contribue évidemment au renflouement de l’économie. Les 360 milliards d’euros du plan ne sont aucunement comparables aux dépenses du revenu de solidarité active, de l’éducation nationale ou à toute autre dépense budgétaire. Ceux qui laissent croire le contraire sont peu inspirés, si vous me permettez l’expression. J’insiste donc, ce plan ne pèse pas sur les finances publiques, nous n’avons pas créé un « fonds » de 360 milliards d’euros dans lequel les banques pourraient venir puiser.
Les 40 milliards d’euros destinés à permettre des prises de participation seront financés par l’emprunt, ce qui augmente « facialement » la dette publique, mais cette dette est gagée sur des actifs, que nous espérons rentables à terme pour le contribuable. Pour ce qui concerne l’autre volet du plan, la garantie accordée par l’État ne représente pas une dépense, elle sera même payante, nous l’avons dit à plusieurs reprises.
Je voudrais donc vous décrire en quelques mots les vraies dépenses inscrites dans ce projet de loi : elles tirent les conséquences du passé, elles préparent l’avenir et elles traduisent une recherche systématique d’efficacité.
Tout d’abord, il nous faut affronter les contraintes héritées du passé. À ma place, au-delà des graves enjeux conjoncturels, faire preuve de responsabilité, c’est oser dire que le passé nous rattrape et qu’il faut en tirer les conséquences. Le passé nous rattrape du fait de la dette publique accumulée ces trente dernières années.
Je vous l’ai dit l’an dernier, le temps est révolu où la baisse des taux d’intérêt servait d’anesthésiant à la progression de la dette ; c’est le moins que l’on puisse dire cette année. Je vous ai prévenus depuis dix-huit mois que les « bonnes surprises » sur les intérêts appartenaient au passé. Cette année, la charge de la dette augmente de 4 milliards d’euros ; c’est absolument considérable par rapport à ce que nous avons pu connaître dans le passé !
Ce passé nous rattrape aussi par la démographie. Les dépenses de pensions traduisent l’arrivée à l’âge de la retraite des générations du baby boom : pour les finances publiques, il en résulte un surcroît de dépenses de 13 milliards d’euros par an. Nous avons confirmé la prolongation de la durée de cotisation retraite décidée en 2003 et nous avons mis en place un plan ambitieux pour les seniors. Mais il faudra assurément nous retrouver en 2010 pour procéder à l’état des lieux.
La progression de la charge de la dette et des pensions nous est imposée, au moins à moyen terme. Mais faisons-nous le nécessaire pour le reste des dépenses ?
Je le dis haut et fort : la maîtrise de la dépense est sans précédent et doit évidemment le rester. J’ai construit pour les trois ans à venir trois budgets sincères : trois budgets où les dépenses des ministères sont stabilisées en valeur – la crise ne doit pas être l’occasion de relâcher cet effort – ; trois budgets où je poursuis la remise à niveau des dotations historiquement sous-dotées – les remboursements à la sécurité sociale, les opérations extérieures de la défense, dépenses auxquelles vous êtes particulièrement sensibles, mesdames, messieurs les sénateurs – ; trois budgets, enfin, où je clarifie les financements de la protection sociale agricole – au travers du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, le FFIPSA – et des infrastructures de transport – avec l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, l’AFITF. La crise actuelle montre bien l’importance de comptes justes, car il a beaucoup été question de comptabilité dans cette crise.
Cet exercice a requis une énorme volonté politique : c’est le fruit du travail de tout le Gouvernement, sous l’autorité et la vigilance du Premier ministre.
Concrètement, je vous avais dit que je diviserais par deux le rythme de croissance de la dépense publique en euros constants, c’est ce que nous ferons cette année : en 2008, le taux de croissance de la dépense publique s’élèvera à environ 1 %. Depuis plusieurs années, cet objectif était fixé et, immanquablement, n’a jamais été atteint ; il en va, enfin, différemment cette année : nous allons l’atteindre grâce à la maîtrise des dépenses de l’État, hors charge de la dette, et grâce à la maîtrise des dépenses de santé. Chaque année, nous réalisons 10 milliards d’euros d’économies par rapport à la tendance historique.
En ce qui concerne l’État, les dépenses de personnel, d’intervention et de fonctionnement des ministères en euros courants sont stabilisées sur la législature.
C’est énorme ! Et la crise actuelle ne remet pas en cause cet effort ! Quant à la croissance des dotations aux collectivités locales, elle est limitée à l’inflation.
Si tous ces efforts avaient été réalisés sur les dix dernières années, le budget de l’État serait tout simplement à l’équilibre. J’insiste sur ce point parce que je veux que tout le monde en ait bien conscience : si cette politique avait été menée depuis dix ans, nous pourrions tenir un autre discours aujourd’hui. C’est donc la persévérance sur la durée qui compte et non la variation de pression : nous serions dans une position tellement plus favorable pour affronter la crise actuelle et préparer l’avenir !
Ce budget triennal se résume à une recherche d’efficacité dans tous les domaines. Toutes les économies issues, notamment, des travaux engagés dans le cadre de la révision générale des politiques publiques ont été exploitées.
Pour la première fois, grâce à cette méthode de recherche systématique d’efficacité des dépenses, nous n’allons pas remplacer près d’un départ à la retraite sur deux dans la fonction publique, ce qui représente une baisse des effectifs de 30 600 emplois. En une année, nous faisons autant que tous les efforts réalisés pendant le quinquennat précédent !
Cet effort intervient sans reporter la charge sur les opérateurs. Pour la première fois, grâce aux directives que j’ai données à l’ensemble des représentants de l’État, leurs effectifs baisseront de plus de mille en 2009.
Grâce à cette méthode également, tous mes collègues ont obtenu les moyens de leurs politiques, sans qu’il soit besoin de leur attribuer les 13 ou 14 milliards d’euros supplémentaires qu’ils réclamaient au départ.
Enfin, grâce à cette méthode, nous avons pu saluer l’effort des fonctionnaires en matière de réforme de l’État en leur rendant, conformément à l’engagement du Président de la République, 50 % des économies réalisées avec les suppressions d’emplois. J’ajoute, au passage, que nous avons mis fin, avec M. André Santini, à la pratique surréaliste qui consistait à négocier le point d’indice de la fonction publique après le vote du budget : nous avons mené ces discussions très en amont et pour les trois prochaines années.
Il n’était pas possible d’exempter les collectivités locales de cet effort sans précédent sur les dépenses.
Je sais que les relations entre l’État et les collectivités locales sont complexes, mais nous respectons nos engagements : les concours de l’État aux collectivités territoriales se verront appliquer la même norme d’évolution que celle des dépenses globales de l’État, c’est-à-dire l’inflation. Pour 2009, exceptionnellement, …
Vous connaissez la suite de mon discours, monsieur le rapporteur général ?
En 2009, exceptionnellement, ces concours progresseront même plus rapidement que l’inflation, puisque nous avons révisé nos prévisions comme vous l’a dit Mme Christine Lagarde. En effet, pour respecter la règle, il aurait fallu aligner l’indexation des concours sur l’inflation révisée à la baisse à 1, 5 %. De votre côté, vous vous apprêtiez, sans doute, à demander une augmentation de ces concours au-delà de l’inflation initialement prévue dans le projet de loi de finances. Nous ne ferons ni l’un ni l’autre : nous en resterons donc à une progression de 2 %, soit 1, 1 milliard d’euros d’augmentation.
D’une certaine façon, nous acceptons d’ajouter 0, 5 % aux 1, 5 % annoncés, afin d’aider les collectivités locales dans leur politique d’investissement.
Au sein de cette enveloppe, la priorité a été donnée à l’investissement, puisque le Fonds de compensation pour la TVA est préservé et progresse de 660 millions d’euros. J’ajoute que l’État a répondu présent pour assurer le sauvetage de Dexia et a garanti son refinancement, afin d’apporter le soutien nécessaire dans cette crise au financement des collectivités locales. Nous demandons donc un effort aux collectivités locales, mais il sera accepté parce qu’il est juste.
L’effort portera également sur la sécurité sociale. En 2009, la conjoncture pèsera bien évidemment sur la progression des cotisations et sur le déficit du régime général mais l’effort sur la dépense permettra de limiter cette dégradation à 2 milliards d’euros. Pour l’assurance maladie, l’accroissement de l’objectif national de dépenses de l’assurance maladie, l’ONDAM, est fixé à 3, 3 % pour chaque année d’ici à 2012. Ce chiffre nous permet d’éviter deux écueils : l’optimisme de façade, qui est d’afficher par facilité un objectif que l’on sait impossible à atteindre, et la résignation, qui est de laisser les dépenses croître plus vite que les ressources.
La tenue des dépenses en 2008 en témoigne, il existe une voie médiane : l’ambition peut être réaliste, quand on s’en donne les moyens, et le taux de 3, 3 % me semble répondre à ce critère.
Mais pour aller vers l’équilibre de l’assurance maladie, …
… il nous faut consentir collectivement un effort gigantesque. Nous ne résorberons pas les déficits de l’assurance maladie par la seule intervention de la loi, j’en suis convaincu – sinon, nous y serions déjà parvenus ! –, mais nous le ferons par des changements de comportement et par une action puissante et sans relâche des gestionnaires. Je n’accepte pas de faire passer l’efficacité par pertes et profits sous prétexte que seule la qualité compte ; et la situation conjoncturelle n’est pas en cause : il est possible d’allier qualité et efficacité.
Nous aurons naturellement l’occasion de discuter prochainement en détail le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le Gouvernement y prend toutes ses responsabilités : il reprend la dette du régime des salariés comme des exploitants agricoles, il apporte des recettes nouvelles à l’assurance maladie comme à l’assurance vieillesse, il fixe des objectifs de dépenses réalistes.
L’État peut-il faire plus ? Oui, en plaçant chaque gestionnaire – des partenaires sociaux aux personnels soignants, du Gouvernement aux caisses d’assurances maladie – face à ses responsabilités, afin que son seul souci soit de respecter les objectifs qui lui ont été fixés. Il ne faut plus considérer que le dépassement de l’ONDAM va de soi, qu’il résulte d’une sorte de droit non écrit.
Cet effort de réduction de la dépense publique marqué dans la durée est un apport majeur de la loi de programmation. En avons-nous fait assez ? En avons-nous fait trop ? Comme pour un avion, il faut calibrer l’effort pour un atterrissage réussi ! Avec une baisse trop brutale, notamment en période de crise – c’est vrai pour les dépenses de la sécurité sociale comme pour les dépenses de l’État – on risque la dépressurisation et l’accident. L’effort que nous entreprenons est régulier, il est calibré pour la période que nous traversons : plus brutal, il serait dangereux ; il favoriserait non pas la reprise, mais la « recrise ».
Surtout, la maîtrise des dépenses ne doit pas se réaliser au détriment des dépenses prioritaires, celles qui nous permettront précisément de traverser la crise et de profiter au mieux de la reprise à venir. La recherche et l’enseignement supérieur, le « Grenelle de l’environnement », la valorisation du travail sont au cœur de ce budget pluriannuel : ces investissements sont véritablement porteurs de l’avenir et donc de la sortie de crise.
Des moyens sans précédent sont dégagés pour la recherche et l’enseignement supérieur : ils représentent 1, 8 milliard d’euros supplémentaires par an. Ils permettront le financement des chantiers engagés par le Gouvernement et voulus par le Président de la République : autonomie des universités, excellence de la recherche publique et dynamisation de la recherche privée.
L’effort en faveur de l’investissement civil, en particulier des infrastructures, augmentera de près de 6 % en 2009. Au total, en tenant compte des partenariats public-privé, les investissements dans les infrastructures devraient quasiment doubler entre 2007 et 2012.
Concernant les recettes, je l’ai dit, nous ne compenserons pas la faiblesse de la conjoncture par des hausses d’impôts. Faut-il pour autant bloquer toute évolution de la fiscalité et camper dans l’immobilisme ?
Évidemment, non ! Mme Christine Lagarde y reviendra dans le détail lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2009, mais les mesures fiscales qui y sont proposées sont globalement équilibrées. Sauf à être immobiles, nous devons accepter que certains impôts augmentent, parce que c’est l’intérêt général, pour que d’autres diminuent.
Mais il faut reconnaître que le bilan pour cette année n’est qu’une petite partie de l’histoire. Je veux le rappeler très clairement : les mesures décidées depuis le début de la législature représentent plus de 10 milliards d’euros de baisse des prélèvements obligatoires. C’est difficile dans le contexte actuel, mais il faut le faire ! Toute polémique à ce sujet ne peut survivre longtemps à l’analyse objective des faits.
Sécuriser les recettes est crucial. Votre commission des finances, en particulier son président comme son rapporteur général, partage, je le sais, cet avis. Créer des niches fiscales pour remplacer la dépense budgétaire ne résout rien ! La loi de programmation des finances publiques est particulièrement novatrice sur ce chapitre de la sécurisation des recettes. Pour la première fois, en effet, nous présentons une évolution pluriannuelle des recettes et nous établissons des règles sur les niches fiscales comme sur les niches sociales.
Cela devenait impératif : le projet de loi prévoit désormais une évaluation des crédits d’impôt, un objectif annuel de dépenses fiscales et garantit qu’il sera mis un terme à la prolifération des niches fiscales et sociales.
Je sais que votre rapporteur a fait de nouvelles propositions allant dans ce sens, que Christine Lagarde et moi-même accueillerons favorablement, notamment celles qui tendent à rendre les niches fiscales « à durée déterminée ».
Ces règles sur les dépenses fiscales sont une avancée majeure dans la maîtrise des finances publiques. Par le passé, les dépenses étaient encadrées par la seule norme de dépense budgétaire, le fameux « zéro volume ». Force est de constater cependant que cette norme a été contournée par le développement de la dépense fiscale.
Après l’élargissement de la norme intervenu l’année dernière et les rebudgétisations, c’est donc un nouveau pas que nous accomplissons ensemble aujourd’hui dans notre gouvernance des finances publiques. Nous corrigeons ainsi les effets pervers des règles du passé.
En résumé, mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi de programmation des finances publiques traduit une véritable stratégie, sortant du cadre strictement annuel et du seul budget de l’État, en sécurisant les recettes et en inscrivant la réforme de l’État dans la durée.
Ce texte prend en compte la situation particulièrement difficile que nous connaissons, car rien ne serait pire que de la nier. Il peut, je crois, donner lieu à une discussion éclairée et responsable de nos finances publiques. À mes yeux, il montre le chemin pour préparer au mieux l’avenir : un effort sans précédent, durable, documenté sur la dépense publique nous permettra de traverser cette crise et d’assainir à terme nos finances publiques.
Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, ce que je souhaitais vous dire aujourd’hui, avec le plus de précisions possibles, à l’occasion de ce débat.
Vifs applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, madame le ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d’abord saluer les deux interventions que nous venons d’entendre et plus particulièrement l’effort de transparence et de sincérité qu’elles traduisent.
En effet, et je voudrais m’attarder quelques instants sur ce point, l’appréciation du contexte macroéconomique est naturellement, dans la conjoncture actuelle, l’un des aspects les plus délicats lorsqu’il s’agit d’élaborer des documents budgétaires, qu’ils soient annuels ou pluriannuels. Trop souvent, mes chers collègues, j’entends le Gouvernement s’approprier, en quelque sorte, des prévisions de croissance ou des chiffres de la croissance.
Mme le ministre et M. le ministre sourient.

Parler au nom du Gouvernement de « sa » prévision de croissance - permettez-moi de le dire en toute sincérité, fort des convictions que j’exprime avec constance à cette tribune depuis longtemps - me paraît être une erreur. Il n’y a pas de taux de croissance du Gouvernement, cela n’existe pas, pas plus que de taux de croissance du Parlement ou des pouvoirs publics.
Sourires

Le seul vrai taux de croissance, par définition, est celui que l’on constatera a posteriori.
Mme le ministre acquiesce.

Mais comme, bien entendu, il faut prévoir et élaborer des documents budgétaires, des hypothèses doivent être retenues. Il convient donc de parler d’hypothèses de croissance ou, plus largement, d’hypothèses macroéconomiques concernant l’inflation, les prix de l’énergie ou les parités monétaires.

Si l’on veut aller jusqu’au bout du raisonnement, il convient, me semble-t-il, non pas de focaliser son attention sur un chiffre par grande donnée macroéconomique, mais plutôt de se fixer des fourchettes, en particulier en matière de taux de croissance. C’est ce que Mme Christine Lagarde a fait en évoquant tout à l’heure un taux de croissance de 0, 2 % à 0, 5 %, et c’était une première.
L’important n’est pas le chiffre en valeur absolue ; c’est de reconnaître que l’aléa existe et de ne pas commettre, en quelque sorte, de péché d’orgueil. En effet, rien ne nous dit que les conjoncturistes des banques ou de différents instituts français et internationaux aient davantage la vérité révélée que ceux de l’INSEE, du Centre d’analyse stratégique ou de ce qu’on appelait naguère la direction de la prévision.
L’essentiel pour nous, dans notre fonction délibérative portant sur les lois de finances et, à présent, pour la première fois, sur une loi triennale de programmation des finances publiques, est de réfléchir sur la base de raisonnements, de données, dans un monde incertain.
Je salue donc l’exercice de sincérité du Gouvernement. J’espère que, pour l’avenir, on saura en tirer les conséquences et que l’on raisonnera, tant pour les recettes que les dépenses et le solde, en termes de fourchette. Si la situation est relativement médiocre, on n’engagera qu’un minimum de dépenses ; si elle est meilleure, on débloquera des dépenses supplémentaires qui pourront être affectées à des projets ou à des fonctions identifiées à l’avance. C’est un budget transparent - qu’il s’agisse de la sécurité sociale ou de l’État, nous pouvons raisonner de la même manière - susceptible de s’ajuster à la conjoncture économique.
Il me semble, en outre, que le Gouvernement est tout à fait fondé à mettre l’accent sur les normes de dépenses, car, dans les temps difficiles que nous connaissons, seule la dépense publique centralisée est susceptible d’être contrôlée de manière relativement certaine. La dépense publique centralisée, mes chers collègues, c’est la dépense de l’État, de ses démembrements et celle des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale. En d’autres termes, la dépense centralisée est celle qui doit obéir aux normes proposées par le Gouvernement et votées par le Parlement.
Il existe d’autres dépenses publiques qui ne sont pas centralisées. Par définition, ce sont les dépenses de nos collectivités territoriales. On peut en faire une addition, une consolidation, mais rien de plus, car c’est bien le conseil municipal, le conseil communautaire, le conseil général, le conseil régional qui vote sa dépense, équilibrée par la fiscalité et les ressources correspondantes.
S’il est logique et légitime de faire figurer une prévision de la dépense locale dans une programmation triennale des finances publiques, pour autant, les chiffres qui se situent à ce niveau ne sont pas de même nature que ceux qui sont relatifs à la dépense publique centralisée. Cela motive d'ailleurs un amendement de principe que notre commission vous soumettra.
S’agissant des collectivités territoriales, sujet auquel nous sommes particulièrement sensibles, je voudrais souligner une avancée très significative, très concrète que le ministre du budget vient, ce matin, de présenter devant notre assemblée : en 2009, l’enveloppe globale des concours de l’État aux collectivités territoriales – je l’appelle encore « l’enveloppe normée » - évoluera donc à un demi-point au-dessus de l’inflation, dont le taux révisé est de 1, 5 %, ce qui représente, mes chers collègues, environ 275 millions d’euros supplémentaires...

C’est une nouvelle qu’il faut apprécier à sa juste valeur, car, monsieur le ministre, elle traduit le fait que vous nous avez entendus avant même que se soit ouvert le débat budgétaire, qui va notamment être focalisé sur ces questions.
Vous nous avez entendus parce que, en tant que maire et président d’une communauté de communes, vous connaissez la réalité des choses et du pilotage de la gestion locale.
Vous nous avez entendus parce que vous savez que, durant la phase de conjoncture basse, de stagnation et, peut-être, l’an prochain, de récession que nous connaîtrons, l’activité des collectivités territoriales sera un élément conjoncturel très important. En matière d’investissement comme en matière de dépenses de solidarité, on va se tourner plus particulièrement vers les communes, les intercommunalités, les départements et même les régions pour mettre en œuvre quelques amortisseurs face à la dureté de la crise.
Qu’il s’agisse des petites et moyennes entreprises, notamment dans la branche du bâtiment et des travaux publics, qu’il s’agisse des personnes que la crise peut temporairement laisser sur le bord de la route, ce sont bien les budgets locaux qui joueront un rôle important d’amortisseur. À cet égard, les 275 millions d’euros - c’est un ordre de grandeur -, se situant au-delà de l’hypothèse d’inflation révisée à 1, 5 %, seront un amortisseur non négligeable et permettront sans doute de rendre plus facile l’examen, dans quelques semaines, des concours pour 2009 aux collectivités territoriales.
Je terminerai cet exposé par l’évocation rapide des amendements que la commission des finances a adoptés.
Tout d’abord, comme vous l’avez dit à juste titre, monsieur le ministre, il y avait un risque d’évasion par rapport à la norme de dépense qu’en d’autres temps nous avions intitulé l’ « agencisation » de l’État, c’est-à-dire l’imputation, sur des organismes proches de l’État, en général des établissements publics, de dépenses, notamment des dépenses de personnel, hors de la norme globale de dépense. Vous venez de nous dire – c’est une première, et elle mérite d’être saluée – que, pour 2009, les effectifs du personnel affecté à ces démembrements de l’État vont se voir appliquer la règle de base en vigueur pour la gestion des effectifs de la fonction publique au sens strict.
Mais une redoutable dérive demeure encore possible, vous le savez, avec les dépenses fiscales.
La dépense fiscale est la plus grande tentation qui peut menacer encore les ministres - je parle des ministres dépensiers, non de vous, bien entendu !
Sourires

… de cette tentation, il faut se prémunir. Le Sénat, en particulier, est là pour veiller au bon comportement en matière de finances publiques sur la durée, comme vous le souhaitez, madame le ministre de l’économie, monsieur le ministre du budget. D’où les amendements que nous avons préparés et qui, je le suppose, rencontreront vos propres préoccupations.
La révision des hypothèses macroéconomiques prises en compte par le Gouvernement entraîne mécaniquement le dépôt d’une série d’amendements ; ils seront examinés par la commission des finances à l’occasion de la suspension de séance.
Il est particulièrement important que le Sénat soit le lieu d’un vrai débat, qui soit en prise avec l’actualité immédiate, tout en s’inscrivant dans une perspective plus large.
De grâce, n’ajoutons pas la crise à la crise ! Arrêtons de faire des cadeaux fiscaux, parce que nous n’en avons plus les moyens, et trouvons des solutions nous permettant de gérer avec continuité et persévérance la norme de dépense, mais aussi de faire en sorte qu’un euro de dépense fiscale soit traité exactement de la même façon qu’un euro de dépense budgétaire, en prévision comme en réalisation.
Voilà, mes chers collègues, les principales préoccupations dont je souhaitais vous faire part au nom de la commission des finances.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons fini par en prendre l’habitude, les médias considèrent que la messe est dite dès lors qu’un texte a été examiné par l'Assemblée nationale et, de manière générale, se font assez rarement l’écho des travaux du Sénat.
Nous démontrerons une nouvelle fois au cours de l’examen des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2009 que le Sénat est souvent une force de propositions. Même si ces dernières ne sont pas retenues immédiatement, elles finissent souvent par l’être l’année suivante, soit par le Gouvernement, soit par l'Assemblée nationale.
Sourires

Madame la ministre, monsieur le ministre, vous avez réservé au Sénat l’annonce de votre volonté de jouer la transparence, la crédibilité et le réalisme en ce qui concerne les prévisions macroéconomiques. Je salue cet effort et vous en remercie, après Philippe Marini.
Nos concitoyens auraient sans doute eu du mal à comprendre qu’il en aille autrement et que l’on ne tienne pas compte de la crise financière dans les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale.
Ces textes ayant été établis avant la crise, la commission des affaires sociales a procédé à leur examen en se fondant sur les prévisions macroéconomiques de l’été.
Comme vous l’avez souligné, madame Lagarde, l’examen du projet de loi de programmation des finances publiques est une première. Il intervient quelques semaines seulement après la révision constitutionnelle, promulguée le 23 juillet dernier. Je salue la rapidité avec laquelle le Gouvernement a mis en œuvre une réforme que nous appelions de nos vœux depuis un certain temps déjà et que les différentes conférences des finances publiques tenues ces deux dernières années ont permis de préparer.
Ce premier projet de loi de programmation comporte, outre un cadrage macroéconomique et des objectifs sur lesquels je reviendrai plus loin, plusieurs règles de gouvernance, notamment en matière de recettes et de niches sociales.
La commission des affaires sociales ne peut que s’en féliciter, car ces règles sont proches de celles qu’elle avait elle-même préconisées à plusieurs reprises, en particulier dans le cadre d’une proposition de loi organique dont le président de la commission Nicolas About et moi-même étions les auteurs, et qui a été votée par le Sénat le 22 janvier 2008.
Le Parlement est donc conduit à approuver la stratégie du Gouvernement en matière de finances publiques, stratégie que ce dernier élaborait jusqu’à présent lui-même, à l’occasion de la transmission, au début du mois de décembre, du programme de stabilité à la Commission européenne.
Que les assemblées se prononcent, en toute transparence, par un vote sur cette programmation est véritablement un progrès. Nous nous souvenons en effet d’une période, pas si lointaine, où ces prévisions revêtaient un caractère tellement confidentiel que le Parlement et ses commissions financières n’en étaient même pas destinataires.
L’approche globale que cette nouvelle catégorie de lois nous permet d’avoir sur les comptes publics, en intégrant les finances de l’État, celles de la sécurité sociale et celles des collectivités locales dans un même ensemble et en les inscrivant dans une perspective pluriannuelle, représente également une avancée intéressante.
Jusque-là, nous ne pouvions avoir un débat général que sur l’évolution des prélèvements obligatoires : l’année dernière, il s’est tenu à la même époque ; il a lieu aujourd'hui, en même temps que la discussion du présent projet de loi.
Si l’exercice est très utile en ce qu’il permet un débat d’ensemble, il ne concerne cependant qu’un aspect du sujet, à savoir les recettes. Pour les dépenses, la réflexion était d’habitude renvoyée aux projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale, et ce pour la seule année suivante. Philippe Marini a eu raison de considérer tout à l’heure qu’il y avait lieu d’intégrer dans ces prévisions les dépenses et les recettes, et de mener notre réflexion sur l’ensemble.
En matière sociale, nous étions toutefois plus avancés puisque, depuis le vote de la loi organique du 2 août 2005, le projet de loi de financement de la sécurité sociale est accompagné d’une annexe B qui comporte une projection pour les quatre années à venir, tant pour les recettes que pour les dépenses, à la fois pour le régime général et l’ensemble des régimes de base.
Nous avons beaucoup critiqué cette annexe même si, d’année en année, nous avons pu constater une certaine amélioration. S’il faut en faire un bilan, je dirais que, malgré ses limites, notamment en termes de fiabilité et de durabilité des projections – je vous engage à regarder le tableau qui figure dans mon rapport écrit et qui retrace ces projections depuis l’origine –, l’annexe a le mérite incontestable de proposer une trajectoire et de faire apparaître des tendances qui montrent avec beaucoup de clarté les difficultés qui jalonnent le chemin de retour à l’équilibre.
La programmation qui nous est proposée aujourd’hui par le Gouvernement intervient, cela a été souligné, dans un contexte économique tout à fait exceptionnel.
La crise financière des dernières semaines et ses conséquences sur l’économie réelle sont des facteurs majeurs d’incertitude qui, malheureusement, remettent pour partie en cause la pertinence de l’exercice qui nous est proposé, mais pour partie seulement.
Je note au passage qu’aucun institut de prévision n’est actuellement capable de prédire l’ampleur de la récession, de chiffrer de façon fiable l’impact de la crise actuelle sur notre économie, sur la croissance et sur l’emploi à moyen terme, c’est-à-dire pour l’horizon de cette programmation ou, tout du moins, pour l’année 2009. Je cite dans mon rapport les dernières perspectives de l’OFCE, rendues publiques voilà à peine une semaine. Comme vous l’avez précisé, madame la ministre, de multiples précautions entourent le détail des deux scénarios envisagés.
Pour ce qui concerne plus particulièrement les finances sociales, l’hypothèse macroéconomique centrale est celle de l’augmentation de la masse salariale, masse qui, je vous le rappelle, représente, pour la sécurité sociale, les trois quarts de l’assiette de ses recettes. Cette augmentation est estimée, dans le projet de loi comme dans l’annexe B du PLFSS pour 2009, à 3, 5 % en 2009 et à 4, 6 % par an les trois années suivantes. Ces prévisions seront corrigées cet après-midi à l’initiative du Gouvernement pour faire preuve d’un plus grand réalisme et d’un maximum de transparence.
Ces taux étaient évidemment très volontaristes. Or un point de masse salariale en moins représente une baisse de 2 milliards d’euros de recettes pour la sécurité sociale, et une difficulté supplémentaire pour revenir vers l’équilibre en 2012, ce qui est l’objectif fixé dans le projet de loi pour le régime général.
Comme je l’avais souligné devant mes collègues de la commission des affaires sociales, notamment ceux de l’opposition qui avaient dénoncé le caractère trop optimiste des prévisions macroéconomiques, il est fort probable que nous soyons amenés, avec le Gouvernement, à réviser ces prévisions et que l’équilibre ne soit atteint qu’en 2013, au lieu de 2012. Nous espérons que la conjoncture à partir de 2010 ou 2011 permettra un tel rattrapage.
En tout état de cause, il faut faire preuve de prudence et ne pas bercer nos concitoyens d’illusions sur le sujet. Il faut savoir se montrer courageux et réaliste : c’est ce que fait le Gouvernement, et je ne peux que l’en féliciter.
Dans le rapport annexé au projet de loi, trois éléments sont cités comme indispensables pour parvenir à l’équilibre.
Premièrement, il faut disposer d’une base financière assainie, ce qui suppose de régler trois problèmes : le transfert de la dette sociale à la Caisse d’amortissement de la dette sociale – le Gouvernement exauce le vœu que nous avions exprimé l’année dernière puisque ce transfert est prévu dans le PLFSS pour 2009 – ; le traitement de la situation structurellement déficitaire du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles – problème qui sera partiellement réglé cette année, notamment dans son volet « branche maladie » –, et la clarification des relations financières entre l’État et la sécurité sociale.
Ces trois questions sont traitées dans le cadre du PLFSS pour 2009, mais – je me permets de le souligner – de manière imparfaite.
En effet, si le transfert de la dette sociale à la CADES est bien effectué, toutefois, comme je vous l’avais déjà indiqué, monsieur le ministre, lors de votre audition devant la commission des affaires sociales, cela entraînera malgré tout une fragilisation du Fonds de solidarité vieillesse, en raison du dispositif qui a été imaginé.
Seul est résolu le problème de la branche maladie du FFIPSA, le déficit de sa branche vieillesse restant entier.
Par ailleurs, si de réels progrès ont été réalisés dans les relations financières entre l’État et la sécurité sociale, nous devrons bien constater qu’une dette s’est reconstituée à hauteur de 3, 5 milliards d’euros à la fin de l’exercice 2008. Cela étant, monsieur le ministre, vous nous avez annoncé, en commission, votre intention d’honorer, dans le cadre du prochain collectif, au moins une partie de cette dette, pour un milliard d’euros. Nous ne pouvons que nous en féliciter.
La dégradation de la conjoncture actuelle accroît toutefois les risques sur le montant de cette dette. J’ai noté également votre souci de faire en sorte de « coller » le mieux possible aux besoins de dotations, je pense notamment à l’allocation aux adultes handicapés, à l’aide médicale de l’État et à l’allocation de parent isolé, respectivement l’AAH, l’AME et l’API.
Deuxièmement, pour revenir à l’équilibre, il nous faut parvenir à maîtriser la dépense, M. le ministre et M. Philippe Marini ont insisté sur ce point. L’objectif n’est chiffré que pour la branche maladie, avec un taux d’évolution annuel de l’ONDAM fixé, par l’article 7 du projet de loi, à 3, 3 % pour l’ensemble de la période.
Monsieur le ministre, vous avez annoncé que, malgré la révision des données macroéconomiques, vous mainteniez une progression à 3, 3 % pour cette année et pour le futur exercice, ce qui signifie que le même effort est accompli pour la sécurité sociale et pour les collectivités territoriales. Nous ne pouvons que nous en réjouir.
Ce pourcentage correspond à une croissance des dépenses de maladie inférieure à la croissance du PIB. Cet objectif, certes ambitieux, n’est pas inatteignable, puisque nous l’avons atteint en 2008, même s’il y a eu un petit dérapage par rapport aux prévisions. Nous devrions en effet finir l’année 2008 avec une progression de l’ONDAM de l’ordre de 3, 3 %.
Mes chers collègues, il faut bien en avoir conscience, maintenir ce taux sur toute la période de programmation suppose de trouver, chaque année, 2 milliards d’euros d’économies nouvelles pour contenir la progression des dépenses à 5 milliards d’euros par rapport à l’année précédente. Or, je vous le rappelle, la tendance pour les dépenses de santé est plutôt de l’ordre de 7 milliards d’euros par an. On ne peut pas, en effet, avoir pour les dépenses de santé la même maîtrise comptable que celle qui est exigée par M. le rapporteur général pour les dépenses centralisées de l’État.
Pour parvenir au respect de cette norme, il est impératif de mobiliser toutes les marges qui existent, en poursuivant les efforts sur la maîtrise des dépenses de soins de ville. Depuis quelques années, pour ces soins de ville, de réels efforts ont été réalisés, avec des résultats indéniables. En ce qui concerne l’hôpital, permettez-moi l’expression, je reste sur ma faim ! Des progrès importants restent à faire, et il est particulièrement urgent d’agir, car nous n’avons que trop attendu. Il y a lieu de maintenir l’effort en renforçant la gestion des risques à l’hôpital.
Nous sommes persuadés que l’on peut encore réaliser des économies dans ces différents secteurs, mais cela ne sera pas facile.
Les dépenses des autres branches doivent se contenter de quelques paragraphes dans le rapport annexé au projet de loi. J’en profite pour vous faire observer que, comme à l’accoutumée, ce rapport consacre trois fois plus de développements au budget de l’État qu’aux dépenses de sécurité sociale. Je regrette en particulier que si peu de précisions soient apportées pour la branche vieillesse, dont le déficit dépasse maintenant les 5 milliards d’euros. Certes, l’évolution des dépenses de retraite dépendra essentiellement des progrès que l’on pourra constater en matière d’emploi des seniors et des décisions qui seront prises dans le cadre du « point d’étape » de 2010. Mais les pistes de réformes possibles auraient au moins mérité d’être mentionnées et évaluées.
Je suis d’ailleurs persuadé que la principale raison pour laquelle nos concitoyens semblent systématiquement chercher à anticiper leur départ à la retraite tient au manque de lisibilité en la matière. C’est donc un sujet sur lequel il faudra un peu plus nous pencher l’année prochaine.
Troisièmement, je vois un dernier pilier du retour à l’équilibre dans la sécurisation des recettes. Celle-ci exige que soient réunies deux conditions : le retour de la croissance et la préservation des recettes actuelles. J’espère qu’il ne s’agit pas d’un vain mot et que les recettes seront effectivement au rendez-vous.
Monsieur le ministre, vous avez annoncé de nouvelles recettes pour la branche vieillesse résultant d’un basculement des cotisations de l’UNEDIC. Permettez-moi de vous inviter à regarder tout cela d’un peu plus près, car, avec le retournement de conjoncture, nous n’atteindrons peut-être pas le niveau espéré.

Le retour à la croissance est évidemment très difficile à prévoir. Cela étant, on peut aussi chercher à préserver les recettes existantes, notamment en veillant à ne pas multiplier les exemptions d’assiettes, les exonérations de charges et contributions sociales, bref en limitant le développement des « niches sociales ». Je constate d’ailleurs, mais nous en reparlerons au moment de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, que cela n’a pas été vraiment le cas en 2008, puisque pas moins de sept niches sociales supplémentaires ont été créées à l’occasion de l’examen de textes de loi ordinaire, et ce sans compensation.
Vous le savez, la commission des affaires sociales s’intéresse à cette question depuis plusieurs années.
Nous avons ainsi proposé successivement, avant que le Gouvernement et l’Assemblée nationale ne s’emparent de ces idées, la taxation des stock-options ou l’instauration d’une flat tax sur les niches sociales.
Nous avons également cherché à limiter la création d’exonérations de charges dans les textes de loi ordinaire en déposant, puis en faisant voter par le Sénat une proposition de loi organique sur ce sujet. Malheureusement, à chaque fois, nos initiatives ont été repoussées… pour mieux être, l’année suivante, reprises et finalement adoptées !
Sourires

M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis. Comme quoi il ne faut jamais désespérer !
Nouveaux sourires.

Dans le cadre de la discussion du PLFSS pour 2009, la commission des affaires sociales fera de nouvelles propositions la semaine prochaine, je pense notamment à l’extension du forfait social de 2 % à l’ensemble des assiettes exemptées ou bien au ciblage des allégements généraux de charges sociales sur les entreprises de moins de cinquante salariés. Nous estimons en effet que le moment est venu d’ouvrir un débat sur les allégements de charges, qui avoisinent 25 milliards d’euros pour les seuls allégements dits Fillon. Quel est leur impact véritable en termes d’emplois ?

Où se trouve la limite entre utilité réelle et effet d’aubaine ?
Prenons l’exemple, au hasard, de la grande distribution. Ne profite-t-elle pas de l’effet d’aubaine des allégements de charges ?

N’est-ce pas dans la grande distribution que l’on trouve le plus d’emplois à temps partiel ?

N’est-ce pas dans la grande distribution qu’il y a le plus de travailleurs pauvres ?

C’est d’ailleurs ce type de situation qui nous a conduits à adopter le texte sur le RSA.
Toutes ces questions méritent d’être posées, …

… notamment celle de savoir si le coût de ces allégements est justifié.
Pour tirer des enseignements, je vous renvoie au rapport de la Cour des comptes, dans lequel figure une série d’analyses extrêmement intéressantes sur le sujet. Il conviendrait d’aller plus loin.
La commission des affaires sociales se réjouit des règles de bonne gouvernance et d’encadrement des dépenses fiscales et des niches sociales prévues aux articles 9 à 11 du projet de loi de programmation. Nous regrettons seulement qu’elles ne s’appliquent pas dès à présent et que leur mise en œuvre soit reportée, sans doute, à l’année prochaine.
Par exemple, dans le PLFSS pour 2009, le Gouvernement nous demande de mettre en place un dispositif de prise en charge des frais de transport exonéré de toutes charges sociales et bien entendu sans aucune compensation pour la sécurité sociale. Est-ce bien cohérent ?

En réalité, l’article 10 de la loi de programmation, qui prévoit une compensation, n’est pas respecté.

J’espère que vous nous expliquerez comment vous faites dans votre réponse aux orateurs, monsieur le ministre, et je m’engage alors à retirer cette dernière remarque ! (Sourires.)
Il faut donc que ces nouvelles règles soient réellement appliquées et qu’elles s’imposent à tous, aux différents ministres comme aux parlementaires.
En conclusion, mes chers collègues, la commission des affaires sociales émet un avis favorable sur le projet de loi et vous invite à l’adopter, sous réserve que le Gouvernement prenne plusieurs engagements.
Tout d’abord, nous aimerions qu’il s’engage à mieux étayer les projections relatives aux finances sociales dans la prochaine loi de programmation.
Ensuite, nous souhaiterions qu’il s’engage à réfléchir à l’utilité de fixer un objectif de progression des dépenses de vieillesse, compte tenu tout à la fois du montant élevé de ces dépenses, du fait que le déficit de cette branche dépasse maintenant celui de la branche maladie et de la nécessité, plus encore dans ce domaine que dans d’autres, de respecter le nouvel objectif constitutionnel d’équilibre des comptes des administrations publiques.
Enfin, nous voudrions qu’il s’engage à déposer un nouveau projet de loi de programmation si les hypothèses macroéconomiques sur lesquelles le présent texte est construit devaient être sensiblement corrigées. J’ai compris que ce serait le cas dès cet après-midi, et je ne peux que vous en remercier, madame, monsieur les ministres.
À tous, merci de contribuer à un meilleur équilibre des comptes sociaux.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Mme Catherine Tasca remplace M. Gérard Larcher au fauteuil de la présidence.

J’indique au Sénat que la conférence des présidents a décidé d’attribuer un temps de parole de dix minutes aux porte-parole de chaque groupe politique et de cinq minutes à la réunion des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe.
Le Gouvernement répondra aux orateurs.
Puis nous aurons une série de questions avec la réponse immédiate du Gouvernement. La durée de la discussion de chaque question est limitée à cinq minutes réparties de façon égale entre l’auteur de la question et le Gouvernement.
La conférence des présidents a décidé d’attribuer quatre questions aux groupes UMP et socialiste, deux questions aux groupes UC, CRC et RDSE et une question aux sénateurs non-inscrits.
Je rappelle que nous devons suspendre la séance à onze heures cinquante-cinq pour la cérémonie traditionnelle d’hommage aux sénateurs et fonctionnaires du Sénat morts pour la France.
Dans ces conditions, monsieur le président de la commission des finances, pensez-vous que nous pourrons reprendre notre débat vers douze heures quinze ?

À titre personnel, madame la présidente, je n’y vois pas d’inconvénient. Cela étant, plusieurs d’entre nous ont des obligations qui les contraindront à quitter l’hémicycle vers douze heures trente. Je me tourne donc vers nos collègues : pouvons-nous utilement reprendre nos travaux pour un quart d’heure ?

Personnellement, j’en doute aussi.
De surcroît, la commission des finances doit se réunir à quatorze heures quarante-cinq pour examiner les amendements que le Gouvernement vient de déposer. Sans doute nos travaux iront-ils promptement, car il s’agit d’une série d’amendements un peu mécaniques, consécutifs à la révision des hypothèses macroéconomiques, et je sais gré aux ministres de faire ainsi du Sénat le lieu de la sincérité. Mais, dans un souci de cohérence, il serait plus sage de ne reprendre nos travaux qu’à quinze heures ou quinze heures quinze.

Mme la présidente. Afin de permettre à la commission des finances de mener à bien ses travaux, nous reprendrons donc la séance à quinze heures quinze.
Assentiment.

Dans la suite de la discussion commune, la parole est à M. Albéric de Montgolfier.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant d’aborder le fond, je tenais à me réjouir de l’initiative qui a permis de joindre la discussion générale du projet de loi de programmation des finances publiques au débat sur les prélèvements obligatoires. Pour avoir une vue plus cohérente de la stratégie des finances publiques, il faut en effet prendre en compte non seulement l’évolution de la dette publique et des dépenses publiques, mais aussi celle des prélèvements obligatoires.
Concernant la programmation des finances publiques, je me félicite également, au nom du groupe UMP, qu’elle fasse l’objet, pour la première fois, d’un débat parlementaire. Chaque année, dans le cadre du programme de stabilité, le Gouvernement communique à la Commission européenne une prévision pluriannuelle relative aux finances publiques. Mais, jusqu’à présent, cette programmation ne faisait pas l’objet d’un débat devant la représentation nationale. Par le biais de ce projet de loi, nous pouvons désormais peser sur les orientations budgétaires des prochaines années.
Ce texte va permettre une meilleure visibilité de la stratégie du Gouvernement s’agissant des finances publiques et contribuer ainsi à une plus grande transparence de son action. Cette avancée est la première application de la réforme constitutionnelle de juillet 2008, qui a instauré des lois de programmation pluriannuelles des finances publiques dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques.
L’examen de ce texte novateur intervient néanmoins dans un contexte économique et financier très dégradé. À cet égard, nous ne pouvons que saluer la volonté de transparence et de réalisme du Gouvernement, qui a revu à la baisse les hypothèses de croissance.
Cette transparence ne doit pas être un prétexte pour renoncer à une maîtrise durable des dépenses.
Dans ce domaine, le Gouvernement fait preuve d’une détermination et d’un volontarisme que notre groupe salue. Il affiche des objectifs ambitieux, comme celui de diviser par deux le taux de croissance en volume de la dépense publique.
Ces objectifs ne pourront être atteints que grâce à une véritable maîtrise des dépenses de l’État. C’est le sens de la révision générale des politiques publiques dont je souhaiterais connaître l’état d’avancement et les perspectives en termes d’économies budgétaires.
Mais, comme le souligne très bien notre rapporteur général, M. Philippe Marini, les deux tiers de l’effort de réduction de la croissance des dépenses publiques seraient portés par la sécurité sociale et les collectivités territoriales.
Notre collègue Alain Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, a très bien souligné les enjeux en matière de finances sociales : partir d’une base assainie, maîtriser la dépense et sécuriser les recettes.
En matière de finances locales, le Gouvernement souhaite pérenniser l’indexation des concours de l’État sur l’inflation et même plus encore cette année, puisque, je tiens à le souligner, comme l’a fait Philippe Marini, elle est un demi-point au-dessus de l’inflation révisée.
Par ailleurs, le Gouvernement estime que le taux de croissance en volume des dépenses des collectivités territoriales sera ramené à 1, 25 % en moyenne de 2009 à 2012, ce que la commission des finances juge peu réaliste. Je pense en particulier à la situation des départements confrontés à une forte progression « naturelle » des dépenses sociales, notamment de l’allocation personnalisée d’autonomie.
Notre groupe souhaiterait à ce stade faire deux observations.
Première observation, si nous comprenons très bien que les collectivités territoriales doivent, tout comme l’État, qui le fait notamment à travers la RGPP, participer à l’effort de maîtrise des dépenses publiques, nous ne l’acceptons qu’à la condition que l’État mette fin aux transferts de charge larvés et qu’il clarifie ses relations avec les collectivités locales.
Nous soutenons également la volonté du Président de la République de clarifier les compétences et les structures des différents échelons de collectivité. Notre groupe entend participer activement à ce grand chantier.
Seconde observation, nous tenons à insister sur la nécessité de ne pas pénaliser l’investissement et la péréquation.
Si un effort doit être consenti en matière de dépense locale, il doit porter avant tout sur le fonctionnement. À cet égard, nous saluons la décision du Gouvernement de ne pas engager une réforme précipitée des critères d’attribution du FCTVA, le fonds de compensation pour la TVA, même si celui-ci est désormais inclus dans la norme d’évolution des concours de l’État.
Nous approuvons le choix qui est fait de privilégier d’abord les investissements des collectivités locales, au travers du FCTVA, puis la péréquation, au travers de la DGF, la dotation globale de fonctionnement. Ce choix nous apparaît d’autant plus nécessaire aujourd’hui, au moment où la conjoncture économique se dégrade. Nous ne devons pas oublier que les dépenses des collectivités locales représentent près des trois-quarts du total de l’investissement public.
Au total, nous retenons essentiellement de cette programmation la volonté du Gouvernement de maîtriser durablement les dépenses publiques, qu’il s’agisse de crédits budgétaires ou de dépenses fiscales. Là réside pour nous l’élément structurel principal qui permettra un retour progressif vers l’équilibre des finances publiques, quels que soient les aléas conjoncturels.
C’est dans cet esprit de responsabilité, malgré les incertitudes pesant sur la croissance et les comptes publics à court terme, que le groupe UMP du Sénat aborde l’examen de ce projet de loi de programmation.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Madame la présidente, madame, monsieur les ministres, mes chers collègues, face aux difficultés de l’économie mondiale, les seules politiques possibles sont celles de la vérité et de l’action : la vérité pour gagner la confiance des Français ; l’action, car, face aux difficultés, l’État doit incarner la responsabilité et la régulation.
Conséquence d’un excès de crédit, d’endettement et de complexité, mais aussi d’un excès de cupidité et de volatilité – vous l’avez fort bien dit, madame le ministre –, une spirale irrationnelle de la défiance est venue contrecarrer la politique originelle du Président de la République. Celui-ci a déployé toute sa réactivité et son énergie pour relancer le flux du financement de l’économie afin de restaurer la confiance.
À l’évidence, les réformes structurelles doivent se concentrer sur le secteur financier, en particulier sur le secteur bancaire, pour mettre un terme aux excès du passé et faire en sorte que les circuits financiers redeviennent des instruments au service de la croissance, des entreprises et des Français.
La loi de programmation pluriannuelle et le projet de loi de finances pour 2009 développent deux idées simples : maîtriser la dépense publique, comme la commission des finances du Sénat vous y incite depuis plusieurs années, et tendre à l’équilibre pour protéger nos recettes.
Pour maîtriser les dépenses, tout d’abord, le projet de loi de programmation propose une reconduction de la dépense au niveau de l’inflation chaque année jusqu’en 2012 ; les crédits affectés aux diverses missions sont prévus pour 2009, 2010 et 2011. Cette idée figurait déjà dans le rapport présenté par notre collègue Alain Lambert.
Une telle politique permet de maîtriser la dépense publique. Il est en effet plus aisé d’engager des réformes tendant à dépenser mieux en dépensant moins, avec une visibilité sur trois ans. Les gestionnaires sont ainsi incités à rechercher des économies ou à redéployer les crédits. Mes chers collègues, trop longtemps la dépense publique est demeurée une fracture idéologique. Cette conception est dépassée, la crise en ayant révélé les limites. Nos voisins nous incitent à de saines comparaisons.
Il est cependant vrai qu’on ne peut rationaliser à l’extrême : la France n’est pas seulement une entreprise. La dépense publique est aussi un levier indispensable pour réduire les inégalités, et nous ne pouvons l’ignorer.
Avec une inflation à 2 %, les dépenses sont limitées en volume à 7 milliards d’euros. L’accroissement des charges de pensions représentera 2, 4 milliards ; la charge de la dette augmentera, quant à elle, de près de 3 milliards d’euros ; le prélèvement sur recettes en faveur de l’Union européenne progressera de 500 millions d’euros, et les concours de l’État aux collectivités locales augmenteront exactement au même rythme que l’ensemble du budget, soit de 2 % sur 55 milliards d’euros ; ajoutons 300 millions d’euros pour l’augmentation des dépenses de personnel. Le total obtenu consomme la totalité de cette marge de manœuvre de 7 milliards d’euros.
Nous devons donc nous appuyer sur la révision générale des politiques publiques. Grâce à cette méthode de recherche systématique d’efficacité des dépenses, nous n’allons pas remplacer près d’un départ à la retraite sur deux dans la fonction publique, soit une baisse des effectifs de plus de 30 000 emplois. Rappelons que, depuis les débuts de la décentralisation en 1982, 500 000 postes ont été créés par nos collectivités locales sans que l’État engage symétriquement une diminution de ses effectifs correspondants.
Au-delà des dépenses de l’État, il nous faut maîtriser l’ensemble des dépenses publiques : c’est le seul gisement d’économie à exploiter sans modération. En 2007, la dépense publique a atteint 52, 4 % du PIB. En volume, la progression moyenne de cette dépense sur une longue période a été un peu supérieure à 2 % par an. J’y reviendrai.
Les dépenses de l’État représentent 300 milliards d’euros ; les dépenses de protection sociale atteignent 450 milliards d’euros ; les dépenses des collectivités locales se montent à plus de 200 milliards d’euros, d’où un certain nombre d’évolutions proposées dans le projet de loi de programmation. Ainsi, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie progresserait de 3, 3 % pour la période de 2009 à 2012, et les dotations aux collectivités augmenteraient de 0, 5 % de plus que la progression estimée de l’inflation, soit 2 %.
Par conséquent, il nous faut d’ici à 2012 dépenser 10 milliards d’euros de moins. C’est pourquoi, afin de nous rapprocher le plus possible de l’équilibre budgétaire en 2012, le Gouvernement doit s’engager à mettre en œuvre un ajustement structurel des finances publiques de 0, 5 % du produit intérieur brut par an, et ce dès 2008.
Mes chers collègues, seul un rétablissement de nos finances publiques nous évitera de continuer à vivre à la charge de nos enfants et de nos petits-enfants et de leur transférer une charge budgétaire de plus en plus lourde, ainsi que vous l’avez souligné, madame le ministre.
Si les recettes ne sont pas au rendez-vous, il y aura une progression du déficit ; mais il est inconcevable, pour préserver notre compétitivité, que nous compensions ces moins-values de recettes par une augmentation des impôts. Le Gouvernement a donc choisi de poser comme cadre de travail la stabilité des taux de prélèvements obligatoires. Ce principe est inscrit dans le projet de loi de programmation des finances publiques qui nous est soumis. Je m’en félicite.
Il importe de mettre notre système fiscal au service de la croissance. Mais ce n’est pas parce que la politique fiscale est orientée vers la baisse des prélèvements que l’on doit s’interdire de mener à bien certains projets par des financements spécifiques, contributions à la justice sociale, et, disant cela, je pense notamment au RSA. Monsieur le ministre, vous avez rappelé la nécessité de cette souplesse.
Avec anticipation, nous avons mis en place dès juillet 2007 des dispositifs grâce auxquels nous pouvons mieux affronter la crise. Au-delà de la dépense publique, les réformes structurelles doivent se poursuivre pour se concentrer sur le secteur financier, en particulier sur le secteur bancaire.
Il importe, je le répète, de mettre un terme aux excès du passé et de faire en sorte que les circuits financiers redeviennent des instruments au service de la croissance et des entreprises. L’argent des banques doit-il servir à produire de l’argent ou doit-il œuvrer au développement des entreprises ? Mes chers collègues, la bourse doit redevenir vertueuse ! L’argent investi doit être mis au service du seul développement des entreprises et de l’emploi. Je propose, pour ce faire, de créer une taxe inversement proportionnelle à la durée de l’investissement afin de privilégier le long terme et de briser les tentations d’aller et retour spéculatives et déstabilisatrices.
La mise en œuvre du revenu de solidarité active, la promotion de l’intéressement et de la participation, ainsi que la conditionnalité des allégements de charges reflètent une politique soucieuse de favoriser le retour à l’emploi et une redistribution plus équilibrée des richesses. Ce sont des éléments de stabilisation économique et de justice sociale.
La loi de programmation pluriannuelle apporte des innovations profondes. Si baisses d’impôts il y a, elles doivent être absolument compensées pour le même montant afin de revenir à l’équilibre. La dépense fiscale doit être une variable d’ajustement.
Le débat sur les prélèvements obligatoires et leur évolution prend, cette année, une dimension évidemment particulière, tout d’abord parce que la conjoncture aura une incidence forte sur les comptes de l’État, ensuite parce que ce débat intervient dans le cadre de la révision générale des politiques publiques et la revue générale des prélèvements obligatoires.
Nous devons souligner, dans l’évolution de ce taux, la combinaison de moins en moins lisible des financements sociaux et fiscaux. Sur près de 7 % de hausse des taux de prélèvements obligatoires depuis la fin des années soixante-dix, 6, 2 % proviennent des administrations de la sécurité sociale. Nous assistons donc à une forte socialisation des besoins de nos concitoyens.
L’évolution de notre fiscalité impose, au-delà du débat sur les prélèvements obligatoires, un principe directeur de toute réforme fiscale. Celui-ci doit résider dans la combinaison d’une assiette d’imposition large, et pourquoi pas universelle, et de taux bas. Suivons en cela la pensée de Raymond Barre : nous devons absolument moderniser nos prélèvements obligatoires.
Deux constats s’imposent.
Le premier concerne la fiscalité locale. Chacun convient qu’elle est totalement archaïque. Néanmoins, la substitution de dotations à des impôts locaux n’est pas satisfaisante ; elle équivaut à nationaliser la fiscalité locale, et donc à déresponsabiliser les élus locaux.
Le second constat concerne le financement de la protection sociale. Celui-ci repose essentiellement sur le travail. Nous avons concédé aux grandes entreprises des allégements de charges : trop sans doute, car il n’y a pas d’effet durable sur l’emploi, comme l’a souligné la Cour des comptes dans un rapport récent, et comme l’a rappelé Alain Vasselle. Il faudra concentrer les exonérations de charges sur les petites et moyennes entreprises.

Le Président de la République a annoncé sa volonté d’exonérer de taxe professionnelle les investissements nouveaux et de trouver une ressource de substitution pour les collectivités locales, cohérente avec une réflexion à mener sur les compétences des niveaux d’administration territoriale.
Cette modification inquiète les élus locaux, lesquels s’interrogent : comment vont-ils amortir le financement de leurs infrastructures ? Il faudra créer un impôt moderne en s’inspirant de ce qui se fait dans les pays à fiscalité plus performante, sans doute avec une assiette plus large. Ce débat aura lieu dans le cadre de la commission chargée d’examiner l’évolution des institutions locales.
On parle d’une nécessaire réorganisation de la finance mondiale ; il doit en être de même du système fiscal français. Les impôts sont des outils qui doivent être économiquement efficaces et socialement justes. Répétons-le, les taux sont aujourd’hui trop élevés, l’assiette souvent trop étroite et les niches beaucoup trop nombreuses. Un déplafonnement anormal, notamment, permet à des contribuables ayant pourtant des revenus très importants de ne pas acquitter le moindre impôt.
Si, dans une démocratie éprise de justice, l’impôt ne doit pas être confiscatoire ou spoliateur, à l’inverse, nul ne doit pouvoir s’exonérer de l’impôt dès lors qu’il perçoit des revenus. Il s’agit là d’un préalable à l’évolution de nos prélèvements obligatoires.
Nous l’avons compris, seule la maîtrise de la dépense publique permettra d’abord le retour à l’équilibre de nos finances publiques, puis, par la suite, la baisse des prélèvements obligatoires afin de restaurer notre compétitivité et de rendre la France plus attractive. Comparons notre situation avec celle de nos voisins de la zone euro : la part de la dépense publique dans notre PIB est supérieure de 6, 2 % à la moyenne de la zone euro ; 117, 3 milliards d’euros sont ainsi dépensés en plus, somme qui couvrirait largement notre déficit et permettrait d’investir dans les infrastructures, les salaires et le social.
La loi de programmation propose une reconduction de la dépense au niveau de l’inflation chaque année jusqu’en 2012. Pourquoi, comme je l’ai souvent proposé, ne pas s’en tenir, à l’exception des retraites, à une reconduction des crédits en euros courants ?
La crise financière ne doit d’ailleurs pas nous détourner de notre objectif d’équilibre. Madame le ministre, vous l’avez dit, « l’équilibre des finances publiques, ce sont des marges politiques retrouvées ». Et si vous le permettez, j’ajouterai : Yes we can !
Applaudissements sur les travées de l’UMP.

Mon rappel au règlement se fonde sur l’article 29, alinéa 1, du règlement du Sénat.
Je tiens en effet à protester, au nom du groupe socialiste, contre l’organisation du débat. Alors que ce dernier, extrêmement important, prend place dans un contexte délicat, comme l’ont rappelé longuement les ministres, le rapporteur général et le rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, un temps de parole limité, de surcroît identique pour tous, a été accordé aux groupes. Cela me semble préjudiciable à l’organisation de nos travaux.

Dans la suite de la discussion commune, la parole est à Mme Nicole Bricq.

Madame la présidente, madame, monsieur les ministres, mes chers collègues, l’article 34 nouveau de la Constitution nous enjoint de débattre désormais de la programmation des finances publiques jusqu’en 2012. Et nous débattons en même temps – d’où l’importance de mon rappel au règlement ! – d’un sujet extrêmement important, les prélèvements obligatoires.
Je voudrais vous remercier, madame, monsieur les ministres, d’avoir choisi, pratique inhabituelle et qui mérite d’être soulignée, le Sénat plutôt que la presse pour annoncer une révision des prévisions qui, il faut bien le dire, ne résistaient pas aux faits. Or, comme un Premier ministre a eu l’occasion de le dire dans le passé, les faits sont têtus !
Autant vous le dire, malgré cette révision, nous ne croyons pas davantage à l’hypothèse retenue par le Gouvernement d’un retour à l’équilibre en 2012. Rien ne nous convainc vraiment, en effet : ni le scénario de la prévision de croissance qui, même réécrit, devra encore être revu d’ici à la fin de l’année, ni le niveau du déficit, ni le niveau de la dette, pourtant actualisé. Monsieur le ministre, vous avez vous-même reconnu la vulnérabilité de vos prévisions.
Monsieur le rapporteur général, je vous ai, comme à l’habitude, bien écouté : ce qui peut être reproché au Gouvernement, c’est de se fonder, dans cette prévision encore, sur un scénario unique. Il serait plus intéressant de faire plusieurs hypothèses, …

…qui permettraient une révision en cours de route. Mais tel n’est pas le cas, puisque vous ne privilégiez qu’une hypothèse.
C’est vrai aussi pour les prélèvements obligatoires puisque vous avez renoncé à l’engagement pris pendant la campagne électorale par le futur Président de la République de les baisser de quatre points. Vous dites que vous allez les stabiliser, confirmant ainsi – je le souligne au passage – les doutes que nous avions émis l’année dernière.
Ce qui nous inquiète, ce sont les réponses que vous allez fournir à deux questions qui nous paraissent essentielles. Tout d’abord, première question, comment allez-vous atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés ? Au détriment de qui et au détriment de quoi en regard des choix lourds que vous avez effectués en 2007 ?
Ensuite, seconde question – elle est à mes yeux essentielle d’un point de vue macro-économique –, comment aborderons-nous la sortie de crise en regard d’une compétitivité déjà peu assurée avant le déclenchement de celle-ci et à l’aune de finances publiques déjà très anciennement dégradées?

Je développerai successivement mon point de vue sur les dépenses, les recettes et la dette, puis traiterai des prélèvements obligatoires.
Côté dépenses, vous insistez beaucoup sur la compression des dépenses – vous l’avez encore fait ce matin, même si vous avez légèrement modéré vos propos par rapport à ceux que vous avez tenus à l’Assemblée nationale –, en fixant pour trois ans la règle d’une progression limitée à l’inflation pour l’État et les dotations aux collectivités locales.
Cette règle – je pense que vous le savez – va se révéler redoutable avec la progression du coût des pensions des fonctionnaires et de la dette. Pour ce qui est des dépenses sociales, le vieillissement de la population laisse augurer une augmentation des coûts et, pour ce qui est des collectivités locales, M. le rapporteur général a souligné hier devant la commission des finances ce qu’il avait mentionné dans son rapport écrit, à savoir le caractère « irréaliste » des prévisions.

Côté recettes, il faut noter qu’elles plafonnent depuis plusieurs années, alors même que la croissance était positive. On connaît l’impact funeste des dépenses fiscales. Il est donc urgent non seulement de plafonner ces dernières, comme le groupe socialiste l’a toujours demandé, mais aussi de les évaluer. Et, s’agissant de cette évaluation, l’initiative doit appartenir à la commission des finances : c’est à mon avis son rôle, du reste conforté par la Constitution.
Mais, monsieur le ministre, il faudrait commencer par ne plus créer de dépenses dans une conjoncture particulièrement difficile. Or, pas plus tard que la semaine dernière, à l’occasion de l’examen du projet de loi en faveur des revenus du travail, votre collègue M. Xavier Bertrand s’est prononcé contre notre amendement, identique à celui du rapporteur pour avis de la commission des finances, M. Serge Dassault, tendant à supprimer l’article 1er.

Absolument ! Nous l’avions voté à l’unanimité en commission des finances. Nous nous opposions en effet au nouveau crédit d’impôt visant à favoriser l’intéressement, dont le coût devrait s’élever, si cela fonctionnait, ce dont nous doutons quand même, à près d’un milliard d’euros en année pleine !

Vous êtes trop souvent dans la contradiction entre vos déclarations et votre action !
Par ailleurs, il est intéressant de se pencher sur le coût pour les finances publiques des exonérations des heures supplémentaires, disposition adoptée voilà dix-huit mois : il est de 4 milliards d’euros.
Il suffit de se livrer à un simple calcul pour démontrer que, dans le contexte actuel de montée du chômage, cette démarche est absurde dans la mesure où elle dissuade les entreprises d’embaucher.

Il serait donc grand temps de la ranger au « frigidaire », de laisser l’idéologie au repos et de redéployer les 4 milliards d’euros dans le soutien à l’économie et à l’emploi, qui en ont bien besoin !

Mme Nicole Bricq. Le même raisonnement pourrait être appliqué au bouclier fiscal.
M. le rapporteur pour avis s’exclame.

Alors que, avant les effets de la crise financière, nos résultats étaient moins bons que ceux de nos partenaires de l’Union européenne, vous gardez la même hypothèse de travail en la décalant dans le temps. En fait, vous remplacez un zéro par un deux. Je pense que, très rapidement, vous vous affranchirez de votre engagement.
Il me faut maintenant dire quelques mots sur la dette, dont on a beaucoup moins parlé ce matin qu’à l’habitude.
Dans votre hypothèse, monsieur le ministre, vous considérez que la dette publique ne sera aggravée que par le déficit. Celui-ci devant, selon vous, se réduire, la dette baisserait pour arriver progressivement à 61, 8 % du PIB en 2012. Cela suppose donc une stabilisation du déficit et un retour dès 2010 à une croissance de 2, 5 %. Voilà une hypothèse bien optimiste qui fait fi du ralentissement économique dont le poids ne manquera pas de peser sur les dépenses sociales ! Il est fort possible que la dette atteigne 68 % en 2012.
J’ajoute que les mesures de recapitalisation des banques évoquées par M. le rapporteur général dans son rapport écrit, même si elles n’atteignent pas les 40 milliards d’euros prévus – mais 10, 5 milliards d’euros sont déjà engagés dans le plan d’urgence de la loi de finances rectificative –, pèseront sur l’encours de la dette et sur la charge de celle-ci. On en arriverait ainsi à ce que le service de la dette devienne dans la période triennale le premier budget de l’État, devant celui de l’éducation nationale ! Cela veut dire qu’il faut revoir l’orientation des finances publiques.
À ce titre, permettez-moi, madame, monsieur les ministres, de vous rappeler que vous vous êtes engagés devant nous à associer le Parlement au suivi de ce plan d’urgence. Or jusqu’à présent – en tout cas, jusqu’à hier soir –, nous n’avons pas eu de concrétisation de cet engagement.
Quant aux prélèvements obligatoires, il nous faut redire – les années se succèdent en se ressemblant – que leur seul niveau ne suffit pas à déterminer s’ils sont justes et efficaces. Ce qui compte, c’est l’assiette des prélèvements et leur finalité.
D’une part, l’État se défausse sur les collectivités locales et la sécurité sociale ; d’autre part, toutes les mesures que vous avez prises ont eu pour effet de faire reculer la progressivité de l’impôt, et donc, à nos yeux, de la justice fiscale.
La vérité est que le Gouvernement persiste à priver l’État de munitions fiscales face à la crise. Les mesures fiscales prévues pour 2009 s’équilibrent quasiment entre hausse et baisse d’impôts. La maîtrise des dépenses est, dans le scénario gouvernemental, le seul levier d’action. Du reste, monsieur le ministre, vous avez insisté lourdement devant nos collègues députés en proclamant qu’un budget, c’est d’abord une « autorisation de dépense ».
Certains ministères voient leurs budgets reculer, et les collectivités locales sont appelées à supporter la rigueur. C’est au moment où la menace de récession exige une politique de soutien fiscal active…

…que les États ayant multiplié les allégements d’impôts – la France n’est en effet pas le seul pays dans ce cas ! – se trouvent démunis. Le ralentissement économique dans un système fiscal de moins en moins progressif a un impact immédiat sur les recettes et menace fortement l’équilibre budgétaire.
Nous sommes à un moment charnière des politiques fiscales en Europe. M. le rapporteur général voit juste quand il indique dans son rapport écrit que la fiscalité ne restera pas à l’écart de la remise à plat et de la remise en cause des idées reçues. Mais il est sceptique sur le débouché de cette remise à plat quant à la réhabilitation de l’impôt. C’est sans doute là où nous nous séparons.
Je pense que la concurrence et la course au moins disant fiscal ont vécu sans pour autant que le tabou sur l’impôt soit encore levé.

Le système fiscal national, tel qu’il est bâti aujourd’hui, repose essentiellement sur les ménages et les entreprises captives, alors même que les entreprises mondialisées et les hauts revenus particuliers développent des stratégies d’évitement de l’impôt. Si l’impôt ne pèse plus que sur les revenus ne bénéficiant pas d’une mobilité internationale, prenons garde qu’il ne se trouve alors délégitimé. Or l’impôt n’est pas un simple instrument économique. Il reflète un choix de société, un choix de justice. C’est vrai au niveau national, c’est vrai au niveau européen.
J’ai évoqué tout à l’heure la sortie de crise. Elle passe par un retour à une croissance positive et, si possible, à notre seuil de croissance potentielle, qui est fondamentalement et durablement le moyen de susciter des gains de pouvoir d’achat dès lors que l’efficience de notre système de prévention et de redistribution sociale sera elle-même accrue.
En visant le moyen terme, il faudrait promouvoir éducation, formation et recherche. Pour ce faire, la remise en cause des mesures rentières prises par les gouvernements – l’actuel et les précédents – est indispensable. La réinstauration de la progressivité de l’impôt sur le revenu, une évaluation très volontaire des niches en vue de supprimer toutes celles qui ne servent pas l’investissement productif ou le bien-être social, la réduction progressive des baisses de charges sociales consenties aux grands groupes permettraient de mobiliser plusieurs dizaines de milliards d’euros.
Dans l’immédiat, compte tenu de l’assèchement de nos finances publiques, il convient sans doute de mobiliser l’épargne privée dans le soutien au programme du bâtiment et des travaux publics peu importateurs et créateurs d’emplois afin de satisfaire aux demandes de nos concitoyens en matière de logement et de transports.
Nous ne trouvons pas trace dans cette proposition de votre volonté d’assurer le présent et de préparer l’avenir. Vous nous proposez une hypothèse macroéconomique « vulnérable », des recettes à périmètre constant. Votre seul levier d’action est la dépense, et vous faites peser sur les collectivités locales les deux tiers de l’effort de réduction du déficit, ce qui est très étonnant compte tenu de la contribution essentielle de ces collectivités à l’investissement public civil – 73% –, …

…sauf à les obliger à augmenter les impôts alors que vous prétendez stabiliser les prélèvements obligatoires. Vous êtes, à mon avis, dans une contradiction insurmontable. Un effet de ciseau terrible peut dépendre de votre prévision de dépenses.
Comprenez que ce premier exercice pluriannuel augure assez mal pour nous des projets de loi de finances qui vont suivre, notamment de celui de 2009 dont nous discuterons dès la semaine prochaine. En conséquence, nous nous y opposerons.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Madame la présidente, madame, monsieur les ministres, mes chers collègues, le projet de loi de programmation des finances publiques pour la période 2009-2012 est la traduction de la réforme institutionnelle votée au mois de juillet par le Parlement.
Sa portée normative est limitée, mais ses objectifs vertueux en matière de gestion publique concourent au nécessaire, mais très difficile, retour à l’équilibre de nos finances publiques.
Néanmoins, ce projet de loi a tout lieu d’être qualifié d’anachronique, même si, sur la forme, il a le mérite d’exister.
Il est anachronique, car, malheureusement, la crise financière et boursière qui a touché, depuis sa rédaction, l’ensemble des pays a totalement bouleversé les perspectives économiques pour les années à venir. Malgré les réponses volontaristes apportées par les différents gouvernements, notamment européens, les perspectives initialement tracées ne peuvent être perçues comme totalement réalistes.
Naturellement, madame, monsieur les ministres, nous ne vous tenons pas pour responsables de ce décalage, d’autant, madame la ministre, que, à l’ouverture de cette discussion, vous avez apporté les correctifs nécessaires.
L’on ne peut que saluer le réalisme qui a conduit le Gouvernement à retenir des hypothèses de croissance plus adaptées à la situation. Du fait des difficultés auxquelles nous allons être confrontés lors de l’examen du projet de budget pour 2009, on peut néanmoins se demander comment il peut être envisagé d’encadrer les volumes des dépenses de toutes les missions budgétaires pour l’année 2012 en se basant sur des taux d’inflation qui ne peuvent être tenus !
Ce projet de loi montre à quel point il est difficile, en particulier en matière de finances publiques, d’effectuer des prévisions et d’en tirer des lois de programmation dont la date de péremption peut être très rapidement atteinte.
Cependant, je le disais, ce texte a le mérite d’exister, de fixer des cadres budgétaires et surtout – soyons un peu optimistes – de créer un climat budgétaire marqué par la vertu financière, vertu dont, madame, monsieur les ministres, nous vous savons d’ailleurs dotés.
La loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 représente une avancée dans la maîtrise des comptes publics en permettant au Parlement de fixer la trajectoire des finances publiques vers l’équilibre des comptes des administrations. C’est une démarche nouvelle, qu’il convient de saluer.
L’inscription constitutionnelle de l’équilibre des comptes publics constitue une double avancée.
Tout d’abord, il est désormais fait référence au principe d’équilibre des comptes de l’ensemble des administrations publiques, ce qui englobe l’État, les organismes de sécurité sociale, mais aussi les collectivités territoriales.
Ensuite, pour la première fois, est affirmée dans la Constitution la nécessité de concilier deux exigences : celle de la pluriannualité budgétaire, déjà introduite conformément à la philosophie de la LOLF, et celle de l’objectif d’équilibre des comptes publics.
Cette loi de programmation est ainsi le support de la stratégie budgétaire à l’horizon 2012 : le redressement de nos finances publiques doit être atteint sans augmentation du poids des impôts et des charges, et donc entièrement grâce à la maîtrise des dépenses.
Enfin, certaines propositions, telle celle qui permet d’affecter les éventuels surplus budgétaires – on peut rêver ! – au désendettement, sont les bienvenues et recueillent naturellement le soutien du groupe Union centriste.
Je reviendrai maintenant sur la question des prélèvements obligatoires et de leur évolution, point sur lequel porte aussi notre débat du jour.
Le taux des prélèvements obligatoires est toujours un instrument de mesure imparfait. En effet, d’une part, on compare souvent l’évolution dans le temps, mais les paramètres sont si complexes qu’il est évidemment difficile de parvenir à les lire correctement et, d’autre part, la comparaison avec les autres pays se fait rarement avec le même périmètre d’action et rend donc bien évidemment assez obsolètes les chiffres que l’on peut donner pour la France.
Chacun l’a déjà rappelé, le taux des prélèvements obligatoires pour 2007 s’élève à 43, 3% du PIB, en baisse par rapport à 2006.
Les prévisions pour les années à venir laissent à penser, selon l’excellent rapport de M. le rapporteur général, que ce taux se stabilisera, voire sera en légère diminution suivant les scénarios économiques envisagés.
Cette stabilisation me semble tout à fait opportune et, pour le coup, elle entre dans le cadre des normes fixées par le projet de loi de programmation qui nous intéresse aujourd’hui.
On peut regretter que ce taux soit trop élevé, du point de vue de l’histoire de nos finances publiques mais aussi en comparaison avec nos partenaires, notamment l’Allemagne ou le Royaume-Uni. Pour autant, il semble difficile, compte tenu de mes propos précédents, de prétendre diminuer les prélèvements obligatoires tant les contraintes financières sont importantes sur les administrations publiques. Par ailleurs, il paraît inopportun – et nous avons toujours défendu cette position – de chercher à les augmenter, car ce serait une mesure totalement contreproductive à l’encontre non seulement de nos concitoyens, mais aussi de nos entreprises.
Les prélèvements obligatoires, au-delà de leur niveau, appellent un second constat, s’agissant de leur structure.
Une fois encore, nous devons souligner, dans l’évolution de ce taux, un phénomène, dont on a d’ailleurs souvent parlé ici, à savoir la combinaison de moins en moins lisible des financements sociaux et fiscaux.
Je citerai un exemple chiffré : sur près de 7 % de hausse des taux de prélèvements obligatoires depuis la fin des années soixante-dix, 6, 2 % proviennent des administrations de la sécurité sociale. Nous assistons donc à une forte socialisation des besoins de nos concitoyens.
Dans ce contexte, nous ne pouvons que nous féliciter du tassement des taux de prélèvements obligatoires, car les charges croissantes qui résulteront du vieillissement de la population nous obligeront bientôt à dégager encore de nouvelles marges de manœuvre.
En conclusion, on l’aura compris, seule la maîtrise de la dépense publique permettra, d’abord, le retour à l’équilibre de nos finances publiques et, par la suite, l’abaissement des prélèvements obligatoires afin de restaurer la compétitivité de notre économie. La crise financière actuelle ne doit d’ailleurs pas nous détourner de cet objectif d’équilibre. Mais c’est la structure de ces prélèvements obligatoires, plus que le niveau de ces derniers, qui pose problème aujourd’hui.
Je disais précédemment que l’on ne pouvait pas augmenter les prélèvements obligatoires, notamment pour la bonne santé de nos entreprises ; je souhaite pour terminer, madame, monsieur les ministres, aborder le problème du développement économique de nos PME, notamment dans cette période de crise qui les touche bien sûr directement tant sur le plan de leurs besoins de trésorerie que sur celui de leurs investissements.
Le Président de la République rappelait récemment que les prélèvements publics sur les entreprises représentaient près de 15 % du PIB en France, contre 11, 5 % dans les autres pays de la zone euro.
Cet écart de 3, 5 points représente plus de 70 milliards d’euros et constitue un véritable handicap pour nos entreprises dans la compétition internationale. Le poids de la fiscalité qui pèse sur nos PME ternit largement l’attractivité de notre pays face à nos voisins européens.
Dans cette période de crise, ne serait-il pas possible, par des mesures à court terme, de renforcer les fonds de roulement de nos PME et de favoriser leurs projets d’investissement en fléchant de manière peut-être plus encadrée encore les crédits accordés aux banquiers à destination des entreprises ?
J’aimerais aussi, madame, monsieur les ministres, que vous esquissiez devant nous d’éventuelles mesures tendant à diminuer les prélèvements publics sur nos entreprises, notamment les plus innovantes.
Vous avez en effet reçu cette semaine un rapport sur le financement des PME, dans lequel est présentée une série de onze mesures sur ce thème dont la plupart me semblent très intéressantes.
L’un des problèmes pointé dans ce rapport est non pas le manque de financement de la recherche dans notre pays, mais bien le faible nombre de bons projets innovants. Nos PME ont besoin de collaborer beaucoup plus étroitement avec les centres de recherches, en particulier avec ceux qui ont une vocation mondiale.
Pourquoi en France, comme cela a été rappelé dans une interview des auteurs de ce rapport parue hier dans Les Échos, la proportion des PME qui deviennent de véritables groupes n’est-elle que de 1 %, contre 7 % en Europe et même 25 % en Amérique du Nord ?
Il est urgent d’accélérer et d’amplifier la politique de financement par projet de notre recherche en renforçant en ce sens le rôle de l’ANR, l’Agence nationale de la recherche, mouvement qui est d’ailleurs déjà engagé, notamment grâce au programme blanc qui vise, par définition, à soutenir des projets innovants et qui représentera 35 % des financements de l’ANR, contre 28 % aujourd’hui.
D’autres mesures proposées dans ce rapport, qui dénonce une certaine insuffisance du soutien de l’État aux PME, concernent les jeunes entreprises innovantes : il faut soutenir ces entreprises, flécher les aides et les investissements dans leur direction, revoir les aides fiscales à l’investissement, développer les garanties financières, réduire les délais de paiement, notamment dans la sphère publique, souvent très mauvaise élève sur cette question…
Nous devons aider nos entreprises, et c’est encore plus nécessaire en cette période d’incertitude. C’est pourquoi j’espère que ces propositions auront votre faveur, madame, monsieur les ministres : l’avenir de notre structure économique et les emplois de demain en France dépendent de l’attention que les pouvoirs publics vont porter à l’innovation menée dans les entreprises et à l’attractivité de notre pays.
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

Mes chers collègues, je tiens à saluer la présence dans nos tribunes d’une délégation de sénateurs du Cambodge, à qui je souhaite la bienvenue. §(Mme et M. les ministres, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.)
Nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures quinze.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à onze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures quinze, sous la présidence de Mme Monique Papon.