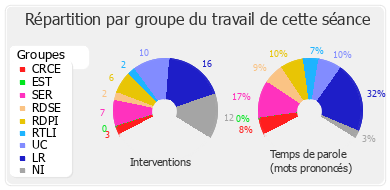Séance en hémicycle du 22 octobre 2019 à 21h30
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Valérie Létard.

La séance est reprise.

Mon rappel au règlement, au nom du groupe communiste républicain et citoyen, se fonde sur l’article 36 régissant l’organisation de nos travaux.
Nous allons débuter notre débat sur le bilan du Conseil européen des 17 et 18 octobre 2019, lequel s’est montré bien terne au sujet de la dramatique situation qui se joue en ce moment même dans le nord-est de la Syrie.
Dans une demi-heure exactement, le cessez-le-feu va prendre fin. Erdogan a promis le massacre pour les Kurdes, il a recommencé son chantage cet après-midi à l’adresse de la France et de tous ceux qui essaieraient d’entraver la reprise des hostilités.
Nous avons débattu ici même, cet après-midi, de cette question. Notre union a été forte dans la condamnation, mais hormis cela c’était un débat sans grand résultat. Pourtant, les informations sont toutes extrêmement alarmantes, y compris celles que nous a données cet après-midi le secrétaire d’État.
Allons-nous continuer à débattre comme si de rien n’était, alors que tout le monde estime qu’il s’agit d’une situation tout à fait exceptionnelle, dramatique et pleine de dangers ? Le Gouvernement n’a-t-il rien de neuf à nous dire ? Et si le pire recommence ce soir, dans quelques minutes ou quelques heures, poursuivrons-nous nos débats sans prendre aucune initiative nouvelle ? L’ordre du jour restera-t-il inchangé ? Le sujet ne reviendra-t-il en débat que dans une semaine lors des questions d’actualité au Gouvernement ? Allons-nous enfin faire quelque chose qui empêche le pire de se produire ?
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE. – M. Didier Marie applaudit également.

L’ordre du jour appelle le débat à la suite de la réunion du Conseil européen des 17 et 18 octobre 2019.
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Madame la présidente, messieurs les présidents de commission, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis heureuse de m’adresser à vous pour le traditionnel débat que nous tenons à l’issue des conseils européens. Lors du débat préalable à ce sommet, vous aviez exprimé vos attentes et posé des questions relatives aux différents points à l’ordre du jour : la présentation de l’agenda de la nouvelle Commission, le cadre financier pluriannuel, la demande d’ouverture de négociations d’adhésion à l’Union européenne de l’Albanie et de la Macédoine du Nord et enfin, bien sûr, le Brexit.
Le Conseil européen s’est donc réuni jeudi et vendredi derniers, des conclusions ont été adoptées et le Président de la République s’est exprimé en conférence de presse sur le déroulement des travaux et sur nos positions.
Ce Conseil européen était d’abord l’occasion pour la nouvelle présidente élue de la Commission européenne, Mme Ursula von der Leyen, de présenter son agenda. Nous nous reconnaissons très largement, vous le savez, dans ses priorités.
La première d’entre elles porte sur la lutte contre le changement climatique et la présentation d’un nouveau pacte vert. L’objectif est de faire de l’Union européenne le premier continent neutre en carbone à l’horizon 2050 et de mettre toutes les politiques – industrielle, environnementale, énergétique… – en cohérence avec cet objectif plus large. Notons également que la présidente élue a mentionné l’établissement d’un mécanisme d’inclusion carbone aux frontières compatible avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce, l’OMC, et notre marché de permis carbone dit ETS.
La présidente élue a également rappelé la priorité donnée au numérique et à ses différents aspects fiscaux, concurrentiels et juridiques.
Elle a de nouveau fait valoir qu’elle ferait des propositions sur la révision du régime d’asile – nous avons d’ailleurs eu un débat sur les sujets migratoires dans cet hémicycle il y a quelques jours.
Elle a enfin souligné que sa commission serait géopolitique, car l’Europe doit affirmer sa place et arrêter sa propre ligne en matière de défense économique, et ainsi gagner en souveraineté.
Le Conseil européen a aussi conduit sa première véritable discussion substantielle sur le prochain cadre financier pluriannuel, dit CFP. Ce débat venait opportunément compléter la discussion sur les priorités du nouveau collège.
Les échanges ont confirmé les positions connues qui restent aujourd’hui, avouons-le, très éloignées les unes des autres, que ce soit sur le volume global, les priorités à financer ou l’opposition entre les politiques dites traditionnelles et les nouvelles priorités que nous préférons plutôt voir comme des politiques qui, pour certaines, soutiennent notre souveraineté et notre autonomie au niveau européen, quand d’autres permettent d’améliorer notre convergence et notre solidarité. Des divergences existent aussi sur les ressources propres et les rabais.
Le Président de la République a rappelé la position française : la France veut le maintien de l’enveloppe UE-27 de la politique agricole commune, la PAC, et ne souhaite pas opposer le premier et le second pilier de cette politique, car sans agriculteurs, il n’y a pas et il n’y a plus besoin de développement rural. Il y a là une opposition qu’il nous faut combattre.
Je vous rappelle que le budget de la PAC représente 0, 3 % de la richesse européenne produite chaque année et que ce budget doit être réparti sur 80 % de notre territoire, soit la part de l’espace européen où se situent des champs et des forêts exploités. Dans ce contexte, nous avons besoin de soutenir le revenu et l’investissement des agriculteurs pour les aider à faire évoluer leurs modes de production et faire face aux risques climatiques, de marché et de production auxquels ils sont confrontés.
Nous voulons financer le budget par de nouvelles ressources propres, notamment dans le domaine environnemental, car la France ne pourra pas augmenter indéfiniment sa contribution nationale et le prélèvement sur ses recettes.
Nous voulons aussi verdir le budget dans son ensemble pour arriver à 40 % de dépenses compatibles avec le climat, la biodiversité et l’environnement.
Nous ne nous exprimerons pas sur le volume de ce budget, tant que nos demandes politiques ne seront pas satisfaites sur la PAC, le verdissement, les ressources propres, la fin des rabais et les conditionnalités.
La discussion doit donc se poursuivre et le prochain Conseil européen débattra sans aucun doute de cette question. Il nous faut parvenir à un accord rapidement et en tout état de cause au plus tard en début d’année prochaine, car nous devons cette fois-ci faire beaucoup mieux qu’en 2014 – la France avait alors pris beaucoup de retard dans sa capacité à déployer les politiques européennes.
S’agissant du point consacré à l’élargissement qui a fait l’objet de longs échanges et qui a donné lieu à une abondante couverture de presse, je crois qu’il me revient ce soir de clarifier un certain nombre de points.
D’abord, la conclusion du Conseil européen n’est pas le fruit, comme je le lis depuis quelques jours, d’un quelconque veto français. Pour qu’il y ait veto, il faut qu’il y ait vote ; or il n’y en a pas eu.
Ensuite, de nombreux projets de conclusion ont été présentés, que ce soit au conseil Affaires générales ou devant le Conseil européen, et aucun de ces projets n’a réuni de consensus. Pourquoi ? Parce que certains États membres souhaitaient l’ouverture immédiate des négociations d’adhésion pour la Macédoine du Nord et l’Albanie, d’autres le souhaitaient uniquement pour la Macédoine du Nord et d’autres enfin posaient des conditions en termes de réformes supplémentaires.
La France, comme souvent dans les institutions européennes, a proposé une approche positive et crédible et a cherché à réunir une unanimité – c’est la procédure qui s’applique à ces sujets. Nous avons axé notre message sur les points suivants : d’abord, renforcer notre attachement à la perspective européenne des pays des Balkans occidentaux – leur avenir est européen –, ensuite demander la mise en œuvre complète des réformes que nous avons réclamées au Conseil en juin 2018 et 2019.
Nous avons également demandé qu’une nouvelle procédure de négociations soit proposée, ce que la France soutient depuis des années. Il ne s’agit pas de ralentir le processus, mais de s’assurer que, pendant les négociations, les populations des pays concernés y trouvent un avantage concret plutôt que de voir se dérouler un processus juridique qui n’amène qu’une seule chose : l’émigration massive des jeunes et des classes moyennes qui finalement perdent espoir.
C’est sur cette base et selon ces étapes que nous pourrons nous décider à ouvrir les négociations ou en tout cas à étudier leur ouverture au printemps 2020 en amont du sommet Union européenne-Balkans qui se tiendra sous la présidence croate à Zagreb en mai 2020.
Et puis j’aimerais vous dire quelques mots sur le Brexit, ce véritable feuilleton, même si je dois vous dire que ce sujet fait davantage l’objet de discussions depuis le Conseil européen que lors de sa réunion. En effet, jeudi, nous étions juste quelques heures après la conclusion d’un nouvel accord entre l’équipe de négociation de Michel Barnier et celle du Gouvernement britannique.
Je voudrais d’abord vous dire que cet accord est un bon accord. Il propose un nouvel équilibre sur les questions de la frontière irlandaise et du consentement démocratique en Irlande du Nord et en ce qui concerne la relation future entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Vous le savez, je vous en avais parlé la semaine dernière, la France a particulièrement insisté sur le fait que cette relation future devra être loyale, équilibrée et sans divergences excessives avec nos normes sociales, fiscales et environnementales.
Mais comme en avril dernier et plus que jamais, nous devons absolument clarifier les enjeux et les échéances pour nos concitoyens. Sans délai clair – nous connaissons trop bien cette petite musique –, la situation pourrait de nouveau s’enliser. C’est bien parce qu’en avril dernier et depuis lors le Président de la République a tenu une position très ferme sur la date butoir du 31 octobre que nous avons réussi à faire des progrès depuis dix jours. La question est finalement assez simple : est-ce que le Parlement veut, oui ou non, d’un nouvel accord ?
Nous le savons, une sortie sans accord, un no deal, serait un moment de vide juridique et nous ne le souhaitons pas, mais nous devons avec la même force limiter l’incertitude qui mine des millions de familles et d’entreprises, car l’incertitude liée au Brexit est une cause à ne pas négliger de la récession industrielle qui sévit dans certains pays européens.
Pour entrer en vigueur, ce projet d’accord de retrait révisé ainsi que la déclaration politique sur les relations futures qui l’accompagne doivent être adoptés par l’Union européenne et ratifiés par le Parlement européen et le Parlement britannique.
Ce n’est pas encore le cas ! Cependant, une étape importante a été franchie ce soir et je crois qu’il faut la saluer : pour la première fois depuis des mois, une majorité s’est exprimée en faveur des objectifs de l’accord. Pour autant, le Parlement britannique se divise sur la rapidité du processus de ratification de cet accord, ce qui complique naturellement les choses.
Nous n’avons donc pas de clarté sur le calendrier, ce qui accroît l’incertitude. D’autant plus que le Parlement britannique a mis sur la table des amendements de substance, notamment pour revenir à l’union douanière, étendue à tout le Royaume-Uni, comme c’était déjà le cas dans la version de l’accord avec Theresa May. Vous imaginez bien que, lorsqu’un accord est amendé d’un côté, il est difficile pour l’autre partie, en l’occurrence les Européens, de déterminer sa position.
De manière très solennelle, je veux le dire devant le Sénat, qui représente les Français, parfois de l’étranger, les territoires, nous devons absolument sortir de cette incertitude, qui est toxique, angoissante, pénalisante pour la vie de nos familles et des entreprises.
Certains nous disent que la situation de ce soir justifierait forcément une extension. J’ai envie de répondre : pour quoi faire ? Nous le savons, le temps seul n’apportera pas de solution. Seule une décision politique peut apporter une clarification.
Il nous faut comprendre comment les Britanniques prévoient de recréer les conditions d’un alignement démocratique entre le peuple, le parlement et le gouvernement. Certains nous parlent d’élections, d’autres de référendum. La position française est de dire que nous ne pouvons pas étendre à l’infini, en restant spectateurs d’un processus dont rien ne ressort. Une extension ou une demande d’extension ne peut être entendue que si elle est justifiée et que nous en comprenons les raisons. Je crois qu’il y a là, pour nous tous, une ligne claire à tenir.
Pendant ce Conseil européen, les chefs d’État et de gouvernement ont également échangé sur les sujets de politique étrangère, en particulier la situation du nord-est de la Syrie et le problème des forages turcs en Méditerranée. Le Conseil, comme j’avais pu le faire devant cette assemblée lors d’un débat sur l’offensive turque, a condamné très fermement et à l’unanimité les actions militaires unilatérales de la Turquie en Syrie. Il a pris acte de l’annonce par les États-Unis et la Turquie d’une pause dans les opérations militaires, mais il a surtout demandé qu’elles cessent immédiatement et de manière définitive, avec un retrait des forces en présence. De plus, conformément aux conclusions du Conseil des affaires étrangères de l’Union européenne du 14 octobre dernier, il a rappelé que tous les États membres avaient décidé de suspendre les licences d’exportation d’armement vers la Turquie. Un appel collectif à la réunion de la coalition contre Daech a été lancé pour que ceux qui, hier, combattaient ensemble et qui, aujourd’hui, combattent les uns contre les autres, prennent leurs responsabilités.
Sur le sujet des forages turcs en Méditerranée orientale, le Conseil européen a endossé les conclusions du conseil du 14 octobre, qui prévoient l’adoption de mesures restrictives, ciblées, à l’encontre des responsables de ces forages illégaux et ont réaffirmé la solidarité entière de l’Union européenne avec Chypre.
Enfin, je terminerai sur la prise de fonction de la nouvelle Commission, même si ce point n’a pas été officiellement à l’ordre du jour de la réunion. Il est clair qu’elle ne pourra pas avoir lieu le 1er novembre. L’objectif est désormais le 1er décembre, si les trois nouvelles candidatures sont présentées dans les deux prochaines semaines. C’est un enjeu essentiel de travail collectif pour que le Conseil, le Parlement et la Commission puissent faire ce que l’on attend d’eux : proposer des projets européens et les mettre en œuvre pour apporter des résultats à nos concitoyens.
Applaudissements au banc des commissions, sur les travées du groupe LaREM et sur des travées du groupe UC.

La parole est à M. le président de la commission des affaires étrangères.

Madame la secrétaire d’État, je vous remercie de ce compte rendu clair, qui nous a permis de survoler les points qui ont été évoqués.
Ce Conseil européen devait ouvrir une nouvelle page pour l’Europe. Le moins que l’on puisse dire est qu’il nous laisse un sentiment un peu mitigé.
Alors que la France a une position forte, aujourd’hui, en Europe, il est bon que nous veillions à ne pas gâcher notre crédit par ce que l’on pourrait qualifier de maladresse, qui nous conduirait à l’isolement.
Je ne reviendrai pas sur le rejet par le Parlement européen de la candidate française à la Commission. Le choix français était risqué, passons à l’étape suivante. Où en est-on aujourd’hui, madame la secrétaire d’État ? Avez-vous reçu des garanties quant au maintien des attributions élargies pour le futur commissaire français ou bien cet épisode affaiblira-t-il durablement nos positions à Bruxelles ?
Sur l’élargissement, nous avons été maladroits dans la méthode et je ne me satisfais pas, pour ma part, de cette victoire à la Pyrrhus, quand la France pense avoir raison contre tous. À quel prix ! Là encore, je le dis avec un peu de regret, nous n’avons peut-être pas su mettre les formes. Il y a les faits et la manière dont l’opinion et la presse le rapportent. Or nous avons depuis samedi, de la Suède à l’Italie, des retours assez négatifs de pays qui ne comprennent pas la position française compte tenu de ce qu’avait déclaré le Président de la République lors de son discours aux ambassadeurs.
Sur le fond, nous partageons la volonté de réformer le processus d’adhésion. Il faut qu’il soit plus politique, plus rigoureux, et qu’il demeure réversible et adapté à la fois à la situation de chaque pays candidat et à la capacité d’absorption de l’Union. Dans une Europe menacée d’éclatement voire de paralysie, l’élargissement ne peut plus être automatique.
Aujourd’hui, les mêmes qui ne souhaitent pas augmenter le budget de l’Union souhaitent l’adhésion de nouveaux membres, et ce alors même que le Brexit, cher président Bizet, s’annonce comme un séisme, et que le fonctionnement de l’Union à 28 est déjà bien difficile.
Pour autant, nous nous alarmons de la façon dont l’attitude de la France, soutenue par les Pays-Bas et le Danemark, a été expliquée et ressentie, ainsi que de ses conséquences : des élections anticipées vont se tenir en avril en Macédoine du Nord, car nous avons, de fait, mis le Premier ministre en difficulté, et c’est tout le courageux élan de l’accord de Prespa qui risque de se trouver brisé. On ne peut sans cesse reculer l’horizon sans désespérer les peuples ! Pourquoi avoir refusé de découpler Albanie et Macédoine du Nord ? Il y avait là une première évolution qui nous semblait intéressante.
Personnellement, mais je ne suis pas le seul, je plaide, au-delà du mécanisme des 35 chapitres et de l’application des critères de Copenhague, pour une sorte de statut intermédiaire d’association plein et entier, qui soit une sorte d’antichambre à l’adhésion, …

… en fonction des efforts accomplis par chaque pays sur la lutte contre la criminalité, la maîtrise de l’immigration, les ratios économiques et monétaires. Le Gouvernement est-il prêt à intégrer cette proposition à sa réflexion sur la réforme de l’élargissement ?
Sur le Brexit – le président Bizet en parlera sûrement dans un instant –, qui nous laissera « tous perdants », comme le dit le titre d’un récent rapport du groupe de suivi sur le Brexit du Sénat, que j’ai l’honneur d’animer avec Jean Bizet, nous attendons, comme vous, la suite de l’interminable feuilleton britannique. Le vote de ce soir est indicatif ; c’est un bon point. Espérons que cette ligne tiendra dans les heures et les jours qui viennent.
J’appelle le Gouvernement à ne pas se laisser dévorer par la gestion de péripéties du quotidien, sur lesquelles nous n’avons aucune prise. L’enjeu est bien la relation future entre le Royaume-Uni et l’Union. Le rapport du Sénat pointe les dangers d’un dumping fiscal, social et réglementaire, si un « Singapour-sur-Tamise » s’installait à nos portes.
Il est urgent, aussi, de regarder au-delà du court terme et d’établir une relation future solide avec le Royaume-Uni, singulièrement dans le domaine de la défense. Les Vingt-Sept devront rester aussi solidaires qu’ils l’ont été depuis trois ans, grâce au remarquable travail de Michel Barnier.
Dernier enjeu, et non des moindres : la réforme de l’Europe. Nous sommes tous d’accord pour dire qu’une véritable refondation est nécessaire. Il faut sortir l’Europe de son impuissance et aborder sous un jour nouveau le prochain cycle européen. Le groupe Brexit du Sénat fera prochainement des propositions de feuille de route afin d’être à vos côtés pour entamer cette refondation, car l’avenir de l’Europe doit rester notre priorité.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et LaREM, ainsi qu ’ au banc des commissions.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, messieurs les présidents de commission, mes chers collègues, comme vous le savez, le Conseil européen de la semaine dernière a été essentiellement marqué par la poursuite du feuilleton du Brexit.
À l’heure du bilan, je ne peux que m’inscrire dans les pas du rapporteur général de la commission des finances, qui, lors du dernier débat préalable au Conseil européen, ici même, avait prévenu qu’il fallait se garder de tirer des conclusions hâtives sur l’issue des négociations, compte tenu des innombrables rebondissements du Brexit.
Une nouvelle fois, tous les pronostics ont été déjoués. Alors qu’un accord avait été arraché in extremis par les négociateurs, la Chambre des communes britannique a tout d’abord réservé son vote pour une date ultérieure, prolongeant ainsi une période d’incertitude politique et économique, puis voté aujourd’hui même pour cet accord, tout en rejetant le calendrier. Il reviendra sans doute de nouveau aux États membres de trancher la question d’un éventuel report du Brexit. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, a indiqué aujourd’hui à l’Assemblée nationale qu’« à ce stade, […] il n’y a pas de justification pour une nouvelle extension ». Il a ajouté : « cela fait trois ans qu’on attend cette décision. Il importe qu’elle soit aujourd’hui annoncée ».
Madame la secrétaire d’État, pouvez-vous nous éclairer sur la position française, compte tenu de ces tout derniers rebondissements ?
Concernant le contenu de l’accord trouvé, la solution du « backstop » irlandais proposée par l’Union européenne n’a finalement pas été retenue. L’Irlande du Nord restera donc dans l’union douanière britannique, tout en constituant un point d’entrée dans le marché commun. Si ce compromis permet d’éviter le rétablissement d’une frontière entre les deux Irlande, il repose en pratique sur des arrangements douaniers complexes. Madame la secrétaire d’État, cette solution comporte-t-elle des garanties suffisantes pour préserver le marché commun, alors que les contrôles douaniers pour les marchandises destinées au marché européen seront effectués par des agents britanniques ?
Pendant que les négociations patinent, le Parlement européen s’organise. Il examine actuellement une proposition de règlement visant à modifier le Fonds de solidarité de l’Union européenne afin d’en élargir le champ et de prévoir un soutien pour les États membres qui feraient face à une lourde charge financière en conséquence directe de la sortie du Royaume-Uni. Madame la secrétaire d’État, quelle est votre position sur ce texte ? Alors que l’effet du Brexit sur l’économie française pourrait s’élever jusqu’à 0, 5 % du PIB, selon l’OCDE, à combien s’élève le soutien financier que pourrait recevoir la France en application de ce texte ?
Par ailleurs, le Conseil européen de la semaine dernière a permis d’aborder un autre sujet, que suit particulièrement la commission des finances, à savoir les négociations relatives au prochain cadre financier pluriannuel, le CFP.
Après avoir procédé, une nouvelle fois, à un « échange de vues », le Conseil européen a invité la présidence finlandaise à présenter un cadre de négociation assorti de chiffres, portant à la fois sur le volume global et sur la répartition entre les rubriques budgétaires d’ici au mois de décembre prochain. Je vous rappelle, madame la secrétaire d’État, qu’un accord à l’unanimité doit être trouvé rapidement, étant donné que l’actuel CFP s’achèvera en décembre 2020.
Compte tenu de ce calendrier très serré, il semble difficilement compréhensible que les négociations n’aient pas encore permis de dégager un compromis, au moins sur le volume total du CFP. Les États membres ont fait part de leurs lignes rouges respectives, mais les blocages persistent. Il est indéniable que l’incertitude financière liée au retrait du Royaume-Uni pèse également sur l’avancée des négociations. Des concessions de la part de certains États membres vous semblent-elles envisageables d’ici à la fin de l’année ? Comment peut-on répondre à l’impatience des autorités de gestion et des porteurs de projets locaux, qui souhaitent avoir un minimum de visibilité pour l’avenir ?
Applaudissements au banc des commissions.

La parole est à M. le président de la commission des affaires européennes.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, dans le droit fil des propos tenus par les présidents Cambon et Éblé, à mon tour d’évoquer ce Conseil européen de la semaine dernière. Un épisode important de la saga du Brexit s’y est joué : les Vingt-Sept ont approuvé le nouvel accord de retrait conclu in extremis entre l’Union européenne et le Premier ministre britannique, ainsi que la nouvelle déclaration politique qui l’accompagne, ce point étant particulièrement important.
Je veux ici rendre de nouveau hommage, comme l’a fait Christian Cambon, à Michel Barnier, qui est parvenu à ce résultat en restant ferme sur les trois exigences de l’Union : préserver la paix, assurer l’intégrité du marché unique et subordonner tout futur accord de libre-échange avec le Royaume-Uni au respect de conditions de concurrence équitables.
Cet aboutissement ne signe pourtant pas la fin de l’histoire : le « super samedi » qui a suivi aura finalement été celui de la déception. Au lieu de voter sur l’accord, le Parlement britannique a adopté un amendement reportant le vote attendu, si bien que le Premier ministre britannique a été contraint de solliciter un troisième report de la date du Brexit. Enfin, hier, le président de la Chambre des communes, en lui interdisant de se prononcer sur l’accord, a définitivement réduit à néant le bref soulagement que certains avaient pu éprouver à la conclusion de l’accord de retrait révisé.
L’unité des Vingt-Sept, acquis principal du Brexit, ne l’oublions pas, pourrait même éclater si les Vingt-Sept devaient se prononcer sur une nouvelle extension du délai prévu à l’article 50, extension qui exigerait la nomination d’un commissaire britannique pour assurer le fonctionnement normal des institutions européennes. Il y a là quelque chose d’irrationnel. Madame la secrétaire d’État, comment éviter ce scénario catastrophe ?
Sur l’élargissement, autre sujet évoqué par le président Cambon, il ne serait pas bon que notre pays se trouve de nouveau isolé. Déjà, la semaine dernière, il a fait cavalier seul, ou presque. J’ai le sentiment que la France s’est distinguée par son exigence louable à l’égard du respect des conditions fixées pour ouvrir des négociations d’adhésion et par son appel à revoir le processus d’adhésion, ce à quoi nous souscrivons. Sans doute devons-nous revoir, en effet, la façon dont nous accompagnons les pays candidats à l’adhésion ; sans doute devons-nous dénoncer l’incohérence de ceux qui prônent l’élargissement et refusent en même temps d’augmenter le budget de l’Union ; sans doute faut-il cesser d’utiliser l’élargissement comme un seul instrument de politique étrangère, mais il est dangereux de tarder à tendre la main à des pays comme l’Albanie et, plus encore, la Macédoine du Nord, qui consentent des efforts importants pour se rapprocher de l’Union et voient leur jeunesse les quitter pour nous rejoindre.
M. Olivier Cadic applaudit.

La Chine, la Russie, la Turquie et les États-Unis – j’oserai même ajouter l’Arabie saoudite – ne nous attendent pas pour étendre leur influence dans les Balkans, …

… au risque de réveiller la poudrière et de menacer la sécurité de notre continent.
Madame la secrétaire d’État, quelle solution alternative entendez-vous proposer rapidement à ces pays qui frappent aujourd’hui à la porte de l’Union, qui pourraient demain s’en détourner, et que nous ne pouvons pas désespérer trop longtemps ? Le Sénat a des idées sur la question. Nous vous en ferons part le moment venu, mais nous aimerions aussi écouter vos propositions.
Dernier sujet, qui n’est pas sans lien avec le précédent : la Turquie, pays candidat à l’adhésion, mène des activités de forage illégales d’hydrocarbures dans la zone économique exclusive chypriote. Je tiens ici à souligner la nécessité d’une réaction européenne claire, appropriée et progressive en réponse à cette provocation sur le territoire même de l’UE, bien qu’elle soit d’une nature et d’une ampleur différentes de l’offensive que mène Ankara en Syrie. Cette question sensible a également été soulevée lors de la dernière session d’automne de l’Assemblée parlementaire de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l’OSCE, à laquelle j’ai participé, et durant laquelle notre collègue Pascal Allizard…

… ici présent, a joué un rôle majeur.
Je n’ignore pas que la relation entre l’Union européenne et la Turquie recouvre des enjeux variés, y compris migratoires, mais nous devons marquer notre solidarité envers Chypre et, sans nourrir l’escalade dans un contexte tendu, veiller à ce que ces violations du droit international ne restent pas sans conséquence. Madame la secrétaire d’État, quelles mesures pouvons-nous attendre de l’Union en ce sens ?
J’ai bien conscience de ne pas avoir pu évoquer, dans cette intervention liminaire, tous les sujets abordés lors du dernier Conseil européen. J’ai en effet focalisé mon attention sur les points qui me semblent les plus décisifs au regard de l’identité et de l’intégrité de l’Union européenne. Je sais pouvoir compter sur mes collègues pour compléter utilement notre débat.

La parole est à Mme la secrétaire d’État, qui souhaite répondre aux trois présidents de commission.
App laudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC, ainsi qu ’ au banc des commissions.
Merci, madame la présidente.
J’ai été interrogée par M. le président Cambon sur le portefeuille du prochain commissaire français. Nous cherchons à nous assurer que l’industrie, le numérique, la défense soient bien, au cœur de cette nouvelle Commission, portés par le candidat que le Président de la République proposera à Ursula von der Leyen dans les prochains jours. Sur son profil type, son portrait-robot, si je peux m’exprimer ainsi, il faut qu’il s’agisse de quelqu’un susceptible de gagner la confiance du Parlement européen et travailler avec lui à obtenir des résultats. Au fond, la question est la suivante : comment créons-nous concrètement des emplois en Europe dans les domaines industriels, numériques, et dans le secteur de la défense ? Nous cherchons non pas une figure, mais un candidat qui aura la capacité de porter devant le Parlement le projet ambitieux du Président de la République, qui, parfois, fait grincer un peu les dents.
Vous m’avez aussi interrogée sur la nomination d’un commissaire britannique. Je rappelle que c’est bien pour cette raison que le Président de la République avait fixé la date du 31 octobre. J’étais même venue m’en expliquer ici. Il fallait s’assurer qu’à l’entrée en fonction de la nouvelle Commission nous puissions être opérationnels dans sa configuration de plein exercice, c’est-à-dire sans les Britanniques. Je suis d’accord avec vous, la relation future sur l’économie, la défense, la politique extérieure, la sécurité, la culture, l’éducation, la recherche aura à être reconstruite. Néanmoins, je le répète, l’échéance du 31 octobre nous permettait d’avoir une position cohérente.
Nous le savons, si le Royaume-Uni est encore membre de l’Union européenne après l’entrée en fonction de la nouvelle commission, dorénavant fixée au 1er décembre, la question va se poser. C’est donc pour cela que nous travaillons à des échéances les plus claires et les plus rapprochées possible. Si un commissaire doit être nommé, il faut une décision à l’unanimité de tous les chefs d’État et de gouvernement, puisqu’il faudra changer des textes qui requièrent une telle unanimité. C’est beaucoup de travail et de procédures. C’est surtout nous retrouver dans une situation que nous ne voulions pas, c’est-à-dire que le Brexit perturbe notre capacité à nous donner des objectifs et des priorités pour les citoyens de l’Union.
Je répondrai bien entendu ensuite aux questions que les sénatrices et les sénateurs m’auront posées, mais je veux m’attarder un instant sur l’élargissement. Pourquoi avons-nous refusé de découpler ? Le Président de la République a pensé qu’il s’agissait d’une stratégie funeste pour la stabilité de la région. C’était aussi l’avis de très nombreux chefs d’État et de gouvernement. Si, d’un côté, nous disons « oui » à la Macédoine du Nord, mais que nous laissons l’Albanie au milieu du gué, sans perspective, sans trajectoire, tous les efforts que nous faisons pour stabiliser le Kosovo, sachant qu’il y a des minorités albanaises dans l’intégralité des pays de la région, seront réduits à néant.
En outre, nous avons constaté que des réformes demandées en juin 2018 et en juin 2019 n’étaient pas arrivées à leur terme en Macédoine du Nord, et que d’autres réformes demandées en Albanie n’étaient pas non plus mises en œuvre complètement. Il était alors difficile de dire qu’avec la même méthode nous arrivions à des conclusions différentes.
Le point clé de notre démarche, monsieur le président Bizet, c’est non pas de proposer une solution alternative, mais de travailler avec ces pays pour qu’ils puissent rejoindre l’Union européenne en ayant franchi les étapes initiales que nous leur avons fixées. C’est un processus par étapes, et nous ferons des propositions à la Commission, propositions que nous avons partagées, depuis déjà quelques mois, avec nos partenaires. Je ne parlerai pas de statut intermédiaire. À mon sens, ce n’est pas forcément le statut qui compte, mais il faut que nous puissions apporter à ces pays la possibilité d’avoir un accès graduel, séquentiel aux politiques, en commençant, peut-être, par la politique agricole, la politique de cohésion, la politique d’innovation, pour, in fine, accéder au marché intérieur et au Conseil européen.
Aujourd’hui, c’est un processus purement juridique. Seule la Commission met de la pression, mais les populations n’en voient pas les résultats. Pour un gouvernement, c’est plus difficile de faire des réformes si la pression vient seulement de l’extérieur. Si nous arrivons à apporter aux populations des bénéfices concrets, ces peuples accorderont beaucoup de crédit à l’Europe.

La parole est à Mme la secrétaire d’État, qui souhaite répondre aux trois présidents de commission.
Merci, madame la présidente.
J’ai été interrogée par M. le président Cambon sur le portefeuille du prochain commissaire français. Nous cherchons à nous assurer que l’industrie, le numérique, la défense soient bien, au cœur de cette nouvelle Commission, portés par le candidat que le Président de la République proposera à Ursula von der Leyen dans les prochains jours. Sur son profil type, son portrait-robot, si je peux m’exprimer ainsi, il faut qu’il s’agisse de quelqu’un susceptible de gagner la confiance du Parlement européen et travailler avec lui à obtenir des résultats. Au fond, la question est la suivante : comment créons-nous concrètement des emplois en Europe dans les domaines industriels, numériques, et dans le secteur de la défense ? Nous cherchons non pas une figure, mais un candidat qui aura la capacité de porter devant le Parlement le projet ambitieux du Président de la République, qui, parfois, fait grincer un peu les dents.
Vous m’avez aussi interrogée sur la nomination d’un commissaire britannique. Je rappelle que c’est bien pour cette raison que le Président de la République avait fixé la date du 31 octobre. J’étais même venue m’en expliquer ici. Il fallait s’assurer qu’à l’entrée en fonction de la nouvelle Commission nous puissions être opérationnels dans sa configuration de plein exercice, c’est-à-dire sans les Britanniques. Je suis d’accord avec vous, la relation future sur l’économie, la défense, la politique extérieure, la sécurité, la culture, l’éducation, la recherche aura à être reconstruite. Néanmoins, je le répète, l’échéance du 31 octobre nous permettait d’avoir une position cohérente.
Nous le savons, si le Royaume-Uni est encore membre de l’Union européenne après l’entrée en fonction de la nouvelle commission, dorénavant fixée au 1er décembre, la question va se poser. C’est donc pour cela que nous travaillons à des échéances les plus claires et les plus rapprochées possible. Si un commissaire doit être nommé, il faut une décision à l’unanimité de tous les chefs d’État et de gouvernement, puisqu’il faudra changer des textes qui requièrent une telle unanimité. C’est beaucoup de travail et de procédures. C’est surtout nous retrouver dans une situation que nous ne voulions pas, c’est-à-dire que le Brexit perturbe notre capacité à nous donner des objectifs et des priorités pour les citoyens de l’Union.
Je répondrai bien entendu ensuite aux questions que les sénatrices et les sénateurs m’auront posées, mais je veux m’attarder un instant sur l’élargissement. Pourquoi avons-nous refusé de découpler ? Le Président de la République a pensé qu’il s’agissait d’une stratégie funeste pour la stabilité de la région. C’était aussi l’avis de très nombreux chefs d’État et de gouvernement. Si, d’un côté, nous disons « oui » à la Macédoine du Nord, mais que nous laissons l’Albanie au milieu du gué, sans perspective, sans trajectoire, tous les efforts que nous faisons pour stabiliser le Kosovo, sachant qu’il y a des minorités albanaises dans l’intégralité des pays de la région, seront réduits à néant.
En outre, nous avons constaté que des réformes demandées en juin 2018 et en juin 2019 n’étaient pas arrivées à leur terme en Macédoine du Nord, et que d’autres réformes demandées en Albanie n’étaient pas non plus mises en œuvre complètement. Il était alors difficile de dire qu’avec la même méthode nous arrivions à des conclusions différentes.
Le point clé de notre démarche, monsieur le président Bizet, c’est non pas de proposer une solution alternative, mais de travailler avec ces pays pour qu’ils puissent rejoindre l’Union européenne en ayant franchi les étapes initiales que nous leur avons fixées. C’est un processus par étapes, et nous ferons des propositions à la Commission, propositions que nous avons partagées, depuis déjà quelques mois, avec nos partenaires. Je ne parlerai pas de statut intermédiaire. À mon sens, ce n’est pas forcément le statut qui compte, mais il faut que nous puissions apporter à ces pays la possibilité d’avoir un accès graduel, séquentiel aux politiques, en commençant, peut-être, par la politique agricole, la politique de cohésion, la politique d’innovation, pour, in fine, accéder au marché intérieur et au Conseil européen.
Aujourd’hui, c’est un processus purement juridique. Seule la Commission met de la pression, mais les populations n’en voient pas les résultats. Pour un gouvernement, c’est plus difficile de faire des réformes si la pression vient seulement de l’extérieur. Si nous arrivons à apporter aux populations des bénéfices concrets, ces peuples accorderont beaucoup de crédit à l’Europe.
Je ne vois pas non plus d’incohérence avec le discours des ambassadeurs.
Le Président de la République a déclaré que nous devions nous réinvestir dans les Balkans pour que ce ne soit pas la Chine, la Russie, la Turquie et d’autres qui viennent investir, construire des infrastructures, conclure des partenariats universitaires.
Je ne vois pas non plus d’incohérence avec le discours des ambassadeurs.
Le Président de la République a déclaré que nous devions nous réinvestir dans les Balkans pour que ce ne soit pas la Chine, la Russie, la Turquie et d’autres qui viennent investir, construire des infrastructures, conclure des partenariats universitaires.
Nous avons relancé le plan d’engagement de l’Agence française de développement, l’AFD, pour les Balkans. Il s’agit d’engagements concrets, réaffirmés par le Président de la République.
Nous avons relancé le plan d’engagement de l’Agence française de développement, l’AFD, pour les Balkans. Il s’agit d’engagements concrets, réaffirmés par le Président de la République.
Messieurs les sénateurs, ce qui n’est pas crédible, c’est de considérer que le seul outil de politique étrangère et de partenariat à notre disposition, c’est un épais formulaire de 6 000 questions envoyé à des gouvernements, qui nous permettrait de dire : « Nous avons rempli notre rôle ! » Il y a là beaucoup d’hypocrisie. Si nous voulons que ces pays s’arriment à l’Europe, nous devons leur proposer des politiques concrètes pour qu’ils ne fassent pas affaire avec d’autres puissances.
Je tiens à vous dire qu’il est dangereux et, au fond, assez dérangeant d’entendre que l’élargissement est notre seul levier de politique de partenariat.

C’est un engagement qui avait été pris après la guerre en ex-Yougoslavie !
Messieurs les sénateurs, ce qui n’est pas crédible, c’est de considérer que le seul outil de politique étrangère et de partenariat à notre disposition, c’est un épais formulaire de 6 000 questions envoyé à des gouvernements, qui nous permettrait de dire : « Nous avons rempli notre rôle ! » Il y a là beaucoup d’hypocrisie. Si nous voulons que ces pays s’arriment à l’Europe, nous devons leur proposer des politiques concrètes pour qu’ils ne fassent pas affaire avec d’autres puissances.
Je tiens à vous dire qu’il est dangereux et, au fond, assez dérangeant d’entendre que l’élargissement est notre seul levier de politique de partenariat.
Quand nous travaillons avec l’Ukraine, la Moldavie, les pays d’Afrique du Nord, nous avons d’autres leviers. Pourquoi, avec ceux-là, en serions-nous réduits à parler, en termes juridiques, d’organisation des marchés publics et de recrutement des fonctionnaires ? Je pense que nous devons muscler nos dispositifs et allier le concret au juridique. À entendre vos réactions, je pense que vous y reviendrez.

C’est un engagement qui avait été pris après la guerre en ex-Yougoslavie !
Quand nous travaillons avec l’Ukraine, la Moldavie, les pays d’Afrique du Nord, nous avons d’autres leviers. Pourquoi, avec ceux-là, en serions-nous réduits à parler, en termes juridiques, d’organisation des marchés publics et de recrutement des fonctionnaires ? Je pense que nous devons muscler nos dispositifs et allier le concret au juridique. À entendre vos réactions, je pense que vous y reviendrez.
Enfin, je terminerai par le CFP. Vous avez raison, monsieur le président Éblé, il nous faut avancer, mais aujourd’hui la proposition prétendument de consensus que la présidence finlandaise a mise sur la table a abouti à un autre consensus : aucun pays n’est d’accord !
Nous devons donc reprendre la discussion, avec une méthode différente, selon nous. Le point de départ ne peut pas être de savoir combien chacun met, à la décimale près. Peu importe que ce soit 1, 065, 1, 066 ou 1, 067 ou 1, 00, comme certains nous le disent. Vous serez d’accord avec moi, je ne connais pas de budget qui soit construit à partir d’un chiffre arbitraire décidé dans un bureau. Un budget, c’est un outil politique. Quelles priorités fixons-nous ? Quelles politiques voulons-nous reconduire ? Que voulons-nous faire de nouveau ? Sur quelles ressources nous appuyons-nous ? Je sais bien qu’il ne faut pas inventer des impôts tous les matins, mais je vous rappelle que l’Europe n’a pas de ressources propres. Tout dépend des contributions nationales, et donc des contribuables que sont les entreprises et les ménages. Tant que nous n’aurons pas eu cette discussion, qui inclut la fin des rabais et notre capacité à être cohérents, tout d’abord sur le climat, la France n’entrera pas dans des discussions de boutiquiers.
Applaudissements sur les travées du groupe LaREM.
Enfin, je terminerai par le CFP. Vous avez raison, monsieur le président Éblé, il nous faut avancer, mais aujourd’hui la proposition prétendument de consensus que la présidence finlandaise a mise sur la table a abouti à un autre consensus : aucun pays n’est d’accord !
Nous devons donc reprendre la discussion, avec une méthode différente, selon nous. Le point de départ ne peut pas être de savoir combien chacun met, à la décimale près. Peu importe que ce soit 1, 065, 1, 066 ou 1, 067 ou 1, 00, comme certains nous le disent. Vous serez d’accord avec moi, je ne connais pas de budget qui soit construit à partir d’un chiffre arbitraire décidé dans un bureau. Un budget, c’est un outil politique. Quelles priorités fixons-nous ? Quelles politiques voulons-nous reconduire ? Que voulons-nous faire de nouveau ? Sur quelles ressources nous appuyons-nous ? Je sais bien qu’il ne faut pas inventer des impôts tous les matins, mais je vous rappelle que l’Europe n’a pas de ressources propres. Tout dépend des contributions nationales, et donc des contribuables que sont les entreprises et les ménages. Tant que nous n’aurons pas eu cette discussion, qui inclut la fin des rabais et notre capacité à être cohérents, tout d’abord sur le climat, la France n’entrera pas dans des discussions de boutiquiers.
Applaudissements sur les travées du groupe LaREM.
Applaudissements sur les travées des groupes UC et LaREM, ainsi qu ’ au banc des commissions.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, messieurs les présidents de commission, mes chers collègues, je concentrerai mon intervention sur la priorité du Brexit. Est-il permis d’être original à ce propos ? Je ne m’y autoriserai pas. Je me limiterai à trois suggestions et à une réserve, ou plutôt une manifestation de scepticisme.
La première suggestion concerne la position des Vingt-Sept sur la demande de report ou d’extension de l’article 50. Ce qui sera retenu n’est pas l’exégèse des positions des uns et des autres sur la longueur du délai, mais la capacité des Vingt-Sept à rester unis pour la suite. Si je devais résumer : peu importe le délai si nous avons l’unanimité !
Applaudissements sur les travées des groupes UC et LaREM, ainsi qu ’ au banc des commissions.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, messieurs les présidents de commission, mes chers collègues, je concentrerai mon intervention sur la priorité du Brexit. Est-il permis d’être original à ce propos ? Je ne m’y autoriserai pas. Je me limiterai à trois suggestions et à une réserve, ou plutôt une manifestation de scepticisme.
La première suggestion concerne la position des Vingt-Sept sur la demande de report ou d’extension de l’article 50. Ce qui sera retenu n’est pas l’exégèse des positions des uns et des autres sur la longueur du délai, mais la capacité des Vingt-Sept à rester unis pour la suite. Si je devais résumer : peu importe le délai si nous avons l’unanimité !

Ma deuxième suggestion concerne la période de transition pendant laquelle le Royaume-Uni continuera à appliquer les règles de l’Union européenne, à savoir jusqu’au 31 décembre 2020, avec possibilité de prolongation, comme chacun sait, jusqu’à fin 2022. Si le Brexit se déclenche, par exemple, le 31 octobre, et que, le 3, le 4 ou le 5 novembre, peu importe, il ne s’est rien produit, j’entends déjà l’ironie des extrêmes sur le thème : ils vous ont menti ! Vous voyez bien que ce n’était pas si grave ! Et nous retomberons alors dans la perte de confiance à l’égard de la parole publique, ce qui n’est pas un petit problème aujourd’hui. Selon moi, il faudrait que le Gouvernement fasse la pédagogie de cette période de transition pour que chacun comprenne bien que les problèmes sont à venir.
Ma troisième suggestion concerne l’hypothèse d’un report, même modeste. Le Brexit étant entouré d’un halo d’incrédulité, je ne crois pas que nos PME soient prêtes. Tout délai doit signifier de mieux se préparer, et non de procrastiner.
La réserve que je vous ai annoncée concerne le contenu du nouvel accord dit « hybride ». Pour les uns, l’Irlande du Nord est dedans, et pour les autres elle est dehors. Quand dans un contrat, une partie comprend A et l’autre partie comprend B, il n’est pas nécessaire d’être un grand juriste pour prévoir des problèmes qui vont impacter d’une manière ou d’une autre le marché unique.

Ma deuxième suggestion concerne la période de transition pendant laquelle le Royaume-Uni continuera à appliquer les règles de l’Union européenne, à savoir jusqu’au 31 décembre 2020, avec possibilité de prolongation, comme chacun sait, jusqu’à fin 2022. Si le Brexit se déclenche, par exemple, le 31 octobre, et que, le 3, le 4 ou le 5 novembre, peu importe, il ne s’est rien produit, j’entends déjà l’ironie des extrêmes sur le thème : ils vous ont menti ! Vous voyez bien que ce n’était pas si grave ! Et nous retomberons alors dans la perte de confiance à l’égard de la parole publique, ce qui n’est pas un petit problème aujourd’hui. Selon moi, il faudrait que le Gouvernement fasse la pédagogie de cette période de transition pour que chacun comprenne bien que les problèmes sont à venir.
Ma troisième suggestion concerne l’hypothèse d’un report, même modeste. Le Brexit étant entouré d’un halo d’incrédulité, je ne crois pas que nos PME soient prêtes. Tout délai doit signifier de mieux se préparer, et non de procrastiner.
La réserve que je vous ai annoncée concerne le contenu du nouvel accord dit « hybride ». Pour les uns, l’Irlande du Nord est dedans, et pour les autres elle est dehors. Quand dans un contrat, une partie comprend A et l’autre partie comprend B, il n’est pas nécessaire d’être un grand juriste pour prévoir des problèmes qui vont impacter d’une manière ou d’une autre le marché unique.

Pour ce qui concerne les vocations à venir d’un accord de libre-échange, je suis assez sceptique bien que, vous le savez, très européen, quant à la solidité des digues face au risque d’une concurrence déloyale.
Est-ce un bon accord ? J’ai entendu, madame la secrétaire d’État, votre réponse affirmative et ne demande qu’à vous croire. Je comprends, sans difficulté, qu’un accord est préférable à un no deal. Mais il sera à l’évidence nécessaire d’approfondir la compréhension de sa teneur, de ses détails et de ses mécanismes avant d’énoncer qu’il s’agit d’un bon accord.
La démarche actuellement entamée par le Parlement britannique, consistant à examiner le détail de l’accord, est, je crois, un modèle à ne pas négliger pour le Parlement européen. Je regrette que le Parlement français – mais telles sont nos règles institutionnelles – ne puisse faire le même exercice. Nous en mourons pourtant d’envie !
Applaudissements sur les travées du groupe UC et au banc des commissions.

Pour ce qui concerne les vocations à venir d’un accord de libre-échange, je suis assez sceptique bien que, vous le savez, très européen, quant à la solidité des digues face au risque d’une concurrence déloyale.
Est-ce un bon accord ? J’ai entendu, madame la secrétaire d’État, votre réponse affirmative et ne demande qu’à vous croire. Je comprends, sans difficulté, qu’un accord est préférable à un no deal. Mais il sera à l’évidence nécessaire d’approfondir la compréhension de sa teneur, de ses détails et de ses mécanismes avant d’énoncer qu’il s’agit d’un bon accord.
La démarche actuellement entamée par le Parlement britannique, consistant à examiner le détail de l’accord, est, je crois, un modèle à ne pas négliger pour le Parlement européen. Je regrette que le Parlement français – mais telles sont nos règles institutionnelles – ne puisse faire le même exercice. Nous en mourons pourtant d’envie !
Applaudissements sur les travées du groupe UC et au banc des commissions.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, une fois encore, le Conseil européen s’est penché sur l’inévitable Brexit. Alors que la date butoir du 31 octobre approche, le feuilleton continue… Le 19 octobre dernier, journée prématurément qualifiée de « super samedi », n’a pas permis de clarifier la situation malgré un accord remanié. Le débat d’hier à la Chambre des communes a encore une fois souligné la confusion.
Dans ces conditions, la question d’un report se pose à nouveau. Berlin vient d’ouvrir la porte à un éventuel report technique. Quelle est la position française sur le principe d’un nouveau délai jusqu’au début de l’année 2020 ?
Madame la secrétaire d’État, comme vous avez eu l’occasion de le souligner devant notre commission des affaires européennes il y a quelques jours, nos intérêts frontaliers directs avec la Grande-Bretagne nous obligent à favoriser les conditions d’un retrait négocié. Toutefois, le Brexit étant l’otage de la politique intérieure britannique, l’Union européenne doit aussi en appeler à la responsabilité de Londres.
Nous devons désormais avancer, en refermant le plus rapidement possible ce chapitre du Brexit, car l’Union européenne a de nombreux autres chantiers à poursuivre.
Parmi ceux-ci, je reviendrai sur les négociations autour du cadre financier pluriannuel 2021-2027. Les conclusions du Conseil invitent à la présentation d’un cadre assorti de chiffres d’ici à la fin de l’année. Mon groupe y sera attentif. En attendant, nous connaissons les grandes priorités retenues, sur lesquelles on ne peut que s’accorder, qu’il s’agisse du soutien à la recherche et l’innovation, à l’investissement, à la politique de migration, de gestion des frontières et de défense… Tout cela va dans le bon sens puisqu’il s’agit d’encourager la mutualisation des moyens pour affronter des défis qui se posent à nous au niveau mondial ; et ils sont nombreux.
Pour autant, j’ai déjà eu l’occasion de le rappeler ici, mon groupe est attaché à la préservation des moyens des politiques traditionnelles, compte tenu des enjeux qui se jouent aussi à l’échelle de nos territoires. Je pense bien sûr à la PAC ainsi qu’à la politique de cohésion qui sont, hélas, touchées par des réductions budgétaires décidées par la précédente Commission.
J’ai entendu que l’évolution de la part de l’enveloppe dédiée à la PAC n’était pas le point le plus important, mais qu’il fallait plutôt se pencher sur ce que l’on faisait des crédits. Certes, nous sommes tous conscients, je pense, de la nécessité d’inciter l’agriculture à se transformer et à accélérer sa transition écologique. Mais cet objectif d’une agriculture plus vertueuse a un coût, en particulier dans un monde plus ouvert et compte tenu des accords de libre-échange que l’Union européenne met en place et qui ne sont pas sans impact sur le secteur agricole.
À cet égard, les agriculteurs se sont encore mobilisés ce matin même, inquiets du traité avec le Mercosur qui ouvrirait la porte à des distorsions de concurrence. Le RDSE a déjà alerté le Gouvernement sur cet accord par un texte devenu le 27 avril 2018 une résolution européenne du Sénat.
Nous renouvelons le vœu d’une vigilance particulière sur ce dossier afin que les filières, en particulier celles du sucre et de l’élevage bovin, ne soient pas fragilisées plus qu’elles ne le sont déjà.
S’agissant de la politique de cohésion, si les négociations budgétaires de la précédente programmation ont retardé la mise en œuvre des projets, on sait très bien que la sous-consommation des crédits est due à une gestion interne aux États membres, pas toujours très efficace. C’est le cas dans notre pays.
Notre collègue Colette Mélot soulève très justement, dans son rapport sur le sujet, les difficultés liées au pilotage des fonds européens en France. Il est urgent de revoir le fonctionnement de l’autorité de gestion de ces fonds pour, d’une part, multiplier les projets dont nos territoires ont besoin, et, d’autre part, ne pas voir l’Union européenne restreindre la politique de cohésion au prétexte de la sous-consommation de ses crédits.
Le Conseil européen a également échangé sur le suivi des priorités de l’Union européenne énoncées dans le programme stratégique 2019-2024. Je ne reviendrai pas sur l’ensemble des orientations générales, mais j’émettrai quelques souhaits portés par mon groupe.
S’agissant du volet économique, le programme stratégique évoque la nécessité d’avoir une approche plus intégrée, en matière industrielle notamment, ainsi qu’un environnement avec des règles du jeu plus équitables. Aussi faudrait-il s’y atteler plus rapidement et plus concrètement.
Je prendrai un exemple dans le domaine de l’intelligence artificielle, dont nous avons débattu récemment au Sénat et qui est un élément de la stratégie pour le marché unique numérique. C’est un domaine dans lequel nous devons absolument fabriquer un champion européen afin de ne pas laisser les États-Unis et la Chine gagner définitivement la bataille de l’intelligence artificielle, compte tenu de ses enjeux non seulement économiques mais aussi stratégiques, et j’ajouterai éthiques.
Cependant, pour y parvenir, il faudrait assouplir quelques-unes des règles du marché unique. Je pense à certains blocages de la politique européenne de la concurrence, qui interdit la constitution de leaders européens pour éviter un monopole au sein de l’Union. C’est un principe louable pour le marché intérieur, mais qui s’avère être un frein pour affronter la concurrence mondiale dans des secteurs technologiques essentiels. Il me semble que la Commission doit approfondir cette question, les projets importants d’intérêt européen commun, les PIIEC, mentionnés à l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne n’étant peut-être pas suffisants dans le contexte d’une guerre commerciale aujourd’hui difficile.
Enfin, je souhaitais évoquer brièvement la question de l’élargissement. La position de mon groupe a été rappelée la semaine dernière à l’occasion du débat sur l’accession de la Macédoine à l’OTAN.
Nous partageons, madame la secrétaire d’État, la position du Chef de l’État. L’élargissement ne peut pas être poursuivi sans une amélioration de la capacité d’agir en commun. En outre, nous avons besoin d’une Europe qui œuvre à une convergence sur le plan économique, fiscal et social, objectif qu’un élargissement sans bornes risquerait de compromettre.
En somme, tirons les leçons de notre passé récent pour faire de l’Union européenne une véritable zone de prospérité.
Applaudissements sur les travées des groupes LaREM et UC.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, une fois encore, le Conseil européen s’est penché sur l’inévitable Brexit. Alors que la date butoir du 31 octobre approche, le feuilleton continue… Le 19 octobre dernier, journée prématurément qualifiée de « super samedi », n’a pas permis de clarifier la situation malgré un accord remanié. Le débat d’hier à la Chambre des communes a encore une fois souligné la confusion.
Dans ces conditions, la question d’un report se pose à nouveau. Berlin vient d’ouvrir la porte à un éventuel report technique. Quelle est la position française sur le principe d’un nouveau délai jusqu’au début de l’année 2020 ?
Madame la secrétaire d’État, comme vous avez eu l’occasion de le souligner devant notre commission des affaires européennes il y a quelques jours, nos intérêts frontaliers directs avec la Grande-Bretagne nous obligent à favoriser les conditions d’un retrait négocié. Toutefois, le Brexit étant l’otage de la politique intérieure britannique, l’Union européenne doit aussi en appeler à la responsabilité de Londres.
Nous devons désormais avancer, en refermant le plus rapidement possible ce chapitre du Brexit, car l’Union européenne a de nombreux autres chantiers à poursuivre.
Parmi ceux-ci, je reviendrai sur les négociations autour du cadre financier pluriannuel 2021-2027. Les conclusions du Conseil invitent à la présentation d’un cadre assorti de chiffres d’ici à la fin de l’année. Mon groupe y sera attentif. En attendant, nous connaissons les grandes priorités retenues, sur lesquelles on ne peut que s’accorder, qu’il s’agisse du soutien à la recherche et l’innovation, à l’investissement, à la politique de migration, de gestion des frontières et de défense… Tout cela va dans le bon sens puisqu’il s’agit d’encourager la mutualisation des moyens pour affronter des défis qui se posent à nous au niveau mondial ; et ils sont nombreux.
Pour autant, j’ai déjà eu l’occasion de le rappeler ici, mon groupe est attaché à la préservation des moyens des politiques traditionnelles, compte tenu des enjeux qui se jouent aussi à l’échelle de nos territoires. Je pense bien sûr à la PAC ainsi qu’à la politique de cohésion qui sont, hélas, touchées par des réductions budgétaires décidées par la précédente Commission.
J’ai entendu que l’évolution de la part de l’enveloppe dédiée à la PAC n’était pas le point le plus important, mais qu’il fallait plutôt se pencher sur ce que l’on faisait des crédits. Certes, nous sommes tous conscients, je pense, de la nécessité d’inciter l’agriculture à se transformer et à accélérer sa transition écologique. Mais cet objectif d’une agriculture plus vertueuse a un coût, en particulier dans un monde plus ouvert et compte tenu des accords de libre-échange que l’Union européenne met en place et qui ne sont pas sans impact sur le secteur agricole.
À cet égard, les agriculteurs se sont encore mobilisés ce matin même, inquiets du traité avec le Mercosur qui ouvrirait la porte à des distorsions de concurrence. Le RDSE a déjà alerté le Gouvernement sur cet accord par un texte devenu le 27 avril 2018 une résolution européenne du Sénat.
Nous renouvelons le vœu d’une vigilance particulière sur ce dossier afin que les filières, en particulier celles du sucre et de l’élevage bovin, ne soient pas fragilisées plus qu’elles ne le sont déjà.
S’agissant de la politique de cohésion, si les négociations budgétaires de la précédente programmation ont retardé la mise en œuvre des projets, on sait très bien que la sous-consommation des crédits est due à une gestion interne aux États membres, pas toujours très efficace. C’est le cas dans notre pays.
Notre collègue Colette Mélot soulève très justement, dans son rapport sur le sujet, les difficultés liées au pilotage des fonds européens en France. Il est urgent de revoir le fonctionnement de l’autorité de gestion de ces fonds pour, d’une part, multiplier les projets dont nos territoires ont besoin, et, d’autre part, ne pas voir l’Union européenne restreindre la politique de cohésion au prétexte de la sous-consommation de ses crédits.
Le Conseil européen a également échangé sur le suivi des priorités de l’Union européenne énoncées dans le programme stratégique 2019-2024. Je ne reviendrai pas sur l’ensemble des orientations générales, mais j’émettrai quelques souhaits portés par mon groupe.
S’agissant du volet économique, le programme stratégique évoque la nécessité d’avoir une approche plus intégrée, en matière industrielle notamment, ainsi qu’un environnement avec des règles du jeu plus équitables. Aussi faudrait-il s’y atteler plus rapidement et plus concrètement.
Je prendrai un exemple dans le domaine de l’intelligence artificielle, dont nous avons débattu récemment au Sénat et qui est un élément de la stratégie pour le marché unique numérique. C’est un domaine dans lequel nous devons absolument fabriquer un champion européen afin de ne pas laisser les États-Unis et la Chine gagner définitivement la bataille de l’intelligence artificielle, compte tenu de ses enjeux non seulement économiques mais aussi stratégiques, et j’ajouterai éthiques.
Cependant, pour y parvenir, il faudrait assouplir quelques-unes des règles du marché unique. Je pense à certains blocages de la politique européenne de la concurrence, qui interdit la constitution de leaders européens pour éviter un monopole au sein de l’Union. C’est un principe louable pour le marché intérieur, mais qui s’avère être un frein pour affronter la concurrence mondiale dans des secteurs technologiques essentiels. Il me semble que la Commission doit approfondir cette question, les projets importants d’intérêt européen commun, les PIIEC, mentionnés à l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne n’étant peut-être pas suffisants dans le contexte d’une guerre commerciale aujourd’hui difficile.
Enfin, je souhaitais évoquer brièvement la question de l’élargissement. La position de mon groupe a été rappelée la semaine dernière à l’occasion du débat sur l’accession de la Macédoine à l’OTAN.
Nous partageons, madame la secrétaire d’État, la position du Chef de l’État. L’élargissement ne peut pas être poursuivi sans une amélioration de la capacité d’agir en commun. En outre, nous avons besoin d’une Europe qui œuvre à une convergence sur le plan économique, fiscal et social, objectif qu’un élargissement sans bornes risquerait de compromettre.
En somme, tirons les leçons de notre passé récent pour faire de l’Union européenne une véritable zone de prospérité.
Applaudissements sur les travées des groupes LaREM et UC.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, on vilipende souvent la qualité médiocre et le peu de succès à l’international des productions audiovisuelles européennes. C’est en effet vrai sur la décennie écoulée, mais les choses sont en train de changer assez rapidement.
Une série espagnole, coproduite et diffusée par un géant américain du streaming, connaît actuellement un énorme succès dans toute l’Europe et bien au-delà. La troisième saison de La Casa de Papel – c’est le nom de la série en question – vient de s’achever et, déjà, plusieurs dizaines de millions d’Européens abonnés à Netflix attendent avec impatience la sortie de la quatrième et dernière saison, prévue pour le début de l’année prochaine.
Initialement programmée pour la fin de cette année, sa diffusion a subi – c’est étrange ! – un report d’au moins quelques semaines. De quoi alimenter encore un peu plus l’incertitude quant à l’issue de cette saga mettant en scène des braqueurs issus de toute l’Europe, qui ont l’audace d’investir l’hôtel de la Monnaie espagnol, de prendre de nombreux otages, de faire durer l’opération non seulement pour s’emparer des liquidités disponibles dans la banque mais aussi pour imprimer près d’1 milliard d’euros supplémentaire en billets. À la fin de la troisième saison, le suspense est à son comble : ces Robin des Bois anti-système qui étaient parvenus à se rendre populaires auprès de l’opinion font pour la première fois couler le sang. Chacun doute qu’ils parviennent, malgré leur génie maléfique, à sortir indemnes de l’affaire…
Rien à voir, bien sûr, avec cette autre grande série – britannique cette fois et au succès d’audience paneuropéen – intitulée Brexit qui a, elle, déjà bien entamé sa quatrième saison et qui reste toujours aussi palpitante tant les rebondissements se multiplient et parviennent à nous faire encore douter de l’issue finale.
Sourires.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, on vilipende souvent la qualité médiocre et le peu de succès à l’international des productions audiovisuelles européennes. C’est en effet vrai sur la décennie écoulée, mais les choses sont en train de changer assez rapidement.
Une série espagnole, coproduite et diffusée par un géant américain du streaming, connaît actuellement un énorme succès dans toute l’Europe et bien au-delà. La troisième saison de La Casa de Papel – c’est le nom de la série en question – vient de s’achever et, déjà, plusieurs dizaines de millions d’Européens abonnés à Netflix attendent avec impatience la sortie de la quatrième et dernière saison, prévue pour le début de l’année prochaine.
Initialement programmée pour la fin de cette année, sa diffusion a subi – c’est étrange ! – un report d’au moins quelques semaines. De quoi alimenter encore un peu plus l’incertitude quant à l’issue de cette saga mettant en scène des braqueurs issus de toute l’Europe, qui ont l’audace d’investir l’hôtel de la Monnaie espagnol, de prendre de nombreux otages, de faire durer l’opération non seulement pour s’emparer des liquidités disponibles dans la banque mais aussi pour imprimer près d’1 milliard d’euros supplémentaire en billets. À la fin de la troisième saison, le suspense est à son comble : ces Robin des Bois anti-système qui étaient parvenus à se rendre populaires auprès de l’opinion font pour la première fois couler le sang. Chacun doute qu’ils parviennent, malgré leur génie maléfique, à sortir indemnes de l’affaire…
Rien à voir, bien sûr, avec cette autre grande série – britannique cette fois et au succès d’audience paneuropéen – intitulée Brexit qui a, elle, déjà bien entamé sa quatrième saison et qui reste toujours aussi palpitante tant les rebondissements se multiplient et parviennent à nous faire encore douter de l’issue finale.

Madame la secrétaire d’État, vous n’êtes sans doute pas très informée de ce que contiendra la prochaine saison de La Casa de Papel. Mais, compte tenu de votre position, peut-être en savez-vous plus sur l’issue de la série Brexit ? Que va-t-il se passer d’ici au 31 octobre ? Y aura-t-il une suite ? S’oriente-t-on vers une cinquième saison ? Retrouverons-nous les mêmes acteurs que lors de la saison précédente ?
Sourires.
Nouveaux sourires.

Madame la secrétaire d’État, vous n’êtes sans doute pas très informée de ce que contiendra la prochaine saison de La Casa de Papel. Mais, compte tenu de votre position, peut-être en savez-vous plus sur l’issue de la série Brexit ? Que va-t-il se passer d’ici au 31 octobre ? Y aura-t-il une suite ? S’oriente-t-on vers une cinquième saison ? Retrouverons-nous les mêmes acteurs que lors de la saison précédente ?

Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je vous prie bienévidemment d’excuser mon ton un peu farceur, malicieux etprimesautier. Mais comme certains de mes collègues, notamment ceux qui siègent à la commission des affaires européennes, j’ensuis à plus d’une douzaine d’interventions – quand on aime, on ne compte plus ! – dans l’hémicyclesur ce sujet depuis 2015… Mon imagination en matière de série à répétition n’est malheureusement pas aussidéveloppée que celle de nos chers collègues britanniques !
Pourtant, je me soigne et j’essaie de comprendre ce qui se passe dans ce royaume britannique que j’aime tant.
Pour ce faire, j’ai la chance d’échanger fréquemment avec Denis MacShane, ancien ministre des affaires européennes de Tony Blair, europhile convaincu et « inventeur » du terme « Brexit » en 2012, qui vient de faire paraître en fin de semaine passée un nouveau livre dont le titre, Brexeternity – un Brexit sans fin – résume à lui seul son sentiment : le Royaume-Uni, et accessoirement l’Union européenne, est loin d’en avoir fini avec le Brexit. MacShane considère qu’au-delà d’une mise en œuvre officielle du Brexit à court terme, son pays en aura encore au moins pour dix à quinze ans de débats passionnés sur le sujet. On appelle aussi cela un cancer de longue durée…
Comme lui, je note cependant une évolution récente assez intéressante, presque rassurante, avec l’accord trouvé entre l’Union européenne et le Premier ministre Boris Johnson la semaine passée. Dans les discours de ce dernier, qui accompagnent ses tentatives de faire approuver l’accord par son parlement, on note un début de reconnaissance, sinon à l’endroit de l’Union européenne, tout au moins à celui de l’idée européenne. C’est un premier pas, certes timide, mais cela sonne un peu comme la fin de certains discours surréels et haineux à l’endroit de l’Europe qui ont été développés ces cinq dernières années par les « Brexiters », dont Boris Johnson était un des fiers hérauts.
Car il est bien difficile aujourd’hui d’imaginer comment le Royaume-Uni pourrait s’inventer un destin national en dehors de l’Europe. Les « réalités alternatives », chères à Donald Trump et propagées à la sauce anglaise, ont à présent sérieusement du plomb dans l’aile.
Première hypothèse, au début du Brexit : la création d’une association européenne alternative à l’Union européenne, sur le modèle de l’Association européenne de libre-échange, l’AELE, des années soixante.
Le problème, c’est que le référendum sur le Brexit n’a pas du tout entraîné un effet domino sur les autres États européens, y compris ceux gouvernés par des forces eurosceptiques.
Deuxième hypothèse, évoquée par le président Cambon : le « modèle Singapour », porté par plusieurs dirigeants conservateurs, ferait du Royaume-Uni un paradis de la déréglementation fiscale et sociale par l’adoption rapide de lois fiscales très attractives pour les investisseurs étrangers.
Ce scénario est jugé totalement irréaliste, même par le Premier ministre de Singapour. Ce qui est possible pour un petit État qui n’a pas trop de charges, compte 66 millions d’habitants et affiche une dette sociale, tout en étant capable d’investir dans la défense, ne peut être appliqué dans un pays qui a déjà beaucoup dérégulé.
Le troisième scénario est le « Commonwealth revisité ».
On peut en rire ! Le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont d’ores et déjà signé des traités de libre-échange avec l’Union européenne. Seule l’Inde pouvait encore complaire à la mère patrie… Mais, lors des dernières rencontres entre Mme May et le Premier ministre Narendra Modi, celui-ci a dit à son interlocutrice : ouvrez d’abord vos frontières à nos 1, 2 ou 1, 3 milliard d’Indiens, et nous verrons ensuite…
Il ne reste plus que l’accord « phénoménal », selon le terme employé par Donald Trump, proposé par les États-Unis. Mais la réciprocité des flux commerciaux serait défavorable au Royaume-Uni, lequel, ne l’oublions pas, est le deuxième pays en Europe, après l’Allemagne, à avoir une balance commerciale positive avec les États-Unis. Le Trésor britannique estime qu’un tel accord ne ferait monter le PIB du Royaume-Uni que de 0, 2 %, et recommande ardemment de passer de nouveaux accords avec l’Union européenne.
À défaut d’un Brexit « post-réalité », la réalité post-Brexit est aujourd’hui amère et sera sans doute cruelle demain, tant pour le peuple britannique que pour le futur de ses nations.
« There is no alternative ! », scandait régulièrement Mme Thatcher, à partir de 1979, pour justifier sa politique. Aujourd’hui, le Royaume-Uni est nu face à un destin qu’il ne maîtrise plus et qu’il semble incapable de reformuler.
En tant qu’Européens, nous avons, et nous aurons toujours, la gentillesse de discuter avec eux, et de les accueillir en cas de retour dans l’Europe.
Nouveaux sourires.
Applaudissements sur les travées du groupe LaREM et sur des travées du groupe UC, ainsi qu ’ au banc des commissions.

Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je vous prie bienévidemment d’excuser mon ton un peu farceur, malicieux etprimesautier. Mais comme certains de mes collègues, notamment ceux qui siègent à la commission des affaires européennes, j’ensuis à plus d’une douzaine d’interventions – quand on aime, on ne compte plus ! – dans l’hémicyclesur ce sujet depuis 2015… Mon imagination en matière de série à répétition n’est malheureusement pas aussidéveloppée que celle de nos chers collègues britanniques !
Pourtant, je me soigne et j’essaie de comprendre ce qui se passe dans ce royaume britannique que j’aime tant.
Pour ce faire, j’ai la chance d’échanger fréquemment avec Denis MacShane, ancien ministre des affaires européennes de Tony Blair, europhile convaincu et « inventeur » du terme « Brexit » en 2012, qui vient de faire paraître en fin de semaine passée un nouveau livre dont le titre, Brexeternity – un Brexit sans fin – résume à lui seul son sentiment : le Royaume-Uni, et accessoirement l’Union européenne, est loin d’en avoir fini avec le Brexit. MacShane considère qu’au-delà d’une mise en œuvre officielle du Brexit à court terme, son pays en aura encore au moins pour dix à quinze ans de débats passionnés sur le sujet. On appelle aussi cela un cancer de longue durée…
Comme lui, je note cependant une évolution récente assez intéressante, presque rassurante, avec l’accord trouvé entre l’Union européenne et le Premier ministre Boris Johnson la semaine passée. Dans les discours de ce dernier, qui accompagnent ses tentatives de faire approuver l’accord par son parlement, on note un début de reconnaissance, sinon à l’endroit de l’Union européenne, tout au moins à celui de l’idée européenne. C’est un premier pas, certes timide, mais cela sonne un peu comme la fin de certains discours surréels et haineux à l’endroit de l’Europe qui ont été développés ces cinq dernières années par les « Brexiters », dont Boris Johnson était un des fiers hérauts.
Car il est bien difficile aujourd’hui d’imaginer comment le Royaume-Uni pourrait s’inventer un destin national en dehors de l’Europe. Les « réalités alternatives », chères à Donald Trump et propagées à la sauce anglaise, ont à présent sérieusement du plomb dans l’aile.
Première hypothèse, au début du Brexit : la création d’une association européenne alternative à l’Union européenne, sur le modèle de l’Association européenne de libre-échange, l’AELE, des années soixante.
Le problème, c’est que le référendum sur le Brexit n’a pas du tout entraîné un effet domino sur les autres États européens, y compris ceux gouvernés par des forces eurosceptiques.
Deuxième hypothèse, évoquée par le président Cambon : le « modèle Singapour », porté par plusieurs dirigeants conservateurs, ferait du Royaume-Uni un paradis de la déréglementation fiscale et sociale par l’adoption rapide de lois fiscales très attractives pour les investisseurs étrangers.
Ce scénario est jugé totalement irréaliste, même par le Premier ministre de Singapour. Ce qui est possible pour un petit État qui n’a pas trop de charges, compte 66 millions d’habitants et affiche une dette sociale, tout en étant capable d’investir dans la défense, ne peut être appliqué dans un pays qui a déjà beaucoup dérégulé.
Le troisième scénario est le « Commonwealth revisité ».
On peut en rire ! Le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont d’ores et déjà signé des traités de libre-échange avec l’Union européenne. Seule l’Inde pouvait encore complaire à la mère patrie… Mais, lors des dernières rencontres entre Mme May et le Premier ministre Narendra Modi, celui-ci a dit à son interlocutrice : ouvrez d’abord vos frontières à nos 1, 2 ou 1, 3 milliard d’Indiens, et nous verrons ensuite…
Il ne reste plus que l’accord « phénoménal », selon le terme employé par Donald Trump, proposé par les États-Unis. Mais la réciprocité des flux commerciaux serait défavorable au Royaume-Uni, lequel, ne l’oublions pas, est le deuxième pays en Europe, après l’Allemagne, à avoir une balance commerciale positive avec les États-Unis. Le Trésor britannique estime qu’un tel accord ne ferait monter le PIB du Royaume-Uni que de 0, 2 %, et recommande ardemment de passer de nouveaux accords avec l’Union européenne.
À défaut d’un Brexit « post-réalité », la réalité post-Brexit est aujourd’hui amère et sera sans doute cruelle demain, tant pour le peuple britannique que pour le futur de ses nations.
« There is no alternative ! », scandait régulièrement Mme Thatcher, à partir de 1979, pour justifier sa politique. Aujourd’hui, le Royaume-Uni est nu face à un destin qu’il ne maîtrise plus et qu’il semble incapable de reformuler.
En tant qu’Européens, nous avons, et nous aurons toujours, la gentillesse de discuter avec eux, et de les accueillir en cas de retour dans l’Europe.
Applaudissements sur les travées du groupe LaREM et sur des travées du groupe UC, ainsi qu ’ au banc des commissions.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, les eurocrates et les europhiles ont tendance à donner systématiquement des leçons de démocratie. À les écouter, on a l’impression qu’ils ont le monopole du respect de la démocratie et de la volonté populaire, et que ceux qui ne sont pas des eurocrates ou des europhiles bafouent tous les principes de la pseudo bonne démocratie européenne !
Pour moi, la véritable démocratie, la démocratie honnête, c’est d’abord de respecter la volonté du peuple, laquelle s’exprime dans les urnes. Et le meilleur moyen pour que cette volonté s’exprime est de demander au peuple de se prononcer dans les urnes par référendum.
Les eurocrates et les europhiles ont peur des référendums, car ils ont peur de la volonté du peuple, et veulent imposer leur propre vision en passant au-dessus de sa tête et de ce qu’il souhaite.
J’avais trouvé absolument scandaleuse l’attitude du président Sarkozy, …

M. Jean Bizet, président de la commission des affaires européennes. Ce n’est pas bien !

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, les eurocrates et les europhiles ont tendance à donner systématiquement des leçons de démocratie. À les écouter, on a l’impression qu’ils ont le monopole du respect de la démocratie et de la volonté populaire, et que ceux qui ne sont pas des eurocrates ou des europhiles bafouent tous les principes de la pseudo bonne démocratie européenne !
Pour moi, la véritable démocratie, la démocratie honnête, c’est d’abord de respecter la volonté du peuple, laquelle s’exprime dans les urnes. Et le meilleur moyen pour que cette volonté s’exprime est de demander au peuple de se prononcer dans les urnes par référendum.
Les eurocrates et les europhiles ont peur des référendums, car ils ont peur de la volonté du peuple, et veulent imposer leur propre vision en passant au-dessus de sa tête et de ce qu’il souhaite.
J’avais trouvé absolument scandaleuse l’attitude du président Sarkozy, …
Sourires.

M. Jean Bizet, président de la commission des affaires européennes. Ce n’est pas bien !
Sourires.

Et encore, je suis gentil avec lui ! Il a en effet bafoué le résultat du référendum par lequel le peuple français s’était prononcé de manière très claire.
Sarkozy a changé trois virgules en disant : je propose finalement le traité de Lisbonne, mais on ne va pas refaire un référendum ; on va plutôt passer au-dessus de la tête du peuple et faire voter le Parlement.

Et encore, je suis gentil avec lui ! Il a en effet bafoué le résultat du référendum par lequel le peuple français s’était prononcé de manière très claire.
Sarkozy a changé trois virgules en disant : je propose finalement le traité de Lisbonne, mais on ne va pas refaire un référendum ; on va plutôt passer au-dessus de la tête du peuple et faire voter le Parlement.

C’est une honte pour la démocratie ! Ce qui se passe actuellement en Grande-Bretagne, c’est exactement la même chose : le peuple anglais, le peuple de Grande-Bretagne, s’est exprimé en faveur du Brexit…

C’est une honte pour la démocratie ! Ce qui se passe actuellement en Grande-Bretagne, c’est exactement la même chose : le peuple anglais, le peuple de Grande-Bretagne, s’est exprimé en faveur du Brexit…

Il y a ici des gens qui sont pour ou contre le Brexit, mais vous pourriez au moins me respecter !
Les Anglais s’étaient donc prononcés.

Il y a ici des gens qui sont pour ou contre le Brexit, mais vous pourriez au moins me respecter !
Les Anglais s’étaient donc prononcés.

Or, tant au niveau de l’Union européenne que parmi ceux qui ont été battus à l’issue du référendum, on a essayé de bafouer ce que le peuple anglais avait exprimé !
Les députés anglais qui avaient été désavoués – personne en effet ne s’attendait à un tel résultat ! – ont essayé de contourner le système en bloquant la mise en œuvre dudit résultat. Et au sein de l’Union européenne, on a fait tout ce que l’on a pu pour apporter de l’eau au moulin du blocage de la concrétisation du Brexit.

Or, tant au niveau de l’Union européenne que parmi ceux qui ont été battus à l’issue du référendum, on a essayé de bafouer ce que le peuple anglais avait exprimé !
Les députés anglais qui avaient été désavoués – personne en effet ne s’attendait à un tel résultat ! – ont essayé de contourner le système en bloquant la mise en œuvre dudit résultat. Et au sein de l’Union européenne, on a fait tout ce que l’on a pu pour apporter de l’eau au moulin du blocage de la concrétisation du Brexit.

Je l’ai déjà dit à cette tribune, mais malheureusement j’ai très peu de temps de parole…

Je l’ai déjà dit à cette tribune, mais malheureusement j’ai très peu de temps de parole…

Que retenir du Conseil européen des 17 et 18 octobre ? En vérité, on ne sait plus par quelle impasse commencer tant la construction européenne s’enfonce un peu plus chaque jour dans la crise !
Première impasse, ce n’est pas très original, le Brexit.
On nous annonçait la sortie du tunnel des négociations à l’issue du Conseil, mais Boris Johnson a été une nouvelle fois battu aux Communes samedi. L’homme méprise tellement son Parlement qu’il tente depuis un nouveau passage en force, non sans avoir adressé au Conseil européen, dimanche, plusieurs lettres au nom du Royaume-Uni, disant une chose – la décision du Parlement – et son contraire – sa propre position.
Au-delà du feuilleton dont il devient hasardeux de prédire la date de fin, il convient surtout de retenir la détermination de Boris Johnson à obtenir une sortie qui lui laisse le plus de marge possible pour jouer demain la concurrence et le dumping social. Les travaillistes et les syndicalistes britanniques demandent d’ailleurs que le paquet législatif qui accompagnera le Brexit leur soit communiqué.
L’accord scellé in fine entre Boris Johnson et Michel Barnier a fait passer la question des droits sociaux de l’accord à la déclaration politique qui l’accompagne : un glissement qui offre toutes les marges au Premier ministre du Royaume-Uni pour s’en dégager le moment venu. C’est donc, à coup sûr, vers une sortie par le bas pour les droits sociaux que l’on se dirige.
Vous parlez d’un bon accord, madame la secrétaire d’État. Je pense, au contraire, que la crise du Brexit n’en a pas fini de rebondir, et que son coût politique sera très cher pour tous les Européens.
Mais l’impasse européenne n’est pas seulement britannique. Le ver est dans le fruit de l’Union. Ainsi, l’accord n’a pu être trouvé non plus entre les Vingt-Sept sur le cadre financier pluriannuel. Le maintien du montant de la PAC et le sens de sa réorientation donnent lieu à discussion, tout comme les fonds structurels, qui restent les principaux éléments de cohésion et de solidarité. La France, qui souhaite le maintien de ces politiques, plaide en même temps pour la montée en charge des dépenses militaires et de sécurité, sans obtenir d’accord sur l’augmentation du budget européen.
Au fond, le désaccord budgétaire ne fait que mettre en lumière l’absence croissante d’accord sur les objectifs communs de l’Union, et c’est ce qui fait problème.
Pendant ce temps, mais on en parle très peu, Christine Lagarde est confirmée nouvelle présidente de la Banque centrale européenne, la BCE, sans que soit remise à plat une seule seconde la mission de cette dernière. Pourtant, quoi de plus urgent dans cette situation d’impasse sociale, économique et politique que de réorienter les immenses richesses et le pouvoir de crédit de la BCE en ces temps de taux zéro vers la relance sociale et la transition écologique ? Or on préfère continuer comme avant !
Impasse, encore, quand il s’agit de la Syrie. L’Europe, c’est vrai, condamne l’offensive turque, et vous l’avez dit, madame la secrétaire d’État. Mais après ? Le Conseil européen a-t-il ouvert la voie à une offensive diplomatique commune d’ampleur pour mettre les Kurdes sous protection internationale ? Rien de cela ! A-t-il ouvert un débat sérieux sur l’horizon d’un nouveau système de sécurité collective émancipé de l’OTAN ? Non !
L’Europe, qui nourrit en son sein le processus d’élargissement de l’OTAN, est tétanisée par les décisions américaine et turque en Syrie. Et de quoi se félicite la France ? D’une réunion, qui se tiendrait prochainement à Londres, entre les trois Européens – Allemagne, Royaume-Uni, France – et le président turc… Un sommet entre Emmanuel Macron, Boris Johnson, Angela Merkel et Erdogan, cela fait rêver dans une perspective de paix ! Mais pour quoi faire ? Où est la vision commune, le projet qui nous guide ?
Décidément, de quelque côté que l’on se tourne, l’Europe est dans la crise et dans l’impasse.
Voilà dix ans, lorsque nous critiquions sévèrement les orientations qui nous ont menés jusque-là et que nous proposions des États généraux de la refondation européenne pour reconstruire de la solidarité, de l’harmonisation sociale vers le haut, de la transition vers un nouveau modèle, on nous traitait d’anti-européens. Mais aujourd’hui, qui sont les fossoyeurs de l’Union sinon les sourds d’alors ?
Repenser l’Europe est plus que jamais urgent, mais pas pour resservir les plats réchauffés d’hier. Les priorités et les urgences sont ailleurs.
Madame la secrétaire d’État, à quand un Conseil européen sur le dossier d’Alstom-General Electric, qui nous dit l’urgence d’une nouvelle politique industrielle et de son financement ?
À quand un Conseil européen sur l’accident ferroviaire des Ardennes, qui nous dit l’urgence d’une grande politique ferroviaire de service public en Europe, et non de sa déréglementation continue ?
À quand un Conseil européen qui traitera de la colère du monde agricole contre le CETA ?
À quand un Conseil européen qui parlera de la colère de nos communes, laquelle nous dit l’urgence d’une réorientation des fonds structurels vers le financement des services publics et des solidarités territoriales ?
À quand, tout simplement, des Conseils européens qui porteront sur les priorités des Européens, loin des débats actuels sur le colmatage des brèches d’une marchandisation capitaliste à bout de souffle ?
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.

Que retenir du Conseil européen des 17 et 18 octobre ? En vérité, on ne sait plus par quelle impasse commencer tant la construction européenne s’enfonce un peu plus chaque jour dans la crise !
Première impasse, ce n’est pas très original, le Brexit.
On nous annonçait la sortie du tunnel des négociations à l’issue du Conseil, mais Boris Johnson a été une nouvelle fois battu aux Communes samedi. L’homme méprise tellement son Parlement qu’il tente depuis un nouveau passage en force, non sans avoir adressé au Conseil européen, dimanche, plusieurs lettres au nom du Royaume-Uni, disant une chose – la décision du Parlement – et son contraire – sa propre position.
Au-delà du feuilleton dont il devient hasardeux de prédire la date de fin, il convient surtout de retenir la détermination de Boris Johnson à obtenir une sortie qui lui laisse le plus de marge possible pour jouer demain la concurrence et le dumping social. Les travaillistes et les syndicalistes britanniques demandent d’ailleurs que le paquet législatif qui accompagnera le Brexit leur soit communiqué.
L’accord scellé in fine entre Boris Johnson et Michel Barnier a fait passer la question des droits sociaux de l’accord à la déclaration politique qui l’accompagne : un glissement qui offre toutes les marges au Premier ministre du Royaume-Uni pour s’en dégager le moment venu. C’est donc, à coup sûr, vers une sortie par le bas pour les droits sociaux que l’on se dirige.
Vous parlez d’un bon accord, madame la secrétaire d’État. Je pense, au contraire, que la crise du Brexit n’en a pas fini de rebondir, et que son coût politique sera très cher pour tous les Européens.
Mais l’impasse européenne n’est pas seulement britannique. Le ver est dans le fruit de l’Union. Ainsi, l’accord n’a pu être trouvé non plus entre les Vingt-Sept sur le cadre financier pluriannuel. Le maintien du montant de la PAC et le sens de sa réorientation donnent lieu à discussion, tout comme les fonds structurels, qui restent les principaux éléments de cohésion et de solidarité. La France, qui souhaite le maintien de ces politiques, plaide en même temps pour la montée en charge des dépenses militaires et de sécurité, sans obtenir d’accord sur l’augmentation du budget européen.
Au fond, le désaccord budgétaire ne fait que mettre en lumière l’absence croissante d’accord sur les objectifs communs de l’Union, et c’est ce qui fait problème.
Pendant ce temps, mais on en parle très peu, Christine Lagarde est confirmée nouvelle présidente de la Banque centrale européenne, la BCE, sans que soit remise à plat une seule seconde la mission de cette dernière. Pourtant, quoi de plus urgent dans cette situation d’impasse sociale, économique et politique que de réorienter les immenses richesses et le pouvoir de crédit de la BCE en ces temps de taux zéro vers la relance sociale et la transition écologique ? Or on préfère continuer comme avant !
Impasse, encore, quand il s’agit de la Syrie. L’Europe, c’est vrai, condamne l’offensive turque, et vous l’avez dit, madame la secrétaire d’État. Mais après ? Le Conseil européen a-t-il ouvert la voie à une offensive diplomatique commune d’ampleur pour mettre les Kurdes sous protection internationale ? Rien de cela ! A-t-il ouvert un débat sérieux sur l’horizon d’un nouveau système de sécurité collective émancipé de l’OTAN ? Non !
L’Europe, qui nourrit en son sein le processus d’élargissement de l’OTAN, est tétanisée par les décisions américaine et turque en Syrie. Et de quoi se félicite la France ? D’une réunion, qui se tiendrait prochainement à Londres, entre les trois Européens – Allemagne, Royaume-Uni, France – et le président turc… Un sommet entre Emmanuel Macron, Boris Johnson, Angela Merkel et Erdogan, cela fait rêver dans une perspective de paix ! Mais pour quoi faire ? Où est la vision commune, le projet qui nous guide ?
Décidément, de quelque côté que l’on se tourne, l’Europe est dans la crise et dans l’impasse.
Voilà dix ans, lorsque nous critiquions sévèrement les orientations qui nous ont menés jusque-là et que nous proposions des États généraux de la refondation européenne pour reconstruire de la solidarité, de l’harmonisation sociale vers le haut, de la transition vers un nouveau modèle, on nous traitait d’anti-européens. Mais aujourd’hui, qui sont les fossoyeurs de l’Union sinon les sourds d’alors ?
Repenser l’Europe est plus que jamais urgent, mais pas pour resservir les plats réchauffés d’hier. Les priorités et les urgences sont ailleurs.
Madame la secrétaire d’État, à quand un Conseil européen sur le dossier d’Alstom-General Electric, qui nous dit l’urgence d’une nouvelle politique industrielle et de son financement ?
À quand un Conseil européen sur l’accident ferroviaire des Ardennes, qui nous dit l’urgence d’une grande politique ferroviaire de service public en Europe, et non de sa déréglementation continue ?
À quand un Conseil européen qui traitera de la colère du monde agricole contre le CETA ?
À quand un Conseil européen qui parlera de la colère de nos communes, laquelle nous dit l’urgence d’une réorientation des fonds structurels vers le financement des services publics et des solidarités territoriales ?
À quand, tout simplement, des Conseils européens qui porteront sur les priorités des Européens, loin des débats actuels sur le colmatage des brèches d’une marchandisation capitaliste à bout de souffle ?
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, messieurs les présidents de commissions, mes chers collègues, en trois ans et demi, le Brexit a donné lieu à d’innombrables rebondissements. Après des jours et des nuits d’intenses négociations, les Britanniques et les Européens ont présenté un accord de retrait. Il a été qualifié de raisonnable, équilibré et respectueux des engagements européens, ce que nous continuons à croire.
La pression s’est alors reportée sur le Parlement britannique et les yeux se sont rivés sur le Palais de Westminster, qui n’avait pas siégé un samedi depuis la guerre des Malouines en 1982.
Les interrogations quant au vote du texte par le Royaume-Uni restaient entières. Et nous n’avons pas été déçus ! L’adoption de l’amendement Letwin décale le vote sur l’accord négocié deux jours avant par Boris Johnson et les Vingt-Sept…
L’Europe est une nouvelle fois plongée dans l’incertitude. Pas moins de trois lettres ont été envoyées ce week-end au président du Conseil européen pour demander un report de la date de sortie au 31 janvier 2020. Les Vingt-Sept vont devoir faire un choix à l’unanimité.
Le président Macron ainsi que le Gouvernement ont déjà fait savoir qu’un délai ne serait dans l’intérêt d’aucune partie. Nous nous associons pleinement à ces propos, à moins qu’un tel délai ne soit dûment motivé et réellement nécessaire. Nous avons donc besoin de signaux clairs de la part du Royaume-Uni, et cela semble survenir.
Les Européens méritent mieux que cette cacophonie qui n’a que trop duré. Le véritable enjeu demeure les relations futures avec le Royaume-Uni ; c’est pourquoi il faut privilégier un retrait négocié. Le Conseil européen de la semaine dernière a d’ailleurs apporté la preuve de la nécessité d’une Europe rassemblée et résolument tournée vers l’avenir. De nombreux sujets cruciaux sont à traiter, et demandent toute notre attention et notre engagement.
Permettez-moi d’évoquer en premier lieu le cadre financier pluriannuel qui nous engagera jusqu’en 2027. Nous attendons dans les prochaines semaines un cadre de négociations et des chiffres clairs de la part de la présidence finlandaise.
Nous avons noté les divergences entre les États membres et souhaitons que les futures négociations soient guidées par un souci d’avenir. L’Union européenne doit être ambitieuse ; cela passera par un budget tout aussi ambitieux et empreint de conditionnalité.
Comme l’a mis en évidence notre collègue Colette Mélot dans son excellent rapport sur les fonds européens, les États membres, et en particulier la France, devront améliorer leur système de mise en œuvre et de déploiement des fonds européens.
Je pense qu’il est temps aussi d’envisager le développement des ressources propres pour renforcer le budget.
Ce budget devra concilier le maintien de nos politiques historiques et vitales – l’indispensable PAC et la politique de cohésion –, tout en mobilisant les ressources nécessaires aux nouvelles orientations stratégiques : je veux parler de l’environnement, du numérique et, bien sûr, des enjeux de sécurité et de défense.
Madame la secrétaire d’État, comment comptez-vous soutenir efficacement la politique agricole commune et la politique de cohésion lors des négociations du cadre financier pluriannuel, qui s’annoncent tendues ?
Ce Conseil a également consacré la nomination de Mme Lagarde comme présidente de la Banque centrale européenne, ce qui est un honneur pour la France. Nous avons une confiance totale en elle pour mener à bien la lourde tâche qui lui a été confiée.
Cependant, concernant la nomination de notre commissaire européen, formons le souhait que la France propose rapidement une personnalité incontestée et expérimentée qui saura porter haut la voix de la France. Où en sommes-nous sur ce point, madame la secrétaire d’État ? Pouvez-vous nous préciser le calendrier de cette future nomination ?
Je souhaite aussi aborder le sujet essentiel de l’avenir et de la stratégie choisie. Pour assurer notre avenir, l’Union européenne doit être forte et s’imposer sur le plan international.
Enfin, l’Union européenne doit contribuer à la stabilisation du monde. Son ambition doit être plus grande, ses politiques et ses mécanismes mieux adaptés pour répondre de manière ordonnée et concrète. La crise turque est le parfait exemple que condamner les actions ne suffit pas : il faut agir, ensemble.
Toutefois, l’Europe ne pourra montrer la voie que si elle se réinvente. Le manque de consensus sur la question de l’élargissement le prouve. Il est important que l’Europe se renforce avant de s’élargir, notamment en matière institutionnelle.
Bien sûr, le processus d’adhésion doit être réformé, pour mieux répondre aux réalités actuelles de l’Union européenne, mais nous devons bien évidemment également tenir compte des efforts entrepris par l’Albanie et la Macédoine du Nord, afin de leur apporter une réponse concrète en mai prochain.
En conclusion, le mandat de la nouvelle Commission et du nouveau Parlement sera déterminant pour l’avenir de l’Europe. Nous devons tous en être conscients, car il est avant tout question de redonner à l’Union européenne sa place prépondérante sur la scène internationale.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Indépendants, LaREM, RDSE, UC et Les Républicains.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, messieurs les présidents de commissions, mes chers collègues, en trois ans et demi, le Brexit a donné lieu à d’innombrables rebondissements. Après des jours et des nuits d’intenses négociations, les Britanniques et les Européens ont présenté un accord de retrait. Il a été qualifié de raisonnable, équilibré et respectueux des engagements européens, ce que nous continuons à croire.
La pression s’est alors reportée sur le Parlement britannique et les yeux se sont rivés sur le Palais de Westminster, qui n’avait pas siégé un samedi depuis la guerre des Malouines en 1982.
Les interrogations quant au vote du texte par le Royaume-Uni restaient entières. Et nous n’avons pas été déçus ! L’adoption de l’amendement Letwin décale le vote sur l’accord négocié deux jours avant par Boris Johnson et les Vingt-Sept…
L’Europe est une nouvelle fois plongée dans l’incertitude. Pas moins de trois lettres ont été envoyées ce week-end au président du Conseil européen pour demander un report de la date de sortie au 31 janvier 2020. Les Vingt-Sept vont devoir faire un choix à l’unanimité.
Le président Macron ainsi que le Gouvernement ont déjà fait savoir qu’un délai ne serait dans l’intérêt d’aucune partie. Nous nous associons pleinement à ces propos, à moins qu’un tel délai ne soit dûment motivé et réellement nécessaire. Nous avons donc besoin de signaux clairs de la part du Royaume-Uni, et cela semble survenir.
Les Européens méritent mieux que cette cacophonie qui n’a que trop duré. Le véritable enjeu demeure les relations futures avec le Royaume-Uni ; c’est pourquoi il faut privilégier un retrait négocié. Le Conseil européen de la semaine dernière a d’ailleurs apporté la preuve de la nécessité d’une Europe rassemblée et résolument tournée vers l’avenir. De nombreux sujets cruciaux sont à traiter, et demandent toute notre attention et notre engagement.
Permettez-moi d’évoquer en premier lieu le cadre financier pluriannuel qui nous engagera jusqu’en 2027. Nous attendons dans les prochaines semaines un cadre de négociations et des chiffres clairs de la part de la présidence finlandaise.
Nous avons noté les divergences entre les États membres et souhaitons que les futures négociations soient guidées par un souci d’avenir. L’Union européenne doit être ambitieuse ; cela passera par un budget tout aussi ambitieux et empreint de conditionnalité.
Comme l’a mis en évidence notre collègue Colette Mélot dans son excellent rapport sur les fonds européens, les États membres, et en particulier la France, devront améliorer leur système de mise en œuvre et de déploiement des fonds européens.
Je pense qu’il est temps aussi d’envisager le développement des ressources propres pour renforcer le budget.
Ce budget devra concilier le maintien de nos politiques historiques et vitales – l’indispensable PAC et la politique de cohésion –, tout en mobilisant les ressources nécessaires aux nouvelles orientations stratégiques : je veux parler de l’environnement, du numérique et, bien sûr, des enjeux de sécurité et de défense.
Madame la secrétaire d’État, comment comptez-vous soutenir efficacement la politique agricole commune et la politique de cohésion lors des négociations du cadre financier pluriannuel, qui s’annoncent tendues ?
Ce Conseil a également consacré la nomination de Mme Lagarde comme présidente de la Banque centrale européenne, ce qui est un honneur pour la France. Nous avons une confiance totale en elle pour mener à bien la lourde tâche qui lui a été confiée.
Cependant, concernant la nomination de notre commissaire européen, formons le souhait que la France propose rapidement une personnalité incontestée et expérimentée qui saura porter haut la voix de la France. Où en sommes-nous sur ce point, madame la secrétaire d’État ? Pouvez-vous nous préciser le calendrier de cette future nomination ?
Je souhaite aussi aborder le sujet essentiel de l’avenir et de la stratégie choisie. Pour assurer notre avenir, l’Union européenne doit être forte et s’imposer sur le plan international.
Enfin, l’Union européenne doit contribuer à la stabilisation du monde. Son ambition doit être plus grande, ses politiques et ses mécanismes mieux adaptés pour répondre de manière ordonnée et concrète. La crise turque est le parfait exemple que condamner les actions ne suffit pas : il faut agir, ensemble.
Toutefois, l’Europe ne pourra montrer la voie que si elle se réinvente. Le manque de consensus sur la question de l’élargissement le prouve. Il est important que l’Europe se renforce avant de s’élargir, notamment en matière institutionnelle.
Bien sûr, le processus d’adhésion doit être réformé, pour mieux répondre aux réalités actuelles de l’Union européenne, mais nous devons bien évidemment également tenir compte des efforts entrepris par l’Albanie et la Macédoine du Nord, afin de leur apporter une réponse concrète en mai prochain.
En conclusion, le mandat de la nouvelle Commission et du nouveau Parlement sera déterminant pour l’avenir de l’Europe. Nous devons tous en être conscients, car il est avant tout question de redonner à l’Union européenne sa place prépondérante sur la scène internationale.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Indépendants, LaREM, RDSE, UC et Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, messieurs les présidents de commission, mes chers collègues, depuis des mois, nous suivons la situation au Levant, en particulier l’engagement de nos forces contre l’État islamique. Si la France, avec d’autres, participe à la coalition contre Daech, il faut admettre qu’en réalité les Européens pèsent peu dans le contexte régional.
Il y a d’abord eu les Russes, qui ont su imposer leur présence au milieu du chaos sur le terrain et du vide diplomatique.
Aujourd’hui, le retrait américain et l’offensive turque illustrent encore le peu de prise de l’Europe sur le cours des événements. Depuis les guerres d’Afghanistan puis d’Irak, au coût financier et humain exorbitant, les États-Unis ne veulent plus se trouver enferrés dans de tels conflits, dans des régions qui, selon eux, seraient « par nature » instables. Quand le président Trump dit que « le job est fait », il s’en tient à Daech écrasé sous les bombes. Mais quid du sort des populations civiles ou des djihadistes prisonniers, notamment européens, qui pourraient revenir dans leurs pays d’origine ?
La Turquie, jadis bon élève de l’OTAN et un temps au seuil de l’Union européenne, joue désormais seule sa partition d’acteur régional et renvoie les Européens à leurs propres turpitudes, celles de notre incapacité collective à avoir su prévenir puis gérer la crise migratoire, conduisant à la conclusion d’un accord à haut risque. Ce pis-aller, trouvé en urgence, nous paralyse désormais, puisque les autorités turques agitent le spectre d’un flot migratoire régulièrement, à chaque mouvement d’humeur de l’Union européenne à leur endroit.
Par ailleurs, les tensions avec la Turquie ont aussi des développements en Méditerranée orientale, puisque Chypre se retrouve à nouveau aux prises avec les autorités turques dans un différend en matière d’espaces maritimes, exacerbé par la présence de gisements d’hydrocarbures dans ladite zone. Depuis quelques semaines, l’intrusion d’un navire de forage turc dans la zone économique exclusive chypriote contestée par la Turquie fait craindre une escalade régionale. La même situation était déjà survenue cet été, aboutissant à des réactions fermes de l’Union européenne, mais sans effet. Le Conseil, qui considère ces activités de forage comme « illégales », s’est entendu dernièrement sur la mise en place de mesures restrictives. La France, qui a des intérêts énergétiques dans la zone, a, semble-t-il, dépêché des moyens navals sur place. Quelle est la situation à ce stade ?
J’en viens aux relations entre l’Union européenne et la Russie, que j’espère, dans notre intérêt partagé, voir prendre une tournure plus apaisée, car l’un des dangers pour l’Union européenne est la convergence sino-russe. La Russie bascule sur son versant asiatique en soignant sa relation avec la Chine, même si la sinisation en cours de l’orient russe inquiète Moscou. Au Forum sur les nouvelles routes de la soie, puis au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, Russie et Chine ont montré leur entente. C’est aussi le cas au sein de l’Organisation de coopération de Shanghai, sur laquelle les deux pays ont pris le leadership. En septembre 2019, un exercice militaire russo-chinois à grande échelle s’est déroulé en Russie. De même, cet été, des patrouilles d’avions militaires chinois et russes ont été menées au large de la Corée du Sud et du Japon. Aujourd’hui, la base chinoise de Djibouti intéresse à l’évidence les Russes, comme, d’ailleurs, les bases russes de Méditerranée orientale suscitent l’intérêt des Chinois.
Le message adressé aux Américains comme aux Européens est clair. Cette convergence de deux États aux ambitions globales, jusqu’en Arctique et en Méditerranée, doit, me semble-t-il, inviter les Européens à une plus grande coopération pour desserrer l’étau qui se met en place.
Pour ce qui concerne la Chine, mes chers collègues, vous connaissez les enjeux, mais aussi les opportunités, pour l’Union européenne, des routes de la soie. Il faudra cependant que nous demeurions attentifs à la stratégie chinoise consistant à diviser l’Europe par le biais des relations bilatérales avec ses États membres.
Je note avec intérêt la récente signature d’un partenariat pour une connectivité durable et des infrastructures de qualité entre l’Union européenne et le Japon.
Un autre danger pour le vieux continent est la convergence turco-russe qui, au-delà de la seule Union européenne, inquiète également l’OTAN, en particulier depuis l’achat par Ankara de systèmes antiaériens S400 russes.
Enfin, madame la secrétaire d’État, je veux revenir sur les vides juridiques que vous avez évoqués et mis en cause. Je suis personnellement convaincu que les technocrates qualifient de « vides juridiques » les espaces de liberté laissés par le législateur. En démocratie, la liberté est le principe, quand l’interdiction ou la réglementation sont l’exception.
Je veux vous dire aussi que j’approuve votre position concernant les demandes d’élargissement de l’Union européenne.
Pour terminer, si nous ne prenons pas toute la mesure des événements qui se déroulent sous nos yeux, nous finirons, à n’en pas douter, comme de simples clients ou sous-traitants des Chinois ou des Américains, sous la pression permanente des Russes.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et LaREM.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, messieurs les présidents de commission, mes chers collègues, depuis des mois, nous suivons la situation au Levant, en particulier l’engagement de nos forces contre l’État islamique. Si la France, avec d’autres, participe à la coalition contre Daech, il faut admettre qu’en réalité les Européens pèsent peu dans le contexte régional.
Il y a d’abord eu les Russes, qui ont su imposer leur présence au milieu du chaos sur le terrain et du vide diplomatique.
Aujourd’hui, le retrait américain et l’offensive turque illustrent encore le peu de prise de l’Europe sur le cours des événements. Depuis les guerres d’Afghanistan puis d’Irak, au coût financier et humain exorbitant, les États-Unis ne veulent plus se trouver enferrés dans de tels conflits, dans des régions qui, selon eux, seraient « par nature » instables. Quand le président Trump dit que « le job est fait », il s’en tient à Daech écrasé sous les bombes. Mais quid du sort des populations civiles ou des djihadistes prisonniers, notamment européens, qui pourraient revenir dans leurs pays d’origine ?
La Turquie, jadis bon élève de l’OTAN et un temps au seuil de l’Union européenne, joue désormais seule sa partition d’acteur régional et renvoie les Européens à leurs propres turpitudes, celles de notre incapacité collective à avoir su prévenir puis gérer la crise migratoire, conduisant à la conclusion d’un accord à haut risque. Ce pis-aller, trouvé en urgence, nous paralyse désormais, puisque les autorités turques agitent le spectre d’un flot migratoire régulièrement, à chaque mouvement d’humeur de l’Union européenne à leur endroit.
Par ailleurs, les tensions avec la Turquie ont aussi des développements en Méditerranée orientale, puisque Chypre se retrouve à nouveau aux prises avec les autorités turques dans un différend en matière d’espaces maritimes, exacerbé par la présence de gisements d’hydrocarbures dans ladite zone. Depuis quelques semaines, l’intrusion d’un navire de forage turc dans la zone économique exclusive chypriote contestée par la Turquie fait craindre une escalade régionale. La même situation était déjà survenue cet été, aboutissant à des réactions fermes de l’Union européenne, mais sans effet. Le Conseil, qui considère ces activités de forage comme « illégales », s’est entendu dernièrement sur la mise en place de mesures restrictives. La France, qui a des intérêts énergétiques dans la zone, a, semble-t-il, dépêché des moyens navals sur place. Quelle est la situation à ce stade ?
J’en viens aux relations entre l’Union européenne et la Russie, que j’espère, dans notre intérêt partagé, voir prendre une tournure plus apaisée, car l’un des dangers pour l’Union européenne est la convergence sino-russe. La Russie bascule sur son versant asiatique en soignant sa relation avec la Chine, même si la sinisation en cours de l’orient russe inquiète Moscou. Au Forum sur les nouvelles routes de la soie, puis au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, Russie et Chine ont montré leur entente. C’est aussi le cas au sein de l’Organisation de coopération de Shanghai, sur laquelle les deux pays ont pris le leadership. En septembre 2019, un exercice militaire russo-chinois à grande échelle s’est déroulé en Russie. De même, cet été, des patrouilles d’avions militaires chinois et russes ont été menées au large de la Corée du Sud et du Japon. Aujourd’hui, la base chinoise de Djibouti intéresse à l’évidence les Russes, comme, d’ailleurs, les bases russes de Méditerranée orientale suscitent l’intérêt des Chinois.
Le message adressé aux Américains comme aux Européens est clair. Cette convergence de deux États aux ambitions globales, jusqu’en Arctique et en Méditerranée, doit, me semble-t-il, inviter les Européens à une plus grande coopération pour desserrer l’étau qui se met en place.
Pour ce qui concerne la Chine, mes chers collègues, vous connaissez les enjeux, mais aussi les opportunités, pour l’Union européenne, des routes de la soie. Il faudra cependant que nous demeurions attentifs à la stratégie chinoise consistant à diviser l’Europe par le biais des relations bilatérales avec ses États membres.
Je note avec intérêt la récente signature d’un partenariat pour une connectivité durable et des infrastructures de qualité entre l’Union européenne et le Japon.
Un autre danger pour le vieux continent est la convergence turco-russe qui, au-delà de la seule Union européenne, inquiète également l’OTAN, en particulier depuis l’achat par Ankara de systèmes antiaériens S400 russes.
Enfin, madame la secrétaire d’État, je veux revenir sur les vides juridiques que vous avez évoqués et mis en cause. Je suis personnellement convaincu que les technocrates qualifient de « vides juridiques » les espaces de liberté laissés par le législateur. En démocratie, la liberté est le principe, quand l’interdiction ou la réglementation sont l’exception.
Je veux vous dire aussi que j’approuve votre position concernant les demandes d’élargissement de l’Union européenne.
Pour terminer, si nous ne prenons pas toute la mesure des événements qui se déroulent sous nos yeux, nous finirons, à n’en pas douter, comme de simples clients ou sous-traitants des Chinois ou des Américains, sous la pression permanente des Russes.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et LaREM.
Applaudissements sur les travées du groupe SOCR.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, messieurs les présidents de commission, mes chers collègues, le Brexit a, une nouvelle fois, largement attiré l’attention des médias et occupé une part significative des discussions du dernier Conseil européen. Nombre de mes collègues viennent de s’exprimer à ce sujet.
On peut, à ce jour, se féliciter de la solidarité des Vingt-Sept. L’Union européenne a, il faut le dire, assumé ses responsabilités. Dans l’attente d’un éventuel dénouement, nous découvrons, chaque heure, une nouvelle subtilité de la créativité de la démocratie parlementaire britannique.
Plus sérieusement, nous souhaitons, madame la secrétaire d’État, que l’on sorte de cette situation d’incertitude, qui nuit à nos relations bilatérales, à nos entreprises et aux ressortissants de nos pays respectifs. Nous devons éviter un nouveau report et nous souhaitons que le Conseil et la Commission restent fermes sur la ligne adoptée jusqu’ici. À cet égard, nous soutenons votre position sur le sujet.
Applaudissements sur les travées du groupe SOCR.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, messieurs les présidents de commission, mes chers collègues, le Brexit a, une nouvelle fois, largement attiré l’attention des médias et occupé une part significative des discussions du dernier Conseil européen. Nombre de mes collègues viennent de s’exprimer à ce sujet.
On peut, à ce jour, se féliciter de la solidarité des Vingt-Sept. L’Union européenne a, il faut le dire, assumé ses responsabilités. Dans l’attente d’un éventuel dénouement, nous découvrons, chaque heure, une nouvelle subtilité de la créativité de la démocratie parlementaire britannique.
Plus sérieusement, nous souhaitons, madame la secrétaire d’État, que l’on sorte de cette situation d’incertitude, qui nuit à nos relations bilatérales, à nos entreprises et aux ressortissants de nos pays respectifs. Nous devons éviter un nouveau report et nous souhaitons que le Conseil et la Commission restent fermes sur la ligne adoptée jusqu’ici. À cet égard, nous soutenons votre position sur le sujet.

Cette belle unanimité sur le Brexit ne peut, pour autant, être l’arbre qui cache la forêt.
En effet, madame la secrétaire d’État, la réunion du Conseil européen dont nous sommes invités à commenter les résultats me laisse inquiet, frappé par l’état de faiblesse de nos institutions européennes, alors que débutera, au 1er novembre prochain, une nouvelle mandature, qui devrait ouvrir un nouveau cycle européen.
Alors que le besoin de relance d’une Europe forte est de plus en plus prégnant, les dirigeants européens ont semblé paralysés par un manque de cohésion intérieure et la menace des défis extérieurs : mise en place laborieuse de la Commission, absence de politique étrangère, défaut d’entente sur les frontières de l’Europe, blocage du budget à long terme de l’Union européenne… Autant de dossiers que le Conseil européen, attentiste, n’a pas réussi à régler. Ses conclusions sont d’ailleurs anémiques, toute décision étant reportée, au mieux, au prochain Conseil, qui se réunira au mois de décembre.
Permettez-moi de m’arrêter sur quelques-uns de ces sujets. Ma première inquiétude concerne la capacité d’impulsion de la Commission européenne.
La présidente élue prendra ses fonctions dans quelques jours sans avoir bouclé sa Commission. Imposée par défaut par les dirigeants européens et mal élue par les députés, elle apparaît plus en situation de devoir plaire au Parlement et de complaire au Conseil que de tracer les lignes de force des politiques de l’Union européenne. Mme von der Leyen reconnaît elle-même être à la tête d’une Commission plus géopolitique que politique, composée de commissaires désignés pour répondre avant tout à des considérations nationales. La France, prise à son propre jeu, est d’ailleurs tombée dans ce piège.
La nouvelle configuration du Parlement européen ne devrait pas l’aider. Avec un Parlement sans majorité, celle-ci devant être bâtie au fil des textes, la Commission européenne risque d’abaisser par anticipation le degré d’ambition de ses propositions.
Le fragile équilibre du collège de la Commission, son organisation extrêmement pyramidale, la difficulté à discerner parfois les fonctions des uns et des autres risquent de concourir à la neutralisation des initiatives indispensables à la relance européenne. Le signal envoyé par le Conseil européen à son intention pourrait également réduire sa marge de manœuvre.
La France porte une part de responsabilité dans cette situation. L’Union européenne ne peut être le terrain de manœuvres incessantes et l’interventionnisme continuel du Président de la République ne peut que se retourner contre notre pays. L’exécutif doit respecter les rôles dévolus à chaque institution européenne. La Commission ne peut être le secrétariat du Conseil, encore moins celui des intérêts particuliers des États. L’indépendance du Parlement européen doit être respectée, le renforcement de son rôle doit être défendu, notamment à travers l’attribution d’un droit d’initiative propre. Nous avons tout intérêt à la défense de la démocratie parlementaire européenne, car c’est elle qui, dans l’équilibre des institutions, permet de faire primer les intérêts des citoyens européens sur les logiques nationales qui, actuellement, affaiblissent tant la Commission que le Conseil.
La France, au lieu de voir une crise institutionnelle là où le Parlement n’a fait qu’exercer ses prérogatives, serait mieux avisée de plaider efficacement pour un cadre financier ambitieux et un Green Deal européen à hauteur des défis de la transition écologique et de défendre le mieux-disant social européen.
Madame la secrétaire d’État, l’Europe est dans l’urgence. Alors que le populisme prospère, elle a besoin d’institutions fortes et d’un projet clair. En quoi la France y a-t-elle contribué ? Que comptent faire le Gouvernement et le Président de la République pour sortir de l’ornière dans laquelle l’Union européenne se trouve ?
Ma deuxième inquiétude concerne l’incapacité du Conseil européen, au-delà d’une condamnation de principe, à définir une position claire et ferme à l’égard de l’invasion par la Turquie du nord-est de la Syrie pour en chasser les Kurdes, abandonnés honteusement par la coalition internationale.

Cette belle unanimité sur le Brexit ne peut, pour autant, être l’arbre qui cache la forêt.
En effet, madame la secrétaire d’État, la réunion du Conseil européen dont nous sommes invités à commenter les résultats me laisse inquiet, frappé par l’état de faiblesse de nos institutions européennes, alors que débutera, au 1er novembre prochain, une nouvelle mandature, qui devrait ouvrir un nouveau cycle européen.
Alors que le besoin de relance d’une Europe forte est de plus en plus prégnant, les dirigeants européens ont semblé paralysés par un manque de cohésion intérieure et la menace des défis extérieurs : mise en place laborieuse de la Commission, absence de politique étrangère, défaut d’entente sur les frontières de l’Europe, blocage du budget à long terme de l’Union européenne… Autant de dossiers que le Conseil européen, attentiste, n’a pas réussi à régler. Ses conclusions sont d’ailleurs anémiques, toute décision étant reportée, au mieux, au prochain Conseil, qui se réunira au mois de décembre.
Permettez-moi de m’arrêter sur quelques-uns de ces sujets. Ma première inquiétude concerne la capacité d’impulsion de la Commission européenne.
La présidente élue prendra ses fonctions dans quelques jours sans avoir bouclé sa Commission. Imposée par défaut par les dirigeants européens et mal élue par les députés, elle apparaît plus en situation de devoir plaire au Parlement et de complaire au Conseil que de tracer les lignes de force des politiques de l’Union européenne. Mme von der Leyen reconnaît elle-même être à la tête d’une Commission plus géopolitique que politique, composée de commissaires désignés pour répondre avant tout à des considérations nationales. La France, prise à son propre jeu, est d’ailleurs tombée dans ce piège.
La nouvelle configuration du Parlement européen ne devrait pas l’aider. Avec un Parlement sans majorité, celle-ci devant être bâtie au fil des textes, la Commission européenne risque d’abaisser par anticipation le degré d’ambition de ses propositions.
Le fragile équilibre du collège de la Commission, son organisation extrêmement pyramidale, la difficulté à discerner parfois les fonctions des uns et des autres risquent de concourir à la neutralisation des initiatives indispensables à la relance européenne. Le signal envoyé par le Conseil européen à son intention pourrait également réduire sa marge de manœuvre.
La France porte une part de responsabilité dans cette situation. L’Union européenne ne peut être le terrain de manœuvres incessantes et l’interventionnisme continuel du Président de la République ne peut que se retourner contre notre pays. L’exécutif doit respecter les rôles dévolus à chaque institution européenne. La Commission ne peut être le secrétariat du Conseil, encore moins celui des intérêts particuliers des États. L’indépendance du Parlement européen doit être respectée, le renforcement de son rôle doit être défendu, notamment à travers l’attribution d’un droit d’initiative propre. Nous avons tout intérêt à la défense de la démocratie parlementaire européenne, car c’est elle qui, dans l’équilibre des institutions, permet de faire primer les intérêts des citoyens européens sur les logiques nationales qui, actuellement, affaiblissent tant la Commission que le Conseil.
La France, au lieu de voir une crise institutionnelle là où le Parlement n’a fait qu’exercer ses prérogatives, serait mieux avisée de plaider efficacement pour un cadre financier ambitieux et un Green Deal européen à hauteur des défis de la transition écologique et de défendre le mieux-disant social européen.
Madame la secrétaire d’État, l’Europe est dans l’urgence. Alors que le populisme prospère, elle a besoin d’institutions fortes et d’un projet clair. En quoi la France y a-t-elle contribué ? Que comptent faire le Gouvernement et le Président de la République pour sortir de l’ornière dans laquelle l’Union européenne se trouve ?
Ma deuxième inquiétude concerne l’incapacité du Conseil européen, au-delà d’une condamnation de principe, à définir une position claire et ferme à l’égard de l’invasion par la Turquie du nord-est de la Syrie pour en chasser les Kurdes, abandonnés honteusement par la coalition internationale.

Là où les Kurdes attendaient un soutien concret, le Conseil a acté son incapacité à peser sur la Turquie autrement que par l’adoption de « positions nationales concernant leur politique d’exportation d’armements » et par la mise en place – tenez-vous bien, mes chers collègues ! – d’un groupe de travail. Que dire d’un Haut Représentant qui affirme ne pas avoir de « pouvoirs magiques » ? Le Président de la République ne cesse de parler d’« autonomie stratégique européenne », mais en quoi celle-ci consiste-t-elle réellement ?
Madame la secrétaire d’État, quelles initiatives concrètes la France compte-t-elle prendre pour contribuer à un sursaut de l’Union européenne à l’égard de la Turquie et, plus largement, à une recherche de cohésion en matière de politique étrangère ?
Ma troisième inquiétude concerne l’attentisme du Conseil face aux défis que nous devons relever et l’incapacité de l’Union à définir son projet pour les années à venir.
Concernant la question migratoire, si l’accord obtenu il y a quelques semaines entre quelques États membres sur un dispositif commun pour le débarquement des migrants secourus en mer est le bienvenu, il reste temporaire et repose sur une simple base volontaire. Face aux milliers de personnes qui tentent de franchir la Méditerranée et aux centaines de morts, nous avons déjà trop tergiversé. Il est plus que temps d’engager une réforme du règlement de Dublin, d’harmoniser les critères européens, de créer des centres de premier accueil sur tous les points d’arrivée, d’ouvrir d’autres voies légales d’immigration, plus sûres, plus respectueuses, y compris s’agissant des procédures de réinstallation.
Il est temps que les dirigeants européens traduisent concrètement leur indignation envers les pays d’où partent les embarcations par la solidarité envers les personnes qui les fuient.
L’Union européenne a de nombreux défis à relever. Elle ne pourra le faire sans un budget ambitieux. Or, là encore, les divergences nationales l’emportent, les États membres ayant une fois de plus bloqué les discussions.
Pour rappel, le Parlement européen a proposé, depuis novembre 2018, des dépenses globales à hauteur de 1, 3 % du revenu national brut de l’Union, contre 1, 11 %, taux recommandé par la Commission européenne. Un an après, qu’ont fait les États ? Rien. Pis, la Finlande propose désormais un taux entre 1, 03 % et 1, 08 %. Alors que la présidence finlandaise suggère également de réduire la taille des enveloppes destinées à la PAC, nous devons nous assurer que les nouvelles priorités stratégiques que sont la défense, les migrations et le climat soient développées et que les politiques traditionnelles soient confortées.
Par ailleurs, face à l’urgence environnementale, il est indispensable de mettre nos politiques européennes, comme la PAC, la politique de cohésion ou la recherche, au service de l’environnement et de la lutte contre le dérèglement climatique.
Si nous saluons la décision de nommer un vice-président exécutif qui sera chargé de mettre en place le Green Deal, tout reste néanmoins à bâtir concernant ce dernier : son volume, son champ, le choix du levier de financement, ses modalités.
Les premiers indices ne plaident pas, pour l’instant, en faveur d’un plan Climat qui permette de dégager 1 100 milliards d’euros par an, comme le prône la Cour des comptes européenne. Pour que les nouvelles priorités ne se fassent pas au détriment des politiques traditionnelles, ni la transition écologique au détriment de la justice sociale, de nouvelles ressources propres sont nécessaires.
Un retard du vote du budget 2021-2027 porterait préjudice à l’Europe. Un mauvais accord tout autant ! Dans ces conditions, et alors que M. Macron prétend ne pas être inquiet de l’absence de consensus, comment le Gouvernement entend-il peser pour que celui-ci soit trouvé dans les temps et qu’il soit à la hauteur des défis qui nous attendent ?
Pour conclure, madame la secrétaire d’État, nous ne pouvons plus demeurer dans l’expectative et rester bloqués par les logiques nationales. Il nous faut maintenant avancer pour consolider l’existant et bâtir des politiques nouvelles qui rétablissent la confiance dans l’Union européenne.
Les forces populistes, en réclamant des solutions nationales et un retour aux frontières, mènent l’Europe au bord de la fragmentation et du déclin. Pour les faire reculer, nous devons mettre un terme aux logiques technocratiques et budgétaires et redonner corps à l’idée européenne.
Quelles grandes orientations le Gouvernement entend-il porter pendant cette mandature pour donner à l’Europe les moyens de réussir ? L’Europe doit sortir de son inertie, dépasser ses blocages et s’élancer vers de nouveaux horizons. Pour cela, elle a besoin de la France. Nous attendons donc de l’exécutif des actes forts.
Applaudissements sur les travées du groupe SOCR.

Là où les Kurdes attendaient un soutien concret, le Conseil a acté son incapacité à peser sur la Turquie autrement que par l’adoption de « positions nationales concernant leur politique d’exportation d’armements » et par la mise en place – tenez-vous bien, mes chers collègues ! – d’un groupe de travail. Que dire d’un Haut Représentant qui affirme ne pas avoir de « pouvoirs magiques » ? Le Président de la République ne cesse de parler d’« autonomie stratégique européenne », mais en quoi celle-ci consiste-t-elle réellement ?
Madame la secrétaire d’État, quelles initiatives concrètes la France compte-t-elle prendre pour contribuer à un sursaut de l’Union européenne à l’égard de la Turquie et, plus largement, à une recherche de cohésion en matière de politique étrangère ?
Ma troisième inquiétude concerne l’attentisme du Conseil face aux défis que nous devons relever et l’incapacité de l’Union à définir son projet pour les années à venir.
Concernant la question migratoire, si l’accord obtenu il y a quelques semaines entre quelques États membres sur un dispositif commun pour le débarquement des migrants secourus en mer est le bienvenu, il reste temporaire et repose sur une simple base volontaire. Face aux milliers de personnes qui tentent de franchir la Méditerranée et aux centaines de morts, nous avons déjà trop tergiversé. Il est plus que temps d’engager une réforme du règlement de Dublin, d’harmoniser les critères européens, de créer des centres de premier accueil sur tous les points d’arrivée, d’ouvrir d’autres voies légales d’immigration, plus sûres, plus respectueuses, y compris s’agissant des procédures de réinstallation.
Il est temps que les dirigeants européens traduisent concrètement leur indignation envers les pays d’où partent les embarcations par la solidarité envers les personnes qui les fuient.
L’Union européenne a de nombreux défis à relever. Elle ne pourra le faire sans un budget ambitieux. Or, là encore, les divergences nationales l’emportent, les États membres ayant une fois de plus bloqué les discussions.
Pour rappel, le Parlement européen a proposé, depuis novembre 2018, des dépenses globales à hauteur de 1, 3 % du revenu national brut de l’Union, contre 1, 11 %, taux recommandé par la Commission européenne. Un an après, qu’ont fait les États ? Rien. Pis, la Finlande propose désormais un taux entre 1, 03 % et 1, 08 %. Alors que la présidence finlandaise suggère également de réduire la taille des enveloppes destinées à la PAC, nous devons nous assurer que les nouvelles priorités stratégiques que sont la défense, les migrations et le climat soient développées et que les politiques traditionnelles soient confortées.
Par ailleurs, face à l’urgence environnementale, il est indispensable de mettre nos politiques européennes, comme la PAC, la politique de cohésion ou la recherche, au service de l’environnement et de la lutte contre le dérèglement climatique.
Si nous saluons la décision de nommer un vice-président exécutif qui sera chargé de mettre en place le Green Deal, tout reste néanmoins à bâtir concernant ce dernier : son volume, son champ, le choix du levier de financement, ses modalités.
Les premiers indices ne plaident pas, pour l’instant, en faveur d’un plan Climat qui permette de dégager 1 100 milliards d’euros par an, comme le prône la Cour des comptes européenne. Pour que les nouvelles priorités ne se fassent pas au détriment des politiques traditionnelles, ni la transition écologique au détriment de la justice sociale, de nouvelles ressources propres sont nécessaires.
Un retard du vote du budget 2021-2027 porterait préjudice à l’Europe. Un mauvais accord tout autant ! Dans ces conditions, et alors que M. Macron prétend ne pas être inquiet de l’absence de consensus, comment le Gouvernement entend-il peser pour que celui-ci soit trouvé dans les temps et qu’il soit à la hauteur des défis qui nous attendent ?
Pour conclure, madame la secrétaire d’État, nous ne pouvons plus demeurer dans l’expectative et rester bloqués par les logiques nationales. Il nous faut maintenant avancer pour consolider l’existant et bâtir des politiques nouvelles qui rétablissent la confiance dans l’Union européenne.
Les forces populistes, en réclamant des solutions nationales et un retour aux frontières, mènent l’Europe au bord de la fragmentation et du déclin. Pour les faire reculer, nous devons mettre un terme aux logiques technocratiques et budgétaires et redonner corps à l’idée européenne.
Quelles grandes orientations le Gouvernement entend-il porter pendant cette mandature pour donner à l’Europe les moyens de réussir ? L’Europe doit sortir de son inertie, dépasser ses blocages et s’élancer vers de nouveaux horizons. Pour cela, elle a besoin de la France. Nous attendons donc de l’exécutif des actes forts.
Applaudissements sur les travées du groupe SOCR.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, messieurs les présidents de commission, mes chers collègues, au lendemain du Conseil européen « de la dernière chance » des 17 et 18 octobre derniers, j’aimerais revenir sur trois grands thèmes, à savoir le prochain cadre financier pluriannuel, notre futur à 27 ainsi que l’Europe qui protège.
Premièrement, madame la secrétaire d’État, le dernier Conseil européen a été l’occasion de revenir sur le cadre financier pluriannuel pour 2021-2027, soit le budget à long terme de l’Union européenne. Or celui-ci soulève plusieurs questions.
En effet, il doit résoudre une équation relativement complexe : prendre en compte l’amputation que provoque le Brexit, le Royaume-Uni étant l’un des principaux contributeurs au budget européen, tout en investissant sur de nouvelles politiques, parfois au détriment de politiques dites « historiques » – j’y reviendrai –, sans réformer structurellement le financement du budget.
Or, comme le Président de la République l’a lui-même déclaré lors de sa conférence de presse, le budget européen doit être ambitieux, disposer, à ce titre, de davantage de ressources propres et remettre en cause les rabais dont bénéficient plusieurs États membres, certains remontant aux années quatre-vingt.
Par la suite, si les pistes de travail présentées par la Commission européenne en mai 2018 dévoilent un budget en hausse, porté à 1 135 milliards d’euros contre 959 milliards pour le précédent, la politique agricole commune verrait, pour sa part, son budget réduit. Alors que l’agriculture devra relever à l’avenir de lourds défis, qu’il s’agisse du développement économique, de la ruralité, de la défense d’un modèle agricole plus respectueux de l’environnement ou encore de la défense de notre souveraineté alimentaire, pouvez-vous, madame la secrétaire d’État, nous donner des précisions sur les objectifs d’une telle diminution ?
Deuxièmement, ce Conseil européen était, selon moi, important en ce qu’il a été l’occasion d’évoquer, devant la future présidente de la Commission européenne et le prochain président du Conseil européen, qui y assistaient, aussi bien le départ de l’un de ses États membres que les perspectives d’élargissement pour l’Union.
Une question se pose : quel est notre futur à 27 ? Quelles sont nos ambitions communes dans ce contexte nouveau ? À cette question, j’aimerais vous entendre sur deux sujets.
Le premier porte sur les 27 politiques industrielles nationales, qui restent encore cloisonnées et qui condamnent les Européens à disposer d’un marché unique abouti, mais à ne jamais voir émerger de géants industriels européens dans la compétition internationale. J’évoque cette politique, car elle est symptomatique d’une incapacité collective à dépasser nos intérêts nationaux et à redonner du sens au collectif.
Le second sujet concerne l’inachèvement de l’Union économique et monétaire et sur les projets esquissés lors du Conseil européen. J’ai entendu le Président de la République évoquer la nécessité d’une assurance chômage au sein de la zone euro, mais cela ne me semble pas être la principale priorité quand l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité pour la zone euro semble encore bien éloigné d’un véritable budget de la zone euro et alors que l’union bancaire reste inachevée et incapable de garantir les dépôts et d’assurer in fine la stabilité du secteur bancaire en cas de crise économique.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, messieurs les présidents de commission, mes chers collègues, au lendemain du Conseil européen « de la dernière chance » des 17 et 18 octobre derniers, j’aimerais revenir sur trois grands thèmes, à savoir le prochain cadre financier pluriannuel, notre futur à 27 ainsi que l’Europe qui protège.
Premièrement, madame la secrétaire d’État, le dernier Conseil européen a été l’occasion de revenir sur le cadre financier pluriannuel pour 2021-2027, soit le budget à long terme de l’Union européenne. Or celui-ci soulève plusieurs questions.
En effet, il doit résoudre une équation relativement complexe : prendre en compte l’amputation que provoque le Brexit, le Royaume-Uni étant l’un des principaux contributeurs au budget européen, tout en investissant sur de nouvelles politiques, parfois au détriment de politiques dites « historiques » – j’y reviendrai –, sans réformer structurellement le financement du budget.
Or, comme le Président de la République l’a lui-même déclaré lors de sa conférence de presse, le budget européen doit être ambitieux, disposer, à ce titre, de davantage de ressources propres et remettre en cause les rabais dont bénéficient plusieurs États membres, certains remontant aux années quatre-vingt.
Par la suite, si les pistes de travail présentées par la Commission européenne en mai 2018 dévoilent un budget en hausse, porté à 1 135 milliards d’euros contre 959 milliards pour le précédent, la politique agricole commune verrait, pour sa part, son budget réduit. Alors que l’agriculture devra relever à l’avenir de lourds défis, qu’il s’agisse du développement économique, de la ruralité, de la défense d’un modèle agricole plus respectueux de l’environnement ou encore de la défense de notre souveraineté alimentaire, pouvez-vous, madame la secrétaire d’État, nous donner des précisions sur les objectifs d’une telle diminution ?
Deuxièmement, ce Conseil européen était, selon moi, important en ce qu’il a été l’occasion d’évoquer, devant la future présidente de la Commission européenne et le prochain président du Conseil européen, qui y assistaient, aussi bien le départ de l’un de ses États membres que les perspectives d’élargissement pour l’Union.
Une question se pose : quel est notre futur à 27 ? Quelles sont nos ambitions communes dans ce contexte nouveau ? À cette question, j’aimerais vous entendre sur deux sujets.
Le premier porte sur les 27 politiques industrielles nationales, qui restent encore cloisonnées et qui condamnent les Européens à disposer d’un marché unique abouti, mais à ne jamais voir émerger de géants industriels européens dans la compétition internationale. J’évoque cette politique, car elle est symptomatique d’une incapacité collective à dépasser nos intérêts nationaux et à redonner du sens au collectif.
Le second sujet concerne l’inachèvement de l’Union économique et monétaire et sur les projets esquissés lors du Conseil européen. J’ai entendu le Président de la République évoquer la nécessité d’une assurance chômage au sein de la zone euro, mais cela ne me semble pas être la principale priorité quand l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité pour la zone euro semble encore bien éloigné d’un véritable budget de la zone euro et alors que l’union bancaire reste inachevée et incapable de garantir les dépôts et d’assurer in fine la stabilité du secteur bancaire en cas de crise économique.

Sur ces deux sujets, madame la secrétaire d’État, avez-vous des précisions à nous apporter ?
Troisièmement, je veux revenir sur la question de l’Europe qui protège.
Le Brexit est le résultat d’un espoir nostalgique de retour à une souveraineté nationale fantasmée. Or nous savons bien que, unis, nous sommes l’un des géants de la compétition internationale et du nouveau monde multipolaire tel qu’esquissé au lendemain de la chute de l’Union soviétique, mais que, isolés, prisonniers d’un imaginaire westphalien anachronique, nous ne pèserons guère dans cette compétition.
Face aux défis que nous devrons relever, qu’il s’agisse du changement climatique, du défi migratoire ou encore des enjeux du numérique, la souveraineté ne pourra s’exercer qu’à l’échelon européen par une coopération accrue, sincère et ambitieuse.

Sur ces deux sujets, madame la secrétaire d’État, avez-vous des précisions à nous apporter ?
Troisièmement, je veux revenir sur la question de l’Europe qui protège.
Le Brexit est le résultat d’un espoir nostalgique de retour à une souveraineté nationale fantasmée. Or nous savons bien que, unis, nous sommes l’un des géants de la compétition internationale et du nouveau monde multipolaire tel qu’esquissé au lendemain de la chute de l’Union soviétique, mais que, isolés, prisonniers d’un imaginaire westphalien anachronique, nous ne pèserons guère dans cette compétition.
Face aux défis que nous devrons relever, qu’il s’agisse du changement climatique, du défi migratoire ou encore des enjeux du numérique, la souveraineté ne pourra s’exercer qu’à l’échelon européen par une coopération accrue, sincère et ambitieuse.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, messieurs les présidents de commission, mes chers collègues, le point urgent de l’ordre du jour du Conseil européen était l’approbation du nouvel accord de sortie du Royaume-Uni, ce nouvel accord qui, à l’heure actuelle, n’a toujours pas trouvé de majorité chez les députés britanniques.
Ceux-ci font preuve d’une grande créativité pour reculer sans cesse l’échéance du Brexit et pour ne pas respecter le verdict du référendum. Ils ne sont d’accord sur rien, sauf sur le fait de ne pas retourner devant les électeurs… pour ne pas se faire renvoyer. Et, quand les manœuvres politiques ne suffisent pas à ficeler le gouvernement, ils font appel aux juges.
Jusqu’à présent, le Royaume-Uni était cité dans toutes les écoles de sciences politiques comme le modèle de la démocratie parlementaire. Après ce triste feuilleton du Brexit, cela ne sera plus le cas…
Mais le mal est bien plus étendu. En effet, l’élite politico-économique occidentale tient de plus en plus souvent le peuple pour quantité négligeable. Cela a commencé en 2005, avec la France et les Pays-Bas, dont les référendums défavorables à la Constitution européenne ont été contournés par les gouvernements et les parlements. Les Pays-Bas ont recommencé en contournant le référendum défavorable à l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Ukraine.
Aux États-Unis, c’est pire. Élu par les « déplorables », comme les qualifiait la candidate démocrate, Donald Trump a vu son élection contestée avant même son installation. Et, depuis lors, les députés mènent une véritable guérilla, en mobilisant, là aussi, les juges, à tous les niveaux et à tout propos.
Avec le déclassement des classes moyennes et populaires, l’attitude désinvolte de l’élite politico-économique à l’égard du peuple nourrit les mouvements d’extrême gauche et d’extrême droite dans tout l’Occident.
Le Conseil européen a également renvoyé à plus tard l’ouverture des négociations d’adhésion avec l’Albanie et la Macédoine du Nord. Donald Tusk et Jean-Claude Juncker n’ont pas réussi à surmonter le veto de la France, des Pays-Bas et du Danemark.
Il faut dire que l’Albanie et la Macédoine du Nord ne sont pas les meilleurs élèves de la classe préparatoire à l’entrée dans l’Union européenne ! Ces deux pays ont encore beaucoup de réformes à faire avant d’être au niveau. Par ailleurs, l’Albanie se singularise par le nombre de ses ressortissants qui viennent demander l’asile politique en France, avec 7 133 demandes enregistrées dans notre pays en 2018.
On relèvera aussi que l’Albanie, déjà membre de l’OTAN, et la Macédoine du Nord, qui le sera d’ici peu, bénéficient de la part des États-Unis du programme d’aide appelé « ERIP » pour remplacer leur matériel militaire d’origine soviétique par du matériel américain. Pour ceux qui se posent la question de l’utilité de l’OTAN, voilà la réponse : alimenter les carnets de commandes du complexe militaro-industriel des États-Unis !
La France demande que l’Union européenne commence par la révision complète des procédures actuelles d’élargissement. Mais, au-delà, c’est le fonctionnement de l’Union européenne qu’il faut réformer avant de l’élargir.
À présent que les Britanniques, qui ont toujours veillé à ce qu’elle ne soit qu’un marché unique, en sortent, l’Union peut enfin s’approfondir, au lieu de s’élargir sans fin. C’est ce que Jacques Delors demandait déjà vainement en son temps.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et Les Indépendants.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, messieurs les présidents de commission, mes chers collègues, le point urgent de l’ordre du jour du Conseil européen était l’approbation du nouvel accord de sortie du Royaume-Uni, ce nouvel accord qui, à l’heure actuelle, n’a toujours pas trouvé de majorité chez les députés britanniques.
Ceux-ci font preuve d’une grande créativité pour reculer sans cesse l’échéance du Brexit et pour ne pas respecter le verdict du référendum. Ils ne sont d’accord sur rien, sauf sur le fait de ne pas retourner devant les électeurs… pour ne pas se faire renvoyer. Et, quand les manœuvres politiques ne suffisent pas à ficeler le gouvernement, ils font appel aux juges.
Jusqu’à présent, le Royaume-Uni était cité dans toutes les écoles de sciences politiques comme le modèle de la démocratie parlementaire. Après ce triste feuilleton du Brexit, cela ne sera plus le cas…
Mais le mal est bien plus étendu. En effet, l’élite politico-économique occidentale tient de plus en plus souvent le peuple pour quantité négligeable. Cela a commencé en 2005, avec la France et les Pays-Bas, dont les référendums défavorables à la Constitution européenne ont été contournés par les gouvernements et les parlements. Les Pays-Bas ont recommencé en contournant le référendum défavorable à l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Ukraine.
Aux États-Unis, c’est pire. Élu par les « déplorables », comme les qualifiait la candidate démocrate, Donald Trump a vu son élection contestée avant même son installation. Et, depuis lors, les députés mènent une véritable guérilla, en mobilisant, là aussi, les juges, à tous les niveaux et à tout propos.
Avec le déclassement des classes moyennes et populaires, l’attitude désinvolte de l’élite politico-économique à l’égard du peuple nourrit les mouvements d’extrême gauche et d’extrême droite dans tout l’Occident.
Le Conseil européen a également renvoyé à plus tard l’ouverture des négociations d’adhésion avec l’Albanie et la Macédoine du Nord. Donald Tusk et Jean-Claude Juncker n’ont pas réussi à surmonter le veto de la France, des Pays-Bas et du Danemark.
Il faut dire que l’Albanie et la Macédoine du Nord ne sont pas les meilleurs élèves de la classe préparatoire à l’entrée dans l’Union européenne ! Ces deux pays ont encore beaucoup de réformes à faire avant d’être au niveau. Par ailleurs, l’Albanie se singularise par le nombre de ses ressortissants qui viennent demander l’asile politique en France, avec 7 133 demandes enregistrées dans notre pays en 2018.
On relèvera aussi que l’Albanie, déjà membre de l’OTAN, et la Macédoine du Nord, qui le sera d’ici peu, bénéficient de la part des États-Unis du programme d’aide appelé « ERIP » pour remplacer leur matériel militaire d’origine soviétique par du matériel américain. Pour ceux qui se posent la question de l’utilité de l’OTAN, voilà la réponse : alimenter les carnets de commandes du complexe militaro-industriel des États-Unis !
La France demande que l’Union européenne commence par la révision complète des procédures actuelles d’élargissement. Mais, au-delà, c’est le fonctionnement de l’Union européenne qu’il faut réformer avant de l’élargir.
À présent que les Britanniques, qui ont toujours veillé à ce qu’elle ne soit qu’un marché unique, en sortent, l’Union peut enfin s’approfondir, au lieu de s’élargir sans fin. C’est ce que Jacques Delors demandait déjà vainement en son temps.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et Les Indépendants.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, messieurs les présidents de commission, mes chers collègues, de nombreux points de désaccord ont été relevés lors du Conseil européen qui nous réunit aujourd’hui. Je souhaite pour ma part m’exprimer plus particulièrement sur la politique agricole commune.
En effet, avec le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, tout doit être mis en œuvre pour que la baisse des ressources ne soit pas synonyme d’une diminution de la prochaine programmation.
Alors que l’agriculture française occupe la première place en Europe, la politique agricole est un enjeu majeur, sur lequel la France doit peser de tout son poids.
Les nouvelles priorités de l’Union européenne ne doivent pas se faire au détriment des politiques traditionnelles et le volet agricole ne peut être une variable d’ajustement.
La souveraineté alimentaire doit être une priorité et conduire l’Europe à proposer une politique ambitieuse permettant de relancer la compétitivité des exploitations et leur capacité à investir et à se transformer, données essentielles d’une durabilité économique.
Les nouvelles orientations ne doivent s’appliquer que si elles sont jugées nécessaires et en parfaite adéquation avec les ambitions des États membres.
La simplification de la PAC est considérée comme l’Arlésienne, car la bureaucratie a créé de véritables usines à gaz qui complexifient les processus, pour les agriculteurs comme pour les États membres auxquels la charge a été transférée.
Si nul ne remet en cause les normes de « verdissement » rendues nécessaires, entre autres, par la protection des ressources naturelles, il convient de sortir d’une approche trop défensive, souvent déconnectée des réalités du terrain.
L’agriculture européenne rend des services à la société et à l’environnement. Les agriculteurs méritent une rémunération au titre des biens publics qu’ils produisent. Je pense aux externalités positives, comme le stockage du CO2 dans les sols. Il faut encourager le renouvellement de l’approche européenne, avec de véritables paiements pour services environnementaux rendus par les agriculteurs, dans le cadre de l’un ou l’autre des deux piliers.
Les questions environnementales doivent être appréhendées avec pragmatisme et efficacité, en s’appuyant sur le développement de la recherche et de l’innovation.
Le lien entre l’agriculture et les territoires doit être encouragé. L’agropastoralisme, par exemple, est un mode d’élevage à la fois traditionnel et renouvelé, en phase avec une agriculture de son temps.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, messieurs les présidents de commission, mes chers collègues, de nombreux points de désaccord ont été relevés lors du Conseil européen qui nous réunit aujourd’hui. Je souhaite pour ma part m’exprimer plus particulièrement sur la politique agricole commune.
En effet, avec le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, tout doit être mis en œuvre pour que la baisse des ressources ne soit pas synonyme d’une diminution de la prochaine programmation.
Alors que l’agriculture française occupe la première place en Europe, la politique agricole est un enjeu majeur, sur lequel la France doit peser de tout son poids.
Les nouvelles priorités de l’Union européenne ne doivent pas se faire au détriment des politiques traditionnelles et le volet agricole ne peut être une variable d’ajustement.
La souveraineté alimentaire doit être une priorité et conduire l’Europe à proposer une politique ambitieuse permettant de relancer la compétitivité des exploitations et leur capacité à investir et à se transformer, données essentielles d’une durabilité économique.
Les nouvelles orientations ne doivent s’appliquer que si elles sont jugées nécessaires et en parfaite adéquation avec les ambitions des États membres.
La simplification de la PAC est considérée comme l’Arlésienne, car la bureaucratie a créé de véritables usines à gaz qui complexifient les processus, pour les agriculteurs comme pour les États membres auxquels la charge a été transférée.
Si nul ne remet en cause les normes de « verdissement » rendues nécessaires, entre autres, par la protection des ressources naturelles, il convient de sortir d’une approche trop défensive, souvent déconnectée des réalités du terrain.
L’agriculture européenne rend des services à la société et à l’environnement. Les agriculteurs méritent une rémunération au titre des biens publics qu’ils produisent. Je pense aux externalités positives, comme le stockage du CO2 dans les sols. Il faut encourager le renouvellement de l’approche européenne, avec de véritables paiements pour services environnementaux rendus par les agriculteurs, dans le cadre de l’un ou l’autre des deux piliers.
Les questions environnementales doivent être appréhendées avec pragmatisme et efficacité, en s’appuyant sur le développement de la recherche et de l’innovation.
Le lien entre l’agriculture et les territoires doit être encouragé. L’agropastoralisme, par exemple, est un mode d’élevage à la fois traditionnel et renouvelé, en phase avec une agriculture de son temps.

Cette activité permet de conserver un tissu rural vivant et d’atteindre nos objectifs environnementaux, climatiques et de protection de la biodiversité.
Aussi est-il essentiel que les surfaces pastorales obtiennent une meilleure reconnaissance. L’Union européenne doit aider à la promotion et au développement des produits sous signe de qualité et à créer de la valeur ajoutée grâce à la protection des produits agroalimentaires issus de l’élevage pastoral.
La mise en œuvre d’une politique montagne utilisant de façon ciblée une partie des outils mis à disposition pour l’indemnité compensatoire de handicaps naturels, l’ICHN, doit également être prise en compte pour soutenir le maintien de l’agriculture dans les zones défavorisées et à handicap.
Je me réjouis du lancement de l’observatoire européen du marché des fruits et légumes, secteur-clé de notre agriculture, alors que nous sommes en fin de campagne de récolte des pommes et des poires, notamment de l’excellente « pomme des Alpes » dans mon département des Hautes-Alpes. Ce secteur donne lieu à des distorsions de concurrence intraeuropéenne inacceptables qu’il convient de corriger.
Nous devons donc poursuivre notre mobilisation pour que les États membres valident le maintien du budget actuel de la PAC à vingt-sept, pour la période 2021-2027. Nos agriculteurs méritent qu’on se batte. Il y va également des intérêts de la France.
Bravo ! et applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.

Cette activité permet de conserver un tissu rural vivant et d’atteindre nos objectifs environnementaux, climatiques et de protection de la biodiversité.
Aussi est-il essentiel que les surfaces pastorales obtiennent une meilleure reconnaissance. L’Union européenne doit aider à la promotion et au développement des produits sous signe de qualité et à créer de la valeur ajoutée grâce à la protection des produits agroalimentaires issus de l’élevage pastoral.
La mise en œuvre d’une politique montagne utilisant de façon ciblée une partie des outils mis à disposition pour l’indemnité compensatoire de handicaps naturels, l’ICHN, doit également être prise en compte pour soutenir le maintien de l’agriculture dans les zones défavorisées et à handicap.
Je me réjouis du lancement de l’observatoire européen du marché des fruits et légumes, secteur-clé de notre agriculture, alors que nous sommes en fin de campagne de récolte des pommes et des poires, notamment de l’excellente « pomme des Alpes » dans mon département des Hautes-Alpes. Ce secteur donne lieu à des distorsions de concurrence intraeuropéenne inacceptables qu’il convient de corriger.
Nous devons donc poursuivre notre mobilisation pour que les États membres valident le maintien du budget actuel de la PAC à vingt-sept, pour la période 2021-2027. Nos agriculteurs méritent qu’on se batte. Il y va également des intérêts de la France.
Bravo ! et applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.
Mme Amélie de Montchalin, secrétaire d ’ État. Beaucoup d’entre vous m’ont interrogée sur l’éventualité d’une extension. Tout indique que nous devrons faire un point, en fin de semaine, sur la nécessité d’accepter une extension purement technique de quelques jours. Il s’agit de permettre au Parlement britannique d’achever une procédure qu’il souhaite mener, non pas à un train de sénateur
Sourires.
Mme Amélie de Montchalin, secrétaire d ’ État. Beaucoup d’entre vous m’ont interrogée sur l’éventualité d’une extension. Tout indique que nous devrons faire un point, en fin de semaine, sur la nécessité d’accepter une extension purement technique de quelques jours. Il s’agit de permettre au Parlement britannique d’achever une procédure qu’il souhaite mener, non pas à un train de sénateur
Sourires.
Nouveaux sourires.
Une extension qui ne servirait qu’à gagner du temps ou à rediscuter l’accord est totalement exclue. Il ne s’agit pas d’un changement de position. Nous avons déjà perdu trop de temps. Nous avons trouvé un accord équilibré qui respecte à la fois la souveraineté britannique et les lignes rouges européennes. Nous devons consacrer toute notre énergie à le mettre en œuvre sans délai.
Nous devons nous employer à faire cesser une incertitude qui crée beaucoup d’angoisses et qui pénalise économiquement des millions de familles, d’entreprises et d’emplois. C’est la raison pour laquelle la France ne veut pas d’une extension à l’infini. Nous voulons pouvoir nous appuyer sur des échéances claires et rapprochées et avancer étape après étape.
Monsieur le président Éblé, vous m’avez interrogée sur le fameux plan de contingence visant justement à répondre à l’incertitude, si elle venait à se manifester. Certains règlements ont déjà été modifiés, notamment le mécanisme d’interconnexion des infrastructures portuaires qui a permis de réaliser des investissements à Boulogne, à Calais et autour de l’entrée du tunnel sous la Manche, à Coquelles. Je pense également au fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, ou Feamp, en cas d’immobilisation de la flotte. La Commission a aussi proposé de nouveaux aménagements concernant l’activation du fonds de solidarité de l’Union européenne, le fameux FSUE, destiné à aider les pays confrontés à des chocs subis et non prévisibles et la mobilisation du fonds européen d’ajustement à la mondialisation, le FEM, qui permet notamment de se protéger contre des chocs commerciaux extérieurs ou d’y répondre.
Au départ, la Commission prévoyait des critères suffisamment restrictifs pour que ces mécanismes ne profitent qu’à très peu de monde, pour ne pas dire à personne. La France a plaidé, avec un certain succès, pour qu’ils puissent être réellement mis en œuvre. Il ne s’agit pas d’être dans le symbolique : si l’on crée des mécanismes, il faut s’assurer de l’existence de bénéficiaires.
Il est difficile de savoir aujourd’hui combien de millions ou de milliards d’euros tout cela pourrait représenter pour la France. Ce n’est pas une enveloppe par pays, mais en fonction des besoins. Je ne peux vous dire combien d’entreprises en bénéficieraient si nous activions ces mécanismes.
Je tiens à rappeler mes propos lors de mon audition : j’ai besoin de vous et de votre soutien si jamais les Britanniques venaient à ne pas payer leur contribution de 2020, soit 12 milliards d’euros – non pas parce qu’ils seraient forcés de rester, comme j’ai pu l’entendre ce soir, mais bien parce qu’il s’agit de sommes dues.
Il faudrait alors absolument rappeler à la Commission européenne que nous nous opposons au plan qu’elle a imaginé, à savoir 6 milliards d’euros coupés dans les dépenses prévues – ce qui aurait des conséquences immédiates sur nos collectivités locales – et un appel à contribution des États membres de 6 milliards, soit plus d’1 milliard d’euros pour la France. Vous êtes en train d’examiner le projet de loi de finances : je vous laisse imaginer ce que représenterait sur nos comptes publics une telle contribution exceptionnelle… Dans la mesure où, pour entamer des discussions sur une relation future, il faudrait que le Royaume-Uni ait payé ses contributions, cela reviendrait à faire des avances de trésorerie.
Si cette situation venait à se produire, il faudrait trouver une solution technique pour apporter 12 milliards d’euros de trésorerie à la Commission, puisque nous savons que cet argent sera récupéré. S’il ne l’était pas, il n’y aurait pas de relation future. Il faut mener un travail technique sur ce sujet, peut-être par la BEI, la Banque européenne d’investissement, au capital de laquelle le Royaume-Uni a des parts.
Il existe plusieurs manières de trouver des garanties et de se prémunir. Il s’agit d’un sujet hautement politique. Je ne me vois pas revenir devant vous ou ailleurs pour expliquer aux élus locaux ou aux contribuables que nous devons faire des efforts en raison d’un petit problème de trésorerie britannique…
Monsieur le sénateur Bonnecarrère, nous nous sommes effectivement mobilisés contre une relation future marquée par la concurrence déloyale. Nous considérons que la déclaration politique sur la relation future est une bonne déclaration en ce qu’elle encadre très fermement les conditions d’un accord de libre-échange.
Je tiens d’ailleurs à vous rassurer : vous aurez à ratifier cet accord de libre-échange. Les parlements nationaux vont rentrer de nouveau dans le jeu : si l’accord de divorce est bien un processus restreint à l’Union européenne au nom des Vingt-Sept, au Parlement européen et au Royaume-Uni, dès qu’il s’agira de l’accord de libre-échange, même négocié au nom de l’Union européenne, chacune des chambres nationales devra bien le ratifier.
Madame la sénatrice Guillotin, vous m’avez interrogée sur l’exécution des fonds européens. C’est bien beau de négocier des enveloppes, mais c’est encore mieux si elles se concrétisent ensuite. Comme vous le savez, j’ai l’intention de travailler très précisément, avec tous les parlementaires, tous les élus locaux, toutes les associations d’élus, à simplifier le recours aux fonds européens. Trop souvent, on dit que l’Europe est compliquée ; en fait, ce sont les procédures françaises de mise en œuvre des politiques européennes qui sont compliquées. Avec Jacqueline Gourault et les ministres référents – Didier Guillaume pour les politiques agricoles ou Muriel Pénicaud pour les politiques sociales – nous menons, avec un certain nombre de préfets, un travail de recension très pratique : quelles sont les démarches à suivre en France pour avoir accès au fonds social européen et quelles sont celles à suivre en Belgique, par exemple ? Inspirons-nous de ce qui est plus simple ailleurs pour faciliter la vie des porteurs de projets. Notre objectif est de faire en sorte que l’argent arrive dans les territoires.
En ce qui concerne l’élargissement, vous nous avez appelés à développer une prospérité réelle. Il s’agit aussi pour l’Europe de retrouver des modes de décision interne qui soient efficaces. Beaucoup de vos interventions, mesdames, messieurs les sénateurs, soulignaient que l’Europe était dans une impasse, à la croisée des chemins… D’autres encore ont dit que nous devions nous ressaisir.
C’est là tout le paradoxe : quand nous sommes au Conseil européen et qu’on nous parle d’élargissement, il est devenu tabou de dire que le sujet n’est pas de savoir si tel ou tel pays mérite ou démérite, mais d’avoir revu nos procédures internes de décision le jour où nous aurons à statuer sur leur adhésion effective. La règle de l’unanimité donne parfois un pouvoir démesuré à des coalitions de pays qui se mettent dans une posture de blocage et non de proposition. Je pense également à la représentation d’un commissaire. Peut-on vraiment travailler avec un gouvernement dont les trente membres sont sur un pied d’égalité totale. Comment organiser la collégialité, comment prendre des décisions et, surtout, comment retrouver de la rapidité ?
Ce qui rend beaucoup d’Européens sceptiques sur la valeur du projet européen, c’est la lenteur des processus entre le moment où l’on se fixe des objectifs et le moment où l’on arrive à les mettre en œuvre. Il faut des réformes. C’est la raison pour laquelle le Président de la République, la Chancelière Merkel et d’autres chefs d’État et de gouvernement soutiennent cette fameuse conférence sur l’Europe. Nous devons mettre certaines choses sur la table pour retrouver de l’agilité, de la rapidité et de la capacité à décider. Mme Merkel disait, au moment de choisir ceux qui allaient occuper les « top jobs », que le sujet ne portait pas tant sur les hommes que sur la capacité à prendre des décisions qu’on leur donne. Il nous reste à mener une réflexion sur le sujet.
Monsieur le sénateur Gattolin, je suis très déçue de ne pas disposer du temps suffisant pour regarder toutes les séries Netflix que vous avez décrites. §Je suis, parfois avec amusement, mais toujours avec beaucoup d’intérêt, celle qui s’appelle le Brexit. On finit par se demander si on est dans la fiction ou dans la réalité. Ce qui est certain, c’est que nous ne pouvons malheureusement pas en sourire, tant il y a d’incertitudes. Quand vous rencontrez les pêcheurs de Boulogne-sur-Mer, vous comprenez vite qu’il ne s’agit pas d’un feuilleton humoristique ni parodique.
Vous avez raison de souligner que ce processus sera de longue durée. Nous aurons en effet à « retricoter » toutes nos relations culturelles, universitaires, sociales et économiques. J’ai grandi à Calais. Le tunnel sous la Manche a été construit quand j’y habitais. Il mesure 50 kilomètres de long ; il ne fera pas davantage demain. Nous verrons toujours les falaises de Douvres depuis Calais. Au nord-ouest, le Royaume-Uni est notre premier voisin. Les 5 millions de camions qui passent par Calais chaque année pour rejoindre l’Angleterre ne vont pas disparaître demain. Nous avons des liens forts avec le Royaume-Uni qui a la possibilité, à tout instant, de dire qu’il souhaite rester dans l’Union européenne. Il peut également choisir un jour de refaire le chemin inverse.
L’accord de libre-échange traite de nos liens commerciaux. Nous avons aussi conclu de nombreux traités bilatéraux, notamment sur la défense. L’année prochaine, nous célébrerons les dix ans des accords de Lancaster House, traité fondateur dans nos relations avec le Royaume-Uni en termes de sécurité et de défense. Nous avons encore beaucoup de sujets sur lesquels travailler. J’espère que nous le ferons de manière positive. Il est toujours plus facile, politiquement, de se rapprocher que de se détacher.
Je vois que le sénateur Masson a quitté l’hémicycle. Il est coutumier du fait : souvent, il prend la parole, puis s’en va sans attendre ma réponse… Je voulais faire une première précision sémantique : il faut parler des Britanniques et non des Anglais. Anglais, Écossais, Nord-Irlandais, Gallois ont tous voté de manière assez différente sur le Brexit, mais c’est bien le peuple britannique qui a voté.
Je ne pense pas non plus que la comparaison entre 2005-2007 et ce qui se passe aujourd’hui soit de bon aloi. La France et ses partenaires n’ont pas voulu bloquer la volonté du peuple britannique de réaliser le Brexit. Depuis le départ, et vous savez que c’est un souhait permanent du Président de la République, nous ne devons pas nous opposer à ce référendum, mais faire en sorte que le processus démocratique aboutisse. Nous voudrions que les choses aillent plutôt vite. La lenteur ne sera pas forcément un gage de réalisation de cette volonté souveraine. Il faut toujours être extrêmement respectueux. Si nous croyons en l’État de droit, nous devons nous interdire toute ingérence directe.
Monsieur le sénateur Laurent, vous m’avez interrogée sur ce que vous décrivez comme des impasses. Je retiens deux choses : une nouvelle politique industrielle qui puisse nous amener à parler d’Alstom et de Siemens et une nouvelle politique ferroviaire, notamment pour permettre des investissements publics sur la sécurité ou sur le fret.
La Commission travaille déjà à changer de version, sinon de logiciel, et met clairement à jour sa doctrine pour pouvoir protéger nos emplois. Quand la présidente de la Commission nous dit vouloir mettre en place un mécanisme d’inclusion carbone aux frontières, j’y vois une méthode très intéressante de protection des normes environnementales et des emplois sur notre continent.
Il faut effectivement repenser un modèle de croissance, de prospérité, de partage des richesses. La France aimerait, par exemple, que toutes les dispositions sur l’intéressement et sur la participation puissent s’exporter à l’échelle européenne. Quand nous défendons le bouclier social, et notamment le salaire minimum européen, c’est-à-dire le fait qu’aucun travailleur à plein temps en Europe ne puisse gagner moins que le seuil de pauvreté, nous créons sinon un nouveau capitalisme, du moins un capitalisme respectueux des richesses qui permettent la production de prospérité collective.
Monsieur le sénateur Menonville, vous m’avez interrogée sur la PAC, sur la cohésion et sur la façon dont nous allions défendre ces politiques. Nous allons les défendre sans être conservateurs. Nous allons d’abord rappeler que l’Europe doit construire la souveraineté et la convergence. Si nous ne sommes pas capables d’apporter aux citoyens à la fois souveraineté et convergence, tout ce que je pourrai vous dire ici n’aura aucun sens concret dans la vie de nos compatriotes que nous appelons aux urnes tous les cinq ans.
Notre principale défense consiste à montrer en quoi ces politiques sont pertinentes, en quoi elles répondent aux exigences de nos territoires et des citoyens. Pour le Président de la République, la PAC et la cohésion sont tout à fait finançables avec une contribution de 1 % du PIB national. Par contre, le financement du reste doit reposer sur des ressources propres. J’y vois le chemin d’un compromis à même de réconcilier les pays contributeurs nets, très vigilants sur l’effort qu’ils consentent, et les pays qui souhaiteraient voir de nouvelles politiques se déployer.
Monsieur le sénateur Allizard, vous m’avez interrogée sur la Chine et l’Asie en général. Comme vous le savez, quand Xi Jinping est venu à Paris, nous l’avons reçu en compagnie de Mme Merkel. Un sommet avec Jean-Claude Juncker a ensuite eu lieu. Le Président de la République se rendra à son tour en Chine dans quelques jours, avec une délégation européenne… Nous devons essayer de nouer avec la Chine une relation, non pas d’égal à égal, car les Européens ne seront jamais aussi nombreux que les Chinois, mais de partenaires économiques et commerciaux qui repose sur une forme de réciprocité.
Une partie du déplacement du Président de la République en Chine est justement consacrée à l’ouverture des marchés chinois à nos entreprises. Nous devons créer de l’écoute et donc de la réciprocité sur ces sujets.
Vous m’avez également interrogée sur les forages turcs au bloc 7 au large de Chypre. Le Conseil européen a décidé des sanctions à l’encontre de ceux qui mènent ces forages. La limite à poser est celle de la souveraineté territoriale d’un État membre. Nous sommes extrêmement mobilisés sur ce sujet.
Monsieur le sénateur Marie, vous souhaitez savoir quels projets phares nous portons pour les années qui viennent. La France et l’Allemagne, contrairement à beaucoup de nos partenaires, ont une feuille de route. C’est le discours à la Sorbonne qui a ensuite été décliné sous diverses formes durant la campagne des élections européennes et qui a largement inspiré le discours d’Ursula von der Leyen.
Ce discours nous dit que l’Europe doit se positionner face aux défis de son siècle – le climat, la capacité à créer des emplois dans un monde très innovant… – et doit porter sa voix dans un monde qui n’est plus celui des années quatre-vingt-dix, avec des blocs très organisés, où chacun savait où il habitait. Les alliances sont aujourd’hui très mouvantes, ce qui nous oblige à retrouver de l’autonomie.
Cette souveraineté européenne est un cadre qui rassemble davantage chaque jour. Les différents pays ne peuvent répondre autrement qu’en Européens face aux pressions commerciales ou aux investisseurs prêts à partir très loin et à détruire des emplois…
Comment Ursula von der Leyen peut-elle trouver une majorité pour soutenir ce projet ? Le travail mené la semaine dernière avec les chefs d’État et de gouvernement lors du Conseil européen et cette semaine au Parlement européen ne vise pas à signer un accord de coalition, un bout de papier signé la main sur le cœur pour cinq ans dont on ignore s’il aboutira à quoi que ce soit. Sur les grandes thématiques, les grandes priorités qu’elle a fixées, la présidente de la Commission doit pouvoir disposer d’un engagement collectif et de confiance.
Je me rends à Strasbourg tous les mois depuis six mois, au moment de la plénière, pour rencontrer les parlementaires européens de manière extrêmement intensive. Les choses sont bien évidemment plus compliquées qu’avec deux blocs et des positions définies dès le départ, mais je peux vous assurer qu’une majorité existe sur de nombreux thèmes. Il faut construire cette majorité, sujet par sujet. C’est un travail que je mène aussi au Conseil. Si l’on se contente de dire que la France et l’Allemagne sont d’accord, ça ne marche pas. Les coalitions se forment sujet par sujet : nous avons des partenaires sur le budget, nous en avons d’autres sur le climat ou sur la cohésion… Nous avançons thématique par thématique, ce qui demande plus de travail et d’agilité. Nous avons une majorité moins visible, moins automatique, qui demande plus de mobilisation collective.
En ce qui concerne le cadre financier pluriannuel, le CFP, je pense que nous pourrons trouver des contributions nationales pour les politiques actuelles et des ressources propres pour financer le coût des nouvelles politiques. Il existe un chemin pouvant nous permettre de rallier les contributeurs nets et les pays les plus demandeurs.
Monsieur le sénateur Longeot, en ce qui concerne le calendrier, mieux vaut un bon accord qu’un mauvais accord négocié trop vite. Nous essayons tout de même d’avoir de la visibilité pour le début 2020. Nos chercheurs, nos collectivités locales, nos entreprises qui dépendent au quotidien de ces fonds européens ont besoin de clarté. Vous m’en voudriez beaucoup si, dans quelques semaines, je venais vous annoncer un accord avec une PAC réduite à la portion congrue ou des régions en transition maltraitées. Il faut trouver le juste équilibre.
Toutefois, nous ne voulons pas prendre de retard. Nous ne voulons pas nous retrouver avec les mêmes problèmes qu’en 2014 sur le terrain. Nous savons combien cela pourrait être dommageable.
Madame la sénatrice Morhet-Richaud, vous avez souligné que les Américains avaient largement soutenu les programmes de développement militaire en Macédoine du Nord. Or, pour 2 millions d’habitants, ce pays a reçu de l’Union européenne 664 millions d’euros de soutien entre 2014 et 2020, au travers de l’instrument de préadhésion.
Nous menons avec ces pays une politique d’investissement collectif très forte. S’il faut traiter le sujet juridico-politique de l’élargissement, les chiffres que je viens de citer montrent que l’Union européenne ne se désintéresse pas de ces pays situés au cœur de l’Europe et avec lesquels nous devons nouer une relation stratégique.
Je vous remercie de ces échanges et de votre soutien, dans une période où nous avons besoin d’une parole unie et non d’une parole dure, d’une parole qui amène de la clarté. Nos partenaires doivent savoir que si nous sommes parfois exigeants, c’est aussi dans leur intérêt. (
Nouveaux sourires.
Une extension qui ne servirait qu’à gagner du temps ou à rediscuter l’accord est totalement exclue. Il ne s’agit pas d’un changement de position. Nous avons déjà perdu trop de temps. Nous avons trouvé un accord équilibré qui respecte à la fois la souveraineté britannique et les lignes rouges européennes. Nous devons consacrer toute notre énergie à le mettre en œuvre sans délai.
Nous devons nous employer à faire cesser une incertitude qui crée beaucoup d’angoisses et qui pénalise économiquement des millions de familles, d’entreprises et d’emplois. C’est la raison pour laquelle la France ne veut pas d’une extension à l’infini. Nous voulons pouvoir nous appuyer sur des échéances claires et rapprochées et avancer étape après étape.
Monsieur le président Éblé, vous m’avez interrogée sur le fameux plan de contingence visant justement à répondre à l’incertitude, si elle venait à se manifester. Certains règlements ont déjà été modifiés, notamment le mécanisme d’interconnexion des infrastructures portuaires qui a permis de réaliser des investissements à Boulogne, à Calais et autour de l’entrée du tunnel sous la Manche, à Coquelles. Je pense également au fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, ou Feamp, en cas d’immobilisation de la flotte. La Commission a aussi proposé de nouveaux aménagements concernant l’activation du fonds de solidarité de l’Union européenne, le fameux FSUE, destiné à aider les pays confrontés à des chocs subis et non prévisibles et la mobilisation du fonds européen d’ajustement à la mondialisation, le FEM, qui permet notamment de se protéger contre des chocs commerciaux extérieurs ou d’y répondre.
Au départ, la Commission prévoyait des critères suffisamment restrictifs pour que ces mécanismes ne profitent qu’à très peu de monde, pour ne pas dire à personne. La France a plaidé, avec un certain succès, pour qu’ils puissent être réellement mis en œuvre. Il ne s’agit pas d’être dans le symbolique : si l’on crée des mécanismes, il faut s’assurer de l’existence de bénéficiaires.
Il est difficile de savoir aujourd’hui combien de millions ou de milliards d’euros tout cela pourrait représenter pour la France. Ce n’est pas une enveloppe par pays, mais en fonction des besoins. Je ne peux vous dire combien d’entreprises en bénéficieraient si nous activions ces mécanismes.
Je tiens à rappeler mes propos lors de mon audition : j’ai besoin de vous et de votre soutien si jamais les Britanniques venaient à ne pas payer leur contribution de 2020, soit 12 milliards d’euros – non pas parce qu’ils seraient forcés de rester, comme j’ai pu l’entendre ce soir, mais bien parce qu’il s’agit de sommes dues.
Il faudrait alors absolument rappeler à la Commission européenne que nous nous opposons au plan qu’elle a imaginé, à savoir 6 milliards d’euros coupés dans les dépenses prévues – ce qui aurait des conséquences immédiates sur nos collectivités locales – et un appel à contribution des États membres de 6 milliards, soit plus d’1 milliard d’euros pour la France. Vous êtes en train d’examiner le projet de loi de finances : je vous laisse imaginer ce que représenterait sur nos comptes publics une telle contribution exceptionnelle… Dans la mesure où, pour entamer des discussions sur une relation future, il faudrait que le Royaume-Uni ait payé ses contributions, cela reviendrait à faire des avances de trésorerie.
Si cette situation venait à se produire, il faudrait trouver une solution technique pour apporter 12 milliards d’euros de trésorerie à la Commission, puisque nous savons que cet argent sera récupéré. S’il ne l’était pas, il n’y aurait pas de relation future. Il faut mener un travail technique sur ce sujet, peut-être par la BEI, la Banque européenne d’investissement, au capital de laquelle le Royaume-Uni a des parts.
Il existe plusieurs manières de trouver des garanties et de se prémunir. Il s’agit d’un sujet hautement politique. Je ne me vois pas revenir devant vous ou ailleurs pour expliquer aux élus locaux ou aux contribuables que nous devons faire des efforts en raison d’un petit problème de trésorerie britannique…
Monsieur le sénateur Bonnecarrère, nous nous sommes effectivement mobilisés contre une relation future marquée par la concurrence déloyale. Nous considérons que la déclaration politique sur la relation future est une bonne déclaration en ce qu’elle encadre très fermement les conditions d’un accord de libre-échange.
Je tiens d’ailleurs à vous rassurer : vous aurez à ratifier cet accord de libre-échange. Les parlements nationaux vont rentrer de nouveau dans le jeu : si l’accord de divorce est bien un processus restreint à l’Union européenne au nom des Vingt-Sept, au Parlement européen et au Royaume-Uni, dès qu’il s’agira de l’accord de libre-échange, même négocié au nom de l’Union européenne, chacune des chambres nationales devra bien le ratifier.
Madame la sénatrice Guillotin, vous m’avez interrogée sur l’exécution des fonds européens. C’est bien beau de négocier des enveloppes, mais c’est encore mieux si elles se concrétisent ensuite. Comme vous le savez, j’ai l’intention de travailler très précisément, avec tous les parlementaires, tous les élus locaux, toutes les associations d’élus, à simplifier le recours aux fonds européens. Trop souvent, on dit que l’Europe est compliquée ; en fait, ce sont les procédures françaises de mise en œuvre des politiques européennes qui sont compliquées. Avec Jacqueline Gourault et les ministres référents – Didier Guillaume pour les politiques agricoles ou Muriel Pénicaud pour les politiques sociales – nous menons, avec un certain nombre de préfets, un travail de recension très pratique : quelles sont les démarches à suivre en France pour avoir accès au fonds social européen et quelles sont celles à suivre en Belgique, par exemple ? Inspirons-nous de ce qui est plus simple ailleurs pour faciliter la vie des porteurs de projets. Notre objectif est de faire en sorte que l’argent arrive dans les territoires.
En ce qui concerne l’élargissement, vous nous avez appelés à développer une prospérité réelle. Il s’agit aussi pour l’Europe de retrouver des modes de décision interne qui soient efficaces. Beaucoup de vos interventions, mesdames, messieurs les sénateurs, soulignaient que l’Europe était dans une impasse, à la croisée des chemins… D’autres encore ont dit que nous devions nous ressaisir.
C’est là tout le paradoxe : quand nous sommes au Conseil européen et qu’on nous parle d’élargissement, il est devenu tabou de dire que le sujet n’est pas de savoir si tel ou tel pays mérite ou démérite, mais d’avoir revu nos procédures internes de décision le jour où nous aurons à statuer sur leur adhésion effective. La règle de l’unanimité donne parfois un pouvoir démesuré à des coalitions de pays qui se mettent dans une posture de blocage et non de proposition. Je pense également à la représentation d’un commissaire. Peut-on vraiment travailler avec un gouvernement dont les trente membres sont sur un pied d’égalité totale. Comment organiser la collégialité, comment prendre des décisions et, surtout, comment retrouver de la rapidité ?
Ce qui rend beaucoup d’Européens sceptiques sur la valeur du projet européen, c’est la lenteur des processus entre le moment où l’on se fixe des objectifs et le moment où l’on arrive à les mettre en œuvre. Il faut des réformes. C’est la raison pour laquelle le Président de la République, la Chancelière Merkel et d’autres chefs d’État et de gouvernement soutiennent cette fameuse conférence sur l’Europe. Nous devons mettre certaines choses sur la table pour retrouver de l’agilité, de la rapidité et de la capacité à décider. Mme Merkel disait, au moment de choisir ceux qui allaient occuper les « top jobs », que le sujet ne portait pas tant sur les hommes que sur la capacité à prendre des décisions qu’on leur donne. Il nous reste à mener une réflexion sur le sujet.
Monsieur le sénateur Gattolin, je suis très déçue de ne pas disposer du temps suffisant pour regarder toutes les séries Netflix que vous avez décrites. §Je suis, parfois avec amusement, mais toujours avec beaucoup d’intérêt, celle qui s’appelle le Brexit. On finit par se demander si on est dans la fiction ou dans la réalité. Ce qui est certain, c’est que nous ne pouvons malheureusement pas en sourire, tant il y a d’incertitudes. Quand vous rencontrez les pêcheurs de Boulogne-sur-Mer, vous comprenez vite qu’il ne s’agit pas d’un feuilleton humoristique ni parodique.
Vous avez raison de souligner que ce processus sera de longue durée. Nous aurons en effet à « retricoter » toutes nos relations culturelles, universitaires, sociales et économiques. J’ai grandi à Calais. Le tunnel sous la Manche a été construit quand j’y habitais. Il mesure 50 kilomètres de long ; il ne fera pas davantage demain. Nous verrons toujours les falaises de Douvres depuis Calais. Au nord-ouest, le Royaume-Uni est notre premier voisin. Les 5 millions de camions qui passent par Calais chaque année pour rejoindre l’Angleterre ne vont pas disparaître demain. Nous avons des liens forts avec le Royaume-Uni qui a la possibilité, à tout instant, de dire qu’il souhaite rester dans l’Union européenne. Il peut également choisir un jour de refaire le chemin inverse.
L’accord de libre-échange traite de nos liens commerciaux. Nous avons aussi conclu de nombreux traités bilatéraux, notamment sur la défense. L’année prochaine, nous célébrerons les dix ans des accords de Lancaster House, traité fondateur dans nos relations avec le Royaume-Uni en termes de sécurité et de défense. Nous avons encore beaucoup de sujets sur lesquels travailler. J’espère que nous le ferons de manière positive. Il est toujours plus facile, politiquement, de se rapprocher que de se détacher.
Je vois que le sénateur Masson a quitté l’hémicycle. Il est coutumier du fait : souvent, il prend la parole, puis s’en va sans attendre ma réponse… Je voulais faire une première précision sémantique : il faut parler des Britanniques et non des Anglais. Anglais, Écossais, Nord-Irlandais, Gallois ont tous voté de manière assez différente sur le Brexit, mais c’est bien le peuple britannique qui a voté.
Je ne pense pas non plus que la comparaison entre 2005-2007 et ce qui se passe aujourd’hui soit de bon aloi. La France et ses partenaires n’ont pas voulu bloquer la volonté du peuple britannique de réaliser le Brexit. Depuis le départ, et vous savez que c’est un souhait permanent du Président de la République, nous ne devons pas nous opposer à ce référendum, mais faire en sorte que le processus démocratique aboutisse. Nous voudrions que les choses aillent plutôt vite. La lenteur ne sera pas forcément un gage de réalisation de cette volonté souveraine. Il faut toujours être extrêmement respectueux. Si nous croyons en l’État de droit, nous devons nous interdire toute ingérence directe.
Monsieur le sénateur Laurent, vous m’avez interrogée sur ce que vous décrivez comme des impasses. Je retiens deux choses : une nouvelle politique industrielle qui puisse nous amener à parler d’Alstom et de Siemens et une nouvelle politique ferroviaire, notamment pour permettre des investissements publics sur la sécurité ou sur le fret.
La Commission travaille déjà à changer de version, sinon de logiciel, et met clairement à jour sa doctrine pour pouvoir protéger nos emplois. Quand la présidente de la Commission nous dit vouloir mettre en place un mécanisme d’inclusion carbone aux frontières, j’y vois une méthode très intéressante de protection des normes environnementales et des emplois sur notre continent.
Il faut effectivement repenser un modèle de croissance, de prospérité, de partage des richesses. La France aimerait, par exemple, que toutes les dispositions sur l’intéressement et sur la participation puissent s’exporter à l’échelle européenne. Quand nous défendons le bouclier social, et notamment le salaire minimum européen, c’est-à-dire le fait qu’aucun travailleur à plein temps en Europe ne puisse gagner moins que le seuil de pauvreté, nous créons sinon un nouveau capitalisme, du moins un capitalisme respectueux des richesses qui permettent la production de prospérité collective.
Monsieur le sénateur Menonville, vous m’avez interrogée sur la PAC, sur la cohésion et sur la façon dont nous allions défendre ces politiques. Nous allons les défendre sans être conservateurs. Nous allons d’abord rappeler que l’Europe doit construire la souveraineté et la convergence. Si nous ne sommes pas capables d’apporter aux citoyens à la fois souveraineté et convergence, tout ce que je pourrai vous dire ici n’aura aucun sens concret dans la vie de nos compatriotes que nous appelons aux urnes tous les cinq ans.
Notre principale défense consiste à montrer en quoi ces politiques sont pertinentes, en quoi elles répondent aux exigences de nos territoires et des citoyens. Pour le Président de la République, la PAC et la cohésion sont tout à fait finançables avec une contribution de 1 % du PIB national. Par contre, le financement du reste doit reposer sur des ressources propres. J’y vois le chemin d’un compromis à même de réconcilier les pays contributeurs nets, très vigilants sur l’effort qu’ils consentent, et les pays qui souhaiteraient voir de nouvelles politiques se déployer.
Monsieur le sénateur Allizard, vous m’avez interrogée sur la Chine et l’Asie en général. Comme vous le savez, quand Xi Jinping est venu à Paris, nous l’avons reçu en compagnie de Mme Merkel. Un sommet avec Jean-Claude Juncker a ensuite eu lieu. Le Président de la République se rendra à son tour en Chine dans quelques jours, avec une délégation européenne… Nous devons essayer de nouer avec la Chine une relation, non pas d’égal à égal, car les Européens ne seront jamais aussi nombreux que les Chinois, mais de partenaires économiques et commerciaux qui repose sur une forme de réciprocité.
Une partie du déplacement du Président de la République en Chine est justement consacrée à l’ouverture des marchés chinois à nos entreprises. Nous devons créer de l’écoute et donc de la réciprocité sur ces sujets.
Vous m’avez également interrogée sur les forages turcs au bloc 7 au large de Chypre. Le Conseil européen a décidé des sanctions à l’encontre de ceux qui mènent ces forages. La limite à poser est celle de la souveraineté territoriale d’un État membre. Nous sommes extrêmement mobilisés sur ce sujet.
Monsieur le sénateur Marie, vous souhaitez savoir quels projets phares nous portons pour les années qui viennent. La France et l’Allemagne, contrairement à beaucoup de nos partenaires, ont une feuille de route. C’est le discours à la Sorbonne qui a ensuite été décliné sous diverses formes durant la campagne des élections européennes et qui a largement inspiré le discours d’Ursula von der Leyen.
Ce discours nous dit que l’Europe doit se positionner face aux défis de son siècle – le climat, la capacité à créer des emplois dans un monde très innovant… – et doit porter sa voix dans un monde qui n’est plus celui des années quatre-vingt-dix, avec des blocs très organisés, où chacun savait où il habitait. Les alliances sont aujourd’hui très mouvantes, ce qui nous oblige à retrouver de l’autonomie.
Cette souveraineté européenne est un cadre qui rassemble davantage chaque jour. Les différents pays ne peuvent répondre autrement qu’en Européens face aux pressions commerciales ou aux investisseurs prêts à partir très loin et à détruire des emplois…
Comment Ursula von der Leyen peut-elle trouver une majorité pour soutenir ce projet ? Le travail mené la semaine dernière avec les chefs d’État et de gouvernement lors du Conseil européen et cette semaine au Parlement européen ne vise pas à signer un accord de coalition, un bout de papier signé la main sur le cœur pour cinq ans dont on ignore s’il aboutira à quoi que ce soit. Sur les grandes thématiques, les grandes priorités qu’elle a fixées, la présidente de la Commission doit pouvoir disposer d’un engagement collectif et de confiance.
Je me rends à Strasbourg tous les mois depuis six mois, au moment de la plénière, pour rencontrer les parlementaires européens de manière extrêmement intensive. Les choses sont bien évidemment plus compliquées qu’avec deux blocs et des positions définies dès le départ, mais je peux vous assurer qu’une majorité existe sur de nombreux thèmes. Il faut construire cette majorité, sujet par sujet. C’est un travail que je mène aussi au Conseil. Si l’on se contente de dire que la France et l’Allemagne sont d’accord, ça ne marche pas. Les coalitions se forment sujet par sujet : nous avons des partenaires sur le budget, nous en avons d’autres sur le climat ou sur la cohésion… Nous avançons thématique par thématique, ce qui demande plus de travail et d’agilité. Nous avons une majorité moins visible, moins automatique, qui demande plus de mobilisation collective.
En ce qui concerne le cadre financier pluriannuel, le CFP, je pense que nous pourrons trouver des contributions nationales pour les politiques actuelles et des ressources propres pour financer le coût des nouvelles politiques. Il existe un chemin pouvant nous permettre de rallier les contributeurs nets et les pays les plus demandeurs.
Monsieur le sénateur Longeot, en ce qui concerne le calendrier, mieux vaut un bon accord qu’un mauvais accord négocié trop vite. Nous essayons tout de même d’avoir de la visibilité pour le début 2020. Nos chercheurs, nos collectivités locales, nos entreprises qui dépendent au quotidien de ces fonds européens ont besoin de clarté. Vous m’en voudriez beaucoup si, dans quelques semaines, je venais vous annoncer un accord avec une PAC réduite à la portion congrue ou des régions en transition maltraitées. Il faut trouver le juste équilibre.
Toutefois, nous ne voulons pas prendre de retard. Nous ne voulons pas nous retrouver avec les mêmes problèmes qu’en 2014 sur le terrain. Nous savons combien cela pourrait être dommageable.
Madame la sénatrice Morhet-Richaud, vous avez souligné que les Américains avaient largement soutenu les programmes de développement militaire en Macédoine du Nord. Or, pour 2 millions d’habitants, ce pays a reçu de l’Union européenne 664 millions d’euros de soutien entre 2014 et 2020, au travers de l’instrument de préadhésion.
Nous menons avec ces pays une politique d’investissement collectif très forte. S’il faut traiter le sujet juridico-politique de l’élargissement, les chiffres que je viens de citer montrent que l’Union européenne ne se désintéresse pas de ces pays situés au cœur de l’Europe et avec lesquels nous devons nouer une relation stratégique.
Je vous remercie de ces échanges et de votre soutien, dans une période où nous avons besoin d’une parole unie et non d’une parole dure, d’une parole qui amène de la clarté. Nos partenaires doivent savoir que si nous sommes parfois exigeants, c’est aussi dans leur intérêt. (
Conclusion du débat
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Mme la présidente. La parole est à Mme Pascale Gruny, au nom de la commission des affaires européennes.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, messieurs les présidents de commission, mes chers collègues, M. Jean Bizet, président de la commission des affaires européennes, m’a fait l’honneur de me confier le soin de conclure, au nom de la commission, ce débat consécutif au Conseil européen des 17 et 18 octobre dernier. Permettez-moi tout d’abord de vous remercier pour vos diverses contributions à ce débat très riche, à la suite d’un Conseil européen particulièrement délicat. Même s’il reste du pain sur la planche, je souhaite souligner ici les pistes d’avenir qu’il a tracées.
D’abord, la négociation sur le cadre financier pluriannuel a été relancée. Assurément, la proposition de la présidence finlandaise a fait l’unanimité contre elle. C’est évidemment une déception. La bonne nouvelle, c’est que tout reste ouvert dans la négociation : le niveau des ressources, la part de chaque politique dans le budget, les ressources propres, les rabais, ainsi que les conditionnalités… Il y va de la capacité d’action de l’Union européenne pour les cinq années à venir.
Aussi, nous devons persévérer dans nos demandes : préserver l’enveloppe budgétaire de la politique agricole commune, qui est une politique stratégique pour l’Union, pour sa capacité à assurer un niveau de vie correct à ses agriculteurs, pour sa souveraineté alimentaire et pour sa transition climatique ; supprimer les rabais, car si cette suppression n’a pas lieu à l’occasion du départ des Britanniques, elle ne pourra jamais se faire ; revoir les ressources propres, en les mettant en rapport avec les objectifs ambitieux et nombreux que les citoyens européens assignent à l’Union européenne ; soumettre à conditionnalités l’octroi des fonds européens afin d’en faire des leviers utiles, notamment au service de l’État de droit…
Le sujet du cadre financier pluriannuel sera à nouveau abordé en décembre, sur le fondement d’un nouveau cadre de négociation que la présidence finlandaise est invitée à élaborer et sous la nouvelle présidence de Charles Michel. Toutefois, au regard des divergences profondes qui persistent, il ne sera sans doute pas évident de conclure en 2020 cette négociation qui requiert l’unanimité.
C’est aussi en décembre que le Conseil européen devra finaliser ses orientations sur la stratégie européenne de long terme sur le changement climatique. Cette convergence des sujets financiers et climatiques en décembre est propice pour que l’Union se donne les moyens d’une transition verte socialement équitable. La transition écologique est en effet un enjeu d’envergure européenne. Il importe que l’Union continue à se positionner comme leader dans la mise en œuvre de l’accord de Paris. Nous pouvons à cet égard nous féliciter qu’un nombre toujours croissant d’États membres se rallie progressivement à l’objectif de neutralité carbone en 2050.
L’Union devra aussi accorder l’attention nécessaire au lien entre climat et océans, que le nouveau rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, le Giec, a mis en lumière le mois dernier. Il faudra toutefois veiller à ce que cette transition écologique se réalise au même rythme et selon le même niveau d’exigence d’un État membre à l’autre, sous peine d’encourager de nouvelles distorsions de concurrence au détriment de nos entreprises et de nos agriculteurs.
Ces deux sujets majeurs – budget et climat – ne pourront valablement avancer que s’ils sont portés par de nouvelles institutions européennes en bon état de marche. La Commission européenne est en position d’apporter une contribution décisive à la mise en œuvre des priorités fixées par l’agenda stratégique. Or sa composition reste encore incomplète, en partie du fait du nouveau Parlement européen dont les équilibres renouvelés changent le fonctionnement.
Nous attendons notamment le nom du nouveau candidat français au poste de commissaire. Nous sommes surpris de voir que le Président de la République semble avoir d’autres priorités : à l’issue de la réunion du Conseil européen, il a préféré proposer la création d’une Haute Autorité de la transparence de la vie publique au niveau européen…
Absorbée par la négociation du Brexit et ralentie par le renouvellement de ses institutions, l’Europe prend du retard, alors qu’elle doit répondre aux nombreux défis urgents qui sont devant elle. Nous avons d’ailleurs appris, voilà une heure, que Donald Tusk avait proposé d’accepter le report de quatre-vingt-dix jours.
Le monde n’attend plus l’Europe. La priorité doit donc être aujourd’hui de la remettre en action et de la refonder pour qu’elle se projette plus efficacement dans l’avenir et pour l’avenir de l’ensemble des citoyens européens.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC, RDSE, Les Indépendants et LaREM, ainsi que sur des travées du groupe SOCR.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, messieurs les présidents de commission, mes chers collègues, M. Jean Bizet, président de la commission des affaires européennes, m’a fait l’honneur de me confier le soin de conclure, au nom de la commission, ce débat consécutif au Conseil européen des 17 et 18 octobre dernier. Permettez-moi tout d’abord de vous remercier pour vos diverses contributions à ce débat très riche, à la suite d’un Conseil européen particulièrement délicat. Même s’il reste du pain sur la planche, je souhaite souligner ici les pistes d’avenir qu’il a tracées.
D’abord, la négociation sur le cadre financier pluriannuel a été relancée. Assurément, la proposition de la présidence finlandaise a fait l’unanimité contre elle. C’est évidemment une déception. La bonne nouvelle, c’est que tout reste ouvert dans la négociation : le niveau des ressources, la part de chaque politique dans le budget, les ressources propres, les rabais, ainsi que les conditionnalités… Il y va de la capacité d’action de l’Union européenne pour les cinq années à venir.
Aussi, nous devons persévérer dans nos demandes : préserver l’enveloppe budgétaire de la politique agricole commune, qui est une politique stratégique pour l’Union, pour sa capacité à assurer un niveau de vie correct à ses agriculteurs, pour sa souveraineté alimentaire et pour sa transition climatique ; supprimer les rabais, car si cette suppression n’a pas lieu à l’occasion du départ des Britanniques, elle ne pourra jamais se faire ; revoir les ressources propres, en les mettant en rapport avec les objectifs ambitieux et nombreux que les citoyens européens assignent à l’Union européenne ; soumettre à conditionnalités l’octroi des fonds européens afin d’en faire des leviers utiles, notamment au service de l’État de droit…
Le sujet du cadre financier pluriannuel sera à nouveau abordé en décembre, sur le fondement d’un nouveau cadre de négociation que la présidence finlandaise est invitée à élaborer et sous la nouvelle présidence de Charles Michel. Toutefois, au regard des divergences profondes qui persistent, il ne sera sans doute pas évident de conclure en 2020 cette négociation qui requiert l’unanimité.
C’est aussi en décembre que le Conseil européen devra finaliser ses orientations sur la stratégie européenne de long terme sur le changement climatique. Cette convergence des sujets financiers et climatiques en décembre est propice pour que l’Union se donne les moyens d’une transition verte socialement équitable. La transition écologique est en effet un enjeu d’envergure européenne. Il importe que l’Union continue à se positionner comme leader dans la mise en œuvre de l’accord de Paris. Nous pouvons à cet égard nous féliciter qu’un nombre toujours croissant d’États membres se rallie progressivement à l’objectif de neutralité carbone en 2050.
L’Union devra aussi accorder l’attention nécessaire au lien entre climat et océans, que le nouveau rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, le Giec, a mis en lumière le mois dernier. Il faudra toutefois veiller à ce que cette transition écologique se réalise au même rythme et selon le même niveau d’exigence d’un État membre à l’autre, sous peine d’encourager de nouvelles distorsions de concurrence au détriment de nos entreprises et de nos agriculteurs.
Ces deux sujets majeurs – budget et climat – ne pourront valablement avancer que s’ils sont portés par de nouvelles institutions européennes en bon état de marche. La Commission européenne est en position d’apporter une contribution décisive à la mise en œuvre des priorités fixées par l’agenda stratégique. Or sa composition reste encore incomplète, en partie du fait du nouveau Parlement européen dont les équilibres renouvelés changent le fonctionnement.
Nous attendons notamment le nom du nouveau candidat français au poste de commissaire. Nous sommes surpris de voir que le Président de la République semble avoir d’autres priorités : à l’issue de la réunion du Conseil européen, il a préféré proposer la création d’une Haute Autorité de la transparence de la vie publique au niveau européen…
Absorbée par la négociation du Brexit et ralentie par le renouvellement de ses institutions, l’Europe prend du retard, alors qu’elle doit répondre aux nombreux défis urgents qui sont devant elle. Nous avons d’ailleurs appris, voilà une heure, que Donald Tusk avait proposé d’accepter le report de quatre-vingt-dix jours.
Le monde n’attend plus l’Europe. La priorité doit donc être aujourd’hui de la remettre en action et de la refonder pour qu’elle se projette plus efficacement dans l’avenir et pour l’avenir de l’ensemble des citoyens européens.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC, RDSE, Les Indépendants et LaREM, ainsi que sur des travées du groupe SOCR.

Nous en avons terminé avec le débat à la suite de la réunion du Conseil européen des 17 et 18 octobre 2019.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, mercredi 23 octobre 2019 :
À quinze heures :
Questions d’actualité au Gouvernement.
De seize heures trente à vingt heures trente :
(Ordre du jour réservé au groupe SOCR)
Proposition de loi visant à adapter la fiscalité de la succession et de la donation aux enjeux démographiques, sociétaux et économiques du XXIe siècle, présentée par MM. Patrick Kanner, Thierry Carcenac, Claude Raynal, Vincent Éblé et plusieurs de leurs collègues (texte de la commission n° 62, 2019-2020) ;
Proposition de loi tendant à renforcer l’effectivité du droit au changement d’assurance emprunteur, présentée par M. Martial Bourquin (texte de la commission n° 59, 2019-2020).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
Ordre du jour
La séance est levée à vingt-trois heures quarante-cinq.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, mercredi 23 octobre 2019 :
À quinze heures :
Questions d’actualité au Gouvernement.
De seize heures trente à vingt heures trente :
(Ordre du jour réservé au groupe SOCR)
Proposition de loi visant à adapter la fiscalité de la succession et de la donation aux enjeux démographiques, sociétaux et économiques du XXIe siècle, présentée par MM. Patrick Kanner, Thierry Carcenac, Claude Raynal, Vincent Éblé et plusieurs de leurs collègues (texte de la commission n° 62, 2019-2020) ;
Proposition de loi tendant à renforcer l’effectivité du droit au changement d’assurance emprunteur, présentée par M. Martial Bourquin (texte de la commission n° 59, 2019-2020).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures quarante-cinq.