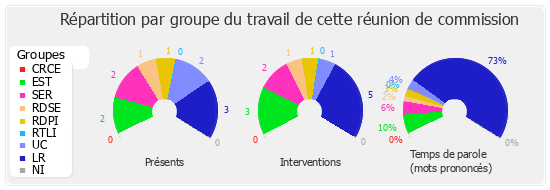Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
Réunion du 20 mai 2020 à 9h30
Sommaire
- Biodiversité
- Audition de m. jean-françois guégan professeur à l'école des hautes études en santé publique membre du conseil national français sur les changements globaux sur le thème « crise environnementale et pandémie » (voir le dossier)
- Répercussions de la crise de covid-19 sur les secteurs de l'eau et de la biodiversité
La réunion

Cette réunion se tient pour la première fois dans un format mixte : certains d'entre nous se trouvent in situ, salle Monory, les autres participent à cette réunion en visioconférence.
Nous accueillons M. Jean-François Guégan. Aujourd'hui directeur de recherche de classe exceptionnelle à l'Institut de recherche sur le développement durable (IRD), en accueil à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae), spécialiste de l'étude des relations entre la santé et l'environnement, professeur à l'École des hautes études en santé publique, il a également été membre du Haut Conseil de santé publique et a fait partie du comité d'experts que Roselyne Bachelot avait mis en place lors de l'épidémie de grippe A, en 2009.
Nous avons inauguré la semaine dernière un cycle d'auditions prospectives pour réfléchir au « monde d'après » et essayer de formuler un certain nombre de propositions post-crise. Notre commission travaille de manière régulière sur les questions de biodiversité et de risques liés à la destruction des écosystèmes. La crise actuelle met plus que jamais en lumière les liens entre l'impact de nos activités sur la nature et l'émergence de nouvelles pandémies.
C'est donc très naturellement que nous avons souhaité vous entendre ce matin, monsieur Guégan, puisque vous avez eu l'occasion d'écrire un certain nombre d'articles sur le sujet. Vous avez notamment qualifié la crise actuelle de « coup de semonce qui nous est donné » et, dans un entretien au Monde il y a un mois, lancé cet avertissement : « Si nous ne changeons pas nos modes de vie, nous subirons des monstres autrement plus violents que le coronavirus. »
Pouvez-vous nous éclairer sur les liens qui existent entre l'état de santé de notre environnement et l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des maladies infectieuses pouvant se transmettre de l'animal à l'homme et nous indiquer les actions qu'il conviendrait de mener, non seulement pour mieux gérer les crises, mais aussi pour les anticiper et les prévenir ?
(Un document PowerPoint est projeté durant l'intervention de M. Jean-François Guégan.)
J'ai eu l'occasion d'être reçu à plusieurs reprises au Sénat au cours de ma carrière. Je pense en particulier à l'audition organisée par Mme Fabienne Keller dans le cadre du rapport d'information sur les nouvelles menaces des maladies infectieuses émergentes en 2012. J'ai moi-même écrit un rapport sur ces questions avec le professeur Catherine Leport.
Je suis un ancien chercheur, directeur de recherche de classe exceptionnelle à l'Institut de recherche pour le développement (IRD), avec une connaissance importante des zones intertropicales où j'ai toujours mon activité. À l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae), je m'occupe des interfaces entre écosystèmes naturels, biodiversité, développement de l'agriculture et de l'élevage et risques sanitaires, dont le risque infectieux émergent.
Je vous présenterai quelques flashs sur ce que l'on connaît aujourd'hui des maladies infectieuses émergentes, notamment le risque épidémique et pandémique pour l'Europe, mais aussi de manière beaucoup plus globale.
Ces dernières années, de nombreuses maladies infectieuses émergentes sont dues à des virus : il suffit de penser à l'actuel coronavirus ou au virus Ebola. Toutefois, dans le monde, on meurt beaucoup plus de maladies d'origine bactérienne que d'infections dues à des virus. On pense que les virus se dispersent et se transmettent beaucoup plus. Ce n'est absolument pas vrai : la bactérie responsable de la coqueluche humaine est tout aussi transmissible et contagieuse qu'un virus comme celui de la rougeole.
Par ailleurs, on observe beaucoup plus d'agents infectieux d'origine zoonotique, ou animale, que d'agents à transmission vectorielle, par exemple le paludisme, d'agents contagieux ou de maladies d'origine environnementale, par exemple la bactérie responsable du tétanos. En résumé, nous avons aujourd'hui beaucoup plus de maladies d'origine à réservoir qui affectent et infectent les populations humaines, avec une accélération de ce phénomène depuis trente à quarante ans.
Que se passe-t-il dans les écosystèmes naturels ? Il y a tout d'abord un cycle enzootique, qui s'appelait par le passé « cycle sylvatique », car il se déroule la plupart du temps en forêt. Un certain nombre d'organismes sont abrités dans la diversité biologique, qu'elle soit d'origine tempérée ou tropicale : des centaines de millions, voire des milliards de micro-organismes y circulent. Il s'agit de formes non pathogènes, plutôt bénéfiques, des commensaux de l'animal. La destruction des forêts a pour conséquence de mettre en contact des animaux, notamment des animaux de la forêt et des animaux d'élevage domestique, qui vont se rapprocher des populations humaines et transmettre leurs micro-organismes soit aux animaux qu'ils rencontreront, soit à l'homme.
Depuis 50 à 60 ans, 75 % des nouvelles infections apparues chez l'humain sont d'origine animale zoonotique, alors que, dans l'histoire des infections et des parasitoses humaines depuis environ le néolithique, 62 % de maladies infectieuses et parasitaires humaines étaient d'origine animale. On note donc une importante accélération de ce phénomène de passage de micro-organismes de l'animal sauvage vers les populations humaines, laquelle est due à une augmentation des contacts entre les uns et les autres.
On note une augmentation d'espèces virales décrites par la science et la médecine. Cette observation peut se faire à tous les niveaux : pour les bactéries, comme pour les champignons parasites. On le doit évidemment à deux phénomènes essentiels : d'une part, les progrès très importants de la biologie moléculaire, qui permettent aujourd'hui, à travers du séquençage massif, de décrire de nombreuses espèces de virus, de bactéries ou de champignons parasites ; d'autre part, le fait que de nombreuses disciplines, de nombreux chercheurs et de nombreux médecins travaillent sur ces sujets.
La plupart du temps, ces recherches sont effectuées sur la base de séquençages modernes, de séquençages moléculaires, qui décrivent des séquences de virus. Cela n'implique pas que ces virus et bactéries soient pathogènes ou hautement pathogènes pour l'humain. Il s'agit d'une forme de taxonomie moderne de description de nouvelles espèces virales et bactériennes. Aujourd'hui se développe une infectiologie exploratoire vouée à la description d'un certain nombre de nouvelles espèces de virus, de bactéries, de protozoaires mais aussi de champignons parasites. La diversité biologique abrite, en réalité, des centaines de millions, voire des milliards de micro-organismes de cette nature.
Grâce à un travail réalisé aux États-Unis, on a pu localiser les zones où il reste à décrire des virus, dont certains pourraient à l'avenir se révéler pathogènes pour l'espèce humaine, mais aussi pour d'autres animaux. L'Amérique centrale et le nord de l'Amérique du Sud sont ce qu'on appelle des hotspots, c'est-à-dire des points chauds pour la découverte de nouvelles espèces de virus.
Un travail très récent que je viens de publier en collaboration a permis d'établir une carte du monde présentant les zones aujourd'hui les plus sensibles à de nouvelles infections dues à une origine zoonotique. Alors que les travaux précédents se concentraient essentiellement sur la présence et la distribution de virus d'origine animale potentiellement pathogènes pour l'espèce humaine et pour les animaux, nous avons inclus des paramètres qui sont souvent oubliés : la distribution des grands biomes forestiers dans le monde, la diversité biologique qu'on y trouve, qui est en fait le réservoir de ces virus et bactéries, mais aussi la densité humaine, qui est un facteur extrêmement important, l'intrusion humaine, c'est-à-dire tous les phénomènes de pénétration des populations humaines dans les grands biomes forestiers, notamment pour le développement de l'agriculture et de l'élevage ; enfin, la pauvreté des populations.
On découvre ainsi que les zones à fort risque de transmission de nouvelles infections d'origine animale aux populations humaines sont différentes de celles qui ont été identifiées par les travaux précédents : les dimensions d'exposition des populations mais aussi de vulnérabilité au travers de paramètres de pauvreté sont extrêmement importantes pour comprendre la transmission infectieuse.
En d'autres termes, un virus ou une bactérie ne font pas la maladie. Il faut que des paramètres s'entrecroisent, en particulier, l'exposition à travers les pratiques et les usages - la chasse, mais aussi le développement de l'agriculture et de l'élevage, surtout dans les zones intertropicales - et la pauvreté. La pauvreté et la vulnérabilité des populations ont toujours fait le lit des infections. C'est un paramètre extrêmement important à prendre en compte et que l'on oublie généralement.
Un travail réalisé en Guyane française, dans le cadre d'un labex pour lequel j'avais la responsabilité des recherches en santé, a fait apparaître ce qui se passe quand, près d'une forêt primaire, s'installe une population, se développe une activité humaine et se crée une grande ville. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années sur la mycobacterium ulcerans, qui est responsable de l'ulcère de Buruli.
Au cours de phénomènes de déforestation, l'écosystème est complètement perturbé. Les communautés d'espèces qui se retrouvent dans ces habitats déforestés sont désorganisées : certaines espèces disparaissent, en particulier les formes prédatrices, ce qui entraîne la pullulation d'espèces qui sont normalement les proies de ces prédateurs. Cette prolifération favorise le développement de la mycobacterium ulcerans, présente, comme d'autres agents infectieux, dans tous les écosystèmes aquatiques intertropicaux, et provoque cette maladie, qui se manifeste par des ulcérations, avec une progression à feu bactérien sur la peau et une toxine qui détruira l'épiderme et le derme, mettant les muscles à nu, provoquant des infections secondaires et, à terme, la mort des individus qui la contractent.
Le phénomène de déforestation, notamment dans les zones intertropicales, selon un phénomène de cascade d'effets, peut entraîner la pullulation d'un micro-organisme dans les environnements. Alors que ce micro-organisme est depuis la nuit des temps dans ces écosystèmes, les perturbations humaines vont créer une augmentation de sa charge dans l'environnement. Les pratiques et les usages - la pêche ou encore la récupération de crabes de mangrove - exposeront les individus à ce germe microbien.
Il a été possible de déterminer les explications au phénomène d'émergence de maladies d'origine environnementale ou zoonotique. Parmi elles figurent le changement d'usage des sols et l'intensification agricole. Ces deux paramètres sont en quelque sorte les starters au déclenchement de maladies infectieuses émergentes. En effet, la modification de l'usage des sols - pensons à la déforestation dans les grands biomes intertropicaux - expose l'homme à des germes installés là depuis des milliers, voire des millions d'années, qui sont une composante de la diversité biologique. Par ses pratiques d'agriculture et ensuite d'élevage, l'homme est mis en rencontre avec ces germes qui provoquent ces nouvelles infections humaines mais aussi animales.
En fonction des pays et des régions, les différents paramètres peuvent avoir plus ou moins d'importance. Au Brésil, ce sont surtout les changements d'usage des sols et l'intensification de l'agriculture et de l'élevage. En Afrique centrale, ce sont pour beaucoup les pratiques de chasse, en particulier la chasse traditionnelle, qui sont responsables de la transmission infectieuse à partir de germes microbiens d'origine animale ou environnementale. Tout cela peut changer avec le temps : au Cameroun on observe une déforestation massive, en particulier pour le développement du palmier à huile. Ainsi, en Afrique, le phénomène de déforestation prendra de l'importance dans l'explication du phénomène émergentiel.
Tout épidémiologiste vous dira que la taille de population, qui détermine le nombre d'individus potentiellement sujets, est un paramètre extrêmement important pour la transmission infectieuse. Le sens de diffusion se fera beaucoup plus facilement et rapidement dans les grandes villes que dans les petites villes : plus la densité de population est élevée, plus la transmission est importante, notamment pour les agents à transmission contagieuse de personne à personne ou pour les maladies à transmission vectorielle. La densité de population détermine ce que l'on appelle le taux de contact.
Autre paramètre, la connectivité entre les différentes populations, c'est-à-dire les flux d'individus à travers les transports, en particulier les transports de produits et d'animaux - il circule aujourd'hui dans le monde beaucoup plus d'animaux, notamment d'animaux domestiques et d'élevage, que d'individus. Cela va déterminer les flux et l'intensité des flux en personnes mais aussi en germes microbiens. C'est ce qui s'est passé avec la pandémie à Covid-19 mais à une échelle beaucoup plus globale.
Aujourd'hui, nous devons intégrer en épidémiologie ce que j'appelle l'épidémiologie écologique et que l'on appelle les continuités biodiversité-ville. Les contacts entre les grandes villes - qui constituent des zones de forte biodiversité en organismes mais aussi en micro-organismes, puisqu'il y a un lien entre les deux, notamment dans le monde intertropical - et des zones à forte biodiversité favoriseront une plus grande transmission infectieuse du compartiment animal sauvage vers les populations humaines par rapport à des configurations où les zones de forte diversité biologique en micro-organismes seront plus éloignées de cités et de villes de taille plus petite.
La contiguïté entre la biodiversité, l'agriculture et l'élevage et la ville, c'est exactement la conformation qui est en train de se réaliser depuis 30 ans, en particulier en Asie du Sud-Est. Dans les zones périurbaines se sont développées des zones de production agricole et d'élevage qui sont à la fois en contact avec les zones de forte biodiversité dans les grands biomes des zones intertropicales, riches en micro-organismes, et la cité, riche en population humaine. Les zones d'interface favorisent les ponts de l'un à l'autre, c'est-à-dire les passages des animaux sauvages vers les animaux domestiques et d'élevage, le passage aux agriculteurs et aux éleveurs, lesquels vendent leurs produits au centre des villes et y transmettent les infections.
Au nord-est de Bangkok, on trouve des biomes forestiers, qui conservent de la diversité biologique et des micro-organismes, mais aussi des zones d'élevage et d'agriculture, qui sont à la fois au contact de ces grands biomes forestiers et à proximité des grandes villes, puisque ces zones périurbaines visent à nourrir les populations au centre des villes. On peut mesurer la densité de population et d'animaux d'élevage au fur et à mesure que l'on s'éloigne de Bangkok. Évidemment, en centre-ville, on trouve peu d'élevages de porcs ou de poulets ; à une quinzaine de kilomètres de là, dans les zones périurbaines, on constate de fortes concentrations de ces animaux d'élevage ; au fur et à mesure que l'on s'en éloigne et que l'on se rapproche des grands biomes forestiers intertropicaux, ces concentrations d'élevages diminuent.
On a donc organisé des écosystèmes anthropisés, qui favorisent la transmission infectieuse des grands biomes naturels vers les populations humaines par l'intermède de zones périurbaines où se sont développés l'agriculture et l'élevage ces 30 dernières années.
Je terminerai en formulant quelques constats sur le dispositif de recherche national.
Je considère que nous avons armé notre système de recherche national pour comprendre les infections, les épidémies et les pandémies, mais pas pour les anticiper, c'est-à-dire faire de la veille et de l'action en amont. C'est beaucoup moins vrai à l'étranger, notamment chez nos collègues anglo-saxons.
Notre dispositif de recherche est constitué de casernes de pompiers. Or le pompier a absolument besoin que le feu soit généré pour pouvoir l'éteindre. En d'autres termes, notre système de recherche compte de nombreux virologues et bactériologistes, qui ont besoin que le virus sorte du bois, permettez-moi cette expression, pour pouvoir l'analyser. Nous sommes très peu à essayer de comprendre les raisons favorisant ces émergences. Cela demande un travail de terrain et un travail au long terme, alors que la recherche aujourd'hui exige - j'insiste sur ce verbe - une production dans l'immédiat.
Par ailleurs, nos modes de compréhension doivent évoluer car nous sommes dans des systèmes complexes, non linéaires, qui sont très proches de systèmes chaotiques où l'approche expérimentale est difficilement possible.
Lorsque vous faites de la biologie, passer à l'approche expérimentale pour démontrer qu'une cause est responsable d'une conséquence, c'est le Graal ! Il faut développer l'expérimentation pour démontrer plusieurs fois ce rapport de cause à effet. Les systèmes non linéaires ne permettent pas de développer l'expérimentation, d'autant que l'approche expérimentale se fait au laboratoire et réduit la dimension des possibles à des objets et à des dimensions de temps et d'espace que l'on peut analyser. J'ai pour habitude de dire que la compréhension ne dépasse pas alors les bordures d'une boîte de Petri. Aujourd'hui, ces phénomènes sont à très large échelle, voire à une échelle globale ; cette pandémie le montre bien. Par conséquent, on ne peut développer l'expérimental et l'expérimentation. Nous sommes là face à un important dilemme.
En France, ces sujets deviennent très rapidement un problème de médecine, alors qu'ils ne le sont absolument pas au départ. Nous sommes, en effet, dans des interfaces entre des problèmes d'écologie, d'agriculture, d'élevage, mais aussi de sociologie, d'anthropologie, de démographie. Les causes en amont sont au-delà de la seule médecine. Or la France a tendance à refermer ces sujets autour de la médecine.
Puisque la plupart de ces phénomènes d'émergence sont localisés dans les zones intertropicales - il y a très peu d'infections émergentes dans les zones tempérées, nous devons développer des recherches dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux dans ces régions pour comprendre les tenants et aboutissants de cette crise d'ampleur mondiale, car il y en aura d'autres ! En effet, les biomes naturels regorgent de micro-organismes, dont il est vain de vouloir estimer le nombre.
L'appareil de recherche national pour le développement a été amputé ces dernières années. Il faut absolument repenser nos politiques de développement dans le cadre des objectifs de l'agenda 2030 des Nations unies. À mon avis, l'Agence française de développement est très en retard sur ces approches et perspectives par rapport à d'autres agences de développement. Ce n'est qu'à la fin des années 2010 qu'elle a pris en considération ces phénomènes, que l'on appelle la sustainability sciences, la science du développement ou de la soutenabilité.
L'agriculture et l'élevage intensifs étant des moteurs importants de l'amplification et de la transmission infectieuses, la France et l'Europe doivent initier les approches et un accompagnement de recherche et d'expertise sur la transition agricole, eu égard aux risques sanitaires. Le risque sanitaire existe, même s'il est d'origine externe à l'Europe ; il pourra arriver très rapidement sur notre territoire, infecter des troupeaux et des élevages entiers, et certaines formes pourront aussi passer aux populations humaines.
Il faut mettre en place des modèles témoins en territoires et comprendre leur évolution. C'est l'approche actuelle de l'Inrae. Il m'a été demandé de les développer au travers d'un programme prioritaire tri-institutionnel Inrae-Cirad-IRD pour intégrer la problématique du risque sanitaire dans le cadre de la transition agricole internationale.
On ne peut plus, aujourd'hui, pratiquer les développements agricoles et d'élevage sans prendre en compte le risque sanitaire, tel que nous le comprenons aujourd'hui. Il faut un appui très fort des décideurs publics sur ces orientations.
En France, l'hyperspécialisation fait que nous avons un positionnement très complexe s'agissant de la recherche transversale multidisciplinaire, qui n'a pas été soutenue au cours des 30 dernières années. Ainsi mes propres recherches sont-elles financées par de grandes agences nord-américaines.
Cette crise a mis en évidence la complexité organisationnelle des institutions nationales françaises, y compris de recherche. J'ai été sollicité sept fois par différentes institutions pour rédiger une note sur le même sujet. On est confronté à une sorte d'agitation brownienne caractérisée par un manque de créativité et de multiples demandes non concertées. Alors que nous possédons le Centre de synthèse et d'analyse sur la biodiversité (Cesab), cet organisme ne dispose pas de moyens financiers suffisants car nous avons, en France, une compréhension très analytique des phénomènes, qui laisse peu de place aux approches de synthèse, lesquelles viennent souvent contredire la connaissance perceptionnelle.
Le rapport sur les maladies infectieuses émergentes, que j'ai établi en 2011 avec le professeur Catherine Leport, infectiologue, explique très bien ce qui se passe à l'heure actuelle.

L'année 2020 devait être une grande année de la biodiversité avec le Congrès mondial de la nature et la COP 15 en Chine. Or, la pandémie entretient des liens importants avec notre environnement et la biodiversité.
Dans votre présentation, vous n'avez pas évoqué la Chine, alors que le Covid-19 y trouve son origine. Quels liens existe-t-il entre l'épidémie et le mode alimentaire des Chinois ? Ne convient-il pas d'accentuer les efforts pour faire converger tous ces sujets ? Quelles propositions pourriez-vous avancer en la matière ? Je pense notamment au développement d'aires protégées. Comment lutter contre la déforestation ? Vous n'avez pas non plus évoqué le trafic d'animaux sauvages et son impact sur la propagation du virus.
Vous avez abordé la nécessité d'avoir une recherche plus importante dans le domaine de la biodiversité, laquelle devrait bénéficier d'une meilleure écoute de la part des décideurs.
Dernière question, comment expliquez-vous l'impréparation du monde face à cette pandémie, alors même qu'un certain nombre de signaux étaient perceptibles, tels que l'émergence du SRAS, le phénomène de la mondialisation et la rapidité des échanges ?
Pourquoi la Chine n'apparaît-elle pas sur les cartes que je vous ai montrées ? Tout simplement, les indicateurs utilisés pour les dresser ne tiennent pas compte de la chasse ou de la consommation de produits extraits de la diversité biologique.
Les pratiques de chasse sont toujours liées aux populations les plus pauvres du monde. Elles peuvent être à l'origine d'un trafic plus ou moins fructueux.
Dans les cartes produites dans la littérature scientifique internationale, la Chine, à l'exception du sud de la Chine, ne figure pas dans les hotspots de diversité biologique en maladies infectieuses émergentes.
S'agissant de la biodiversité, vous l'avez bien compris, toutes les interfaces que nous produirons en tant que société humaine, les usages de la biodiversité, seront toujours des pratiques à risque. Je serais bien prétentieux de répondre seul, la solution devant être organisée aux niveaux national et international. Toutefois, selon moi, il convient de créer des sanctuaires de diversité biologique et d'éviter au maximum les expositions.
La médecine a oublié ce qu'est un risque : il s'agit de la multiplication de menaces ou dangers avec des expositions dans le cadre d'une vulnérabilité. En effet, si vous n'êtes pas exposé à un danger, il n'y a pas de risque.
Il faut donc éviter les expositions dans le cadre, en particulier, de la pratique de la chasse mais aussi du tourisme. Ainsi, des virus de la rougeole, transmis par le biais de touristes, ont-ils exterminé des populations entières de grands singes. Le phénomène fonctionne donc dans les deux sens.
Comment lutter contre la déforestation ? Il s'agit d'un sujet majeur non seulement pour la problématique du changement climatique, mais aussi pour le développement de l'agriculture et de l'élevage. On en revient là à la création de grands espaces naturels sanctuarisés.
C'est moins la consommation de viande de brousse boucanée que les contacts avec les animaux chassés qui expliqueraient les transmissions infectieuses de l'animal à l'humain. Les blessures, les expectorations ou les fluides - urine, bave - peuvent provoquer la contamination du chasseur.
Les deux virus responsables du sida, HIV1 et HIV2, proviennent respectivement du chimpanzé et du singe vert d'Afrique de l'Ouest. On dit qu'ils auraient été transmis à l'humain par la consommation de viande de brousse. En réalité, nous n'en savons rien ! Lors des premières contaminations par le virus du sida dans les années 1920 au sud-est du Cameroun, personne n'était là pour faire une photo de l'événement.
D'ailleurs, d'après toutes les études réalisées sur ce sujet, notamment à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, la viande saisie dans les aéroports bruxellois et français n'a rien révélé s'agissant de la présence de virus. Cela signifie non pas que ces particules virales n'existent pas, mais que les techniques moléculaires utilisées ne les révèlent pas si elles sont à des densités extrêmement faibles.
Quant au trafic d'animaux sauvages, il s'agit d'un problème réel. Je pense notamment à l'utilisation de certains organes, des os ou des écailles entrant dans la pharmacopée traditionnelle chinoise. Je pense aussi aux trafics d'animaux sauvages - petits rongeurs, écureuils de terre - destinés à alimenter les nouveaux marchés des animaux de compagnie. Ils ont été responsables de l'introduction, dans les années 2003 à Atlanta, du virus de la variole du singe, qui est très pathogène.
La chasse et les trafics d'animaux sont toujours associés à des populations extrêmement pauvres. Il s'agit donc d'une véritable problématique de développement durable, dans la mesure où on ne peut pas interdire la chasse aux populations des forêts africaines ou d'Amérique du Sud et centrale, si on ne trouve pas les moyens de développer une agriculture leur permettant d'assurer leur existence.
Il s'agit d'ailleurs d'un sujet d'anthropologie car je ne suis pas sûr que les populations amérindiennes qui ont une pratique de chasse traditionnelle aient été plus affectées que d'autres populations par des virus ou des bactéries mortelles.
Sur ce qui concerne notre impréparation, nous faisons face au syndrome du nuage de Tchernobyl, qui s'arrête à la frontière germano-française. En médecine, comme dans tout domaine d'activité, il existe des sciences nobles et des sciences moins nobles. Toutes les recherches en matière infectieuse - l'infectiologie, la santé publique, l'épidémiologie - n'ont pas été privilégiées en France ; les sciences plus nobles disposent d'une place hégémonique. On observe la même chose en biologie : un virologue a beaucoup plus de prestige qu'un bactériologiste. Ainsi, au sein même de la médecine, bien des gens n'ont pas cru que nous étions possiblement vulnérables à de nouvelles infections et parasitoses, estimant que nous trouverions les moyens de les arrêter ou de nous guérir. En réalité, pour développer un vaccin, il faut compter de 2 ans à 12 ans, et plutôt 12 ans que 2 ans ! En effet, il faut créer le vaccin, le tester, puis le commercialiser : c'est là que ça achoppe la plupart du temps. Par conséquent, selon la médecine, l'espèce humaine n'est plus du tout vulnérable à ce type de risques, qu'elle a les moyens de stopper voire d'éradiquer.

L'épidémie actuelle appartient au groupe des maladies zoonoses, qui lie espèces sauvages, animaux domestiques et humains. Je vous remercie de la clarté de vos explications et des illustrations que vous avez partagées avec nous.
Depuis des années, nous affrontons d'autres maladies de ce type, telles que Chikungunya, Ebola ou H1N1. Beaucoup d'autres n'ont pas fait la une de l'actualité mais on sait bien qu'elles sont présentes. Leur nombre est en constante augmentation et il nous faudra peut-être apprendre à vivre avec des épisodes épidémiques de plus en plus fréquents.
Ces espèces virales sont parfois inoffensives pour l'homme mais le pourcentage de risques pour les populations est réel. Dans ce contexte, vous avez déploré la perte d'une culture de la prévention des risques épidémiologiques en France, avec des médecins, des étudiants et des décideurs politiques qui pensaient parfois que ces maladies tropicales et infectieuses n'étaient pas une menace.
Vous venez d'ailleurs d'évoquer le manque de prévention dans le cadre de nos dispositifs de recherche nationaux, qui induit une baisse non seulement des enseignements épidémiologiques et, donc, des connaissances mais aussi des crédits budgétaires en faveur de la recherche contre ces maladies.
Pensez-vous qu'il faille modifier nos enseignements de médecine ? De manière plus générale, la formation destinée à mieux prendre en compte le lien entre santé et environnement ne doit-elle pas être développée plus volontairement ? Quelles sont vos pistes de réflexion en la matière ? Qu'attendez-vous des évolutions, voire des bouleversements de la recherche pour faire face aux pandémies à venir ?

Monsieur le professeur, dans un article que vous avez récemment publié, vous évoquez la nécessité de promouvoir une nouvelle organisation mondiale plus respectueuse des engagements de l'agenda 2030 des Nations unies. Les collectivités locales sont des acteurs à part entière pour atteindre cet objectif, notamment au travers de l'élaboration des plans climat-énergie territoriaux ou encore la mise en oeuvre d'une politique sur les espaces naturels sensibles, qui concernent 73 % des départements français.
Quelle place peut occuper, selon vous, l'échelle territoriale locale dans ce nécessaire changement mondial ? Les moyens accordés par l'État sont-ils suffisants à la fois en termes humains et financiers ?

Il semblerait que nous ayons entrouvert la boîte de Pandore d'où s'est échappé le coronavirus. Refermer cette boîte en modifiant nos pratiques humaines demandera du temps, même si le programme de développement durable des Nations unies à l'horizon 2030 est une bonne chose.
Le pompier en chef, c'est quand même l'Organisation mondiale de la santé (OMS). La pandémie de grippe H1N1 a été la première pandémie du XXIe siècle, et la première depuis l'adoption par 196 pays du règlement sanitaire international de l'OMS. À l'époque, on s'enorgueillissait de la robustesse de ce règlement. Aujourd'hui, il semble dépassé. Faut-il le modifier ? Selon quelles modalités ? Malgré la complexité du sujet, peut-on modéliser la propagation d'une épidémie ?
Un professeur d'infectiologie français qui s'appelait Charles Nicolle avait l'habitude de dire qu'un agent microbien devient pathogène par circonstance, et non pas par nécessité. C'est l'humain, par ses activités et ses pratiques, qui organise son transfert et le rend pathogène.
J'enseigne en médecine à Montpellier, à Angers, ainsi qu'à Paris. Je me rends compte que la perte de connaissance est importante sur les sujets qui nous intéressent, c'est-à-dire l'environnement et la santé. Il serait pertinent que certaines écoles de médecine se spécialisent sur ces sujets. On réfléchit aujourd'hui sur l'apport de la théorie de l'évolution dans la compréhension de la genèse de certaines maladies infectieuses ou chroniques. Il convient donc de former de jeunes médecins dont les esprits soient plus orientés vers des approches évolutives et écologiques. Ainsi, dans ma spécialité, on ne cesse d'alerter sur la résistance aux antibiotiques. Pourtant, on continue de produire ces molécules !
Pour ma part, j'ai été formé, dans les années 1980, dans des unités d'enseignement en parasitologie et en pathologie, par des médecins qui étaient aussi de très grands naturalistes et connaissaient bien le terrain. De nos jours, il est intéressant de le constater, on retrouve ces médecins dont la vision est globale dans les services de santé, les ONG et aussi à l'IRD. Ils ne font pas seulement de la biologie, mais travaillent sur des problèmes d'interface, par exemple les liens entre le niveau de pauvreté des individus et les parasitoses.
Je préconise donc un retour au terrain, pour comprendre la réalité du monde. Traditionnellement, les médecins français partaient d'abord travailler dans des ONG, ce qui leur permettait de connaître vraiment ces problématiques. Aujourd'hui, la médecine est devenue très individualisée, très technologique, très nucléaire, très réparatrice. Ce sont les gens sur le terrain qui peuvent diagnostiquer très rapidement les premiers cas et lancer des alertes. Cela est vrai également pour les vétérinaires.
Il faut aussi former à ces pratiques nos partenaires des pays du Sud, car il existe d'importants problèmes de diagnostic. Ainsi, nous avons des spécialistes en Guyane française capables de détecter les ulcères de Buruli. Or il n'y a aucune raison de penser que la maladie n'est pas présente ailleurs, par exemple au Brésil, puisque les mêmes écosystèmes hébergent les mêmes germes microbiens. Pourtant, la maladie est cataloguée au Brésil comme une leishmaniose cutanée.
La prévention et la science épidémiologique doivent faire l'objet d'un travail de fond. Je vous l'ai dit, je passe mon temps dans les grandes écoles de santé publique britanniques ou nord-américaines, qui travaillent sur les déterminants de santé, alors que la France possède une culture curative, où les aspects santé et environnement ont une acception extrêmement réduite : il s'agit des maladies chroniques, de la toxicologie et de l'écotoxicologie. Ce domaine s'est lui-même fermé à l'infectieux.
Il faut favoriser les approches de terrain avec nos partenaires, car les premiers garants du système d'alerte sont ceux qui seront aptes à déterminer au plus vite une infection. Bien entendu, ils ne doivent pas être muselés, comme on l'a vu en Chine.
S'agissant de l'échelle locale, l'Inrae, que je représente, est tout à fait favorable à des décisions prises en territoire en faveur de pratiques agricoles et d'élevage respectueuses des hommes et de l'environnement. Les trajectoires seraient définies par les communautés locales, puis analysées en fonction de leurs bénéfices et de leurs risques. Je le rappelle, l'agriculture et l'élevage intensifs sont facteurs de risque de transmission infectieuse. Le retour aux races animales me paraît essentiel car elles sont génétiquement garantes d'une plus grande résilience face aux infections et parasitoses. C'est également vrai dans le domaine végétal, où l'on parle de variétés. Il s'agit là de diversité biologique, plus exactement de diversité génétique, qu'il faut absolument réintroduire dans nos systèmes agricoles et d'élevage.
Il est donc nécessaire non seulement d'accorder la priorité aux échelles locales en la matière mais aussi d'instaurer des collaborations avec nos partenaires du Sud. Nous avons vu ces dernières années la création de jumelages entre des villes ou des villages situés, d'une part, en France et, d'autre part, au Mali ou au Sénégal.
S'agissant du rôle de l'OMS et du règlement sanitaire international, c'est aussi un problème politique. Selon moi, les organisations internationales ont perdu de la puissance. Pour ma part, je suis catastrophé par la quasi-absence de l'OMS dans les discours tenus à l'heure actuelle. Au fil du temps, ces institutions ont été de moins en moins bien dotées. Sans doute convient-il de réfléchir à leur réorganisation à la lumière des dernières avancées scientifiques. Ainsi, à chaque fois qu'il y a eu un département sciences environnementales et santé à l'OMS, les choses ont toujours très bien fonctionné. La santé des humains, des animaux et des plantes dépend des conditions environnementales dans lesquelles les populations vivent.
Par ailleurs, nombre de ces institutions sont dirigées par des personnes formées dans les années 1960 à des pratiques de zootechnie. Elles n'ont pas assimilé toutes les nouvelles notions. Par exemple, il est très important de considérer le rôle que l'élevage mondial peut avoir sur le changement climatique. La France et l'Europe doivent agir en faveur d'une reprise en main de ces institutions. L'OMS, par exemple, a été très déstabilisée, notamment en Afrique, par les financements de grandes fondations, comme celle de Bill et Melinda Gates. C'est un sujet très préoccupant.
Peut-on modéliser la propagation d'une épidémie ? Nous sommes capables de produire des cartes. Le programme américain US Predict avait très bien prévu l'éclosion de cette épidémie. Il vient d'être arrêté tout simplement parce qu'il collaborait avec le laboratoire virologique de Wuhan. Nous manquons de ressources humaines. En France, nous ne sommes que quatre à six chercheurs seniors à travailler sur ces sujets, deux à trois seulement de manière spécialisée. Nous pourrions former une vingtaine de jeunes chercheurs mais nous avons du mal à obtenir des crédits, car nous ne produisons que de la science de corrélation. Qu'est-ce que le fait scientifique quand on ne peut pas démontrer par l'expérimentation que la cause est à l'origine de la conséquence, cette conséquence devenant elle-même la cause d'une autre conséquence dans un système linéaire chaotique ? Je considère que le formalisme de la science actuelle ne permet pas de répondre à ces questions planétaires.
Nous sommes trop peu nombreux pour modéliser de manière suffisante. Les chercheurs britanniques et américains dominent le sujet, même si quelques Français collaborent avec eux.

Vous préconisez de privilégier l'agriculture et l'élevage locaux. Avec ma collègue Nelly Tocqueville, nous avons mis en place un groupe de travail sur les enjeux de l'alimentation durable et locale à l'aune de cette crise sanitaire. La Malaisie offre un exemple intéressant, où la déforestation et l'élevage intensif de porcs ont favorisé l'émergence du virus Nipah. Les autorités doivent encourager une consommation responsable en misant sur le local. Quand les consommateurs choisiront d'acheter de la viande, de l'huile ou des farines issues des petits producteurs, l'industrie agro-alimentaire sera forcée d'évoluer.
Lors de leur audition, les représentants de l'Inrae ont mis en avant le rôle des projets alimentaires territoriaux. Considérez-vous que la dimension sanitaire doit faire partie des items les plus importants au sein de ces projets ? Et dans quelle mesure permettront-ils de mieux anticiper les futures épidémies ?

Tous les virus ne déclenchent pas une pandémie mais l'action humaine la favorise en contribuant à l'appauvrissement des ressources, à la dégradation de la biodiversité et à l'artificialisation des sols, sans parler de l'autre facteur important qu'est la pauvreté. Quels remèdes environnementaux privilégier pour prévenir les nouvelles épidémies ? Notre politique agricole ne devrait-elle pas développer la polyculture, limiter l'élevage industriel ou bien encore faire une place plus large aux protéines végétales ? Ces pistes nous permettraient également de mieux faire face aux aléas climatiques.
La recherche sur la biodiversité a encore beaucoup à explorer car on estime que 75 à 80 % du système vivant restent non répertoriés, qu'il s'agisse de bactéries, de champignons ou de virus. Comment faire mieux ?

La relation entre la pandémie et la destruction des écosystèmes n'est plus à établir. La crise actuelle est une crise écologique globale et il n'est plus possible de nier l'impact négatif d'une pression humaine accrue sur notre biodiversité : elle a modifié significativement 75 % des écosystèmes terrestres et plus de 65 % des écosystèmes marins.
Les réticences face au Green New Deal démontrent une fois encore que l'urgence climatique n'en est finalement pas une pour de nombreux États. L'épidémie actuelle est une crise écologique que l'on pourrait qualifier d'« endogénéisée ». En perturbant les chaînes alimentaires des espèces animales et en provoquant des changements comportementaux, l'action humaine augmente les risques de transmission pathogènes aux humains. Quels risques devons-nous le plus redouter face au réchauffement climatique, entre l'import de nouvelles maladies infectieuses par des insectes vecteurs dans des zones auparavant épargnées et la libération de pathogènes disparus pour lesquels nous n'avons plus d'anticorps ?
Nous appelons de nos voeux la définition de mesures novatrices afin de contrer le changement climatique en réduisant notre empreinte environnementale. Quels principes de précaution préconisez-vous en matière sanitaire ?
Le virus Nipah est transmis par des chauves-souris géantes qui vivaient initialement en Indonésie. La déforestation pour la plantation de palmiers à huile les en a chassées, de sorte qu'elles ont trouvé refuge à Singapour, en Malaisie et au Bangladesh. Elles disséminent à travers leurs urines des particules d'un virus extrêmement virulent et pathogène, mortel à 70 %. Or en Thaïlande, on continue à fertiliser des manguiers de manière artificielle pour augmenter la production, alors même que cela attire ces chauves-souris, très friandes de mangues. Elles viennent les consommer dans les vergers et y déposent des particules virales qui se transmettent ensuite aux porcs puis aux éleveurs et aux agriculteurs. Voilà comment on augmente le risque de contamination à travers des pratiques agricoles de fertilisation. Des équipes du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) ont analysé cet exemple. C'est tout à fait le type de recherches que nous préconisons, fondé sur un travail avec les populations locales qui sont exposées dans leurs pratiques.
Quant aux projets alimentaires territoriaux, ils doivent effectivement inclure une dimension sanitaire au sens large, en prenant aussi en compte les maladies chroniques. Nos collègues de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) ont mené un travail original qui montrait que la distribution des cas de la maladie de Parkinson était liée au développement de certaines pratiques agricoles, comme l'utilisation de pesticides ou d'insecticides. On observe ainsi les taux de maladie de Parkinson les plus élevés en France dans certains vignobles très appréciés. Dans ces mêmes régions, la biodiversité en oiseaux et en insectes a tendance à diminuer de manière importante. Et pourtant, alors que la cause est la même, il reste difficile d'établir le lien entre les risques pour la santé humaine, la pollution des écosystèmes et la perte de la diversité biologique.
Il y a deux ans, dans le cadre du Plan national santé environnement, nous avions fait remonter des documents préconisant une compréhension en territoires des aspects sanitaires des populations humaines. Il s'agissait de prendre en compte les différents types d'agriculture, les modes de consommation et les risques sanitaires associés. Voilà à quoi il faut tendre. En mettant en place des observatoires, nous pourrons établir des corrélations qui nous en diront beaucoup. Si l'on observe un taux de maladie de Parkinson ou un taux de cancer élevé dans un même territoire et à un même moment, alors que les sols et les eaux sont riches en pesticides, fongicides et autres polluants, il faut pouvoir en tirer des conclusions.
Il est essentiel de réintroduire de la diversité dans la politique agricole française et européenne. Pour l'instant, nous n'utilisons que six à sept variétés végétales. Il suffirait qu'elles soient très sensibles à un virus ou à un champignon parasite qui serait introduit sur le sol français pour que tout le stock de production soit fragilisé. Plutôt que de fabriquer des clones, nous devons réintroduire de la diversité génétique à tous les étages. C'est une garantie et un premier rempart contre les virus.
Voyez ce qui se passe en Afrique, où l'on ne cultive plus qu'une seule variété de riz dans la partie ouest et centrale du continent. En créant des boulevards de rizières, on a favorisé la dissémination du virus de la panachure jaune du riz qui détruit plants et production. Pourtant, 30 ou 40 ans en arrière, rien qu'au Sénégal, on trouvait plusieurs variétés de riz, chacune adaptée aux conditions différentes de manque d'eau.
Concernant la limitation de l'élevage intensif, on parle bien de transition agricole. J'ai moi-même travaillé dans l'industrie agro-alimentaire du Grand Ouest, pendant deux ans, au nord de Vannes. Si on a mis des animaux en chambre d'élevage, c'est aussi pour les mettre sous cloche, c'est-à-dire les protéger de tout danger infectieux. Désormais, le retour des troupeaux dans les champs pose problème. Comment évaluer le risque d'une nouvelle menace sanitaire, notamment infectieuse ? Les ovins et les caprins, pour la plupart en élevage semi-extensif, sont très sensibles à des infections ou des parasitoses qu'on ne sait pas soigner. L'évolution doit se faire progressivement, avec un passage de transition, sans changement immédiat ou radical. Beaucoup d'études ont été réalisées sur la transmission des grippes aviaires. En Inde, ce ne sont ni les grands élevages ni les petits élevages qui sont le plus à risque de transmission mais les élevages de poulets. Il faut développer la recherche agricole pour comprendre ce genre de phénomènes.
Le changement climatique et les maladies infectieuses constituent mon deuxième sujet de travail. Il m'a conduit à collaborer avec des physiciens du climat, que ce soit au niveau français, européen ou international. La question a déjà fait couler beaucoup d'encre, pas forcément toujours à bon escient. On a parlé, par exemple, de la remontée du moustique tigre en France, à partir du sud de l'Europe jusqu'aux départements atlantiques et même au sud de Paris. Pourtant, le moustique tigre ne remonte pas à cause du changement climatique. Il embarque à chaque fois qu'un touriste venu visiter le sud de la France ouvre son coffre de voiture avant de repartir dans la région de Nantes ou d'Auxerre. Il embarque aussi dans les camions, le long des autoroutes, dans les containers cargo sur les trains et aussi les avions.
Un article a fait la synthèse des 450 à 500 publications portant sur le lien entre le changement climatique et les maladies infectieuses transmises par des vecteurs. Parmi ces travaux, 52 % montrent un effet significatif du changement climatique, ce qui signifie que 48 % n'en montrent pas ou bien concluent à un effet inverse. J'ai moi-même écrit un article sur Bamako en 2050 qui montre que la circulation du paludisme ne pourra plus se faire car il fera trop chaud et trop sec. Quoi qu'il en soit, l'article synthétique que je mentionnais montre que le sujet a donné lieu à beaucoup d'exagérations, alors qu'on n'en sait pas grand-chose. Sur les 52 % de publications qui concluent à un effet significatif du changement climatique, 90 % n'ont pris en compte que les variables bioclimatiques sans les confronter aux variables anthropologiques, sociologiques, nutritionnelles ou sociales. Or la taille des populations et la pauvreté restent des éléments essentiels pour comprendre la transmission des maladies infectieuses.

Les constats sur les enjeux de pauvreté et de dérèglement climatique sont nombreux mais nous manquons de réponses hiérarchisées. Quelles seraient les priorités immédiatement accessibles pour limiter le risque ? Faut-il faire porter l'effort sur la lutte contre le commerce illégal d'espèces vivantes ? Quelles espèces viser en particulier ? Faut-il interdire la consommation de viande de singe ou de chauve-souris ? Des négociations auront lieu dès l'année prochaine. Il y aura surtout la COP sur la biodiversité. Il faut faire des propositions.
Les politiques de développement françaises restent trop rares sur ces enjeux. Quelle stratégie pour mobiliser l'ensemble de la coopération scientifique française ? Il n'y a pas que les médecins qui ont un rôle à jouer. Les vétérinaires peuvent mener une action essentielle en matière de santé et d'environnement.

Dans cette crise, nous n'avons répondu qu'à l'immédiat. Il faut prévenir l'accélération des phénomènes épidémiques. Ne serait-il pas judicieux de créer des groupements de recherche pluridisciplinaires pour favoriser la transversalité ? La France ne gagnerait-elle pas à développer un laboratoire de ce type en Guyane ? De manière générale, avons-nous assez de laboratoires de recherche en virologie comparables à celui de Wuhan ? N'est-il pas temps de réinterroger la place du sauvage dans le monde ? La France est en première ligne dans son département guyanais. Elle devrait être force de proposition lors de la COP sur la biodiversité. Nous pourrions notamment quantifier les dimensions des zones sanctuarisées. Quelle place pour les prédateurs dont le rôle a été oublié ? Enfin, vous n'avez pas parlé de la mutation du virus qui pourrait aggraver la situation.
Ces sujets doivent être traités de manière collégiale. À titre personnel, je considère que le commerce des espèces est un problème essentiel à résoudre. La conversion vers le pangolin s'est opérée ces dernières années sans doute parce qu'il était devenu difficile pour les Chinois de s'approvisionner en cornes de rhinocéros. Depuis une quinzaine d'années, on favorise l'introduction sur le territoire américain de nouveaux petits animaux de compagnie, avec les risques que j'ai mentionnés lorsque j'ai évoqué la variole du singe.
De nombreux articles montrent qu'un parti pris biaisé s'est développé dans les travaux les plus récents de la recherche. Les scientifiques se sont centrés sur les virus des chauves-souris parce qu'ils disposaient d'un échantillonnage important de ces animaux. Désormais on en sait bien plus sur les virus que sur les bactéries, alors que celles-ci tuent bien plus que les virus. Il faut considérer toutes les populations à fort effectif et à faible diversité génétique concentrées dans certains espaces. Le problème est celui des interfaces entre la faune domestique et la faune sauvage. Se focaliser sur certaines espèces comme les chauves-souris, à la symbolique forte - elles représentent souvent le démon - n'est pas forcément de bonne méthode.
En tant qu'ancien chercheur de l'IRD, je connais très bien les terrains intertropicaux africains. Les propositions que j'ai faites pour élargir les enseignements concernant le développement dans cette zone se sont heurtées à des refus, au motif que ce n'était pas une priorité. De mon côté, je considère qu'une formation sur le terrain et de manière transversale est essentielle. Il faut bien faire comprendre aux populations, décideurs publics comme villageois que, s'il y a des intérêts bénéfiques au développement agricole et à l'élevage, des risques sanitaires existent aussi. D'où l'importance de les accompagner dans le développement des pratiques. C'est un travers de notre société de n'envisager que les bénéfices. Depuis 40 ans, la société française préfère voir la bouteille à moitié pleine et ignorer qu'elle est à moitié vide. Et, par ce choix, elle ne fait qu'accumuler les bouteilles vides tout en écartant ceux qui font preuve d'esprit critique. Subir les crises sans les comprendre est néfaste. Les crises sanitaires sont toujours des crises d'interfaces, liées aux pratiques agricoles et d'élevage.
La nécessité de développer des groupes de recherche interdisciplinaire se heurte à une tradition française trop extrême. Certes, on a besoin de spécialistes mais les scientifiques de culture transversale ont également un rôle à jouer. Les gens touche-à-tout sont précieux. C'est ce type de chercheur qui nous fait défaut. La pluridisciplinarité se développera grâce à des chercheurs curieux.
Notre laboratoire d'excellence en Guyane mène un très joli travail. Il est financé par l'État. Beaucoup des exemples que je vous ai présentés sont issus des travaux effectués en Guyane. Faut-il développer un laboratoire virologique à l'image de celui de Wuhan, en Guyane ? Il y a quinze ans, j'avais suggéré l'idée au ministère de la recherche. Eu égard à la position de la Guyane, ce laboratoire de haute performance pourrait être intéressant. Mais où le placer ? La question n'est pas résolue. En attendant, on a préféré créer le centre de recherche et de veille sur les maladies émergentes dans l'Océan indien (CRVOI), à la Réunion.
Quant à la mutation des virus, elle rend difficile la création des vaccins car elle est d'une capacité énorme et d'un caractère imprévisible. Nos collègues américains avaient prévu qu'il y aurait une crise en Chine sans doute liée à un coronavirus. Mais le virus n'a pas été détecté car c'est une recombinaison entre celui porté par les chauves-souris et celui porté par les pangolins.
La compréhension de ces sujets est au long terme. Le rôle essentiel de la déforestation dans les fièvres hémorragiques du virus Ebola n'est connu que depuis deux ans seulement. C'est en fin de circuit qu'on peut comprendre tout le phénomène. On commence par comprendre l'agent étiologique et on peut désormais séquencer un virus très rapidement - sept semaines seulement pour le coronavirus. Pour autant, on ne connaît rien des territoires d'émergence. C'est là qu'il faut développer notre compréhension. Les sciences vétérinaires ont tout leur rôle à jouer.

Nous vous remercions pour les éclairages que vous nous avez donnés sur les liens entre environnement et santé, notamment les conséquences de la déforestation sur la santé humaine. Au-delà des mots, il faudra des décisions politiques fortes.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo disponible en ligne sur le site du Sénat.

Nous entendons M. Guillaume Chevrollier au sujet des répercussions de la crise de Covid-19 sur les secteurs de l'eau et de la biodiversité. Certains sénateurs sont présents dans la salle ; d'autres assistent à la réunion en téléconférence.

Nommé « référent » par le bureau de notre commission, j'ai eu en charge depuis le début du confinement le suivi des impacts de la crise que nous traversons sur les secteurs de l'eau et de la biodiversité. Les impacts de la crise sanitaire sur la gestion de l'eau et de l'assainissement, services essentiels à la Nation, ont nécessité des réactions urgentes et immédiates. Je souhaite vous présenter le résultat des consultations que j'ai menées, essentiellement par visioconférence.
S'agissant du secteur de l'eau et de l'assainissement, qui représente environ 30 000 emplois directs et 13 milliards d'euros par an, les opérateurs et les collectivités territoriales ont démontré leurs capacités de résilience, en dépit des nombreuses difficultés opérationnelles recensées, en matière de garde d'enfants et d'organisation de la rotation des équipes : c'est l'un des principaux enseignements de la crise et il est rassurant. Si cette crise illustre le caractère essentiel de l'eau et de l'assainissement, elle rappelle cependant que les personnels qui assurent ces missions sont souvent invisibles, comme dans le secteur des déchets ou de l'énergie. Je salue leur sens de l'engagement et leur mobilisation. Face à une situation inédite, les professionnels se sont organisés rapidement et des échanges quotidiens ont eu lieu avec le Gouvernement et les associations d'élus. Une chaîne de solidarité entre entreprises a également été mise en place. J'attire votre attention sur la situation des Antilles, qui est très problématique en raison des dégâts causés par l'ouragan Irma sur les réseaux et d'un contexte social fragile.
Deuxième enseignement, la crise a mis en lumière l'importance du travail réalisé en matière de digitalisation, qui a permis de basculer vers le télétravail et d'assurer le suivi de l'exploitation et des contrôles qualité. Le choc n'en est pas moins violent. Les opérateurs ont fait face à des baisses d'activité allant de 20 à 80 % en fonction des territoires, amorties grâce au dispositif général d'activité partielle, et ils ont dû absorber des charges imprévues, notamment pour la surveillance et la sécurisation de la filière des boues d'épuration. En outre, ils enregistrent des difficultés importantes en matière de recouvrement des factures d'eau qui pèsent sur leur trésorerie : au report des échéances pour les microentreprises et les TPE, rendu possible par une ordonnance du 25 mars, se sont ajoutés des retards de facturation d'autres clients et la baisse de la consommation d'eau, de l'ordre de 4 à 5 % au total.
D'autres points de vigilance m'ont également été signalés. D'abord, s'agissant des équipements de protection sanitaire. Dans ce secteur comme pour d'autres, il y a malheureusement eu des tensions sur l'approvisionnement lors du passage de l'épidémie au stade 3, qui a porté le besoin en masques à 500 000 par semaine selon les entreprises de l'eau. Le problème a pu être réglé rapidement grâce au pont aérien vers la Chine.
En matière de contrôles d'exploitation et de qualité, les opérateurs ont fait part d'une situation d'insécurité juridique. La priorité a été donnée à l'autocontrôle et certains contrôles ont été reportés. Des instructions ont été publiées par le ministère.
Concernant l'épandage des boues d'épuration, le Gouvernement et les autorités sanitaires ont appelé à mettre en oeuvre le principe de précaution, en stockant ces boues pour éviter tout risque de contamination en l'absence de certitudes établies et en épandant uniquement les boues hygiénisées, avec des contrôles stricts. Les surcoûts sont à la charge des collectivités mais certaines agences de l'eau leur apportent de façon exceptionnelle un soutien financier.
Enfin, 85 départements ont connu des problèmes de sécheresse l'an dernier. Au stress humain et opérationnel pourrait donc rapidement s'ajouter une situation de stress hydrique dans les prochaines semaines. Nous manquons d'un plan global d'adaptation au changement climatique.
Deux pistes de propositions s'offrent à nous pour accompagner le secteur dans la reprise. D'abord, il est indispensable de préserver les investissements identifiés lors des Assises de l'eau. À l'heure actuelle, le secteur consent 6 milliards d'euros d'investissements par an mais les professionnels estiment qu'il faudrait porter ce niveau à 8 à 10 milliards d'euros par an pour assurer un entretien convenable des réseaux, améliorer la qualité de l'eau et préserver la ressource. Les travaux ont baissé de l'ordre de 80 à 90 % pendant le confinement et cela s'ajoute au sous-investissement chronique dans le secteur de l'eau, avec un taux de renouvellement des canalisations qui demeure trop faible, à 0,5 % par an. La reprise rapide des travaux impose bien entendu une clarification relative aux élections municipales et communautaires. Les entreprises de l'eau demandent la mise en place d'un fonds spécial d'amélioration de la qualité de l'assainissement de l'eau potable (Aquae) et attendent beaucoup des nouvelles équipes municipales. Sur ce point, une dérogation pourrait être introduite pour autoriser les collectivités à attribuer des subventions d'équilibre, comme c'est déjà le cas pour les communes de moins de 3 000 habitants.
Je rappelle aussi que les ressources des agences de l'eau sont ponctionnées chaque année au profit du budget général de l'État, avec le fameux plafond mordant. Elles devront être préservées pour accompagner ces changements et soutenir les projets locaux. Nous aurons l'occasion d'en reparler à l'autonome dans le cadre de la discussion budgétaire.
Enfin, les entreprises de l'eau demandent une défiscalisation intégrale des heures supplémentaires pour inciter les collaborateurs à s'investir dans les mois à venir afin de rattraper les retards enregistrés. Elles demandent aussi une exonération de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour les boues non épandables du fait du Covid-19 et qui sont incinérées ou stockées. Nous avions pu aborder certains de ces sujets lors de l'audition de la ministre Élisabeth Borne et j'y resterai attentif.
La crise a fait émerger la question du lien entre santé humaine et destruction des écosystèmes et de la biodiversité - le professeur Guégan en a longuement parlé. Quatre experts mondiaux de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) ont lancé le 27 avril un appel dénonçant notre responsabilité dans la pandémie de Covid-19. « La déforestation effrénée, l'expansion incontrôlée de l'agriculture, l'agriculture intensive, l'exploitation minière et le développement des infrastructures ainsi que l'exploitation des espèces sauvages », écrivent-ils, « ont créé les conditions parfaites pour la propagation des maladies de la faune aux humains ». Dans le même communiqué, ils ajoutent qu'on estime à 1,7 million le nombre de virus non identifiés, du type connu, pour infecter les humains qui existent encore chez les mammifères et les oiseaux aquatiques. N'importe lequel d'entre eux pourrait être à l'origine, demain, d'une prochaine pandémie encore plus perturbatrice ou mortelle que l'actuelle.
Le directeur de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) France, Sébastien Moncorps, que j'ai entendu en visioconférence, a rappelé que l'OMS estimait à 75 % la proportion des maladies infectieuses qui sont des zoonoses, c'est-à-dire qui sont transmises par des animaux - surtout des animaux sauvages - à l'homme, à l'origine de 700 000 décès par an. Selon lui, la recrudescence de la fréquence et de l'intensité de ces maladies est en lien direct avec la dégradation de l'environnement, notamment par les activités humaines - déforestation, artificialisation des sols, destruction des écosystèmes, commerce illégal d'animaux sauvages et d'espèces protégées. Ce phénomène est accentué par l'explosion démographique, qui augmente l'exposition des populations et accroît la propagation de ces virus. Des études scientifiques ont bien montré une corrélation entre la réduction de la superficie des milieux naturels et l'apparition des maladies infectieuses.
Le professeur Gilles Boeuf, ancien président du Muséum national d'histoire naturelle, nous a également parlé du rôle de régulation et, notamment, de régulation des maladies infectieuses que jouent des écosystèmes fonctionnels diversifiés. Il a qualifié la crise actuelle de « super-alerte » et a rappelé que l'OMS avait mis en garde contre les risques d'une pandémie à grande échelle dès 2003.
De nombreux virus ont déjà été transmis de l'animal à l'homme par le biais d'hôtes intermédiaires au cours des dernières années, qu'il s'agisse d'Ebola, de la dengue, du chikungunya, du virus Zika, du SARS ou encore du virus du Nil occidental.
En ce qui concerne les pratiques et activités humaines à l'origine de ces perturbations écosystémiques, Yann Laurans et Aleksandar Rankovic de l'Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri) en ont mentionné cinq qui constituent des risques au titre de l'émergence des zoonoses et qui devraient, selon eux, structurer le débat de la communauté internationale sur les réponses à apporter à la crise en termes de régulation : les marchés d'animaux sauvages, l'utilisation de la viande de brousse, l'orpaillage clandestin, la déforestation au sens d'un changement d'usage des sols, l'élevage de monogastriques et surtout de volailles, avec la grande concentration et le manque de variété génétique et des questions de l'antibiorésistance.
En second lieu, mes interlocuteurs ont souligné le risque de relégation au second plan des enjeux liés à la protection de la biodiversité sur la scène internationale quand l'urgence sera de relancer les économies.
La secrétaire exécutive de l'IPBES, Anne Larigauderie, s'est inquiétée dans la presse la semaine dernière que ce sujet « perde l'élan qu'il avait commencé à prendre » alors que 2020 devait être une année cruciale pour les négociations internationales sur la biodiversité. Le chamboulement du calendrier des négociations peut être de nature à inquiéter. La COP 15 de Kunming, qui devait avoir lieu à l'automne, est reportée à 2021, vraisemblablement avril, voire mai. Or ce rendez-vous était extrêmement important : il devait conduire à réviser le cadre des objectifs internationaux adoptés en 2010 à Aichi, et à adopter le nouveau guide d'action politique des membres de la Convention sur la diversité biologique d'ici à 2030. Le Congrès mondial de la nature, organisé par l'UICN, qui devait avoir lieu en juin à Marseille, est reporté à janvier 2021.Ces rendez-vous étaient très attendus. L'Iddri nous a indiqué que le redémarrage formel des discussions sur cet agenda devrait avoir lieu en septembre, à l'occasion du sommet de l'Assemblée générale des Nations unies à New York.
Face à ces constats, des pistes d'action pour le monde d'après émergent. Les leçons doivent être tirées, les alertes enfin entendues. Le confinement et le retour d'espèces qu'on ne voyait plus montrent l'incroyable résilience du vivant, comme le rappelait le professeur Gilles Boeuf dans un article de La Dépêche du Midi le 6 avril 2020. En soi, cela doit nous inciter à agir.
La place qui sera donnée à la biodiversité dans le cadre des plans de relance est essentielle. Il paraît incontournable d'identifier prioritairement les secteurs économiques favorables à la biodiversité afin de ne pas « subventionner de futures pandémies », pour reprendre les mots des experts de l'IPBES que je citais précédemment. En tout état de cause, ces plans devront favoriser sur un même niveau les investissements favorables à la préservation de la biodiversité et au climat.
La lutte contre la déforestation importée, pour laquelle la France est en pointe avec la stratégie nationale de 2018, doit être amplifiée. Elle conduit également à poser la question, comme l'a souligné l'Iddri, de la traçabilité et de la durabilité de notre alimentation avec, par exemple, l'affichage environnemental des produits alimentaires - sujet sur lequel l'Ademe a lancé en février un appel à projets. Nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de savoir si le cacao ou le soja que l'on achète provient de la déforestation.
Nous avons mis en place, aux niveaux international et national, un outil puissant et efficace : les réseaux d'aires protégées. Nous atteindrons vraisemblablement notre objectif de 30 % en 2030. Mais nous devons amplifier ce mouvement, investir dans la protection des écosystèmes et des espèces sauvages. Si nous disposons du cadre juridique pour le faire, l'impulsion politique doit être renforcée dans tous nos territoires.
De la même manière, si la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a renforcé les sanctions en matière de lutte contre le commerce illicite d'espèces protégées, les moyens - humains, notamment en matière de formation, mais aussi budgétaires - manquent aujourd'hui. Il faut les renforcer. À titre d'exemple, le directeur de l'UICN nous a rappelé que l'aéroport Charles-de-Gaulle était une des plaques tournantes du trafic d'espèces menacées, notamment d'Afrique vers l'Asie. Les douaniers constatent ainsi une recrudescence du commerce du pangolin, comme l'atteste la saisie record, en 2014, de 250 kg d'écailles de pangolin. Pas moins de 270 tonnes de viande de brousse transitent, en outre, chaque année par Roissy.
Le plan de relance ne pourra pas faire l'impasse sur des investissements massifs dans la recherche - le professeur Guégan en a rappelé l'importance.
Sur le plan de la gouvernance internationale, l'Iddri a rappelé que le temps du multilatéralisme était un temps long et a évoqué plusieurs pistes d'évolution La voie d'un renforcement de la convention sur la diversité biologique pourrait être une option intéressante, même si elle présente une limite, à savoir que les États-Unis n'en font pas partie. La voie d'une extension du mandat de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Cites), qui ne couvre pas à ce jour les zoonoses, à l'ensemble des espèces susceptibles de transmettre des maladies zoonotiques, pourrait en être une autre, couplée à une amélioration de la coopération avec l'OMS, davantage chargée de la gestion des pandémies que de leur prévention. L'Iddri a également mis en avant la piste d'un mandat qui pourrait être confié sur le sujet de la gouvernance des pandémies par l'assemblée générale des Nations unies à une commission spéciale ou à un organisme existant, notamment afin de favoriser les retours d'expériences des causes et des solutions. Les organisations internationales sont malmenées. Les parlements nationaux pourraient assurer un contrôle et jouer le rôle d'aiguillon.

La délégation aux outre-mer a organisé une visioconférence avec la ministre Girardin. La Martinique et la Guadeloupe sont confrontées à un gros problème d'alimentation en eau potable. Le sujet, bien connu, a pris de l'ampleur avec la crise du Covid-19. Les réseaux sont vétustes et mal entretenus. Les préfets tentent de remettre de l'ordre mais les investissements restent insuffisants. La population a des difficultés à s'alimenter en eau potable.
Le professeur Guégan a largement exposé les problèmes liés à l'élevage : mettre un troupeau sous cloche, c'est diminuer le risque épidémique, a-t-il dit. Et pourtant, certains critiquent la mise sous cloche et souhaitent que les troupeaux retournent en plein air. La contradiction est patente. Il faudrait déterminer les meilleures solutions. La France est un grand pays d'élevage.
J'ai une question moins politiquement correcte. Les conséquences de la crise ont été considérables. Le monde entier a été bloqué. Les morts de l'après-crise risquent d'être nombreux. Entre le 1er janvier et le 1er mai 2020, selon les chiffres officiels, le coronavirus a tué 240 000 personnes de trop. Mais la malaria en a tué 327 000, les suicides 357 000, les accidents de la route 450 000, le cancer 2,74 millions et les maladies infectieuses, 4,33 millions.

À ce stade, le coronavirus a tué environ un million de personnes dans le monde. En Angleterre, en Italie ou aux États-Unis, la mortalité enregistrée est le double des morts officiels du coronavirus. Si l'on considère la situation en Équateur ou en Amérique du Sud, il faut compter un million de morts supplémentaires. Sans le confinement, il y aurait eu des dizaines de millions de morts. Cette crise est totalement inédite du point de vue sanitaire. Je ne crois pas que l'on puisse utiliser les chiffres officiels de la mortalité pour dire que la crise que nous traversons n'est qu'une crise parmi d'autres.
Parmi les mesures urgentes à prendre, il faut renforcer les moyens de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, service spécialisé dans les trafics d'espèces. Les moyens sont bien trop faibles par rapport à l'enjeu. Dans chacune de nos ambassades, un cadre de sécurité est chargé de contrôler les trafics, de drogue notamment. Ne faudrait-il pas inscrire le trafic d'espèces au même niveau que les autres trafics ? Il faudrait interpeller le Gouvernement sur ce sujet.

Dans les outre-mer, c'est l'Office français de la biodiversité qui finance l'entretien des réseaux. Il faut investir davantage pour garantir la salubrité publique. D'autant que cela aurait un effet vertueux sur le plan environnemental.
L'élevage sous cloche et le suivi vétérinaire sont des questions complexes que nous devons aborder dans leur globalité. Les auditions ont montré que le problème de l'élevage intensif se posait pour les volailles notamment, en Asie du Sud-Est. Les conclusions à tirer ne sont pas forcément les mêmes au niveau national. Un des moyens d'action possibles consiste à décourager toute consommation qui entraîne une déforestation importée. L'audition du professeur Guégan a montré qu'il fallait considérer de manière large l'ensemble du spectre de la santé, sans opposer celle de l'homme et celle des animaux.
Il est effectivement nécessaire de mieux former les douaniers en matière de trafic des espèces et de leur donner plus de moyens. Le cadre juridique peut être ambitieux ; si les moyens manquent sur le terrain, il ne sera pas efficace.

Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour l'audition de M. Julien Denormandie.
La réunion est close à 12 h 5.