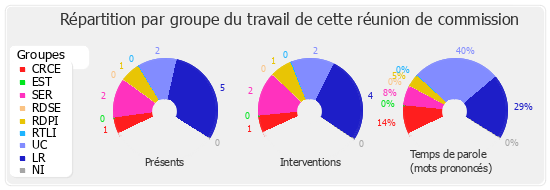Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
Réunion du 4 mars 2020 à 10h30
La réunion

La commission nomme rapporteurs :
- M. Edouard Courtial sur le projet de loi n° 338 (2019-2020) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération bilatérale en matière d'instruction militaire ;
- Mme Christine Prunaud sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord relatif au centre culturel algérien en France, de l'accord relatif à l'école internationale algérienne de Paris, de l'accord relatif au lycée international Alexandre Dumas à Alger, et de l'avenant à l'accord du 16 juillet 2006 relatif à l'ouverture, à Alger, d'une école primaire destinée à la scolarisation d'enfants de cadres d'expatriés d'entreprises (sous réserve de son dépôt) ;
- M. Olivier Cadic sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord portant reconnaissance réciproque et échange des permis de conduire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'État du Qatar et de l'accord portant reconnaissance réciproque et échange des permis de conduire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine (sous réserve de son dépôt).

Mes chers collègues, M. Alain Cazabonne a souhaité se faire remplacer dans la mission Russie.
C'est notre collègue Jacques Le Nay, que je remercie, qui participera au déplacement à Moscou fin mars.
Il n'y a pas d'opposition ? Il en est ainsi décidé.

Nous poursuivons notre travail sur l'opération Barkhane et la situation au Sahel en accueillant trois personnalités d'horizons différents, qui vont nous livrer en toute liberté leur analyse. Colonel Michel Goya, ancien des troupes de marine, vous êtes ici en votre qualité d'enseignant et d'auteur de nombreux ouvrages, spécialisés dans l'histoire militaire et l'analyse des conflits ; Yvan Guichaoua, vous êtes chercheur à l'Université du Kent et spécialiste du Sahel ; et Mathieu Pellerin, vous êtes chercheur spécialiste du Sahel notamment à l'Institut français des relations internationales (IFRI) et à l'International Crisis Group.
Chacun sait combien la France est engagée pour la sécurité du Sahel, avec l'opération Barkhane qui comptera bientôt 5 100 hommes. Nos armées ont payé un lourd tribut à la stabilisation du Sahel avec quarante-cinq morts depuis 2013, si l'on agrège les opérations Serval et Barkhane. Je souhaiterais une fois de plus leur rendre hommage, ainsi qu'à leurs frères d'armes des pays du Sahel tombés dans ce combat, sans oublier les nombreux civils victimes des terroristes.
Ce cycle d'auditions vise d'abord à mieux comprendre le contexte dans lequel se déroule l'opération Barkhane.
Mathieu Pellerin, vous pourrez nous éclairer sur la nature des ennemis que nos soldats affrontent, sur leurs origines, leurs modes d'action et leur degré d'enracinement local. Faut-il distinguer les différents groupes contre lesquels nous combattons en fonction de leur idéologie, de leur agenda local ou international ?
La question de la stabilisation du Sahel est également éminemment politique et sociale. Yvan Guichaoua nous éclairera sur les racines profondes, politiques et sociales, des troubles et des affrontements. Les processus en cours afin de tenter d'y mettre fin, je pense notamment aux accords d'Alger - à supposer qu'ils soient menés à leur terme - constituent-ils une réponse adéquate ? Nous pouvons aussi nous demander si certains pays du G5 ne luttent pas plus efficacement que d'autres contre les racines du mal, par la meilleure inclusion de certaines de leurs populations - deux exemples sont parfois cités, la Mauritanie et le Niger, est-ce justifié ? Ce sera également l'occasion d'aborder la question des manifestations anti-françaises, très nombreuses l'année dernière : quelle est leur cause et comment les combattre ? L'ambassadeur du Mali, qui a tenu des propos irrecevables à ce sujet la semaine dernière devant notre commission, vient d'être rappelé par son pays. Le ministre des affaires étrangères du Mali est venu en personne au Sénat et interviendra prochainement devant notre commission pour rappeler le soutien et la reconnaissance que le Mali souhaite manifester à nos troupes.
Peut-être pouvons-nous commencer par la question militaire : les opérations Serval puis Barkhane ont-elles eu l'effet militaire escompté jusqu'à présent ? Comment expliquer qu'après tant de succès tactiques le problème demeure, sept ans après le début de Serval ? Quel résultat espérer des décisions prises au sommet de Pau en janvier dernier, concernant l'envoi de renfort, la création d'une nouvelle coalition et la décision de lancer une force spéciale internationale ? Michel Goya va commencer par nous livrer son analyse sur cet enjeu d'efficacité militaire. Au fond, Colonel, une réponse militaire peut-elle résoudre une question politique ? Ne demande-t-on pas l'impossible à nos militaires ?
L'Afrique est le théâtre d'opérations militaires privilégié de la Ve République. Nous y intervenons régulièrement depuis le début des années 1960 grâce à un dispositif particulier fait d'accords, de bases militaires, de forces prépositionnées ou d'interventions qui peuvent agir rapidement sur simple décision du Président de la République. C'est un système assez unique dans le monde et relativement efficace militairement. Il souffre toutefois de deux faiblesses : la sensibilité aux pertes humaines et la peur d'être perçus comme des néo-colonialistes.
Depuis toujours, nous devons arbitrer entre des demandes d'intervention nombreuses et la nécessité de garantir leur acceptabilité politique. Nous avons tâtonné dans nos formes opérationnelles : actions anti-coup d'État dans les années 1960, comme au Tchad en 1969 ; puis nous avons basculé vers des formes d'interventions de contre-insurrection plus directes et courtes, avant, dans les années 1980, d'intervenir en appui de forces armées locales, comme au Rwanda. C'était encore trop, alors nous avons opté pour des opérations d'interposition, comme en Côte d'Ivoire, ou de stabilisation, c'est-à-dire des opérations qui n'ont pas d'ennemi désigné et de préférence sous mandat international. Toutes ces opérations, qui constituaient en réalité des substituts à des interventions directes, ont eu des résultats globalement assez mitigés.
Lorsque nous sommes intervenus au Sahel, avec le déclenchement de l'opération Sabre en 2009, notre premier dispositif était léger, discret, composé d'une petite force d'intervention. Il fournissait un appui aux forces locales à la demande des États - cela fut plutôt un succès en Mauritanie, mais pas au Mali. En 2012, la situation a changé considérablement. Notre force d'intervention est alors apparue un peu trop légère, tandis que, dans le même temps, le projet de stabilisation militaire qui était en cours, autour de la constitution d'une force interafricaine, connaissait tous les problèmes habituels de ce type d'opérations multinationales : procédures interminables, financements qui tardent, manque de moyens, hétérogénéité des forces, etc. Finalement, la France a décidé d'intervenir directement, pour la première fois depuis 1978. Ce fut le déclenchement de l'opération Serval, qui constitua une réussite militaire et tactique, parce qu'elle a combiné les ingrédients d'une stratégie efficace, avec des objectifs clairs et limités et des moyens adaptés. Serval est une opération séquentielle : on peut suivre directement sa progression sur la carte, au fil des avancées de l'armée. Lorsqu'un soldat tombe au feu, on peut facilement expliquer dans les médias pourquoi : pour libérer ou reprendre telle ville ou telle position. Cela est donc beaucoup plus acceptable pour l'opinion. Mais il ne s'agissait, en réalité, que d'une bataille dans cette guerre. La phase active de Serval s'est achevée avec des résultats très concrets : reprise de contrôle des villes du Nord, destruction des grandes bases djihadistes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) et dislocation d'une grande partie de ses forces, puisque nous avons à peu près détruit un tiers des combattants de ces organisations qui ont dû fuir ou passer dans une forme de clandestinité.
Ces résultats n'étaient toutefois que temporaires, car AQMI existait toujours, de même que les problèmes sous-jacents à l'origine du conflit. De plus, la mission des Nations Unies, la Minusma, destinée à remplacer Serval, tardait à se mettre en place. C'est dans ce contexte que l'on a décidé de poursuivre Serval par l'opération Barkhane. J'étais, à l'époque, assez circonspect, en raison de la règle non écrite des interventions, la « règle des trois ans » : s'il ne semble pas envisageable d'obtenir un résultat stratégique significatif en trois ans, mieux vaut éviter une action visible et s'organiser pour mener une guerre de longue durée, de basse intensité, à bas coûts et à basse visibilité. Tel n'est pas le choix qui a été fait, puisque l'on a décidé de maintenir Serval, dans un format un peu réduit, et de l'intégrer avec les autres opérations en cours dans la région, dans le cadre d'une grande opération unique, Barkhane. Celle-ci mobilise entre 3 000 et 5 000 soldats, six ou sept avions de chasse, une vingtaine d'hélicoptères, sur un espace immense. La principale différence est que Barkhane constitue une opération cumulative, non séquentielle : pas de grandes batailles ni de progression claire sur une carte, mais une multitude de petites actions, destinées à produire un effet par cumul. Barkhane travaille en collaboration avec les autres forces locales. Même si Barkhane représente la force la plus importante de la région, incontestablement, ses moyens ne lui permettent pas pour autant de faire beaucoup plus que des raids et des frappes ; ses effectifs sont tellement réduits que, même associés à des bataillons de forces locales, ils ne peuvent se déployer que quelques semaines dans une région. Nous ne sommes donc pas capables d'assurer une présence permanente dans une région, afin d'attendre la mise en place d'une administration locale efficace. Barkhane est donc surtout dissuasive, empêchant l'ennemi de reconstituer des bases importantes ou de mener des opérations militaires de grande ampleur, sous peine d'être immédiatement décelé et détruit. Elle maintient une pression forte, mais c'est insuffisant pour gagner la guerre et le potentiel de l'ennemi n'est pas véritablement entamé : en moyenne, on élimine un combattant et demi tous les deux jours, pour un coût de 600 millions annuels, soit deux millions d'euros pour éliminer un combattant...
En réalité, on s'attaque aux symptômes, mais pas aux causes profondes, ni à la capacité de régénération de l'ennemi, car son centre de gravité ne se trouve pas dans ses camps du désert, mais bien à Bamako. Les organisations que nous affrontons ne sont fortes que parce que les États locaux, certains d'entre eux en tout cas, sont faibles. Tant qu'il en sera ainsi les ennemis continueront à gagner en puissance. Sur la durée, Barkhane coûte cher, financièrement, mais aussi humainement. Les pertes de soldats au combat vont s'accroître, inévitablement. Elles peuvent être acceptées par la société, pourvu qu'elles ne paraissent pas inutiles. Or, dans un contexte aussi flou, cela apparaît difficile. Barkhane a déjà coûté 2,5 milliards d'euros, qui auraient pu être employés différemment, alors que nos ennemis ne sont que des forces armées de quelques centaines de combattants, non des superpuissances militaires.
Cette intervention devient la plus longue que nous ayons menée depuis longtemps. Plus elle dure, plus nous nous exposons à l'apparition d'un « cygne noir », un événement ou un accident susceptible de modifier la donne : une erreur de frappe militaire, qui tue de nombreux civils, ou la perte de plusieurs soldats. La disparition brutale de treize soldats dans un accident d'hélicoptère a fait la une des médias, mais a aussi eu un effet stratégique négatif. De plus, à terme, comme cette opération ne produit pas d'effets visibles, elle risque de voir son soutien local diminuer. Il n'est jamais agréable d'avoir une force étrangère sur son propre territoire et les populations sont tentées de surestimer le visible par rapport à l'invisible : après tout, si les Français ne l'emportent pas, en dépit de forces apparemment aussi puissantes que Barkhane, c'est qu'ils le veulent bien ! Cet échec peut ainsi être instrumentalisé par ceux qui veulent masquer leurs propres insuffisances.
Barkhane, mécaniquement, est destinée à s'user. Si on poursuit dans cette voie, le risque d'accident augmente. Quitter la zone revient à abandonner toute notre stratégie qui vise à contenir les groupes djihadistes, à stabiliser la région du golfe de Guinée, à endiguer les trafics et les migrations, et à protéger indirectement notre territoire national. Il faut donc reconfigurer notre action dans la région pour la rendre plus efficace et surtout plus tenable sur la très longue durée. Cela signifie qu'il faut être le moins visible possible dans la zone critique, tout en conservant une capacité de frappe et de réaction en périphérie, et en activant tous les instruments de puissance à notre disposition, au-delà du militaire. Nous manquons à cet égard d'une vision commune des instruments de puissance : le militaire, l'aide au développement, la diplomatie - il est quand même surprenant de voir que l'on continue à critiquer les forces françaises sans que l'on n'arrive à riposter en termes de communication. Peut-être faut-il regrouper nos moyens sous une autorité unique, en nous inspirant de la Minusma, dont le chef a le rang de ministre. Son rôle militaire est très faible, mais son action globale est beaucoup plus large. Nous devons maintenir une présence discrète, en lien avec les forces locales. Les opérations étrangères qui ont réussi sont passées par l'intégration sous commandement national de forces différentes, voire de mercenaires locaux ou des forces privées, qui ont le mérite d'être moins visibles. Les Américains ont ainsi recruté 100 000 mercenaires locaux en Irak.

Je ne suis pas sûr de comprendre ... vous proposez donc d'intégrer des milices privées ?
Je pense qu'il faut intégrer des forces locales, qui seraient associées à notre action, tout en conservant le contrôle, le commandement. Il ne s'agit pas de recourir à des forces d'autodéfense laissées à elles-mêmes. L'action russe en Syrie n'a pu se perpétuer dans la durée que parce que les Russes ont fait appel à des mercenaires ou ont pris le commandement direct d'un corps d'armée syrien. Les Américains se sont sortis de la situation en Irak grâce au recrutement de 100 000 miliciens sunnites du mouvement du Sahwa. L'intervention au Tchad en 1969 constitue l'un des rares exemples de contre-insurrection réussie parce que l'objectif était limité et réaliste, et surtout parce que l'on a intégré des forces militaires régulières locales pendant un temps. Ne nous leurrons pas, le recours aux mercenaires et aux armées privées constitue l'une des grandes tendances militaires des années à venir.
Il existe une convergence de vue parmi les analystes sur la nature de l'ennemi. Il ne fait pas de doute que les shouras, les conseils qui dirigent ces organisations, sont composés essentiellement de personnes convaincues religieusement ou qui défendent un agenda essentiellement religieux d'imposition de la charia, voire d'un État islamique. En revanche, au niveau du corps des combattants, l'agenda religieux semble marginal. Les facteurs d'engagement au sein de ces groupes sont, en effet, beaucoup moins religieux que sociaux. Il s'agit, en général, de se mobiliser par les armes pour faire face à une situation vécue comme injuste, avec des configurations variables selon les lieux. Il est possible d'identifier région par région les principaux moteurs d'engagement. Par exemple, les communautés nomades ont souvent le sentiment d'être victimes d'un manque de représentation sociale ou politique, ou d'être plus fréquemment ciblées par des groupes d'autodéfense ou par les appareils étatiques qui multiplient les brimades à leur encontre. Cependant, cela ne signifie pas que ces individus ne se radicalisent pas ensuite, sur le plan religieux, une fois enrôlés.
On considère souvent en Occident qu'il existerait un continuum entre salafisation et djihadisation. Mais lorsque l'on regarde les parcours, on constate un passage direct de l'islam soufi à un engagement armé. On peut faire un parallèle avec les trajectoires d'anciennes rébellions armées qui n'avaient pas nécessairement de coloration islamique au départ. Or, on trouve parmi ces combattants d'anciens rebelles qui avaient un agenda politique au moment où ils ont pris les armes et qui ont désormais un agenda islamiste djihadiste.
Entre ces deux catégories de combattants, ceux qui ont un agenda purement religieux et ceux qui défendent des intérêts prosaïques liés à des situations d'injustice, on trouve une variété d'acteurs qui se joignent à ces groupes pour des raisons pragmatiques. L'une des trajectoires les plus courantes dans le Sahel, au Burkina Faso, mais aussi au Mali et au Niger, est la djihadisation du banditisme. On retrouve dans les groupes djihadistes beaucoup d'anciens bandits qui ont choisi de les rejoindre, soit par opportunisme, pour se protéger contre l'État, soit parce qu'ils trouvent dans le djihad un nouveau sens à leur vie. Cela correspond d'ailleurs aux trajectoires de radicalisation que l'on observe dans les prisons européennes. On retrouve aussi des individus nouvellement considérés par le système socio-politique comme des bandits : ainsi, dans l'Est du Burkina Faso, beaucoup d'anciens chasseurs sont devenus braconniers à cause du développement des aires protégées, alors qu'ils ne font que perpétuer leur mode d'existence traditionnel. On trouve également des acteurs motivés par des intérêts divers, familiaux, économiques ou communautaires, qui suivent ou rejoignent dans le djihad une personne en qui ils ont confiance, ou encore qui agissent par appât du gain, comme ceux payés pour poser un IED. Autant de motivations prosaïques et singulières !
Toutefois, les personnes qui se sont enrôlées pour ces raisons en 2012 ou 2013 sont travaillées depuis par des groupes qui ont un agenda djihadiste. Il importe donc de distinguer les facteurs d'engagement et les trajectoires. Or, la majorité des politiques de prévention sont focalisées sur la prévention de la radicalisation religieuse alors que la religion joue un rôle minoritaire dans les engagements. Il faut donc également les axer sur les dimensions sociales et politiques, qui fondent l'engagement djihadiste.
Chaque groupe possède une identité propre. Le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM ou JNIM selon l'acronyme arabe) constitue une coalition des katibas, des unités combattantes, qui relevaient d'Al-Qaïda au Maghreb islamique ou d'Al Qaïda au Sahara et ont fusionné. Il y a aussi l'État islamique (EI) qui possède deux branches : une branche saharienne, qui concentre l'attention de la France, et une branche autour du lac Tchad, dans le nord du Nigéria. Ces groupes sont construits autour d'identités fortes, voire rivales. Les forces militaires françaises elles-mêmes ont établi une distinction : au sommet de Pau, l'accent a été mis sur l'EI dans la région du Liptako parce que ce mouvement recrute de plus en plus de combattants. Le nombre de combattants au Sahel a doublé, voire davantage, en dix-huit mois, passant de 500 ou 800 combattants à plus du double. La raison en est que les facteurs d'engagement que j'ai précédemment évoqués ont été exacerbés par les réponses apportées par les États nationaux, notamment le Burkina Faso et le Mali. On a enregistré en 2019 plus d'attaques cumulées que pendant les cinq années précédentes. Les massacres perpétrés contre les populations civiles, majoritairement d'origine peule, au centre du Mali ou dans la province du Soum au Burkina Faso, se sont multipliés. En retour, ces populations sont donc tentées de rejoindre les groupes djihadistes pour se venger. Elles rejoignent plus volontiers l'EI que le JNIM, car l'État islamique a une organisation beaucoup plus souple et laisse ses combattants s'adonner à des vengeances communautaires. Je connais le cas d'une personne dont le père a été exécuté. Pour trouver des armes et se venger, il a adhéré à l'un de ces groupes, alors qu'il n'avait initialement aucun attribut d'un « radicalisé, ni aucune sympathie pour ces groupes. Son premier réflexe a été de trouver des armes au sein du groupe qui lui laisse la plus grande latitude pour se venger, à la fois du meurtrier de son père, puis, par extension, du village auquel appartient l'individu et de sa communauté. Dans son esprit, ils sont tous coupables. C'est ce qui explique pourquoi on a basculé si rapidement, au Burkina Faso, dans un cycle de violences communautaires. Heureusement, les autorités traditionnelles et les chefferies coutumières n'alimentent pas le phénomène. Mais il faut enrayer l'engrenage violences-représailles. On ne pourra pas le faire en recourant uniquement à la force. Les armées nationales sont sous-équipées ; les unités déployées sur le terrain sont épuisées faute de relève et atteintes psychologiquement. Or, on leur demande toujours plus, d'augmenter la pression, d'obtenir des résultats. On imagine aisément ce que cela peut donner...
Quelle légitimité donner à ces groupes dans la perspective d'un dialogue éventuel ? La légitimité passe-t-elle par la nationalité des chefs ? C'est l'argument des autorités maliennes, qui acceptent de parler avec le JNIM parce qu'il est dirigé par Lyad Ag Ghali, un Malien. Mais cet argument de la nationalité ne semble pas recevable au Niger : la plupart des combattants djihadistes nigériens appartient à l'EI, aussi bien à sa branche saharienne, avec des populations largement originaires de la région de Tillabéri, qu'à sa branche opérant autour du lac Tchad, dans la région de Diffa. Mais les chefs de l'EI ne sont pas Nigériens, ils sont essentiellement Sahraouis. Il est donc, a priori, plus difficile de discuter avec l'EI, mais tout dépend aussi de ce que l'on entend par le mot « dialogue ». S'il s'agit seulement de traiter avec les émirs de ces groupes, le JNIM semble plus disponible, et, de fait, des canaux ont déjà été ouverts depuis quelques semaines. Cela semble plus difficile avec l'EI, car ses chefs sont étrangers, mais les unités sont plus autonomes, car son organisation est très déconcentrée. Cela laisse donc une marge aux États pour discuter avec certaines unités. Tout dépend des facteurs d'engagement : si le facteur d'engagement a été la révolte par rapport à une situation locale précise, en réponse à un massacre ou une confiscation de terres par certains groupes avec l'assentiment de certaines autorités - le cas existe -, il peut être possible de s'entendre et pas forcément sur un agenda religieux. Cela offre plus de latitudes pour penser une politique de démobilisation - je ne parle pas forcément de dialogue - sans passer par les chefs.
Enfin, l'autre fondement de légitimité pour discuter avec ces groupes pourrait être, si l'on en croit les autorités, la compatibilité républicaine de ces groupes. Cela a été réaffirmé par l'ambassadeur du Mali ici même la semaine dernière. Le dialogue a des limites : il n'est pas question de transiger sur la compatibilité républicaine de ces groupes. Mais la Mauritanie est une République islamique. Tout dépend, là encore, de ce que l'on entend par la République ou l'ordre républicain. M. Moussa Mara, l'ancien Premier ministre malien, pourtant très critique à l'égard d'un dialogue avec ces groupes, rappelle lui-même que, dans certains espaces du territoire malien, la charia existe depuis très longtemps et que les cadis, les juges islamiques, sont respectés par les populations. Tout dialogue suppose des concessions, même limitées, et des compromis : si nul n'a envie d'en faire, il n'aboutira jamais. Dans les zones qui étaient sous domination du JNIM et qui sont passées sous la domination de l'EI, de plus en plus de voix s'élèvent pour protester contre les interdictions nouvelles ou l'obligation de porter des pantalons coupés au-dessus de la cheville, ce qui n'était pas le cas avant.
Il ne faut donc pas en rester aux concepts ni aux mots affichés, mais étudier prosaïquement sur le terrain ce qui peut être fait. Des autorités maliennes discutent déjà depuis deux ans avec les groupes djihadistes pour que les mairies continuent à fonctionner. Il faut traduire ce dialogue en un processus plus organisé pour parvenir à la paix.
Je traiterai trois points : le sentiment anti-français qui s'est manifesté ces derniers mois au Niger, au Mali et au Burkina ; l'avancement du processus de paix au Mali ; et, enfin, le prix que paient les civils.
Il est difficile de mesurer l'ampleur du sentiment anti-français dans les pays du Sahel, mais on peut en avoir une idée à travers les manifestations, très diverses, qui proviennent de sources officielles, de personnalités influentes, de la rue ou des réseaux sociaux. Un député malien de la majorité présidentielle ou un ministre burkinabé ont, par exemple, suggéré que la France avait un agenda caché dans la région et ne disait pas tout à ses partenaires. On a entendu un chanteur malien internationalement connu expliquer que les djihadistes étaient des mercenaires payés par la France. Plusieurs rassemblements de rue ont eu lieu dans les capitales sahéliennes, où ont été scandées toutes sortes de slogans anti-français. Enfin, sur les réseaux sociaux, on a constaté à l'automne une avalanche de fausses informations sur des pages très suivies, avec centaines de milliers d'abonnés.
Je ferai tout d'abord trois remarques factuelles.
Premièrement, le mouvement ne concerne pas uniquement la France. Au Mali, la Minusma est aussi visée - il existe un rejet peut-être plus général des interventions étrangères.
Deuxièmement, le mouvement est très hétérogène et peu structuré. Ses acteurs viennent de plusieurs endroits du spectre politique, du combat anti-impérialiste au conservatisme religieux, qui voit d'un mauvais oeil la diffusion au Sahel de valeurs occidentales jugées décadentes. Pour autant, le fait que le mouvement soit peu structuré aujourd'hui ne veut pas dire qu'il ne le sera pas demain. Nous naviguons sur des équilibres fragiles que quelques accidents consécutifs peuvent faire basculer.
Troisièmement, si le sentiment antifrançais est vecteur de fausse information, même s'il est en partie délibérément entretenu, il révèle malgré tout une sorte de hiatus politique entre la manière dont la France perçoit son action et celle dont elle est perçue par certaines catégories de la population des pays sahéliens. La France a tendance à se voir dans le rôle du bon Samaritain venu délivrer de la barbarie des pays amis en danger et elle ne comprend pas que cette intervention puisse heurter les franges de l'opinion des pays sahéliens les plus attachées à leur souveraineté. L'intervention française, soixante ans après les déclarations d'indépendance, est humiliante, pour ceux qui ont la fibre patriotique. Les discours souvent paternalistes des autorités ou des médias français sont humiliants - comme, par exemple, l'obligation des chefs d'État du G5 Sahel de se rendre à Pau.
L'opération Barkhane a un coût, non seulement financier pour la France, mais également politique pour le pouvoir sahélien. Nous pouvons même dire qu'elle sape un peu la légitimité des autorités sahéliennes, qui sont, de facto, mises sous tutelle de la communauté internationale et, de ce fait, placées en porte-à-faux par rapport à leur opinion publique.
Concernant la mise en oeuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, un grand pas a été réalisé avec le retour de l'armée malienne à Kidal et le lancement de l'armée reconstituée - telle est son appellation. Il s'agit là d'une accélération du calendrier qui est bienvenue, car, je rappelle, le processus a longtemps été bloqué, notamment après les accusations émises par le régime nigérien sur la complicité de la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA) avec les djihadistes.
Symboliquement, le retour des forces armées maliennes à Kidal est important. Il signifie, au moins sur le papier, que la souveraineté des autorités centrales est restaurée sur l'ensemble du territoire, ce qui enlève aux souverainistes bamakois l'argument selon lequel la France empêchait le retour de l'armée malienne. Sur le plan opérationnel, le retour des forces maliennes ne va pas changer grand-chose, du moins à court terme.
Il est souvent avancé que la mise en oeuvre de l'accord de paix constitue un prérequis à la lutte contre les groupes armés djihadistes qui est, de fait, le grand problème du Sahel. Si cela n'est pas complètement faux, quand bien même l'accord serait mené à bien, le règlement de la crise serait encore très lointain. D'abord, parce qu'elle est devenue régionale, avec des djihadistes majoritairement burkinabés au Burkina ou nigériens au Niger. Ensuite, parce que même à l'échelle du Mali, le centre du pays n'est pas couvert par l'accord. Enfin, parce que la CMA est certes désireuse d'obtenir la paix, mais pas par des moyens militaires. Pourquoi ? Parce que si elle se lance dans lutte antiterroriste au sens militaire, elle risque de provoquer une guerre civile entre « Azawadiens » sur lesquels elle entend exercer une autorité politique. Autrement dit, pour la CMA, faire du contre-terrorisme au sens militaire, c'est devenir l'auxiliaire d'une démarche de reprise en main étatique qui, in fine, risque de l'affaiblir.
Le dernier point de mon intervention concerne les civils. Cette guerre a un coût faramineux pour les populations, avec l'explosion au Mali, au Burkina Faso et au Niger du nombre de personnes déplacées internes (PDI). Au Burkina Faso, quasiment toutes les zones rurales sont touchées par les violences.
La dernière carte que je vous présenterai représente une mise à jour par le Haut-Commissariat des réfugiés (HCR) des mouvements de populations à Tillabéry, au Niger. Elle montre l'obligation, pour ces populations, de trouver en permanence un lieu sûr, en fonction des violences qui se déplacent, ce qui provoque des déplacements continuels dans toutes les directions.
Ces populations fuient les atrocités commises par les mouvements djihadistes, notamment par l'EI au Grand Sahara, qui a adopté des méthodes de répression des civils excessivement brutales - jusque-là inconnues dans la zone -, mais également les violences commises par les armées locales - non pas des bavures involontaires, mais bien des exécutions extra-judiciaires. Ces violences sont dûment documentées par les associations des droits de l'homme ou des organisations indépendantes qui recensent les victimes de guerre au Sahel.
Je vous citerai l'exemple de l'exécution par l'armée nigérienne, dans une petite localité, de dix civils maliens, déjà rescapés d'un massacre commis par l'EI au Grand Sahara, en avril 2018 ; une communauté ciblée des deux côtés.
Les soupçons s'étendent même à Barkhane qui aurait, le 7 février, au nord de Gossi - selon plusieurs témoignages qui restent à confirmer -, frappé des civils venus chercher des corps de djihadistes ciblés la veille.
Ces violences soulèvent des problèmes de droit évidents, mais ont aussi des ramifications politiques. Nous observons une intensification de l'effort antiterroriste depuis plusieurs semaines - ce qui coïncide à l'après-Pau - qui touche durement les mouvements djihadistes. Cependant, ces victoires militaires ne pourront pas être converties si nous n'offrons pas aux civils - des acteurs doués de réflexion politique, des citoyens qui voteront un jour - la protection qui leur est due.
Les conditions d'une paix durable demain sont intimement dépendantes, d'une part, des méthodes qui sont employées aujourd'hui pour mener la guerre et, d'autre part, du projet de gouvernance que l'on entend incarner.

Messieurs, je vous remercie.
Il serait intéressant de répondre à une question qui a notamment été évoquée par le Président de la République, au sommet de Pau, lorsqu'il a indiqué que « toutes les hypothèses étaient sur la table ». Que se passerait-il si la France se retirait ? La question mérite d'être posée, au vu notamment des manifestations et de la déclaration de l'ambassadeur malien.
Peut-être que, contrairement au djihadisme qui organise des attentats en Europe et qui souhaite dominer le monde, ces conflits sont davantage ancrés dans l'histoire de ces territoires depuis fort longtemps.

Concernant votre remarque, monsieur le président, le caractère particulier du djihadisme et du terrorisme qui sévissent dans la région ne signifie pas pour autant qu'ils ne constituent pas une menace, notamment au vu de la mutation rapide des situations. Effectivement, si nous devons nous poser la question d'un retrait des forces françaises, nous devons nous la poser dans son entièreté.
Messieurs, je vous remercie de vos propos très intéressants. Pour l'essentiel, nous n'avons pas appris grand-chose par rapport à la complexité de la situation, mais il serait intéressant de faire le point sur la dimension militaire, civile et de développement qui se dessine depuis Pau. Après avoir rencontré à Bamako les responsables de l'Agence française de développement (AFD), les chefs militaires de l'opération Barkhane et l'équipe de l'ambassadeur, on se rend compte que la perspective de développement de certaines zones, en lien avec les autorités maliennes, est à présent possible, non seulement grâce à la présence des forces militaires extérieures, mais également au début de la remontée en puissance d'une force de sécurité malienne.
Colonel Goya, concernant la fragilité de la situation, pouvons-nous, sur le plan militaire, nous comporter comme si le sommet de Pau n'avait pas eu lieu ? La montée en puissance des forces militaires locales signifie-t-elle une évolution de la situation ?
J'ai trouvé les propos de M. Pellerin, sur la problématique du dialogue - avec qui devons-nous discuter ? - extrêmement intéressants.
Monsieur Guichaoua, il était utile de nous rappeler le sentiment antifrançais que ressentent certaines populations et le regard que nous portons sur ces États. Mais, sincèrement, il y a encore dix ans, nous étions pleins d'espérance. Pourtant, il s'agissait du même Mali, des mêmes conflits avec les Touaregs. Des accords de paix avaient été signés et des efforts réalisés pour tenter de les faire respecter. Ne pouvons-nous pas parler aujourd'hui d'un sentiment d'ambivalence de la part de la population ?
Vos propos étaient très intéressants, mais ils nous laissent avec nos questions, non seulement sur le court terme, dans lequel nous sommes engagés, mais également sur les perspectives à moyen et long termes, pour ces pays qui sont à nos portes - y compris en termes de flux migratoires.

Quelles précisions pouvez-vous nous apporter sur le rôle joué - ou non - par les Russes et les Chinois au Sahel ?
Compte tenu de leurs nombreux investissements sur le continent africain, les Chinois ont, me semble-t-il, un intérêt certain à la stabilité de la région. Quant aux Russes, contribuent-ils au sentiment antifrançais ou est-ce une expression locale postcoloniale ?
Enfin, la Russie et la Chine mènent-elles une action concertée en Afrique ?

Je rebondirai sur les propos de Jean-Marie Bockel concernant le continuum de développement, pour indiquer que, dans son article, publié dans le Figaro de ce matin, l'excellent Nicolas Barotte précise que les choses sont en train de se mettre en place entre l'AFD et les militaires. Or, vous nous dites, mon colonel, que cela ne fonctionne pas très bien, voire pas du tout. Pouvez-vous revenir sur cette question ?

Je suis étonné, en regardant les cartes que vous nous avez projetées, de constater que le Sénégal et la Mauritanie sont complètement en dehors des zones rouges et orange. Quelle en est la raison ?
Enfin, d'aucuns ont évoqué le rôle de l'Algérie comme base arrière pour un certain nombre de combattants de l'Azawad et autres djihadistes. La nouvelle politique extérieure algérienne vous donne-t-elle un espoir en la matière ?

Récemment, le président malien a prôné le dialogue avec les chefs djihadistes de son pays, notamment sur RFI et France 24. Ce changement de stratégie locale sonne comme un constat d'échec de la méthode employée jusqu'ici. S'agit-il d'un tournant de la guerre menée au Sahel ou d'autre chose ?

Ma question rejoint celle d'André Vallini : quid de l'aide au développement qui se met en place - son rôle et ses perspectives ?

J'étais à Doha le week-end dernier et, lorsque j'ai vu les talibans discuter avec les forces américaines, je me suis dit « tout ça pour ça », dix-neuf ans après.
Nous devons nous interroger, face à l'évolution de la carte du Sahel - qui devient de plus en plus rouge - sur l'efficacité de notre action.
Le colonel Goya l'a dit, il ne s'agit pas simplement d'un coût financier - 2,5 milliards d'euros -, le coût humain est considérable ; une vie n'a pas de prix. Nous devons penser en permanence à la protection des populations.
Par ailleurs, ces pays dépendent de l'économie informelle. Or, une partie de l'action militaire pour préparer l'arrivée des forces internationales visait à bloquer le trafic qui finance les djihadistes - trafic d'armes, de drogues, d'êtres humains - ce qui est indispensable. Mais, paradoxalement, ne participons-nous pas, en gênant l'économie informelle, au renforcement des djihadistes ? Comment trouver un équilibre entre tenter de bloquer les financements des djihadistes et laisser passer ce qui aide l'économie informelle ?

Colonel, lorsque nous avons reçu le chef d'état-major des armées, il nous a dit qu'il n'y aurait pas de victoire militaire sans restauration des États. Or, nous savons tous où nous en sommes sur cette question. Au Mali, il n'y a plus rien : plus de police, plus d'armée, plus d'enseignants, plus de médecins... Il a ajouté qu'une victoire sur le plan économique était également nécessaire. L'opération Barkhane est bien placée pour savoir ce qu'il faut faire en la matière.
Il a, par ailleurs, évoqué la nécessité d'aider les populations locales, notamment les paysans qui se sont réarmés pour des raisons d'intérêt économique ; si nous ne leur donnons pas les moyens de travailler, ils iront combattre. Où en est-on en la matière ? Depuis septembre 2018, l'AFD dispose d'un chargé de mission permanent auprès de l'opération Barkhane ; cela a-t-il changé quelque chose ?

Ce que nous venons d'entendre relativise beaucoup l'incident de la semaine dernière. Je craignais qu'il nous conduise à être sourds à ce qui a été dit, peut-être de manière contestable, sur la réalité de la situation. Vos propos étaient extrêmement intéressants. Ainsi, ne nous précipitons pas dans l'audition du ministre des affaires étrangères du Mali pour qu'il nous dise ce que nous aimerions entendre, mais qui n'est peut-être pas la réalité.
La solution devra être militaire et politique. Le colonel Goya, comme tous les militaires que nous avons entendus, l'a bien indiqué : une victoire militaire devra s'accompagner d'une victoire politique. Colonel, est-ce que je vais trop loin si je vous dis que j'ai le sentiment que l'intensification des opérations militaires peut éloigner la solution politique ? S'agissant de cette solution politique, avec qui faut-il discuter ?
Outre la question de l'aide au développement, vous avez indiqué, monsieur Pellerin, qu'il convenait d'intensifier les politiques de prévention sociale. Quelles sont les priorités en matière sociale dans ces pays d'Afrique ?
Enfin, la situation réservée aux migrants en Europe joue-t-elle un rôle dans l'état de l'opinion en Afrique à l'égard des opérations comme celle que nous menons ?

Environ 4 500 kilomètres séparent Dakar du Soudan, ce qui rend la tâche difficile. Les forces du G5 Sahel et de Barkhane font face à 800, voire à 1 600 djihadistes, une différence d'effectifs majeure sur un territoire à l'échelle d'un continent. Alors, comment expliquer que nous ne soyons pas en capacité de mieux les cerner ? Est-ce un problème de renseignement, de mobilité ?
Les pertes subies par les armées des différents pays concernés sont considérables ; toute attaque entraîne la mort de soixante à quatre-vingts soldats. Plusieurs officiers de l'armée française que nous avons auditionnés ont évoqué l'idée selon laquelle il conviendrait d'intégrer, dans les unités africaines, des soldats français, plus aguerris, plus efficaces. Bien entendu, le risque humain est tellement important que cette solution ne sera pas envisagée.
Quel est votre sentiment sur ce rapport de forces : les djihadistes contre les forces en présence qui sont malheureusement peu efficaces ?
je commencerai par répondre à la question du président Cambon. Le départ des forces françaises serait perçu comme un abandon - et peut-être à raison - de la part des États sahéliens. Je vous rappelle qu'ils s'accordent à dire que tout est de notre faute du fait de la Libye. De sorte que si la France se retire, le message envoyé sera qu'elle n'assume pas ses fautes. Sans les forces françaises, les États sahéliens seraient en très grande difficulté.
Je n'empièterai pas sur le domaine de prédilection du colonel Goya, mais effectivement, la question du format peut se poser. D'aucuns suggèrent un format focalisé sur les forces spéciales, plus concentré sur des cibles importantes, avec un retrait progressif du nombre de troupes impliquées dans des opérations qui pourraient être concédées aux armées nationales. Cela me semble intéressant.
Monsieur Bockel, vous évoquiez le sommet de Pau comme le départ d'une synergie sécurité-développement. En réalité, malheureusement, il faudrait dire défense-développement. Au moment où la France appelle de ses voeux une augmentation des moyens des forces de sécurité - qui ont la mission de sécuriser les territoires -, ce sont bien les armées qui prennent le pas sur les forces de police et de gendarmerie. Cette synergie défense-développement pose donc déjà, en soi, un problème.
Ensuite, je suis extrêmement dubitatif quant à l'opérationnalisation de cette synergie, même s'il est vrai que le sommet de Pau a accéléré la coordination des bailleurs à travers l'Alliance Sahel, à qui des moyens ont été alloués, et que le rapprochement avec les opérations militaires s'opère. Mais la traduction sur le terrain n'existe pas. Je ne sais pas qui, à l'AFD, à Bamako, a prétendu que des choses se mettaient en place, mais je vous assure que rien ne se passe.
Pour revenir au sommet de Pau, à partir du moment où la manière employée par les forces de défense et de sécurité pour répondre à la menace représente une part du problème, comment voulez-vous que la situation ait évolué en deux mois ; les armées n'ont pas changé. Le problème de gouvernance de ces forces est toujours aussi impérieux.
En outre, les groupes d'autodéfense, véritables vecteurs de violence locale, voient leur nombre augmenter de façon considérable. De fait, il est inimaginable d'envisager un projet de développement - qui tiendrait compte d'une régulation, des questions de cohésion sociale et de développement - dans des zones où les groupes d'autodéfense communautaires sévissent.
Par ailleurs, les espaces sont progressivement vidés des populations civiles. Là encore, comment imaginer des projets de développement sans elles ? Ce n'est pas possible, d'autant que les chefs traditionnels et les élus sont également en phase de retrait. Nous comptons 800 000 déplacés internes (DPI) au Burkina Faso, essentiellement pour la partie septentrionale du pays. Si un projet de développement est mis en oeuvre avec seulement une partie de la population, au retour des personnes déplacées les problèmes seraient énormes. Il n'est pas raisonnable de parler de développement dans cette région, actuellement.
Et puis qu'entendons-nous par développement ? Il ne s'agit pas uniquement de construire des routes et des barrages. Il convient aussi de s'intéresser à la justice sociale. Les gens prennent moins les armes parce qu'ils manquent de routes, que pour contester un projet de développement mal ficelé qui aboutira à les exclure de leurs terres.
Nous pouvons imaginer des projets de soutien au pastoralisme, aux bassins d'agriculture ou autres, mais, tant qu'ils ne seront pas réalisés dans un cadre qui inclura les populations, ils ne fonctionneront pas. Or, il existe un véritable problème de gouvernance dans les trois pays qui concernés, notamment sur la manière dont l'accès aux ressources est géré.
Définir une gouvernance est prioritaire. En parallèle, des actions d'aide d'urgence et de stabilisation peuvent être menées. La stabilisation ne passe pas, encore une fois, uniquement par des actions génératrices de revenus ou par des projets à haute intensité de main-d'oeuvre, mais aussi par des systèmes éducatifs plus adaptés, par exemple au mode de vie nomadique de ces populations. Enfin, elle passe par un accès renforcé à la citoyenneté, la plupart des populations nomades ne disposant pas de papiers, ce qui les expose à des formes de racket. Ces actions, qui ne sont pas économiques, participent au développement de la cohésion sociale qui doit être renforcée dans ces espaces.
Vous nous demandez également si l'intensification des opérations est compatible avec une solution politique ? D'aucuns prétendent qu'avant de négocier il faut taper fort pour être en position de force. Mais, pour les mêmes raisons, nos adversaires ne vont pas attendre d'être fragilisés pour négocier.
Malgré les succès apparents des opérations, ces dernières semaines, je ne suis pas certain que Barkhane ait récupéré autant de matériels que cela. Je vous rappelle qu'en 2019, les attaques djihadistes qui ont été conduites ont été sans commune mesure avec ce qui avait été fait auparavant et le matériel qu'ils ont récupéré est donc considérable.
Comme l'a indiqué le colonel Goya, la capacité de régénération des groupes djihadistes est très grande. Bien que les opérations menées contre eux soient extrêmement intenses, ils continuent de conduire des attaques qui fonctionnent et dont les bilans sont lourds - je pense au camp de Mondoro, au Sahel Burkinabais. L'opération Barkhane ne sera donc pas décisive dans la désorganisation et la fragilisation de ces groupes. S'il s'agit juste d'une étape consistant à les fragiliser durant trois mois pour ensuite négocier, cela peut être une bonne option. Mais je ne suis pas certain qu'il s'agisse de l'agenda actuel, car cela signifierait qu'il existe une entente entre les États sahéliens et la France pour opérer militairement puis négocier, ce qui n'est pas le cas.
Concernant le dialogue et la façon dont il est conduit, des actions sont menées sur le terrain, des canaux sont ouverts, notamment dans le centre du Mali, à Mopti - à Kidal, des actions sont également en cours. Le problème majeur est qu'ils sont trop nombreux ; chaque acteur politique a son propre agenda et veut placer son intermédiaire dans ces filières de dialogue, ce qui aboutit à des initiatives concurrentielles, avec des acteurs qui ont perdu tout crédit auprès des groupes et qui décrédibilisent la manière dont le dialogue est conduit.
Enfin, s'agissant du trafic, je suis extrêmement réservé sur l'idée selon laquelle les trafics de drogues et de migrants alimenteraient les filières djihadistes, même si, effectivement, l'économie de guerre fonctionne bien.
Colonel Michel Goya. - Je m'attacherai plus spécifiquement aux aspects militaires.
Nous savons à quoi peut ressembler la paix dans ce type de conflit. L'État local doit avoir rétabli une administration permanente, légitime, honnête, équitable et qui fonctionne à peu près, une administration soutenue par des forces de sécurité efficaces, qui répondent aux menaces politiques et criminelles - sachant que la principale menace provient des groupes irréguliers. Face à eux, la réponse - locale, bien entendu - doit être à la fois militaire, policière et judiciaire. Une unité comme le Bataillon d'intervention rapide (BIR) au Cameroun cumule ces fonctions.
Alors, nous pouvons envoyer des forces pour assurer la sécurité, et des personnels de l'AFD pour mettre en place des projets de développement, mais nous ne sommes pas destinés à rester. Sinon, cette présence ressemblera, à nouveau, à une administration coloniale.
Monsieur Yung, en effet, en termes de sécurité, la Mauritanie a réussi une transformation militaire efficace, avec l'aide de la France et des États-Unis, notamment. Considérée pendant longtemps comme l'un des États les plus faibles de la région, sur lequel se concentraient de nombreuses attaques entre 2005 et 2011, sa transformation n'était pas gagnée d'avance.
Pour réussir une transformation militaire, il est indispensable que les forces soient aussi à l'aise sur le terrain que l'adversaire. Pour se faire, la Mauritanie a notamment créé des groupes spéciaux d'intervention, des unités de nomadisation qui coopèrent avec les forces spéciales françaises, qui parfois les accompagnent. Il s'agit là d'un excellent exemple d'unités bien adaptées au terrain, qui contrôlent une partie de la frontière. Par ailleurs, huit bataillons mauritaniens sont implantés dans des villes clés et contrôlent les lieux habités de la zone désertique. Ils s'appuient sur un réseau de renseignement, notamment humain, très performant. Enfin, troisième élément, les forces d'intervention rapide sont susceptibles, à tout moment, d'intervenir. Il s'agit d'une formation d'intervention low-cost, technique, à bas coût, mais qui dispose d'une force aérienne performante de vingt-six avions. Je rappelle que le budget de la défense de la Mauritanie est de quelque 200 millions d'euros. Mais ce système n'aurait pas pu fonctionner, si les soldes n'avaient pas été rétablies et si les soldats n'étaient pas fiables.
Il est beaucoup plus compliqué d'instaurer un tel système au Mali, les problèmes étant, je l'ai dit, structurels, plus profonds. Placer ces forces sous notre tutelle - les payer nous-mêmes - est une solution inenvisageable.
La mission de formation de l'Union européenne au Mali (EUTM) a formé 14 000 soldats maliens, un nombre infiniment plus important que le nombre de combattants djihadistes. Pourtant, cela ne fonctionne pas, les problèmes structurels de corruption, n'étant pas résolus.
Alors pourquoi sommes-nous dans cette région ? Il est difficile de dater le début de l'engagement de la France au Sahel, comme il sera difficile d'en dater la fin. La guerre contre les organisations djihadistes a commencé en 1994-1995, lorsque vingt-six Français ont été tués en Algérie et en France par AQMI, qui avait également menacé de crasher un avion sur Paris. Les djihadistes d'aujourd'hui sont les héritiers d'AQMI et ils nous détestent toujours autant.
La conception stratégique est celle du bouclier éloigné, visant à contenir les adversaires dans la région pour éviter des attaques trop violentes, sur place, ou là où nous détenons des intérêts, comme en Côte d'Ivoire ou dans la région du golfe de Guinée, ou encore sur le territoire métropolitain. Cette vision est peut-être exagérée ou fausse et peut-être que, si nous disposons d'un bon système de protection en France et de bons services de renseignement, nous ne risquons pas grand-chose.
C'était aussi le discours que nous tenions pour justifier notre intervention en Afghanistan. Les attaques d'origine afghane se sont-elles multipliées sur le territoire français depuis notre départ d'Afghanistan ? Non, mais nul ne sait toutefois véritablement quel est le degré de menace dans cette région. Il importe de se placer dans la longue durée, car les problèmes sont complexes et ne se résoudront pas du jour au lendemain. Il convient donc d'être patient, même si cela n'est pas toujours compatible avec les mandats ou les agendas politiques.
La coopération civilo-militaire entre l'AFD et l'armée constitue un peu une arlésienne. La question de la cohérence de nos actions est un problème ancien, qui se posait déjà en Afghanistan. Le sujet est compliqué pour de nombreuses raisons. Vous me demandiez si l'action militaire n'aboutissait pas à entretenir le conflit : peut-être, mais on pourrait dire la même chose, parfois, de l'aide au développement. Les groupes armés qui contrôlent une région sont bien contents de voir arriver des organisations non gouvernementales (ONG) qui s'occupent de la population et les déchargent de cette action, sans parler des ressources qui sont détournées au profit de ces groupes. En Afghanistan, j'avais calculé que l'aide qui parvenait réellement aux villages afghans n'était que de 10 % de l'aide versée... Une partie finissait dans les poches des talibans et contribuait à financer leur mouvement ! C'est pourquoi il faut mener ces actions dans le cadre d'une stratégie globale de réimplantation de l'autorité locale dans la longue durée.
En ce qui concerne l'alignement des politiques entre le militaire et le développement, peu de choses ont changé sur le terrain, mais une « révolution » a eu lieu à l'échelle de l'administration française. Lorsque l'on discute avec des personnes du Quai d'Orsay, de Balard ou de l'AFD, ceux qui travaillent sur le Sahel parlent d'un alignement un peu miraculeux des différentes administrations, même si, sur le terrain, la situation n'est pas réglée. Il semble, en effet, un peu prématuré d'envisager des actions de développement sur des terrains laissés à feu et à sang par les différentes actions militaires. De plus, avec quels partenaires allons-nous travailler ? Faut-il récompenser ceux qui nous ont aidés dans la lutte contre le terrorisme ? Ce serait la porte ouverte à tous les règlements de compte via les projets de développement. On évoque un nexus, une conjonction entre la sécurité et le développement ou entre la défense et le développement, mais on ne parle quasiment jamais de la gouvernance : qui peut légitimement prétendre gouverner certaines zones ? Nul ne se pose la question. L'administration française raisonne de manière trop bureaucratique. On a l'impression qu'elle s'efforce d'offrir des solutions à des problèmes qu'elle a conceptualisés dans ses propres termes. On cherche à définir des plans d'action, avec des administrations responsables, on évoque un alignement entre le civil et le militaire, mais en fait cela s'apparente à de l'ingénierie sociale, depuis Paris... Nul ne demande aux Maliens ou aux Nigériens ce qu'ils souhaitent réellement ni ne pose la question de la légitimité des autorités avec lesquelles on agit. Notre réflexion est très centrée sur nos capacités étatiques, mais celles-ci n'existent pas nécessairement dans les pays du Sahel.
J'en viens à la question du règlement politique et de l'articulation avec le militaire. Un chercheur américain a qualifié la guerre en Afghanistan de guerre multifocale : on se bat contre des terroristes affiliés à des organisations transnationales, mais qui se nourrissent de clivages locaux. Le règlement politique de la crise consiste donc à raccommoder, à une échelle locale, les communautés qui ont, pour une raison ou une autre, pris parti pour un camp ou pour un autre, pas toujours volontairement d'ailleurs. Or nous n'avons pas les outils pour mener ce raccommodage depuis Paris : nous ne sommes pas au Sahel, nous ne parlons pas les langues locales, nous ne connaissons pas l'histoire des relations communautaires. C'est aux pays concernés de mener ce raccommodage.
Un dernier mot sur l'action militaire. Nous sommes en train d'abattre nos cartes, les unes après les autres, et nous nous apercevons que nous n'en avons plus tellement en main ! La dernière fut la création de l'unité de forces spéciales européennes « Takuba », réunissant certains de nos partenaires européens. Ces forces seront en première ligne pour former et accompagner les armées locales. Mais si, fin 2020, nous n'avons pas obtenu de résultats, je ne sais pas quelles solutions nous pourrons trouver. L'année 2020 sera critique.
En ce qui concerne les armées locales, des initiatives ont été prises. Le Mali, en matière de contre-insurrection, a tendance traditionnellement à armer des milices, ce qui conduit à une exacerbation des conflits entre les groupes et à une prolifération des armes sans contrôle. C'est une politique à courte vue, qui n'a rien de républicain ! Une fois que l'on a armé les gens, il est difficile de les désarmer.
Le Burkina Faso privilégie le recours à des volontaires, mais c'est une stratégie quelque peu suicidaire, car ils doivent affronter des combattants aguerris. Je ne rappellerai pas les défaites qu'ont subies les armées locales à Boulkessy, Inates, Indelimane, etc. Les mouvements djihadistes comptent des combattants qui ont fait plusieurs campagnes successives et remporté plusieurs batailles, tandis que les forces nationales sont peu expérimentées. Recruter des volontaires semble donc dangereux, sauf s'il s'agit de milices comme au Mali.
Le Niger réfléchit à l'intégration des populations de périphérie, souvent des communautés nomades, dans l'armée. Ce projet avait déjà été évoqué avec les anciennes forces nationales d'intervention et de sécurité (FNIS). Il s'agit de faire en sorte que l'armée soit plus inclusive, associant toutes les communautés, ce qui peut contribuer à désamorcer certaines tensions. Toutefois certains acteurs semblent réticents ou en marge du processus, à l'image de la communauté peule. Nous n'en avons donc pas nécessairement fini avec les tensions.
Il est intéressant de constater que, face à des situations assez comparables, le Mali, le Burkina Faso et le Niger font des choix sécuritaires différents.