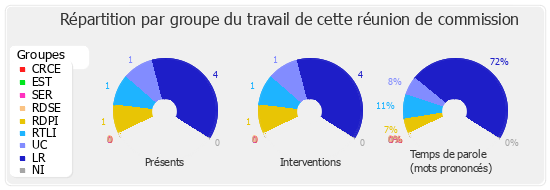Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale
Réunion du 24 mars 2021 à 10h15
Sommaire
La réunion
La commission soumet au Sénat la nomination de MM. François-Noël Buffet, Marc-Philippe Daubresse, Étienne Blanc, Loïc Hervé, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, MM. Hussein Bourgi et Thani Mohamed Soilihi, comme membres titulaires, et de Mme Brigitte Lherbier, M. Stéphane Le Rudulier, Mmes Jacky Deromedi, Françoise Gatel, MM. Jean-Yves Leconte, Jean-Yves Roux, et Mme Éliane Assassi, comme membres suppléants, de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la sécurité globale.

Nous accueillons aujourd'hui en visioconférence M. Bertrand Mathieu, professeur à l'École de droit de la Sorbonne à l'Université Paris-I, directeur du Centre de recherche de droit constitutionnel et président émérite de l'Association française de droit constitutionnel.
Notre audition porte sur le projet de loi constitutionnelle complétant l'article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l'environnement, qui a été adopté par l'Assemblée nationale et sera examiné en séance publique par le Sénat dans le courant du mois de mai. Je salue la présence, outre les membres de la commission des lois, de Guillaume Chevrollier, rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable sur ce texte.
Monsieur le président, c'est un honneur pour moi d'être entendu par votre commission afin de transmettre des éléments d'appréciation sur ce texte. Pour ce faire, je reprendrai le canevas des questions qui m'ont été adressées.
La première portait sur le droit en vigueur, tel qu'il résulte de la jurisprudence constitutionnelle.
Le Conseil constitutionnel a reconnu pleine valeur constitutionnelle à la Charte de l'environnement, même si les droits et principes qu'elle reconnaît ne créent pas d'« effet cliquet » : il est toujours loisible au législateur de modifier, dans le cadre de sa compétence, des textes antérieurs ou de les abroger, à la condition de ne pas priver de garanties les exigences constitutionnelles. Les dispositions de la Charte de l'environnement constituant pour l'essentiel des objectifs de valeur constitutionnelle, elles peuvent justifier la limitation d'autres droits ; il appartient au juge constitutionnel ou administratif de vérifier que les autorités normatives poursuivent effectivement ces objectifs.
Le respect de l'obligation de promouvoir un développement durable s'apprécie au regard de la conciliation opérée entre les objectifs environnementaux, économiques et sociaux. L'environnement est un patrimoine commun qui confère au législateur la faculté, voire le devoir, de promouvoir la protection de celui-ci sur l'ensemble de la planète - c'est une innovation dans la jurisprudence constitutionnelle. Certaines dispositions de la Charte peuvent être invoquées à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), notamment l'article 1er (« Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé »), l'article 2 (« Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement »), l'article 3 (« Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences », l'article 4 (« Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement [...] ») ou encore l'article 7 (« Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement »).
Le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont très largement développé les potentialités de la Charte. Ce n'est pas un document seulement programmatique ou symbolique ; comme toute norme constitutionnelle, elle produit des effets.
La question se pose de savoir ce qu'apportera l'inscription de la préservation de l'environnement, de la diversité biologique et de la lutte contre le dérèglement climatique à l'article 1er de la Constitution.
Le problème peut être appréhendé de deux manières. On peut considérer que cette inscription est essentiellement symbolique et destinée à montrer le poids accordé aux questions environnementales au sens large du terme. Cependant, ce point de vue ne peut être retenu, car il faudra nécessairement articuler cette disposition avec les autres normes constitutionnelles relatives à l'environnement. Cette cohérence est essentielle, et j'y reviendrai.
J'en viens à la portée du terme « garantit ». On retrouve cette expression à plusieurs reprises dans la Constitution : aux articles 12 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au troisième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 qui garantit à la femme des droits égaux à ceux de l'homme, ou encore aux onzième et treizième alinéas de ce même préambule. Ce terme emporte des effets assez variables selon le principe auquel il se rattache. Il peut renvoyer à un droit ou à un simple objectif comme le droit à la santé. Donc, théoriquement, le choix du terme « garantit » ne change pas la nature de la protection constitutionnelle, avec deux bémols : en premier lieu, l'inscription du principe de préservation de l'environnement à l'article 1er de la Constitution le place au même niveau que les droits subjectifs que sont l'égalité devant la loi et le droit au respect des croyances ; en second lieu, la conciliation des objectifs environnementaux, sociaux et économiques n'est pas mentionnée, ce qui pourrait éventuellement conduire le juge constitutionnel à glisser d'une conciliation à une hiérarchisation. C'est dire l'importance des travaux préparatoires pour guider l'interprétation du juge.
Le risque est que cette nouvelle disposition introduise un certain désordre dans notre système normatif, au regard tant de sa conciliation avec d'autres dispositions constitutionnelles que de l'emploi du terme « garantit », qui peut renvoyer aussi bien à un objectif constitutionnel qu'à un droit subjectif. Son ajout à l'article 1er serait en outre redondant avec la référence à la Charte dans le préambule de la Constitution.
Le verbe « garantit », au sens propre, est inapproprié : comment la France pourrait-elle à elle seule garantir la préservation de l'environnement et de la diversité biologique ? Tout au plus peut-elle s'engager à oeuvrer en ce sens. À cet égard, la référence dans le rapport fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale à une « quasi-obligation de résultat » paraît excessivement contraignante, imprécise et irréaliste. Il faut plutôt entendre ce terme comme faisant peser sur les pouvoirs publics une obligation d'agir dans un sens déterminé et avec des moyens considérés comme efficaces. Ce terme est donc particulièrement ambigu. Il reviendrait in fine au juge constitutionnel d'en déterminer la portée. Certes, le constituant emploie souvent des formules très larges ; mais il se défausserait ici complètement sur le juge.
La fin de la phrase se contente d'énoncer que la France « lutte contre le dérèglement climatique » : on imagine mal que la France puisse « garantir » l'absence de dérèglement climatique, alors que, dans une conception extensive, elle peut protéger sur le territoire l'environnement et la biodiversité. Toutefois, malgré la différence des termes employés, les obligations qu'ils sous-tendent ne sont pas fondamentalement différentes.
Faire une distinction entre la « préservation de l'environnement », celle de la « diversité biologique » et la « lutte contre le dérèglement climatique » a-t-il un sens ? La référence au climat est nouvelle, alors que la Charte mentionne déjà la diversité biologique. Il ne me revient pas d'établir la différence entre la biodiversité et la diversité biologique, mais il n'est jamais très sain qu'un texte constitutionnel emploie deux termes différents.
Surtout, il me semble que la référence à la diversité biologique et au dérèglement climatique recèle une évolution conceptuelle, car ceux-ci ne relèvent pas directement des droits de l'homme. Cette ambiguïté était déjà apparue lors de l'élaboration de la Charte de l'environnement : s'agissait-il de protéger l'environnement de l'homme, sa santé, ses droits, ou s'agissait-il d'une autre protection, indépendante de celles droits de l'homme ? La Charte vise clairement la protection de l'environnement de l'homme dans son propre intérêt. Une évolution s'est produite avec l'ouverture du champ de la protection à une conception plus vaste, qui peut conduire à relativiser les droits de l'homme et à exiger leur conciliation avec la protection de la biodiversité - cela s'imposera pour l'habitat humain et la préservation de la faune et de la flore.
L'effet premier de ce texte, en ce qui concerne le contrôle de constitutionnalité des lois et de légalité des actes administratifs, est de confier au juge la détermination de la portée des mots « garantit » et « lutte ». Or on sait que le juge constitutionnel fait produire effet à toutes les dispositions contenues dans les textes normatifs. En réalité, ce texte opère un transfert de compétence au juge. Ce renforcement, souvent critiqué, du pouvoir normatif du juge est parfois l'oeuvre du législateur lui-même, et c'est en quelque sorte le cas ici. Ce pouvoir du juge sera d'ailleurs renforcé par la nécessaire recherche de compatibilité entre le nouvel article 1er de la Constitution et l'article 6 de la Charte, qui impose une prise en considération égale de la protection de l'environnement, du développement économique et du progrès social. Ici encore, le texte manque de cohérence, de clarté et constitue une source d'insécurité juridique.
Ce nouveau principe pourra-t-il être invoqué dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité ? A priori non, car il ne s'agit pas d'un droit ou d'une liberté dont un requérant pourrait se prévaloir, mais des associations s'y essaieront sans doute. La réponse est encore entre les mains du juge ; si elle était affirmative, toute la législation antérieure pourrait voir sa constitutionnalité réexaminée en raison du changement de circonstances.
Autre question très importante : l'engagement de la responsabilité des pouvoirs publics devant les juridictions françaises. L'utilisation du terme « garantit » implique pour le moins, à défaut d'une obligation de résultat, une obligation d'agir. Les pouvoirs publics pourraient voir leur responsabilité engagée pour ne pas avoir employé les moyens nécessaires à cette fin. Cette responsabilité aurait une portée plus large que celle qui résulterait du non-respect du principe de précaution. L'obligation de garantie dont serait assortie l'action des pouvoirs publics pourrait incontestablement faciliter l'engagement de leur responsabilité devant le juge administratif pour des actes administratifs, mais aussi législatifs, compte tenu de la jurisprudence récente du Conseil d'État sur l'engagement de la responsabilité sans faute de l'État du fait de lois inconstitutionnelles. Même sans aucune atteinte à la santé ou à l'environnement d'une personne, il suffirait d'une absence de lutte assortie de moyens efficaces contre la dégradation de l'environnement, de la biodiversité ou du climat. Le champ de la responsabilité est donc potentiellement extrêmement large. Par ailleurs, si l'on retenait une « quasi-obligation de résultat », on assisterait à un renversement de la charge de la preuve au détriment des pouvoirs publics.
Je ne m'étendrai pas sur l'incidence de cette révision sur les obligations et l'engagement de la responsabilité de la France dans l'ordre international, notant seulement que le Conseil constitutionnel a compétence pour examiner la constitutionnalité des conventions internationales que la France entend ratifier.
Certaines dispositions de la Charte de l'environnement demandent-elles à être précisées ? En vertu de simples considérations de légistique, il aurait peut-être été préférable de modifier la Charte de l'environnement, alors que les droits et les devoirs qu'elle reconnaît sont déjà au même niveau que les droits de l'homme et le principe de souveraineté, selon le triptyque sur lequel repose notre système constitutionnel. Il aurait été tout à fait possible d'y introduire le terme « garantit » et d'élargir le champ de la protection à la biodiversité et au climat, à la seule condition d'une volonté politique du constituant, qui aurait aussi dû veiller à la cohérence interne du texte.
Une autre solution en vue d'assurer la cohérence de l'ensemble des textes et de rester dans l'épure du projet de loi constitutionnelle aurait été de procéder par renvoi, en rédigeant ainsi l'article unique : la France « garantit la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique dans les conditions prévues par la Charte de l'environnement ». Cela, quitte à amender la Charte si nécessaire.
Le principe de précaution, quant à lui, doit être conçu comme un principe d'action et non pas d'abstention. Il impose aux pouvoirs publics une obligation d'information et celle d'agir en prenant en compte les études conduites et en apportant une réponse proportionnée face à un risque potentiel - ce qui diffère de la prévention d'un risque avéré. La jurisprudence du Conseil constitutionnel et celle du Conseil d'État sont pour l'essentiel convergentes, celui-ci se bornant en particulier à vérifier si les mesures prises ne sont pas manifestement insuffisantes. C'est d'ailleurs le sens de l'article 5 de la Charte de l'environnement.
L'effet pervers du principe de précaution est lié non pas au contrôle de l'activité normative des pouvoirs publics, mais à la mise en jeu de la responsabilité de l'administration, voire de la responsabilité pénale des décideurs. La dérive est prévisible, qui consiste à considérer que la réalisation du dommage suffit à caractériser a posteriori une violation du principe de précaution. Ce principe peut donc inciter à l'abstention, en un temps où l'on assiste à un développement exponentiel de la responsabilité pénale des décideurs publics - je me contenterai de mentionner les informations judiciaires ouvertes au sujet de la conduite de la politique sanitaire du Gouvernement. Une réflexion autour de l'articulation entre le principe de précaution et l'engagement de la responsabilité des décideurs serait souhaitable et pourrait conduire à l'élaboration d'un texte législatif.
Vous m'interrogiez enfin sur une éventuelle consécration du principe de non-régression en matière environnementale. Ce principe figure déjà, sous une forme édulcorée, dans le code de l'environnement. Dans sa décision n° 2020-809 DC, le Conseil constitutionnel a refusé de reconnaître une valeur constitutionnelle à ce principe. Non seulement cette décision est parfaitement justifiée, mais il me paraîtrait très dangereux d'introduire une telle disposition dans la Constitution. Ce que l'on a appelé à tort le « cliquet anti-retour » est inapplicable en matière de droits fondamentaux. En effet, le plus souvent, les droits doivent être conciliés ; mais le renforcement de la protection d'un principe affaiblit la protection de l'autre. Il appartient au législateur d'établir un équilibre et au juge d'apprécier si celui-ci n'est pas manifestement déséquilibré. Établir un principe de non-régression conduirait, d'une part, à faire prévaloir la protection de l'environnement sur toute autre considération, sur tout autre droit ou toute autre liberté, et, d'autre part, à la paralysie des pouvoirs publics qui, en cas d'urgence, peuvent être amenés à prendre des mesures portant atteinte temporairement à l'environnement. Le pouvoir du juge serait encore une fois considérablement renforcé, car il devrait apprécier la situation au cas par cas.
Mes réponses peuvent vous paraître quelque peu caricaturales, mais je me devais, dans le délai qui m'était imparti, de pointer tous les problèmes importants.

Vous avez évoqué la décision rendue par le Conseil constitutionnel à la fin de l'année dernière, dans laquelle le juge dit explicitement ne pas reconnaître le principe de non-régression. Il m'a semblé que le Conseil constitutionnel fixait également, dans cette même décision, les conditions dans lesquelles ce principe ne s'appliquait pas. Il y a un paradoxe entre, d'un côté, affirmer ne pas reconnaître un principe et, de l'autre, fixer les conditions dans lesquelles il ne s'applique pas. Peut-on y voir une évolution et un nouveau « verdissement » du juge constitutionnel ?

Nous sommes la chambre des territoires. Je suis, par exemple, président de la commission des routes du conseil départemental de l'Aveyron. Lorsque nous souhaitons créer une voie supplémentaire, nous devons tenir compte de contraintes déjà très strictes, notamment celles fixées par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal).
La manière dont sera rédigé ce projet de loi constitutionnelle aura un impact sur les décisions des collectivités. Et l'hypothèse d'une mise en cause pénale des décideurs pourrait paralyser l'action publique. Il nous faudra être vigilants sur ce point dans un moment où, après la période de la covid, il sera nécessaire de relancer l'activité et d'entreprendre des projets.

En 2002, la commission Coppens avait envisagé trois manières d'intégrer la protection de l'environnement dans la Constitution et rejeté l'idée d'une déclaration de principe dont le contenu serait précisé par une loi organique. Elle a estimé qu'une charte annexée à la Constitution était la forme idoine. Pouvez-vous nous le confirmer ?

Dans le projet de loi Climat et résilience, une disposition concernant l'artificialisation des sols va considérablement freiner certaines politiques publiques et notamment contraindre les communes dans l'élaboration de leurs plans locaux d'urbanisme. Cette disposition consiste à diviser par deux le rythme d'artificialisation constaté sur une période antérieure. La disposition ne fait que limiter la consommation de sol naturel, sans l'interdire. Avec ce projet de révision constitutionnelle, ne risque-t-on pas, au titre de la garantie de la biodiversité, de devoir réduire ce chiffre directement à zéro ?

Dans les différents projets de révision constitutionnelle, un glissement sémantique s'est opéré. On a d'abord pu lire « agir pour », puis « favoriser » et maintenant « garantir » la préservation de l'environnement. Pouvez-vous analyser ce glissement ?
Autre question : à quelle époque fait-on précisément référence lorsque nous parlons de revenir à un état naturel - le mot de « renaturation » est aujourd'hui employé ? En effet, une telle expression peut être source de beaucoup d'interprétations et de contentieux.
Concernant le principe de non-régression, la jurisprudence du Conseil constitutionnel est très classique : on ne peut pas considérer qu'un droit ne peut jamais être remis en cause. En revanche, l'évolution législative ne doit pas priver de garanties légales les principes qui figurent dans la charte de l'environnement. Il ne s'agit pas d'un principe de non-régression, mais d'un principe qui empêche le retrait de toute protection. Descendre en dessous d'un certain seuil conduirait à priver de garanties légales des exigences constitutionnelles.
La question fondamentale, à mes yeux, est la suivante : souhaite-t-on rompre avec la formule de l'article 6 de la Charte de l'environnement, selon laquelle le développement durable comprend la protection de l'environnement, le développement économique et le progrès social ? Si l'on reste dans l'épure de cet article 6, la jurisprudence sera classique, il s'agira de vérifier que le législateur et l'autorité administrative auront bien équilibré ces trois éléments. Si l'on raisonne autrement et que l'on considère, comme le ministre de la justice, que l'on est tenu à une obligation de résultat, la situation sera tout à fait différente.
J'ignore quelle réponse sera apportée. En revanche, je suis certain du nombre considérable de contentieux que les nouvelles dispositions constitutionnelles entraîneraient. Sur cette base, en effet, la création d'un rond-point ou l'artificialisation des sols pourront faire l'objet d'un contentieux. Ce manque de cohérence entre, d'une part, la formule qui serait ajoutée à la Constitution et, d'autre part, celle de l'article 6 de la Charte de l'environnement est, si je puis dire, un nid à contentieux.
Prenons l'exemple de l'artificialisation des sols. La question de la biodiversité doit-elle l'emporter sur le développement de l'habitat ? Le souci est-il de créer un équilibre entre les deux ou de faire prévaloir l'un sur l'autre ? Cette question, si elle n'est pas traitée, sera renvoyée au juge administratif et posera des problèmes.
La place de la protection de l'environnement est éminente dans la Constitution : outre la Charte de l'environnement elle-même, le préambule énonce que le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits et devoirs définis dans la Charte. L'article 1er prolonge le préambule, et la récurrence de la référence à l'environnement n'est pas indispensable.
Mon analyse sur le glissement sémantique souligné par M. le rapporteur pour avis est la suivante : dans « agir pour », on entend l'obligation d'action ; avec « favoriser », se pose le problème de l'équilibre, mais une obligation ne prévaut pas nécessairement sur les autres ; quant au terme « garantir », tout dépend si l'on y entend une obligation de résultat... Encore une fois, instituer une obligation de garantie me semble non seulement dangereux, mais irréaliste. Je ne vois pas comment seuls le législateur ou le gouvernement français pourraient à eux seuls préserver la biodiversité. En employant la formule « participer à la garantie de », le résultat aurait été aussi satisfaisant sur le plan des principes et plus réaliste.

Nous arrivons au terme de cette audition. Merci pour la clarté de vos propos.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo disponible en ligne sur le site du Sénat.

Nous accueillons Dominique Rousseau, professeur émérite de droit public à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directeur de l'Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne (ISJPS), président du conseil scientifique de l'Association française de droit constitutionnel (AFDC), membre de l'Institut universitaire de France (IUF) depuis 1998, membre du comité scientifique de la Revue du droit public, rédacteur à la revue interdisciplinaire Le Temps des savoirs. La commission des lois, monsieur le professeur, souhaite vous entendre sur le projet de loi constitutionnelle en cours d'examen.
Je vous remercie de m'avoir convié à cette audition. C'est toujours un honneur pour un universitaire de partager ses réflexions avec les élus de la Nation.
Pour ne pas faire durer le suspense, d'un point de vue juridique, cette révision constitutionnelle est inutile. Quelle que soit la formulation choisie, l'inscription à l'article 1er de la Constitution de la protection de l'environnement, du respect de la biodiversité et de la lutte contre le réchauffement climatique est juridiquement inutile. Ces principes, en effet, ont déjà une valeur constitutionnelle, supérieure à la loi, qui oblige le législateur, le Gouvernement et les autorités publiques à les respecter. Ces principes sont inscrits dans la Charte de l'environnement, qui elle-même se trouve adossée à la Constitution, de la même manière que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et que le préambule de 1946. Les principes inscrits dans la Charte ont donc la même valeur que les articles de la Constitution.
Faut-il y ajouter expressément la lutte contre le réchauffement climatique ? Cette charte a été pensée et rédigée après la fameuse déclaration du président Chirac : « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. » Elle a donc été précisément élaborée dans le but de lutter contre le réchauffement climatique.
Tout est déjà là sur le plan juridique. La révision de 2008, engagée par le président Sarkozy, ajoute à l'article 34 de la Constitution un alinéa en vertu duquel il appartient au législateur de déterminer les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement, dans le cadre constitutionnel défini par la Charte de l'environnement. Il ne servirait à rien d'inscrire ces principes dans le corps même de la Constitution, les juges se fondant déjà sur la Charte pour apprécier le contenu des politiques publiques ou des lois adoptées par le législateur. Trois décisions rendues récemment par le Conseil constitutionnel le prouvent : celles du 31 janvier 2020, du 10 décembre 2020 et du 19 mars 2021.
La décision du 31 janvier 2020 fait suite à un vote du Parlement interdisant la production, l'importation et la commercialisation de produits phytopharmaceutiques. Les entreprises concernées ayant introduit un recours devant le Conseil constitutionnel au motif que cette loi portait atteinte à la liberté d'entreprendre, celui-ci a répondu que la loi, en effet, portait atteinte à la liberté d'entreprendre, mais que cette atteinte se justifiait par un objectif de de valeur constitutionnelle inscrit dans la Charte de l'environnement, à savoir la protection de l'environnement et la préservation de la biodiversité.
Ce travail d'arbitrage entre différents droits inscrits dans la Constitution est celui du juge. Son rôle est de vérifier que la conciliation est bien raisonnable, proportionnée, adéquate.
La décision du 10 décembre 2020 portait sur le point de savoir si l'autorisation dérogatoire de pesticides était contraire au principe de la protection de l'environnement. Le Conseil constitutionnel a indiqué que l'usage de pesticides portait atteinte à la biodiversité et qu'il y avait bien un risque pour les insectes et la qualité de l'eau. Mais, au regard des garanties figurant dans la loi, il a jugé cette atteinte limitée et non contraire à la Constitution. Sans ces garanties, le Conseil constitutionnel aurait peut-être censuré la disposition. Cela montre que le législateur a intégré en amont l'exigence constitutionnelle.
La décision du 19 mars 2021 est très intéressante. Elle concerne des chartes élaborées au niveau départemental afin de fixer une limite à l'épandage de pesticides ; approuvées par le préfet, celles-ci constituent des décisions publiques. Le Conseil constitutionnel a donc considéré que ces chartes devaient être élaborées non par les seuls représentants des habitants de la zone concernée, mais, conformément à la Charte de l'environnement, par toute personne désirant participer à leur élaboration.
La Charte de l'environnement constitue déjà un cadre, au niveau national comme départemental, pour la détermination de toutes les politiques publiques.
Le texte même de la Constitution et la jurisprudence me conduisent à considérer que la modification envisagée de l'article 1er ne changerait rien à l'état du droit. Cela ne gênerait pas davantage le législateur et ne donnerait pas au Conseil constitutionnel un instrument supplémentaire pour contrôler les pouvoirs publics.
Le Conseil constitutionnel ne contrôle pas les lois au regard des conventions internationales, mais la justice civile et administrative le fait, on l'a encore vu récemment avec « l'affaire du siècle », où le juge administratif a condamné l'État au motif qu'il n'avait pas pris les mesures propres à ce que la France respecte la trajectoire de l'accord de Paris. Les conventions internationales sont donc déjà utilisées, à leur place dans la hiérarchie des normes, ici pour juger l'inaction publique de l'État.
Vous m'avez aussi interrogé sur le vocabulaire, c'est-à-dire sur la différence de portée d'une obligation selon qu'on écrit que l'État « favorise », « garantit », « agit », ou encore « lutte » pour la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Je suis réservé sur l'importance normative que l'on prête à chacun de ces verbes. Le dictionnaire en fait des synonymes, chacun faisant écho et renvoyant à l'autre ; en droit, favoriser, c'est protéger, de même que garantir, sans qu'on puisse en déduire une différence d'impact normatif.
Ce débat avait déjà eu lieu lors de la révision constitutionnelle du 8 juillet 1999, relative à l'égalité entre les femmes et les hommes ; un accord avait été trouvé pour employer le verbe « favoriser », avec cet ajout à l'article 1er de la Constitution : « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. » Cependant, le préambule de la Constitution de 1946 dispose déjà que « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme ». Le rapprochement des deux textes montre que le Conseil constitutionnel n'établit pas de différence normative entre les verbes « favoriser » et « garantir » : il ne considère pas que le premier soit moins contraignant que le second.
Avec la Charte de l'environnement, on pourrait penser que la contrainte est encore plus forte puisque le texte pose l'objectif « l'amélioration » de l'environnement : améliorer, cela peut sembler encore plus contraignant qu'agir ou que garantir, mais dans ses décisions, le Conseil constitutionnel considère cette notion comme synonyme de celle de protection. C'est pourquoi je crois qu'il ne faut pas accorder une valeur juridique plus contraignante à l'un ou à l'autre de ces termes - sans ignorer que ce n'est pas la même chose sur le plan politique.
Vous m'avez interrogé sur le principe de non-régression, que certains appellent « effet cliquet », selon lequel le législateur ne pourrait pas revenir en arrière sur l'état du droit.
Dans sa décision du 10 décembre 2020, saisi de ce motif, le Conseil constitutionnel rappelle que, « s'il est loisible au législateur [...] de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, il [...] ne saurait priver de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé consacré par l'article 1er de la Charte de l'environnement ». Plusieurs politiques publiques sont possibles, au législateur de choisir, mais sans que la voie choisie ne prive le droit énoncé de garanties légales, en l'occurrence le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Le terme « non-régression » ne figure pas dans la Charte, mais la chose y est - et s'il est loisible au législateur de modifier les politiques publiques, c'est dans le respect des garanties apportées au principe énoncé par la Charte.
Je crois donc que, juridiquement, cette révision constitutionnelle est inutile. La proposition n'en vient du reste pas de la Convention pour le climat, mais du Président de la République, qui l'avait inscrite dans son projet de révision constitutionnelle en 2018. J'avais dit à l'époque que je trouvais cette révision inutile, je n'ai pas changé d'avis.

Si je vous comprends bien, les termes n'ont pas en droit constitutionnel le même sens qu'en droit civil, où « garantir » implique une obligation de résultat, et non pas seulement une obligation de moyens ?
Effectivement, on parle d'autonomie des significations par discipline juridique, le Conseil constitutionnel prend d'ailleurs souvent le soin de préciser qu'il emploie des termes « au sens de » telle disposition constitutionnelle - et la responsabilité n'a pas le même sens en droit constitutionnel, la distinction entre obligations de moyens et de résultat n'y a pas cours.
Dans sa décision du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel a-t-il « favorisé » ou « garanti » la préservation de l'environnement par rapport à la liberté d'entreprendre ? En réalité, le Conseil constitutionnel considère qu'aucun droit n'est absolu, mais que chacun doit être concilié avec les autres droits de même niveau dans la hiérarchie des normes, ce qui emporte qu'il ne peut y avoir d'obligation de résultat pour un droit considéré isolément. Le doyen Vedel prenait cet exemple du droit que le préambule de 1946 reconnaît à chacun d'avoir un emploi - « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi » - qui fonde l'obligation pour le législateur de garantir le droit du travail, mais pas une obligation à ce que chacun ait effectivement un emploi.

Quand bien même la révision constitutionnelle serait inutile sur le plan juridique, comme vous le dites, elle aurait cependant des conséquences négatives sur le cours des choses en juridiciarisant plus encore les relations sociales et en entravant l'activité.
La Charte de l'environnement date de 2004, mais les décisions que vous citez n'ont pas deux ans : est-ce à dire que, pendant plus de quinze ans, cette Charte n'a pas été une source de droit pour le Conseil constitutionnel ? L'idée de réviser la Constitution pour y introduire la protection de l'environnement, elle, a pris corps en 2018 : est-ce parce que le recours à la Charte était trop limité ?

J'ai beaucoup apprécié cette intervention, votre propos est toujours stimulant, mais je crois que le débat doit se poursuivre sur la question de la portée juridique de cette révision constitutionnelle. Car si elle devait aboutir, le Conseil constitutionnel en chercherait l'effet utile, en postulant que le peuple français ne se s'est pas dérangé pour rien.
Or, s'il est vrai qu'aucun droit n'est absolu, mais qu'il y a des droits à concilier - c'est ce que fait le législateur, sous le contrôle du Conseil constitutionnel - il me semble que, dans sa rédaction actuelle, le texte du projet de loi constitutionnelle est composé de deux parties qui peuvent avoir des effets bien différents sur notre droit.
Une partie me semble ne poser aucun problème pour la conciliation des droits : lorsqu'on écrit que la France « lutte contre le dérèglement climatique », on n'oblige à aucun résultat - et si nous luttons comme le faisait la chèvre de M. Seguin, qui s'en trouve dévorée à la fin par le loup, nous aurons fait notre devoir contre le dérèglement climatique tout en échouant et sans que le Conseil constitutionnel puisse y trouver rien à redire. Reste que nous inscririons utilement dans la Constitution un objectif de valeur constitutionnelle qui ne figure pas expressément dans la Charte de l'environnement - cela peut avoir son importance si un dirigeant climatosceptique à la manière de Jair Bolsonaro venait à diriger notre pays.
En revanche, lorsqu'on écrit que la France « garantit la préservation de l'environnement et de la diversité biologique », la conciliation des droits est placée dans un cadre bien différent. Je ne suis pas convaincu par votre recours à l'exemple de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, car s'il a fallu alors inscrire dans la Constitution ce principe d'égal accès aux mandats et aux responsabilités, c'est pour donner une base constitutionnelle qui justifie des mesures favorables aux femmes, lesquelles viennent corriger une situation de fait, elle-même due à l'état de la société - car le principe d'égalité inscrit dans le préambule de la Constitution interdisait jusque-là de telles mesures. Je crois qu'il y a une différence entre « favoriser » et « garantir ».
Quand, à son article 2, la Charte de l'environnement dispose que « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement » - ce qui inclut le législateur, comme le Conseil constitutionnel l'a jugé - elle n'oblige pas à grand-chose, car on peut prendre part sans obligation de réussir. Lorsqu'à l'article 6, il est écrit que « les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable » et qu'« à cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social », le texte s'inscrit dans la même logique intellectuelle que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui ne proclame aucun droit sans poser aussitôt les limites de ce droit, à savoir d'autres droit ou l'ordre public. Cet article 6 reste donc dans un monde connu. En revanche, si la France s'engageait à « garantir » la préservation de l'environnement et de la biodiversité, on ne pourrait plus guère en tolérer la moindre atteinte à ces derniers, on en ferait un impératif absolu, qui primerait nécessairement les autres droits. J'aimerais être démenti, mais c'est bien ce que cette partie de la révision constitutionnelle me paraît sous-tendre.
La question est de savoir si les verbes utilisés, entre « garantir » et « favoriser » par exemple, ont une intensité normative différente : je ne le crois pas, parce qu'en réalité, ce qui compte, c'est la conciliation entre les droits. La Charte de l'environnement utilise des verbes apparemment plus contraignants encore que « garantir » ou « favoriser », par exemple le devoir de prendre part à « l'amélioration » de l'environnement, mais cela n'a rien changé au fait que le Conseil constitutionnel contrôle la conciliation opérée entre les divers droits.
Le Conseil constitutionnel a conféré une valeur constitutionnelle à la Charte de l'environnement dès 2006. On débattait jusque-là pour savoir si elle n'était qu'un guide pour l'action publique, sans valeur contraignante. Le Conseil a répondu qu'elle avait valeur de norme contraignante, qui oblige les pouvoirs publics. Le nombre de décisions tient à celui des saisines ; ce n'est qu'à partir de 2010 qu'est venue la question préalable de constitutionnalité, qui a conduit à un recours plus fréquent à la Charte.
Les verbes utilisés dans la Charte ont une intensité plus forte que « garantir » et « favoriser », mais cela n'a pas empêché le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 10 décembre 2020, d'accepter qu'on réintroduise les pesticides, car le législateur assortissait cette faculté de garanties : le juge a concilié plusieurs droits. Sa décision aurait-elle été différente si la Charte avait disposé que les politiques publiques « garantissaient » un développement durable ? Je ne le crois pas et je pense également que le Conseil aurait pu s'appuyer sur les verbes « promouvoir » et « améliorer » pour censurer cette réintroduction des pesticides même dérogatoire, puisqu'elle ne saurait « améliorer » la préservation de l'environnement et de la biodiversité.
Je comprends le débat politique sur les verbes, mais je pense qu'ils n'ont pas en eux-mêmes une force qui les fasse échapper au contexte dans lequel le juge les interprète. Aujourd'hui, ce qui importe au Conseil constitutionnel, c'est que les politiques publiques protègent la biodiversité et l'environnement en conciliant cette protection avec les autres droits. Je ne pense donc pas que, sur le plan juridique, il y ait une différence importante entre les verbes « favoriser » et « garantir ».
Des verbes différents sont d'ailleurs utilisés dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, mais le Conseil constitutionnel les met sur le même plan, comme autant de droits à concilier les uns avec les autres. Voyez par exemple la conciliation entre le droit de grève et la continuité des services publics. Le droit de grève est-il garanti, ou bien promu ? Il est reconnu par la Constitution, et le Conseil constitutionnel le protège en le conciliant avec les autres droits. Certains de mes collègues considèrent que l'article 1er de la Constitution ne regroupe que des « neutrons législatifs », selon la formule de Pierre Mazeaud ; je considère pour ma part que tous les droits énoncés dans la Constitution ont une portée normative, qui s'imposent de ce fait et doivent être conciliés.
Je n'accorde donc pas l'importance juridique que vous accordez à la différence entre les verbes que vous citez. Cette révision me paraît inutile ; ne modifions pas la Constitution pour faire plaisir. Pense-t-on que le Conseil constitutionnel recherchera l'effet utile et qu'il en sera plus attentif au climat, à l'environnement, à la biodiversité ? Il l'est déjà, il vient de nous le rappeler en jugeant que les chartes d'engagement devaient être rédigées non pas seulement avec les représentants des habitants, mais avec toute personne qui le demanderait - je ne suis pas certain qu'en rédigeant l'article 7 de la Charte de l'environnement le Constituant ait eu à l'esprit d'instituer une nouvelle forme de démocratie directe...
Enfin, peut-être le Conseil constitutionnel fait-il un recours plus marqué à la Charte de l'environnement pour montrer que la révision constitutionnelle n'est pas nécessaire ; c'est une hypothèse qui porte sur ses intentions, je préfère me régler sur ses décisions et je ne vois pas ce que cette révision apporterait au droit positif. Mais je suis persuadé ne pas avoir convaincu le président Philippe Bas...

L'objectif premier était d'éclairer les travaux de la commission. Nous vous remercions de votre participation.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo disponible en ligne sur le site du Sénat.

Dans le cadre de l'examen du projet de révision constitutionnelle, nous recevons à présent Mme Jessica Makowiak, professeur à l'université de Limoges, directrice du Centre de recherches interdisciplinaires en droit de l'environnement, de l'aménagement et de l'urbanisme (Crideau) et responsable du master « droit de l'environnement, de l'aménagement et de l'urbanisme ».
Merci de votre invitation. La parole que je vous livre n'est pas celle du centre de recherche auquel j'appartiens, mais un point de vue personnel qui n'est pas partagé par certains de mes collègues universitaires. Merci de m'avoir envoyé un questionnaire détaillé : je vais y répondre point par point.
Est-il opportun de réviser la Constitution pour y insérer de nouvelles dispositions relatives à la préservation de l'environnement et de la biodiversité ainsi qu'à la lutte contre le changement climatique ? Cette question difficile n'appelle pas une réponse binaire. Je vais être très franche : si vous m'aviez posé la question à propos du premier projet, en 2018, je vous aurais répondu clairement que j'y étais défavorable. Sur le principe même d'une révision, mon point de vue n'a guère évolué, même si le projet actuel est meilleur sur la forme et sur le fond. Il apporte notamment quelque chose sur le plan symbolique. Juridiquement, c'est plus compliqué...
J'ai naturellement consulté l'avis du Conseil d'État rendu à son endroit. Il me semble nécessaire de se montrer très prudent sur l'interprétation des termes, car tout dépend de la manière dont le requérant et le juge se saisiraient de cette modification éventuelle de l'article premier. Cela interdit de faire une réponse trop tranchée. De plus, il faut se demander comment le juge constitutionnel articulerait cette nouvelle rédaction avec la Charte de l'environnement. Beaucoup d'incertitudes demeurent...
Vous me demandez s'il me semble nécessaire de renforcer les exigences constitutionnelles liées à la protection de l'environnement. Oui, c'est nécessaire : cela ne fait aucun doute dans mon esprit. En 2019, au terme d'une recherche sur le bilan de la question prioritaire de constitutionnalité en matière d'environnement, nous avions appelé le Conseil constitutionnel à faire preuve de plus d'audace dans l'interprétation de la Charte de l'environnement, considérant que le problème n'était pas dans le texte, mais dans ce que le juge constitutionnel en faisait. Nous pensions qu'il aurait pu aller plus loin en combinant, bien plus qu'il ne le faisait alors, les références à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à la Charte et au préambule de la Constitution de 1946. Nous l'invitions aussi à s'appuyer sur le préambule de la Charte, qui fait référence à la conservation de la diversité biologique.
Depuis la remise de notre rapport - et il s'agit là d'une opinion personnelle -, sa jurisprudence a évolué dans un sens plutôt favorable à la protection de l'environnement. Dans une décision prise juste après la remise de notre rapport, il a ainsi jugé que la protection de l'environnement constituait un nouvel objectif de valeur constitutionnelle. Plus récemment, toujours en 2020, il a jugé, en se fondant sur l'article 2 de la Charte, que le législateur ne saurait « priver de garanties légales » le droit à l'environnement consacré à l'article premier.
Je suis donc un peu embarrassée pour trouver des arguments en faveur du projet de révision... En tant que juriste, j'essaie toujours de trouver des arguments pour et contre.

Vous n'êtes pas obligée d'en trouver : vous n'êtes pas l'avocat du projet du Gouvernement...
Ses apports sont limités. Depuis que la commission Coppens a réfléchi à la Charte de l'environnement, la crise climatique s'est accentuée, les contentieux climatiques se sont multipliés, les enjeux liés à diversité biologique ont pris plus de place.
Cette révision aurait donc au moins un effet symbolique : celui de réitérer l'exigence de protection de l'environnement à l'article premier, à côté des autres valeurs fondamentales de la République. Je dis bien réitérer, puisque cette exigence déjà présente ailleurs : si le changement climatique ne figure pas nommément dans la Charte, la biodiversité et la protection de l'environnement y sont. Il est vrai qu'en mentionnant le dérèglement climatique, la France serait une sorte de modèle, car très peu de Constitutions dans le monde y font référence.
Une modification de l'article 1er est préférable à celle de l'article 34, auquel il n'est pas nécessaire de toucher pour donner au législateur la compétence d'agir pour la protection de l'environnement : il l'a déjà, et l'exerce.
Vous me demandez ensuite si « garantir » peut avoir un sens différent de l'utilisation du présent de l'indicatif dans la proposition : « la France lutte contre le dérèglement climatique ». Tout le monde n'est pas d'accord dans la communauté des juristes universitaires.
Pour moi, « garantir » n'institue pas une obligation de résultat - comme le redoute le Conseil d'État, même si ce dernier est bien conscient que cela ne va pas jusque-là, puisqu'il parle de « quasi-obligation de résultat ».
J'ai recherché l'effet que le terme « garantir » pouvait avoir dans le préambule de 1946. Les deux incidences illustrent bien qu'il n'entraîne pas d'obligation de résultat : « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme », « [la Nation] garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. »
Ce verbe a certes un sens juridiquement plus fort que « favoriser » - qui ne veut rien dire. « Agir » a, quant à lui, un sens beaucoup plus fort. « Garantir » implique de tout mettre en oeuvre, et donc une obligation de moyens, sans que le résultat soit forcément atteint. Ce qui est très important, c'est l'objet de la garantie. Or il est en l'espèce suffisamment vague, large, pour ne pas entraîner une obligation de résultat.
L'article 2 de la Charte de l'environnement comporte une formulation tout aussi forte - comme l'interprétation qu'en a faite le juge constitutionnel : « toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. » Il n'y a aucune différence de portée juridique entre l'indicatif présent « lutte contre le changement climatique » et « garantit ».
J'ai des réserves en revanche sur l'objet de la lutte : lutter contre le dérèglement climatique, c'est lutter contre une conséquence, alors qu'il faudrait lutter contre ses causes, soit les émissions de gaz à effet de serre.
Vous me demandez s'il y aurait un sens à distinguer la préservation de l'environnement de celle de la diversité biologique et de la lutte contre le dérèglement climatique. Pour moi, théoriquement, l'environnement inclut tout. Juridiquement, la biodiversité est déjà citée dans le préambule de la Charte. Il n'y a donc pas d'intérêt autre que symbolique à la citer. La définition législative de l'environnement à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, qui donne une définition de ses composantes, cite expressément la « diversité biologique ».
La lutte contre le dérèglement climatique, elle, n'est pas citée dans la Charte. On pourrait donc voir son inscription dans l'article 1er comme un apport. Mais si la protection de l'environnement comprend le « droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » et le devoir pour « toute personne de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement », cela inclut la lutte contre le changement climatique. Dans les composantes de l'environnement citées par le code de l'environnement, figure la « qualité de l'air ».
Si l'on interprète pleinement la charte, il est évident que la qualité de l'air et le climat font partie de l'environnement.
Vous me posez une question plus difficile : quels seraient les effets de cette révision constitutionnelle sur le contrôle de constitutionnalité des lois ? D'autres universitaires sont peut-être plus affirmatifs que moi : je pense, pour ma part, qu'il est difficile de se prononcer. Le juge a une grande marge d'interprétation. Le Conseil constitutionnel l'a montré en n'interprétant pas la Charte comme la doctrine s'y attendait.
Cette modification pourrait entraîner certains effets à l'occasion de questions prioritaires de constitutionnalité, mais tout dépend de la façon dont le Conseil constitutionnel articulerait la Charte avec cet éventuel nouvel article premier. À l'occasion d'un contrôle a priori, c'est peu probable : aujourd'hui, très peu de lois sont ainsi censurées sur le seul fondement de la Charte. Je ne vois donc pas de raison que cela bouleverse la jurisprudence.
Il en va de même concernant le contrôle de constitutionnalité des conventions internationales, car il faudrait imaginer que la France signe un accord contraire à ses propres engagements internationaux - hypothèse peu crédible.
Vous m'interrogez sur la responsabilité des pouvoirs publics. En la matière, il n'y a rien à craindre de ce texte, qui me semble beaucoup moins exigeant que le droit européen, tel qu'interprété par le juge administratif - les directives européennes fixant, elles, des obligations de résultat en matière de protection de l'environnement. Il est rare, au demeurant, que la responsabilité de l'État soit retenue sur le fondement de principes constitutionnels.
Vous me demandez si certaines dispositions de la charte gagneraient à être précisées quant à leur contenu et leur justiciabilité. J'imagine que vous me demandez cela d'un point de vue textuel, et ne visez pas une précision par le juge...
Il me semble totalement inopportun de modifier la Charte de l'environnement. On n'a jamais modifié le préambule de 1946, par exemple.
Cela ne me semble pas utile non plus : ses articles sont clairs, beaucoup plus précis que bien des dispositions du préambule de 1946, telles que le droit au repos ou aux loisirs... Quant à leur justiciabilité, c'est au Conseil constitutionnel de la préciser. C'est ce qu'il a fait, depuis son adoption, au travers des questions prioritaires de constitutionnalité. Les articles 1 à 4 sont invocables, comme l'article 7. Seule question non réglée, celle du principe de précaution édicté à l'article 5. Concernant son préambule, tout le monde doutait de son invocabilité, mais le Conseil constitutionnel n'a pas hésité à s'appuyer sur ses considérants dans sa décision du 31 janvier 2020.
Le principe de précaution me semble être le principe le plus précisément défini dans la Charte : le plus longuement - mais cela n'est pas forcément gage de précision - mais aussi le plus clairement. Le Constituant a défini à qui incombait cette responsabilité, à savoir les autorités publiques dans leurs domaines d'attribution, ce qui permet concrètement au juge de faire respecter la répartition des compétences entre ce qui relève de l'État et du pouvoir de police administrative générale du maire. Les conditions de mise en oeuvre du principe sont aussi clairement définies : un « risque de dommage grave et irréversible » - soit deux conditions cumulatives. Les mesures à mettre en oeuvre aussi : l'autorité doit prendre des mesures « provisoires et proportionnées ».
Autre point, peut-être le plus difficile : faut-il consacrer au niveau constitutionnel un principe de non-régression ? Cela dépend de l'analyse que l'on fait de la dernière décision du Conseil constitutionnel de fin 2020 à laquelle j'ai fait allusion.
Le Conseil d'État affirme dans son avis - un peu rapidement, à mon sens - que le Conseil constitutionnel refuse, dans cette décision, de consacrer un principe de non-régression. Certes, il ne consacre pas ce principe, mais cette décision constitue pourtant une avancée dans le domaine de la non-régression, en ouvrant des potentialités. Le juge rappelle en effet la liberté du législateur de modifier ou d'abroger des textes antérieurs - liberté à laquelle il est très attaché - tout en affirmant qu'il ne saurait « priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel », parmi lesquelles figure le droit de l'homme à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Ce qui est nouveau, c'est l'application de cette jurisprudence au domaine de l'environnement. Le Conseil constitutionnel affirme qu'on peut toujours modifier un régime juridique, même constitutionnellement protégé, selon la théorie de « l'effet artichaut » : on peut enlever des éléments de ce régime, mais non en toucher le coeur. Il effectue un contrôle assez classique de la proportionnalité de la mesure, en vérifiant que la décision est justifiée par un objectif d'intérêt général et proportionnée à celui-ci. Ce qui est nouveau, c'est la référence à l'article 2 de la Charte, qui dessine une application implicite du principe de non-régression, puisque l'article 2 implique une obligation que l'état de la protection de l'environnement ne subisse pas d'amoindrissement.
De mon point de vue, c'est au regard de cet article 2 que le juge peut déjà implicitement censurer d'éventuelles régressions. Il ne me semble donc pas nécessaire de consacrer aujourd'hui un principe de non-régression au niveau constitutionnel.
Il y a d'autres raisons à cela : ce principe ne me semble pas suffisamment mûr ni suffisamment compris. Le juge l'applique déjà au pouvoir réglementaire, puisqu'il est inscrit dans la loi. Le Gouvernement est hostile à une telle consécration. Je ne pense pas que ce principe ait atteint la maturité nécessaire pour être intégré au sommet de la hiérarchie des normes. Mais certains universitaires vous diront le contraire.

Je crois que vos propos ont été si clairs que nous n'avons pas de questions. Vous n'êtes donc pas favorable au principe de la réforme ; si toutefois, il fallait continuer l'analyse, la question de son utilité se maintiendrait...
Tout à fait, même si je ne pense pas pour autant que les exigences actuelles en faveur de l'environnement suffisent.