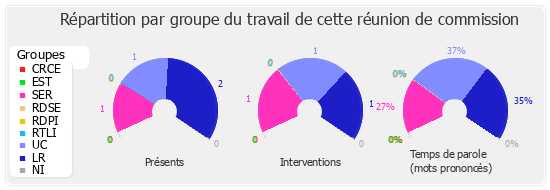Commission des affaires européennes
Réunion du 2 juillet 2020 à 11h05
Sommaire
- Agriculture et pêche
- Institutions européennes
- Table ronde franco-allemande sur le thème : « quel projet allemand pour l'europe ? » autour de m. nicolas baverez économiste avocat contributeur à l'institut montaigne mme claire demesmay directrice du programme relations franco-allemandes du dgap deutsche gesellschaft für auswärtige politik institut allemand de politique étrangère mm. jean-dominique giuliani président de la fondation robert schuman et hans stark conseiller pour les relations franco-allemandes à l'institut français des relations internationales professeur de civilisation allemande à l'université de la sorbonne (voir le dossier)
La réunion

En deux mots, cependant : le Sénat français veut concilier productivité et environnement et ce que l'on dessine au nom du Green Deal ne nous convient pas.
La réunion est close à 11 h 10.
- Présidence de M. Jean Bizet, président
La réunion est ouverte à 11 h 05.
Table ronde franco-allemande sur le thème : « quel projet allemand pour l'europe ? » autour de m. nicolas baverez économiste avocat contributeur à l'institut montaigne mme claire demesmay directrice du programme relations franco-allemandes du dgap deutsche gesellschaft für auswärtige politik institut allemand de politique étrangère mm. jean-dominique giuliani président de la fondation robert schuman et hans stark conseiller pour les relations franco-allemandes à l'institut français des relations internationales professeur de civilisation allemande à l'université de la sorbonne

Bonjour à tous. Je remercie pour leur présence, Nicolas Baverez ainsi que Claire Demesmay, Jean-Dominique Giuliani et Hans Stark.
Je salue également mes collègues sénateurs, qui sont présents au Sénat ou en visioconférence. La présidence du Conseil de l'Union européenne est confiée à l'Allemagne depuis le 1er juillet dernier, au moment où l'Union européenne doit sortir de la crise la plus profonde de son histoire. L'Union européenne est désormais présidée par son État membre le plus puissant. La Commission européenne est également présidée par une ressortissante allemande. Cette coïncidence doit permettre une relance forte, au moment où l'Allemagne ressort renforcée de la crise sanitaire et a fait preuve de son engagement européen en proposant, avec la France, un plan de relance inédit. Celui-ci repose sur la création d'un fonds de relance ambitieux, temporaire et ciblé, adossé au prochain cadre financier pluriannuel.
Compte tenu du caractère exceptionnel des difficultés liées à la pandémie de Covid-19, la France et l'Allemagne proposent que la Commission Européenne soit habilitée à emprunter sur les marchés au nom de l'Union, afin que 500 milliards d'euros de subventions soient octroyés aux secteurs et régions les plus touchés. Cette proposition constitue un tournant majeur de la politique européenne. Il intervient alors que l'Union européenne fait face à un défi existentiel, le Brexit la privant d'un membre éminent et le virus lui ayant fait courir un risque d'éclatement.
Au printemps, la pandémie a servi de révélateur de la fragilité de la construction européenne. L'incapacité de l'Europe à agir face au virus a réveillé les réflexes nationalistes. De fait, comme la crise migratoire l'avait déjà montré, la solidarité européenne n'est pas une évidence. La pandémie a également mis en exergue la dépendance de l'Europe envers l'extérieur, notamment envers l'Asie.
Aujourd'hui, l'Allemagne semble prête à tout pour sauver la construction européenne et intitule le programme de sa présidence « Tous ensemble pour relancer l'Europe ». Même en insistant sur le caractère exceptionnel et temporaire de sa démarche, l'Allemagne innove en soutenant le principe d'une dette contractée par l'Europe pour soutenir les pays les plus touchés par la pandémie. Elle rompt ainsi avec le modèle de l'orthodoxie budgétaire qui justifiait son intransigeance envers la Grèce il y a cinq ans. Elle affiche son ambition de donner à l'Europe une capacité d'agir. Jusqu'alors partisane du libre-échange, elle promeut désormais l'autonomie technologique et sanitaire de l'Europe. Comme la France, elle envisage une révision de la politique de concurrence pour soutenir les entreprises européennes sur les marchés mondiaux.
L'Allemagne serait-elle devenue plus européenne que multilatéraliste ? Néanmoins, son tribunal constitutionnel a rendu début mai une décision marquante, qui remet en cause la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne (BCE) et refuse de reconnaître la primauté de l'ordre juridique européen.
En matière de défense, l'Allemagne ne semble pas prête à échanger l'alliance américaine, même défaillante, contre une hypothétique défense européenne s'appuyant sur la France.
Nous pouvons donc nous demander si nous assistons vraiment à une mutation du projet allemand pour l'Europe. Existe-t-il d'ailleurs un projet allemand pour l'Europe ? L'Allemagne a toujours eu des réticences à concevoir un dessein pour l'Europe et à assurer un leadership. Quelle est la place de la France et des autres États membres dans la vision allemande de l'Europe ? Enfin, cette vision survivra-t-elle au départ d'Angela Merkel ?
Toutes ces questions nous préoccupent. C'est la raison pour laquelle nous avons fait appel à des experts, que je remercie pour leur présence aujourd'hui. Nous aborderons successivement deux thématiques. La première thématique est d'ordre institutionnel, voire géopolitique : Comment l'Allemagne entend-elle articuler sa souveraineté nationale avec la souveraineté européenne, qu'elle reconnaît désormais comme un objectif de moyen terme ? Derrière cette question se profile un questionnement sur la notion de puissance : comment l'Allemagne appréhende-t-elle cette notion, à quelle échelle et avec quelles déclinaisons politiques ?
La seconde thématique est d'ordre économique. La zone euro est menacée par les « incartades » de la cour de Karlsruhe et par les trajectoires divergentes de ses membres. L'Euro a-t-il un avenir ? Comment l'Allemagne l'envisage-t-il ?
Je salue Nicolas Baverez, qui compte parmi les économistes les plus écoutés aujourd'hui. Vous contribuez aux travaux de l'Institut Montaigne qui a souligné, dans une note remarquée de mai dernier, la nécessité de faire converger les économies européennes, notamment en favorisant une augmentation du temps de travail en France. Un tel propos est provocateur, mais frappé au coin du bon sens.
Nous accueillons également Claire Demesmay, spécialiste des relations franco-allemandes, qui vient de publier une note intéressante sur les défis et enjeux de la présidence allemande.
Je souhaite également la bienvenue à Hans Stark, professeur de civilisation allemande à la Sorbonne. Merci de nous faire bénéficier de votre expertise de longue date sur le couple franco-allemand.
Je salue enfin le président de la fondation Robert Schuman, qui connaît aussi bien l'Europe que le Sénat.
Je vous propose d'aborder en premier la question de la souveraineté vue d'Allemagne.
économiste, avocat, contributeur à l'Institut Montaigne. -. Ce terme de souveraineté doit être interrogé. Il est typiquement français. Théoriquement, il s'applique à la nation. Ce mot renvoie surtout à la Révolution française et est étranger à l'Allemagne, qui a surtout raisonné en termes de puissance avant 1945 et raisonne en termes d'unité et de démocratie depuis 1945.
Dans le contexte français, la souveraineté renvoie à l'État-nation. L'illusion que l'Europe se construirait par la destruction des États-nations est derrière nous. Pour clarifier cette question de vocabulaire, il vaut mieux parler de souveraineté pour les États-nations et de puissance pour l'Union européenne.
Les principes sur lesquels s'est refondée l'Allemagne en 1945 sont très proches du projet européen. Ils sont culturellement très différents des valeurs retenues par la République en France, centrées autour de son État. L'Allemagne s'est reconstruite autour de la démocratie, du rôle du parlement, de la force de l'État de droit garanti par la cour de Karlsruhe, du fédéralisme et de l'économie sociale de marché. Le primat du droit et du marché, et non de l'État comme en France, est au coeur de l'Allemagne. En outre, ces différents éléments sont encadrés par la sécurité américaine et par la paix franco-allemande. Dans ce cadre, l'Allemagne a géré sa réunification et la mise en place de l'euro ainsi que l'adaptation à la mondialisation. L'Allemagne a beaucoup bénéficié de ce cycle de mondialisation et de l'ouverture de la Chine. Elle est ainsi devenue le pays le plus puissant d'Europe, mais a exercé un leadership par défaut non assumé, sur fond d'une divergence de plus en plus importante avec la France du fait du déclassement social et économique de l'Hexagone.
Toutefois, ce modèle allemand a été profondément déstabilisé au cours des derniers temps. L'Allemagne se porte très bien sur le plan macro-économique, mais fait face à un problème de vieillissement démographique. De plus, concernant son modèle économique, 47 % de son PIB sont constitués d'exportations : or la Chine se referme, tandis que les États-Unis sont lancés dans une guerre commerciale et technologique. L'Allemagne présente en outre un talon d'Achille dans le domaine financier. Ainsi, la Deutsche Bank est une institution malade et le scandale Wirecard a montré la fragilité de la finance allemande et les failles de la régulation, notamment par l'autorité fédérale de supervision financière (BaFin). Des problèmes de transition écologique se posent également, comme l'illustre le« dieselgate », ou la sortie du nucléaire qui s'est traduite par un retour au charbon. Avec Donald Trump, l'Allemagne doit également faire face à la fin de l'ordre de 1945 et de la garantie de sécurité américaine. Le refus de Madame Merkel de participer au G7 a constitué une réponse à la menace américaine de transférer 10 000 soldats américains d'Allemagne en Pologne.
Aujourd'hui, l'Allemagne n'a plus d'autre stratégie que l'Union européenne. La mondialisation n'est plus une stratégie, puisque ce système se restructure autour de blocs régionaux. Les États-Unis ne sont plus une option en raison de la politique menée par Donald Trump. Même l'éventuelle élection de Joe Biden ne marquera pas un retour au monde d'avant. De même, le Royaume-Uni ne constitue plus une option en raison du Brexit.
Le grand marché et l'Union européenne sont donc vitaux pour l'Allemagne. L'Allemagne doit tenir compte du Brexit et de la contestation du modèle libéral. L'expansion de l'influence allemande vers l'est est aussi contrariée par les régimes d'Europe de l'Est de plus en plus autoritaires.
Le troisième facteur de mouvement, interne, est la décision de Karlsruhe du 5 mai dernier. Depuis lors, les réponses apportées par la BCE et la Bundesbank ont été jugées satisfaisantes. Néanmoins, la décision de Karlsruhe soulève des difficultés juridiques en raison du refus de la suprématie du droit européen sur le droit national, et de la contestation du fait que les institutions européennes ne sont justiciables que devant la Cour de justice de l'Union.
Le tournant allemand intervient dans ce contexte. Le Président de la République affirmait vouloir s'appuyer sur deux piliers : la modernisation de la France et la refondation de l'Europe. La refondation de l'Europe a été bloquée par l'Allemagne durant trois ans. À cause de cette crise sanitaire et économique sans précédent, l'Allemagne s'ouvre. Le changement est ainsi un vrai changement de paradigme. Il est à la fois interne, avec le plan « bazooka » de 1 300 milliards d'euros, mais aussi européen, avec le plan de relance. Ce dernier s'accompagne d'un souhait de changement de la politique de concurrence qui intégrerait l'offre, et pas seulement l'impact sur le consommateur, d'une possibilité d'union pour la santé et d'un mouvement pour la défense. Certes, la défense reste un problème politique important pour l'Allemagne. Néanmoins, le mouvement est incontestable : la chancelière allemande a affirmé que les Européens devaient prendre leur destin en main.
Par ce concours de circonstances heureux, l'Allemagne est en mesure de piloter et d'être le moteur de la relance européenne. Il existe une vraie réflexion sur la façon de faire de l'Union une puissance et de renforcer davantage son autonomie que sa souveraineté. Cependant, l'Allemagne continuera à le faire avec ses principes. Elle ne renoncera pas au droit, au marché, au pragmatisme et au respect des droits des parlements (nationaux et européen).
Enfin, je constate que les régimes autoritaires et les dirigeants populistes gèrent très mal la crise actuelle. A l'inverse, l'Allemagne a gagné une légitimité énorme, puisque le bilan s'établit à 9 200 morts pour 83 millions d'habitants. De plus, elle a déployé un plan de relance économique tout à fait sérieux. Cette gestion de crise, lorsqu'elle s'opère dans un cadre démocratique, permet de faire reculer l'extrême-droite.
Je vous remercie pour votre invitation.
Je suis ravie d'être présente parmi vous. La crise sanitaire présente au moins l'avantage de me permettre d'être à Berlin tout en participant en direct à cette réunion.
Je suis d'accord avec Nicolas Baverez lorsqu'il affirme que le concept de souveraineté s'applique à la nation. Traditionnellement, l'Allemagne est très prudente quant à l'emploi du terme de « souveraineté européenne ». En effet, en Allemagne, l'approche de la politique européenne est très juridique. Le Bundestag est le seul représentant souverain, ce qui rend difficile l'usage de la notion de souveraineté européenne. S'agissant de ces questions de souveraineté nationale et européenne, la cour constitutionnelle de Karlsruhe est très vigilante sur l'utilisation du terme de souveraineté.
De plus, les réticences de l'Allemagne à employer le terme de souveraineté européenne se traduisent aussi dans sa politique industrielle. L'Allemagne est loin d'appliquer une logique colbertiste. Elle ne revendique pas d'intervention de l'État directement dans les questions économiques et industrielles.
Pour autant, les discours changent aujourd'hui. La crise sanitaire a fait émerger une conscience, et a accéléré une prise de conscience des dépendances européennes vis-à-vis de grandes puissances étrangères et de la nécessité de les limiter. Le déclencheur a été le constat qu'il est aujourd'hui en Europe difficile d'accéder à des produits pharmaceutiques fabriqués en Asie (Chine et Inde). La dépendance vis-à-vis de la Chine se situe au centre de cette problématique, dans un contexte de violation des droits de l'Homme dans ce pays.
La chancelière fédérale a parlé de souveraineté européenne le 18 mai. Elle en a reparlé il y a quelques jours lors de la rencontre franco-allemande de Meseberg. Elle n'est pas la seule : les ministres allemands de l'économie, de la santé et des affaires étrangères en ont également parlé.
Ces évolutions signifient que les efforts visant à rendre l'Union européenne plus indépendante se concentrent sur les grandes questions stratégiques que sont la santé et la technologie. L'Allemagne soutient une politique pharmaceutique et de santé européenne, notamment à travers la constitution de stocks de médicaments et de matériels, ainsi qu'à travers la relocalisation d'une partie de la production. Néanmoins, la prudence reste de mise sur ces questions, car la politique reste distante des dossiers industriels et la santé est un sujet nouveau à l'échelon européen.
Sur les questions technologiques, la logique est similaire. La crise sanitaire a souligné le caractère stratégique des questions digitales. Les questions de cloud européen et d'intelligence artificielle mobilisent l'Allemagne et la France sur le plan bilatéral.
L'indépendance européenne présente aussi des limites. Ainsi, tous les sujets ne sont pas concernés. La défense européenne est loin d'être une réalité. De même, l'Allemagne ne souhaite pas se replier sur le marché européen ; la relocalisation totale de la production industrielle en Europe n'est pas d'actualité pour l'Allemagne. L'objectif est surtout de diversifier les partenariats, pour réduire la dépendance à la Chine. Il importe aussi de parler d'une seule voix face aux grandes puissances mondiales et d'éviter les divisions européennes.
De même, les règles du libre-échange international ne changent pas. L'Allemagne reste attachée au commerce international. Les exportations continueront de rester essentielles pour son économie. L'Allemagne souhaite notamment qu'un accord commercial soit rapidement conclu avec les pays du Mercosur.
Aujourd'hui, il existe une prise de conscience profonde, qui ne se traduit pas encore en termes d'agenda politique, mais a permis d'engager un débat. Les conditions sont favorables pour avancer sur ces questions, tant à l'échelle européenne que sur le plan bilatéral franco-allemand.
Bonjour à tous. Je vous remercie pour cette invitation et me réjouis d'être parmi vous à distance. Je reviendrai sur les propos qui viennent d'être tenus, sur le plan de relance franco-allemand et sur la décision de la cour constitutionnelle de Karlsruhe.
Le plan de relance franco-allemand constitue un changement de paradigme. Au début de l'année, l'Allemagne était encore très réticente à l'idée de mettre en place des « Coronabonds » comme le suggérait l'Italie. L'Allemagne a ensuite été très touchée par les images venant d'Italie et d'Espagne.

Nous venons de perdre le contact à distance avec Monsieur Stark. Je propose de céder la parole à Monsieur Giuliani, le temps que nous rétablissions le contact avec Monsieur Stark.
Je vous remercie pour votre invitation. Je suis heureux et honoré d'être présent parmi vous. J'en profite pour saluer mes camarades avec lesquels je note une convergence d'analyse.
Notre réflexion sur le terme de souveraineté reste à approfondir, notamment dans une perspective historique. En France, la souveraineté est attachée à l'État, alors qu'elle est attachée à la nation dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Lorsqu'un État s'est mis en place en Allemagne, des conséquences catastrophiques pour l'Allemagne et le continent européen en ont découlé. La France constitue une exception en Europe lorsque l'État incarne la nation et sa souveraineté.
Après la crise de la Covid-19, nous, Français, devrions nous interroger sur l'efficacité de l'État et sur sa verticalité. Ce point constitue une différence fondamentale avec l'Allemagne.
La réintroduction de l'Allemagne dans le concert des nations après le naufrage du nazisme s'est opérée de deux manières : l'insertion dans le concert des nations dans le contexte de la guerre froide ; l'intégration européenne et l'OTAN.
Depuis le naufrage du nazisme et ce XXè siècle dramatique pour l'Allemagne, ce pays n'est pas un État comme les autres et le restera très longtemps. À l'occasion du 70è anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, la chancelière a affirmé que « se souvenir des crimes, nommer leurs auteurs, rendre aux victimes un hommage digne, c'est une responsabilité qui ne s'arrête jamais. Ce n'est pas négociable et c'est inséparable de notre pays. Être conscient de cette responsabilité est une part de notre identité nationale ». Ce propos doit nous conduire à mieux comprendre cette part de l'identité allemande. Cette identité n'a jamais été stabilisée dans l'histoire du peuple allemand, et encore moins autour d'un État. Elle trouve deux stabilisateurs, l'Union européenne à l'extérieur, la constitution, le droit et la décentralisation en interne. La cour constitutionnelle de Karlsruhe protège ce système auquel sont attachés les Allemands.
Celui-ci entraîne néanmoins des contraintes importantes en matière de politique étrangère pour l'Allemagne. Hier encore, le parlement allemand a refusé de prononcer des sanctions à l'encontre d'Israël pour ses projets d'annexion en Cisjordanie. L'Allemagne estime ainsi ne pas être en mesure de sanctionner Israël en raison de son passé. Ces composantes de l'identité allemande expliquent d'importantes fragilités sur lesquelles la France devrait davantage s'interroger.
Le mot « souveraineté » gêne nos partenaires allemands, mais ceux-ci peuvent entendre les termes d'indépendance et d'autonomie. En effet, dans le contexte de la Covid-19 et de la crise économique qui en découle, le marché unique européen est en cause. Or, s'agissant de la structure du commerce allemand, les exportations intraeuropéennes représentent près de la moitié des exportations allemandes.

Je vous remercie et cède la parole à Hans Stark, avec qui nous avons rétabli la connexion.
Je vous prie de m'excuser pour ce contretemps. J'insistais sur le fait que le plan franco-allemand du 18 mai constitue un changement de paradigme par rapport à la position allemande vis-à-vis de la gouvernance budgétaire et financière de l'Union européenne.
En mars dernier, l'Allemagne affichait encore une forme de fermeté. Cette position a suscité des critiques, y compris en Allemagne. Certains ont en effet considéré qu'il n'était pas possible de traiter la crise sanitaire de 2020 comme la crise de la dette de 2010-2012, dans la mesure où la crise sanitaire est un événement extérieur qui se rattache davantage à l'article 122 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qu'à des conditions de mauvaise gouvernance budgétaire au sein des États membres.
La France ne partageait pas la position allemande. A la fin du mois de mars, la France et huit autres États ont signé une lettre en faveur de la mise en place des « Coronabonds ». À trois mois de sa présidence, il était impératif pour l'Allemagne de se rapprocher de la France, cette présidence ne pouvant réussir qu'à la condition d'une convergence franco-allemande.
La prise en compte du contexte économique s'ajoute à ces éléments. En effet, l'Union européenne et l'Eurozone subissent le décrochage économique entre ses États membres. Le taux de chômage, la balance commerciale et la balance des paiements sont des paramètres qui différencient notamment de plus en plus la France de l'Allemagne depuis 2010-2012. Ce processus de décrochage risquait de s'accroître avec la crise sanitaire de 2020.
L'Allemagne dispose d'une force de frappe à l'échelle nationale équivalente à celle des 26 autres États membres. Ainsi, sans ce plan de relance du 18 mai, elle se sortirait beaucoup mieux de la crise que les 26 autres États membres, ce qui aurait accentué le décrochage entre États membres et donc menacé le marché unique. Or le marché unique est au coeur du projet européen.
L'Allemagne n'ayant pas de réelle alternative aujourd'hui, elle fait un pari différent de celui de 2010. À l'époque, elle s'est tournée vers les pays émergents pour y orienter son excédent commercial (250 milliards d'euros chaque année). Or ces pays émergents (Chine, Brésil, Russie), auxquels s'ajoutent les États-Unis, sont de moins en moins des partenaires. Les États-Unis restent un partenaire, mais un partenaire difficile, qui a sanctionné l'Allemagne, y compris sur le plan militaire avec l'annonce du retrait d'un tiers des soldats américains. La politique de la Chine et celle du Brésil montrent que ces pays ne peuvent plus être considérés comme des partenaires par l'Allemagne. L'Union européenne reste donc le principal foyer de stabilité et d'architecture multilatérale pour l'Allemagne. Il est ainsi impératif pour l'Allemagne de stabiliser le marché unique.
Aujourd'hui, nous rentrons donc dans une logique de politique économique keynésienne à laquelle l'Allemagne est favorable. Une forte coopération franco-allemande est aujourd'hui possible. Toutefois, le keynésianisme allemand est plutôt contra-cyclique, alors que le keynésianisme français est pro-cyclique. L'Allemagne a certes donné son accord à un plan de relance de 500 milliards d'euros, mais elle ne renoncera pas à une politique marquée par des équilibres budgétaires.
La cour constitutionnelle de Karlsruhe n'est pas un acteur politique comme le gouvernement fédéral. Cette précision étant apportée, il est vrai que la cour s'interroge sur la proportionnalité de la politique de la BCE (quantitative easing). En effet, cette politique n'est pas évoquée dans les traités européens et constitue en fait une politique de soutien aux États. Une clarification est donc nécessaire. La cour constitutionnelle a également soulevé la problématique des taux d'intérêt très bas, qui est dissuasive pour l'épargne alors que les Allemands épargnent beaucoup. L'argent se détourne alors des voies classiques et se retrouve dans l'immobilier. Les taux d'intérêt très bas ont conduit à une hausse des prix immobiliers en Allemagne : de nombreuses familles des classes moyennes ont dû quitter les centres-ville, notamment à Berlin.
En conclusion, les intérêts suprêmes de l'Allemagne sont une Europe stable et dont la cohésion économique est assurée.

Je vous remercie pour ces propos très clairs. J'ouvre le débat avec nos collègues sénateurs.

Merci pour la qualité des interventions. La question du Brexit a été mise en suspens à cause du confinement sanitaire. Il conviendra d'être vigilant pour que l'Europe ne soit pas spoliée par un excès de concessions. De quelle façon pensez-vous que l'Allemagne doit se positionner pour mener les négociations ?
Nous connaissons l'importance d'une relance forte et coordonnée. Comment peut-on concilier relance et transition écologique ?
Enfin, je considère qu'il est nécessaire d'adapter les règles de concurrence à la particularité de l'agriculture. Pensez-vous que l'Allemagne prendra en compte cet aspect propre à l'agriculture dans la régulation des marchés économiques européens ?

La dernière question portant sur l'agriculture et la concurrence a été abordée ce matin dans le cadre d'une autre réunion, avec le commissaire européen Janusz Wojciechowski. Un vent environnementaliste fort souffle à Bruxelles, et risque d'emporter l'ensemble de l'Europe.

Je salue également la qualité des interventions. Je reviens sur l'arrêt de la cour de Karlsruhe, qui s'érige en double censeur de la BCE et de la Cour de justice de l'Union européenne. Cette prise de position fait peser des risques sur le respect du droit européen et soulève un risque de dislocation de la zone euro. En effet, si le juge constitutionnel allemand s'érige aujourd'hui en censeur de la Cour de justice de l'Union européenne, ne pensez-vous pas que demain, le juge constitutionnel hongrois ou polonais pourrait également s'engager sur la même voie, et sur d'autres sujets que la monnaie unique ? Que resterait-il alors de l'Union européenne ?

Je cède la parole à Nicolas Baverez, qui doit nous quitter dans quelques minutes, afin qu'il puisse répondre aux premières questions.
S'agissant de la question du Brexit, l'Allemagne a perdu toute illusion sur le Royaume-Uni. Elle a tout fait pour donner plus de délais aux Britanniques pour qu'ils reviennent éventuellement sur le référendum. L'Allemagne n'a ensuite pas ménagé ses efforts pour trouver un accord. Au final, le Brexit sera dominé par la stratégie de Boris Johnson, qui semble consister à masquer la gestion de crise désastreuse de la Covid-19 par une sortie de l'Union européenne sans accord. L'Allemagne risque de se retrouver en position de greffier actant la sortie du Royaume-Uni sans accord.
En matière de relance économique, il importe qu'une dimension écologique soit présente, mais celle-ci ne doit pas être la seule. Trois volets permettent de fonder cette relance : intégrer le green deal, prendre en compte le numérique et s'intéresser à la résilience et à la sécurité (santé, défense). Compte tenu des délais de décision et de mise en place, les fonds européens arriveront dans le meilleur des cas en 2022 ou en 2023. Il faut donc articuler ce soutien européen à terme avec des plans de relance nationaux immédiats. Le principal impact de la crise économique est enregistré dès aujourd'hui, avec les faillites et le chômage. Les plans de relance nationaux doivent donc être accélérés et « faire le pont » entre le confinement et l'arrivée de l'argent européen.
Concernant l'euro, la ligne générale est la même. La monnaie n'a pas le même rôle pour les Allemands que pour les autres européens. L'Allemagne s'est faite par trois fois autour de sa monnaie (en 1871, 1949 et 1991). La monnaie est donc extrêmement importante pour elle et se situe au coeur de la culture de stabilité allemande. Cependant, les principes de Maastricht ont été posés par l'Allemagne en dehors des crises. Et la gestion de la double crise du krach de 2008 et de l'euro de 2010 a été largement ratée. La restructuration grecque a ainsi été peu glorieuse. Il a fallu attendre 2015 pour que l'activité reparte en Europe, alors qu'elle a redémarré dès 2009 aux États-Unis et au Royaume-Uni.
La cour de Karlsruhe a rendu service à tout le monde. Les États européens ont délégué la gestion de la politique économique à la BCE, à la limite des traités, ce qui leur a en outre permis de se désengager et de ne pas opérer d'accompagnement budgétaire. La cour de Karlsruhe a eu raison de poser ce problème. Ce signal d'alarme doit conduire à un rééquilibrage, qui est sain.
Ce changement de paradigme dont parlait Hans Stark vaut également pour l'euro. En 2020, la réactivité a ainsi été beaucoup plus forte qu'en 2008, et la solidarité a été une réalité. La place de l'Allemagne sera centrale. L'Allemagne est ainsi un point d'équilibre entre les pays du sud et les pays « frugaux ». Elle a bien compris que l'éclatement de l'euro entraînerait l'éclatement du marché unique ; il en va de son intérêt vital de l'éviter. L'Allemagne doit s'engager beaucoup plus dans l'union bancaire et dans l'union des marchés de capitaux. Le processus doit néanmoins s'inscrire dans le respect de l'État de droit à l'allemande (respect des traités, respect du parlement allemand et respect du parlement européen).
Le dialogue franco-allemand sera crucial : si la France arrive à se redresser et à éviter que la dette passe de 120 à 160 % du PIB, l'Allemagne pourra continuer à réassurer la zone euro tout en étant solidaire. Si la France doit diverger, la fin de la monnaie unique sera inévitable.
Je m'excuse auprès de tous de devoir vous quitter.

Ne pensez-vous pas que la France aurait besoin de changer profondément ses institutions ? En cas contraire, nous risquons d'accumuler de nombreuses frustrations sur la compréhension du fonctionnement de l'Union européenne. Sur le plan politique, les institutions européennes ne sont pas suffisamment solides. Nous ne comprenons pas ce qui se passe en Allemagne.
Le même propos vaut pour les aspects économiques. Nous croyons que la réindustrialisation est un enjeu européen, alors que celui-ci est profondément national.
Monsieur Leconte a parfaitement raison. Vous faites allusion à un article de presse qui renvoie au fait que les institutions françaises ont été conçues par le Général de Gaulle pour effacer l'effondrement de 1940. À l'inverse, l'Union européenne est massivement calquée sur le modèle parlementaire. Par conséquent, l'Allemagne est « confortable » avec l'Union européenne, alors que la France ne comprend pas le fonctionnement des institutions européennes. Nous projetons à chaque fois notre image ancienne et archaïque d'un État efficace et vertical, alors que l'Union européenne est l'inverse : la formation lente d'un consensus qui anticipe les problèmes. Le modèle français présente toutefois des atouts en matière d'efficacité de chaîne de commandement et de diplomatie.
Il ne s'agit pas d'une opposition entre la France et l'Allemagne, entre la France et l'Union européenne, mais d'une addition de nos qualités qui représente l'idéal européen. La réactivité des institutions européennes mériterait d'être plus forte ; les Allemands y sont prêts en matière commerciale et pour sanctionner des acteurs qui ne respecteraient pas le droit européen. La cour de Karlsruhe a rappelé l'attachement des citoyens allemands à l'État de droit.
La chancelière évoque la nécessité de changer les traités européens pour les aligner sur la pratique. Aujourd'hui, nous avons dépassé les limites des traités. Nous avons développé des pratiques qui se situent hors traités. Nous devons donc modifier les traités, ce qui permettra de libérer l'initiative et la créativité allemandes. Les responsables français ont toutefois peur d'une telle perspective, eu égard à l'expérience de 2005.
Par ailleurs, certains propos sur notre pays ont peut-être été excessivement pessimistes. La France sait percevoir la recette publique depuis Louis XI. Elle est solide, ce qui ne doit pas l'empêcher d'être plus rigoureuse dans la gestion de la dépense publique. Au final, la France n'a pratiquement jamais fait faillite, au contraire d'autres États européens.
L'Allemagne apparaît plus compliquée que la France. En France, les décisions sont prises par le Président de la République et s'imposent au gouvernement et au parlement. En Allemagne, la chancelière n'est pas la seule à décider ; la décision est partagée notamment avec les Länder, la cour constitutionnelle et le parlement. Les Allemands se méfient de la concentration du pouvoir et du concept de « vision ». En France, nous attendons toujours une vision du Président et du Premier Ministre. En Allemagne, il existe à l'inverse des consensus économiques, sociaux et financiers. Nous devrions essayer de cultiver cette qualité. Pour les nouvelles technologies numériques, la France est plus agile que les Allemands. Ces derniers sont plus sensibles aux enjeux écologiques, même si leur industrie rencontre parfois des problèmes d'évolution. L'Union européenne se situe entre l'horizontalité allemande et la verticalité française. La France et ses institutions sont, au niveau européen, plutôt une exception que la règle.
Je me concentrerai sur deux questions. La question du rôle d'une cour constitutionnelle, en Allemagne et dans d'autres pays européens, est centrale. Si le droit allemand a la primauté sur le droit européen, comment ne pas penser qu'il pourrait en être de même dans d'autres pays européens ? Dans le contexte de la violation de l'État de droit par certains États membres comme la Pologne ou la Hongrie, il faut faire respecter le droit européen dans l'ensemble des États membres. La problématique n'est pas uniquement de nature économique et monétaire. Par ailleurs, la difficile question de la révision des traités pourrait prendre plusieurs années.
S'agissant de la relance économique et de la transition écologique, le gouvernement allemand considère que ces deux éléments ne sont pas contradictoires. Pour les concilier, dans le cadre de son plan de relance national, il octroie des subventions conditionnées au respect de critères environnementaux. L'Allemagne investit ainsi dans un plan hydrogène ambitieux (7 milliards d'euros), mais pas dans un plan de mise à la casse. Elle souhaite appliquer cette même logique à l'ensemble européen, dans le cadre des discussions budgétaires. Enfin, le contexte de politique intérieure allemande pourrait permettre l'arrivée au pouvoir des écologistes. Angela Merkel et la CDU sont donc vigilantes à concilier ces deux éléments.
La cour de Karlsruhe n'a jamais affirmé que le droit allemand est supérieur au droit européen. Néanmoins, les failles dans l'application du droit européen et des traités sont soulignées par la cour de Karlsruhe. S'agissant de la BCE, les 19 États membres étaient très heureux de la politique de quantitative easing menée par la BCE, car celle-ci a stabilisé la zone euro depuis 2010. Néanmoins, une telle politique n'est pas couverte par les traités. Ces derniers prévoient que la BCE doit défendre la stabilité monétaire, et non assurer le financement des États. L'arrêt de Karlsruhe est salutaire, car il doit nous permettre de clarifier les traités et le mandat accordé à la BCE.
Les Allemands auraient souhaité que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. En effet, la philosophie de ces deux pays est proche, notamment en matière de libéralisme et de libre-échange. Boris Johnson a néanmoins choqué l'Allemagne : l'accord qui a été adopté entre Londres et l'Union européenne à l'automne 2019, qui constitue un préaccord pour le Brexit, n'est plus respecté par le Royaume-Uni. Or dans la pensée allemande, une telle pratique est très choquante. S'y ajoutent des désaccords entre la Grande-Bretagne et les Européens sur le respect des normes (libre-échange, marché du travail, écologie, etc.). L'Allemagne est très attachée au marché unique, représentant le coeur du projet européen. Par conséquent, et malgré la proximité philosophique et culturelle entre l'Allemagne et le Royaume-Uni, l'Allemagne ne soutiendra pas le Royaume-Uni et les 27 États membres resteront unis.
Enfin, concernant la question environnementale, l'Allemagne souhaite effectivement concilier industrie (23 % du PIB allemand) et écologie. L'industrie est indispensable pour assurer notre autonomie par rapport à nos rivaux mondiaux. L'Allemagne dépend du charbon et 10 % de son économie dépendent de l'automobile, ce qui ne facilite pas la prise en compte des enjeux écologiques. Il faudra vivre avec ces contradictions.

Merci beaucoup pour votre analyse. Je vous propose d'aborder la question de l'avenir de la zone euro.
La zone euro est tenue par des règles budgétaires qui ont implosé pour répondre à la pandémie. La crise a réveillé les clivages entre le sud en difficulté économique et budgétaire et les autres pays. La France parle souvent de réforme, mais n'en engage pratiquement jamais. Par conséquent, la crédibilité de l'euro repose surtout sur l'Allemagne, qui en retour bénéficie beaucoup de l'euro. L'euro ne pourrait exister sans l'Allemagne et sans la position de prêteur en dernier ressort qu'a adoptée la BCE. La politique monétaire européenne ne pourrait éviter une nouvelle crise des différentiels (spreads) de taux si la BCE se voyait interdire de racheter des titres de dette souveraine.
Fondamentalement, la zone euro n'est pas une zone monétaire optimale. Elle ne peut survivre durablement sans une mobilité du travail et du capital, et sans des transferts budgétaires pour compenser l'asymétrie entre États membres. Je crois que nous continuons à porter ce péché originel de la création de la zone euro. Or l'Allemagne se refuse à voir le fonds de relance comme l'embryon d'un budget de la zone euro.
Dans ce contexte, l'éclatement de l'euro est-il inéluctable à vos yeux ?
Je vous propose de prendre la parole à tour de rôle.
L'éclatement de l'euro n'est pas inéluctable. Avant d'expliquer ce point de vue, je souhaite revenir sur l'arrêt de la cour de Karlsruhe. Comme l'indique Hans Stark, la cour de Karlsruhe n'affirme pas qu'il existe une primauté du droit allemand sur le droit européen ; elle s'est uniquement prononcée sur la participation allemande à la politique européenne. Dans les faits, si la Bundesbank ne participait plus aux programmes de la BCE, ces programmes seraient remis en question et la BCE aurait les mains liées en raison du poids qu'y représente l'Allemagne.
Il faut distinguer Karlsruhe et Berlin. L'arrêt de Karlsruhe pourrait fragiliser la zone euro, mais il ne faut pas sur-interpréter cette décision sur le plan politique. Le gouvernement fédéral allemand a été silencieux durant les jours qui ont suivi cet arrêt, ce qui a généré de la nervosité chez les partenaires européens. Aujourd'hui, la chancelière Merkel considère que les gouvernements nationaux doivent s'engager davantage en faveur d'une politique économique commune. Le plan franco-allemand du 18 mai dernier répond complètement à cette logique. De même, le ministre des finances allemand estime que la BCE respecte les exigences formulées dans l'arrêt du 5 mai.
Cette position ne vaut pas seulement pour le gouvernement allemand, mais pour la quasi-totalité des partis représentés au Bundestag (CDU-CSU, FDP, SPD et les Verts). Ainsi, ce consensus est large et dépasse les clivages partisans.
La logique de l'apaisement prévaut aujourd'hui. Un changement de paradigme est à l'oeuvre, caractérisé par l'initiative franco-allemande et par le soutien au fonds de relance. Cela ne signifie pas pour autant que l'Allemagne est prête à ouvrir les robinets financiers. La position allemande s'explique par une crise exceptionnelle. La crise que nous vivons aujourd'hui n'est pas liée à une mauvaise gestion budgétaire, mais à un virus. L'approche moralisatrice et punitive de l'Allemagne adoptée en 2010 ne peut donc s'appliquer.
L'Allemagne n'appartient plus au groupe des pays « frugaux », mais elle a posé ses conditions. Ainsi, le fonds de relance est plafonné à 500 milliards d'euros alors que la France avait proposé 1 500 milliards d'euros. Surtout, le fonds est limité dans le temps. Il constitue ainsi un mécanisme exceptionnel qui n'a pas vocation à être pérennisé, ce qui répond à une logique politique et constitutionnelle en Allemagne. Sur le plan politique, l'opinion publique allemande accepte mieux ce genre de mécanisme. Il ne faut pas exclure une plus grande souplesse à l'avenir, tout en restant prudent à ce stade.
Enfin, la question du contrôle et de la conditionnalité reste centrale. L'Allemagne n'est pas prête à s'engager dans une Union de transferts dans laquelle les États les plus riches verseraient durablement des subsides aux États les plus pauvres si la question du contrôle n'est pas réglée.
L'éclatement de la zone euro constituerait une catastrophe et est inconcevable. Nous redeviendrions dépendants du dollar, mais dans un contexte différent de la guerre froide. Les Américains sont un rival économique, et non plus une puissance bienveillante. La prospérité économique de l'Europe en subirait les conséquences.
L'éclatement de la zone euro impliquerait le retour aux monnaies nationales, et donc à l'instabilité monétaire telle que nous l'avons connue dans les années 70 et 80. La liberté de mouvement des capitaux et des services serait terminée. Les frontières seraient remises en place. L'Europe reviendrait à un modèle du XIXè siècle, et le nationalisme gagnerait du terrain.
Pour éviter un tel scénario, il faut accepter d'y mettre le prix. Les Allemands commencent à le comprendre. Les règles établies en 1990 ne sont plus applicables aujourd'hui. Sur le plan de la dette, la France se trouvera demain dans la situation italienne avant la crise sanitaire. L'Italie se trouvera demain dans la situation de la Grèce avant la crise sanitaire. Ainsi, les dettes publiques seront insoutenables et des solutions devront être trouvées. L'annulation partielle de la dette n'est pas inconcevable pour les Allemands si elle s'accompagne d'un plus grand respect des règles budgétaires, règles qui ne changeront pas dans la mesure où elles s'inspirent du keynésianisme d'avant 1945. Keynes ne laissait pas filer les déficits n'importe comment. En phase de croissance économique soutenue, des excédents budgétaires doivent ainsi être constitués.
Dès lors que nous tomberons d'accord sur le respect des règles budgétaires (déficit inférieur à 3 % du PIB), nous pourrons régler le problème de la dette qui est devenue insoutenable pour plusieurs États européens.
Je pense au contraire que la dette est soutenable. La zone euro est quatre fois moins endettée que le Japon et deux fois moins que les États-Unis. L'idée hamiltonienne de fusionner les emprunts puis les dettes progressera à l'avenir. Si la Commission européenne a emprunté une fois, elle empruntera à nouveau à l'avenir. Le fonds de soutien provisoire sera certes adossé au budget et contrôlé par le parlement, mais il sera impossible de revenir en arrière. En effet, l'avenir du marché intérieur est en jeu. Le marché intérieur est devenu vital pour les économies européennes, et notamment pour l'économie allemande.
Pour autant, est-ce la fin de l'ordolibéralisme et de l'idée selon laquelle les budgets doivent toujours être à l'équilibre ? En Allemagne, les économistes ont évolué sur cette question. Il faut davantage tirer les leçons de la crise de 2008 et de la crise de 2011. La décision allemande consistant à refuser de garantir la dette grecque qui ne représentait que 2 % du PIB de l'Union européenne a fortement dégradé l'image de l'Allemagne. L'Allemagne en a beaucoup souffert.
Enfin, depuis son arrivée au pouvoir, la chancelière allemande n'a jamais été à l'offensive. Elle n'a jamais pris de grande initiative franco-allemande ou européenne. Elle n'est pas aussi enthousiaste sur l'Europe que le chancelier Kohl ou d'autres prédécesseurs, et a agi uniquement sous la contrainte de la crise.

Nous en arrivons à la conclusion de ces deux tables rondes. Celles-ci ont été riches d'enseignements. Je remercie chacune et chacun d'entre vous. Je me réjouis de la présence d'un pilote dans l'avion européen. Ce pilote sera allemand au cours des six prochains mois. J'espère que la crise que nous traversons restera exceptionnelle. Les crises sont des révélateurs de nos faiblesses et des accélérateurs de certaines tendances. J'espère que la France prendra conscience de ses faiblesses et les corrigera, afin que nous évitions une fragmentation du marché unique.
La problématique environnementale constitue un tournant. Peut-être qu'en Allemagne, les écologistes sont plus raisonnables qu'en France. Les environnementalistes français sont radicaux. Ainsi, plusieurs maires écologistes récemment élus en France ont fait part de leur opposition au déploiement des réseaux 5G. Le Sénat souhaite que cette évolution technologique, qui conditionne l'avenir économique de nos territoires, ne soit pas soumise au bon vouloir d'élus locaux. Il faut insister sur le fait que cet investissement stratégique ne doit pas être entravé par une idéologie écologiste radicale.
Cela renvoie aux conclusions de la convention citoyenne sur le climat. À quand une convention citoyenne pour l'innovation et l'économie du XXIè siècle ?
La France doit également réagir en matière de réformes structurelles. Des réformes structurelles sont régulièrement annoncées en France, pour ensuite être repoussées. Quelle sera la crédibilité de la France sur les marchés, alors que sa dette approche le seuil des 120 % du PIB ?
Enfin, la France doit pouvoir reprendre en main un minimum d'autorité intérieure. Les dégradations qui sont le fait d'une minorité sont insupportables et fragilisent l'économie nationale.
Si nous ne prenons pas garde à ces différents éléments, nous risquons une fragmentation de la zone euro, laquelle fragiliserait l'Union européenne. L'environnement géopolitique qui entoure l'Union européenne devient inquiétant.
Je salue le pragmatisme allemand qui consiste à stabiliser le marché unique tout en se projetant à l'extérieur. Je suis ainsi pleinement favorable à la signature d'accords de libre-échange assortis de clés de sécurité pour certaines filières. Je salue ici le travail réalisé par l'ancien président de la Commission européenne, Monsieur Juncker, car il a imposé des normes dans le cadre de la conclusion d'accords de libre-échange. Ces normes sont devenues mondiales. Or celui qui a les normes a le marché.
J'insisterai enfin sur l'articulation nécessaire entre le plan de relance de l'Union européenne et les plans de relance nationaux. Alors que l'activité de la BCE a été intense durant la crise, il appartient maintenant aux États de prendre le relai. La BCE ne pourra pas tout faire.
Je vous remercie pour la qualité de ces échanges et pour le temps que vous y avez consacré. Les sénateurs et les sénatrices y sont très sensibles.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo disponible en ligne sur le site du Sénat.
La réunion est close à 13 heures.