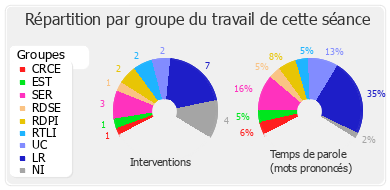Séance en hémicycle du 20 juin 2023 à 21h30
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Valérie Létard.

La séance est reprise.

L’ordre du jour appelle le débat préalable à la réunion du Conseil européen des 29 et 30 juin 2023, organisé à la demande de la commission des affaires européennes.
Dans le débat, la parole est à Mme la secrétaire d’État.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, c’est pour moi un plaisir de vous retrouver afin de vous présenter, comme de coutume avant chaque Conseil européen, les principaux sujets qui y seront traités.
Premièrement, la guerre en Ukraine restera bien sûr au cœur de l’agenda.
Deuxièmement, les chefs d’État et de gouvernement échangeront sur la réponse européenne à l’Inflation Reduction Act (IRA), ainsi que sur la définition d’une stratégie européenne de sécurité économique.
Troisièmement, les questions de défense seront abordées au travers de deux axes : d’une part, le renforcement des capacités de production de notre industrie de défense européenne, d’autre part, la préparation du sommet de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan) à Vilnius.
Quatrièmement, le Conseil européen devrait revenir sur la question des migrations après le terrible naufrage au large de la Grèce et les récentes avancées enregistrées sur le pacte sur la migration et l’asile.
Cinquièmement, comme à l’habitude, un certain nombre de thématiques internationales seront traitées. Pour être précise, j’indiquerai que trois le seront : notre relation avec la Chine, la préparation du sommet avec la Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (Celac) du 17 et du 18 juillet prochain, ainsi que notre relation avec la Turquie.
Comme vous le savez, sur l’ensemble de ces sujets, la situation évolue tous les jours, et les positions que je vous exposerai ce soir sont encore susceptibles d’être ajustées, notamment dans le cadre des concertations conduites entre Européens.
Premièrement, comme je le soulignais, l’Ukraine restera l’une des principales priorités de ce Conseil européen. Il nous faut absolument continuer d’aider ce pays à mener une contre-offensive efficace. C’est indispensable, car se jouera dans les prochaines semaines et dans les prochains mois la possibilité de la paix – une paix choisie, donc durable.
Un nouveau seuil a été franchi avec la destruction partielle du barrage de Kakhovka. Il s’agit bien entendu d’un acte grave, d’un acte inexcusable et odieux, qui aura des conséquences durables sur la vie de milliers d’Ukrainiens déjà meurtris par la guerre et qui ont dû être évacués. De plus, cet acte met en danger l’environnement et l’avenir des récoltes. Il menace aussi de façon irresponsable la sécurité de la centrale nucléaire civile de Zaporijia.
Évidemment, la Russie cherche à semer le doute sur l’origine de ce sabotage, mais nous ne devons pas perdre de vue un fait simple : c’est elle, et elle seule, qui porte la responsabilité de cette situation. C’est elle qui a engagé cette guerre, c’est elle qui bombarde, c’est elle qui tue, c’est elle qui détruit les infrastructures civiles, au service d’un projet aussi impérialiste qu’illégal.
Face à cette situation, les chefs d’État et de gouvernement rappelleront donc leur engagement à soutenir l’Ukraine aussi longtemps que nécessaire, y compris en assurant un soutien financier de long terme. Ils évoqueront également le soutien à la formule de paix en dix points du président ukrainien. Les dirigeants européens auront aussi un échange sur les garanties de sécurité qui doivent être octroyées à l’Ukraine en vue du sommet de l’Otan de Vilnius du 11 et du 12 juillet prochain.
Comme vous le savez, le Président de la République s’est dit favorable à donner des garanties tangibles et crédibles à l’Ukraine pour au moins deux raisons. La première est que l’Ukraine protège l’Europe : elle représente un gage de sécurité pour cette dernière. La seconde est que ce pays est doté d’un armement si important qu’il est dans notre intérêt qu’elle obtienne à nos côtés des gages crédibles en matière de sécurité, dans un cadre multilatéral.
De plus, les chefs d’État et de gouvernement reviendront sur les actions engagées par l’Union européenne (UE) et par les États membres en matière de lutte contre l’impunité des crimes internationaux commis en Ukraine et en matière de recours aux actifs russes gelés et immobilisés.
Enfin, le Conseil européen réaffirmera la perspective européenne de l’Ukraine et de la Moldavie. Il saluera les progrès réalisés vers l’adhésion à l’UE sur la base de l’évaluation orale que rendra la Commission cette semaine, à l’occasion du conseil Affaires générales informel de Stockholm auquel je participerai demain et après-demain.
Le Président de la République a été très clair à l’occasion de son discours à Bratislava : la question pour nous n’est pas de savoir si nous devons élargir l’UE – nous y avons répondu il y a un an – ni quand nous devons le faire – pour nous, le plus vite possible –, mais bien comment.
Permettez-moi d’en profiter pour saluer le déplacement des sénatrices Marta de Cidrac et Gisèle Jourda, ainsi que du sénateur André Reichardt, en Moldavie. Nous en avions parlé lors de ma dernière audition, me semble-t-il.
La manifestation du soutien de la France à l’intégration européenne exprimée par ce déplacement est essentielle. Nicolae Popescu a d’ailleurs eu l’occasion de répéter la semaine dernière au bureau de la commission des affaires européennes combien le soutien de la France était apprécié à Chisinau.
Deuxièmement, une large partie du Conseil européen sera consacrée aux questions économiques, dans leurs dimensions multiples.
Un point sera fait sur la mise en œuvre des décisions prises par le Conseil européen en février et en mars dernier concernant la réduction des dépendances stratégiques, le renforcement de la politique industrielle européenne et notre réponse à l’Inflation Reduction Act.
Les chefs d’État et de gouvernement débattront surtout de la stratégie de sécurité économique européenne. Lors de son discours à La Haye, à l’institut Nexus, le Président de la République a esquissé les contours de cette nouvelle doctrine, dont l’objectif est d’assurer pleinement notre souveraineté. Elle repose sur cinq piliers complémentaires.
Le premier pilier est la compétitivité. Nous devons continuer d’innover, de réformer et de renforcer nos systèmes éducatifs et de formation. Nous devons aussi approfondir le marché unique pour favoriser l’émergence d’acteurs économiques européens plus forts.
Le deuxième pilier concerne la politique industrielle. Je serai contente d’entendre que la France a joué un rôle clé pour faire progresser la politique industrielle européenne : ce concept n’est désormais plus un tabou. L’Europe doit continuer en ce sens pour asseoir son leadership industriel.
Les trois piliers suivants, allant du plus défensif au plus ouvert, dessinent quant à eux une géométrie de la sécurité économique européenne.
Le troisième pilier est le volet le plus défensif. Il vise la protection des intérêts stratégiques de l’Europe. Il s’agit de protéger nos entreprises contre les actions hostiles et les distorsions de concurrence, de réduire les dépendances stratégiques de l’UE, de protéger notre propriété intellectuelle et de mobiliser nos instruments de défense commerciale.
Le quatrième pilier est la réciprocité. Il s’agit d’intégrer dans chaque négociation commerciale des critères de durabilité sociale et environnementale. La systématisation des mesures miroir est un autre outil essentiel pour que les producteurs européens soient soumis aux mêmes règles de production que les entreprises qui produisent à l’extérieur de l’Union européenne.
Le cinquième et dernier pilier est la coopération. Il s’agit de renforcer le multilatéralisme et de faire en sorte que les politiques européennes de solidarité internationale soient en cohérence avec les intérêts légitimes de l’Union européenne.
Comme vous le savez, une communication relative à ce sujet a été présentée aujourd’hui par la Commission. Elle tend à rejoindre plusieurs de ces priorités : c’est un pas dans la bonne direction. Le Conseil européen donnera des orientations pour sa mise en œuvre, qui devra s’appuyer sur des analyses concrètes de nos dépendances et de nos besoins. Nous veillerons également au respect des compétences nationales pour les aspects les plus sensibles.
Troisièmement, ces enjeux de sécurité économique ont un lien direct avec l’Europe de la défense, qui sera également à l’agenda du Conseil européen.
En effet, si nous voulons continuer à soutenir l’Ukraine dans la durée, il faut passer dès maintenant à une économie de guerre européenne. Il faut donc renforcer les capacités de production de l’industrie de défense de l’Union européenne et mettre en œuvre rapidement les propositions de la Commission dans ce domaine. La France prend toute sa part, puisque nous allons atteindre un total de 413 milliards d’euros de dépenses avec la loi de programmation militaire (LPM) en cours d’examen par le Sénat.
Le Conseil européen devra aussi permettre de dessiner les grandes lignes de l’avenir de la coopération entre l’Union européenne et l’Otan, dans l’esprit de la troisième déclaration conjointe sur la coopération du 10 janvier 2023. Comme vous le savez, cette déclaration souligne l’apport pour la sécurité transatlantique d’une défense européenne renforcée.
Quatrièmement, le Conseil européen sera l’occasion d’un nouveau point sur les questions migratoires.
Après le terrible naufrage qui a eu lieu au large de la Grèce, nous sommes complètement déterminés à poursuivre, avec responsabilité et solidarité, le travail engagé avec nos partenaires européens sur les questions migratoires. Cette tragédie doit nous rappeler l’importance de la coopération entre Européens et avec les pays tiers en matière de sauvetage en mer et de lutte contre les réseaux de passeurs.
En ce qui concerne la réforme de notre système européen d’asile et de migration, nous venons de franchir une étape très importante : le Conseil a trouvé un accord sur les principaux textes du pacte sur la migration et l’asile : ils contiennent chacun une mesure phare de notre futur cadre européen commun en matière de solidarité et de responsabilité.
Je pense que c’est un résultat dont nous pouvons collectivement être fiers. Nous sommes bien plus proches désormais d’une réponse européenne sur cette question, alors que les réponses exclusivement nationales se sont évidemment soldées par des échecs.
Néanmoins, ces succès internes ne doivent pas nous faire oublier le nécessaire travail que nous devons mener sur les aspects externes. Il faut à présent intensifier le renforcement de nos partenariats avec les pays tiers et avec les pays d’origine, afin de traiter les causes profondes des migrations et de prévenir les départs.
Cinquièmement, mesdames, messieurs les sénateurs, le Conseil européen évoquera nos relations avec la Chine, avec l’Amérique latine et avec la Turquie.
En ce qui concerne la Chine, le Conseil européen sera l’occasion d’une discussion stratégique, qui s’inscrira dans la continuité de la discussion entre ministres des affaires étrangères tenue lors du Gymnich du 12 mai dernier.
Il me semble que l’on peut en retenir une certaine convergence de vues entre États membres, au moins sur la pertinence du triptyque européen : « partenaire, concurrent commercial et rival systémique ». L’on peut aussi en retenir le besoin d’actualiser notre stratégie, afin de tenir compte de la montée en puissance de la dimension de rivalité systémique.
En ce qui concerne notre partenariat économique et commercial, nous cherchons non pas un découplage avec la Chine, mais une réduction des risques. Pour cela, nous devons poursuivre la mise en œuvre de l’agenda agréé lors du Conseil européen de Versailles et renforcer les instruments européens de lutte contre les pratiques commerciales déloyales et abusives, comme je l’évoquais tout à l’heure dans le cadre de notre doctrine de sécurité économique.
En parallèle, nous devons bien sûr maintenir le dialogue avec Pékin sur les enjeux globaux. La participation du Premier ministre chinois, Li Qiang, au sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial, ces jours-ci, en est d’ailleurs l’illustration.
Enfin, dans le contexte de la guerre en Ukraine, il est crucial d’appeler la Chine à s’engager dans la recherche d’une solution.
Pour ce qui concerne la préparation du prochain sommet avec la Communauté des États latino-américains et des Caraïbes, nous souhaitons rappeler que les questions des droits de l’Homme, de la démocratie et de l’État de droit restent fondamentales. Ces thématiques sont centrales dans la relation avec de nombreux pays latino-américains, et il conviendra d’aborder ouvertement ces sujets.
La situation à Haïti sera également mise en avant par la France et d’autres partenaires, européens comme latino-américains : nous devons agir collectivement et rapidement pour le rétablissement de la sécurité et d’un cadre démocratique.
Par ailleurs, les perspectives de coopération ouvertes par le Global Gateway devraient constituer des livrables importants du sommet avec un agenda d’investissement dans la région qui est en cours d’élaboration. Je pense que nous ne pourrons pas réduire notre partenariat économique aux accords commerciaux. Cet agenda d’investissements sera donc extrêmement important.
La victoire de Recep Tayyip Erdogan et de son parti aux dernières élections présidentielle et législatives a ouvert une nouvelle phase en Turquie. Je tiens d’ailleurs à saluer le sénateur Leconte pour sa participation à la mission d’observation électorale dans ce pays, au titre de l’Assemblée parlementaire de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Maintenant que le scrutin est derrière nous, il sera utile que nous ayons une discussion plus approfondie à vingt-sept.
La Turquie est évidemment un acteur important de notre voisinage : il est par conséquent essentiel de poursuivre le dialogue et de maintenir la coopération avec elle sur les sujets d’intérêt partagé dans le contexte international et régional dégradé que nous connaissons.
Au-delà de ces élections, il faut aussi rappeler que tout réengagement de l’Union européenne à l’égard d’Ankara doit être subordonné à la capacité des autorités turques à remplir les conditions fixées par le Conseil européen en mars et en juin 2021, ainsi qu’à prendre des mesures concrètes sur les questions de politique étrangère les plus urgentes, s’agissant notamment de l’adhésion rapide de la Suède à l’Otan et du contournement des sanctions adoptées en réaction à l’agression russe contre l’Ukraine.
Il est essentiel que nous restions unis et que nous soyons parfaitement clairs quant à nos attentes à l’égard de la Turquie.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, voilà, en quelques mots, les enjeux de ce Conseil européen. Je ne doute pas que vos questions me fourniront l’occasion de revenir plus en détail sur l’un ou l’autre de ces points.

La parole est à M. le vice-président de la commission des affaires étrangères.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la semaine dernière, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a examiné le projet de loi de programmation militaire pour la période 2024-2030. Cette LPM doit être inscrite dans le cadre global de la réaction déterminée et unie des pays européens face au retour de la guerre sur notre continent.
Dans un contexte inédit de « réveil géopolitique de l’Europe », la programmation des dépenses militaires de la France est un aspect essentiel de notre crédibilité comme acteur stratégique sur le continent. Le projet de LPM que nous avons examiné tend à rappeler que la France constitue « un acteur clé » de la défense de l’Europe et qu’elle doit y assumer des « responsabilités particulières ».
D’un point de vue capacitaire, la constitution d’une base industrielle et technologique de défense (BITD) européenne réactive, robuste et souveraine est un objectif que nous portons de longue date. Il faut espérer que les menaces grandissantes qui pèsent sur notre sécurité commune provoquent une prise de conscience collective et rapide.
Seule une volonté politique partagée et clairement affirmée nous permettra de mener à bien nos grands projets capacitaires à développer à l’échelle européenne. Je pense en particulier au projet de système de combat aérien du futur (Scaf), que nous élaborons actuellement avec l’Allemagne et l’Espagne. Ces travaux de développement menés en commun pour élaborer les technologies militaires qui équiperont nos armées demain sont essentiels.
De plus, madame la secrétaire d’État, nous devons nous organiser dès à présent pour répondre dans l’urgence au défi humanitaire, diplomatique, opérationnel, mais aussi logistique, que représente notre soutien collectif à l’effort de guerre ukrainien. L’Union européenne et ses membres ont démontré depuis le 24 février 2022 leur capacité à soutenir l’Ukraine dans la durée et sans que l’unité européenne soit remise en cause, ce qui est extrêmement important.
Cette unité fait notre force, et j’insiste sur l’importance de ne pas céder à la tentation d’une division artificielle, dont nos compétiteurs et nos adversaires seraient évidemment les premiers bénéficiaires.
À cet égard, madame la secrétaire d’État, peut-être nous donnerez-vous des détails sur l’acte de soutien à la production de munitions (Asap pour Act in Support of Ammunition Production), présenté le 3 mai dernier par le commissaire français Thierry Breton. Pouvez-vous nous indiquer quelle est la position française sur ce projet, qui vise un financement de 500 millions d’euros d’ici au mois de juin 2025 en faveur de l’accélération de la cadence de production de munitions en Europe ?
Si nous souhaitons aider l’Ukraine, nous ne désirons pas, en revanche, que la Commission européenne centralise les informations des entreprises de la BITD pour les utiliser à sa guise. Nous faisons face ici à des sujets qui touchent au cœur de la souveraineté nationale.
Par ailleurs, le commissaire Thierry Breton a insisté sur sa volonté d’une adoption rapide de ce programme de financement d’urgence. Alors que le Parlement européen a voté en faveur de ce plan le 1er juin dernier, nous vous demandons, madame la secrétaire d’État, que le Gouvernement défende clairement nos positions sur ce point.
Notre commission soutient le renforcement de la défense européenne, mais selon des modalités pragmatiques qui n’empiètent pas sur notre souveraineté dans ce domaine éminemment sensible. En matière de défense, efficacité opérationnelle est synonyme de subsidiarité.
Enfin, j’évoquerai brièvement un sujet qui concerne notre politique de commerce extérieur.
En août 2019, le Président de la République a fait état de son opposition à la ratification du traité de libre-échange entre l’Union européenne et Mercosur au regard du risque de concurrence déloyale qu’il pourrait faire peser sur certains de nos producteurs.
À la fin de l’année 2021, le Président a réaffirmé son opposition au traité dans son état actuel au motif qu’il est incompatible avec notre agenda climatique et de biodiversité. La semaine dernière, l’Assemblée nationale a adopté une résolution invitant le Gouvernement à réitérer son opposition à l’adoption du traité et à son application partielle.
Pourtant, le voyage récent de la présidente Ursula von der Leyen en Amérique du Sud aussi bien que les perspectives dessinées pour la présidence espagnole du Conseil de l’Union européenne au semestre prochain ont renforcé l’attention portée à ce traité et à l’hypothèse de sa ratification par l’Union européenne.
Dans ce contexte, madame la secrétaire d’État, ma question est la suivante : quelle position la France défendra-t-elle au Conseil européen sur ce dossier ? Quelles sont vos priorités pour mettre en œuvre une politique commerciale européenne qui assure la défense de nos producteurs en cohérence avec nos objectifs climatiques ?

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, mon intervention se concentrera sur deux sujets d’intérêt majeur pour la commission des finances : les perspectives de révision du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 et la réforme de la gouvernance économique européenne.
En ce qui concerne mon premier sujet, la Commission européenne présente aujourd’hui même ses propositions. En effet, cette révision du cadre financier pluriannuel paraît incontournable.
D’une part, la hausse des taux d’intérêt, qui découle de l’inflation, remet en cause les hypothèses de remboursement des intérêts du plan de relance Next Generation EU et risque, par conséquent, d’affecter des programmes budgétaires déjà approuvés.
D’autre part, la guerre en Ukraine a fait émerger de nouvelles dépenses en matière de sécurité alimentaire et énergétique, de prise en charge des réfugiés ou encore de défense.
De plus, une révision ambitieuse du CFP impliquerait de nouveaux besoins de financement. En ce sens, la Commission a annoncé qu’elle joindrait à cette réforme un second panier de nouvelles ressources propres. Parmi ces dernières, la Commission européenne pourrait notamment présenter un nouveau cadre pour la fiscalité des entreprises.
En tout état de cause, les retards pris dans la mise en œuvre des nouvelles ressources propres du premier panier, en particulier le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, m’incitent à rester prudent face à ces annonces.
Dans ce contexte, madame la secrétaire d’État, pourriez-vous nous préciser la position du Gouvernement sur une éventuelle révision du cadre financier pluriannuel ? Au sujet de son financement, l’adoption de nouvelles ressources propres à moyen terme vous paraît-elle réaliste ?
En ce qui concerne mon second sujet, la réunion du Conseil européen devrait être l’occasion d’un échange de vues sur la réforme de la gouvernance économique européenne. Elle intervient alors que la Commission européenne a présenté, le 26 avril dernier, ses initiatives de réforme de la gouvernance budgétaire.
Les règles actuelles du pacte de stabilité et de croissance (PSC) connaissent des critiques qui sont anciennes. Elles n’ont pas permis de prévenir des trajectoires fortement divergentes en matière d’endettement public entre les États membres. De plus, elles ont pu constituer un frein à la mise en œuvre de politiques publiques de soutien à la croissance économique et n’ont pas contribué à accentuer l’investissement public.
Les propositions formulées par la Commission européenne viennent achever un débat ouvert par la suspension du pacte de stabilité et de croissance opérée lors de la crise sanitaire.
Sans revenir sur la règle de limitation des déficits et de l’endettement à respectivement 3 % et 60 % du PIB, la Commission européenne propose notamment de maintenir le cadre commun de surveillance en rendant plus automatique la mise en œuvre des sanctions. Elle propose également que les États s’engagent sur des trajectoires pluriannuelles de moyen terme en décrivant leurs cibles budgétaires et les réformes et investissements envisagés. Elle suggère de tenir compte des investissements prévus pour la transition écologique, pour le numérique et pour la défense. Enfin, elle invite à différencier les objectifs prévus pour chacun des États en fonction de la situation de leurs finances publiques.
Certaines de ces propositions me semblent aller dans le sens d’une amélioration souhaitable du cadre existant.
En premier lieu, l’individualisation des trajectoires des États devrait permettre une meilleure appropriation nationale des règles budgétaires.
En second lieu, je ne puis qu’approuver la prise en compte des investissements dans le suivi des trajectoires nationales. Si la Commission européenne n’a pas retenu une différenciation de la dette selon sa nature, sa proposition vise à préserver l’investissement des efforts de redressement des comptes publics à venir et à accroître les dépenses favorables à la transition écologique.
Ces dépenses d’avenir sont indispensables, alors que la réalisation de nos objectifs de transition impliquera un effort d’investissement de deux points de PIB par an en 2030, comme l’ont récemment rappelé dans leur rapport Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz.
Par conséquent, madame la secrétaire d’État, pourriez-vous nous éclairer sur le calendrier de mise en œuvre de cette gouvernance budgétaire rénovée ?
Par ailleurs, de quelle manière le Gouvernement souhaite-t-il se saisir de ce cadre favorable à l’investissement pour accélérer nos efforts en matière de transition écologique ?

La parole est à M. le président de la commission des affaires européennes.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous débattons ce soir très en amont de la prochaine réunion du Conseil européen, alors même que son ordre du jour n’est pas encore publié sur la page internet qui est lui consacrée. Cela nourrit nos interrogations sur la méthode suivie dans les travaux de notre assemblée en matière européenne.
Grâce à la secrétaire générale du Conseil, que la commission des affaires européennes a auditionnée récemment, nous avons toutefois pu obtenir quelques indications : le prochain Conseil européen devrait principalement parler d’Ukraine, de défense, d’économie, de relations extérieures et d’enjeux migratoires.
À n’en pas douter, la priorité du Conseil européen sera de faire le point sur la contre-offensive ukrainienne. Ce qui est en jeu, c’est la sécurité du continent. À ce titre, le soutien de l’Union européenne ne saurait faillir. La solidarité non plus, et l’on peut à cet égard s’inquiéter de la divergence franco-allemande qui se creuse ostensiblement en matière de défense, notamment en ce qui concerne le bouclier antiaérien.
Le Conseil européen, en mars dernier, a pointé du doigt l’urgence d’un approvisionnement suffisant de l’Ukraine en munitions à ce stade du conflit. C’est pourquoi la Commission européenne, le mois dernier, a proposé un texte destiné à accélérer la production de munitions dans l’Union, mais aussi à assurer leur disponibilité, en surveillant les stocks et leur localisation.
Autant nous soutenons l’urgence d’une relocalisation de la production de munitions sur le sol européen – nous l’avons déjà appelée de nos vœux en amont du Conseil européen de mars –, autant nous sommes inquiets du caractère très intrusif des pouvoirs que la Commission européenne entend se donner à cet effet, dans un domaine éminemment régalien, sur lequel l’information est très sensible et échappe d’ailleurs largement aux parlementaires que nous sommes.
Madame la secrétaire d’État, à la veille de la réunion du Comité des représentants permanents (Coreper) qui devrait examiner ce texte déjà adopté en urgence au Parlement européen, nous tenons à appeler les autorités françaises à la plus grande vigilance sur ce dossier stratégique.
J’ai proposé au président de la commission des affaires étrangères, Christian Cambon, de formaliser ensemble cet appel par un courrier officiel à la Première ministre, auquel je souhaite associer les rapporteurs de la commission des affaires européennes qui nous ont alertés sur le sujet, nos collègues Gisèle Jourda et Dominique de Legge.
Concernant l’Ukraine, le Conseil européen de la fin juin sera informé du rapport que la Commission publiera demain et qui évaluera les progrès des réformes attendues en matière de justice et de lutte contre la corruption et le blanchiment, en Ukraine comme en Moldavie. À cet égard, l’interdiction du parti de l’oligarque prorusse Ilan Shor, décidée hier par le Conseil constitutionnel de Moldavie, constitue une avancée indéniable.
Toutefois, la route est longue vers l’élargissement, même si l’Ukraine réclame d’ouvrir sans délai les négociations pour son adhésion et que la Géorgie entend bien, avant la fin de l’année, se voir reconnaître à son tour le statut de pays candidat.
Nous ne devons pas oublier que, parmi les critères à considérer avant tout élargissement, l’un concerne l’Union européenne elle-même. Il s’agit de sa capacité d’absorption : dans quelle mesure l’Union européenne est-elle capable de se maintenir comme union de paix si elle intègre des États qui sont en guerre, qui abritent des conflits gelés, comme en Transnistrie, ou qui n’ont pas résolu leurs contentieux de voisinage – je pense au Kosovo et à la Serbie ?
En outre, comment l’Union européenne est-elle capable d’assurer la viabilité de ses politiques – politique agricole commune (PAC) ou politique de cohésion, par exemple –, au vu de l’impact budgétaire de l’entrée de nouveaux membres ?
Madame la secrétaire d’État, pouvez-vous nous dire si ces questions fondamentales seront abordées au Conseil européen ?
Même si je doute qu’il aille aussi loin, le Conseil européen ne pourra pas, lors de sa prochaine réunion, ignorer les questions immédiates que soulève déjà la révision à mi-parcours des perspectives financières de l’Union, à l’heure où s’imposent tant de priorités – Claude Raynal en a parlé.
Madame la secrétaire d’État, nous sommes particulièrement inquiets pour nos agriculteurs : déjà soumis à des exigences environnementales croissantes, dont l’impact n’est pas sérieusement évalué, ils se trouvent menacés de subir la concurrence déloyale du Mercosur, avec lequel la Commission européenne et la prochaine présidence espagnole du Conseil semblent pressées de conclure un accord.
Doivent-ils aussi craindre que le budget de la politique agricole commune ne fasse les frais des priorités que la Commission européenne a fait valoir aujourd’hui même, à savoir le soutien à l’Ukraine, la riposte aux subventions que les États-Unis et la Chine consacrent à leur économie pour en assurer la compétitivité, ou encore l’appui financier aux pays de départ pour réguler les flux migratoires ?
De fait, la pression migratoire redouble en Méditerranée centrale et trop de bateaux surchargés font naufrage sous nos yeux. Les avancées enregistrées au Conseil sur le pacte sur la migration et l’asile permettent d’espérer en finir avec l’impuissance. Madame la secrétaire d’État, que peut-on attendre du prochain Conseil européen à ce sujet qui figure expressément à son ordre du jour ?
Moins d’un an nous sépare des élections européennes : il n’est plus temps de tergiverser pour donner à l’Union européenne les moyens de ne pas subir l’avenir.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et RDPI.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le compte à rebours est lancé : dans moins d’un an, nous serons appelés aux urnes pour les élections du Parlement européen.
Bien des bilans seront dressés dans les douze prochains mois. Les institutions européennes voudront mener à bien nombre de propositions engagées qui reflètent les promesses, mais aussi les évolutions dues aux récentes crises. Le mandat 2019-2024 est un tournant pour notre Union européenne et pour nous tous.
Néanmoins, à l’heure des premiers bilans, je crois plutôt que nous devrions continuer inlassablement d’avancer. Nous entrons dans une période de débat où la question principale est de savoir quelle Union européenne nous voulons inventer pour demain.
Le 9 mai dernier, le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré qu’il souhaitait une union ouverte et renforcée.
Sur certains sujets, nous sommes plutôt alignés, par exemple sur l’extension du vote à la majorité qualifiée à plusieurs domaines – encore faut-il savoir lesquels… La fiscalité est une piste, mais ce n’est pas la seule. Les affaires étrangères en sont une autre. Le groupe Les Indépendants est attaché au débat sur ce sujet. L’unanimité est un frein parfois trop important pour que l’Union européenne avance correctement dans l’intérêt des citoyens européens.
D’autres points développés par le chancelier font partie des nombreux désaccords des derniers mois. Il n’y a rien d’insurmontable, certes, mais nos visions divergent sur certains dossiers. Cela enrichit le débat, mais apporte aussi de nombreuses frustrations et parfois des incompréhensions. Quelques-uns des sujets que je vais aborder en sont des exemples types.
Avant cela, j’aimerais formuler une remarque de forme sur le débat préalable que nous avons ce soir. Au-delà de l’heure tardive, un sujet que j’ai déjà évoqué il y a quelques mois, j’y ajouterai : « Mieux vaut tard que jamais ». Nous avons en effet reçu l’ordre du jour du Conseil européen il y a seulement quelques heures…
Le rôle des élus nationaux, particulièrement des parlementaires, dans le système européen est important. Cela ne concerne pas uniquement la subsidiarité. Nous sommes au fait de ce qui se passe sur nos territoires, de ce que vivent les Européens. Notre parole est l’amplification de la leur. Les orientations et questions dont nous nous faisons ce soir le relais sont les leurs – ne l’oublions pas !
Pour revenir sur les sujets européens, celui de l’énergie fait bien sûr partie des priorités. Pouvez-vous, madame la secrétaire d’État, nous rassurer quant aux réserves en gaz pour l’hiver prochain ? La France pourra-t-elle atteindre au 1er novembre prochain ses objectifs en matière de stockage ? Le tout premier appel d’offres pour des achats groupés de gaz a été lancé début mai. Quels sont les premiers retours et quand est prévu le prochain ?
Le marché intérieur de l’électricité est l’un des dossiers les plus urgents de cette fin d’année. Qu’attendez-vous du prochain Conseil européen concernant la proposition d’évolution du système et l’objectif de son adoption avant la fin de l’année ?
Depuis mars dernier et les dernières conclusions du Conseil européen, notre position n’a pas changé concernant la guerre d’agression contre l’Ukraine. Je souhaite la réitérer : les responsables des crimes de guerre devront être jugés et les crimes documentés ; je pense notamment aux déportations d’enfants ukrainiens, car ce sujet reste central.
Alors que l’Ukraine a lancé sa contre-offensive, pouvez-vous déjà nous indiquer où en est le prochain paquet de sanctions à l’encontre de la Russie et quelles sont ses grandes lignes ? Est-ce que le paquet est prêt à être présenté lors du Conseil dans dix jours ?
Dans les dernières conclusions du Conseil européen, il a également été question des migrations.
Mercredi dernier, la Méditerranée a encore été le théâtre d’un drame humain : des dizaines de personnes sont mortes noyées en espérant rejoindre le sol européen. Ces victimes viennent malheureusement allonger une liste déjà bien trop longue de plusieurs dizaines de milliers de personnes mortes dans les mêmes conditions depuis une décennie. La mer Méditerranée ne peut être un cimetière à ciel ouvert.
Ce drame survient seulement quelques jours après qu’il y a eu accord en Conseil de l’Union européenne des ministres de l’intérieur sur deux principaux axes du pacte européen sur la migration et l’asile.
Ce pacte est complexe à faire aboutir, et nous savons que l’objectif est une adoption avant juin prochain. Le principal mécanisme est celui qui est dit de solidarité. Comment la France envisage-t-elle sa mise en pratique entre les deux options proposées : la relocalisation des réfugiés et la compensation financière ? Comment le sujet sera-t-il abordé lors du Conseil européen ?

Enfin, parce que c’est un sujet qui me préoccupe particulièrement et qu’il y a urgence, je souhaite ce soir aborder une nouvelle fois la question du cyberharcèlement. Le développement fulgurant de l’intelligence artificielle est un risque supplémentaire, notamment dans la création de contenus.
L’Union européenne l’a bien compris, et je salue le travail mené par le commissaire Thierry Breton concernant un pacte sur l’intelligence artificielle. Il est important de trouver un cadre efficace. Je sais le processus européen long et complexe, et 2025 semble bien loin. Je vous encourage, madame la secrétaire d’État, ainsi que vos collègues, à faire en sorte qu’une solution efficace soit rapidement trouvée en Conseil de l’Union européenne, mais aussi au Parlement européen.
Avant cela, il y aura bien sûr l’entrée en application du règlement européen sur les services numériques (DSA) en août prochain et en février 2024. Sommes-nous prêts ?
Le cyberharcèlement tue. Les risques pour nos enfants sont énormes. Je souhaite que nous soyons intraitables collectivement sur la bonne mise en place de ces normes, ainsi que sur leur efficacité, quitte à être très réactifs si nous observons des dysfonctionnements et des besoins de révision des règles. Nous serons nombreux au Sénat à y être très attentifs.
Applaudissements sur les travées du groupe UC. – M. André Gattolin applaudit également.
Vifs applaudissements sur les travées du groupe GEST, ainsi que sur des travées du groupe SER.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, les nouvelles frappes russes hier soir me conduisent, pour commencer, à renouveler au nom du groupe écologiste notre soutien sans faille à l’Ukraine et à sa population.
Nous saluons donc la volonté du Gouvernement de persister à soutenir l’Ukraine par tous les moyens qui sont nécessaires. Nous continuons à porter le projet d’une défense européenne, pour que l’Europe soit autonome stratégiquement et militairement.
Pour le reste, qu’en est-il aujourd’hui de notre projet européen, de notre cohésion sur les grands objectifs et de nos valeurs communes ? Ils sont – c’est leur lot – ballottés, malmenés, voire carrément reniés. Ce Conseil européen serait utile s’il contribuait à redonner vigueur à ces impératifs qui fondent notre unité.
Dans nombre d’États européens, les surenchères sécuritaires prospèrent, les entraves au Pacte vert se dressent, le lobbying en faveur de la finance et du libre marché gagne du terrain, les concessions à l’extrême droite, voire les coalitions avec elle, se multiplient. À un an des élections européennes, nous attendons des responsables européens la clarté et la détermination nécessaires pour donner envie d’Europe en plus et en mieux.
Au large de Kalamata, à proximité du Péloponnèse, c’est dès l’après-midi que Frontex a pu prendre la mesure du drame qui se nouait, mais c’est à 23 heures cette nuit-là que l’embarcation abandonnée à son sort a sombré avec près de 750 personnes… Ce bilan est l’un des plus lourds des dernières années ; ces dizaines et peut-être centaines de morts viennent s’ajouter aux 1 300 autres recensés depuis le début de 2023.
Bien sûr, la culpabilité première revient aux trafiquants d’êtres humains, profiteurs de celles et ceux qui fuient la misère, la guerre et, de plus en plus, un dérèglement climatique invivable. Bien sûr, cette culpabilité est première, mais elle ne décharge pas pour autant les politiques européennes de leur lourde part de responsabilité.
Il faut, hélas, le dire clairement : ces morts sont un peu à mettre au bilan de Frontex. En se reniant depuis tant d’années face aux discours anti-migrants, en intensifiant les politiques migratoires très restrictives, en externalisant le contrôle de ses frontières, en sous-traitant à des pays où les droits humains sont bafoués, l’Europe a fait de la Méditerranée la voie migratoire la plus meurtrière au monde.
Si ce Conseil européen entend vraiment lutter contre cette mortalité effroyable au seuil de l’Europe, son urgence doit être d’organiser la coopération pour les sauvetages – vous venez d’en dire un mot, madame la secrétaire d’État. Or l’accord du 15 juin entre les États membres sur le pacte sur la migration et l’asile n’ouvre aucune perspective de création d’une force européenne de secours en mer. Ce nouveau drame y oblige ; c’est un impératif minimum.
En ce qui concerne le volet énergie, on constate encore de l’incohérence. En septembre dernier, le Gouvernement annonçait vouloir rattraper son retard dans les énergies renouvelables. Dans les faits, Paris a totalement bloqué les choses jusqu’à ce que ses demandes sur le nucléaire soient satisfaites dans ce texte clé du Pacte vert qu’est la proposition de directive relative aux énergies renouvelables.
Il a donc fallu que la Commission européenne finisse par acter « la reconnaissance du nucléaire dans l’atteinte de nos objectifs de décarbonation ». Il y a quelques semaines, on dénonçait les manœuvres de blocage de nos voisins allemands sur les voitures thermiques. Aujourd’hui, on les imite !
Ce lobbying déstabilise les investissements dans la décarbonation et en encourage d’autres : ainsi, hier, en Conseil des ministres européens de l’énergie, la France a soutenu la prorogation des subventions aux centrales à charbon existantes jusqu’en 2028 – encore un recul !
Ce retard sur nos objectifs de décarbonation coûtera cher, tout comme le démantèlement annoncé de Fret SNCF, pour lequel le gouvernement français semble capituler avant même d’avoir mené la bataille, alors que notre cause avait des raisons solides, partagées en Europe. Plutôt que de tenir, vous consentez à en finir avec Fret SNCF.
Comment la mise à la découpe de cette entreprise pourrait-elle ne pas briser le rebond ferroviaire nécessaire et ramener des camions sur les routes ? À quoi en Europe veut-on donner la priorité ? Au climat ou à la libre concurrence ?
Cette question vaut également pour l’accord UE-Mercosur, tel qu’il a été conclu en 2019, que l’Assemblée nationale vient de rejeter dans une résolution. Cet accord serait une usine à dérégler le climat, à accroître la déforestation, à contaminer l’environnement, à détruire l’agriculture paysanne et à coloniser les terres des peuples autochtones.
Le respect de l’accord de Paris et celui de nos normes sanitaires et environnementales pour tout produit agroalimentaire importé, voilà la ligne à tenir, sans pour autant couper les ponts avec l’Amérique latine. L’Union européenne peut aider à protéger l’Amazonie, en respectant ses engagements en matière de financement de l’action climatique et par ses aides en faveur des forêts des pays du Mercosur.
Cela passe aussi par une directive ambitieuse sur le devoir de vigilance. Les eurodéputés ont voté un texte prometteur prévoyant un mécanisme de responsabilité civile et un accès renforcé des victimes à la justice européenne, qui a nettement élargi le champ des entreprises concernées et qui inclut le secteur financier et la chaîne de valeur aval des entreprises.
Maintenant que les négociations en trilogue vont débuter, ce n’est pas le moment d’affaiblir le texte. Les eurodéputés se sont montrés ambitieux ; au gouvernement français de suivre cette ligne.
Cette nécessité de peser en faveur de nos grands objectifs communs est aussi en cause avec la loi européenne sur la restauration de la nature, dont le vote a été repoussé par une alliance entre l’extrême droite, la droite conservatrice, les libéraux et une partie du groupe Renew. C’est le sort du Green Deal qui se joue. Nous n’avons pas le luxe de nous permettre une pause !
Applaudissements sur les travées du groupe GEST. – M. Patrice Joly applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, douze ans : depuis douze ans, je prends la parole à l’occasion de chaque débat préalable au Conseil européen, ainsi qu’à l’occasion de tous les autres débats qui ont trait à l’Europe dans cet hémicycle.

Ne vous méprenez pas : pour moi, c’est tout sauf un pensum ou une sinécure ! Et si je m’attelle ce soir à cet exercice pour la dernière fois, parce que j’ai fait le choix de vous quitter bientôt, c’est plus que jamais avec plaisir et passion, sans amertume aucune.
Je suis né Européen sans le savoir, et c’est grâce au voir et au savoir que je le suis devenu. J’ai beaucoup parcouru l’Europe avant de devenir sénateur ; j’ai continué de le faire en l’étant, je le ferai davantage encore en ne l’étant plus.
Ce continent, qui porte le beau nom d’une princesse d’Asie enlevée par Zeus, est si beau et si complexe, si riche et si fragile aussi, qu’il mérite que nous consacrions ce qui nous reste de futur personnel à tenter de préserver le sien. Mais, s’ils ont souvent la même fragilité, un être humain et un continent ne s’inscrivent évidemment pas dans la même temporalité.
Dans la part de temporalité commune qui peut exister entre une personne et son territoire, c’est-à-dire entre notre histoire personnelle et l’Histoire tout court, chacun peut mesurer sa chance au regard des événements heureux qui lui ont été donnés de vivre, mais aussi au regard d’événements terribles auxquels il a eu le bonheur d’échapper.
Nous sommes tous ici, dans cet hémicycle, issus de plusieurs générations qui ont eu la chance de ne pas connaître la barbarie nazie, ses cortèges de morts, de déportés et d’exactions sans nom. Cette longue paix, nous la devons bien évidemment à l’Europe, à sa patiente construction dans un cadre démocratique, en dépit des crises et soubresauts qui l’ont traversée et qui continuent de le faire.
Lorsque nous en disposons depuis longtemps, la paix comme la liberté passent pour acquises au point de faire figure de non-événement.
C’est une erreur, pis, une cécité, de ne pas voir que, chaque matin, lorsqu’elles se réveillent, tant de personnes dans tant d’autres parties du monde s’interrogent sur ce que la journée aura peut-être de fatal pour elles ou pour leurs proches. À l’heure du retour de la guerre dans l’est de notre continent, c’est une chose que nous omettons de raconter et d’expliquer à nos enfants, car, parfois, nous n’en avons nous-mêmes plus guère conscience.
Toutefois, l’événement européen de portée véritablement historique vécu par les générations ici représentées restera certainement la chute du mur de Berlin, la fin du rideau de fer et l’effondrement de l’URSS. Ce fut la promesse d’une aube nouvelle pour l’Europe, mais si soudaine, si bouleversante et si enthousiasmante pour les peuples du continent que nous avons omis à l’époque de mesurer pleinement les défis que cette Europe élargie poserait à plus long terme.
Parce que le régime soviétique, tel un cyclope éborgné, s’était écroulé de lui-même, nous avons voulu croire à la fin de toute velléité impériale de la part de la Russie. Triste aveuglement qui n’est pas étranger à l’horrible tragédie qui secoue aujourd’hui l’Ukraine.
Quand j’ai choisi il y a douze ans de devenir sénateur, plutôt que de tenter de devenir eurodéputé, j’avais la conviction profonde que c’était au plus proche de nos concitoyens qu’il fallait parler d’Europe, afin de la rendre audible autant que sa complexité le permet.
En effet, il ne suffit pas d’être un Européen convaincu ; il convient surtout d’être un Européen convaincant, capable d’expliquer les enjeux réels qui se posent à nous dans un monde de plus en plus délicat à appréhender.
Au cours de ces douze dernières années, notre Europe a connu bien des crises, au point de se demander si leur succession, désormais incessante, n’est pas devenue, bien plus que le présumé moteur franco-allemand, le cœur du réacteur de son processus d’approfondissement et sans doute, demain, de son processus d’élargissement.
Ébranlée, bousculée, parfois au point de pouvoir être renversée, l’Union européenne, malgré sa plasticité de boxeur plus apte à encaisser les coups qu’à en donner, a cependant bien plus évolué durant la décennie écoulée qu’on ne le dit. Bien sûr, ce cheminement vers davantage d’intégration politique ne s’est fait, pour l’essentiel, qu’en réaction aux nombreuses crises que nous avons traversées.
Il serait illusoire de croire qu’il puisse en être autrement : les États membres n’acceptent de se départir d’une part de leur souveraineté nationale que, lorsqu’en ultime instance, ils finissent par admettre leur incapacité à affronter seuls un défi qui les dépasse.
Que cela nous plaise ou non, il ne saurait en être autrement, et le « Grand Soir constituant », rêvé par nombre d’européistes convaincus, n’a plus l’heur de convaincre et de faire espérer. Il en est ainsi, et il faut cesser de voir dans le réel l’ennemi de la politique. Le réel n’est que la matière à partir de laquelle se construisent patiemment les édifices.
À ce titre, la liste des sujets traités lors des Conseils européens depuis plus d’une décennie illustre bien l’évolution, certes lente, mais profonde, qui a affecté l’Union européenne au cours de la période et qui préfigure peut-être son devenir.
Au début des années 2010, presque tout ce qui était débattu en Conseil renvoyait à la crise financière de 2008, à ses conséquences directes et indirectes, à la crise de l’euro et à la déflagration violente suscitée dans les pays du sud de l’Europe. Les réponses proposées renvoyaient encore et toujours au renforcement du marché unique, véritable Graal des chevaliers de la Table ronde du Conseil… On était prêt à sacrifier la Grèce sur l’autel d’une orthodoxie qui n’avait rien de religieux, mais tout de financier.
La politique extérieure de l’Union européenne, hors la multiplication effrénée d’accords de libre-échange, se limitait à quelques timides politiques de voisinage, dont, au passage, il serait bon un jour de tirer un bilan honnête et sans fard.
Toutefois, même durant cette période quelque peu atavique, l’Europe nous a parfois réservé de très belles surprises.
Je me rappelle ainsi mon tout premier déplacement pour la commission des affaires européennes : c’était en Croatie en novembre 2011, quelque temps avant l’entrée officielle de ce pays dans l’Union européenne. Vingt ans auparavant, j’étais à Zagreb, à quelques kilomètres du front, sous les pluies de tirs perdus qui tombaient sur la capitale. Au risque de passer pour un fou en France, je militais déjà activement en faveur d’un avenir européen pour ce pays.
À la fin de ce séjour, notre délégation sénatoriale fut reçue par le Président de la République, Ivo Josipovic. Surprise : nous avions sympathisé vingt ans auparavant en pleine guerre, il était alors universitaire et musicologue, et nous nous étions ensuite perdus de vue au fil des ans.
Le 1er juillet 2013, la Croatie devint le vingt-huitième membre de l’Union européenne. Nous ignorions à l’époque que ce serait, à ce jour, le dernier pays à rejoindre l’Europe.
Nous ignorions aussi que, quelques années plus tard, un État membre de l’Union européenne prendrait la décision impensable de la quitter.
L’avenir de l’Europe est souvent imprévisible, et nous sommes, particulièrement aujourd’hui, payés pour le savoir. Mais ce que je veux retenir ici, c’est que, au prix d’immenses efforts, la Croatie vient en ce début d’année de rejoindre la zone euro et l’espace Schengen. C’est un signe d’espoir : il peut y avoir une vie européenne après la guerre.
Cependant, dans la situation actuelle, avec la guerre qui fait rage en Ukraine, la question majeure que devront se poser les chefs d’État et de gouvernement qui se réuniront dans quelques jours à Bruxelles est grave, extrêmement grave.
Il s’agit ni plus ni moins que de savoir s’il peut subsister une Europe après la guerre horrible conduite par la Russie, si l’Ukraine venait à perdre celle-ci. La réponse est vraisemblablement non ! Et le poids de notre responsabilité en la matière sera immense si nous renonçons à aller plus avant dans notre soutien à Kyiv.
Pour conclure sur une touche différente, je tiens à saluer très chaleureusement les trois présidents de la commission des affaires européennes qui se sont succédé depuis 2011, Simon Sutour, Jean Bizet et naturellement Jean-François Rapin, avec lesquels j’ai eu, durant ces douze années, le grand bonheur de travailler.
Applaudissements.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous devons débattre ce soir de l’ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil européen.
Cependant, le contexte économique, social et sociétal que vivent les Européens nous oblige à évoquer également d’autres questions essentielles pour lesquelles la vigilance de chacun doit être de rigueur.
Depuis le début de 2021, l’inflation a vivement augmenté dans les principales économies de la zone euro. Les prix des produits alimentaires ont progressé de 15 % par rapport à 2020 et expliquent à eux seuls près de la moitié de l’inflation, pénalisant les ménages les plus modestes, qui consacrent une part importante de leur budget à l’alimentation.
Une inflation élevée réduit le pouvoir d’achat des citoyens et rend de nombreuses entreprises moins compétitives ; surtout, elle a un impact disproportionné sur les personnes à faible revenu.
Dans un tel contexte, les conséquences de la hausse de 0, 25 point de son taux d’intérêt par la Banque centrale européenne, annoncée le 4 mai dernier, doivent être questionnées.
Tout d’abord, parce que cette hausse prive les plus modestes de l’accès au crédit et vient s’ajouter à la réduction du pouvoir d’achat des Européennes et des Européens.
Ensuite, parce que, aujourd’hui, l’inflation est tirée par les superprofits, la cupidité, l’avidité. Elle est liée au maintien des marges des entreprises. La Banque centrale européenne a également émis des craintes contre cette spirale des prix « qui pourrait appauvrir tout le monde ». La question d’un contrôle temporaire des prix se pose donc pour prévenir les spirales inflationnistes de ces prix abusifs.
Enfin, parce que la hausse des taux d’intérêt va dégrader directement la rentabilité des opérations de rénovation énergétique des logements et des bâtiments ; elle va plus globalement détériorer la rentabilité des investissements de la transition écologique que nous devons financer.
S’il faut saluer l’assouplissement des règles budgétaires proposé par la Commission européenne, l’angle mort de cette réforme demeure la question des recettes pour financer les transitions. Qui va payer pour augmenter les dépenses vitales en vue d’atténuer les émissions de CO2, réduire par là même notre dépendance aux énergies fossiles, largement importées, et nous adapter au changement climatique en cours ?
Ainsi, le récent rapport de France Stratégie sur les incidences économiques de l’action pour le climat a estimé à 66 milliards d’euros par an à l’horizon 2030, soit plus de 2 points de PIB, le nécessaire coût de la transition écologique en France.
Ce n’est malheureusement pas simplement avec une taxe sur les cryptomonnaies, un impôt sur les plastiques, ou encore la taxe sur les transactions financières actuellement bloquée au Conseil que l’on va financer la défense européenne, la transition écologique et l’industrie dont nous avons aujourd’hui terriblement besoin.
Nous avons besoin d’un plan pérenne et de réponses concrètes de la Commission européenne sur ce point. Nous avons besoin d’une capacité budgétaire européenne. Nous avons besoin de justice fiscale, de taxation sur le capital et d’un prélèvement pour le marché unique, parce que, si l’on aime l’Europe, on la finance !
Le 8 juin dernier, un projet d’initiative citoyenne européenne appelant à créer un impôt européen sur les grandes fortunes a été déposé auprès de la Commission européenne par l’eurodéputée Aurore Lalucq et le président du parti socialiste de Belgique Paul Magnette. Ils sont soutenus notamment par Thomas Piketty et l’ancien commissaire européen hongrois Laszlo Andor, ainsi que par plusieurs ONG, comme Oxfam, et par des millionnaires eux-mêmes. Tous plaident pour la création d’un impôt européen sur les grandes fortunes.
Partout dans le monde, les plus riches parmi les plus riches sont beaucoup moins taxés que les autres en proportion de leurs revenus, parce qu’ils bénéficient d’une fiscalité avantageuse sur le capital ou qu’ils ont la capacité de défiscaliser leurs revenus. L’Institut des politiques publiques a montré, dans sa note en date du 6 juin dernier, que, à partir d’un certain seuil de richesse, le taux d’imposition régresse, car les profits que les ultra-riches tirent de leurs sociétés échappent au calcul de l’impôt sur le revenu.
Il est temps de rétablir une fiscalité plus juste et équitable. L’économiste américain Joseph Stiglitz, lauréat du prix Nobel, avait même proposé de mettre en place un taux d’imposition mondial spécial de 70 % sur les revenus les plus élevés, ainsi qu’un impôt sur la fortune de 2 % à 3 %.
Avec mes collègues du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, je ne puis que relayer avec force ces propositions alors que nous plaidons, depuis plusieurs mois maintenant, pour la mise en place d’un impôt sur les superprofits.
Une coopération entre les États est urgente pour lutter, par le biais de la fiscalité, contre la spéculation et pour une juste répartition de la richesse produite. Je forme le vœu que nous parvenions à un accord politique au Conseil européen à l’automne prochain.
Enfin, alors que le prochain sommet des chefs d’État ou de gouvernement de l’Union européenne et de la Communauté d’États latino-américains et caraïbes se tiendra à Bruxelles le 17 et le 18 juillet prochain, je souhaite vous faire part, madame la secrétaire d’État, de nos grandes inquiétudes concernant l’accord de libre-échange entre le Mercosur et l’Union européenne.
Aujourd’hui, de nombreuses organisations telles que l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae), le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad), ou encore l’Agence française de développement (AFD) concluent que nous pourrons nourrir les 10 milliards d’habitants que comptera le monde en 2050.
En revanche, pour ce faire, quelques conditions doivent impérativement être respectées : mettre un terme à l’accaparement des terres et les partager ; assurer le renouvellement des générations en garantissant un revenu digne à tous les paysans, partout dans le monde ; enfin, établir un commerce équitable non seulement entre les espaces ruraux et les métropoles, mais aussi entre les pays et entre les continents.
Or, madame la secrétaire d’État, cet accord est archaïque tant sur le fond que sur la forme. On ne peut pas promouvoir une agriculture durable en faisant de la lutte contre le changement climatique une priorité et, dans le même temps, faire venir sa viande de l’autre bout de la planète en favorisant un modèle agricole intensif, responsable à 80 % de la destruction de la forêt amazonienne.
Il s’agit non pas de militer uniquement à des fins protectionnistes, mais d’agir au nom d’une souveraineté solidaire, afin que la France affirme ses valeurs universelles tout en défendant ses propres intérêts, lesquels rejoignent en toute logique ceux de l’humanité.
En effet, cet accord est un désastre pour les éleveurs et agriculteurs des deux côtés de l’Atlantique. Les importations de bœuf en provenance du Mercosur pourraient augmenter de 50 %. Ce sont 99 000 tonnes équivalent carcasse de bœuf sud-américain, potentiellement élevé aux antibiotiques, que nous importerions sans imposer de droits de douane, alors même que nous avons, à raison, banni les antibiotiques de croissance en Europe à compter du 1er janvier 2006.
Comment assurer notre souveraineté alimentaire face à un accord qui menace le bien-vivre de celles et ceux qui nous nourrissent ? C’est en remettant en cause ce traité que nous pourrons, dans les conditions que j’ai exposées, nourrir les 10 milliards d’habitants attendus d’ici à 2050.
Applaudissements sur les travées du groupe SER. – M. Jacques Fernique applaudit également.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nombre de questions sont à l’ordre du jour de ce Conseil européen, comme vous l’avez relevé, madame la secrétaire d’État. Je me limiterai à trois séries de remarques.
Dans la première, je pointerai les contradictions entre, d’une part, les grandes déclarations qui sont faites sur une nouvelle politique industrielle, sur la sécurité économique du continent ou encore sur la reconquête de souveraineté, d’autre part, beaucoup de décisions qui ont été prises au fil des dernières semaines.
Je veux vous redire, madame la secrétaire d’État, que nous ne décolérons pas contre l’accord qui a été conclu entre la Commission européenne et notre pays sur le démantèlement de la filiale fret de la SNCF. Nous le considérons comme une aberration sociale et écologique.
De même, le projet de réforme du marché européen de l’électricité, désormais mis dans la boucle du trilogue Commission européenne-Conseil européen-Parlement européen, nous paraît sans rapport avec les ambitions affichées initialement. Sur ce volet majeur de la transition écologique, on persiste dans une logique de marché qui pèsera négativement sur les investissements de long terme et, en France particulièrement, sur les choix nationaux de mix énergétique souverain, avec le risque de factures de nouveau alourdies pour les ménages, les PME et les collectivités locales.
C’est dans dix jours, au moment même du Conseil européen, que surviendra la suppression, sans aucune contrepartie, des tarifs réglementés du gaz, qui nous garantissent pourtant de la sécurité. Ainsi, nous sauterons dans le vide sans filet !
Enfin, alors que la crise sociale – crise de pouvoir d’achat, crise de l’emploi – touche toute l’Europe, aucun point de l’ordre du jour du Conseil européen ne porte sur les questions sociales ; ce n’est pas la première fois. Je veux néanmoins saluer l’accord trouvé au Conseil le 12 juin dernier sur les travailleurs des plateformes, accord qui dresse enfin une liste de critères de présomption de salariat, mais la mise en œuvre de cet accord s’annonce encore très longue.
En revanche, c’est aussi le moment choisi par le président Macron pour faire d’Elon Musk la nouvelle grande vedette de nos plateaux de télévision, notamment hier soir sur France 2. Voilà le patron que les grands patrons français s’arrachent ! Tout cela nous paraît assez aberrant alors que l’on parle d’affirmer notre souveraineté économique.
La deuxième série de remarques que je veux faire à cette tribune porte sur notre conception de la compétition économique et de la reconquête de la souveraineté.
Les conceptions qui sont mises en avant nous semblent davantage motivées, en vérité, par une logique de guerre économique. La façon dont les relations entre l’Union européenne et la Chine sont mises à l’ordre du jour de ce Conseil européen en témoigne à nos yeux.
Il y a quatre ans seulement, le Parlement européen, le Conseil européen et la Commission européenne publiaient une communication conjointe sur leur vision stratégique vis-à-vis de la Chine, alors considérée comme un « partenaire de coopération », un « partenaire de négociation », un « concurrent économique » et un « rival systémique ».
À l’écoute de votre intervention d’aujourd’hui, madame la secrétaire d’État, la Chine ne semble plus être traitée qu’en « rivale systémique ». Mais ce qui nous inquiète le plus, c’est que, derrière ce discours, il semble que nous refusions de nous attaquer aux causes réelles de nos handicaps industriels, qui ne se résument pas à la concurrence de la Chine, mais découlent de décisions qui ont été prises, ou plutôt qui ne l’ont pas été, sur le continent européen, pour assurer notre développement industriel.
Nous voulons rattraper notre retard avec le Green Deal Industrial Plan. Très bien ! Il est question, nous dit-on, de relocaliser la production de technologies vertes suffisamment matures, essentielles à la décarbonation, pour lesquelles l’Europe est aujourd’hui bien trop dépendante.
Toutefois, si la Chine produit aujourd’hui 75 % des panneaux photovoltaïques et des batteries, presque 60 % des éoliennes et 40 % des électrolyseurs et des pompes à chaleur, il faut tout de même examiner ce qui a failli dans nos propres décisions industrielles pour que l’on en arrive à cette situation, si nous voulons l’inverser.
Je serais curieux de savoir, madame la secrétaire d’État, ce que vous pensez de ce passage du rapport de Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz, un document que l’on semble d’ailleurs avoir enterré très rapidement :
« Dans la course qu’elle a engagée pour construire avant les autres un nouveau modèle de croissance verte, c’est-à-dire pour définir les standards de demain et établir une position forte dans les industries du futur, l’Europe prend le risque d’additionner les handicaps. Elle cumule en effet retards industriels, coût de l’énergie élevé, exposition aux fuites de carbone et volonté de ne pas s’écarter de la discipline budgétaire. Si certaines contraintes, sur les prix de l’énergie notamment, lui sont imposées par le contexte international, certaines disciplines, en particulier en matière budgétaire, résultent de ses propres décisions. »
Allons-nous tirer des leçons de ces constats pour être moins belliqueux, mais plus offensifs en matière de reconquête industrielle, en poussant les feux d’un fonds souverain européen et d’un renforcement du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, ou en utilisant la création monétaire ?
Enfin, ma troisième série de remarques portera sur la question de la guerre et sur le sommet de Vilnius.
Vous avez été très peu loquace sur ce sommet, madame la secrétaire d’État. Pour ma part, je vais vous adresser une question assez directe, qui se pose maintenant dans le débat public et à laquelle le Parlement devrait avoir une réponse : la France donnera-t-elle, à Bruxelles dans dix jours et à Vilnius dans quelques semaines, son feu vert à l’entrée de l’Ukraine dans l’Otan ?
Cette question, visiblement, a été évoquée explicitement au cours du conseil de défense qui s’est réuni le 12 juin. Le Parement a le droit d’être informé si la France est en train de changer de position sur cette question, qui est non pas mineure, mais essentielle. En effet, si nous faisions entrer maintenant l’Ukraine dans l’Otan, si nous donnions ce feu vert, alors, nous le savons tous, la frontière orientale de l’Union européenne se verrait transformée en ligne de front de l’Otan, de l’Arctique à la Méditerranée.
Je ne crois pas que ce soit ainsi que nous mettrons fin à la guerre ou que nous obtiendrons le retrait des troupes russes des territoires occupés illégalement. Nous pensons pour notre part que ce serait la voie, non pas d’une victoire rapide, mais d’une guerre longue, terriblement destructrice, coûteuse et dangereuse.
La solution de rechange à la guerre devrait plutôt être la mobilisation de toutes les forces de l’Union européenne et de toutes les coalitions mondiales possibles pour des solutions politiques de paix et de sécurité. Le surarmement, la militarisation et « l’otanisation » de l’Europe ne préparent pas à prendre ce chemin-là.
J’espère, madame la secrétaire d’État, qu’à Vilnius la raison demeurera assez forte pour que la France ne donne pas son feu vert à cette adhésion, qui ne réglera pas les problèmes, mais risquerait de les aggraver encore.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE. – Mme Gisèle Jourda applaudit également.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous voilà réunis pour le débat préalable au Conseil européen du 29 et du 30 juin prochain. À la fin de ce mois, la Suède cédera la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne à l’Espagne. Stockholm avait fixé quatre priorités pour ce semestre de présidence suédoise : la sécurité, la compétitivité, la transition écologique et énergétique et les valeurs de l’Union européenne.
La sécurité du continent renvoie évidemment à la guerre russo-ukrainienne. Oui, nous y sommes : la contre-offensive ukrainienne a débuté, comme l’a confirmé le Président de la République. L’escalade des tensions et la situation précaire à l’Est viennent mettre à l’épreuve la stabilité et la sécurité de la région européenne dans son ensemble.
Le soutien apporté à l’Ukraine dans sa lutte pour la préservation de son intégrité territoriale doit se poursuivre. Le combat que mène ce pays force le respect. Le groupe Union Centriste, comme d’autres, se tient évidemment derrière le peuple ukrainien et apporte son plein soutien à nos amis qui se battent pour les valeurs de l’Union européenne.
L’année 2023 nous invite aussi à célébrer les trente ans du marché unique, qui appelle à une meilleure compétitivité de nos entreprises européennes.
Si notre union économique et monétaire permet à l’Europe de demeurer une puissance commerciale mondiale, ses bénéfices n’ont pas été uniformes pour tous les États membres. Nous le savons, certains secteurs ont, dans chacun des pays européens, gagné en compétitivité du fait de leurs avantages absolus ou comparatifs – l’industrie en Allemagne, le luxe en France ou encore l’agriculture en Espagne – tandis que d’autres secteurs ont pâti du marché unique.
À la suite des crises successives que nous avons traversées, l’objectif d’une souveraineté économique européenne semble faire consensus. Médicaments, batteries électriques, avions propres : nombre de pistes se dessinent. Il faut s’en saisir, mais les Européens doivent aussi faire preuve de cohérence.
À titre d’illustration, l’aéronautique est, depuis longtemps, un domaine fécond pour la coopération européenne. En témoignent les contrats signés ces derniers jours dans le cadre du salon du Bourget. Pourtant, l’année dernière, le Gouvernement allemand annonçait l’achat de 35 avions de combats américains F-16, au détriment du Rafale français. C’est d’autant plus dommageable que nos deux pays coopèrent sur le programme Scaf, le système de combat aérien du futur.
La compétitivité européenne ne dépend donc pas uniquement de la qualité des investissements réalisés ou de l’étendue de nos innovations ; elle repose également sur leur bonne adéquation avec notre politique commerciale. Il y va de la prospérité de nos filières d’avenir, à l’instar de l’agriculture en France.
Alors que les moyens financiers de la politique agricole commune ont été revus à la hausse, le Pacte vert européen prévoit une baisse de la production agricole. Dans le même temps, nous investissons dans un modèle agricole plus respectueux de l’environnement, mais la Commission européenne continue de négocier des traités de libre-échange défavorables à nos producteurs, avec l’Amérique du Sud ou la Nouvelle-Zélande. La logique est donc dure à suivre, particulièrement pour les exploitants agricoles de notre pays !
C’est surtout dans le domaine de la transition énergétique que les États membres s’opposent actuellement. En ce qui concerne la réforme du marché de l’électricité, un point de désaccord majeur subsiste. Les Vingt-Sept se déchirent sur les modalités des contrats pour la différence, à prix garanti par l’État.
Dans ce mécanisme, le producteur d’électricité doit reverser les revenus engrangés si les cours du marché de gros sont supérieurs au prix garanti, mais perçoit une compensation dans le cas contraire. La Commission européenne proposait que tout soutien public à de nouveaux investissements dans la production d’électricité décarbonée se fasse impérativement via ce type de contrat. Si la France s’en réjouit, d’autres États, tels que l’Allemagne ou le Luxembourg, y sont hostiles.
Madame la secrétaire d’État, que pouvez-vous nous dire sur l’état d’avancée de ces discussions importantes pour nos territoires ? Je pense à certaines TPE ou encore à des structures qui gèrent des remontées mécaniques dans les stations de sports d’hiver de mon département.
A contrario, s’il y a une problématique sur laquelle un consensus a su émerger sous la présidence française du Conseil de l’Union européenne, c’est celle de la régulation numérique. Les règlements dits Digital Markets Act (DMA) et Digital Services Act (DSA) vont dans le bon sens.
Le DMA vise à prévenir les abus de position dominante des géants du numérique que sont en particulier les Gafam – Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft – et à offrir un plus grand choix aux consommateurs européens. Tel est par exemple l’objet de la plateforme de marketing digital Utiq, récemment lancée par des opérateurs français, allemand et espagnol, afin de concurrencer les géants américains.
Le DSA vise pour sa part à lutter contre les contenus et produits illégaux en ligne. Le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, que le Sénat examinera prochainement, viendra adapter notre droit national à la nouvelle réglementation européenne.
Oui, l’espace numérique est un espace public comme un autre, mais il s’agit d’un espace où la souveraineté est diffuse et dans lequel ni la censure ni l’anarchie n’ont leur place. Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission spéciale constituée sur ce texte, vous en dira plus dans quelques minutes.
La France doit également être un moteur de la défense des valeurs fondamentales qui nous unissent. C’était la quatrième priorité définie par la Suède pour sa présidence du Conseil de l’Union européenne. Nous devons rester conscients de l’équilibre instable sur lequel repose la démocratie, surtout lorsqu’elle est confrontée à une importante montée des extrémismes à l’échelle de notre continent.
En ce sens, la Communauté politique européenne (CPE), dont le Président de la République a pris l’initiative lors de son discours de la Sorbonne, incarne l’union dans la diversité. Madame la secrétaire d’État, après le sommet de la CPE tenu en Moldavie il y a quelques semaines, pourriez-vous nous indiquer la feuille de route à venir pour cette communauté ?
Avant de conclure mon propos, je souhaite évoquer brièvement deux sujets.
Je veux en premier lieu appeler votre attention, madame la secrétaire d’État, sur les problématiques de gestion de la coopération transfrontalière, notamment entre la France et l’Italie, et sur l’absence persistante d’accords bilatéraux, en particulier sur les questions de coopération hospitalière, entre nos deux pays.
Le traité du Quirinal prévoit de renforcer la coopération transfrontalière. J’apprécierais que nous avancions sur ce dossier. Contrairement à ce qui m’a été dit récemment à l’hôpital de Briançon, les patients venant d’Italie doivent, encore aujourd’hui, avancer les frais de santé, ce qui ne me paraît pas une bonne façon de consolider la coopération transfrontalière.
Je veux en second lieu dire un mot de l’immigration, notamment à la frontière entre la France et l’Italie. J’ai rendu visite cette semaine à la police aux frontières, qui est en grande difficulté du fait d’un manque de moyens et de coopération avec l’Italie, mais surtout parce qu’elle doit gérer à cette frontière une problématique migratoire qui devrait être appréhendée à l’extérieur des frontières européennes.
Je souhaite conclure mon propos sur une note plus positive, en saluant la panthéonisation à venir des résistants Missak et Mélinée Manouchian. Ce couple, rescapé du génocide arménien, s’est illustré par sa lutte armée contre l’occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ils incarnent l’héritage de nos aïeux et nous invitent, par les valeurs qu’ils ont portées, à poursuivre cette quête de préservation de la paix et de la liberté, pour les Européens d’aujourd’hui et de demain.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, à l’origine, l’Union européenne était une entente entre des nations respectueuses de leur souveraineté. Malheureusement, elle est devenue une fédération qui impose une véritable dictature idéologique, y compris pour ce qui concerne les affaires strictement intérieures des États.
Il est ainsi scandaleux que, au sein de l’Union européenne, quelques pingouins veuillent empêcher la Hongrie de présider le Conseil européen, alors que c’est son tour ! Tout cela vise à forcer la main des Hongrois sur des sujets d’ordre strictement intérieur.
M. Thomas Dossus s ’ exclame.

Dans un autre domaine, la guerre en Ukraine, dans laquelle nous sommes quasiment des cobelligérants, nous coûte horriblement cher. L’explosion du prix du gaz et des matières premières, ajoutée aux aides militaires et aux subventions colossales versées à l’Ukraine, est à l’origine d’une inflation galopante et d’un endettement sans précédent. Cela pénalise lourdement les familles françaises et ruine notre pays.
Je n’ai aucune hostilité contre l’Ukraine ni contre la Russie. En revanche, je tiens à dire que les vrais responsables de cette guerre sont les États-Unis, l’Otan et l’Union européenne.
MM. Thomas Dossus et Jean-Michel Arnaud protestent.
MM. Jean-Michel Arnaud et Thomas Dossus protestent.

C’est l’impérialisme américain, conjugué à l’expansionnisme de l’Union européenne. Celle-ci n’a de cesse de s’étendre vers l’est, au détriment de la zone d’influence de la Russie.
Quant à l’Otan, il aurait fallu immédiatement la dissoudre lorsque l’URSS et le pacte de Varsovie ont explosé.
On veut nous faire croire que la Russie serait une menace pour la France, mais c’est un gigantesque mensonge ! Si la France et l’Union européenne avaient laissé la Russie tranquille, sans chercher à l’encercler, nous n’aurions eu ni cette guerre ni les difficultés économiques que nous connaissons actuellement.

N’oublions pas que le coût pour la France de notre engagement dans cette guerre est égal à huit fois le montant des économies qui ont prétendument motivé la récente réforme des retraites.
Vous l’aurez compris, madame la secrétaire d’État, je ne suis pas du tout d’accord avec la politique suivie actuellement par le Gouvernement, et encore moins d’accord avec l’Union européenne.
Ce que je souhaite, c’est que l’on puisse un jour rétablir une véritable souveraineté des États, mais c’est aussi que l’on respecte tous les États, y compris la Russie, qui, elle aussi, a le droit d’exister, de se défendre et de ne pas être encerclée. Les États-Unis n’ont pas voulu que les Russes installent des fusées à Cuba ; pourquoi voudrions-nous que l’Otan s’étende à l’Ukraine et termine d’encercler la Russie ?

C’est pourquoi je crois que la Russie a tout à fait raison de ne pas se laisser faire.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, une nouvelle fois, l’Ukraine sera au premier rang des préoccupations du prochain Conseil européen.
Rien, hélas, ne permet à ce stade d’entrevoir une sortie rapide du conflit. Il est en effet difficile de savoir si la contre-offensive menée par Kiev depuis un peu plus de dix jours triomphera. L’armée russe oppose pour le moment une résistance relativement solide – peut-être avait-elle été sous-estimée au regard des erreurs commises jusqu’alors par ses chefs.
Dans ces conditions, on ne peut que continuer à soutenir les actions déployées par l’Union européenne depuis le début de l’agression russe. L’Europe doit en effet poursuivre sa mobilisation dans plusieurs directions.
J’évoquerai tout d’abord le soutien aux forces armées ukrainiennes. L’Union européenne a déjà fait beaucoup, mais le passage d’une posture défensive à une stratégie offensive va mettre à rude épreuve les matériels livrés. Les stocks des armées européennes se réduisent. Le ministre allemand de la défense l’a rappelé la semaine dernière : « Nous n’allons pas pouvoir remplacer chaque char qui cesse de fonctionner. »
Je rappellerai toutefois que les conclusions du dernier Conseil européen invitent les États membres à redoubler leurs efforts pour répondre aux besoins les plus urgents de Kiev en matière militaire. C’est impératif. Comme chacun sait, ce sont aussi les intérêts des pays européens en matière de sécurité et de défense qui sont en jeu au travers de la guerre en Ukraine.
Face à cette situation, le RDSE est bien entendu favorable à la poursuite de l’aide aux forces ukrainiennes. La livraison en urgence de munitions sol-sol et de munitions d’artillerie, permise dans le cadre du fonds de la Facilité européenne pour la paix, démontre la cohésion de la très grande majorité des États membres en faveur de cette politique de soutien.
Quelles sont les prochaines étapes, madame la secrétaire d’État, pour que l’approvisionnement européen en équipements militaires tienne sur le moyen et long terme ?
Quoi qu’il en soit, il est certain qu’il serait difficile pour l’Europe de faire face à un autre conflit de cette intensité à ses portes. Aussi, bien que le groupe RDSE ait un temps exprimé l’idée qu’il fallait d’abord approfondir le projet européen avant de l’élargir, il apparaît aujourd’hui que le contexte géopolitique nous commande de changer de paradigme.
La Communauté politique européenne, voulue par le Président de la République, est donc une bonne chose, mais elle ne suffira pas à contrer l’impérialisme russe. L’intégration de l’Ukraine à l’Union européenne est bien entendu conditionnée au retour de la paix.
S’agissant de son voisin moldave, en tant que présidente du groupe d’amitié France-Moldavie du Sénat, je suis sensible à son sort. Le principe consistant à maintenir des États tampons aux frontières de l’Europe me semble périmé, du fait des violations par Moscou de l’intégrité de certains de ces territoires. Aider les pays de l’Est à intégrer un ensemble démocratique doit faire partie de la boussole stratégique de l’Union européenne, au bénéfice de leur sécurité, mais aussi de la nôtre.
Je vous saurais donc gré, madame la secrétaire d’État, de nous indiquer quelles perspectives d’élargissement la France envisage de défendre, et dans quelles conditions elle le ferait.
Au prochain Conseil européen, il sera également question de politique économique. Même si l’Union européenne relève la tête, les conséquences du conflit ukrainien sur les prix se font encore sentir.
Lors du Conseil européen de mars dernier, il a été rappelé quelques-uns des grands axes sur lesquels l’Union européenne doit se concentrer pour renforcer sa compétitivité et sa résilience : elle doit réduire ses dépendances stratégiques, en investissant dans les compétences de demain et en adaptant sa base économique, industrielle et technologique pour les transitions écologique et numérique, mais aussi approfondir le marché unique, par la suppression de certains de ses obstacles.
Mon groupe partage ces préoccupations très générales, mais nous souhaitons aussi rappeler quelques principes et exprimer plusieurs interrogations.
Un débat commence à se nouer autour du Pacte de stabilité, entre les partisans d’un plafonnement strict des dépenses et ceux d’un relèvement du budget de l’Union européenne. Avec la flambée des taux d’intérêt, la question de la dette devient de plus en plus prégnante, alors que nous devons affronter un défi de taille, celui de la décarbonation de l’économie, qui nécessite des investissements colossaux. Ne pourrait-on pas imaginer la création d’une dette environnementale, pour chacun des États membres, qui serait soustraite de l’application de critères de type Maastricht ?
Enfin, on peut entendre la nécessité pour l’Europe de lever les obstacles internes au marché unique si, dans le même temps, les politiques sociales convergent davantage.
Un pas vient d’être franchi avec l’accord des Vingt-Sept sur les travailleurs des plateformes, qui instaure une règle de présomption de salariat. C’est une avancée sociale qui s’ajoute à celle qui est relative aux travailleurs détachés.
Il reste de nombreux domaines dans lesquels les règles d’uniformisation mériteraient d’être amplifiées. Je pense en particulier aux règles fiscales, sur lesquelles l’Union européenne manque d’élan du fait de la règle de l’unanimité. Je rappellerai qu’il a fallu en passer par un accord international pour que l’Union européenne accepte un impôt minimum commun sur les multinationales.
Mes chers collègues, sur tous ces points, il s’agit en somme de rappeler que l’Europe doit tout autant renforcer sa résilience économique, pour peser à l’extérieur, qu’encourager à l’intérieur de ses frontières l’esprit de solidarité qui est au fondement du projet européen.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, tous les experts s’accordent pour dire que nous sommes entrés dans une ère multicrises : covid-19, guerre en Ukraine, événements climatiques, crises économiques, la liste continuera sans nul doute de s’allonger.
Face à ce constat, l’Union européenne, habituellement si prompte à se reposer sur les capacités d’autorégulation du marché, s’est décidée depuis quelques années à changer de doctrine. Elle cherche à adapter ses règles pour mieux faire face à ces bouleversements.
Si cette mue, encore inimaginable il y a trois ans, doit nous réjouir, reconnaissons que l’Union se cantonne encore à de la gestion post-crise, plutôt que de créer de véritables outils d’anticipation. Certes, le communiqué publié aujourd’hui par la Commission européenne témoigne d’une volonté de mieux gérer en amont les risques, mais nous sommes encore loin d’avoir atteint cet objectif.
Les divergences d’intérêts des Vingt-Sept et le manque de ressources propres ne nous aident pas à atteindre l’ambition de rapidité et d’efficacité que l’Union européenne affiche. C’est notamment le cas en matière de sécurité et de souveraineté économique, sujet à l’ordre du jour du prochain Conseil européen.
Je ne nie pas que de belles avancées aient été obtenues en la matière, qu’il s’agisse de plan RePowerEU, du Chips Act, du plan industriel du Pacte vert, de l’instrument anti-subvention ou encore de l’accélération des projets importants d’intérêt européen commun (Piiec).
Toutefois, les mesures les plus emblématiques ont une portée limitée. Cela les rend insuffisantes face à la force de frappe de pays comme la Chine, qui a lancé son plan Made in China 2025 dès 2015, ou les États-Unis, dont l’Inflation Reduction Act a été promulgué plus récemment : ce plan, doté d’un montant de 400 milliards de dollars, vise à faire enfin entrer le pays dans une ère écologique, mais en favorisant les entreprises américaines à grands coups de subventions publiques et de crédits d’impôt.
Je ne cherche pas à être défaitiste en disant cela. Bruno Le Maire, ministre de l’économie, a lui-même reconnu l’insuffisance des mesures européennes. Il a ainsi déclaré : « Ce que nous avons fait n’est pas suffisant au niveau européen. Il faut avec beaucoup plus de force et avec des instruments financiers beaucoup plus puissants défendre notre industrie européenne. »
Face aux risques commerciaux, aux menaces de délocalisation d’entreprises du vieux continent vers les États-Unis et à la perte de notre avance technologique en matière d’écologie, l’Europe s’est réveillée, mais bien tard. Qui plus est, les Vingt-Sept se déchirent sur la méthode, en particulier quant à la possibilité d’accorder des subventions publiques aux entreprises.
Les pays scandinaves sont hostiles, par tradition libérale, à ouvrir la manne des subventions. D’autres pays ont décidé de tirer parti de l’assouplissement temporaire des règles d’attribution, mais ils insistent pour que les dérogations soient limitées dans le temps. Enfin, les pays de l’Est sont inquiets de ne pas pouvoir suivre les pays qui disposeraient de plus de moyens qu’eux pour subventionner les entreprises ; ils redoutent qu’une course aux aides ne se mette en place en Europe.
Pour surmonter ces divergences, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé la création d’un fonds de souveraineté européen, dont les contours ont été précisés aujourd’hui. Il a été rebaptisé plateforme Technologies stratégiques pour l ’ Europe (Step) : il a pour objectifs de prévoir des financements communautaires pour aider les pays européens qui n’ont pas les moyens de subventionner massivement leurs industries et d’éviter une « fragmentation du marché unique ».
Cependant, la question du financement se pose. Si l’on en croit les annonces d’aujourd’hui, il apparaît que le fonds sera alimenté par les crédits non encore utilisés de NextGenerationEU. Le problème est que, si ces sommes ne sont pas encore décaissées, elles sont bel et bien déjà engagées vers d’autres projets. De plus, certains chercheurs soulignent que le fonds ne pourra être exploité à son plein potentiel que lorsque le marché unique des capitaux aura été définitivement achevé, car l’afflux d’investissements privés ne pourra se produire efficacement que s’il existe de vastes réserves de capitaux privés attendant d’être investis, ce qui manque actuellement dans l’Union européenne.
On peut donc s’interroger sur la pertinence d’un tel fonds. Une autre voie se dessine : l’instauration d’une préférence européenne. Déjà évoquée par le Président de la République, avec sa suggestion d’un Buy European Act, une telle mesure aurait l’avantage de limiter la concurrence des pays tiers et d’inciter à produire sur le territoire européen.
Il serait alors possible, par exemple, de mieux contrôler les investissements réalisés dans des pays tiers, de réformer les conditions d’accès aux marchés publics en favorisant les entreprises implantées dans l’Union européenne ou encore de réviser les droits de douane pour les importations en provenance de pays n’appartenant pas à l’Union européenne. Le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières constitue d’ailleurs un premier pas dans le sens d’une préférence communautaire, de même que le règlement relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur. Il semblerait donc logique de continuer dans cette voie tout en allant plus loin.
J’admets que l’équilibre est difficile à trouver, entre préservation des intérêts des vingt-sept États membres et nécessité de ne pas créer de conflit commercial avec des pays tiers. La préférence européenne me semble toutefois une piste intéressante à explorer dans la mesure où un fonds de souveraineté pourrait devenir un simple échelon supplémentaire des Piiec et perdre ainsi toute valeur ajoutée.
Madame la secrétaire d’État, quelle sera la position de la France quant aux diverses pistes proposées pour défendre l’économie européenne et notre souveraineté ? La balance vous semble-t-elle pencher davantage vers l’une des solutions proposées ? Si oui, vers laquelle ?
Pour conclure, j’ajouterai qu’il ne faut pas perdre de vue l’objectif qui devrait nous guider : réagir rapidement et efficacement face à des risques économiques. N’oublions pas que le plan chinois a sept ans et que l’IRA existe depuis bientôt un an. Nous devons faire en sorte de disposer de nouveaux outils pour défendre nos industries européennes dans les meilleurs délais. À ce stade, la Commission européenne semble chercher non pas à construire une réelle stratégie, mais seulement à ouvrir une réflexion sur la thématique de la sécurité économique. Nous comptons donc sur le Gouvernement pour plaider en faveur d’une accélération du processus.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous sommes nombreux à avoir évoqué la dernière tragédie en Méditerranée. Nous avons exprimé notre compassion, notre indignation, comme à chaque fois après de tels événements – celui-ci était malheureusement d’une ampleur exceptionnelle –, et puis après, chacun fait comme avant… J’ai été frappé de constater que de nombreuses victimes avaient de la famille en Europe.
Le pacte européen sur la migration et l’asile, s’il avait été en vigueur, aurait-il changé quelque chose et permis d’empêcher une telle tragédie ? L’honnêteté oblige à dire que non. Aucune voie légale n’aurait permis à ces gens d’espérer pouvoir rejoindre leur famille en Europe.
Il n’existe aucune solidarité. Il n’y a aucune affirmation réelle d’une volonté de maintenir un régime d’asile plein et entier, c’est-à-dire qui respecte nos engagements de protéger les personnes, même lorsqu’elles sont sur notre territoire. Un autre drame récent montre combien certains demandeurs d’asile ont besoin que l’on traite leurs traumatismes et que l’on évite d’en créer d’autres avec l’enfermement qui est prévu dans le pacte sur la migration et l’asile.
Ce pacte ne prévoit rien non plus pour permettre aux pays européens riverains de la Méditerranée de respecter le droit de la mer tout en s’appuyant en retour sur la solidarité européenne. Nous devons affirmer le principe selon lequel l’Union européenne doit faire preuve d’une solidarité sans faille à l’égard de l’Espagne, de l’Italie, de la Grèce, de Chypre et de Malte, en échange d’un respect plein et entier du droit de la mer et de leur engagement à accueillir les bateaux de naufragés et de sauvetage en mer.
Bien entendu, cela passe par une réforme du règlement de Dublin d’une autre ampleur que ce qui est prévu : les personnes sauvées en mer devraient non pas dépendre du pays d’arrivée, mais bénéficier, dès le début, d’une solidarité européenne complète, même si elle n’engage que quelques pays.
D’autres sujets montrent l’importance d’avancer vers une reconnaissance mutuelle des instructions de demande d’asile dans les pays européens. Une demande d’asile acceptée dans un pays devrait l’être partout, et un refus opposé par un pays devrait empêcher le dépôt d’une autre demande. Ce mécanisme pourrait entrer en vigueur dans le cadre d’une procédure de coopération renforcée, sur la base d’une convergence des critères et des modalités d’instruction des demandes d’asile. Il me semble absolument impératif d’avancer dans la voie de la reconnaissance mutuelle et de faire évoluer les principes fixés dans le règlement de Dublin.
Il devient possible de mettre en place des voies légales d’entrée, grâce aux évolutions sur les e-visas, à la mise en place du système européen d’autorisation et d’information concernant les voyages (Etias), ou encore à l’entrée en vigueur du système d’entrée/de sortie (EES) de l’Union européenne. Le Canada permet aux ressortissants de certaines nationalités de rentrer sur son territoire avec une autorisation de voyage dès lors qu’ils ont eu auparavant un visa. Une telle évolution est possible en Europe, afin de permettre à toute personne, quelle que soit sa nationalité, dès lors qu’elle a déjà obtenu un visa, de continuer à voyager dans l’Union européenne, pour de courts séjours, mais avec une autorisation de voyage. Il est indispensable de trouver des voies légales pour que des personnes puissent non pas s’installer, mais venir en Europe. Les dispositifs récents que j’ai évoqués y contribueront.
Il est tout aussi nécessaire que l’Europe se dote de tous les outils pour lutter contre les passeurs criminels, les trafics de toutes natures – de stupéfiants, d’êtres humains – et la criminalité organisée. Il conviendrait à cet égard que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) évolue. Pour cela, le droit européen en matière de conservation et d’accès aux données de connexion doit être modifié. De ce point de vue, la législation européenne et la jurisprudence de la CJUE ne sont pas satisfaisantes. Si nous voulons vraiment lutter contre une criminalité grave qui commence à menacer un certain nombre d’États européens, il est indispensable de modifier notre droit. Nous sommes plusieurs à travailler sur le sujet au Sénat.
Enfin, nous avions débattu voilà quelque temps de la situation des enfants ukrainiens déportés de force en Russie. La présidente de la Commission européenne avait annoncé une conférence sur cette question. Qu’en est-il ?
Pourquoi le Gouvernement, lors de l’examen du projet de loi sur la réforme de la justice, n’a-t-il pas souhaité aller jusqu’au bout dans la lutte contre l’impunité ? Pourquoi s’est-il opposé aux amendements tendant à supprimer la double incrimination ? Il est temps de mettre fin à l’impunité de personnes qui peuvent se trouver sur notre territoire, mais qui ne peuvent pas y être poursuivies, soit parce qu’elles ne résident pas habituellement dans notre pays, soit parce que le crime dont elles sont accusées n’est pas puni par la loi de leur pays d’origine. Il convient de faire évoluer les règles si l’on veut lutter contre l’impunité de ceux qui ont commis ou qui sont soupçonnés d’avoir commis des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité.
Applaudissements sur les travées du groupe SER. – M. Jacques Fernique applaudit également.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, en l’état, l’ordre du jour du prochain Conseil européen ne mentionne pas expressément le numérique.
Le Conseil européen sera consacré au suivi des conclusions sur la politique industrielle et sur le marché unique, à la compétitivité et à la productivité à long terme de l’Europe, à la réforme de la gouvernance économique et au bilan sur les capacités de l’Union en matière de sécurité et de défense. Je suis surprise que le numérique ne figure pas à l’ordre du jour. Il constitue l’épine dorsale de nos sociétés. La succession de nouvelles technologies dans ce domaine ne cesse de bouleverser nos modèles économiques et d’affaires. Le sujet est central.
Sous la présidence de Jean-François Rapin, la commission des affaires européennes du Sénat a travaillé et formulé des propositions, anticipant l’adoption des règlements visant à instaurer une régulation européenne du numérique, régulation qui a tant fait défaut durant ces vingt dernières années.
L’heure est maintenant venue, après l’adoption pendant la présidence française de l’Union européenne du DMA, du DSA et du règlement sur la gouvernance des données, le Data Governance Act (DGA), de la transposition. C’est l’objet du projet de loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, sur lequel la commission spéciale constituée par le Sénat travaille activement.
Je me réjouis que l’ensemble des propositions d’amélioration figurant dans des résolutions européennes du Sénat – nous les avons adoptées à l’unanimité – aient été prises en compte dans ces textes. Pour autant, si ces derniers constituent des étapes importantes, ils ne résoudront pas tous les abus des grandes plateformes extraeuropéennes ni certains dysfonctionnements qui sont intrinsèquement liés à leur modèle économique, à leur absence de statut, donc de vraie responsabilité.
Le projet européen de régulation de l’intelligence artificielle (IA) vient d’être adopté par les eurodéputés. Nous sommes fiers que l’Union européenne soit la première dans le monde à légiférer sur ce sujet complexe et difficile à appréhender. L’usage de l’IA se généralise et suscite de nombreuses inquiétudes. Cela représente aussi un formidable gisement de croissance. L’Union européenne doit rester dans la course par le biais d’investissements en matière de politique industrielle. C’est pour ces raisons que nous devons nous doter d’un cadre juridique qui encadre les risques liés à son utilisation, mais qui permette également d’être dans la course.
Le Data Act est encore en cours de discussion. Je rappelle que la donnée est l’or noir du numérique. Beaucoup de nos données, qu’il s’agisse de nos administrations, de nos entreprises, de nos infrastructures critiques, sont extrêmement sensibles. Certaines relèvent même de la sécurité nationale, voire du secret-défense. Il est donc impératif, à la faveur de ce texte, de changer d’approche et de profiter de l’occasion pour alerter sur les dangers du recours à des technologies extraeuropéennes pour le traitement de nos données. N’oublions pas que nous sommes toujours sous la coupe de la législation américaine, notamment le Foreign Intelligence Surveillance Act (Fisa).
En résumé, cette ambition de régulation est bienvenue, mais elle ne saurait à elle seule constituer une stratégie de reconquête de notre souveraineté dans le domaine du numérique, cher à Thierry Breton.
Nous nous interrogeons sur la politique industrielle en la matière. Notre commission des affaires européennes a publié un rapport sur le programme d’action numérique de l’Union européenne à l’horizon 2030. Nous avons pointé du doigt une absence de moyens et de vision stratégique. Par exemple, si le programme met en avant la formation, les modalités pratiques restent bien floues. Quels cursus ?
Finalement, on a l’impression que les États membres sont renvoyés à leurs propres responsabilités. Ils devront mettre en œuvre le programme avec leurs propres moyens, il en résultera des situations différenciées, des états d’avancement plus ou moins avancés selon les pays. Si quelques axes forts sont posés, on observe ainsi un manque de coordination.
Il importe que les États et l’Union européenne appréhendent clairement le numérique comme un élément relevant du domaine régalien et se dotent d’une politique industrielle en la matière. Il s’agit de faire monter en puissance l’industrie européenne pour qu’elle puisse garantir à terme notre autonomie technologique, qu’elle contribue à l’affirmation de notre souveraineté et qu’elle soit en mesure d’assurer la sécurité de nos données, y compris les plus sensibles.
Le Data Act est transposé par anticipation dans le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, texte que nous examinerons dans quelques jours. Il a pour objet d’éviter que les grandes plateformes ne verrouillent techniquement, juridiquement et financièrement le marché de la donnée par le biais de systèmes informatiques « propriétaires ».
Dans notre rapport d’information sur le Data Act, André Gattolin, Florence Blatrix Contat et moi-même proposons d’accompagner nos entreprises européennes et nos PME dans la création et le développement de clouds souverains, afin que l’on ne dépende plus de législations extraeuropéennes.
N’ayons pas peur des mots, il faut assumer le choix d’une préférence communautaire pour nos entreprises. Les impératifs de sécurité nationale peuvent tout à fait justifier des exemptions aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et au droit des marchés publics européens. Cyril Pellevat a évoqué tout à l’heure un Buy European Act, mais on pourrait envisager un Small Business Act. Toutes les puissances étrangères – je pense aux États-Unis, à la Chine, à l’Inde – ont mis en place des réglementations en matière de localisation et de traitement des données, et ont instauré des contraintes liées à des considérations de sécurité nationale qui rendent compliquée, voire impossible l’application d’une concurrence libre et non faussée entre acteurs locaux et européens.
Il est temps d’utiliser la commande publique comme levier et de porter cet argument à l’échelon européen. Il y va de notre intérêt.
Enfin, à l’heure actuelle ont lieu des discussions sur le traitement des données sensibles et stratégiques, autour du projet de schéma européen de certification de cybersécurité pour les services de cloud, qui a été présenté en 2020, sur l’initiative de Thierry Breton.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, lors de leur prochaine réunion, les chefs d’État et de gouvernement aborderont un sujet fondamental pour notre continent : l’asile et les migrations.
Il semble qu’à cette occasion ils puissent enfin constater non pas seulement des divergences irréconciliables et des blocages insolubles, mais bien quelques avancées concrètes.
En effet, le Parlement européen a adopté en mars et en avril dernier ses positions de négociation sur le pacte sur la migration et l’asile. Le 8 juin, il était imité par le Conseil européen, qui a validé ses dernières approches générales, parvenant à un accord sur deux piliers essentiels de la réforme : la proposition de règlement établissant un cadre commun pour la gestion de l’asile et de la migration et la proposition de règlement sur les procédures d’asile.
Huit ans après la crise de 2015, sept ans après les premières mesures présentées par la Commission Juncker et bientôt trois ans après les propositions de la Commission von der Leyen, il semble que les institutions européennes soient enfin en ordre de marche pour la dernière ligne droite des trilogues. La Commission européenne semble optimiste quant à une issue rapide des débats.
Cependant, l’expérience de ces dernières années nous a appris qu’il fallait toujours mâtiner son optimisme d’une certaine dose de prudence lorsque l’on évoque la question migratoire à l’échelon européen.
Et pour cause : l’horloge tourne ! En raison de la tenue des élections européennes l’an prochain, le Parlement européen interrompra ses travaux au mois d’avril, et rien ne dit que l’assemblée qui lui succédera sera encline à remettre l’ouvrage sur le métier. Il reste donc un temps finalement assez court pour clore une négociation à la fois explosive et enkystée depuis tant d’années. L’aboutissement du processus dépendra essentiellement de la capacité à régler la question qui, jusqu’à présent, a fait dérailler toutes les discussions : celle de la solidarité !
Malgré l’abstention de quatre pays – rien que cela ! – et l’opposition formelle de la Pologne et de la Hongrie, les États membres semblent être parvenus à s’entendre autour d’un mécanisme que l’on pourrait qualifier d’hybride et de flexible. Dans ce cadre, 30 000 demandeurs d’asile au moins devraient être relocalisés chaque année au sein de l’Union européenne. Les États membres pourront refuser cette relocalisation, mais devront soit verser une compensation financière de 20 000 euros par migrant qu’ils refusent d’accueillir, soit contribuer directement au renforcement des capacités d’accueil des autres États membres.
Disons-le clairement, ce dispositif est loin d’être parfait, et sa mise en œuvre soulève encore bien des questions opérationnelles, mais il a le mérite d’organiser une forme de solidarité alternative à la relocalisation obligatoire des demandeurs d’asile. Si cette idée de la relocalisation semblait empreinte d’une certaine logique, elle se heurtait jusque-là au ressenti profond de certains pays européens. Cette situation a été à l’origine de tant de psychodrames au cours des dernières années, que l’on pouvait pensait que la politique migratoire européenne était condamnée à ne jamais voir le jour.
Le compromis trouvé par le Conseil européen fait preuve d’un vrai pragmatisme, ce qui pourrait, peut-être, permettre aux Européens d’aller de l’avant, plutôt que de se déchirer.
Madame la secrétaire d’État, j’ai toutefois une inquiétude. La position adoptée par le Parlement européen semble particulièrement éloignée, dans sa philosophie même, de celle qu’a dégagée le Conseil européen. Les eurodéputés défendent l’idée selon laquelle les engagements annuels de solidarité devraient être obligatoirement constitués, à 80 % au moins, de relocalisations, le reste pouvant prendre la forme de mesures de soutien en matériel ou en personnel. Le Parlement européen semble donc irrémédiablement exclure la possibilité qu’un concours financier puisse se substituer à l’accueil des demandeurs d’asile. L’écart entre les deux législateurs européens sur le cœur du pacte est donc profond, et cette situation laisse présager des trilogues particulièrement difficiles.
Nous ne sommes pas encore au bout du chemin, d’autant que des convergences de vue semblent difficiles à obtenir sur d’autres éléments fondamentaux du pacte tels que les mécanismes de filtrage ou la politique d’asile à la frontière. Ces derniers mettent en place des procédures pertinentes qui permettront de mieux contrôler les flux migratoires et d’accélérer l’examen des dossiers des demandeurs d’asile.
Juridiquement, ces dispositifs sont sous-tendus par la fiction de non-entrée sur le territoire européen. Or, si le Conseil entend à juste titre conforter cette notion, le Parlement européen souhaite, lui, la supprimer. Ajoutons à cela qu’après l’épisode lié à la fin des moteurs thermiques en Europe le caractère hétéroclite de la coalition allemande se rappelle une nouvelle fois à notre bon souvenir. Les Verts allemands, rejoignant leurs homologues européens et une partie des sociaux-démocrates, ont ainsi d’ores et déjà fait savoir sans équivoque qu’ils s’opposeraient au compromis trouvé de haute lutte par les États membres.
Je note avec intérêt que les institutions européennes semblent enfin avancer sur la question fondamentale, existentielle même, de l’asile et de l’immigration. Toutefois, vous l’aurez compris, je suis vraiment très sceptique face à l’ampleur de la tâche qui reste à accomplir.
L’Union européenne a déjà largement entamé sa crédibilité sur le sujet et, disons-le sans ambages, elle a en grande partie perdu la confiance des Européens. Si elle veut la regagner, elle ne peut en aucun cas se permettre le luxe d’une nouvelle législature pour rien sur cette question ; elle doit donc au plus vite maîtriser réellement ses frontières.
Quant à la France, madame la secrétaire d’État, si elle veut se doter d’une nouvelle stratégie nationale en matière d’immigration, elle doit préalablement – ou « en même temps », si vous me permettez… – disposer d’une politique claire et efficace de gestion de ses frontières. Est-ce vraiment possible ? À un an des prochaines élections européennes, il y va de notre avenir commun. Sinon, et je le dis ici clairement, ce sera l’heure des populismes pour l’Europe et pour la France !

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, lors de leur réunion du 29 et du 30 juin prochain, les chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne vont devoir traiter d’un ensemble de sujets qui concernent tous trait, peu ou prou, la situation et le positionnement de l’Union européenne dans un environnement géopolitique particulièrement difficile, ainsi que sa capacité, dans ce contexte, à préserver ses intérêts et affirmer ses valeurs.
La guerre en Ukraine, malheureusement, figurera de nouveau au premier rang des préoccupations. Les pays alliés de l’Ukraine sont confrontés à un dilemme : ils doivent tout faire pour mettre fin aux hostilités et favoriser la survenance rapide de la paix, sans paraître toutefois faire la moindre concession sur le droit de l’Ukraine à recouvrer l’intégralité de son territoire national.
Il faut espérer, en tout cas, que l’admirable cohésion dont ont fait preuve les États membres de l’Union jusqu’à présent ne commencera pas à se fissurer.
L’approbation d’un onzième paquet de sanctions européennes contre la Russie fait, à cet égard, figure de test. Les propositions de la Commission, récemment débattues, reposent sur une préoccupation légitime : celle d’éviter que les nombreuses sanctions déjà adoptées ne soient contournées par la Russie avec la complicité de pays ou d’entreprises, y compris européennes, qui y trouveraient un intérêt politique ou économique. Des États membres, dont la Hongrie et la Grèce, ont déjà manifesté leur franche opposition à certains éléments importants du paquet, tandis que l’Allemagne fait, une fois de plus, montre de frilosité à l’égard de tout ce qui pourrait contrarier la Chine et remettre en cause les fructueuses relations commerciales qu’elle entretient avec ce pays.
Madame la secrétaire d’État, quelle sera la position de la France ? Pensez-vous que les divergences entre États puissent être aplanies et qu’un accord puisse être trouvé ?
Le Conseil européen sera par ailleurs invité à se pencher sur les futures réparations par la Russie des dommages de guerre causés à l’Ukraine et sur la mobilisation à cette fin des avoirs russes gelés en Europe. Ces questions pourraient sembler prématurées à certains, mais j’estime que, outre le souci des intérêts fondamentaux de l’Ukraine, ses alliés européens doivent aussi avoir celui de ne pas se faire exclure par d’autres du grand chantier de reconstruction qui ne manquera pas de s’ouvrir une fois le conflit terminé. Les possibilités économiques offertes devront être à la mesure des efforts consentis par notre pays dans les domaines militaire, diplomatique, financier et humanitaire.
En ce qui concerne la perspective européenne de l’Ukraine, j’incite chacun à la prudence. Il est compréhensible que l’Union européenne n’ait pas voulu fermer totalement la porte à une telle perspective dans le contexte actuel. Toutefois, il convient de réaffirmer que les conditions d’accès à l’Union européenne pour tout pays candidat sont inscrites dans les traités ; elles ne sont pas négociables. La marche à suivre pour toute nouvelle adhésion doit donc être respectée.
Il nous faut également tenir compte du fait que d’autres pays figurent déjà sur la liste d’attente et que notre opinion publique, en l’état actuel des choses, n’est pas favorable à un nouvel élargissement.
Incontestablement, l’un des effets de la guerre en Ukraine a été de relancer le débat sur la politique commune de sécurité et de défense et sur la coopération entre l’Union européenne et l’Otan. En cohérence avec la boussole stratégique, adoptée l’année dernière par le Conseil européen, les chefs d’État et de gouvernement devront rapidement faire adopter de nouveaux instruments pour renforcer les industries européennes de défense, notamment en mutualisant les moyens de production et l’approvisionnement en munitions.
Surtout, il convient d’éviter que les efforts budgétaires notablement accrus de plusieurs États membres en matière de défense ne profitent aux fournisseurs des pays tiers.
Par ailleurs, une discussion sur les questions de migrations est prévue à l’agenda du Conseil européen. Elle est évidemment indispensable pour progresser enfin sur cette question très sensible. Faute de s’entendre sur des quotas ou des mécanismes de répartition des migrants, nos pays doivent au moins unir leurs efforts pour organiser le renvoi effectif des migrants clandestins et des déboutés du droit d’asile vers leur pays d’origine.
Cela implique de mettre la pression sur les pays concernés, notamment ceux de la rive sud de la Méditerranée, par tous les moyens à la disposition de l’Union européenne : octroi de visas, préférences commerciales, aides financières… À cet égard, les récentes critiques du pacte migratoire européen formulées par le président tunisien, qui a affiché son refus de coopérer avec les pays de l’Union européenne, sont inacceptables. Nous attendons une réaction ferme de la France et de ses partenaires à l’occasion de la prochaine réunion du Conseil européen.
Celle-ci se tiendra, comme chaque année, à la fin du premier semestre. Il y sera question de coordination des politiques économiques et d’approbation des recommandations par pays de la Commission européenne et du Conseil européen. Il est attristant, à la lecture de ces documents, de constater que la France est, encore une fois, pointée du doigt pour des déséquilibres macroéconomiques importants, une dette publique excessive et insoutenable « à moyen terme », des problèmes sérieux de compétitivité et une faible progression de la productivité du travail.
Par ailleurs, les réformes structurelles nécessaires pour remettre en ordre les finances publiques à plus long terme sont considérées comme insuffisantes à ce stade, et des doutes sont émis sur la capacité du Gouvernement d’en entreprendre de nouvelles.
Ce diagnostic et les recommandations dont il est assorti sont évidemment à prendre très au sérieux, non pas parce qu’ils émanent des institutions européennes, mais parce qu’il y va de l’intérêt et de la crédibilité de notre pays et de sa capacité à faire face à tous les défis qui se présentent à lui.
M. Jean-Marc Boyer applaudit.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le 29 et le 30 juin prochain, le Conseil européen se réunira. Il y sera a priori question de la politique économique de l’Union européenne, au travers des conclusions du Conseil sur la politique industrielle et sur le marché unique, ainsi que sur la compétitivité et la productivité à long terme de l’Europe.
La situation économique, la sécurité et la résilience économique de l’Union européenne seront également abordées. C’est sur ces points que je souhaite m’attarder, car il me paraît nécessaire de faire entendre la voix de la France. Par son histoire, sa longue tradition industrielle et sa vision gaulliste d’une économie au service de la souveraineté nationale, la France a des valeurs dont l’Union européenne doit pouvoir s’inspirer.
Depuis trop longtemps, nos gouvernants européens me semblent faire montre d’une certaine naïveté dans leur vision des rapports de force économiques mondiaux. Nous en portons collectivement la responsabilité, quelle que soit notre tendance politique ou notre nationalité.
Au tournant des années Maastricht, notre croyance dans un marché mondial porteur de toutes les vertus était solidement ancrée. Confiants dans notre potentiel économique, nous croyions que les échanges mondiaux ne pourraient pas nous être préjudiciables. Dans une sorte de surinterprétation de la théorie des avantages comparatifs, l’économie européenne s’est transformée, passant d’une économie industrielle à une économie de service.
Le marché étant le remède à tout et ne pouvant nous nuire, pourquoi garder ces grandes usines laides et polluantes quand on pouvait faire fabriquer ailleurs ? Le concept même de souveraineté semblait appartenir à un autre temps.
Cette vision essentialisée du marché nous a considérablement affaiblis, alors que se réveillaient des géants économiques et que d’autres, outre-Atlantique, renforçaient leurs armes dans la concurrence mondiale.
Depuis, la crise sanitaire et la crise ukrainienne ont remis au goût du jour le concept de souveraineté économique, voire la question d’une souveraineté européenne.
Le chemin à parcourir est encore long. Exemple flagrant de notre naïveté économique persistante, l’essor de la voiture électrique constitue un véritable appel d’air pour les industries automobiles étrangères, qui vont pouvoir s’implanter sur le marché européen.
À l’inverse de l’Union européenne, ces puissances concurrentes contrôlent la chaîne de production de bout en bout. De l’extraction des terres rares à la production des batteries, puis à l’assemblage des véhicules, nos constructeurs font face à une concurrence puissante et inquiétante.
En l’espèce, il s’agit non pas d’avantages technologiques, mais bien de la capacité d’industries étrangères à mobiliser des moyens et des ressources immenses pour conquérir de nouveaux marchés. C’est d’autant plus préoccupant que ces industries concurrentes proviennent parfois de pays ne pratiquant malheureusement ni embargo ni sanctions à l’égard de la Russie. Elles continueront donc d’avoir accès aux ressources minières russes, tandis que nos industriels européens devront se fournir ailleurs à prix d’or et n’auront pas d’autre choix que de reporter le coût supplémentaire sur les consommateurs.
D’une politique économique naïve et mal préparée découlent des conséquences sociales qui distendent le lien démocratique entre l’Europe et ses citoyens. Les zones à faibles émissions (ZFE) en sont un bon exemple : d’une part, elles poussent les consommateurs à acquérir des véhicules électriques bon marché, souvent étrangers, d’autre part, elles créent un périmètre d’exclusion pour ceux qui n’auraient pas les moyens de renouveler leur véhicule.
S’il existe un enjeu environnemental certain, les ZFE établissent une frontière sociale qui va, de fait, rendre inaccessible aux citoyens européens des infrastructures pourtant financées par leurs impôts : gares, musées, hôpitaux, stades… La liste est longue !
Pour la France rurale, ou la France périphérique, les statistiques vont bel et bien se traduire en réalités concrètes en matière de mobilités et de segmentation de l’espace. L’accès de nos concitoyens les plus défavorisés aux métropoles et aux avantages socioéconomiques qu’elles confèrent va graduellement se détériorer.
D’une Europe pourvoyeuse d’un marché unique laissant librement circuler les individus et les biens, sans frontières ni barrières douanières, nous risquons de nous retrouver dans une situation ou l’octroi à l’entrée des villes devra être rétabli…
Mon dernier point concerne la question énergétique. Entre atermoiements, ordres et contre-ordres, la politique de l’Union européenne mérite d’être débattue.
Le temps imparti est malheureusement trop court pour revenir sur le projet Hercule prévu pour EDF, sur le mécanisme européen de couplage des prix de l’électricité sur celui du gaz ou encore sur le label vert obtenu de haute lutte pour le nucléaire… Autant de véritables enjeux de souveraineté et de résilience pour notre économie.
Concentrons-nous sur l’objectif fixé par l’Union européenne de porter à 42, 5 % la part de la consommation énergétique européenne issue d’énergies renouvelables en 2030. Comme pour la voiture électrique, cet objectif pose question. Une fois encore, nous fixons des objectifs qui ne sont atteignables qu’avec le concours d’industries étrangères, et souvent au prix d’une déstabilisation de notre propre filière.
En effet, nous importons actuellement entre 70 % et 80 % des équipements nécessaires à la production d’énergies renouvelables. Les filières scandinaves et allemandes peinent à rivaliser avec leurs concurrents asiatiques. Elles font face à des entreprises qui disposent à domicile des ressources nécessaires à la fabrication des équipements : terres rares, métaux critiques, etc.
Sans compter qu’il s’agit là de futurs déchets pour le traitement desquels les filières de recyclage européennes sont balbutiantes et déjà convoitées par la concurrence internationale. La boucle est bouclée !
Madame la secrétaire d’État, mes collègues vous ont déjà posé de nombreuses questions. Aussi, pour conclure, je dirai simplement que l’Union européenne continue parfois de prendre pour elle-même des décisions économiques qui font le jeu d’intérêts étrangers et qui éloignent démocratiquement le citoyen européen.
Elle doit veiller à faire émerger une souveraineté européenne sans empiéter sur celle des États membres, et bâtir une politique économique et environnementale forte. Les enjeux sont de taille, et l’exercice est difficile ; c’est certain. Toutefois, je veux croire que nous serons entendus.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie de vos interventions et de vos nombreuses questions, auxquelles je vais tâcher de répondre rapidement et efficacement. Je me tiens bien entendu à votre disposition pour toute demande de précision.
Vous êtes nombreux à avoir évoqué – je pense notamment à MM. les sénateurs Rapin et Allizard – le projet de règlement européen sur les munitions. La France soutient le projet de la Commission européenne en faveur de la production de munition et de la mobilisation du budget européen au profit de projets capacitaires militaires. Toutefois, nous veillerons évidemment, lors de l’examen du texte, à préserver à la fois nos intérêts de sécurité nationale et la répartition des compétences qui est prévue par les traités.
Monsieur Rapin, madame Guillotin, monsieur Cadec, l’élargissement européen sera discuté au mois de décembre prochain. Le Président de la République a été clair : l’élargissement doit s’accompagner de réformes des politiques européennes, du budget et de la gouvernance de l’Union européenne.
À cet égard, madame la sénatrice Mélot, l’instauration d’un vote à la majorité qualifiée dans certains domaines, que ce soit la politique fiscale ou bien la sécurité, fera en effet partie des réformes qui seront engagées.
J’ai également été interrogée sur l’adoption du onzième paquet de sanctions, qui est prévue pour le prochain conseil des ministres des affaires étrangères de l’Union européenne le 26 juin prochain. Il comporte deux volets : le premier, sur la mise en œuvre d’un mécanisme anti-contournement des sanctions, pour s’assurer de l’efficacité de celles-ci, le second, sur l’ajout d’une centaine de désignations individuelles contre des responsables russes qui soutiennent l’effort de guerre, que ce soient des militaires, des responsables d’enlèvements d’enfants ou des propagandistes dans les médias.
Monsieur Laurent, au sommet de Bucarest, en 2008, l’Otan a, comme vous le savez, estimé que l’Ukraine avait vocation à rejoindre l’organisation. L’Ukraine a le statut de partenaire « nouvelles opportunités » et le Président de la République a déclaré, à Bratislava, que le sommet de Vilnius serait l’occasion de lui apporter des garanties de sécurité tangibles et crédibles. Voilà la position de la France.
Venons-en à l’économie.
Monsieur le sénateur Raynal, vous m’avez interrogé sur la révision du cadre financier pluriannuel et la réforme de la gouvernance économique européenne, dont le contenu, comme vous le savez, a été communiqué par la Commission européenne aujourd’hui même. Dans ces circonstances, la tenue d’une discussion entre chefs d’État et de gouvernement dès la semaine prochaine nous semble pour le moins prématurée, car elle est « impréparée » d’un point de vue technique.
Nous continuerons donc de travailler sur ce projet de réforme et de demander, monsieur le sénateur Joly, que l’accent soit mis sur les ressources propres.
Monsieur le sénateur Pellevat, nous poussons également pour la création d’un fonds de souveraineté européen, pour la réciprocité des marchés publics et pour l’instauration d’un contrôle des prises de participation et des investissements dans les secteurs stratégiques.
Sur la gouvernance économique, nous soutenons les principes directeurs de la réforme proposée par la Commission européenne, sur la base du triptyque différenciation, appropriation et promotion des investissements et des réformes. Nous pensons bien entendu, monsieur le sénateur Laurent, aux transitions énergétique et numérique.
Nous regrettons que la proposition d’avril réintroduise des règles numériques automatiques, car elles se sont révélées procycliques dans les années précédentes. Il nous semble important de préserver l’esprit des réformes, ce qui inclut bien sûr la soutenabilité des finances publiques. Ces règles numériques automatiques devront probablement être retirées.
Par ailleurs, vous avez été nombreux à m’interroger sur les migrations. J’essaierai de répondre de façon synthétique à MM. les sénateurs Rapin, Fernique, Leconte, Reichardt et Cadec. Nous pouvons nous féliciter de l’accord obtenu le 8 juin au Conseil européen sur les deux textes au cœur du pacte sur la migration et l’asile qui, comme vous l’avez soulevé, était bloqué depuis plus d’une dizaine d’années.
Ces textes représentent une avancée non négligeable. Ils prévoient la mise en œuvre d’un mécanisme de solidarité obligatoire entre États membres et laissent à leur discrétion la nature de cette solidarité entre relocalisations et contributions financières. Le compromis permet de dépasser des blocages qui ont trop longtemps perduré.
Bien entendu, nous devons encore progresser, notamment sur le sauvetage en mer – j’y reviendrai – et sur la dimension extérieure. C’est d’ailleurs sur cette dernière que devraient porter les discussions lors du prochain Conseil européen. La volonté commune des Vingt-Sept est assez claire : travailler de concert avec nos partenaires des pays tiers pour prévenir les migrations et les drames.
C’est dans cette optique que la France entretient un dialogue nourri avec Tunis. Le Président de la République va ainsi s’entretenir avec le président Saïed en marge du sommet pour un nouveau pacte financier mondial. De plus, nous nous mobilisions auprès de nos partenaires européens pour soutenir la Tunisie : Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni et Mark Rutte s’y sont ainsi rendus le 12 juin dernier pour annoncer un paquet global de soutien que nous avons contribué à élaborer et dont nous approuvons les orientations.
Nous devons tout faire pour que cesse le drame épouvantable dont nous avons vu l’expression la semaine dernière. Nous y travaillons encore davantage : le nouveau président de Frontex vient de prendre ses fonctions, des embauches supplémentaires d’agents vont s’ajouter à nos propres garde-côtes et un groupe de contact sur le sauvetage en mer répondra en partie aux inquiétudes.
Sur l’accord avec le Mercosur, messieurs les sénateurs Rapin, Allizard, Fernique, Arnaud et Joly, je répète que la position de la France n’a pas changé. Elle a été rappelée la semaine dernière par le ministre délégué chargé du commerce extérieur, Olivier Becht : nous ne pouvons pas accepter l’accord en l’état.
Comme je le dis à tous nos partenaires européens, cet accord doit être complété par des engagements additionnels contraignants et ambitieux sur le développement durable. L’accord de Paris doit en être une clause essentielle, et l’accord avec le Mercosur doit être aligné avec la nouvelle approche de l’Union européenne en matière de commerce et de développement durable.
Nous portons cette position auprès de la Commission européenne, qui travaille en ce moment avec les États du Mercosur, et nous la relayons à la future présidence espagnole du Conseil de l’Union européenne et à nos partenaires sud-américains. Je vous assure qu’il n’y a aucune ambiguïté sur le sujet.
Le prochain sommet de la Communauté politique européenne se tiendra le 5 octobre en Espagne. Il devrait nous permettre de nous concentrer davantage sur des projets concrets de coopération, notamment en matière d’interconnexions.
Enfin, sur les sujets transfrontaliers avec l’Italie, la réunion qui s’est tenue aujourd’hui entre le Président de la République et la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni va nous permettre d’accélérer sur la mise en œuvre du traité du Quirinal, qui inclut un volet en la matière.
Madame Mélot, les stocks de gaz pour cet hiver sont élevés et la plateforme d’achat conjoint est opérationnelle.
En ce qui concerne la réforme du marché de l’électricité, madame la sénatrice de Cidrac, messieurs les sénateurs Laurent et Arnaud, notre ambition est très claire : que les travaux soient finalisés avant la fin de l’année et le plus vite possible. C’est indispensable pour protéger les consommateurs, pour lutter contre la volatilité des prix et pour encourager les investissements dans les énergies décarbonées. Nous travaillons en ce sens.
Sur les sujets numériques, mesdames les sénatrices Mélot et Morin-Desailly, je centrerai mon propos sur l’intelligence artificielle. Comme vous le savez, un texte visant à encadrer l’intelligence artificielle à l’échelle européenne est en cours de discussion au Parlement européen. Pour notre part, nous nous concentrons sur les répercussions sociétales et sociales de l’IA, au travers d’un cadre de régulation qui promouvra le modèle et les valeurs européens dans le domaine du numérique, auprès de nos partenaires et de manière multilatérale, avec le même succès, je l’espère, que pour le règlement général sur la protection des données (RGPD).
Pour conclure, je remercie chaleureusement le sénateur Gattolin de son engagement, son action et son éloquence. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie de vos questions, de votre participation à ce débat et je me réjouis par avance d’avoir l’occasion de revenir devant votre commission à l’issue du Conseil européen.

Pour conclure le débat, la parole est à M. le président de la commission des affaires européennes.

Comme à mon habitude, je conclurai ce débat brièvement. Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, d’avoir répondu de manière synthétique à toutes les questions.
Vous avez pu constater que cette soirée a été riche en questions, quitte à déborder de l’ordre du jour du Conseil européen. Cela traduit l’engagement fort qui prévaut au sein de la commission des affaires européennes.
Au-delà de la guerre en Ukraine, l’asile et l’immigration constituent un sujet prégnant. Nous l’abordons, comme l’ont fait André Reichardt et Alain Cadec, dans un esprit combatif, pour que les problèmes soient résolus au plus vite. Il s’agira de l’un des principaux enjeux des prochaines élections européennes, qui seront l’occasion d’une opposition entre les différentes visions sur le sujet.
Sur l’accord avec le Mercosur, vous nous avez répondu, mais attendez-vous à ce que d’autres questions vous soient posées sur le sujet, car nous avons tout de même entendu des tergiversations, voire une forme de complicité avec la position de la Commission européenne. Il serait de bon aloi que le discours du Gouvernement soit plus précisément clarifié, car la séquence à l’Assemblée nationale sur la proposition de résolution relative à l’accord commercial entre l’Union européenne et le Mercosur ne nous a pas semblé satisfaisante.
Madame la secrétaire d’État, je vous souhaite un bon Conseil européen. Nous attendons votre retour en commission avec impatience.
Enfin, je remercie André Gattolin et Pierre Laurent, dont c’était peut-être la dernière intervention en séance, de leur participation.
Applaudissements.

Nous en avons terminé avec le débat préalable à la réunion du Conseil européen des 29 et 30 juin 2023.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée demain, mercredi 21 juin 2023 :
À quinze heures :
Questions d’actualité au Gouvernement.
À seize heures trente et le soir :
Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à lutter contre le dumping social sur le transmanche (texte de la commission n° 735, 2022-2023) ;
Suite du projet de loi relatif à l’industrie verte (procédure accélérée ; texte de la commission n° 737, 2022-2023).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures cinquante-cinq.