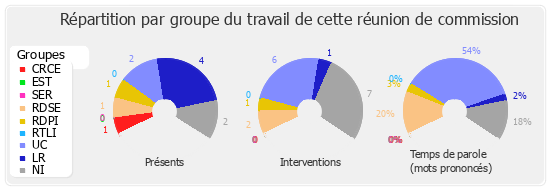Commission des affaires sociales
Réunion du 23 juin 2010 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion
Au cours d'une première réunion tenue dans la matinée, la commission examine les amendements sur la proposition de loi n° 191 (2009-2010), présentée par M. Paul Blanc, tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap dans le texte n° 531 (2009-2010) de la commission adopté le 9 juin 2010.
Elle adopte d'abord trois nouveaux amendements présentés par son rapporteur :
à l'article 4 (accès des personnels des MDPH aux formations dispensées par le centre national de la fonction publique territoriale), un amendement actualisant une référence ;
à l'article 11 bis (élargissement des compétences du fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique), un amendement précisant une référence ;
à l'article 14 bis (élargissement des compétences du fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique), un amendement de précision rédactionnelle.
Elle examine ensuite les amendements déposés sur le texte, auxquels sont donnés les avis suivants :

L'assemblée des départements de France s'est majoritairement ralliée au maintien du groupement d'intérêt public (Gip). Mais certains de nos collègues souhaitent encore que les MDPH soient intégrées dans les services du conseil général.

Ces deux amendements identiques remplacent, au sein de la commission exécutive des MDPH, les représentants de l'Etat désignés par le préfet par des représentants désignés par le directeur de l'agence régionale de santé (ARS).
Actuellement, l'Etat est représenté à cette commission exécutive par au moins trois personnes : deux sont désignées par le préfet, l'une venant de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (Ddass), l'autre de l'ancienne direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) ; la troisième l'est par le recteur d'académie.
La présence d'un représentant de l'ARS n'exclut pas que d'autres soient désignés par le préfet. Il serait en particulier utile que la nouvelle direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) et que la nouvelle direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) soient représentées pour traiter des questions concernant l'emploi et veiller au respect des conditions d'attribution des diverses allocations (AAH, PCH, etc.).
La loi prévoit que la moitié des membres de la commission exécutive représente le conseil général et qu'un quart soit réservé aux associations. L'ajout d'un représentant des ARS sur le quart restant ne remet donc pas en cause cet équilibre.

La création des ARS ajoute de la complexité dans l'organisation du système médico-social. Les agences ont la compétence médico-sociale, ce qui justifie leur représentation dans la commission exécutive des MDPH. Mais la présence de l'Etat se justifie aussi, semble-t-il, du fait du maintien des personnels qu'il met à disposition des MDPH.

Les ARS ne couvrant pas l'ensemble du champ de compétences des MDPH, il convient de maintenir parallèlement la présence des représentants de la DDCS et de la Direccte nommés par le préfet.
Cet amendement prévoit la remise d'un rapport par le Gouvernement au Parlement, au plus tard le 30 novembre 2010, évaluant les dettes de l'Etat à l'égard des MDPH, au titre de la compensation financière des postes non mis à disposition, en associant l'Assemblée des départements de France (ADF) et l'association des directeurs des MDPH.
Il est nécessaire de faire le point sur les dettes de l'Etat vis-à-vis des MDPH. Je suis donc plutôt favorable au principe d'un rapport. Mais dans sa rédaction actuelle, cet amendement pose trois difficultés :
- son positionnement serait préférable après l'article 5, qui traite des questions de financements en prévoyant une convention triennale d'objectifs et de moyens ;
- la date du 30 novembre 2010 me semble trop proche dès lors que l'adoption de la proposition de loi pourrait n'avoir lieu qu'à la fin de l'année ;
- il conviendrait de supprimer l'injonction faite au Gouvernement d'associer l'ADF et l'association des directeurs de MDPH.
Sous réserve de ces modifications, je propose de donner un avis favorable à cet amendement.

Il est en effet préférable de prévoir la date de publication d'un rapport en fonction de la promulgation de la loi. Selon toute vraisemblance, l'examen de ce texte ne pourra s'achever demain dans le temps imparti et sera reporté à l'automne. Au vu du nombre d'amendements à examiner - près de soixante-dix - il aurait fallu au moins sept heures de discussion alors que nous ne disposerons au mieux que de deux heures, le groupe UMP ayant choisi d'inscrire deux propositions de loi sur le même créneau. Dans un souci de respect de l'équilibre des temps accordés à chaque groupe pour l'examen des textes issus d'initiatives parlementaires, la Conférence des présidents n'a pas répondu favorablement à la demande du groupe UMP, que j'avais soutenue, de prolonger les débats en séance de nuit.

Je comprends mal les raisons qui ont conduit la Conférence des présidents à rejeter notre demande alors que ce texte vise à apaiser les inquiétudes des associations représentatives des personnes handicapées, à améliorer le fonctionnement des MDPH et à donner aux conseils généraux les garanties financières qu'ils sont en droit d'attendre.

Je déplore les conditions dans lesquelles nous devrons examiner ce texte qui porte pourtant sur le sujet sensible du handicap. Plutôt que d'interrompre nos débats durant la période de vacances, il semblerait préférable de reporter l'examen de l'ensemble du texte à la rentrée.

Je partage cet avis. Cette façon de procéder est irrespectueuse pour les personnes handicapées et pour le rapporteur qui a beaucoup travaillé sur ce texte. Il ne me parait pas opportun de séparer la discussion générale de l'examen des articles. Le report de l'ensemble de la discussion à la rentrée me semble préférable, d'autant plus que nombreux sont celles et ceux qui, parmi nous, vont rencontrer des difficultés de transport du fait des grèves annoncées demain.

Je rejoins mes collègues sur la nécessité de ne pas segmenter la discussion sur ce texte sensible. Pour ma part, je ne pourrai être présente demain matin, étant retenue par une réunion du Comité national d'éthique. J'aimerais plus de considération, à l'avenir, pour la commission des affaires sociales et les questions dont elle débat.

Je suis disposé à demander le retrait du texte de l'ordre du jour, à condition qu'un autre créneau nous soit accordé. Je crains que cela ne puisse être, au plus tôt, qu'au mois d'octobre.

Le report de la discussion générale ne constitue pas une solution car il est évident qu'un texte de cette ampleur ne peut être examiné sur le seul créneau d'une demi-journée, soit quatre heures de séance. Il me semble qu'il vaut mieux en commencer la lecture et prévoir ensuite de réserver une journée dans l'ordre du jour pour l'achever. D'ailleurs, le Gouvernement pourrait tout à fait prévoir de l'inscrire en priorité sur les semaines qui lui sont réservées.

Une solution pourrait aussi être trouvée grâce à un accord entre les groupes : si le groupe socialiste accordait au groupe UMP la demi-journée qui lui est réservée, on disposerait ainsi d'une journée complète de séance, à charge de réciproque le mois suivant par exemple.

J'approuve l'idée d'un report de ce texte pour pouvoir en débattre sur une journée, sans interruption. Dans ce cas, est-il utile de procéder dès aujourd'hui à l'examen des amendements ?

Nous pouvons les examiner dès maintenant puisque le délai-limite de leur dépôt est expiré.

Nous ne souhaitons pas que l'examen de ce texte soit morcelé mais rien ne fait obstacle, en effet, à ce que nous poursuivions l'examen des amendements.

Afin de raccourcir la durée des travaux en séance publique, et espérer ainsi achever l'examen du texte dans les délais impartis, ne peut-on imaginer que les amendements qui recevront un avis défavorable de la commission soient retirés avant la séance publique ?

Cette solution n'est évidemment pas acceptable sur le plan des principes démocratiques et du respect des droits de l'opposition.

Je me rangerai à la décision de la commission : si nous décidons de reporter le débat, je demanderai à mon groupe de réclamer son retrait de l'ordre du jour de demain matin.

Avant de renoncer à l'inscription de ce texte à notre ordre du jour de demain, il me semble plus prudent de s'assurer de son report. Je me range, de ce point de vue, à l'avis éclairé de Nicolas About.

Je crois en effet qu'il convient de commencer l'examen de ce texte dès demain matin comme prévu, quitte à poursuivre ultérieurement nos débats. Il sera ainsi dans le circuit parlementaire, ce qui est plus prudent compte tenu de la surcharge de l'ordre du jour.

Dans ce cas, il serait opportun de limiter autant que possible la durée de la discussion générale.

Il paraît difficile de restreindre les durées d'intervention de nos collègues.

Je crois en effet que cela n'est pas souhaitable. Cela n'irait pas dans le sens de l'amélioration de la qualité de nos travaux.

On peut néanmoins envisager de regrouper les interventions au sein de notre groupe.

Les auteurs de l'amendement craignent que le manque à gagner pour l'Etat soit très élevé, les autres Gip risquant de réclamer eux-aussi cette exonération. Cela pourrait représenter une somme de 300 millions d'euros.

L'exonération ne concerne que les MDPH et le manque à gagner pour l'Etat est minime, de l'ordre de 1,2 million d'euros. Les autres Gip n'acquittent généralement pas la taxe sur les salaires car ils ne sont pas employeurs et ne fonctionnent qu'avec des personnels mis à disposition par l'Etat ou des collectivités publiques, qui ne sont eux-mêmes pas assujetties au paiement de la taxe. D'ailleurs, deux tiers des MDPH ne la payent pas : c'est le cas lorsqu'elles ont délégué la gestion de leurs personnels aux conseils généraux. Il est fort probable que les auteurs de l'amendement proviennent de départements qui se trouvent précisément dans ce cas de figure. Il convient de corriger cette anomalie qui est à l'origine d'inégalités entre les départements : tels sont l'objet de l'article 3 et la raison de mon opposition à cet amendement qui le supprime.

Je suis surpris de constater que la mise à disposition des personnels d'Etat subsiste dans le dispositif retenu par notre commission. La proposition de loi initiale prévoyait la suppression de ce statut et son remplacement par une formule plus avantageuse de détachement, avec à terme la possibilité d'intégrer la fonction publique territoriale.

C'est exact mais le détachement présentant le risque d'un retour massif des agents de l'Etat dans leur administration d'origine, il nous a paru plus sage d'opter pour un aménagement du régime de la mise à disposition qui offre les mêmes garanties que le détachement, en particulier sur le plan financier pour les conseils généraux.

Je crains que l'obligation fixée par cet article pour les MDPH d'ouvrir leur permanence téléphonique et leurs services pendant une durée hebdomadaire minimale de trente-cinq heures ne soit trop contraignante. Ne serait-il pas préférable de prévoir que cette obligation s'applique alternativement à l'accueil physique ou téléphonique ?

La qualité de l'accueil ne dépend pas seulement de la durée d'ouverture des services mais surtout de la formation des personnels. Celle-ci mériterait d'être améliorée.

Les réponses apportées par téléphone ne remplacent pas le contact et les échanges directs avec la personne handicapée ou sa famille. Il est également important que les MDPH soient ouvertes pour que les personnes puissent récupérer les documents nécessaires à la formulation de leurs demandes.

Dans le cadre de cette délégation de compétence, quel département prendra la décision relative à l'attribution de la prestation et à la fixation de son montant, le délégant ou le délégataire ? La convention prévoit-elle de déléguer l'intégralité de la procédure ? Et auprès de qui la personne handicapée devra-t-elle faire appel de la décision si elle souhaite la contester ?

Lors de la convention, il faut préciser que l'appel relève du conseil général qui a fait l'étude préalable.

Il serait préférable que l'appel de la décision puisse se faire auprès du conseil général du domicile de secours et non auprès de la MDPH qui a instruit la demande et fixé le montant de la prestation. Celle-ci ne peut pas être à la fois juge et partie.

Le dispositif prévoit la signature d'une convention qui doit préciser les modalités concrètes de cette délégation. Cette dernière ne porte que sur l'évaluation des besoins et la décision demeure du ressort du département qui délègue l'évaluation. Il n'est pas nécessaire de tout préciser dans la loi. Les conseils généraux qui ont été consultés sur ce point préfèrent conserver une certaine souplesse. La convention prévoira par exemple si la délégation de l'évaluation doit donner lieu à une compensation financière ou s'il s'agit d'une délégation réciproque.

Cet amendement prévoit de mieux encadrer les conditions dans lesquelles des mesures de substitution sont prises en cas d'impossibilité technique de remplir les exigences d'accessibilité pour les constructions neuves. Je précise qu'il s'agit bien de mesures de substitution et non de dérogations, la différence est de taille. J'ai également souhaité indiquer que l'impossibilité ne peut être que technique et non financière et que l'avis rendu par la commission consultative départementale d'accessibilité pour éclairer la décision du préfet doit être conforme. Malgré les pressions fortes des représentants des logements sociaux notamment, je défendrai cet amendement jusqu'au bout.

Il faudra toutefois veiller à ne pas durcir les exigences de mise en accessibilité de façon démesurée, l'excès de normes pouvant se révéler contre-productif et décourager les meilleures volontés. Il faut se garder de devenir des « ayatollahs de l'accessibilité ».

Je crois toutefois que, pour les constructions neuves, l'assouplissement des exigences doit être strictement encadré. Il convient aussi de faire observer que les surcoûts de 12 % mentionnés par l'union sociale de l'habitat ne sont pas uniquement le fait des normes d'accessibilité, mais résultent également de celles relatives à la sécurité et à l'environnement.

L'objectif de la loi de 2005 n'est pas de mettre en accessibilité totale les bâtiments, mais d'assurer l'accessibilité du service. Ainsi, une mairie qui a prévu une salle d'accueil accessible, au rez-de-chaussée, peut se dispenser de prévoir un ascenseur pour accéder aux bureaux installés à l'étage dès lors que tous les services sont disponibles à ce guichet accessible. Ce serait faire une interprétation extensive de la loi que de conclure qu'elle impose l'accessibilité de tous les locaux.

Je ne comprends pas bien la logique qui sous-tend cet amendement : les parties communes seraient accessibles alors que les locaux d'habitation ne le seraient pas. Si l'objectif est d'éviter une hausse des loyers, je crois qu'il convient de définir des priorités : la mise en accessibilité a un coût, ne justifie-t-elle pas que celui-ci soit intégré aux loyers ?

Cet amendement prévoit la création d'une commission communale d'accessibilité dans toutes les communes, celle-ci n'étant obligatoire que pour celles de plus de cinq mille habitants. Pour les plus petites d'entre elles, la création de commissions intercommunales ne permet malheureusement pas d'établir un diagnostic pour l'ensemble des questions relatives à l'accessibilité, en particulier lorsque la communauté de communes n'est compétente que sur les transports par exemple. Ainsi, le diagnostic sur les établissements recevant du public ou les voieries n'est pas assuré.

La loi de simplification du droit, adoptée l'été dernier, a prévu ce cas en autorisant les communes à déléguer aux intercommunalités l'établissement du diagnostic d'accessibilité dans tous les domaines, y compris ceux pour lesquels elle n'est pas compétente.
Je suis favorable à l'objectif de cet amendement de réactiver les groupes d'entraide mutuelle destinés aux personnes handicapées psychiques, mais je ne suis pas certain que cela passe par une classification contraignante dans la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux. C'est pourquoi j'émets un avis défavorable mais il conviendrait d'étudier plus avant les moyens à mettre en oeuvre pour faire vivre ces groupes dont l'utilité est reconnue.

Les moyens qui leur sont alloués sont en diminution continue. J'approuve l'idée du rapporteur de rechercher une solution adaptée pour les réactiver.

L'option d'une intégration des AVS dans la fonction publique, très coûteuse, a été écartée au profit de la mise en place d'un système conventionnel associant les services d'aide à la personne et les associations de parents d'élèves handicapés. L'objectif est de permettre aux AVS d'exercer leur activité à l'école mais aussi hors temps scolaire, pour offrir une continuité dans l'accompagnement aux enfants pour lesquels il se justifie.

Je vous indique que nous avons prévu d'entendre Luc Chatel, ministre de l'éducation nationale, sur ce sujet, mardi 29 juin, à 16 heures 15.

Nous ne pouvons plus tolérer que des enfants ne soient pas scolarisés faute d'accompagnement. De même, il est regrettable que des AVS arrivant en fin de contrat ne puissent valoriser leurs compétences et l'expérience acquise en poursuivant leur activité au service des élèves handicapés. Par ailleurs, il arrive que le contrat d'un AVS arrive à échéance en cours d'année, et celui-ci ne pouvant être renouvelé, l'enfant doit interrompre sa scolarité faute d'aide, ce qui est humainement insupportable, pour lui et pour sa famille.

Nous sommes très souvent sollicités par les familles qui ne parviennent pas à trouver d'AVS pour leur enfant lequel, pour cette raison, se voit refuser l'accès à l'école ordinaire. Il y a manifestement une grave insuffisance dans ce domaine qu'il faut parvenir à combler.

J'observe de la même façon une pénurie de places pour accueillir les enfants trisomiques.

Je crois aussi que nous ne pouvons tolérer que des enfants handicapés ne puissent être scolarisés du fait de l'impossibilité de leur offrir un accompagnement. Selon les dires des directeurs d'école, il semble que les effectifs d'AVS diminuent et que la situation ne cesse de se dégrader.

Pourquoi dès lors ne pas accepter qu'un rapport dresse un bilan de la situation et donner un avis défavorable à un amendement qui recherche des solutions ?

Pourquoi ne pas prévoir en effet que les AVS seront intégrés au ministère de l'éducation nationale ? Je ne suis pas forcément favorable à la fonctionnarisation de toutes sortes de professions, mais il convient de stabiliser celle-ci.

Je suis hostile à un rapport qui se bornerait à n'étudier que la seule option de l'intégration des AVS dans la fonction publique du ministère de l'éducation nationale. Cette solution n'est pas adaptée car elle est coûteuse et ne permet pas de résoudre la question de la prise en charge hors temps scolaire. L'éducation nationale ne finance l'accompagnement que sur le temps scolaire, c'est-à-dire à peine 180 jours par an. C'est là tout l'intérêt de recourir aux associations de services d'aides à domicile.

Le rapport que notre groupe de travail sur la fin de vie a adopté la semaine dernière n'a pas la prétention de dresser un tableau exhaustif de ce sujet difficile, ni d'en tirer des conclusions définitives. Il a plus simplement pour ambition d'en faire une analyse et il comporte deux propositions qui me paraissent pragmatiques.
L'analyse découle de la vingtaine d'auditions que nous avons conduites dans le souci d'entendre l'expression de toutes les familles de pensée, sans exclusive.
Deux points me semblent essentiels. Tout d'abord, et je pense relayer notre sentiment unanime, nous souhaitons rompre avec une vision purement technicienne de la fin de la vie qui peut aboutir à l'acharnement thérapeutique. Les droits reconnus au patient, sa volonté d'autonomie par rapport à la décision médicale, le fait qu'il puisse décider lui-même de la poursuite ou de l'arrêt des traitements, font l'objet d'un consensus social. La loi Leonetti du 22 avril 2005, venant elle-même à la suite de la loi Kouchner, s'inscrit dans cette logique. Ainsi, la mort n'est plus nécessairement masquée, niée, par la médecine, même si, comme l'a indiqué François Autain, elle l'est encore parfois. Ceux qui le souhaitent peuvent choisir d'y faire face en pleine conscience.
Notre consensus va encore plus loin sur la manière d'aborder la fin de vie. En effet, tant les partisans des soins palliatifs que ceux de l'euthanasie cherchent d'abord à lutter contre la douleur. Plus personne aujourd'hui n'entend lui attribuer une valeur morale ou spirituelle qui ferait obstacle à sa prise en charge ou empêcherait de chercher à la soulager. Que ce soit en diffusant les pratiques palliatives ou en choisissant une « mort douce » provoquée, nous nous préoccupons tous de trouver le meilleur moyen pour que la fin de vie soit, au moins physiquement, apaisée.
La différence entre les conceptions possibles réside ailleurs, dans l'attitude face à la mort elle-même. Pour certains, il faut l'accepter et attendre l'échéance en vivant pleinement tous les instants qui nous en séparent. Pour d'autres, il faut pouvoir maîtriser la mort, non pas prétendre la surmonter, mais pouvoir la choisir et par là conserver jusqu'à la fin la conduite de son existence et l'évolution de son corps.
Face à ces deux attitudes, que permet l'état du droit ? D'abord, si le suicide n'est plus pénalement réprimé en France depuis le code pénal de 1810, le cas du suicide assisté est plus complexe : on ne peut réprimer une action destinée à accomplir un acte qui n'est pas lui-même répréhensible mais le risque d'incrimination sur la base de l'assassinat, de l'empoisonnement ou même de la non-assistance à personne en danger est réel.
La question centrale, comme l'a souligné Gilbert Barbier, est celle du rôle du médecin. La loi Leonetti admet, on le sait, le « double effet » des soins palliatifs : un soin destiné à apaiser la douleur peut avoir aussi pour effet de réduire l'espérance de vie. Ce soin pourra être prodigué si le patient ou son entourage sont informés de ses conséquences potentielles. C'est donc l'intention du médecin qui marque la frontière entre un acte destiné à soulager la douleur, et celui qui abrège la vie.
Plusieurs des personnes auditionnées nous ont affirmé que cette distinction est confuse, voire hypocrite, et qu'elle ne permet pas une bonne application de la loi. Pourtant, la détermination de la valeur d'un acte en fonction de l'intention qui le sous-tend est l'un des fondements de notre droit pénal. Ceux qui sont partisans de l'euthanasie devraient donc compléter la loi Leonetti plutôt que la changer, car elle est cohérente du point de vue des soins palliatifs. Par ailleurs, même si l'euthanasie venait à être autorisée, il est évident, comme le montre l'exemple belge, que les soins palliatifs continueraient à jouer un rôle prédominant dans la fin de vie.
Incontestablement, la loi Leonetti a apporté une solution acceptable pour de nombreux cas en affirmant le droit des malades de refuser le traitement et en demandant la mise en place de soins palliatifs une fois que les soins curatifs ne sont plus envisageables. Bien sûr, il faut que cette loi soit mieux connue et que des moyens supplémentaires soient alloués aux soins palliatifs. Ceux-ci ne doivent d'ailleurs plus être cantonnés aux unités spécialisées mais être intégrés aux pratiques de l'ensemble des services hospitaliers confrontés à la fin de vie et étendus, autant qu'il est possible, aux soins dispensés à domicile.
J'estime cependant, à titre personnel et cette considération ne figure pas en tant que telle dans le rapport, que la loi Leonetti ne règle pas un cas particulier : celui des personnes qui ne sont pas nécessairement en fin de vie mais qui se trouvent dans l'incapacité physique de mettre elles-mêmes fin à leurs jours, si tel devait être leur souhait face aux difficultés insurmontables de leur existence quotidienne. A la suite de la question que m'avait posée Marie-Thérèse Hermange, je précise que j'exclus de cette interrogation les personnes atteintes de troubles mentaux ou d'un handicap mental dont le consentement me semble ne pouvoir être valablement recueilli.
Je suis parfaitement conscient du message que sont venues nous porter plusieurs des personnes auditionnés sur le risque que certaines de ces personnes puissent voir, dans un débat sur l'euthanasie qui leur serait particulièrement consacré, une remise en cause du combat qu'elles mènent à chaque instant pour vivre. Mais mon optique est précisément inverse. Offrir à ceux qui se sont tant battus la possibilité de s'arrêter, quand ils l'auront voulu, sans être une fois encore dominés par le corps contre lequel ils ont dû combattre, c'est leur donner une perspective apaisante. Je ne plaide évidemment pas pour qu'ils aient recours à l'euthanasie mais je conçois que si la possibilité leur en était offerte, cela en aiderait certains à mieux vivre sans jamais, peut-être, y avoir recours.
Concernant l'évolution éventuelle de notre droit, notre rapport ne peut qu'exposer les différents arguments pour et contre une légalisation de l'euthanasie. Bien évidemment, il ne tranche pas en faveur de l'une ou l'autre de ces thèses. Il appartiendra à chacun de prendre, le moment venu, ses responsabilités en fonction de ses convictions les plus profondes. Nous en aurons probablement l'occasion lors de l'examen de la proposition de loi, dont nos collègues François Autain et Guy Fischer ont annoncé le dépôt et dont il nous a été dit que l'inscription à l'ordre du jour serait demandée.
Le groupe de travail a adopté, tout en notant les réserves de Gilbert Barbier, deux propositions :
- la première concerne les procès pour euthanasie. L'audition du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, Bertrand Louvel, a été, sur ce point, particulièrement éclairante. Les juges ont eu à connaître d'une vingtaine de cas d'euthanasie sur les dix dernières années, ce qui est faible. Seule la moitié d'entre eux a abouti devant les tribunaux. Mais ces cas, particulièrement douloureux, ont-ils réellement leur place en cour d'assises ? Je ne le crois pas et nous devons empêcher que d'autres familles n'aient à supporter un tel drame judiciaire, qui s'ajoute au drame humain qu'elles ont déjà vécu. Le groupe de travail demande donc que le Garde des Sceaux adresse aux parquets une instruction tendant, après qu'ils se seront assurés que l'euthanasie était uniquement motivée par la volonté de mourir de la personne, au classement sans suite de ces affaires. Comme le suggérait le président Louvel, la base juridique de ce classement pourrait être celle de l'article 122-2 du code pénal.
Cet article, qui prévoit les cas d'irresponsabilité pénale, a déjà été appliqué par un juge d'instruction au cas d'une mère ayant fait l'injection d'un produit létal à son fils devenu tétraplégique et qui lui demandait de mourir. Le juge a estimé que la volonté du fils s'était substituée à celle de la mère et que cette dernière n'était donc pas responsable de ces actes. Cette interprétation et l'instruction qui, sur cette base, pourrait être donnée aux parquets, me paraissent d'autant plus intéressantes qu'elles sont susceptibles de répondre à la situation des personnes qui, sans être nécessairement en fin de vie, désirent mettre fin au combat quotidien qu'elles mènent pour survivre mais qui ne peuvent techniquement se donner la mort, comme je l'exposais précédemment ;
- la deuxième proposition répond au besoin de connaissances sur les pratiques liées à la fin de vie en France, et précisément sur les euthanasies, dont on sait qu'elles sont, dans les faits, pratiquées en dehors du cadre de la loi. Il existe plusieurs rapports sur la mort à l'hôpital et l'on dispose d'études partielles qui montrent que des décisions d'euthanasie sont prises dans des services médicaux. Mais aucune étude systématique n'a été menée à ce jour sur ce sujet sensible.
L'observatoire de la fin de vie, créé le 10 février dernier à la suite du rapport Leonetti et que préside Régis Aubry, ancien président du comité de suivi du développement des soins palliatifs, pourrait valablement conduire cette étude.
J'insiste, toutefois, sur le fait qu'il est essentiel qu'elle repose sur des méthodes internationalement reconnues et qui permettent la comparaison entre la situation de la France et celle d'autres pays concernant la fin de vie et l'euthanasie.
Le professeur Luc Deliens, de l'université libre flamande de Bruxelles, que nous avons entendu, est un spécialiste reconnu en ce domaine et son approche pragmatique a grandement servi à la réflexion engagée par le législateur belge. Le groupe de travail pourrait donc demander qu'une étude sur les circonstances de la fin de vie en France soit menée selon les principes que ce professeur a élaborés. Il peut sembler paradoxal, voire impossible, de mener une étude et de publier un rapport sur des pratiques illégales, mais le professeur Deliens a déjà conduit un travail de ce type pour d'autre pays, en entourant ses recherches d'un certain nombre de garanties pour les professionnels de santé qui décrivent leurs pratiques, notamment en matière d'anonymat et d'absence de poursuites.
Si l'observatoire de la fin de vie était dans l'incapacité de répondre à cette demande, ne pourrait-on imaginer que la commission des affaires sociales, qui dispose de crédits d'études, demande au professeur Deliens de la conduire pour elle, ce qu'il serait disposé à faire ?
Telles sont les conclusions du groupe de travail. Si vous autorisez la publication de ce rapport d'information, les contributions personnelles des membres du groupe qui souhaiteront préciser leur point de vue, y figureront en annexe.

Je félicite Nicolas About d'avoir mené à son terme les travaux du groupe de travail sur la fin de vie. Son rapport, qui porte sur un sujet délicat, tente de parvenir à un consensus, difficile à trouver du fait des approches fondamentalement différentes des uns et des autres.
Je rappelle ensuite qu'il est important de bien faire la distinction, comme le propose Marie de Hennezel, entre : la limitation ou l'arrêt des thérapeutiques actives ; le soulagement de la douleur et de l'angoisse ; l'acte de donner intentionnellement la mort, c'est-à-dire l'euthanasie au sens propre.
C'est sur ce dernier point que les opinions sont les plus partagées.
L'une des propositions du président About consiste à confier à l'observatoire de la fin de vie une étude sur les pratiques liées à la fin de vie dans notre pays. Ce travail, bien qu'intéressant en soi, risque d'être difficile à mener, dans la mesure où ces pratiques se rencontrent aussi bien dans les services d'urgence, de réanimation, de gériatrie que dans les blocs opératoires ou les services à domicile. En outre, je m'interroge sur la finalité de cette enquête. Servira-t-elle à cautionner l'idée selon laquelle l'existence d'actes illégaux prouve qu'il est désormais temps de les légaliser ? Ou permettra-t-elle de lutter contre ces pratiques clandestines en les sanctionnant ?
Sur la proposition relative aux procès pour euthanasie, je m'oppose - comme je l'ai dit devant le groupe de travail -, à ce que l'on confie au seul juge l'appréciation de l'acte d'euthanasie. Lui laisser la décision de classer l'affaire sous prétexte d'« une euthanasie fondée sur un sentiment d'humanité » me paraît être la porte ouverte à toutes les interprétations. Je note toutefois que cette expression, qui figurait dans l'intervention du président Nicolas About de la semaine dernière devant le groupe de travail, n'a pas été reprise dans celle qu'il vient de prononcer.
En tout état de cause, il ne revient pas au juge de dire si l'acte de donner intentionnellement la mort relève de la cour d'assises ou pas. C'est au législateur de prendre ses responsabilités et de décider de légaliser ou non cette pratique.
En définitive, laissons les médecins et les soignants face à leur conscience, sachant que c'est toujours « l'intention qui préside à l'acte ».

Je trouve particulièrement intéressant de débattre de ce sujet juste après les échanges que nous avons eus sur le handicap et je remercie le président Nicolas About pour le travail qu'il a accompli.
La question sous-jacente au rapport du groupe de travail sur la fin de vie est celle de l'aide à la mort volontaire. En effet, c'est bien de la volonté d'une personne de mettre fin à ses jours dont il s'agit, et non pas de la mort « bonne » ou « douce » en soi, comme le laisse supposer le terme d'euthanasie. La mort volontaire n'est pas non plus la mort digne. Cette assimilation, comme l'a souligné le professeur Axel Kahn lors de son audition, reviendrait à considérer qu'il existe des formes de vie indignes. Or, tant la Déclaration universelle des droits de l'homme que la Convention européenne des droits de l'homme récusent cette idée.
Ce n'est donc pas d'un débat sur l'organisation de la mort volontaire dont notre société a besoin mais d'une réflexion sur les moyens permettant de mieux accueillir les plus faibles d'entre nous. Lancer une discussion sur l'euthanasie, avant d'avoir répondu aux besoins de prise en charge des personnes fragiles, c'est risquer de leur signifier qu'elles sont de trop.
A supposer que l'on accepte l'idée que l'Etat organise une aide à la mort volontaire, deux questions ne peuvent être éludées : qui sera chargé de donner la mort et qui pourra la demander ?
A la première question, les partisans de l'aide à la mort répondent que la France pourrait prendre exemple sur les législations belge et hollandaise, qui imposent que l'injection létale soit faite par un médecin. Comme le montre le débat actuel en Suisse, l'aide au suicide par des volontaires non médecins pose en effet de nombreuses difficultés d'ordre éthique. Cependant, demander à des médecins de donner la mort est lourd de conséquence pour la médecine elle-même. Cela consacrerait un changement dans la conception que notre société se fait de la mission de la médecine qui, tournée jusqu'à présent vers la vie, serait dès lors contrainte d'envisager les moyens d'y mettre fin.
Pour ce qui est de la seconde question, aucune loi sur l'aide à la mort volontaire ne pourra jamais prétendre répondre à l'intégralité des demandes individuelles. Ainsi, à la question prétendument délimitée des personnes en fin de vie s'ajoute aussitôt celle des personnes handicapées, sans que soit clairement déterminé de quel type de handicap il est question. Il est clair que les demandes, tendant à inclure de nouveaux cas où l'aide à la mort sera possible, ne seront pas satisfaites par une loi consacrée aux personnes en fin de vie.
S'agissant des recommandations du groupe de travail, deux remarques s'imposent :
- l'étude relative aux pratiques liées à la fin de vie en France permettra non seulement de mesurer l'ampleur du phénomène mais aussi de lutter contre les pratiques illégales ;
- la proposition consistant à confier l'appréciation de la volonté de mourir de la personne au juge est difficilement acceptable, sauf à être reconnue comme une démission du législateur.

Je félicite à mon tour le président About pour ce rapport qui a le mérite de poser une question de fond : la loi Leonetti du 22 avril 2005 est-elle suffisante ? A mon sens, elle ne l'est pas.
Il me semble particulièrement dangereux de vouloir opposer développement des soins palliatifs et possibilité de donner la mort. Il s'agit là de deux pratiques non antinomiques mais bien complémentaires. C'est à l'individu en fin de vie, et à lui seul, de décider de continuer ou non à vivre dans des conditions éprouvantes. Il doit être libre d'organiser son départ comme il l'entend. Aujourd'hui, cette possibilité n'existant pas, certaines personnes en sont réduites au suicide, autrement dit à une mort violente et solitaire. Sans compter que leurs proches sont susceptibles d'être accusés de non-assistance à personne en danger.
Comme j'ai pu personnellement le constater, la loi Leonetti organise une euthanasie à petit feu. Il est temps, désormais, de laisser à chaque individu le libre choix de s'exprimer.
J'apprécie que le président About ait posé le problème des personnes qui, sans être en fin de vie, ne peuvent physiquement pas se donner la mort. Pourquoi ces dernières, à qui la société apporte une aide dans les tâches de la vie quotidienne, ne pourraient-elles pas également bénéficier d'une assistance lorsqu'elles ont décidé de mourir ?
En ce qui concerne les propositions du groupe de travail, la seconde me paraît être une très bonne idée car elle permettra de sortir de l'hypocrisie actuelle et de mettre à plat un certain nombre de choses. La première est, certes, une piste intéressante, mais je crains que l'instruction adressée aux parquets puisse être contestée à tout moment. Par ailleurs, je suis d'accord avec Gilbert Barbier et Marie-Thérèse Hermange lorsqu'ils affirment que l'appréciation de l'acte d'euthanasie est de la responsabilité du législateur.
La France pourrait utilement s'inspirer des législations hollandaise et belge qui autorisent les médecins à donner la mort. Ainsi que l'a montré le professeur Luc Deliens lors de son audition, le simple fait que les individus en fin de vie aient la possibilité de demander la mort peut les inciter à vouloir poursuivre leur existence.

Ce rapport m'interpelle car j'estime que la loi Leonetti est suffisante. En tant que médecin, j'ai été confronté à ces questions et, en tant que législateur, je ne conçois pas voter un texte qui reviendrait à demander aux médecins de renier le serment d'Hippocrate. Je m'oppose donc à toute loi qui consisterait à légaliser l'euthanasie. Par ailleurs, la proposition du rapport sur l'instruction adressée par le Garde des Sceaux aux parquets ne me semble pas reposer sur un fondement juridique rigoureux.

Je partage pleinement la position de Jean-Pierre Godefroy et tiens à saluer l'esprit d'ouverture ayant présidé à la préparation de ce rapport qui s'attache à respecter tous les points de vue.
Le groupe CRC-SPG déposera prochainement une proposition de loi sur l'aide active à mourir et demandera son inscription à l'ordre du jour, à l'occasion d'une niche accordée au groupe au mois de novembre.
Je ne suis évidemment pas de l'avis de ceux qui combattent l'euthanasie, mais je comprends parfaitement que l'on puisse y être opposé. En revanche, j'estime que ces personnes doivent, inversement, respecter la position de ceux qui plaident pour l'euthanasie.
Dans un pays comme la France, la loi doit donner la possibilité à ceux qui demandent de mourir d'être aidés dans leur geste. Actuellement, et j'y ai été confronté autrefois en tant que médecin, beaucoup d'euthanasies sont pratiquées par sédation par des membres du corps médical. L'acte consistant à aider un patient en fin de vie à mourir n'est pas contraire au serment d'Hippocrate : au contraire, il s'inscrit dans la continuité des soins prodigués par le médecin.
Comme l'a expliqué le professeur Luc Deliens, l'autorisation de recourir à l'euthanasie n'enraye pas le développement des soins palliatifs ; elle a plutôt tendance à l'encourager. Dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie, le recours à cette pratique demeure d'ailleurs marginal.
La première proposition du rapport ne peut être qu'une mesure transitoire : la seule vraie réforme consiste à modifier la loi pour autoriser l'euthanasie. A ce sujet, je rappelle que ce n'est pas la loi Leonetti qui donne le droit aux malades de décider eux-mêmes de la poursuite ou de l'arrêt des traitements, mais la loi Kouchner de 2002. Celle-ci a constitué un premier pas en consacrant une forme d'euthanasie passive.
La seconde proposition me semble très pertinente et, en définitive, je voterai pour la publication de ce rapport.

Je ne partage pas le point de vue exprimé par Jean-Pierre Godefroy sur l'euthanasie et je m'oppose à sa légalisation. Il peut en effet arriver que des personnes en fin de vie demandent à mourir, en raison de l'état de grande détresse physique et/ou morale dans laquelle elles se trouvent, mais reviennent, un peu plus tard, sur leur position notamment lorsqu'on est parvenu à apaiser leurs douleurs.

Je crains que ce débat sur la fin de vie, certes nécessaire, ne soit l'occasion d'ouvrir de nouvelles brèches dans la législation. Le législateur doit-il s'approprier quelque chose, en l'occurrence le corps humain, qui ne lui appartient pas ? Il me semble que ni le législateur, ni le juge, ni le médecin, n'ont à s'emparer de cette question.
Le concept de « liberté de choix », entendu à maintes reprises, me semble particulièrement flou et évolutif.
Par ailleurs, j'insiste sur le fait que la mort n'est pas seulement l'affaire d'un individu, c'est aussi une épreuve pour l'entourage.
Il faudrait que les défenseurs de l'euthanasie nous disent qu'elles sont les valeurs qui les animent.
Enfin, pourquoi ne citer que l'école belge lorsqu'on parle d'euthanasie et ne pas s'intéresser aux travaux de l'école de Lausanne, par exemple ?

Ce rapport, très pédagogique, est en quelque sorte une grille de lecture particulièrement précieuse pour comprendre le sujet, fort complexe, de l'euthanasie.
Je considère que finalement, tout dépend des convictions de chacun : soit l'on croit que notre vie nous appartient, soit l'on croit qu'elle est entre les mains de Dieu.

Janine Rozier vient de parfaitement résumer le sujet que nous devrons approfondir à l'occasion du futur débat parlementaire sur la proposition de loi que déposera prochainement le groupe CRC-SPG. Ce n'est, en revanche, pas le thème que nous avons à traiter aujourd'hui. Le rapport du groupe de travail sur la fin de vie n'a en effet pas pour objectif de se prononcer pour ou contre l'euthanasie.
J'insiste sur le fait que seule l'intervention liminaire que j'ai prononcée devant vous tout à l'heure fait foi. Plusieurs collègues ont réutilisé des mots, que j'ai pu employer lors de la réunion du groupe de travail de la semaine dernière mais que je n'ai volontairement pas repris dans mon propos d'aujourd'hui. C'est en effet tout l'intérêt d'un groupe de travail que de faire évoluer la pensée.
J'aimerais répondre à Gilbert Barbier que toute enquête, quelle qu'elle soit, ne peut présager des conclusions qu'elle est censée apporter. On ne mène pas une étude pour accréditer une thèse en particulier mais, au contraire, pour rendre compte de manière objective d'une situation et, éventuellement, en tirer les leçons qui s'imposent.
S'il s'avère que des euthanasies sont pratiquées en dehors du cadre de la loi en France, ces pratiques doivent être sanctionnées. On ne peut accepter que des personnes en fin de vie soient tuées sous prétexte que le tiers à l'origine de l'acte soit épris d'un « sentiment d'humanité ». L'étude proposée permettra donc, dans un premier temps, de mettre au clair la situation et d'envisager des sanctions pour ceux qui ne respectent pas la loi actuelle. Elle sera, dans un second temps, l'occasion pour tout un chacun de se forger sa propre opinion sur l'euthanasie.
Sur la deuxième proposition du groupe de travail, je précise qu'il est question d'une instruction adressée par le Garde des sceaux aux parquets, ainsi que l'article 30 du code de la procédure pénale en prévoit la possibilité. Cette instruction, délivrée à titre collectif et non pas individuel, autoriserait le juge, après qu'il se sera assuré qu'il n'y a pas d'incrimination prévue par les textes dans le dossier qui lui est soumis, de classer sans suites l'affaire. La base juridique de ce classement pourrait être celle de l'article 122-2 du code pénal qui prévoit les cas d'irresponsabilité pénale. Cette procédure permettrait que les affaires les plus douloureuses ne soient pas renvoyées en cour d'assises.
Concernant le serment d'Hippocrate évoqué par plusieurs collègues, il faut rappeler que celui-ci énonce une obligation à soigner, à prendre soin et à rester humain.
Par ailleurs, je ne cèderai pas à la pression de la théorie de la « pente fatale », selon laquelle toute brèche dans la législation est la porte ouverte aux dérives en tout genre. La loi est là pour interdire certains comportements, pour poser des limites, pour fixer des bornes, qui certes peuvent bouger, mais seulement si le législateur en décide ainsi.
Je voudrais, en réponse à Marie-Thérèse Hermange, citer les propos tenus par le professeur Axel Kahn qui venaient compléter ceux qu'elle a elle-même rapportés : « Je veux rester responsable même si un jour je devais moi-même me réserver la liberté de faire éventuellement ce que me dicte ma conscience ». Cette déclaration est remarquable car son auteur, pourtant grande figure de l'éthique médicale, ne rejette pas l'idée qu'il pourrait, un jour, éventuellement, être amené à faire un acte auquel il s'oppose aujourd'hui. Il déclare simplement qu'il en assumera la responsabilité.
Je précise que je n'ai, dans mon propos introductif, volontairement pas parlé de personnes handicapées, mais de personnes qui ne sont pas obligatoirement en fin de vie et qui ne peuvent physiquement pas mettre elles-mêmes fin à leurs jours, si tel devait être leur souhait. La question est de savoir si ces personnes doivent pouvoir bénéficier d'une aide pour passer à l'acte. Il serait, en revanche, très dangereux que ce débat conduise certains à demander une loi sur l'euthanasie qui concernerait spécifiquement les personnes handicapées.
Comme l'a fait remarquer Françoise Henneron, il est indispensable que la volonté de mourir soit réitérée et non pas exprimée à la va-vite dans la clandestinité.
Enfin, je rappelle à Jean-Louis Lorrain que le débat sur l'euthanasie a été relancé non pas par ce rapport mais dès l'année dernière, à l'occasion d'une question orale avec débat posée au Sénat par le groupe socialiste. J'indique enfin que l'argument suivant lequel le législateur ne doit pas traiter du corps est déjà largement démenti par le droit : la loi a déjà abordé tous les sujets, celui des cellules, de l'embryon, du sang de cordon ombilical. Il a également affirmé, et réaffirmé, l'indisponibilité du corps humain.

Conformément à l'usage, je vais solliciter l'autorisation de la commission pour la publication du rapport du groupe de travail. Je rappelle que celui-ci sera accompagné des contributions des sénateurs de la commission qui le souhaitent, à charge pour eux de faire parvenir ces documents au secrétariat d'ici à la fin du mois.

Je ne vais pas m'opposer à la publication de ce rapport, mais je tiens à souligner que la pratique consistant à faire approuver le principe de la publication d'un rapport avec le contenu duquel on peut être en désaccord me paraît pour le moins surprenante.

A l'inverse, s'opposer à la publication d'un rapport d'information reviendrait en quelque sorte à nier la réalité du travail effectué alors qu'il est susceptible d'apporter une contribution utile à la réflexion.
La commission autorise la publication de ce rapport d'information.
La commission désigne Mme Christiane Demontès, suppléante, appelée à siéger au sein de l'Observatoire national des zones urbaines sensibles.
Présidence de Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales, et de M. Jean Arthuis, président de la commission des finances -