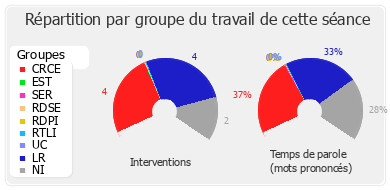Séance en hémicycle du 13 juillet 2011 à 14h45
Sommaire
- Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 (voir le dossier)
- Développement de l'alternance et sécurisation des parcours professionnels (voir le dossier)
- Décisions du conseil constitutionnel sur des questions prioritaires de constitutionnalité
- Clôture de la session extraordinaire
- Ordre du jour (voir le dossier)
La séance
La séance, suspendue à onze heures cinquante, est reprise à quatorze heures quarante.

La séance est reprise.

L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 (texte de la commission n° 742, rapport n° 741).
Dans la discussion générale, la parole est au rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire n’a eu qu’un seul article à examiner – l’article 1er du projet de loi – puisque le Sénat n’avait apporté aucune modification aux quatorze autres articles de ce collectif, qui visaient à rectifier les prévisions de recettes, les tableaux d’équilibre et les objectifs de dépenses pour 2011.
Sur ce sujet d’ailleurs, alors que nous sommes à mi-année, nous voudrions, M. Vasselle et moi-même, nous féliciter non seulement du respect des objectifs votés en loi de financement mais également de la légère amélioration de la situation des comptes sociaux. En effet, le déficit pour 2011 pourrait s’établir à 19, 5 milliards d’euros, ce qui représente une amélioration de près de 1, 4 milliard par rapport aux prévisions initiales et de 4 milliards par rapport au déficit de 2010.
Dans une conjoncture de reprise modeste, c’est incontestablement une bonne nouvelle. Cela témoigne à la fois d’une meilleure tenue des recettes et, surtout, d’une vraie maîtrise des dépenses puisque l’ONDAM, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, ne devrait pas connaître, pour la deuxième année consécutive, de dépassement en 2011, malgré un objectif prévisionnel en progression ralentie par rapport aux années précédentes.
Cela étant, le niveau de déficit auquel nous sommes parvenus reste trop important. À moyen terme, il n’est pas soutenable : les prévisions annexées au présent collectif social font état d’un déficit annuel stabilisé à un peu moins de 20 milliards d’euros à l’horizon 2014.
Il conviendra donc certainement, au-delà d’une maîtrise accrue des dépenses, de s’interroger dans les mois qui viennent sur la mobilisation de nouvelles recettes au profit de notre système de sécurité sociale. Sa pérennité, que nous souhaitons tous, en dépendra.
J’en viens maintenant à l’article 1er, qui crée la prime de partage du profit. La commission mixte paritaire a adopté sans modification le texte du Sénat.
Cette prime, je vous le rappelle mes chers collègues, a plusieurs caractéristiques.
Elle s’imposera lorsqu’une société aura attribué à ses associés ou actionnaires des dividendes en augmentation par rapport à la moyenne de ceux versés au cours des deux exercices précédents.
Elle sera obligatoire pour les entreprises de plus de cinquante salariés et facultative sous ce seuil.
Elle s’appliquera dans les groupes : toutes les entités du groupe devront attribuer une prime si les dividendes augmentent dans la société de tête.
Elle devra bénéficier à l’ensemble des salariés des entreprises concernées mais pourra, comme la participation, être modulée en fonction du montant des salaires ou de l’ancienneté.
Le dispositif sera négocié dans chaque entreprise. En cas d’impossibilité de conclure un accord, la prime pourra être attribuée par décision unilatérale de l’employeur.
Elle ne pourra se substituer à aucune augmentation de rémunération prévue par ailleurs.
Son régime social est aligné sur celui de l’intéressement et de la participation : sous un plafond de 1 200 euros, elle sera exonérée de cotisations patronales et salariales de sécurité sociale mais assujettie à la CSG – 7, 5 % –, à la CRDS – 0, 5 % – et au forfait social – 6 %. Par ailleurs, comme pour l’intéressement et la participation, l’exonération dont la prime bénéficiera ne sera pas compensée aux organismes de sécurité sociale.
Enfin, ce dispositif est conçu comme une mesure pérenne qui s’appliquera pour toute attribution de dividendes décidée à compter du 1er janvier 2011. Une clause de rendez-vous est prévue pour permettre d’éventuelles adaptations législatives au regard de son application. Par ailleurs, si la négociation interprofessionnelle aboutit, une nouvelle loi pourra venir modifier le dispositif de la prime.
Le Sénat a apporté un peu de souplesse à ce dispositif, notamment pour l’année 2011, ainsi que pour l’accord d’intéressement que pourront conclure les entreprises de moins de cinquante salariés.
Par ailleurs, nous avons prévu que la nouvelle loi suivant la négociation interprofessionnelle sur le partage de la valeur ajoutée devra intervenir avant le 31 décembre 2013.
Selon les estimations du Gouvernement, cette mesure pourrait concerner 4 millions de salariés et représenter un apport, pour ceux-ci, de près de 2, 8 milliards d’euros.
Nous espérons qu’en permettant l’injection de plusieurs milliards dans notre économie la prime contribuera à dynamiser la croissance. D’ailleurs, dans sa dernière note de conjoncture, l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’INSEE, envisage un apport positif de cette prime sur le niveau des salaires du second semestre de l’année 2011.
Au demeurant, monsieur le ministre, nous sommes bien, malgré tout, en présence d’une nouvelle « niche ». Nous le regrettons, car la priorité aujourd’hui est avant tout de préserver les ressources publiques, afin de respecter la trajectoire du retour à l’équilibre que nous avons fixée dans la dernière loi de programmation des finances publiques.
C’est pourquoi il est impératif que la règle définie dans cette loi soit parfaitement respectée et que la nouvelle niche soit compensée, dès les prochaines lois financières, par la suppression d’une autre mesure dérogatoire, afin d’en neutraliser les conséquences pour les finances publiques.
L’examen de cette loi de financement rectificative de la sécurité sociale était une première. Ce nouvel exercice législatif est, à notre sens, très concluant. Il montre que toute réforme sociale dans le champ du projet de loi de financement de la sécurité sociale ayant des conséquences financières certaines peut être présentée sous la forme d’un collectif social.
Une telle approche nous a paru avoir le mérite de la transparence et de la clarté. Puissent le gouvernement actuel et les suivants continuer à adopter cette démarche à l’occasion des prochaines réformes !
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires sociales, mesdames, messieurs les sénateurs, beaucoup de choses ont déjà été dites sur la prime que le présent projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale institue. Le principe en est très simple : quand les dividendes versés aux actionnaires augmentent, les revenus des salariés doivent en faire autant !
Soyons clairs, une telle idée correspond plus à une logique de justice qu’à une logique de pouvoir d'achat. Même si le versement de la prime améliorera évidemment les revenus et, partant, le pouvoir d'achat des salariés, le dispositif se justifie d’abord par un souci d’équité. Il faut un meilleur partage de la valeur ajoutée dans notre pays.
Cela nous renvoie d’ailleurs à l’idée de « participation », à laquelle, compte tenu de l’engagement politique qui est le mien, je crois profondément, tout comme d’ailleurs à celle d’« intéressement », concepts éminemment porteurs et qui renforcent notre pacte social.
Le travail du Parlement a permis d’enrichir ce texte ; je salue notamment l’action d’Alain Vasselle et de Muguette Dini.
Ainsi, et cela correspond à un souhait qui était exprimé par nombre de dirigeants de PME, il sera à présent beaucoup plus facile de conclure des accords d’intéressement sur des périodes d’un an.
En outre, en cas de nouvelle négociation nationale interprofessionnelle sur le partage de la valeur, il sera possible d’adapter et de modifier le texte. En d’autres termes, même si le dialogue social n’a pas permis d’obtenir des avancées auparavant – ce que nous regrettons – nous lui offrons une nouvelle chance de trouver sa place, grâce à une négociation qui se tiendra jusqu’au 31 décembre 2013.
D’aucuns ont prétendu que les Français n’étaient pas favorables à ce texte. La vérité est tout autre. Selon les enquêtes qui ont été réalisées, 62 % des Français se déclarent favorables au principe de la prime et les trois quarts des dirigeants de PME indiquent clairement qu’ils sont disposés à l’accorder. Nous pouvons en tirer une leçon : des caricatures multiples n’empêchent pas le bon sens de triompher ! Et cette prime, dont le principe est inscrit à l’article 1er du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, est clairement porteuse de bon sens et de justice ! Je vous remercie d’y apporter votre soutien, mesdames, messieurs les sénateurs.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, cela ne vous surprendra pas, ayant voté contre ce projet de loi lors de son examen en première lecture, nous voterons de nouveau contre après la réunion de la commission mixte paritaire, dussiez-vous invoquer les fameux « 62 % de sondés » ou qualifier mon intervention de « caricaturale », monsieur le ministre.
En effet, la commission mixte paritaire n’a pas vraiment permis d’aboutir à une véritable répartition des richesses, comme nous l’appelions de nos vœux ; vous-même semblez pourtant y être attaché, monsieur le ministre.
Pour notre part, nous avons été surpris par certaines déclarations que nous avons entendues dans la discussion générale en première lecture.
Ainsi, monsieur le ministre, vous avez affirmé : « Il y a deux ans, au moment où notre pays traversait, comme le reste du monde, une crise d’une ampleur sans précédent, le Président de la République a voulu que s’engage une réflexion pour permettre une meilleure répartition des fruits de l’effort collectif. » Une telle déclaration appelle tout de même quelques observations.
D’abord, vous donnez voix à un rapport qui a été remis au Président de la République le 16 mai 2009 ; vous auriez pu trouver plus récent… Et on peut légitimement se demander pourquoi le Gouvernement a attendu plus de deux ans pour proposer enfin une mesure présentée comme devant renforcer le pouvoir d’achat de nos concitoyens. Certains l’expliquent par la proximité de l’élection présidentielle… Je vous laisserai le soin de nous répondre sur ce point, monsieur le ministre.
Par ailleurs, ce rapport n’est pas exempt de critiques. En effet, pour justifier toute sa théorie selon laquelle la part des salaires n’aurait pas radicalement diminué dans le partage des richesses, il se fonde évidemment sur le chiffre le moins gênant : la valeur ajoutée au coût des facteurs de production. Cela permet de conclure que la baisse « n’atteindrait que deux à trois points de valeur ajoutée » sur la période étudiée.
Même si nous ne sommes pas d'accord sur le chiffre retenu, nous notons tout de même, à l’instar de Sylvain Lapoix dans un article de Marianne, que : « Trois points de baisse ramenés au PIB français représenteraient la bagatelle de 55 milliards à 60 milliards d’euros en moins pour les salaires. » Et là, on peut dire que c’est une perte sèche pour le pouvoir d’achat des salariés !
En outre, de nombreux économistes s’accordent à dire, à l’image de Michel Husson, que le véritable enjeu est celui de la répartition de la valeur ajoutée entre deux facteurs : les dividendes et les salaires.
Selon des données fournies par l’INSEE, les salaires nets représentaient 45, 8 % de la valeur ajoutée en 1980, contre 37, 4 % en 2008, soit une perte d’un peu plus de 8 %. Sur la même période, la part de la valeur ajoutée dédiée aux dividendes est passée de 3, 1 % à 8, 4 %, soit une progression de 5, 3 %.
La tendance principale est un transfert des salaires vers les profits équivalant à 8, 8 points de valeur ajoutée. Michel Husson précise : « Du côté des profits, la majeure partie de l’augmentation est allée au versement de dividendes. En 1980, les revenus ainsi distribués par les entreprises représentaient 4, 2 % de leur masse salariale, et cette proportion est passée à 12, 9 % en 2008. Autrement dit, les salariés travaillaient 72 heures par an pour les actionnaires en 1980. En 2008, c’est 189 heures. » Voilà le constat !
Enfin, ce projet de loi ne peut décemment pas être présenté comme étant la conséquence du rapport Cotis. En effet, celui-ci préconisait un partage des richesses en trois tiers : un tiers pour les salariés, un tiers pour les actionnaires et, enfin, un tiers pour l’entreprise. Voilà d’ailleurs qui devrait faire plaisir à notre collègue Serge Dassault, lui qui nous propose cela lors de l’examen de chaque projet de loi de financement de la sécurité sociale…
Bien qu’une telle solution ne nous convienne pas complètement, car elle revient à rémunérer à l’identique travail et spéculation, elle est tout de même plus ambitieuse que la prime exceptionnelle au cœur de ce projet, une mesure unanimement dénoncée par toutes les instances dans lesquelles siègent les organisations syndicales représentatives, et pour cause !
Même si la loi précise que cette prime ne doit pas avoir d’incidence sur les augmentations de salaires, nombreux seront les employeurs qui considéreront avoir déjà satisfait à leurs obligations dans le cadre des négociations annuelles obligatoires ; vous le savez pertinemment, monsieur le ministre.
Pourtant, seules les augmentations de salaires, dès lors qu’elles sont notables, profitent durablement à l’économie, car elles sont réinjectées dans la consommation. Par ailleurs, elles sont à la fois égalitaires, car tous les salariés y ont droit, sécurisées, car il est difficile d’y revenir une fois qu’elles sont acquises, et justes, car le salaire doit rester la rémunération logique du travail que les salariés produisent.
C’est exactement l’inverse des primes, qui, elles, sont flexibles et individuelles et ne sont soumises à aucune cotisation sociale. Elles ne contribuent donc pas à financer ce formidable outil émancipateur qu’est la sécurité sociale, alors que vous annoncez dans le même temps le passage des quarante et une annuités aux quarante et une annuités et demie pour la retraite !
Vous présentez cette mesure comme automatique et technique, en oubliant au passage de préciser que la question principale est celle du financement de la sécurité sociale.

Les Français payent le prix de la multiplication des mesures d’exonérations et d’exemptions de cotisations sociales. Non content de ne pas vous attaquer résolument aux niches sociales, que la Cour des comptes dénonce comme étant les principales responsables du déficit de la sécurité sociale, vous en créez une nouvelle aujourd'hui.
Vous créez aujourd'hui une prime qui ne devrait pas dépasser les 700 euros et qui devrait ne concerner que 4 millions de salariés au maximum, mais que tous nos concitoyennes et concitoyens subiront.
Cela ne peut décemment pas s’appeler du partage de la richesse. En l’occurrence, 20 millions de salariés seront oubliés ; les retraités ou bénéficiaires de minima sociaux ne pourront rien espérer. Quant aux fonctionnaires, ils sont soumis depuis deux ans à un strict gel des salaires, c’est-à-dire à une baisse importante de leur pouvoir d’achat compte tenu de l’inflation.
Ce que veulent les salariés, et on les comprend, ce sont des augmentations de leur pouvoir d’achat, donc des augmentations de salaires. En 2010, le salaire mensuel de base a progressé en moyenne de 1, 8 %. Mais, en tenant compte de l’inflation, la hausse n’aura été que de 0, 3 %.
D’ailleurs, à l’occasion de l’adoption récente d’une proposition de loi relative à l’apprentissage par le Parlement, la majorité a adopté, avec votre soutien, une disposition permettant aux employeurs qui le souhaitent de proposer en lieu et place des heures supplémentaires une modification temporaire du contrat de travail d’un temps partiel à un temps plein.
Là encore, une telle mesure prend les apparences d’une fausse générosité. Bien entendu, les salariés seront ravis de pouvoir un temps bénéficier d’un temps plein. Mais que l’on ne s’y trompe pas : il s’agit là d’une mesure temporaire. Une fois les besoins passés, les salariés retourneront à leur précarité. Ceux qui ont le plus à y gagner, ce sont naturellement les employeurs, qui pourront ainsi se dispenser de la majoration de 25% applicable aux heures complémentaires. Mais, surtout, cela porte un mauvais coup à notre droit du travail, dans la mesure où la jurisprudence se fonde de manière constante sur la généralisation des heures complémentaires pour requalifier ces contrats à temps partiel en contrats à temps plein, une requalification qui, contrairement à votre mesure, est définitive.
Nous exigeons donc que les salaires, les traitements et les pensions soient augmentés. Les dépenses consécutives à une telle mesure profiteront naturellement aux salariés, mais aussi – faut-il le préciser ? – aux comptes sociaux.
Nous considérons également qu’il est grand temps d’ouvrir de nouveau le chantier d’un juste financement de la sécurité sociale. À l’occasion de l’examen de ce projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011, le groupe CRC-SPG avait proposé par voie d’amendements des solutions rapides, concrètes et crédibles. Le rapporteur s’y est systématiquement opposé, renvoyant le débat au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012. Quant à vous, monsieur le ministre, vous avez refusé le débat en vous contentant, de manière quasi systématique, d’une réponse lapidaire : « défavorable ».
Or nous proposions de cesser progressivement les exonérations de cotisations sociales. Selon M. Vasselle, le rythme que nous proposions était trop rapide. Nous en tiendrons compte pour le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, afin que la majorité UMP du Sénat ne puisse pas s’abriter derrière un tel argument.
Pour autant, nous ne partageons pas l’idée selon laquelle la suppression de telles exonérations nuirait à l’emploi. Au contraire, nous savons que ce sont ces exonérations, parce qu’elles portent essentiellement sur les emplois peu ou pas qualifiés, qui créent des mécanismes dits de « trappes à bas salaires », donc de la précarité.
D’ailleurs, il serait intéressant que le Gouvernement nous remette prochainement un rapport effectuant le rapprochement entre les entreprises qui bénéficient le plus de ces exonérations et les dividendes qu’elles reversent à leurs actionnaires. Ces résultats pourraient nous surprendre. Nous pourrions ainsi découvrir que les « assistés », puisque le terme est à la mode, ne sont pas nécessairement celles et ceux auxquels on pense… auxquels vous pensez, monsieur le ministre.
Nous avons également proposé, là encore en vain, de responsabiliser socialement les entreprises, en modulant leur taux de cotisations sociales en fonction de leur politique salariale. Le principe est simple : les entreprises qui favorisent l’emploi et le rémunèrent correctement paieraient moins de cotisations sociales que celles qui préfèrent distribuer massivement les productions de richesses aux actionnaires.
Selon la Commission européenne, entre 1993 et 2009, le volume des cotisations sociales a augmenté de 19 %, tandis que le PIB, notamment en raison des gains de productivité, augmentait de 33 % et que les revenus financiers des entreprises et des banques progressaient de 143 %.
Par ailleurs, la part des produits financiers dans la valeur ajoutée des entreprises est désormais près de deux fois supérieure – 29 % contre 15 % – à celle de leurs cotisations sociales. Il faut donc inverser la logique. Pourquoi ne pas réfléchir à l’instauration d’une cotisation sociale sur les dividendes ? Est-il acceptable que les salariés paient les pots cassés de la crise alors que la ponction sur la richesse produite opérée par les actionnaires continuerait comme avant ? Pour qu’il n’en soit pas ainsi, nous pouvons élargir l’assiette des cotisations aux profits non investis ou établir une contribution spécifique sur les profits distribués.
De la même manière, et pour mettre fin aux techniques de contournement de financement de la sécurité sociale, nous avons proposé, là encore sans succès, de soumettre tous les revenus du travail, y compris les revenus indirects, à cotisations sociales.
Par là je vise, notamment, l’intéressement, la participation – vous avez eu l’occasion, il y a un instant, monsieur le ministre, de nous dire tout le bien que vous en pensiez – l’épargne salariale, le plan d’épargne retraite populaire, le PERP, ou le plan d’épargne pour la retraite collectif, le PERCO, qui sont exonérés, tout du moins partiellement, de cotisations sociales ; c’est d’ailleurs leur seule raison d’être.
Si ceux qui soutiennent la participation veulent parler répartition des richesses, qu’ils prévoient des mécanismes d’augmentation des richesses et de plafonnement de distribution des dividendes. N’oublions pas qu’en pleine crise, alors que des milliers d’emplois étaient détruits, les groupes du CAC 40 ont dégagé 75 milliards d’euros de bénéfices. Sur cette somme, 35 milliards d’euros ont été versés aux actionnaires sous forme de dividendes.
Les salariés ont l’impression qu’ils ont permis, par leurs efforts ou par les licenciements dont ils ont été victimes, à une minorité de personnes d’accaparer la majorité des dividendes produits.
Tout cela nous conduira, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, à voter contre ce projet de loi, non que nous entendions priver de cette prime les rares salariés concernés par elle, …

Mme Annie David. … mais parce que nous considérons que, loin de cette logique de communication, il serait possible d’instaurer un juste partage des richesses qui profiterait aux comptes sociaux, aux salariés et à l’investissement des entreprises. C’est ainsi que nous pourrons faire augmenter le pouvoir d’achat des salariés.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

La parole est à Mme Raymonde Le Texier, dont je salue la dernière intervention dans cet hémicycle.

Je vous remercie, monsieur le président.
Monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, la Grèce avec une dette de 350 milliards d’euros, représentant 152 % de son PIB, fait trembler l’Europe. La dette de la France, elle, devrait atteindre 90 % de notre PIB en 2012, 100 % en 2014, et les prévisions du rapport de la Cour des comptes à l’horizon de 2025 sont plus que sombres.
Face à une situation tendue en matière de finances, au sein de l’Europe, comme en interne, le Gouvernement aurait pu décider de faire de ce premier projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale une occasion de poser de vraies questions. La santé, économie socialisée, ne peut-elle être gérée que de manière libérale ? Peut-on mener une vraie réforme des retraites sans repenser le travail à travers les âges de la vie, sans permettre aux jeunes d’accéder au marché de l’emploi et aux seniors d’y rester ? Est-ce que, face à la dégradation des comptes sociaux, de vrais axes d’interventions politiques ont été définis ?
Non, nous ne sommes réunis aujourd'hui que pour créer une nouvelle niche fiscale pompeusement baptisée « partage de la valeur ajoutée ». Qualifier cela de rééquilibrage entre le capital et le salariat est difficile à entendre.
La résolution des conflits entre le capital et le travail se fera par la politique salariale et non par une défiscalisation qui ne touchera potentiellement qu’entre 8 % et 16 % des salariés, si seulement leurs patrons le veulent bien...
Pendant ce temps, l’accès aux soins diminue, l’hôpital est en crise, la médecine de ville est aux abonnés absents, les urgences sont saturées, les assurés sont pressurés... Mais la situation des finances sociales ne donne pas lieu à des réformes autres que financières, qui se résument en un coup de rabot généralisé nettement plus porté sur l’écrêtage des droits des assurés sociaux que sur une exigence de justice en matière de participation des plus aisés aux sacrifices exigés de tous.
Le déficit social n’a pas atteint cette année les 20, 5 milliards d’euros prévus et ne s’élève « qu’à » 19, 5 milliards d’euros. Certes, mais faire un trou de moins dans la coque ne signifie pas qu’il faille se réjouir de l’état du bateau. Même si notre rapporteur, Alain Vasselle, sait dire les choses qui fâchent d’un ton patelin, il n’en reste pas moins que son propre constat n’est guère optimiste. Il l’a souligné lui-même : « Les trajectoires de déficit ne sont pratiquement pas modifiées ». Il précise que, dans le meilleur des cas, « le déficit du régime général […] s’élèverait encore à 17, 7 milliards d’euros en 2014 », lequel alimentera une nouvelle dette sociale, « ce qui n’est pas soutenable dans la durée ».
Notons, toutefois, que ce même discours a déjà servi à chaque projet de loi de financement de la sécurité sociale. Depuis le temps qu’un nouveau transfert n’est plus soutenable, mesdames et messieurs de la majorité, pourquoi en proposer systématiquement un ?
Mais il est vrai que cette prise de conscience n’était pas l’objet de ce projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale.
La commission mixte paritaire ne s’y est pas trompée. Un seul article faisait débat, celui sur l’instauration de la énième prime de circonstance, vendue comme un moyen de modifier le rapport entre le capital et le travail en faveur du travail. Comme si donner des étrennes avait le même sens que négocier une politique salariale dans une entreprise, comme si donner des étrennes en année préélectorale effaçait le bilan, remettait tous les compteurs à zéro et garantissait la réélection !
C’est ainsi que, sous couvert de justice sociale, vous vendez une prime qui ne concernera in fine au mieux que 4 millions de salariés sur les 25 millions de salariés que compte notre pays, une prime dont le montant dépend autant de la bonne volonté du patron que d’un calcul complexe aux variables aléatoires. En ne versant qu’une gratification, d’un montant allant de 1 euro à 1 200 euros, à un salarié sur six, vous occultez la situation réelle du marché du travail aujourd’hui et vous évacuez la question de la négociation salariale.
De surcroît, rien dans l’instauration de cette prime ne répond aux vrais problèmes de fonctionnement du marché du travail : les jeunes piétinent à sa porte, les seniors en sont éjectés avant soixante ans, et toute la productivité repose sur le segment des 24-59 ans, qui voient, à chaque bout de la chaîne, leur avenir se dégrader – réforme des retraites, précarisation de l’emploi, baisse du pouvoir d’achat, difficulté d’accès au service public...
Le tapage fait autour d’une « carotte » potentielle, qui ne toucherait qu’un sixième des salariés, mais ferait glisser le débat autour du partage de la valeur ajoutée de la question des salaires à celle d’une prime d’intéressement liée aux dividendes, est déjà un beau bénéfice pour les tenants de la droite dite « décomplexée ». Et de fait, elle l’est !
De plus, pour ne pas effaroucher les derniers esprits chagrins du MEDEF, les conditions qui accompagnent le versement de la prime sont peu astreignantes... Ainsi, une firme comme Total, par exemple, qui a réalisé un profit de 10 milliards d’euros en 2010 et qui ne paie pas d’impôts ne serait même pas concernée par le nouveau régime d’obligations !
Au cas où les mailles « adaptables » du filet auraient leurs limites, le montant de la prime est assorti de critères modulables : l’ancienneté, le niveau de salaire, le nombre de marche pour descendre à la cantine... voire peut-être, un jour, le mérite ! Ce serait alors l’aboutissement du nouveau partage de la valeur ajoutée pour le gouvernement de Nicolas Sarkozy !
Enfin, cette nouvelle prime ajoute une niche fiscale au dispositif boursouflé et complexe des niches fiscales et sociales dans leur ensemble, gouffre pour les finances publiques, qui se caractérise par des évaluations plus que légères et une efficacité très relative en matière d’emploi.
Grand pourfendeur de niches dans ses discours, le Gouvernement est bien plus timoré dès lors qu’il s’agit de mettre fin à des rentes de situation, timoré au point d’en créer de nouvelles…
C’est ainsi que, pour donner un semblant de contenu au bilan du Président de la République en matière de pouvoir d’achat, un instrument comme le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale est mobilisé. Face au péril de nos finances sociales, en revanche, le texte est muet : choix de priorité révélateur…
J’aurais préféré, pour ma dernière prise de parole dans cet hémicycle, que ce projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale vise des objectifs de solidarité face à la maladie, à la vieillesse, au chômage. Au lieu d’une ambition et d’une responsabilité gouvernementale à la hauteur, vous optez de nouveau, simplement, pour un effet d’annonce.
Malheureusement, le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale qui nous est soumis aujourd'hui est l’antithèse de ce dont la France a besoin. Le groupe socialiste votera donc contre.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, « qui peut comprendre qu’on distribue plus de 80 milliards d’euros aux actionnaires – précisément 82, 3 milliards d’euros en 2010 – et que, dans le même temps, on explique aux salariés qu’il n’y a pas de quoi augmenter les salaires ? » Je me permets, en toute modestie, de reposer cette question puisqu’elle émane, excusez du peu, de la plus haute autorité de l’État, et que tout le monde se la pose encore, particulièrement les salariés !
Il paraît, en effet, que l’objectif de l’article 1er du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, dont le parcours législatif s’achève aujourd'hui, n’est finalement pas d’augmenter le pouvoir d’achat, mais avant tout une question justice, d’équité et de meilleur partage de la valeur. C’est ce qu’a affirmé tout à l’heure M. le ministre.
Il est vrai que cet article prévoit seulement que les salariés dont l’entreprise verse des dividendes en augmentation sur les deux derniers exercices pourront bénéficier d’une négociation. Mais des échappatoires ont aussi été évoquées, par exemple par le biais du rachat de ses propres actions ou grâce à l’organisation de souscription d’actions à taux préférentiel.
Est-il possible que ce qui serait accordé d’une main soit discrètement repris de l’autre sur la participation ou la rémunération ? Comment pourra-t-on s’assurer qu’un tel système ne devienne pas un marché de dupes ? Nous verrons bien…
Quoi qu’il en soit, réjouissons-nous plutôt qu’après avoir donné aussi largement satisfaction à un syndicat de médecins libéraux le matin par la grâce de la proposition de loi « Fourcade », le Gouvernement se soucie un peu des salariés l’après-midi ! Inutile de jouer les Cassandre et surtout de donner à cette mesure plus d’importance qu’elle n’en a visiblement.
Nous sommes, en revanche, beaucoup plus inquiets de la contradiction aiguë à laquelle s’expose le Gouvernement au regard des prescriptions de sa dernière loi de programmation des finances publiques et de ce nouveau texte. La création de cette niche sociale supplémentaire devrait s’accompagner de la suppression d’une autre niche d’un montant équivalent. Je ne suis pas le seul à souligner ce point, la même remarque ayant été formulée sur différentes travées. Or tel n’est pas le cas. Il est vrai qu’on a oublié d’évaluer le coût de cette niche, ce qui ne suffit bien sûr pas à supprimer le problème, celui d’une nouvelle aggravation des déficits de l’État via le déficit de la sécurité sociale – nous pourrions en débattre – sur la seule initiative du Gouvernement.
Certes, il était à craindre qu’à force de multiplier les lois et les règlements comme les petits pains le Gouvernement finisse par ne plus s’y retrouver lui-même !
Cependant, il ne peut quand même pas avoir déjà oublié les raisons pour lesquelles il défendait, il y a seulement quelques jours, rien moins qu’un projet de réforme constitutionnelle pour s’empêcher lui-même de céder, dorénavant, à la tentation du déficit. Quelle performance ! Il n’aura cette fois même pas attendu que la réforme soit définitivement adoptée pour ne pas la respecter !
Nous avions, en effet, exprimé la crainte que cette « règle d’équilibre » des finances publiques, assortie d’un monopole institué au profit des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, ne suffirait pas à remplacer l’absence de volonté politique : ce projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale nous en fournit malheureusement l’exacte confirmation.
Bien que les articles « d’équilibre » des finances sociales ne soient plus, à ce stade, en débat, permettez-moi, pour conclure, de souligner le caractère peut-être prématuré de ces rectifications en cours d’année. Tel n’était d’ailleurs pas l’objet initialement prévu pour les lois rectificatives de finances sociales, destinées à consacrer une modification importante et brutale de contexte ou une évolution de grande ampleur.
Or le seul événement d’ampleur qui subsiste reste malheureusement la perspective de 17 milliards d’euros de déficit du régime général à l’horizon 2014 et l’absence chronique – que nous dénonçons régulièrement – de volonté et de projet du Gouvernement, qui se contente visiblement de prendre régulièrement la température de l’ONDAM et continue à saigner le patient au prétexte qu’il faut le purger pour son bien !
Comme l’a conclu tout à l'heure ma collègue Raymonde Le Texier, nous voterons contre ce texte, vous l’avez bien compris.

M. Yves Daudigny. Qu’il me soit permis à cette tribune de te dire, chère Raymonde, combien j’ai apprécié, durant trois ans, la sincérité de ton engagement, la qualité de tes interventions – nous en avons eu une nouvelle preuve aujourd'hui – et la pertinence de tes analyses. À tes côtés, j’ai pu apprendre le travail parlementaire et enrichir ma réflexion. Je t’en remercie !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Mes chers collègues, je m’associe à l’éloge adressé à Mme Le Texier.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, d’une part, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d’autre part, étant appelé à se prononcer après l’Assemblée nationale, le Sénat procède à un vote unique sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
PROJET DE LOI DE FINANCEMENT RECTIFICATIVE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2011
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR L’ANNÉE 2011
Section 1
Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement. Prime de partage des profits
(Texte du Sénat)
I. – Le II est applicable aux sociétés commerciales qui emploient habituellement cinquante salariés et plus, au sens des articles L. 3322-2 et L. 3322-4 du code du travail.
Lorsque plus de la moitié du capital d’une société commerciale est détenue directement par l’État ou, ensemble ou séparément, indirectement par l’État et directement ou indirectement par ses établissements publics, le II lui est applicable si elle ne bénéficie pas de subventions d’exploitation, n’est pas en situation de monopole et n’est pas soumise à des prix réglementés.
II. – Lorsqu’une société commerciale attribue à ses associés ou actionnaires, en application de l’article L. 232-12 du code de commerce, des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par part sociale ou par action versés au titre des deux exercices précédents, elle verse une prime au bénéfice de l’ensemble de ses salariés.
Toutefois, lorsqu’une société appartient à un groupe tenu de constituer un comité de groupe en application du I de l’article L. 2331-1 du code du travail, elle verse une prime au bénéfice de l’ensemble de ses salariés dès lors que l’entreprise dominante du groupe attribue des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par part sociale ou par action versés au titre des deux exercices précédents.
III. – La prime mentionnée au II du présent article est instituée par un accord conclu selon l’une des modalités définies aux 1° à 4° de l’article L. 3322-6 et à l’article L. 3322-7 du code du travail, au plus tard dans les trois mois suivant l’attribution autorisée par l’assemblée générale en application de l’article L. 232-12 du code de commerce.
Si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu selon les modalités mentionnées à l’alinéa précédent, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées les propositions initiales de l’employeur, en leur dernier état les propositions respectives des parties et la prime que l’employeur s’engage à attribuer unilatéralement, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. L’accord ou la décision unilatérale de l’employeur est déposé auprès de l’autorité administrative. À défaut de ce dépôt, la société ne bénéficie pas de l’exonération mentionnée au VIII du présent article.
Une note d’information est remise à chaque salarié concerné, précisant éventuellement les modalités de calcul de la prime ainsi que son montant et la date de son versement.
IV. – La répartition de la prime mentionnée au II du présent article peut être modulée entre les salariés en application des critères prévus à l’article L. 3324-5 du code du travail. L’accord prévu au premier alinéa du III peut appliquer les dispositions de l’article L. 3342-1 du même code. Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération prévues par la convention ou l’accord de branche, un accord salarial antérieur ou le contrat de travail. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de dispositions législatives ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.
V. – Le fait de se soustraire à l’obligation d’engager une négociation en vue de la conclusion de l’accord prévu au III du présent article est passible des sanctions prévues à l’article L. 2243-2 du code du travail.
VI. – Ne sont pas soumises aux obligations du présent article les sociétés ayant attribué au titre de l’année en cours au bénéfice de l’ensemble de leurs salariés, par accord d’entreprise, un avantage pécuniaire qui n’est pas obligatoire en application de dispositions législatives en vigueur ou de clauses conventionnelles et est attribué, en tout ou en partie, en contrepartie de l’augmentation des dividendes.
VII. – Les sociétés commerciales qui emploient habituellement moins de cinquante salariés et qui remplissent les conditions définies au II du présent article peuvent se soumettre volontairement aux dispositions du présent article à leur initiative ou par un accord conclu selon l’une des modalités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 3322-6 du code du travail.
VIII. – Sous réserve du respect des conditions prévues au présent article, les primes mentionnées au II ou attribuées en application du VII sont exonérées, dans la limite d’un montant de 1 200 € par salarié et par an, de toute contribution ou cotisation d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l’exception des contributions définies aux articles L. 136-2 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
L’employeur déclare le montant des primes versées à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève.
IX. – L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable pour l’exonération mentionnée au VIII du présent article.
X. – Le II n’est pas applicable à Mayotte.
XI. – Le II est applicable aux attributions de dividendes autorisées à compter du 1er janvier 2011 au titre du dernier exercice clos.
Pour les attributions de dividendes intervenues à la date de promulgation de la présente loi, le délai prévu au III court jusqu’au 31 octobre 2011.
XI bis. – Jusqu’au 31 décembre 2012, les entreprises employant habituellement moins de cinquante salariés peuvent conclure un accord d’intéressement pour une durée d’un an.
Pour 2011, par dérogation à la règle posée par l’article L. 3314-4 du code du travail, la date limite de conclusion de cet accord est exceptionnellement portée au 31 octobre 2011 lorsque la période de calcul est annuelle.
XII. – Avant le 31 décembre 2012, le Gouvernement présente au Parlement un bilan des accords et des mesures intervenus en application du présent article. Ce rapport peut proposer des adaptations législatives découlant de ce bilan.
XIII. – Le présent article s’applique jusqu’à l’intervention d’une loi suivant les résultats d’une négociation nationale interprofessionnelle, au plus tard le 31 décembre 2013, sur le partage de la valeur ajoutée qui pourra notamment proposer des adaptations législatives dans le champ de la participation et de l’intéressement prévus aux titres Ier et II du livre III de la troisième partie du code du travail.
XIV. –
Supprimé
Section 2
Prévisions de recettes et tableaux d’équilibre
Section 3
Dispositions relatives à la trésorerie
SECONDE PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’ANNÉE 2011

Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.

Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. Alain Gournac, pour explication de vote.

Monsieur le ministre, je tiens tout d’abord à vous remercier pour l’action menée par votre ministère en termes de justice sociale. Je remercie également notre rapporteur pour la qualité de son travail et la clarté de ses explications.
Ce projet de loi de financement rectificative retraçant l’évolution de nos comptes sociaux traduit l’amélioration de la situation économique de la France. Ces signes d’embellie, même s’ils sont encore modestes, sont encourageants pour le Gouvernement, qui doit poursuivre sa tâche ardue de redressement des finances publiques.
La prime créée à l’article 1er du projet de loi en est l’une des mesures phare, dont la presse s’est largement fait l’écho. En visant à garantir une répartition équitable de la valeur ajoutée, elle s’inscrit pleinement dans la politique de revalorisation du travail menée depuis 2007 par le Gouvernement.
Revaloriser la valeur travail, c’est reconnaître que, lorsque l’entreprise réussit, il est juste que les actionnaires mais également les salariés en soient récompensés. §Notre groupe approuve cette volonté de redistribution et d’amélioration du pouvoir d’achat.
Comme vous, monsieur le ministre, je tiens à rappeler mon soutien total à la participation et l’intéressement.
Certes, il s’agit d’une nouvelle niche fiscale, mais elle permettra d’injecter plusieurs milliards d’euros dans notre économie et donc de dynamiser notre croissance. Selon l’étude d’impact annexée au projet de loi, la mesure pourrait concerner 4 millions de salariés.

Je sais, on a prétendu que ce n’était pas grand-chose, mais force est d’admettre qu’il s’agit d’une avancée majeure.
Notre Haute Assemblée, sous l’impulsion du rapporteur général de la commission des affaires sociales, Alain Vasselle, a souhaité assouplir un peu le dispositif et préciser certains ajouts de nos collègues députés. Le texte issu de la commission mixte paritaire retient cette rédaction dans une démarche très consensuelle dont il y a lieu de se réjouir, le texte étant étudié en procédure accélérée.
C’est pourquoi, mes chers collègues, vous l’aurez compris, le groupe UMP votera avec enthousiasme en faveur de ce projet de loi.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici le résultat du scrutin n° 273 :
Le Sénat a adopté.
En conséquence, le projet de loi est adopté définitivement.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à quinze heures vingt-cinq, est reprise à quinze heures trente-cinq.

L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi sur le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels (texte de la commission n° 736, rapport n° 735).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme Sylvie Desmarescaux, au nom de la commission mixte paritaire.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, la commission mixte paritaire qui s’est réunie le 6 juillet dernier a adopté un texte commun sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels. Je regrette d’autant plus de n’avoir pu, pour des raisons médicales, participer à ses travaux qu’elle est parvenue à élaborer un texte équilibré, reflétant sincèrement les travaux de nos deux assemblées.
Avant que je n’évoque le fond du texte et les conclusions de la commission mixte paritaire, qu’il me soit d’abord permis de remercier mes collègues membres de la commission des affaires sociales et l’ensemble des sénateurs qui ont participé aux débats : ils nous ont permis d’aboutir à un texte qui apporte de véritables réponses aux jeunes.
Je remercie également M. Xavier Bertrand et Mme Nadine Morano de la confiance qu’ils m’ont accordée tout au long des débats, ainsi que notre présidente de la commission des affaires sociales de son soutien.
Je tiens aussi à saluer le travail qui est mené dans l’ombre par les administrateurs et les membres des cabinets ministériels : leur expertise, leur écoute et leur grande disponibilité m’ont été très précieuses.
J’en viens, maintenant, au fond du texte. Comme vous le savez, celui-ci est un exemple concret de la concertation qui peut être menée auprès des partenaires sociaux, avec lesquels les échanges ont été très riches.
Malgré le recours à la procédure accélérée, le texte a été enrichi, notamment grâce à l’apport de Françoise Férat et à l’implication de Jean-Claude Carle, dont nous connaissons les grandes compétences en matière de formation professionnelle.
Après une lecture unique dans chacune des deux assemblées, vingt-sept articles restaient en discussion. Ceux-ci portaient sur quatre grandes thématiques : le développement de l’alternance, l’encadrement des stages, les groupements d’employeurs, la création du contrat de sécurisation professionnelle.
En ce qui concerne le développement de l’alternance, sur proposition de Gérard Cherpion, rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, la commission mixte paritaire a rétabli la disposition selon laquelle la carte d’étudiant des métiers sera délivrée à certains titulaires d’un contrat de professionnalisation.
Il s’agit toutefois d’une mesure très précisément ciblée, avec deux conditions cumulatives : elle ne concernera que les personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus, complétant leur formation initiale par un contrat de professionnalisation ; celui-ci devra en outre permettre d’acquérir une qualification officiellement reconnue et comporter une action de professionnalisation d’une durée d’au moins douze mois.
Cette mesure ne constitue donc pas la première étape d’une éventuelle fusion de l’apprentissage avec les autres formes de formation en alternance. Au contraire, la proposition de loi reconnaît la spécificité du statut de l’apprenti. Cette disposition a plutôt pour but de donner des droits similaires à des jeunes dont la situation, si elle n’est pas identique, est néanmoins très proche.
En revanche, la position du Sénat a été confirmée en ce qui concerne la suppression du label visant à reconnaître les efforts des entreprises en faveur des formations en alternance, dispositif trop complexe et source potentielle d’inégalités entre les entreprises.
L’ouverture des contrats de professionnalisation aux particuliers employeurs a également été maintenue dans le cadre d’une expérimentation de trois ans.
Enfin, les mécanismes nouveaux introduits sur proposition de Jean-Claude Carle, comme la consolidation de la passerelle entre la préparation d’un baccalauréat professionnel et d’un certificat d’aptitude professionnelle ou la transformation de la préparation opérationnelle à l’emploi en un véritable outil de remise à niveau des « décrocheurs », ont été sauvegardés.
Le texte que je vous proposerai d’adopter est donc fidèle à notre volonté, maintes fois exprimée dans cet hémicycle, de revaloriser l’apprentissage et les formations en alternance.
Les dispositions adoptées par le Sénat concernant l’encadrement des stages appelaient peu de modifications, si ce n’est d’ordre rédactionnel. Toutefois, la commission mixte paritaire a rejeté un amendement proposé par ses rapporteurs qui aurait encadré plus strictement les exceptions à la règle selon laquelle un stage ne peut durer plus de six mois. Le Gouvernement a proposé de rétablir cette mesure, et je le soutiens pleinement. Quoi qu’il en soit, l’encadrement des stages constitue une avancée sociale majeure pour tous les étudiants, car leur statut dans l’entreprise sera consacré et leur travail mieux valorisé.
Sur le thème des groupements d’employeurs, le texte de compromis reprend les modifications apportées par le Sénat.
Tout d’abord, l’entrée en vigueur des articles portant sur ce sujet est différée au 1er novembre prochain, afin de laisser aux partenaires sociaux la possibilité de poursuivre les négociations qu’ils ont récemment engagées.
Ensuite, l’encadrement de l’activité des salariés des groupements d’employeurs en faveur des collectivités territoriales, que nous avions souhaité renforcer, est aménagé, afin de ne pas trop pénaliser le développement économique des groupements tout en s’inscrivant dans le respect des règles qui forment le statut de la fonction publique territoriale.
Enfin, dans le respect de l’accord national interprofessionnel du 31 mai dernier, le texte n’apporte que des modifications mineures, de nature technique ou rédactionnelle, au contrat de sécurisation professionnelle.
Il convient de se féliciter que les deux dispositions nouvelles introduites par le Sénat aient été maintenues. Il s’agit, d’une part, de l’encadrement juridique du prêt de main-d’œuvre à but non lucratif, afin d’offrir un régime juridique protecteur aux salariés, d’autre part, de l’autorisation explicite accordée aux mineurs de seize ans et plus pour constituer une association afin de les encourager à s’engager dans la vie associative, mesure dont notre collègue Isabelle Debré avait pris l’initiative.
Au regard de ces éléments, je vous demanderai, mes chers collègues, d’approuver le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire : il apporte de véritables réponses aux difficultés d’accès au marché du travail que peuvent rencontrer les jeunes en formation ou les salariés cherchant à se reclasser. Par des mesures concrètes et rapidement applicables, il offre une plus grande sécurité dans le déroulement du parcours professionnel.
C’est pourquoi il ne faut pas manquer cette occasion d’assurer aux jeunes une formation professionnelle adéquate et aux salariés victimes des mutations économiques les meilleures chances de recommencer une nouvelle vie professionnelle.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP. –. Mme Anne-Marie Payet applaudit également.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le texte issu des délibérations de la commission mixte paritaire est un texte équilibré, qui apporte des réponses concrètes pour développer l’emploi des jeunes. Je le dis d’autant plus librement qu’il est largement le fruit des efforts des parlementaires.
À cet égard, je tiens à remercier Mme la présidente Muguette Dini ainsi que Mme Sylvie Desmarescaux, qui vient de rendre aux collaborateurs du ministère un hommage que ceux d’entre eux qui sont présents aujourd'hui ont beaucoup apprécié et dont je lui sais moi-même particulièrement gré.
À ce stade, je rappellerai simplement quelques points essentiels.
Tout d’abord, vous le savez, l’emploi des jeunes est une priorité du Président de la République, du Gouvernement et de la majorité ; il devrait être aussi en être une pour l’ensemble de la société française. Je pense que nous en sommes tous ici convaincus, un pays qui n’offre pas d’avenir à ses jeunes, c’est un pays qui n’a pas d’avenir.
Le choix que nous faisons, c’est celui de l’apprentissage, car je reste persuadé que le véritable avenir des jeunes passe par l’entreprise.
À cet égard, le texte ouvre de nouveaux secteurs à l’apprentissage et à la professionnalisation, comme l’intérim, les emplois saisonniers ou, sous forme d’expérimentation, le particulier employeur. Il permet aussi d’apporter des réponses concrètes aux problèmes que rencontrent les jeunes apprentis et les entrepreneurs sur le terrain.
Par ailleurs, le texte transpose les articles de l’accord national interprofessionnel, l’ANI, du 7 juin relatifs aux stages. Délai de carence, plafonnement à six mois, interdiction de pourvoir un emploi lié à l’activité permanente de l’entreprise : autant d’avancées importantes que le Gouvernement souhaite compléter en proposant un amendement visant à calquer pleinement le texte sur celui de l’ANI, dans un souci de respect du dialogue social.
Le texte tend en outre à « libérer » le développement des groupements d’employeurs. Il nous permet ainsi de répondre à des demandes légitimes.
Enfin, la commission mixte paritaire a préservé l’équilibre du texte concernant le contrat de sécurisation professionnelle pour les licenciés économiques, qui constitue un outil efficace de reclassement voulu par les partenaires sociaux, par le Gouvernement et par la majorité.
Mesdames, messieurs les sénateurs, ce texte marque notre ambition de faire reculer le chômage, singulièrement celui des jeunes, et il constitue une parfaite illustration de notre vision très pragmatique en nous permettant de répondre à ce défi essentiel par des mesures concrètes.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Monsieur le ministre, il est très audacieux d’avancer que cette proposition de loi permet d’offrir un avenir aux jeunes et de faire reculer le chômage, car, malheureusement, ce ne sera pas le cas.
Cette proposition de loi, à défaut d’avoir les effets très positifs que vous semblez en escompter, permettra-t-elle, à tout le moins, d’améliorer la situation de l’apprentissage de l’alternance ? Ce n’est pas évident non plus ! Et je tiens à bien préciser que nous ne sommes opposés ni à l’apprentissage ni à l’alternance.

Nous persisterons donc à voter contre ce texte, car il laisse de nombreux problèmes non résolus, quand il ne contribue pas à en aggraver d’autres.
L’apprentissage et les contrats de professionnalisation ne sont, à notre sens, pas suffisamment encadrés pour permettre aux jeunes d’acquérir des compétences professionnelles dans des conditions matérielles et des conditions de travail décentes. Il existe d’ailleurs, de ce point de vue, de grandes inégalités : la situation varie d’un endroit, d’un secteur ou d’une profession à l’autre. Quoi qu’il en soit, la question des conditions réelles d’acquisition des compétences par l’apprentissage devrait être regardée de plus près.
Quant à l’insertion professionnelle des apprentis, elle n’est pas aussi idyllique que l’on veut bien nous le faire croire ; c’est du reste la raison pour laquelle vous parlez d’assurer un avenir aux jeunes ! Plus d’un tiers des apprentis ne trouvent pas d’emploi à l’issue de leur formation.

De plus, les ruptures de contrat concernent chaque année environ un quart des apprentis, et jusqu’à 37 % dans certains secteurs, comme l’hôtellerie et la restauration ! Le passage dans l’emploi est donc bref, et la sortie en est rapide.
En outre, le taux de réussite des apprentis aux examens professionnels est inférieur, de 5 points en CAP et de 6, 5 points en BTS, à celui des élèves scolarisés.
Surtout, nous ne souhaitons pas que, sous prétexte de lutte contre le chômage et d’amélioration de l’insertion professionnelle, l’alternance devienne un « sous-contrat de travail », permettant aux entreprises d’embaucher à moindre coût. Or cette proposition de loi contribuera justement à perpétuer de telles pratiques.
Alors que les dispositions du texte sont censées rendre l’apprentissage attractif, il n’en est rien concernant la rémunération des apprentis, qui reste au même taux, c’est-à-dire entre 25 % et 78 % du SMIC.
En revanche, le projet de loi de finances rectificative pour 2011 a entériné des dispositions qui figuraient initialement dans la présente proposition de loi et dont bénéficient directement les entreprises. Quand il s’agit de donner des avantages aux entreprises, vous êtes toujours aux avant-postes !
En l’occurrence, je pense à l’exonération de charges pendant un an prévue pour toute nouvelle embauche en alternance dans les entreprises de moins de 250 salariés, ainsi qu’au relèvement de 3 % à 4 % du taux de salariés devant être embauchés en apprentissage dans les entreprises de plus de 250 salariés et à l’instauration dans ces dernières d’un système de bonus-malus. En outre, l’impact du malus est amoindri puisque en seront exonérées les entreprises s’engageant à augmenter leur nombre d’apprentis de 10 % d’ici à l’an prochain.
En la matière, les promesses n’engagent que ceux qui les font ! S’il est certain que les entreprises bénéficieront d’exonérations, il n’est absolument pas sûr qu’elles embaucheront 10 % d’apprentis de plus l’année prochaine.
Quant aux articles de la proposition de loi non repris dans le projet de loi de finances rectificative, ils répondent à la même logique : satisfaire les besoins des entreprises.
L’un de ces articles crée ainsi la possibilité de signer un contrat d’apprentissage saisonnier avec deux employeurs différents, ce qui développe la flexibilité de la main-d’œuvre, en fonction des besoins des entreprises, mais au détriment de la protection des travailleurs. §

Cela aura pour conséquence de créer un nouveau vivier de main-d’œuvre à bas coût dans un secteur par définition déjà précaire et d’accroître les difficultés pour les apprentis et leurs familles. Rien ne garantit pourtant que la complémentarité de ces contrats sera assurée pour l’obtention du ou des diplômes préparés, tant les emplois dits « saisonniers » sont divers.
Un autre article du texte crée la possibilité d’effectuer un contrat d’apprentissage dans les entreprises d’intérim. Là encore, si l’opportunité pour l’entreprise est évidente, elle l’est beaucoup moins pour l’apprenti, qui doit être engagé dans une mission longue et formatrice de un à trois ans, ce qui ne correspond nullement à la vocation de l’intérim.
La proposition de loi prévoit également la possibilité de renouveler une fois un contrat de professionnalisation à durée déterminée, alors que ce dernier peut déjà durer douze mois, et jusqu’à vingt-quatre mois dans certains cas. Où est l’amélioration ? Cela revient à créer des contrats précaires pouvant durer jusqu’à quarante-huit mois, en dehors de la législation du travail concernant les CDD ; autrement dit, on aura des CDD sans les garanties qui y sont liées ! C’est ce que font d’ailleurs souvent les entreprises qui prolongent les contrats d’apprentissage.
Nous sommes également opposés à la possibilité d’effectuer un contrat de professionnalisation chez un simple particulier employant un salarié pour ses besoins personnels : services à la personne, travaux du bâtiment, etc. En effet, le manque d’encadrement et de contrôle sur ce type d’emplois en fait la voie royale vers tous les abus.
Avec de tels emplois, vous en conviendrez, des conditions comme le nombre d’heures de travail par semaine ou l’objectif de formation risquent fort de ne pas être remplies. Le particulier, qui n’est employeur que ponctuellement et à hauteur de ses besoins, ne saurait contribuer à la formation. Qui peut se persuader du contraire ?
L’objectif de cette mesure est clair : favoriser les particuliers employeurs, avec des embauches à moindre coût, en faisant se succéder les apprentis.
Autre élément participant de cette logique qui tend à faire du contrat d’alternance un contrat de travail ordinaire : le fait qu’une préparation opérationnelle à l’emploi, ou POE, puisse déboucher sur l’embauche en contrat d’apprentissage. Nous y sommes opposés. En effet, la POE a pour objectif de permettre à une personne au chômage d’accéder à une formation lui permettant d’accéder ensuite à une offre de poste précise transmise à Pôle emploi. Elle doit donc déboucher sur un véritable contrat de travail répondant aux besoins de l’entreprise, et non sur de l’apprentissage.
Ce dernier ne doit pas être considéré comme un contrat de travail banalisé et, surtout, ne doit pas représenter pour l’entreprise une alternative à une embauche réelle, certes plus coûteuse, mais constituant la seule solution envisageable au regard de la lutte contre le chômage et contre la précarité des salariés.
Enfin, last but not least, cette proposition de loi crée des « sections apprentissage » permettant de faire des stages en centres de formation d’apprentis dès la troisième et abaisse parallèlement à 14 ans l’âge minimum pour souscrire un contrat d’apprentissage, au mépris de l’obligation scolaire jusqu’à 16 ans et de l’interdiction du travail des enfants.
Quant aux dispositions sur les groupements d’employeurs, elles instaurent une déréglementation totale au profit des entreprises, en permettant l’adhésion d’un employeur à deux groupements et en élargissant cette possibilité à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, ainsi qu’aux collectivités territoriales. Les salariés sont donc considérés comme des variables d’ajustement pour les entreprises – mais on reconnaît bien là votre façon de voir les choses ! –, qui peuvent les mettre à la disposition des autres employeurs du groupement.
Mais ces salariés sont ainsi placés dans une situation de grande précarité puisque aucune obligation d’embauche en CDI n’est prévue et que le salarié mis à disposition, contrairement à l’intérimaire, ne perçoit précisément pas de prime de précarité. Une fois de plus, on rogne en modifiant le cadre juridique !
Quant à l’ouverture du groupement d’employeurs aux collectivités, elle permet, à l’évidence, de généraliser l’externalisation des emplois, au détriment des emplois publics, que vous vous êtes par ailleurs donné pour tâche de supprimer dans le cadre de la RGPP.
Enfin, les dispositions concernant les stages et le contrat de sécurisation professionnelle, sont, malgré leur titre alléchant, largement insuffisantes.
La situation des stagiaires n’est nullement améliorée. Ainsi, il n’y a pas trace, dans ce texte, de revalorisation de la gratification accordée aux apprentis ni de l’ouverture de droits à cotisation pour la retraite ou le chômage.
Le contrat de sécurisation professionnelle, quant à lui, n’est en réalité qu’un aménagement du licenciement économique. Il ne permet pas de prévenir ou d’éviter un licenciement : il ne fait qu’offrir un parcours d’accompagnement pour une reconversion. Il n’apporte aucune garantie d’emploi ultérieur. Parler de sécurisation professionnelle est donc largement exagéré !
Pour toutes ces raisons, nous voteront contre cette proposition de loi.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à l’évidence, la proposition de loi pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels était, au regard de la situation des jeunes sur le marché de l’emploi, importante et, surtout, attendue.
Avec un taux de chômage des 15-24 ans qui s’élève à 23, 2 % au premier trimestre 2011, notre pays, vous le savez, se situe largement au-dessus de la moyenne européenne, qui est de 20, 6 %. Ce taux double dans certains quartiers ; les jeunes femmes, en particulier, sont dans une situation très difficile. Mais je n’insiste pas sur ces chiffres : ils sont largement connus et ne font pas l’objet de contestations.
Reconnaissons que, face à cette situation, les formations en alternance présentent de réels avantages pour l’insertion professionnelle des jeunes. Le Président de la République l’a d'ailleurs souligné à juste titre dans le discours qu’il a prononcé à Bobigny le 1er mars dernier.

En faisant se succéder périodes d’enseignement théorique et stages en entreprise, l’apprentissage ouvre aux jeunes les portes du monde du travail, leur permettant de gagner en autonomie et en maturité professionnelle et d’acquérir de l’expérience.
Je crois que l’avantage du système, lorsqu’il est appliqué à bon escient, bien entendu, n’est plus à démontrer.

D'ailleurs, ces formations sont efficaces si l’on se réfère au taux d’embauche des élèves à l’issue de ces cycles : 70 %.

Pourtant, reconnaissons aussi, pour porter un jugement équilibré, que ces formations peinent encore à attirer les jeunes. Les entreprises françaises se montrent réticentes : elles ne sont, vous le savez, que 33 % à y avoir recours, contre 60 % des entreprises allemandes.
À l’évidence, le présent texte était l’occasion d’améliorer le canal de l’alternance pour favoriser l’insertion des jeunes.
Nous approuvons certaines de ses mesures, comme la fusion du contrat de transition professionnelle et de la convention de reclassement personnalisé pour les salariés victimes d’un licenciement économique, ou encore l’encadrement des stages, qui ne sont trop souvent qu’un avatar de la précarité.
Je regrette, en revanche, certaines lacunes et insuffisances. Non seulement cette proposition de loi n’est pas le grand texte sur l’emploi des jeunes que nous attendions et qu’elle aurait pu être, mais elle aboutit de surcroît, par certaines de ses dispositions, à dévaloriser les conditions de l’apprentissage et de l’alternance.
Je voudrais souligner trois de ces insuffisances.
D’abord, l’article 4 du texte fait craindre un risque de précarisation, en prévoyant que le renouvellement d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée est possible, au-delà des situations déjà prévues par la loi – échec à l’examen, maladie, accident du travail… –, pour préparer « une qualification supérieure ou complémentaire ». Comme cela a été dit, le danger est que les formations soient découpées artificiellement en diverses mentions « complémentaires » – ce terme est d’ailleurs, par nature, imprécis – pouvant durer jusqu’à trente-six mois sans déboucher sur un contrat à durée déterminée.
Au final, vous risquez de créer les conditions de la vulnérabilité et de l’insécurité en permettant aux employeurs de disposer d’une main-d’œuvre précarisée, non comptabilisée dans les seuils d’effectifs sociaux.
Ensuite, l’article 6 quinquies, crée un risque de dévalorisation de l’apprentissage, en le rendant désormais possible à partir de 14 ans. Nous l’avions déjà dénoncé lors de l’examen du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale, car il s’agit de facto d’une remise en cause de deux principes essentiels : la scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans et le fait qu’un jeune puisse ne puisse travailler qu’à partir de cet âge.
Monsieur le ministre, mon but n’est pas de vous faire un procès d’intention, …

… mais, franchement, cet archaïsme n’a, selon nous, rien à faire dans un texte du XXIe siècle !

Faut-il en revenir aux combats de Charles Dupin, qui, alors qu’il siégeait dans cette même maison, publia en 1840 un rapport fameux sur le travail des enfants et ouvrit ainsi la voie à l’instauration, dans notre pays, d’un âge légal du travail ?
Nous voulons protéger le travail des mineurs car, personne ne peut le nier, les conditions de travail sont aujourd’hui encore, dans un certain nombre de métiers, trop souvent mauvaises, avec des rythmes et des horaires excessifs ou inadaptés.
Mais surtout, au-delà du recul social qu’elle représente, cette disposition dévalorise l’apprentissage : ne craignez-vous pas en effet que les jeunes âgés de 14 ans et en situation d’échec scolaire ne soient relégués systématiquement, par facilité, vers cette voie, qui n’a pourtant pas vocation à remplacer l’éducation ?
Mme Raymonde Le Texier approuve.

En résumé, ce texte n’est pas de nature à répondre à l’enjeu essentiel que représente l’emploi des jeunes parce qu’il manque cruellement d’ambition, alors que de véritables avancées étaient possibles si l’on s’en était donné les moyens.
Je pense notamment à la formation, sujet qui me tient particulièrement à cœur. La proposition de loi tend à ajouter, dans la négociation triennale de branche sur la formation professionnelle, la valorisation de la fonction de « maître d’apprentissage », mais il n’est toujours pas question d’une véritable formation des maîtres d’apprentissage, pourtant demandée par l’Union professionnelle artisanale.
Ensuite, comment ne pas s’interroger sur le décalage entre les promesses du Président de la République, l’annonce d’un grand texte sur l’emploi des jeunes, et les moyens alloués à cette réforme ? Actuellement, 600 000 jeunes sont formés en alternance, dont 418 000 en contrat d’apprentissage. L’objectif proclamé par le chef de l’État, soit 800 000 jeunes formés en alternance, représenterait un milliard d’euros. Or, sauf erreur de ma part, le projet de loi de finances rectificative pour 2011 y consacre à peine 70 millions d’euros !
De notre point de vue, le vote des conclusions de cette commission mixte paritaire entérinera un rendez-vous manqué, alors que diverses mesures auraient pu enrichir ce texte.
L’orientation des jeunes aurait d’abord pu être améliorée par une information plus adéquate sur les métiers et les filières de l’alternance.
La lutte contre les ruptures de contrat et les abandons aurait dû être renforcée, de même que la lutte contre les discriminations dont souffrent les jeunes candidats à l’apprentissage, notamment lorsqu’ils sont issus des quartiers difficiles.
Il appartenait également au législateur d’organiser l’insertion professionnelle des jeunes en les menant sur les chemins de la connaissance, en favorisant la stabilité plutôt que la flexibilité et la précarité.
Je regrette sincèrement, mes chers collègues, que cette occasion ait été manquée.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, d’une part, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d’autre part, étant appelé à se prononcer après l’Assemblée nationale, le Sénat procède à un vote unique sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
PROPOSITION DE LOI POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ALTERNANCE ET LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS
TITRE IER
DÉVELOPPEMENT DE L’ALTERNANCE
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Après l’article L. 6231-4 du code du travail, il est inséré un article L. 6231-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6231-4-1. – Les centres de formation d’apprentis délivrent aux apprentis qui y sont inscrits la carte portant la mention : Étudiant des métiers prévue à l’article L. 6222-36-1. »
(Texte de l’Assemblée nationale)
Après l’article L. 6325-6-1 du même code, il est inséré un article L. 6325-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6325-6-2. – Une carte portant la mention : “Étudiant des métiers” est délivrée par l’organisme ou le service chargé de leur formation aux personnes qui sont mentionnées au 1° de l’article L. 6325-1 du présent code et dont le contrat de professionnalisation a pour objet d’acquérir une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 335-6 du code de l’éducation et comporte une action de professionnalisation, au sens de l’article L. 6325-11 du présent code, d’une durée minimale de douze mois. Cette carte permet à son titulaire de faire valoir sur l’ensemble du territoire national la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d’accéder à des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l’enseignement supérieur.
« La carte d’étudiant des métiers est établie conformément à un modèle déterminé par voie réglementaire. »
(Suppression maintenue)
(Texte du Sénat)
I. – Après l’article L. 6222-5 du code du travail, il est inséré un article L. 6222-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6222-5-1. – Par dérogation à l’article L. 6221-1 et au second alinéa de l’article L. 6222-4 et pour l’exercice d’activités saisonnières au sens du 3° de l’article L. 1242-2, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat d’apprentissage avec toute personne éligible à ce contrat en application des articles L. 6222-1 et L. 6222-2. Par dérogation à l’article L. 6211-1, ce contrat peut avoir pour finalité l’obtention de deux qualifications professionnelles sanctionnées par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
« Une convention tripartite signée par les deux employeurs et l’apprenti est annexée au contrat d’apprentissage. Elle détermine :
« – l’affectation de l’apprenti entre les deux entreprises au cours du contrat selon un calendrier prédéfini, ainsi que le nombre d’heures effectuées dans chaque entreprise ;
« – les conditions de mise en place du tutorat entre les deux entreprises ;
« – la désignation de l’employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par l’apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage.
« Le premier alinéa de l’article L. 6222-18 est applicable, à l’initiative de l’apprenti ou de l’un des employeurs, pendant deux mois à compter du début de la première période de travail effectif chez cet employeur.
« L’apprenti bénéficie d’un maître d’apprentissage, au sens de l’article L. 6223-5, dans chacune des entreprises.
« Le contrat peut être rompu, dans les conditions prévues à l’article L. 6222-18, à l’initiative des deux employeurs ou de l’un d’entre eux, lequel prend en charge les conséquences financières d’une rupture à ses torts. »
II. – La section 1 du chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du même code est complétée par un article L. 6325-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6325-4-1. – Pour l’exercice d’activités saisonnières au sens du 3° de l’article L. 1242-2, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat de professionnalisation à durée déterminée avec toute personne mentionnée au 1° de l’article L. 6325-1, en vue de l’acquisition d’une ou, par dérogation à l’article L. 6325-1, de deux qualifications mentionnées à l’article L. 6314-1.
« Une convention tripartite signée par les deux employeurs et le titulaire du contrat est annexée au contrat de professionnalisation. Elle détermine :
« – l’affectation du titulaire entre les deux entreprises au cours du contrat selon un calendrier prédéfini ;
« – la désignation de l’employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par le titulaire aux actions et aux enseignements mentionnés à l’article L. 6325-13 ;
« – les conditions de mise en place du tutorat.
« La période d’essai prévue à l’article L. 1242-10 est applicable au début de la première période de travail effectif chez chacun des employeurs.
« Ce contrat peut être rompu, dans les conditions applicables aux contrats à durée déterminée, à l’initiative de chacune des parties, laquelle prend en charge les conséquences financières éventuelles de cette rupture. »
(Texte du Sénat)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6224-5 est abrogé ;
2° Après l’article L. 6252-4, il est inséré un article L. 6252-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6252-4-1. – Sans préjudice des prérogatives de l’administration fiscale résultant de l’article 230 H du code général des impôts, les agents chargés du contrôle de la formation professionnelle continue en application de l’article L. 6361-5 du présent code sont habilités à contrôler les informations déclarées par les entreprises aux organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 au titre de la contribution supplémentaire à l’apprentissage prévue à l’article 230 H du code général des impôts, selon les procédures et sous peine des sanctions prévues au chapitre II du titre VI du livre III de la présente partie. Aux fins de ce contrôle, les entreprises remettent à ces agents tous documents et pièces justifiant le respect de leur obligation.
« À défaut, les entreprises versent au comptable public par décision de l’autorité administrative les sommes mentionnées à la seconde phrase du V de l’article 230 H du code général des impôts. Ce versement est recouvré conformément à l’article L. 6252-10. »
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi et dans les départements définis par arrêté du ministre chargé de l’apprentissage, la mission des médiateurs prévus à l’article L. 6222-39 du code du travail est étendue à l’accompagnement de l’entreprise ou de l’apprenti dans la mise en œuvre de la réglementation relative à l’apprentissage par les entreprises artisanales et industrielles, commerciales et de services qui accueillent un ou plusieurs apprentis.
(Suppression maintenue)
(Texte de l’Assemblée nationale)
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement des formations en apprentissage dispensées au sein de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics.
(Texte du Sénat)
Après l’article L. 332-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 332-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-3-1. – Des périodes d’observation en entreprise d’une durée maximale d’une semaine peuvent être proposées durant les vacances scolaires aux élèves des deux derniers niveaux de l’enseignement des collèges ou aux élèves des lycées, en vue de l’élaboration de leur projet d’orientation professionnelle. Dans l’exercice de leurs compétences, les chambres consulaires apportent leur appui à l’organisation de ces périodes. »
(Texte du Sénat)
Au 2° de l’article L. 4153-1 du code du travail, après les mots : « lorsqu’ils suivent », sont insérés les mots : « des périodes d’observation mentionnées à l’article L. 332-3-1 du code de l’éducation ou ».
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Après le troisième alinéa de l’article L. 332-4 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des aménagements particuliers permettent, durant les deux derniers niveaux de l’enseignement des collèges et dans le cadre de dispositifs d’alternance personnalisés, une découverte approfondie des métiers et des formations ainsi qu’une première formation professionnelle. Ces aménagements comprennent notamment le suivi de stages dans les conditions définies à l’article L. 332-3, ainsi que de stages dans des centres de formation d’apprentis et des sections d’apprentissage. »
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
« Après l’article L. 6222-12 du code du travail, il est inséré un article L. 6222-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6222-12-1. – Par dérogation à l’article L. 6222-12, un jeune âgé de seize à vingt-cinq ans, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire, peut, à sa demande, s’il n’a pas été engagé par un employeur, suivre en centre de formation d’apprentis ou en section d’apprentissage une formation visant à l’obtention d’une qualification professionnelle mentionnée à l’article L. 6211-1, dans la limite d’un an et des capacités d’accueil du centre ou de la section fixées par les conventions mentionnées aux articles L. 6232-1 et L. 6232-7.
« Il bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle.
« Lors des périodes réservées à la formation en entreprise, le centre de formation d’apprentis ou la section d’apprentissage organise à son intention des stages professionnalisants en entreprise.
« Une même entreprise ne peut accueillir un jeune en stage plus d’une fois par an.
« À tout moment, le bénéficiaire du présent article peut signer un contrat d’apprentissage d’une durée comprise entre un et trois ans et réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation. »
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
À titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les contrats de professionnalisation peuvent être conclus par un particulier employeur, sous réserve d’un accompagnement de ce dernier adapté aux spécificités de son statut.
Un accord de branche étendu détermine :
1° L’accompagnement adapté du particulier employeur ;
2° Les conditions de financement de la formation du salarié et du particulier employeur ;
3° L’organisme collecteur paritaire agréé chargé de financer cette formation.
Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de cette expérimentation avant son terme.
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le chapitre VI du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6326-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « préparation opérationnelle à l’emploi », il est inséré le mot : « individuelle » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « à durée indéterminée ou » sont remplacés par les mots : « d’une durée minimale de douze mois, un contrat d’apprentissage ou » ;
2° Il est ajouté un article L. 6326-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6326-3. – La préparation opérationnelle à l’emploi collective permet à plusieurs demandeurs d’emploi de bénéficier d’une formation nécessaire à l’acquisition des compétences requises pour occuper des emplois correspondant à des besoins identifiés par un accord de branche ou, à défaut, par un conseil d’administration d’un organisme collecteur paritaire agréé.
« Le contrat de travail qui peut être conclu à l’issue de la préparation opérationnelle à l’emploi collective est un contrat à durée indéterminée, un contrat de professionnalisation d’une durée minimale de douze mois, un contrat d’apprentissage ou un contrat à durée déterminée d’une durée minimale de douze mois.
« La formation est financée par l’organisme collecteur paritaire agréé compétent. L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et le fonds mentionné à l’article L. 6332-18 peuvent également contribuer au financement de la formation dans des conditions fixées par une convention avec l’organisme collecteur paritaire agréé.
« Pour les demandeurs d’emploi âgés de moins de vingt-six ans, la formation peut être dispensée dans un centre de formation d’apprentis. »
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Après l’article L. 6324-5 du code du travail, il est inséré un article L. 6324-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6324-5-1. – La durée minimale des périodes de professionnalisation s’élève, sur douze mois calendaires et pour chaque salarié en bénéficiant, à trente-cinq heures pour les entreprises d’au moins cinquante salariés et à soixante-dix heures pour les entreprises d’au moins deux cent cinquante salariés.
« Cette durée minimale ne s’applique pas au bilan de compétences ni à la validation des acquis de l’expérience.
« Elle ne s’applique pas aux périodes de professionnalisation des salariés âgés d’au moins quarante-cinq ans. »
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
La section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Contrat d’apprentissage préparant au baccalauréat professionnel
« Art. L. 6222-22-1. – Un apprenti engagé dans la préparation d’un baccalauréat professionnel peut, à sa demande ou à celle de son employeur, au terme de la première année du contrat, poursuivre sa formation en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle, un certificat d’aptitude professionnelle agricole ou un brevet professionnel agricole.
« Lorsque la spécialité du certificat d’aptitude professionnelle, du certificat d’aptitude professionnelle agricole ou du brevet professionnel agricole appartient au même domaine professionnel que celle du baccalauréat professionnel initialement visée, la durée du contrat d’apprentissage est réduite d’une année.
« Un avenant au contrat d’apprentissage, précisant le diplôme préparé et la durée du contrat correspondante, est signé entre l’apprenti, ou son représentant légal, et l’employeur.
« Il est enregistré dans les conditions fixées au chapitre IV du présent titre. »
TITRE IER BIS
ENCADREMENT DES STAGES
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Stages en entreprise
« Art. L. 612-8. – Les stages en entreprise ne relevant ni de l’article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie telle que définie par la sixième partie du même code font l’objet entre le stagiaire, l’entreprise d’accueil et l’établissement d’enseignement d’une convention dont les modalités sont déterminées par décret.
« Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire selon des modalités définies par décret.
« Ils ne peuvent pas avoir pour objet l’exécution d’une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l’entreprise.
« Art. L. 612-9. – La durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder six mois par année d’enseignement. Il peut être dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, au bénéfice des stagiaires qui interrompent momentanément leur formation afin d’exercer des activités visant exclusivement l’acquisition de compétences en liaison avec cette formation.
« La limite de six mois ne s’applique pas aux stages de longue durée intégrés dans le cursus des formations de l’enseignement supérieur.
« Art. L. 612-10. – L’accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n’est possible qu’à l’expiration d’un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent. Cette disposition n’est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu avant son terme à l’initiative du stagiaire.
« Art. L. 612-11. – Lorsque la durée de stage au sein d’une même entreprise est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages font l’objet d’une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n’a pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail.
« Art. L. 612-12. – Les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles mentionnées à l’article L. 2323-83 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.
« Art. L. 612-13. – L’entreprise qui accueille des stagiaires tient à jour un registre des conventions de stage, indépendamment du registre unique du personnel mentionné à l’article L. 1221-13 du code du travail. Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les mentions qui figurent sur le registre susmentionné. »
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 1221-13 est complété par les mots : «, indépendamment du registre des conventions de stage mentionné à l’article L. 612-13 du code de l’éducation » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2323-83, les mots : « ou de leur famille » sont remplacés par les mots : «, de leur famille et des stagiaires ».
III. – L’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances est abrogé.
IV. – À la fin de la première phrase du 3° de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles et au 8° du II de l’article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances » est remplacée par la référence : « L. 612-8 du code de l’éducation ».
(Texte du Sénat)
L’article L. 1221-24 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « à l’issue » sont remplacés par les mots : « dans les trois mois suivant l’issue » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d’essai. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le stagiaire est embauché par l’entreprise à l’issue d’un stage d’une durée supérieure à deux mois, au sens de l’article L. 612-11 du code de l’éducation, la durée de ce stage est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté. »
TITRE II
DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI DANS LES GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Les articles 7 A à 10 bis de la présente loi entrent en vigueur au 1er novembre 2011. Un accord collectif national conclu avant cette date peut déroger aux dispositions de ces articles.
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L’article L. 1253-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils garantissent l’égalité de traitement, en matière de rémunération, d’intéressement, de participation et d’épargne salariale, entre le salarié du groupement et les salariés des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition. »
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L’article L. 1253-20 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1253-20. – Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d’une collectivité territoriale ne peuvent constituer l’activité principale du groupement. Le temps consacré par chaque salarié aux tâches effectuées pour le compte des collectivités territoriales adhérentes ne peut excéder, sur l’année civile, la moitié de la durée du travail contractuelle ou conventionnelle, ou à défaut légale, calculée annuellement. »
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – L’article L. 8241-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une opération de prêt de main-d’œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition. »
II. – L’article L. 8241-2 du même code est complété par treize alinéas ainsi rédigés :
« Le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
« 1° L’accord du salarié concerné ;
« 2° Une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l’identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse ;
« 3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
« À l’issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail dans l’entreprise prêteuse sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.
« Les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l’entreprise utilisatrice.
« Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.
« La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d’un mandat représentatif.
« Pendant la période de prêt de main-d’œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise prêteuse n’est ni rompu, ni suspendu. Le salarié continue d’appartenir au personnel de l’entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté son travail dans l’entreprise prêteuse.
« Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’entreprise prêteuse sont consultés préalablement à la mise en œuvre d’un prêt de main-d’œuvre et informés des différentes conventions signées.
« Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise prêteuse est informé lorsque le poste occupé dans l’entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés mentionnée au second alinéa de l’article L. 4154-2.
« Le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel de l’entreprise utilisatrice sont informés et consultés préalablement à l’accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêts de main-d’œuvre.
« L’entreprise prêteuse et le salarié peuvent convenir que le prêt de main-d’œuvre est soumis à une période probatoire au cours de laquelle il peut y être mis fin à la demande de l’une des parties. Cette période probatoire est obligatoire lorsque le prêt de main-d’œuvre entraîne la modification d’un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du prêt de main-d’œuvre, à l’initiative de l’une des parties, avant la fin de la période probatoire, ne peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif de sanction ou de licenciement. »
TITRE III
CONTRAT DE SÉCURISATION PROFESSIONNELLE
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
La sous-section 2 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Contrat de sécurisation professionnelle
« Art. L. 1233-65. – Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise.
« Ce parcours débute par une phase de pré-bilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l’évolution des métiers et de la situation du marché du travail.
« Ce parcours comprend des mesures d’accompagnement, notamment d’appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.
« Art. L. 1233-66. – Dans les entreprises non soumises à l’article L. 1233-71, l’employeur est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.
« À défaut d’une telle proposition, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l’employeur verse à l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.
« Cette contribution, dont le montant est déterminé par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5427-1 selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422-16. Les données nécessaires au recouvrement sont transmises entre l’institution et les organismes. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 1233-67. – L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
« Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis, ni indemnité compensatrice de préavis, ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l’employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l’article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.
« Après l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire ne peut se prévaloir des articles L. 6323-17 et L. 6323-18. La somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation multiplié par le montant forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 6332-14 est affectée au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle.
« Pendant l’exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle.
« Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1233-68, sans que cela ait pour effet de modifier son terme.
« Art. L. 1233-68. – Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie définit les modalités de mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle, notamment :
« 1° Les conditions d’ancienneté pour en bénéficier ;
« 2° Les formalités afférentes à l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et les délais de réponse du salarié à la proposition de l’employeur ;
« 3° La durée du contrat de sécurisation professionnelle et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés intéressés, notamment par la voie de périodes de travail effectuées pour le compte de tout employeur, à l’exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée prévus à l’article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation à l’article L. 1243-13, et des contrats de travail temporaire prévus à l’article L. 1251-7 ;
« 4° Le contenu des mesures mentionnées à l’article L. 1233-65 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en œuvre par l’un des organismes assurant le service public de l’emploi, y concourant ou y participant mentionnés aux articles L. 5311-2 à L. 5311-4 ;
« 5° Les dispositions permettant d’assurer la continuité des formations engagées durant le contrat de sécurisation professionnelle ;
« 6° Les modalités de reprise éventuelle du contrat de sécurisation professionnelle après son interruption du fait d’une reprise d’emploi ;
« 7° Les obligations du bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle et les conditions dans lesquelles le contrat peut être rompu, en cas de manquement à ces obligations, à l’initiative des organismes chargés de la mise en œuvre des mesures mentionnées au 4° ;
« 8° Le montant de l’allocation et, le cas échéant, des incitations financières au reclassement servies au bénéficiaire par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, ainsi que les conditions de suspension, d’interruption anticipée et de cumul de cette allocation avec d’autres revenus de remplacement ;
« 9° Les conditions dans lesquelles les règles de l’assurance chômage s’appliquent aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle, en particulier les conditions d’imputation de la durée d’exécution du contrat sur la durée de versement de l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 ;
« 10° Les conditions dans lesquelles participent au financement des mesures prévues au 4° :
« – l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 ;
« – les employeurs, par un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes, et par un versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire en application de l’article L. 6323-1 et non utilisés.
« À défaut d’accord ou d’agrément de cet accord, les modalités de mise en œuvre et de financement du contrat de sécurisation professionnelle sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 1233-69. – L’employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par :
« 1° Un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes ;
« 2° Un versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire en application de l’article L. 6323-1 et non utilisés.
« Ces versements, dont le montant est déterminé par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, sont recouvrés par les organismes chargés du recouvrement mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5427-1 selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422-16. Les données nécessaires au recouvrement sont transmises entre l’institution et les organismes. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.
« Les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation peuvent affecter des ressources collectées à ce titre aux mesures de formation prévues à l’article L. 1233-65.
« Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l’article L. 6332-18 peut contribuer au financement de ces mesures de formation.
« Les régions peuvent contribuer au financement de ces mesures de formation dans le cadre de la programmation inscrite dans le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l’article L. 214-13 du code de l’éducation.
« Art. L. 1233-70. – Une convention pluriannuelle entre l’État et des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel détermine les modalités de l’organisation du parcours de retour à l’emploi mentionné à l’article L. 1233-65 et de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des mesures qu’il comprend. Cette convention détermine notamment les attributions des représentants territoriaux de l’État dans cette mise en œuvre et les modalités de désignation des opérateurs qui en sont chargés.
« Une convention pluriannuelle entre l’État et l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 détermine les modalités de financement du parcours de retour à l’emploi mentionné à l’article L. 1233-65 et des mesures qu’il comprend. Une annexe financière est négociée annuellement entre l’État et l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1.
« À défaut de ces conventions, les dispositions qu’elles doivent comporter sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° AA L’article L. 1235-16 est abrogé ;
1° AB Au 1° de l’article L. 3253-8, au second alinéa de l’article L. 3253-18-5 et au quatrième alinéa de l’article L. 3253-21, les mots : « de la convention de reclassement personnalisé » sont remplacés par les mots : « du contrat de sécurisation professionnelle » ;
1° AC Au 3° de l’article L. 3253-8, les mots : « proposée la convention de reclassement personnalisé » sont remplacés par les mots : « proposé le contrat de sécurisation professionnelle », et les mots : « cette convention » sont remplacés, deux fois, par les mots : « ce contrat » ;
1° AD Au premier alinéa de l’article L. 5422-16, les mots : « prévues aux articles L. 1233-69, L. 1235-16 » sont remplacés par les mots : « et versements prévus aux articles L. 1233-66, L. 1233-69 » et les mots : « recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « recouvrés et contrôlés » ;
1° AE Au troisième alinéa de l’article L. 5427-1, les mots : « mentionnées aux articles L. 1233-69, L. 1235-16 » sont remplacés par les mots : « et versements mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69 » ;
1° A Au premier alinéa de l’article L. 5428-1, les mots : « La convention de reclassement personnalisé » sont remplacés par les mots : « L’allocation perçue dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle » ;
1° À la seconde phrase de l’article L. 6323-19, la référence : « L. 1233-65 » est remplacée par la référence : « L. 1233-66 » et la référence : « L. 1233-66 » est remplacée par la référence : « L. 1233-67 » ;
2° À la fin du second alinéa de l’article L. 6341-1, les références : « aux articles L. 1233-68 et L. 1233-69 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 1233-68 ».
I bis. –
Supprimé
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 131-2, au b du 4° de l’article L. 135-2, au 2° de l’article L. 351-3 et au e du 2° de l’article L. 412-8, la référence : « L. 321-4-2 » est remplacée par la référence : « L. 1233-68 » ;
1° bis Au premier alinéa de l’article L. 311-5, la référence : « de l’article L. 321-4-2 » est remplacée par la référence : « au 8° de l’article L. 1233-68 » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 142-2 et au 5° de l’article L. 213-1, après le mot : « contributions », est inséré le mot : «, versements », le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et la référence : « L. 321-4-2 » est remplacée par les références : « L. 1233-66, L. 1233-69 ».
II bis A. – Au dernier alinéa de l’article 14 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, les mots : « à une convention de reclassement personnalisé mentionnée » sont remplacés par les mots : « au contrat de sécurisation professionnelle mentionné ».
II bis. – Le recouvrement de la contribution due par l’employeur en cas de non proposition du contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que des versements à sa charge au titre du financement de ce contrat, prévus respectivement aux articles L. 1233-66 et L. 1233-69 du code du travail, est effectué par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 dudit code jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2013. La contribution et les versements exigibles avant la date mentionnée ci-dessus continuent à être recouvrés, à compter de cette date, par l’institution mentionnée ci-dessus selon les règles, garanties et sanctions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
III. – Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d’application de l’article 11 de la présente loi, la convention de reclassement personnalisé et le contrat de transition professionnelle restent applicables selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, sous réserve des stipulations des accords collectifs conclus en application de l’article L. 1233-68 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation peuvent affecter des ressources collectées à ce titre aux mesures de formation mises en œuvre dans le cadre de conventions de reclassement personnalisé ou de contrats de transition professionnelle. Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l’article L. 6332-18 du code du travail peut contribuer au financement de ces mesures de formation.
IV. – L’ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l’expérimentation du contrat de transition professionnelle est abrogée au 31 décembre 2012.
V. – Les articles 11 et 12 de la présente loi ne s’appliquent pas à Mayotte.
(Texte du Sénat)
Après l’article 2 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. – Les mineurs de seize ans révolus peuvent librement constituer une association.
« Sous réserve d’un accord écrit préalable de leur représentant légal, ils peuvent accomplir tous les actes utiles à son administration, à l’exception des actes de disposition. »
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Après le septième alinéa (4°) de l’article L. 5112-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, le Conseil national de l’emploi peut être consulté et émettre un avis par voie écrite ou électronique. »
(Suppression maintenue)

Je vais maintenant appeler en discussion l’amendement qui a été déposé par le Gouvernement.

Sur les articles 1er bis à 6 septies, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.

L’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 7, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, ainsi que dans le cas des stages qui sont prévus dans le cadre d’un cursus pluriannuel de l’enseignement supérieur
II. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le ministre.
Comme je l’ai expliqué lors de la discussion générale, cet amendement vise à respecter l’accord national interprofessionnel du 7 juin dernier, qui permet notamment de donner toute sa portée au plafond de six mois pour la durée des stages, tout en encadrant par décret les conditions des dérogations possibles.
Monsieur le président, puisque je m’exprime certainement pour la dernière fois sur ce texte, vous me permettrez de remercier tout particulièrement les sénateurs et sénatrices qui sont intervenus, à un titre ou à un autre, à un stade ou à un autre de l’examen de cette proposition de loi.
Je conclurai en exprimant également une pensée toute particulière à l’intention de celles et de ceux d’entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, qui ont pris la parole pour la dernière fois dans cet hémicycle au cours de ces dernières semaines, dans la mesure où ils ne se représenteront pas aux prochaines élections sénatoriales. Je tiens à leur dire ma reconnaissance, quelles que soient les travées sur lesquelles ils siègent.

Cette modification est tout à fait utile, car elle respecte bien l’esprit de la négociation entre les partenaires sociaux et permet de beaucoup mieux encadrer les stages. J’émets donc un avis très favorable.

Sur les articles 6 decies à 13 bis, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.

Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à Mme Isabelle Debré, pour explication de vote.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi de revenir sur un point de cette proposition de loi, que Sylvie Desmarescaux a déjà évoqué : il concerne les jeunes de plus de 16 ans qui désirent créer une association, et ils sont nombreux à vouloir s’engager dans la vie associative. C’est ce qui m’avait amenée à déposer, en commission, un amendement tendant à faciliter cet engagement.
L’article 15 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ratifiée par la France, dispose que « les États parties reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique ». Mais la loi de 1901, texte fondateur en matière de droit d’association, est muette à ce sujet, si bien que nul ne sait clairement où passe la frontière entre le licite et l’illicite.
Actuellement, trois circulaires du ministère de l’éducation nationale, de mars et avril 1991 ainsi que de septembre 1992, limitent aux lycéens majeurs le droit de créer des associations, de les présider ou d’en être comptables, mais le ministère de l’intérieur a rappelé aux préfectures que le silence de la loi de 1901 n’autorisait pas à refuser l’enregistrement d’une association au motif que la demande était présentée par des mineurs. Il était donc nécessaire d’instituer un cadre juridique précis et sécurisé destiné aux mineurs de seize ans révolus, à leurs parents et aux tiers.
L’amendement que la quasi-unanimité des membres présents de la commission des affaires sociales a adopté prend en compte les critiques formulées en 2004 et en 2008 par le Défenseur des enfants, qui avait rappelé le droit reconnu aux mineurs de présider une association ou d’en être trésorier.
Avec ce dispositif, les mineurs de seize ans révolus pourront créer une association et l’administrer, dans les limites inhérentes à leur capacité juridique restreinte. Les articles 1990 et 1992 du code civil autorisent des mineurs à être mandataires, le mandant – c’est-à-dire l’association – répondant seul de leurs actes sur son patrimoine ; il convient donc d’autoriser les mineurs de seize ans révolus, ayant obtenu l’autorisation écrite de leur représentant légal, à effectuer les actes de la vie courante nécessaires à l’association. En revanche, seuls des majeurs pourraient intervenir pour des actes de disposition, par exemple, l’achat ou la vente de biens immobiliers.
Cette mesure renforcera les possibilités offertes à la jeunesse de faire l’apprentissage de l’action citoyenne et du sens des responsabilités, de participer à un projet collectif et de se forger ainsi des compétences et expériences parfaitement identifiables et valorisables dans un curriculum vitae.
Je tiens également à souligner que le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, a, quant à lui, reçu des assureurs la garantie qu’ils couvriraient les risques des associations concernées. Le droit est aujourd’hui clarifié et un cadre sécurisé juridiquement est ainsi offert, tant aux mineurs de 16 ans qu’à leurs parents et aux tiers.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP. – Mme Sylvie Desmarescaux applaudit également.

Monsieur le président, madame le ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, nos jeunes ont été particulièrement touchés par la crise économique. Cette situation n’a fait que mettre en lumière les difficultés d’insertion professionnelle et l’inadéquation de la formation par rapport à l’emploi.
Depuis trente ans, notre pays consacre une part importante de ses dépenses publiques à l’emploi des jeunes. Aujourd’hui, cependant, l’enjeu n’est pas tant l’accroissement de ces dépenses que la création de nouveaux dispositifs et, surtout, leur évaluation.
Aussi l’apprentissage apparaît-il comme une voie d’avenir et de succès. À ce jour, seulement un tiers des 16-20 ans passent par l’alternance et cette situation n’est pas satisfaisante.
Je crois pouvoir dire, mes chers collègues, que ce texte est le fruit d’une forme de coproduction législative exemplaire. Il s’inscrit dans les grandes orientations définies par le Président de la République dans son discours de Bobigny, le 1er mars dernier, mais également dans le droit-fil de l’engagement que celui-ci avait pris, lors de la campagne présidentielle, de généraliser le contrat de transition professionnelle. De fait, c’est ce que nous allons pouvoir réaliser grâce à l’adoption de cette proposition de loi.
Je voudrais saluer le travail de notre rapporteur, Sylvie Desmarescaux, dont la réflexion a enrichi un texte qui vient utilement compléter la réforme de la formation professionnelle, préparée notamment par une mission commune d’information sénatoriale et votée en 2009. Je pense en particulier au dispositif qui permet d’adapter les règles de l’apprentissage au baccalauréat professionnel en trois ans, afin d’éviter une diminution des contrats d’apprentissage.
Par ailleurs, ce texte apporte des réponses constructives aux problèmes d’accès au monde du travail auxquels sont confrontés les jeunes à la recherche d’un premier emploi, tout comme les salariés victimes d’un licenciement économique.
Il a également été enrichi par de nombreuses initiatives parlementaires et je voudrais saluer notamment celles de mes collègues Catherine Procaccia et Jean-Claude Carle, dont l’engagement en faveur du développement de la formation en alternance n’est plus à démontrer.
Enfin, en lien avec le processus législatif, un riche dialogue social s’est instauré : trois accords nationaux interprofessionnels auront ainsi été conclus en quelques mois pour aider les jeunes à mieux s’insérer dans la vie active. À ces accords s’ajoute celui qui est relatif au contrat de sécurisation professionnelle. Je suis heureux que nous ayons pu tenir compte de ces accords au cours de la discussion de cette proposition de loi, notamment avec l’adjonction de dispositions très importantes concernant les stages.
C’est donc avec conviction que le groupe UMP votera cette proposition de loi qui incarne la mobilisation de notre majorité pour lutter contre le chômage et la précarité chez les jeunes.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP. – Mme Sylvie Desmarescaux applaudit également.

Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifiée par l’amendement du Gouvernement.
La proposition de loi est adoptée définitivement.
Monsieur le président, je tiens à remercier tous les sénateurs présents qui ont voté cette proposition de loi dont de nombreux jeunes vont pouvoir bénéficier.
Je tiens également à m’associer aux propos tenus par mon collègue Xavier Bertrand pour souhaiter « bon vent » à tous ceux qui ne se représentent pas lors du prochain renouvellement du Sénat et, bien entendu, bonne chance à tous ceux d’entre vous qui se présenteront de nouveau, en septembre, aux suffrages des grands électeurs.
J’ai été ravie, en tant que membre du Gouvernement, d’avoir pu travailler avec vous sur des textes importants, dans les champs de compétence correspondant à mes différentes attributions ministérielles. Je me rappelle notamment la discussion de la loi sur les violences faites spécifiquement aux femmes, qui a donné lieu à un grand débat dans cet hémicycle…
… ou celle de la proposition de loi tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées.
Ce fut un grand honneur de travailler avec vous au service de la France et des Français !
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et au banc des commissions.

M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courriers en date du 13 juillet 2011, quatre décisions du Conseil sur des questions prioritaires de constitutionnalité (nos 2011-149 QPC, 2011-150 QPC, 2011-151 QPC et 2011-153 QPC).
Acte est donné de cette communication.

Je constate que le Sénat a épuisé son ordre du jour pour la session extraordinaire.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre communication du décret de M. le Président de la République portant clôture de la session extraordinaire du Parlement.
En conséquence, il est pris acte de la clôture de la session extraordinaire.
Applaudissements.

Je souhaite à toutes celles et tous ceux d’entre nous qui ne se représenteront pas en septembre une longue vie après le Sénat. J’ai été très heureux de travailler avec vous, mes chers collègues, dans le respect de nos différences. Si nous avons pu, parfois, engager des débats très vifs, nous avons toujours été animés par le souci de faire vivre notre démocratie parlementaire, ce qui me paraît essentiel.

Sauf élément nouveau, le Sénat se réunira le samedi 1er octobre, à quinze heures, avec l’ordre du jour suivant :
- installation du bureau d’âge ;
- ouverture de la session ordinaire 2011-2012 ;
- allocution du président d’âge ;
- scrutin à la tribune pour l’élection du président du Sénat.
Par ailleurs, je vous rappelle que le bureau du Sénat a décidé de célébrer le vendredi 30 septembre 2011, à onze heures, dans la salle des séances, le trentième anniversaire du vote par le Sénat de la loi abolissant la peine de mort.
M. le président du Sénat vous adressera un courrier vous précisant les modalités d’organisation de cette manifestation.
Pour l’heure, je vous souhaite à tous le meilleur pour l’intersession d’été : aux uns de très bonnes vacances et aux autres, ceux qui se représentent en septembre aux élections sénatoriales, une très bonne campagne !
Applaudissements
La séance est levée à seize heures quinze.