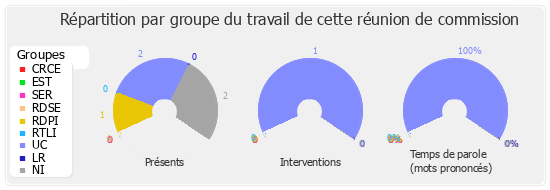Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation
Réunion du 20 février 2007 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion
La commission a procédé à l'audition de M. Patrick Sayer, président de l'Association française des investisseurs en capital (AFIC).

a indiqué que l'audition de M. Patrick Sayer, président de l'Association française des investisseurs en capital (AFIC), devait permettre à la commission de parfaire sa connaissance des mécanismes financiers internationaux actuellement à l'oeuvre.
A ce titre, il a précisé, tout d'abord, que l'AFIC regroupait des professionnels, sociétés d'investissement et fonds d'investissement, dont l'activité consistait à prendre des participations de moyen terme au capital des entreprises afin de réaliser une plus-value au moment de la cession de leurs parts.
Il a précisé que ses principaux « métiers » étaient :
- le « capital-risque », orienté vers les jeunes entreprises à la dimension technologique affirmée ;
- le « capital-développement », destiné à accompagner, de façon généralement minoritaire, des entreprises plus matures devant franchir un « cap de croissance » ;
- et le « capital-transmission », plus connu sous son appellation anglaise Leverage Buy Out (LBO), visant à acquérir, de façon presque toujours majoritaire, des entreprises avec un fort effet de levier, ce segment représentant environ 80 % des montants collectés en France.
a indiqué, d'une part, que les fonds d'investissement se voyaient actuellement reprocher une « recherche effrénée » de rentabilité les conduisant à mener des restructurations drastiques, au détriment de l'emploi domestique. D'autre part, il a observé que l'importance des montants collectés par certains fonds anglo-saxons leur donnait la faculté de conduire des offres publiques d'achat (OPA) sur de grands groupes cotés, au risque de transformer un fleuron de l'économie nationale en simple participation au sein de leur portefeuille d'actions.
Dans ce contexte, il a souhaité connaître l'incidence, d'un point de vue économique et social, des fonds d'investissement et l'évolution, à moyen terme, de leur rôle dans l'économie française.
a remercié la commission de lui donner ainsi l'occasion d'ouvrir le débat et de faire oeuvre de pédagogie sur une profession et un métier souvent décriés du fait, a-t-il estimé, d'une certaine incompréhension.
Il a rappelé que l'AFIC était une structure indépendante créée en 1984, regroupant l'ensemble des structures de « capital-investissement » installées en France. Il a noté qu'elle avait vocation à promouvoir le capital-investissement auprès des investisseurs institutionnels, des entrepreneurs et des pouvoirs publics. Il a souligné qu'elle se devait d'accompagner les entreprises depuis leur création jusqu'à leur transmission, par le travail de ses membres, qu'ils soient actifs ou associés, parmi lesquels des avocats, experts comptables, auditeurs, etc. Il a également indiqué qu'aux trois segments de métier exposés par M. Jean Arthuis, président, on pouvait ajouter les spécialistes du « capital-retournement », professionnels peu nombreux, mais dont l'écho médiatique était fort.
Il a précisé que le capital-investissement devait être clairement distingué des fonds de pension, dont le rôle était le financement des retraites, et incidemment le maintien d'un niveau de capitalisation important dans un pays. Il a noté que les fonds de pension n'existaient pas réellement en France, l'assurance-vie étant « leur parent le plus proche ».
Il a observé que les fonds de gestion alternative, appelés « hedge funds » (soit littéralement des « fonds de couverture »), généralement anglo-saxons, répondaient à des logiques différentes de celles du capital-investissement. En effet, leurs prises de participation dans des entreprises cotées ou leurs opérations sur des marchés de matières premières ou d'énergie obéissaient à un objectif de maximisation du profit à très court terme, les rémunérations de la performance étant fréquemment versées au mois le mois ou sur trois mois. Il a rappelé qu'à l'inverse, les adhérents de l'AFIC n'attendaient de retour sur investissement qu'à moyen terme, soit sur trois à sept ans.
a ajouté que les principales banques d'affaires françaises et internationales, récemment interrogées, estimaient que l'intervention des fonds d'investissement dans les opérations de fusion et d'acquisition de sociétés représenterait 40 % des sommes engagées d'ici à cinq ans, contre moins de 20 % actuellement.
Il a indiqué que 4.852 entreprises, dont 75 % comptaient moins de 250 collaborateurs, étaient soutenues par le capital-investissement en France en 2005. Il a souligné le rôle essentiel du capital-investissement auprès des petites et moyennes entreprises (PME), rappelant que, seules, 60 entreprises bénéficiant de financements dans le cadre du capital-investissement employaient plus de 5.000 personnes.
Il a précisé que le poids économique du capital-investissement représentait, d'une part, 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France en 2005, soit une croissance de 7 à 8 % entre 2004 et 2005 à périmètre constant et, d'autre part, 327 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisé dans le monde, soit une progression de 8 % sur la même période.
Il a noté que le capital-investissement représentait 1,5 million d'emplois de collaborateurs en France, soit l'équivalent des effectifs français des sociétés du CAC 40 et environ 10 % des effectifs du secteur privé. Il a constaté que ces effectifs avaient crû de 4 % entre 2004 et 2005, ce qui correspondait à une augmentation de 60.000 emplois. Il a reconnu qu'il ne s'agissait pas de créations nettes du fait des mouvements de cession et d'acquisition de filiales notamment, et qu'une étude plus fine de l'impact social du capital-investissement était en cours.
a annoncé que 1.250 nouvelles entreprises avaient bénéficié du financement de fonds d'investissement entre 2004 et 2005. Il a remarqué que le capital-investissement avait levé 12 milliards d'euros en 2005 en France, dont 8,1 milliards d'euros avaient permis de financer ces entreprises, en création, développement et transmission. Il a précisé la décomposition de l'activité du capital-investissement en 2005 : 78 % des montants investis, soit 6,3 milliards d'euros, avaient été attribués au capital-transmission, 12 % des montants investis, soit 954 millions d'euros, avaient concerné le capital-développement et 6 % des montants investis, soit 481 millions d'euros, avaient bénéficié au capital-risque. Le solde relevait d'activités plus marginales.
Il a observé que les 6,3 milliards d'euros investis dans le capital-transmission s'étaient répartis ainsi : 3 milliards d'euros en faveur de quatre grandes entreprises et 3,3 milliards d'euros au profit de 315 PME, soit un « ticket d'entrée » d'environ 10 millions d'euros par société. Il a constaté que, dans tous les cas de financement par LBO, les dirigeants avaient été associés au montage pour devenir actionnaires, dans 61 % des cas pour les cadres, et dans 20 % des cas pour les salariés. Il a estimé que ce phénomène prenait de l'ampleur, dans la mesure où les deux formes de capitalisme traditionnel, à savoir le capitalisme familial et celui des grands groupes industriels, à savoir le capitalisme d'Etat, trouvaient désormais leurs limites.
a ainsi relevé que le capitalisme familial, qui apportait certes des garanties de pérennité et de stabilité du capital des entreprises concernées, ne permettait pas de faire face à l'internationalisation des marchés et à l'européanisation des entreprises, et donc de leur faire franchir les paliers de croissance correspondants. S'agissant du capitalisme des grands groupes cotés, il a noté qu'il subissait une pression de court terme, liée à l'exigence de publication des comptes trimestriels, ainsi que le poids des agences de notation, ce qui conduisait fréquemment ces sociétés à se recentrer sur quelques métiers en fonction de leur compétitivité internationale. Il a constaté que, dans cette perspective, les grands groupes revendaient des pans entiers de leur activité qui pouvaient être, soit facilement rachetés et consolidés par des sociétés étrangères, soit soutenus par un apport en capital des fonds d'investissement.
Il a affirmé que le capital-investissement, et plus particulièrement les montages LBO, ne visaient pas à la restructuration systématique ni au démantèlement progressif des entreprises qu'ils finançaient, mais à la planification des investissements utiles à leur développement et à la création de valeur grâce à la mise en place de plans de croissance des ventes sur un horizon de trois à cinq ans. Il a rappelé que les fonds d'investissement soutenaient les entreprises en injectant les fonds nécessaires à leur développement en sus des sommes correspondant à l'acquisition des titres de capital.
Il a reconnu que les dirigeants de ces entreprises, trop souvent enclins, selon lui, à penser que les financements étaient abondants, étaient toutefois mis sous contrainte financière afin d'accroître leur vigilance sur le paiement des créances des clients, la gestion des stocks et la suppression des investissements non productifs. Il a ajouté que cela leur permettait de mieux apprécier le rendement individuel de chaque nouvel investissement, conformément aux intérêts propres des fonds de LBO. Il a remarqué que l'essentiel des opérations de capital-transmission s'accompagnait d'une augmentation des effectifs des entreprises rachetées, contrairement aux idées reçues.
a considéré que le risque de voir les fonds d'investissement déclencher des OPA sur de grandes sociétés cotées était en réalité moins important que celui du rachat de leaders français par de grands groupes étrangers, ainsi que l'illustraient certains exemples récents. Il a estimé que, dans de nombreux cas dans l'actualité récente, la mise en place d'une opération de LBO aurait permis de maintenir ces entreprises sous capitaux français, tout en augmentant le niveau d'investissement.
Evoquant le système des « noyaux durs » mis en place durant les privatisations des deux précédentes décennies, il a rappelé que, s'il était sain pour les grandes entreprises d'être sous la pression de leurs actionnaires, il était sans doute bénéfique qu'elles puissent disposer du soutien d'un actionnaire professionnel, tel qu'un fonds d'investissement, détenant une fraction, même minoritaire du capital, mais susceptible d'apporter une forme d' « insolence » et de s'engager dans une stratégie de moyen ou de long terme. La présence d'un tel actionnaire professionnel était, selon lui, préférable à un retour au principe des « noyaux durs ».
Cet exposé a été suivi d'un large débat.

s'est demandé quelle était la position de la Commission européenne sur les métiers du capital-investissement, compte tenu des postulats de libre-concurrence et d'ouverture du capital des entreprises qui tendaient à inspirer sa doctrine, et si d'autres sociétés et fonds d'investissement européens présentaient des niveaux de rentabilité semblables à ceux des véhicules de droit français.
En réponse, M. Patrick Sayer a indiqué que l'AFIC dialoguait régulièrement avec les services de la Commission européenne, en particulier sur la question de l'harmonisation de la réglementation des structures juridiques d'investissement, et que l'approche communautaire restait marquée par un fort tropisme anglo-saxon. Il s'est félicité de ce que M. Charlie McCreevy, commissaire pour le marché intérieur et les services, se soit récemment posé en défenseur du capital-investissement.
Il a relevé que près du quart des opérations de LBO en Europe étaient réalisées par des opérateurs français, mais que les fonds anglo-saxons étaient surreprésentés en volume sur ce segment et pouvaient investir dans certaines opérations de grande taille, compte tenu de leur faculté de solliciter des fonds de pension dotés de larges moyens, et dont l'équivalent n'existait pas en France. Il a cependant constaté qu'une réponse européenne se structurait face aux grands fonds américains : les structures françaises PAI, Eurazeo et Wendel tendaient ainsi à s'internationaliser, et un fonds d'investissement suédois tel qu'Investor, lié à la famille Wallenberg, détenait un portefeuille important de participations. La typologie des acteurs demeurait néanmoins sensiblement la même dans les différents pays européens.
Il a regretté que l'assurance-vie, fiscalement très aidée en France, ne soit pas davantage investie dans le capital-investissement, malgré l'accord négocié par M. Nicolas Sarkozy, alors qu'il était ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en vue d'atteindre un ratio de 2 % des encours de ce type de placement. Il a indiqué que l'exposition de l'assurance-vie au capital-investissement connaissait une hausse tendancielle, mais a déploré le périmètre extensif de comptabilisation par les compagnies d'assurance, qui retenaient non pas uniquement les sommes effectivement investies, mais également les engagements de déboursement sur le moyen terme et les participations dans leurs filiales non stratégiques chargées de fonctions support. Il a estimé que la part réelle des encours de l'assurance-vie dans le capital-investissement se situait aux alentours de 0,7 %, ce qui était encore loin de l'objectif recherché, et a fortiori de l'exposition d'un fonds de pension tel que l'américain Calpers, qui consacrait environ 10 % de ses actifs à la gestion alternative au sens large, c'est-à-dire au capital-investissement, pour 6 %, et aux fonds spéculatifs, pour 4 %.

s'est inquiété de l'impact potentiellement négatif des nouvelles normes prudentielles dans le secteur de l'assurance, en cours de négociation au niveau communautaire dans le cadre du projet de directive « Solvabilité II », qui tendraient à limiter l'exposition au capital-investissement, et de manière plus générale, à orienter une large fraction de l'épargne vers l'économie non productive, alors même que les liquidités prêtes à s'investir abondaient sur la plupart des places financières.
a constaté que ce projet de directive faisait parfois l'objet d'un double discours, dans la mesure où certains déploraient ses incidences sur les placements en actions, tandis que les compagnies d'assurance considéraient qu'il pouvait contrevenir à la nécessaire congruence entre l'actif et le passif. Il a considéré, néanmoins, que les actifs de capital-investissement étaient adaptés à l'adossement des engagements d'assurance-vie, compte tenu de leur horizon temporel, cohérent avec celui de l'assurance-vie, et de leurs performances élevées, de l'ordre de 18 % en moyenne pour le LBO.

a fait part de son vif intérêt pour un métier qu'il connaissait mal, et a formulé plusieurs questions portant sur la nature des propriétaires des sociétés et fonds d'investissement, sur les critères de choix par ces derniers des sociétés où investir, et sur la durée moyenne de détention des participations. Il s'est également interrogé sur le caractère coopératif ou conflictuel des rapports que les gestionnaires de ces fonds entretenaient avec les dirigeants des PME constituant leurs portefeuilles.
a indiqué que les modalités de détention des sociétés ou fonds d'investissement constituant les membres de l'AFIC étaient très diverses. Les sociétés d'investissement telles qu'Eurazeo appartenaient ainsi à leurs actionnaires, individuels, familiaux, ou issus du marché boursier lorsqu'elles étaient cotées. En réponse à M. Jean Arthuis, président, qui s'interrogeait sur la part des actionnaires stables au capital d'Eurazeo, il a précisé que ces derniers représentaient environ 40 % du capital et 50 % des droits de vote.
Il a ajouté que l'essentiel de la profession était constitué de fonds, dont les capitaux étaient apportés par des souscripteurs individuels et institutionnels, tels que les banques, les fonds de pension, les caisses de retraite et les compagnies d'assurance. A la différence des sociétés d'investissement, la détention du capital d'un fonds n'emportait pas le contrôle de la société de gestion de ce fonds. Ces sociétés de gestion étaient, en effet, généralement des sociétés de personnes ne requérant que peu de capital, qui était détenu par les associés, et pouvaient être totalement indépendantes ou liées à un acteur financier tel qu'une banque, un assureur ou une société de gestion étrangère.
Il a jugé que la qualité d'une équipe de gestion reposait, avant tout, sur son réseau et sa connaissance des dossiers, qui déterminaient le volume du « deal flow », soit le flux d'affaires, véritable facteur-clef de succès de la profession. La qualité de ce flux d'affaires - qui s'inscrivait dans une tendance à la spécialisation par secteur d'activité - était liée à l'expérience des gestionnaires, à leur connaissance personnelle des opportunités d'investissement, comme aux dossiers parfois transmis par les banques d'affaires.

a relevé que les banquiers avaient fait évoluer leur rôle, en se positionnant davantage comme conseillers et apporteurs d'opérations à des fonds, plutôt que comme prêteurs et financeurs directs des PME.
a confirmé que les banques d'affaires, jusqu'au début des années 80, investissaient de manière plus directe dans le capital des sociétés, et éventuellement par l'octroi de prêts. Puis, abordant la question des rapports entre les fonds actionnaires des sociétés et les dirigeants de ces dernières, il a considéré qu'ils étaient positifs par construction. Il a ainsi établi une analogie avec l'équipage d'un bateau : le dirigeant, en tant que « skipper », devait fonctionner en bonne intelligence avec le fonds actionnaire principal, assimilable au « pilote » installé à terre et chargé d'orienter le cap et les choix du skipper. Cet alignement des intérêts du dirigeant et de l'actionnaire devait, selon lui, être fortifié par une prise de participation substantielle du dirigeant dans le capital de sa société, susceptible de représenter un à deux ans de salaire brut, et de nature à accroître sa motivation et son implication en vue d'une amélioration de la performance de la société.
Il a indiqué que les opérations des fonds de LBO reposaient sur un « business plan » ou plan d'activité, établi en général sur un horizon de 3 à 5 ans. Les sorties plus précoces, après un ou deux ans seulement de détention, auxquelles on assistait souvent aujourd'hui, résultaient, selon lui, de deux principaux facteurs exogènes et conjoncturels, qui étaient la forte progression des valorisations boursières et le maintien des taux d'intérêt à un niveau bas. Cette conjonction de facteurs facilitait un relèvement des leviers financiers et une augmentation des multiples d'investissement. Elle permettait par exemple de réaliser, après seulement deux ans de détention, des plus-values représentant trois à quatre fois l'investissement initial. Il a ajouté que cette accélération de la rotation des participations, dans les portefeuilles des fonds de LBO, s'effectuait sans changement managérial à la tête des sociétés concernées.

a remercié M. Patrick Sayer pour ses précisions et a évoqué la situation d'Usinor, société où l'Etat français détenait une participation substantielle avant la constitution d'Arcelor par fusion avec Arbed et Aceralia, et la délocalisation de son siège au Luxembourg, essentiellement pour des raisons fiscales. Il a indiqué que les cadres d'Arcelor qu'il avait rencontrés regrettaient que le capital du groupe fût devenu vulnérable, et s'est demandé si, depuis la disparition des « noyaux durs » au cours des années 90, le capitalisme français n'était pas passé d'un excès à l'autre, de la « consanguinité » des dirigeants représentatifs de ces « noyaux durs » à une trop grande fragilité de l'actionnariat.
a considéré qu'au-delà du cas particulier évoqué, il était avéré que certains groupes industriels créaient « leur propre mauvaise graisse » par un train de vie somptuaire et des dépenses de fonctionnement excessives, de nature à les rendre plus vulnérables à des acquisitions hostiles. Dans ce contexte, les montages caractéristiques du LBO contribuaient à assainir des sociétés mal gérées. Il a déploré, en outre, le caractère parodique des assemblées générales d'actionnaires de certaines sociétés cotées, durant lesquelles l'accent était mis sur les apparences de la gouvernance, des sujets relativement anecdotiques, et la promotion d'administrateurs indépendants qui ne réunissaient pas toutes les garanties de compétence, au détriment du débat sur la question fondamentale de la stratégie et de la gestion de la société.
Puis, en réponse à une observation de M. Jean Arthuis, président, sur les pratiques abusives de rachat par les sociétés cotées de leur propre capital dans un objectif de relution du bénéfice par action, il a estimé que ces rachats d'actions étaient légitimes, dès lors qu'ils demeuraient bornés. Il a indiqué que les entreprises devaient poursuivre un objectif d'optimisation du coût de leur capital, et qu'il pouvait, dès lors, se révéler préférable de rendre une partie de ce capital aux actionnaires, plutôt que de l'investir dans des projets insuffisamment rentables.

Revenant sur les propos de M. Jean Arthuis, président, quant à l'absence de risque inhérent aux stock-options et à l'effet incitatif que ces dernières pouvaient exercer sur les rachats d'actions, il s'est déclaré favorable à cette pratique, et il a considéré que les stock-options, à la différence des attributions d'actions gratuites dont le récent développement en France avait été initié par la société Microsoft, présentaient, malgré tout, le risque de voir leur valeur se réduire ou devenir nulle.
a relevé que le surplus de rémunération des dirigeants constitué par les stock-options n'était pas toujours inscrit en charges d'exploitation, mais que les nouvelles normes comptables internationales conduiraient, probablement, à faire évoluer ce mode de comptabilisation.
a précisé que, pour de nombreuses sociétés, les charges liées aux stock-options apparaissaient bien dans le compte de résultat. Abordant la question du soutien financier aux PME, il a estimé que les banques, pour qui le crédit aux petites entreprises constituait aujourd'hui une activité plus risquée que le crédit immobilier, participaient insuffisamment au financement des entreprises, qui étaient, dès lors, confrontées à certaines carences sur leur fonds de roulement.

a constaté que M. Patrick Sayer se présentait comme le régulateur de sa profession et le défenseur de l'investissement à moyen terme, et s'est demandé si cette posture pouvait résister au mouvement contemporain de financiarisation à l'échelle mondiale et de pression court-termiste. Evoquant les propos tenus par M. Michel Prada, président de l'Autorité des marchés financiers, lors de sa récente audition par la commission, sur l'utilité que pouvaient présenter les « hedge funds », il a souhaité connaître son opinion sur l'impact de ces fonds, dans la mesure où ils pouvaient être perçus comme une dérive ou, au contraire, comme les acteurs d'une profitable « redistribution des cartes ». Puis il a admis que les Français manifestaient une préférence pour l'épargne longue sans risque, et s'est demandé si l'action de l'Etat tendait à privilégier la rente et une économie qui serait moins dynamique, mais plus sûre.
a insisté sur le fait que la plupart des entreprises françaises n'étaient désormais plus confrontées à un marché exclusivement domestique, mais insérées dans une concurrence internationale, et qu'il importait d'accepter cette « nouvelle donne », ainsi que la mobilité croissante des produits et des informations, dont participait la révolution d'Internet. Il a constaté que les marchés financiers disposaient de liquidités en abondance, qui étaient alimentées par la croissance de l'économie chinoise et le recyclage des revenus du pétrole et des matières premières. Ces liquidités tendaient logiquement à se positionner sur les produits financiers offrant le rendement le plus attractif, au rang desquels figuraient les « hedge funds », créant un effet d'éviction des placements plus traditionnels. Il a également reconnu et fait remarquer la qualité et le très haut niveau des profils de nombre de gérants de fonds spéculatifs, et a suggéré que la commission puisse rencontrer de tels professionnels.
Il a considéré que le capital-investissement, à la différence des fonds spéculatifs, permettait de réintégrer une vision de moyen terme dans les anticipations des agents, selon une logique comparable à celle mise en oeuvre par les holdings et sociétés familiales durant la première moitié du vingtième siècle.

Puis, réagissant à l'hypothèse, émise par M. Jean Arthuis, président, que les sociétés ne recourent qu'à une publication simplement annuelle de leurs comptes, il a indiqué qu'un tel débat avait actuellement cours aux Etats-Unis quant à l'intérêt des comptes trimestriels. Il a estimé qu'un actionnaire du capital-investissement était vraisemblablement mieux à même d'apprécier la qualité et l'évolution d'une société que sur le seul fondement de comptes trimestriels.
a reconnu que les membres de la commission devaient être pleinement conscients des nouvelles réalités de la sphère financière. Il a déploré que la valeur ajoutée de certains fonds de capital-investissement, dont les participations étaient cédées après seulement un an de détention, mais avec une confortable plus-value, se révèle finalement très réduite, voire nulle. Il a également émis des doutes quant à la qualité de certains dirigeants associés à des opérations de LBO, dont les décisions pouvaient induire un coût social élevé.
a admis que la profession du capital-investissement, comme d'autres, comportait des exemples négatifs, et a considéré que les entreprises où ces investisseurs étaient présents se comportaient, en moyenne, mieux que le reste de l'économie.
Evoquant l'hypothèse où la dette publique de la France diminuerait à l'avenir, M. Yves Fréville s'est demandé si le surcroît d'épargne ainsi dégagé pourrait être aisément investi dans le capital-investissement national ou international. Se déclarant préoccupé par la situation d'Alcatel, il s'est également interrogé sur l'éventuelle surévaluation de la parité de fusion avec Lucent.
a estimé que, contrairement à une idée parfois admise, l'implication dans le moyen terme des actionnaires professionnels représentatifs de son activité leur permettait d'être plus au fait de la situation réelle des sociétés et de mieux anticiper sur leurs évolutions que certains groupes détenteurs à caractère industriel. Il a ajouté que les impératifs de court terme liés à la cotation en bourse tendaient à empêcher la réalisation de certains investissements pourtant nécessaires.
Il a indiqué que le soutien aux PME devait non seulement se traduire par une réorientation des actifs de l'assurance-vie, mais également par un accès privilégié aux marchés publics, qui permettrait d'assurer un chiffre d'affaires récurrent. La France devait ainsi, selon lui, s'aligner sur les procédures en vigueur dans certains pays, tels que le Canada, la Corée du Sud, les Etats-Unis ou le Japon, qui avaient obtenu le bénéfice, sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce, d'une clause d'exemption favorable aux PME. Il a déploré, en outre, que l' « ultralibéralisme » manifesté, à certains égards, par la Commission européenne, contribue à pénaliser l'investissement dans les PME.

a remercié M. Patrick Sayer pour son exposé à la fois stimulant et dérangeant, et a tenu à relever les initiatives que pouvaient prendre les professionnels du capital-investissement afin de résister aux « excès corrosifs » de la financiarisation.