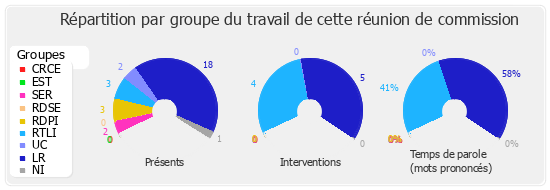Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
Réunion du 20 mai 2015 à 9h30
Sommaire
- Audition de m. pierre-jean luizard directeur de recherche au centre national de la recherche scientifique cnrs histoire de l'islam contemporain : aspects historiques et géopolitiques de daech (voir le dossier)
- Audition de mme myriam benraad chercheuse affiliée au ceri et associée à l'institut de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman iremam : sunnites et chiites au prisme de daesh (voir le dossier)
- Renforcement de la protection des installations civiles abritant des matières nucléaires
- Nomination d'un rapporteur (voir le dossier)
La réunion
Audition de M. Pierre-Jean Luizard directeur de recherche au centre national de la recherche scientifique cnrs histoire de l'islam contemporain : aspects historiques et géopolitiques de daech
Audition de M. Pierre-Jean Luizard directeur de recherche au centre national de la recherche scientifique cnrs histoire de l'islam contemporain : aspects historiques et géopolitiques de daech
La réunion est ouverte à 9 heures 30.

Nous recevons aujourd'hui M. Pierre-Jean Luizard, directeur de recherche au CNRS, spécialiste du Moyen-Orient, pour évoquer Daech.
On est assez surpris par la puissance qu'a acquise cette organisation en assez peu de temps. Vous avez vous-même parlé de « piège » dans l'un de vos ouvrages : il est très inquiétant de voir un mouvement historiquement récent atteindre un tel degré d'organisation, obtenir autant de résultats militaires, et attirer tant de jeunes Européens comme de jeunes Maghrébins.
C'est un sujet que nous avons eu l'occasion d'aborder avec le nouveau président tunisien. Beaucoup de jeunes Tunisiens ont le sentiment de trouver là une organisation qui répond à leur aspiration, leur confie des responsabilités et leur accorde une reconnaissance.
Il existe, en Irak comme en Syrie, une capacité de recrutement assez impressionnante. C'est pour nous un sujet de préoccupation majeure, et nous abordons ces questions avec une vision assez manichéenne, alors que les choses sont assez complexes. Que ce soit en Irak ou en Syrie, voire en Libye, tout ce qui s'est passé ces dernières années a servi ce type de cause.
Je vous propose donc de nous présenter vos réflexions dans leurs grandes lignes, avant que les commissaires ne vous interrogent.
Je confie à présent la présidence à Christian Cambon, vice-président, pour me rendre devant la commission des lois présenter nos amendements sur le texte relatif au renseignement.
- Présidence de M. Christian Cambon, vice-président -
On m'a demandé de solliciter l'histoire pour tenter d'expliquer comment l'État islamique, nouveau venu sur la scène politique, religieuse et militaire moyen-orientale, s'est imposé.
Je n'emploie pas le terme « Daech », auquel préfère celui d'« État islamique ». Le terme « Daech » est en effet très connoté, notamment au Moyen-Orient. En tant que chercheur, j'essaye d'étudier les objets de mes recherches de façon objective, tels qu'ils sont et non en les considérant tels qu'on voudrait qu'ils soient.
L'État islamique a sidéré les opinions occidentales, ainsi que beaucoup de chancelleries, de diplomaties occidentales et, bien au-delà, de dirigeants arabes. En juin prochain, cela fera un an que la ville de Mossoul, seconde ville d'Irak, qui compte plus de 2 millions d'habitants, est tombée entre les mains de l'État islamique en Irak et au Levant, ainsi que s'appelait à l'époque cette organisation.
Très peu de monde pensait qu'un an plus tard, l'État islamique serait toujours présent à Mossoul et aurait agrandit son territoire jusqu'à revendiquer plus d'un tiers de l'Irak, après l'avoir rabouté, au-delà des frontières, au territoire syrien qu'il contrôle.
La force de l'État islamique n'est pas militaire. C'est pourquoi toute démarche visant à le vaincre militairement, sans accompagner ces campagnes d'un volet politique, est vouée à l'échec. L'État islamique peut reculer dans certains secteurs, il avancera dans d'autres. Il peut même être éradiqué de certaines zones en Irak et en Syrie, il renaîtra, car ce qui fait les raisons de son expansion et du succès sont des circonstances politiques exceptionnelles que nous vivons sans les avoir anticipées pour différentes raisons. En effet, les diplomaties reconnaissent les États en place et les frontières existantes ; il est très difficile pour elles d'anticiper la remise en cause d'un ordre étatique, même si c'est bien sur ce terreau que prospère l'État islamique.
Je vais rapidement revenir, à travers trois temporalités, sur les causes de l'expansion fulgurante, selon une expression désormais consacrée, de l'État islamique depuis juin 2014 - en fait depuis décembre 2013, l'État islamique ayant commencé à cette date à constituer son territoire en Syrie en boutant les forces de Jabhat al-Nosra, son grand concurrent salafiste et djihadiste en Syrie, hors des villes de Raqqa et de Deir ez-Zor. Cette portion de territoire continue le long de la vallée de l'Euphrate est la première que l'État islamique a revendiquée. Il y a ajouté, en janvier 2014, bien avant la date de son expansion fulgurante, l'occupation de la ville de Falloujah, ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants, une des plus grandes de la province d'al-Anbâr, qui n'est qu'à une soixantaine de kilomètres de la capitale irakienne.
Il y avait là de quoi se poser certaines questions, d'autant qu'au fil des semaines et des mois, le gouvernement central de Bagdad a semblé incapable de reprendre cette ville. Une fois de plus, nous avons fait comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas là de quoi s'interroger sur ce qui faisait la force de cette organisation qui défiait un État aussi proche de son siège. Il a fallu attendre la date fatidique de juin 2014, époque à laquelle tout a basculé, pour s'apercevoir qu'il n'était plus possible de faire l'autruche et ne pas reconnaître ce nouvel acteur étatique révolutionnaire, sans frontière, qui défiait non seulement les institutions irakiennes, mais également toutes celles au-delà.
Le 10 juin 2014, contre toute attente, les avant-gardes armées de l'État islamique s'emparent de Mossoul et déferlent le long de la frontière de la vallée du Tigre, et occupent une grande partie de la province de Ninive, avec Mossoul, et de Salah ad-Din, avec Tikrit. Ils arrivent à quelques dizaines de kilomètres de Bagdad, avec le projet de prendre la ville en étau entre la province orientale de Diyala, frontalière avec l'Iran - ville multiethnique et multiconfessionnelle, où l'on trouve des Arabes, des Kurdes, des Turkmènes, des Chiites et des Arabes sunnites - et, à l'ouest, la province d'al-Anbâr, à majorité arabe et sunnite.
C'est, on le voit, un véritable changement de la carte politique de l'Irak, qui s'explique par le triomphe dans ce pays d'un jeu communautaire, aux dépens des institutions officielles. Ce jeu communautaire, il a d'abord été celui d'un gouvernement toujours reconnu internationalement, issu d'élections que nous avons voulu croire démocratiques, alors qu'elles sanctionnaient en fait une majorité démographique. Les Américains ont en effet tenté, à partir de 2003, de reconstruire un État irakien à partir des appartenances non pas politiques, mais communautaires, ethniques et confessionnelles.
Aujourd'hui, tous les partis politiques irakiens ont disparu au profit de partis confessionnels chiites, kurdes et sunnites.
Nous n'avons pas voulu voir que le gouvernement central, légitimement reconnu, faisait régner sur les zones qu'il contrôlait, peuplées par une majorité arabe sunnite, une situation invivable, qui faisait paraître l'armée officielle irakienne comme une armée d'occupation, minée par la corruption. Sur le papier, on trouvait 30 000 combattants, soldats et policiers mais, selon une pratique très répandue jusqu'à ce jour, les soldats et les gradés donnaient une partie de leur solde à leurs supérieurs pour ne pas apparaître sur le terrain. Quand l'État islamique s'est présenté aux portes de Mossoul, il y avait trois fois moins de soldats que prévu pour défendre la ville. Ces derniers avaient été largement conditionnés par l'État islamique, qui avait diffusé, sur Internet, des vidéos de crucifixion et de décapitation de soldats. S'il existe un gouvernement irakien, il n'existe pas d'État. Ce pseudo-État s'est donc effondré, l'armée ayant déserté Mossoul, comme elle l'a fait pour Ramadi il y a quelques jours, sans combattre, comme si, pour une armée à majorité chiite, pour sa base ou pour sa direction militaire, mourir pour un territoire considéré comme étranger ne servait à rien.
Le système politique que le gouvernement irakien a imposé à la population, majoritairement sunnite, était un système de clientélisme meurtrier. Les gangs de quartiers faisaient régner la terreur sur la ville, avec l'aval du gouverneur, frère du vice-président sunnite irakien actuel, qui organisait des réseaux de corruption généralisée, suscitant des pénuries artificielles de denrées alimentaires de première nécessité pour faire flamber les prix, ayant la haute main sur les réseaux commerciaux de la ville, et s'en prenant aux habitants qui se rebellaient contre ce système, avec plusieurs dizaines d'exécutions extrajudiciaires.
Ces informations n'ont pas été relayées, les diplomaties ne chargeant pas les États ou les régimes qu'elles reconnaissent aux dépens d'acteurs non-étatiques. C'est toutefois quelque chose qu'il faut prendre en considération si l'on veut comprendre comment l'État islamique a été localement reçu par la population, lorsque les villes sont tombées les unes après les autres. L'État islamique n'aurait pu investir une ville de plus de deux millions d'habitants sans un soutien local populaire massif ! Les djihadistes, lorsqu'ils se sont emparés de Mossoul, ont été considérés comme des libérateurs.
L'État islamique s'est fait fort d'instaurer un État de droit qui a vite été comparé à l'État de non-droit qui régnait lorsque le gouvernement officiel de l'Irak faisait régner sa loi sur les villes arabes sunnites. Certaines actions de la lutte de l'État islamique contre la corruption ont été très largement médiatisées. En l'espace de quelques jours, les marchés ont été approvisionnés, et les prix parfois divisés par deux ou trois. La chasse contre la corruption généralisée a été très cruelle, avec des décapitations et des crucifixions en place publique. C'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit.
Pour beaucoup d'habitants des villes conquises par l'État islamique, l'État de non-droit était représenté par le gouvernement, alors que l'État islamique représente un État de droit, même s'il ne s'agit pas des droits de l'homme, mais d'un droit basé sur la Charia, revu et revisité par un regard salafiste. Pour ceux qui ne s'opposaient pas à l'État islamique, il y a eu, dans les premiers mois, un sentiment d'amélioration notable d'une situation devenue intolérable.
L'État central ne représentait donc plus que des partis communautaires religieux chiites. Par ailleurs, même s'il n'en a guère été fait état dans les médias, du fait de nos rapports amicaux avec le gouvernement régional kurde, lorsque l'État islamique s'est emparé de Mossoul, la direction kurde a joué un double jeu, notamment à travers la personne de Massoud Barzani, chef du parti démocratique du Kurdistan, qui s'opposait à l'Union patriotique du Kurdistan sur la question de savoir comment agir face aux rumeurs insistantes qui laissaient entendre que l'État islamique s'apprêtait à lancer une offensive sur Mossoul.
Massoud Barzani a proposé ses services à Nouri al-Maliki, chef du gouvernement irakien. Vous vous souvenez certainement que Nouri al-Maliki avait de très mauvais rapports avec les dirigeants kurdes, qu'ils soupçonnaient à juste titre de vouloir profiter de la menace djihadiste pour s'emparer des territoires disputés. C'est ce qui va se passer, au terme d'un accord ponctuel entre Massoud Barzani, une fois que le Gouvernement de Nouri al-Maliki lui aura fermé la porte au nez, prévoyant un partage des territoires conquis sur l'armée irakienne en déroute : Mossoul et sa plaine à l'État islamique, Kirkouk et sa région, ainsi qu'une partie des régions de Diala, au sud du Kurdistan, aux Kurdes.
C'est bien ce qui va se passer, le double jeu de la direction kurde devant permettre à l'État islamique de s'approcher de Bagdad. C'est seulement quand Bagdad sera directement menacée qu'il va y avoir une volte-face, sous la pression des proches de Jalal Talabani et de l'Union patriotique du Kurdistan, qui s'oppose à cette alliance avec les djihadistes. Ceci va remettre sur les rails l'alliance des Kurdes avec le gouvernement central de Bagdad, à majorité chiite, et bloquer toute avance des djihadistes sur la route de Bagdad, avec une prise en tenaille par les Peshmergas kurdes au nord et, de l'autre côté, par les milices chiites qui vont sauver Bagdad d'une occupation par l'État islamique, fin juin 2014.
C'est une première temporalité à court terme, mais il en existe une seconde, qui explique le succès de l'État islamique. Il s'agit de l'échec, depuis 2003, de la reconstruction politique sous patronage américain. Comme je l'ai dit, cette reconstruction politique s'est faite « à la libanaise » et au nom d'un communautarisme qui, contrairement au Liban, était inavoué.
À l'exception du fait ethnique kurde, gravé dans le marbre de la Constitution et reconnu à travers le fédéralisme, on ne trouve nulle part mention des Chiites et des Sunnites. Pourtant, pas un seul poste au sein du gouvernement ou de l'administration irakienne qui ne soit multiplié par trois ! Il existe un premier ministre chiite, deux vice-premiers ministres, sunnite et kurde, un président kurde et deux vice-présidents, sunnite et chiite. Tout est ainsi, si bien que les ministères irakiens ont très souvent accueilli à leur tête des gens qui ne sont pas placés là pour leurs compétences. Un ministre de la culture restera probablement dans l'histoire pour avoir surtout été chef de gang et de milice plutôt que ministre de la culture. Chacun a été promu en fonction d'un rapport de force négocié entre les trois grandes communautés du pays.
Ce système s'est trouvé à rebours du système précédent, sous lequel l'Irak a vécu entre 1920 et 2003, fondé par la Grande-Bretagne et qui donnait le monopole à des élites issues de la minorité arabe sunnite. Les Américains, face à la nécessité de la reconstruction, sans qu'il existe cependant un tropisme particulier en faveur des Kurdes ou des Chiites, se sont adressés aux exclus de l'ancien système.
C'est donc au duo branlant chiito-kurde que les Américains vont demander de reconstruire un État irakien. Le vice inhérent à ce type de système réside dans le fait qu'il fait toujours des exclus. Quand on est une minorité, on ne peut espérer autre chose qu'un statut de minorité, ce qui était évidemment inacceptable pour une communauté arabe sunnite, certes minoritaire en Irak, mais très largement majoritaire dans le monde arabe. Qui plus est, celle-ci avait monopolisé le pouvoir à Bagdad depuis toujours.
C'est en 2003, pour la première fois de l'histoire, que les Arabes sunnites perdent Bagdad. Leur destin, dans le système politique en place, qui ne pouvait être que celui d'une minorité marginalisée, sans pouvoir ni ressource, le pétrole et le gaz se trouvant majoritairement dans les zones chiites et kurdes, était inacceptable.
Ceci a été aggravé par l'échec des tentatives d'intégration des Arabes sunnites par les Américains grâce à la politique des conseils de réveil, qui visait à créer des réseaux de clientélisme en payant et en armant les ex-insurgés, à condition qu'ils se retournent contre al-Qaïda.
Lorsque les Américains ont quitté l'Irak, le Premier ministre irakien, Nouri al-Maliki, n'a pas tenu la promesse d'intégrer ces Arabes sunnites, qui constituaient l'élite militaire, même avant le régime de Saddam Hussein. Ceux-ci n'ont pas accepté la nouvelle situation, et ce sentiment d'exclusion s'est aggravé avec l'émergence des printemps arabes, qui ont eu également leur traduction en Irak.
C'est une chose que l'on ne sait pas : il y a eu en Irak, à partir de 2011, des mouvements pacifistes arabes sunnites, à Mossoul, Tikrit et Falloujah, qui entendaient protester contre l'autoritarisme de Nouri al-Maliki et contre la corruption et la marginalisation de leur communauté. Le gouvernement a choisi pour leur répondre d'utiliser l'artillerie lourde, de leur envoyer l'armée et d'utiliser les mêmes méthodes que celles que Bachar al-Assad utilisait contre son opposition, notamment avec le largage de barils bourrés de TNT sur des quartiers, des hôpitaux et des écoles considérés comme des bastions d'insurgés.
Il faut ajouter à cela le fait que l'embryon de classe politique arabe sunnite a été la cible d'accusations visant à l'éradiquer. La plus célèbre concerne le vice-président sunnite, Tareq al-Achemi, accusé en 2011 d'avoir voulu assassiner le Premier ministre. C'est fort possible : comme je l'ai dit, il n'existe pas d'État irakien. À Bagdad, chaque ministère dépend d'un parti communautaire, qui renvoie souvent à une base provinciale. Aucun ministre ne compte sur les services de l'État pour être protégé, mais sur ses propres milices. On a assez souvent assisté à des heurts entre milices, voire entre un ministre et un vice-ministre en désaccord.
Personnellement, je pense que Tareq al-Achemi n'était pas responsable de la tentative d'assassinat sur la personne du Premier ministre, mais que sa milice a dû se rendre coupable d'un certain nombre d'exactions. Toujours est-il que les Arabes sunnites, à partir de 2013, ont réalisé que leur intégration dans le système politique en place était devenue impossible.
C'est alors que l'État islamique en Irak et au Levant s'est présenté comme celui qui allait remédier à ces injustices. Les éléments de court terme et de moyen terme que j'ai mis en avant constituent une explication du basculement, à partir de 2013, d'une majorité arabe sunnite d'Irak, mais aussi de Syrie, qui s'est donnée à l'État islamique en Irak et au Levant. On va alors voir, pour la première de fois de l'histoire de l'Irak, la communauté arabe sunnite se détourner de l'État irakien.
Ce n'est pas parce que l'État islamique disposé d'armes et d'argent qu'il gagne. Si l'État islamique en Irak et au Levant rencontre de tels succès, c'est parce qu'il est confronté à l'effondrement d'institutions étatiques. Il se veut le porte-parole d'un processus et a été, de tous les protagonistes, le premier à proclamer la mort de l'État irakien par la médiatisation de l'effacement de la frontière dite Sykes-Picot entre la Syrie et l'Irak, à travers une vidéo mettant en scène l'action d'un bulldozer qui effaçait une frontière injuste, visant à présenter l'État islamique comme le justicier d'une histoire récente, mais également lointaine, durant laquelle la minorité arabe sunnite en Irak avait été victime d'injustices, faisant référence à la trahison des promesses des alliés au lendemain de la première guerre mondiale.
En effet, les alliés avaient promis au chérif Hussein de La Mecque la constitution d'un royaume arabe unifié sur l'ensemble de la grande Syrie, incluant le Liban, la Syrie actuelle, la Transjordanie et la Palestine, et une partie du territoire irakien, notamment Mossoul, s'il se révoltait contre les Turcs. L'armée chérifienne a bien libéré Aqaba, Jérusalem et Damas, mais les nationalistes arabes ignoraient que Français et Anglais étaient engagés dans une diplomatie secrète, qui a abouti à la division du Moyen-Orient en deux zones d'influence, française et britannique. Ces deux zones devaient donner naissance, en violation des promesses faites aux Arabes, non à un grand État arabe unifié, mais à des mini-États arabes, qui allaient être chacun dans la ligne de mire de minorités, chrétienne pour le Liban, arabe sunnite pour l'Irak et, plus tardivement, druze, ismaélienne et alaouite pour la Syrie.
Ma démarche n'est pas une démarche militante ; il ne s'agit pas pour moi de cibler un péché originel et de considérer que certains États s'effondrent ou connaissent des crises du fait de leur genèse coloniale. Non. Il existe des États d'origine coloniale qui ont évolué et qui ont réussi à offrir une citoyenne partagée à leur population. Tel n'a pas été le cas des États irakien, syrien et libanais. Le premier d'entre eux à s'effondrer et à laisser la voie à un nouveau protagoniste est l'État irakien.
L'État islamique revendique un héritage de l'histoire. On le sait, il n'y a pas d'histoire, sauf l'histoire du temps présent. On a donc tendance, ici et là, à instrumentaliser l'histoire. Cela étant, il faut demeurer très vigilant, car la diabolisation d'un adversaire aussi redoutable que l'État islamique peut nous empêcher de le voir tel qu'il est, c'est-à-dire comme une organisation certes terroriste, mais qui comporte aussi un projet politique qui fonctionne, un projet étatique qui le différencie d'al-Qaïda, et comme celui qui entend s'imposer sur la scène moyen-orientale en tant qu'adversaire d'États prédateurs et répressifs, que ce soit en Syrie ou en Irak. C'est là une des suites des printemps arabes, qui ont permis à des sociétés civiles, convergentes parfois, mais maintenant le plus souvent divergentes, de s'exprimer. D'une certaine façon, on peut dire que l'État islamique est un monstre, mais qu'il peut en partie légitimement s'autoproclamer héritier des printemps arabes.

Merci de nous avoir brossé un portrait à la fois très documenté et très inquiétant du développement de l'État islamique dans cette région du monde.
Que l'Occident doit-il faire face à cette situation ? Il y a encore quelques semaines, l'État islamique apparaissait « en peau de panthère ». Les cartes qui viennent d'être publiées dans la presse aujourd'hui même montrent un État géographiquement constitué.
L'attitude des Américains laisse pantois : ils affirment que, malgré la perte de Ramadi, tout va bien, que la guerre contre Daech continue et que la situation va se retourner. L'Europe et la France regardent tout cela avec interrogation et inquiétude.
Vous avez beaucoup parlé de l'Irak et de la Syrie, mais on pourrait parler de ce qui se passe en Libye, plus proche de nos frontières.
De votre point de vue, compte tenu de la connaissance particulièrement aiguë que vous avez de cette situation, que l'Occident doit-il faire ? Doit-on assister aux événements en attendant qu'ils s'achèvent ? Cela finira-t-il jamais ? L'État islamique ne négocie rien et ne tend aucunement la main pour parler de quoi que ce soit. Certains pays sont menacés, comme la très fragile Jordanie, qui croule sous le poids des réfugiés. L'Arabie saoudite peut également être parmi les prochains pays menacés.
C'est une question difficile, à laquelle il n'y a pas de réponse totalement satisfaisante, mais il existe quand même plusieurs certitudes que nous devrions prendre en compte.
Tout d'abord, le système étatique moyen-oriental que nous avons connu ne renaîtra pas de ces cendres. La question est donc de savoir quoi faire face à des États comme l'État irakien, qui sont en phase d'effondrement.
Je peux illustrer ce dilemme à travers une initiative américaine récente. Les Américains ont compris, je crois, - même s'il existe des divergences au Congrès entre républicains et démocrates - que l'armée irakienne ne fait pas le poids devant l'État islamique, et qu'il vaut mieux s'adresser directement aux Kurdes et aux Arabes sunnites.
Un vote d'intention récent du Congrès américain envisageait l'armement des forces armées kurdes et d'une garde nationale arabe sunnite, comme s'il s'agissait d'ethnies indépendantes, sans passer par le gouvernement central irakien. Vous imaginez la levée de boucliers de la part des officiels irakiens et, plus précisément, des Chiites qui se veulent, parce qu'ils sont majoritaires en Irak mais qu'ils se savent minoritaires à l'échelle du monde arabe, les derniers gardiens du temple de l'État irakien !
La réaction de Moqtada al-Sadr a été extrêmement véhémente : il a en effet menacé directement les Américains, s'ils mettaient en application, je cite, « leur plan américano-sioniste de division de l'Irak sur des bases confessionnelles ». À sa suite, on a vu le Premier ministre irakien Haïder al-Abadi dénoncer ce plan, et l'ayatollah al-Sistani a surenchéri en disant combien il réprouvait une telle initiative.
La question se pose effectivement : existe-t-il une solution politique dans le cadre des institutions irakiennes actuelles ? Je ne le pense pas. Le gouvernement irakien ne représente plus l'ensemble de la population irakienne. Même si l'on trouve des Kurdes au sein du gouvernement, ils n'y sont que pour des raisons tactiques, et force est de constater qu'ils ne représentent pas l'immense majorité des Arabes sunnites qui, malgré quelques défections, continuent à prêter allégeance à l'État islamique.
C'est donc un gouvernement, plus qu'un État, qui représente une partie de la société, et surtout des partis religieux chiites, et qui, même s'il le voulait, ne pourrait s'ouvrir. On a beaucoup glosé sur les pressions occidentales sur Nourine al-Maliki, visant à l'inciter à inclure les Arabes sunnites dans le gouvernement. Toutefois, on n'a pas pris en compte le fait que Nourine al-Maliki n'avait pas les moyens d'imposer son autorité. Même qu'il avait voulu les inclure, il ne le pouvait pas. Tout ce qu'il donne aux uns, ils le retirent en effet aux autres, c'est-à-dire à sa propre base « politique », et plutôt confessionnelle.
Ce système « à la libanaise », qui fonctionne déjà très mal au Liban, ne peut fonctionner dans le cadre de communautés aussi importantes que les trois grandes communautés irakiennes. La question qui se pose pour les diplomaties occidentales est de savoir si elles doivent ou non reconnaître que l'action militaire ne mènera à rien, sinon à renforcer l'État islamique, qui nous présente comme une coalition de « croisés dirigée contre l'islam ».
La question se pose aussi de savoir jusqu'où aller dans la reconnaissance de l'autonomie par rapport à un gouvernement qui n'est plus représentatif des Kurdes, ni des Arabes sunnites. Cela a déjà été le cas lorsque nous avons reçu des généraux kurdes. On ne dissociera pas les Arabes sunnites de l'État islamique si on ne leur offre pas mieux que l'État islamique. Or, l'État islamique, localement, a donné le pouvoir aux acteurs locaux, ce qui constitue ce qu'une tribu ou un quartier peut désirer dans le contexte actuel. Tant qu'on ne fait pas mieux et qu'on n'apporte pas un projet politique à une communauté qui s'estime à juste titre discriminée, il n'y aura pas de résultat, encore moins si notre action se limite à des bombardements aériens.

Vous avez fait le choix de parler de « l'État islamique » ; or, depuis plusieurs mois, nous avons fait le choix d'éliminer le mot d'« État » et de parler de « Daech ». Je crois qu'il serait bon de maintenir ce choix car, vous l'avez dit, ce n'est ni un État de droit, ni un État de non-droit. Prononcer le mot d'État, c'est déjà le reconnaître !
En second lieu, vous avez estimé qu'il ne s'agissait pas d'une organisation militaire. Néanmoins, ils ont tout ce qu'il faut pour constituer une force militaire : des armes, de l'argent pour acheter les troupes, ce qu'ils font, y compris chez nous. L'arsenal est grand !
Il ne faut donc pas se cacher derrière cet argument : ce n'est pas une organisation militaire. Néanmoins, ils se battent sur le terrain avec des armées, des armes et des moyens, sans compter l'Internet, qu'ils maîtrisent largement.
Vous avez raison de dire qu'il s'agit d'un ordre nouveau : à nous, en termes politiques d'essayer de mieux le percevoir et mieux le définir, et surtout d'étudier ce que peut devenir la dynamique qu'il a créée.
Par ailleurs, Daech n'est pas né de rien, en décembre 2013. J'aurais aimé que vous analysiez davantage les origines de ce monstre. Qui a participé à sa naissance ? On le sait un peu, mais c'est une première analyse à réaliser.
En second lieu, quel a été le rôle de la communauté internationale ? Je suis surprise que vous parliez des Chiites, des Sunnites, et que vous n'évoquiez jamais l'Iran, l'Arabie saoudite, la Turquie, voire la Russie !
Je connais bien la Turquie et le problème des Kurdes. Il faut évoquer le rôle de ce pays, notamment par rapport aux Kurdes. Vous parlez en permanence de l'Irak ; je ne centrerai pas tout sur l'Irak, puisqu'il n'en restera bientôt plus rien. Néanmoins, ce sont les Kurdes de Syrie et d'Irak qui se battent sur le terrain, et non ceux de Turquie.
J'étais à Kobané il y a deux semaines. J'y suis entrée par la Turquie. Il faudrait étudier le rôle de la Turquie de plus près. On a tous vu ces images, à quelques kilomètres de Kobané, des troupes turques qui ne participaient pas à la guerre.
Kobané, ville de 200 000 habitants, est maintenant détruite. Les 50 000 réfugiés qui en étaient partis sont aujourd'hui revenus. La Turquie empêche aujourd'hui l'aide humanitaire de passer. Il faut donc que la communauté internationale réclame très vite un couloir humanitaire. La vie de 50 000 réfugiés, dans Kobané et les villages voisins, en dépend. C'est cette analyse des perspectives politiques qu'il faudrait faire !

Votre analyse de la genèse de l'État islamique est juste, mais il ne faut pas ignorer le rôle qu'ont pu jouer le Qatar et l'Arabie saoudite dans son financement. Il n'est par ailleurs pas concevable que les services de renseignement américains n'aient pu prévois que 200 000 kilomètres carrés allaient être occupés par cette force.
Il ne faut pas non plus ignorer un aspect politique de l'État islamique, qui réside dans le fait que beaucoup d'officiers baasistes encadrent aujourd'hui l'État islamique. Les tribus irakiennes ont également joué un rôle important.
Personne ici ne sait qu'il y a eu des escarmouches et des morts entre le PDK et l'UPK. Le gouverneur de Mossoul se trouve aujourd'hui à Erbil. C'est un Orient un peu compliqué que celui-là !
Il faut également évoquer la volonté américaine de supprimer tous les gouvernements exprimant le nationalisme arabe, qui ont partout disparu. C'est un point majeur.
Je rejoindrai enfin Mme Durrieu pour dire qu'on ne peut oublier l'aspect militaire des choses. On déplore quand même un certain nombre de morts ! On compte bien entendu des Peshmergas parmi ceux qui ont combattu, mais aussi des membres du PKK, et de son excroissance, le PID de Syrie, ainsi que des Iraniens. Même si l'on fait une analyse sociologique, on ne peut ignorer les horreurs commises par Daech, qu'il faut éradiquer.
Selon vous, l'Iran peut-il jouer un rôle majeur dans l'éradication de l'État islamique, si vous préférez employer ce terme, puisqu'il faut forcément des troupes au sol pour l'éliminer en Syrie et en Irak ?
En ce qui concerne l'appellation « Daech » ou « État islamique », vous vous souvenez tous qu'il y a eu débat au ministère des affaires étrangères, et que notre ministre avait demandé de pas utiliser le terme d'« État islamique », celui-ci suggérant que l'on reconnaissait à cette organisation les qualités d'État et d'islamique.
Je pense que c'est légitime pour vous, élus, mais cela ne l'est pas à un chercheur. Nous tentons de cerner une réalité. Rien ne sert de faire un tour de passe-passe pour diabolisation l'État islamique. Celui-ci a-t-il les qualités d'un État en formation ? J'en suis désolé, mais il les a ! Il a un pouvoir exécutif, avec le Calife, un pouvoir judiciaire, avec des réseaux de juges religieux qui rendent la justice et la font appliquer en fonction de la Charia. Il existe peu de pouvoirs législatifs, la Charia en faisant office, mais l'État islamique dispose aussi d'une armée, d'un système fiscal, où chacun paie des impôts en fonction de son statut confessionnel et de sa richesse, d'un drapeau.
Seule différence, l'État islamique ne veut pas de frontières. Ce n'est pas, ainsi qu'on l'a dit, un État avec lequel on peut imaginer un jour signer un traité de paix. C'est un État qui est en guerre contre les démocraties occidentales et contre les États de la région.
Utiliser le terme de « Daech » - qui veut d'ailleurs dire la même chose qu'« État islamique » en arabe - constitue donc une sorte de méthode Coué peu utile.
Enfin, pour ce qui est du terme « islamique », Daech est-il musulman ou non ? Je ne suis pas une autorité religieuse musulmane. Dès l'instant que quelqu'un me dit agir au nom de l'islam, je suis obligé de le croire. Force est de reconnaître qu'une majorité d'Arabes sunnites d'Irak fait allégeance à l'État islamique. En Syrie, et au-delà, au Liban, en Libye, au Yémen et dans le Sinaï, beaucoup de groupes salafistes, profitant de la crise de l'autorité religieuse dans l'islam sunnite, font aujourd'hui allégeance à l'État islamique. Rien ne me permet de dire qu'ils sont en dehors de l'islam.
Certes, l'État islamique est doté d'une organisation militaire et d'une puissance financière, mais on ne gagne par une guerre, on ne conquiert pas des territoires sans raisons politiques objectives. L'État islamique est né en 2006 en Irak, grâce à l'union de six ou sept groupes djihadistes salafistes, parmi lesquels al-Qaïda en Irak qui, à la différence de la Syrie, fait partie de l'État islamique. On y retrouve d'anciens baasistes, des tribus arabes sunnites, l'establishment religieux sunnite de l'époque de Saddam Hussein et des notables locaux, dont certains ont été retournés entre 2005 et 2008 pour les besoins des conseils de réveil.
On enregistre très peu de défections. C'est là aussi une chose qu'il faut prendre en compte. Les quelques tribus qui ont eu maille à partir, de façon sanglante et éradicatrice, avec l'État islamique sont des tribus très impliquées avec les Américains ou, en Syrie, très impliquées avec le régime de Bachar al-Assad.
Quant au rôle des États voisins et à la dimension communautaire du conflit en Irak, elle est confessionnelle - chiite et sunnite - et ethnique - arabe et kurde. Ce ne sont ni la Turquie, ni l'Iran, ni l'Arabie saoudite qui ont créé les contradictions dans lesquelles se débattent les Irakiens aujourd'hui. C'est véritablement un problème irakien. Il est vrai que les États de la région aggravent une situation déjà tendue, mais l'origine de la question irakienne se trouve en Irak, non à Riyad ou à Téhéran.
L'influence que les Iraniens ont en Irak est un peu à l'image de l'influence de l'État islamique dans ce pays. L'effondrement est la véritable cause du chaos que connaît aujourd'hui cet État. Tant qu'on ne traitera pas cette question, on ne pourra rien faire ? L'État irakien n'est d'ailleurs pas le seul à s'effondrer. D'autres, comme le Yémen, la Libye, ou la Somalie sont dans la même situation.
Une réflexion globale est probablement à engager : devons-nous continuer à faire la politique de l'autruche en continuant à reconnaître des gouvernements et des États qui, visiblement, ne sont plus représentatifs, ou sont extrêmement engagés dans des politiques criminelles, comme c'est le cas du régime de Bachar al-Assad ?

Vous avez déjà répondu à des questions que je me posais, en particulier sur la notion même d'État islamique. Je rejette cette notion ; je pense que ce n'est pas une bonne chose que de considérer qu'il s'agit d'un État.
Vous l'avez dit vous-même, l'identité d'un État est avant tout délimitée par un territoire. Or, en l'espèce, Daech n'a pas de territoire. Vous avez dit que la force de cette organisation n'était pas militaire, qu'elle pouvait être vaincue mais qu'elle renaîtrait. Avant toute chose, il s'agit d'un mouvement, qui peut naître en tout lieu et à tout instant.
Considérer Daech comme un État donne le sentiment qu'il existe une délimitation du risque ; or, pour moi, il n'en existe pas. Daech peut renaître à tout instant dans d'autres endroits et s'implanter solidement sur d'autres territoires. Je pense à Gaza, au Yémen, à la Libye ou à la Tunisie. Quel est le niveau de risque ? Encore une fois, se focaliser sur ce thème de l'État islamique donne le sentiment, compte tenu de notre culture et de notre identité, que les choses sont délimitées. Pour moi, elles ne le sont pas : le risque est bien plus grand !

Tout d'abord, pourquoi l'État islamique - ou Daech - séduit-il tant de combattants étrangers et européens ?
En second lieu, existe-t-il des risques d'extension et de convergence avec al-Qaïda, dans la mesure où cela s'est déjà produit dans certains États ?

Daech, c'est l'horreur. Cette organisation s'infiltre partout ! De cela, vous n'avez pas beaucoup parlé. On sait que Daech veut détruire tous les symboles culturels. De cela vous n'avez pas parlé non plus. Nous craignons, en France, de connaître des attentats à Notre-Dame de Paris, au Louvre, etc. Cela soulève beaucoup d'inquiétudes parmi nos concitoyens.
Ma collègue a parlé de « monstre » : elle a raison ! Il n'existe pas de qualificatif suffisant pour définir ces individus. Que peut-on faire pour faire reculer le monstre, voire l'anéantir ? N'avons-nous pas été légers ? N'avons-nous pas trop attendu pour agir ? N'est-ce pas trop tard ? Beaucoup sont très pessimistes et ne voient pas comment arrêter Daech. Je préfère le terme de « Daech » à celui d'« État islamique » : beaucoup de musulmans se plaignent en effet que l'on puisse les confondre avec d'autres !
S'agissant de l'État islamique, je pense que nous sommes confrontés à une nouvelle forme de construction étatique, même si cela nous déplaît. Le projet de l'État islamique est très différent de celui d'al-Qaïda. Al-Qaïda en Irak n'avait pas d'autre projet que d'utiliser les Arabes sunnites comme chair à canon dans la guerre qu'al-Qaïda menait contre les Américains et contre les Chiites. L'État islamique n'a pas de frontière parce qu'il ne reconnaît pas des frontières qu'il déclare comme injustes et coloniales. Il a effacé la frontière en un point où elle est particulièrement artificielle, où elle divise la vallée de l'Euphrate entre la Syrie et l'Irak.
Je crois qu'il n'est pas utile de faire l'impasse sur une volonté affichée d'un adversaire, qu'il met en pratique et qui explique la popularité dont il continue à bénéficier aux yeux d'une partie des populations qu'il a conquises.
En ce qui concerne al-Qaïda et l'État islamique, comme je l'ai dit, le berceau de l'État islamique est l'Irak, mais il s'est étendu au-delà, profitant de la crise des États régionaux, et notamment de la crise de l'État syrien. En Syrie, deux grandes zones culturelles ont accueilli des rivaux sur le champ djihadiste salafiste. Il y a ce qu'on appelle le Levant, c'est-à-dire la Syrie des grandes villes et la Syrie rurale - Alep, Homs, Hama, Damas - qui sont plutôt le fait de Jabhat al-Nosra, branche officielle d'al-Qaïda en Syrie. Les territoires de l'est, davantage de culture bédouine, plus proches de l'Irak, sont le fait de l'État islamique.
Les relations entre ces deux mouvements sont des relations de concurrence, mais on a vu que l'attraction de l'État islamique avait permis à celui-ci de s'emparer de Raqqa et de Deir ez-Zor contre Jabhat al-Nosra. Récemment, dans le camp palestinien de Yarmouk, près de Damas, une collaboration a permis à l'État islamique de s'emparer pendant plusieurs heures de ce camp aux portes de la capitale.
Enfin, je n'ai pas le temps de traiter en quelques secondes la question de l'attractivité de l'État islamique. Elle nous emmène sur un volet européen qui prendrait du temps.
Je pense que les solutions sont très difficiles. J'avoue que je ne suis guère optimiste. On le voit avec la politique américaine, quoi que l'on fasse, on tombe dans une forme de piège si on aide le gouvernement central. En aidant d'autres protagonistes que le gouvernement central, ne contribue-t-on pas au délitement de ces États ?
La question est très difficile à résoudre. N'avons-nous pas intérêt à anticiper un processus irréversible, plutôt que de maintenir la fiction d'États représentatifs à l'origine même des crises que connaît le Moyen-Orient ?
Que peuvent faire nos démocraties européennes et occidentales face aux menaces terroristes ? C'est un problème lié, qui a sa propre cohérence, mais je ne suis pas optimiste.
Je ne vais pas engager ici une analyse de fond, mais je ne crois pas à la formation d'un islam gallican et républicain, tel que notre Premier ministre le souhaite. Je pense que c'est une illusion, et qu'il ne verra hélas jamais le jour !

C'est sur ces paroles peu encourageantes que nous allons conclure cette audition.
Merci de nous avoir apporté ces informations.
La réunion est suspendue à 10 heures 40 pour quelques instants.
- Présidence de M. Christian Cambon, vice-président, puis de M. Jacques Gautier, vice-président -
Audition de Mme Myriam Benraad chercheuse affiliée au ceri et associée à l'institut de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman iremam : sunnites et chiites au prisme de daesh
Audition de Mme Myriam Benraad chercheuse affiliée au ceri et associée à l'institut de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman iremam : sunnites et chiites au prisme de daesh
La commission auditionne Mme Myriam Benraad, chercheuse affiliée au CERI et associée à l'Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman (IREMAM), sur les sunnites et chiites au prisme de Daesh.

Mes chers Collègues, nous accueillons à présent Mme Myriam Benraad, chercheuse affiliée au CERI et associée à l'Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman (IREMAM), sur le thème : « Sunnites et chiites au prisme de Daesh ». Madame, les derniers événements survenus en Syrie et en Irak montrent que la progression de Daesh est loin d'être enrayée et qu'il est plus que jamais nécessaire, si l'on veut espérer le combattre efficacement, de comprendre le phénomène que constitue ce groupe terroriste devenu un quasi-État.
Or, la difficulté d'une telle compréhension réside notamment dans la complexité des relations que le groupe terroriste entretient avec les différentes composantes religieuses présentes en Irak et en Syrie.
Pourriez-vous en particulier nous éclairer, d'une part, sur le « champ » sunnite dans ses aspects religieux mais aussi politiques et civils, avec notamment la question des tribus dont le soutien à Daesh est souvent présenté comme un élément déterminant de la puissance de l'organisation terroriste, d'autre part, sur la manière dont la communauté chiite est également concernée par la progression de Daesh ?
Par ailleurs, les conséquences du conflit sont loin d'être confinées aux seuls territoires irakien et syrien. D'abord, les millions de réfugiés déstabilisent les pays voisins, en particulier la Turquie, la Jordanie et le Liban. Ensuite, certains États de la région peuvent instrumentaliser les différents groupes ou tendances religieuses au sein de la Syrie et de l'Irak afin de promouvoir leurs propres intérêts. Ainsi, quelles sont les stratégies mises en oeuvre par l'Égypte, par la Jordanie ou encore par les pays du Golfe ?
Je vous laisse à présent la parole.
Les ferments de la catastrophe que constitue l'émergence de l'État islamique à l'été 2014 étaient présents dès 2004-2005 sous le poids des conséquences désastreuses suscitées par l'occupation américaine. Il faut à cet égard rappeler un épisode décisif, celui des deux sièges militaires américains dans la ville sunnite de Fallouja (province d'Al-Anbar, dans le grand Ouest irakien) courant 2004. Les soldats américains, qui utilisaient alors une école comme poste d'observation, ont ouvert le feu sur des manifestants qui en réclamaient la réouverture. Jusqu'alors, les pouvoirs locaux, notables et imams, avaient adopté une attitude plutôt attentiste pour éviter un bain de sang après l'effondrement de toutes les structures étatiques. Cet événement a enraciné un profond malentendu entre les sunnites, l'armée américaine et les nouvelles autorités irakiennes perçues comme collaboratrices. C'est également en réponse aux événements de Fallouja que quatre contractuels de Blackwater ont été pris en embuscade et tués par des insurgés sunnites au début de l'année 2004, puis leurs corps calcinés suspendus du haut de l'un des deux ponts de Fallouja, ce qui a fait comprendre à l'opinion publique américaine, pour la première fois, dans quel bourbier son armée était engagée.
L'ordre politique établi au printemps 2003 par l'Autorité provisoire de la coalition sous la houlette de l'administrateur civil américain Paul Bremer a tout entier reposé sur une stigmatisation des sunnites, mécaniquement associés au régime baassiste et accusés de tous les maux alors même que toutes les composantes de la société irakienne avaient fait le jeu du régime, comme le prouve la destruction ordonnée par l'ancien Premier ministre irakien Nouri al-Maliki de certains dossiers de « dé-baassification » qui concernaient des figures politiques chiites proches de lui. Cette diabolisation s'est traduite par une purge anti-sunnite dans tout l'appareil d'État et les administrations, les personnes mises à l'écart se trouvant démunies et choisissant de prendre les armes contre l'occupant, armes qui n'ont pas été déposées à ce jour. Une autre erreur a consisté dans le démantèlement de l'armée, dont les hauts gradés et cadres étaient majoritairement sunnites depuis l'époque ottomane.
Avant de poursuivre, je voudrais souligner qu'avant la chute de Saddam Hussein en 2003, les sunnites ne se voyaient pas tant comme sunnites que comme citoyens irakiens. Cela vaut d'ailleurs aussi pour les chiites. À titre d'exemple, les mouvements nationalistes et le parti communiste comprenaient en leur sein de nombreux chiites, chrétiens et juifs.
Les sunnites ne comprennent toujours pas pour quelle raison ils ont été réduits à une minorité et pourquoi ils subissent les discriminations politiques et juridiques associées à ce statut. Les manifestations intervenues en 2012 et 2013 avant la prise de contrôle de Daesh se voulaient initialement pacifiques, réclamant l'égalité des droits, la libération des détenus qui n'avaient pas été jugés équitablement, la réhabilitation politique des sunnites ainsi que leur réintégration dans les institutions, en particulier dans l'armée.
Ce divorce s'est accentué après le retrait militaire américain de décembre 2011 car le Premier ministre d'alors, Al-Maliki, n'a pas tenu sa promesse de réconciliation et a qualifié les sunnites alternativement de terroristes et de baassistes, mettant en oeuvre une répression tous azimuts. C'est à partir de ce moment que la population sunnite s'est laissé happer par Daesh. Il s'agissait d'ailleurs plutôt d'un choix de résignation, ces populations se ralliant à un projet qui avait le mérite de mettre fin à leur oppression et de leur offrir une certaine existence politique et socio-économique. Fin 2013, Al-Maliki a choisi de démanteler le camp sunnite de manifestants à Ramadi, d'où était partie la contestation. Dès lors, la progression de Daesh a été très rapide.
Cette progression était d'autant plus aisée que les membres de Daesh sont des fils du pays. Ils se sont donc adressés directement aux notables locaux et aux tribus, et leur ont promis qu'ils récupéreraient une partie de ce pouvoir politique et de cette autorité sociale qui leur avait échappé au profit de l'autorité centrale, en échange de leur coopération ou, à tout le moins, de leur passivité face à l'assaut des djihadistes. N'oublions pas que les tribus avaient été particulièrement frustrées au lendemain de leur mobilisation aux côtés des l'armée américaine en 2007-2008, qui visait déjà à l'époque l'État islamique, cette mobilisation n'ayant abouti à aucun partage du pouvoir. Au lieu d'intégrer ces combattants et les repentis de Daesh au sein de l'appareil militaire et de sécurité, Al-Maliki a en effet dissous ce mouvement et favorisé le retour des tribus et des anciens insurgés repentis dans le giron de l'État islamique.
Le général Allen, proche du général Petraeus, a bien tenté de s'appuyer à nouveau sur ces tribus. Apprécié et considéré par les cheikhs de la province d'Al-Anbar, il souhaitait les remobiliser dans un cadre plus institutionnalisé qu'à l'époque de G.W. Bush, à travers la création, au sein des provinces, d'une garde nationale parallèle à l'armée irakienne afin, dans un deuxième temps, de recréer un appareil militaire et sécuritaire de ce nom. Cette tentative, certes intéressante, s'est heurtée au refus du gouvernement central dominé par les chiites de livrer aux tribus les armes fournies par les Américains. Les chefs de tribus se plaignent ainsi d'être obligés d'acheter leur armement pour des milliers de dollars au marché noir, ces armes provenant d'ailleurs souvent de soldats de l'armée irakienne impliqués dans la contrebande.
Plus généralement, l'armée irakienne est foncièrement discréditée. Elle a déserté à Mossoul et récemment à Ramadi. Elle est considérée par la population comme corrompue et gangrénée de l'intérieur par les milices chiites, sans même évoquer ici son usage immodéré du racket. Son rejet par les sunnites explique pourquoi les djihadistes ont été perçus comme des libérateurs en 2014.
La stratégie américaine va devoir évoluer : au-delà de l'opportunité de poursuivre ou non les frappes aériennes, il est nécessaire de recourir en tout état de cause, sur le terrain, à des acteurs locaux prêts à combattre Daesh et à coopérer pour la restauration de la sécurité et d'un embryon d'institutions légitimes. Le Congrès américain a proposé d'armer directement les tribus ; cette idée est opportune si l'on souhaite concrètement résister à Daesh.
Pour autant, en Irak, notamment dans la presse, l'idée d'armer les tribus est perçue comme une nouvelle ingérence des États-Unis, comme une énième volonté de diviser l'Irak. Dans le même temps, l'État irakien est complètement à la solde des milices chiites dont il ne peut se passer pour conduire ses opérations et qui poursuivent une logique confessionnelle similaire à celle de Daesh. On a bien vu à Tikrit puis à Ramadi que le gouvernement irakien, lui-même discrédité, était contraint d'avoir recours à ces milices chiites, les fameuses « unités de mobilisation populaire ». Dans ces conditions, on peut craindre une nouvelle guerre civile semblable à celle qui avait pris place en 2006.
Il est indispensable à présent de s'appuyer sur des autorités politiques locales, qui font dramatiquement défaut et que Daesh assassine d'ailleurs systématiquement pour prévenir toute forme de dissidence dans les territoires qu'il contrôle. La population tend pour sa part à se ranger du côté du plus fort et nous avons donc déjà manqué une fenêtre d'opportunité en ne mobilisant pas les tribus et les officiers sunnites à temps. Ce choix impliquerait également des négociations et une amnistie, question qui n'a jamais véritablement été envisagée mais qui va nécessairement se poser.

La France a fait le choix du rapprochement avec les dynasties sunnites, au profit de quelques marchés juteux et au détriment de l'Iran. Alors qu'il existe une contradiction entre détruire Daesh et renforcer notre influence économique, pourrons-nous sortir de cette guerre entre sunnites et chiites ? La stratégie à court terme de la France est-elle bonne ? Finalement, ne risque-t-elle pas de s'aliéner tous les acteurs et ne rate-t-elle pas son approche de la lutte contre le djihadisme ?
Il est hypocrite de dire que les monarchies sunnites du Golfe sont étrangères à Daesh. On peut discuter des voies que le soutien au « Califat » a pu prendre mais il est réel sur le plan idéologique, y compris de la part d'une partie importante du monde musulman sunnite. Certaines autorités dans la région en ont d'ailleurs profité pour exfiltrer leurs dissidences internes, critiques des familles régnantes dont la légitimité est mise en cause. Le problème du retour de ces opposants convertis au djihadisme salafiste commence néanmoins à se poser. La réaction actuelle de certaines autorités sunnites, notamment dans la péninsule, s'apparente finalement à celle du créateur de Frankenstein qui perd le contrôle du monstre qu'il a façonné. Des camps de réhabilitation des djihadistes ont été mis en place dans ces pays, par exemple en Arabie saoudite, mais les résultats sont peu probants. Une partie de la jeunesse est à la dérive dans ces pays, même si l'Occident ne le perçoit pas. Il existe bien des liens : ainsi, durant l'occupation, les prédicateurs irakiens les plus radicaux trouvaient des relais en Arabie saoudite et dans d'autres monarchies du Golfe, et y occupaient le devant de la scène médiatique.
En ce qui concerne l'Iran, il faut cesser de caricaturer la situation en opposant des soi-disant gentils et des soi-disant méchants. Il existe des rapports de force entre les différents pays de la région, des surenchères identitaires et des guerres par procuration. Il est illusoire, comme le souhaitait le Président Obama, de tenter de « régionaliser » le règlement de la crise. L'Iran exerce un droit de veto de fait sur les nominations au sein du gouvernement irakien, lequel a besoin de l'appui de Téhéran et des milices qui lui sont adossées pour se maintenir au pouvoir.
Personnellement, je suis plutôt critique de la politique menée par la France, qui ne développe pas réellement de politique envers l'Irak et le Moyen-Orient. Il est indispensable de repenser notre stratégie. Voici un exemple : nous parlons en permanence d'inclusivité, mais ce terme en vogue ne signifie rien pour les Irakiens ! Les différentes personnalités auxquelles on pourrait penser pour intégrer un gouvernement « inclusif » n'ont en fait aucune légitimité, aucun relais sur le terrain. Or, il est nécessaire de redonner de la sécurité à la population pour qu'elle puisse faire confiance à nouveau dans des autorités. Pour cela, il faut s'appuyer sur les notables locaux, les tribus, les officiers, comme cela a été fait, avec succès, en 2007-2008.

Merci, Madame, pour votre éclairant exposé. Le tableau que vous nous présentez fait froid dans le dos, et ne laisse pas d'être inquiétant. La démocratie et l'État de droit ont-ils encore quelque avenir en Irak ? Les mouvements sunnites modérés peuvent-ils jouer un rôle en ce sens et éviter que le terrorisme ne s'installe durablement dans ce pays ?

Que sait-on du chef de Daesh, Abou Bakr al-Baghdadi ? Quel est le « premier cercle » du pouvoir, à la tête de ce proto-État qu'est Daesh ?
Soyons francs, il ne reste aujourd'hui pas grand-chose de la démocratie en Irak ; il en restait déjà assez peu en 2010, au lendemain des élections. Des espoirs s'étaient pourtant levés, alors ; les Irakiens, pour la première fois depuis 2003, avaient voté pour des projets politiques, et non en fonction de leur appartenance communautaire. Mais Nouri al-Maliki a dépossédé de sa victoire son concurrent Iyad Allaoui, un chiite laïc qui était très populaire, et par la même occasion les électeurs sunnites de celle-ci alors que ces derniers aspiraient à une réconciliation nationale, à des réformes et à la restauration d'un État de droit. Al-Maliki s'est d'ailleurs présenté comme le restaurateur de cet État de droit, dont la coalition qu'il conduisait avait emprunté le nom. Aujourd'hui, non sans paradoxe eu égard à son bilan et à une manière de gouverner qui avait ironiquement fini par ressembler à celle de Saddam Hussein, il conserve une certaine audience en Irak. Il n'a pas disparu de la vie politique, il est vice-président et dispose d'une influence importante grâce à certains cercles de pouvoir qu'il a su verrouiller. Il tente de se reconstruire une image positive face à l'échec de son successeur Haïdar al-Abadi. Sa carrière est loin d'être terminée : l'Irak aspire à un homme fort ; le pays est sans doute prêt à renouer avec la dictature, par lassitude, afin de retrouver l'ordre public ; alors que le gouvernement est en difficulté, Al-Maliki pourrait tirer profit de la situation.
Il n'y a plus guère de modérés sur la scène politique irakienne. On pouvait en effet qualifier comme « modérés », pour l'essentiel, les Frères musulmans dans le champ islamiste sunnite ; or ils ont été laminés par Al-Maliki, qui a traqué un grand nombre de sunnites. Ne demeurent, aujourd'hui, que quelques tribus et les officiers. Je crois que ceux-ci sont appelés à jouer un rôle clé, à la condition que le gouvernement irakien le leur permette en proposant les amnisties nécessaires - elles me paraissent incontournables si l'on vise une sortie de crise, malgré les nombreuses réticences qui s'expriment, notamment dans le camp chiite.
Abou Bakr al-Baghdadi appartient quant à lui à la génération « embargo ». Il a occupé un certain nombre de petits emplois en Irak et a fini prédicateur salafiste dans une mosquée de Bagdad ; c'est à cette époque qu'il s'est radicalisé. Après 2003, il s'est rapproché du Jordanien Abou Moussab Al-Zarqaoui, qui avait pris la tête de la branche irakienne d'Al Qaïda jusqu'à sa mort dans un raid américain en 2006. Puis il a succédé à Abou Omar al-Baghdadi, premier émir de l'État islamique d'Irak, dont il était un des lieutenants. On constate à travers cet exemple que les successions sont préparées à l'avance au sein de Daesh.
Le premier cercle du pouvoir de l'organisation djihadiste est constitué d'une élite irakienne, issue du parti Baas et salafiste. Les Baassistes, en effet, ont joué un rôle majeur dès le début de l'insurrection irakienne, dans la mesure où ils disposaient de la connaissance des lieux de dépôts d'armes, de la compétence militaire requise, et d'un ensemble de réseaux et de liens personnels qui leur ont permis de former très rapidement des groupes, dans une parfaite clandestinité dont ils étaient familiers. On ne peut opposer, comme on le fait souvent dans la presse, Baassistes et islamistes. Dès les années 1990, une partie de l'appareil d'État irakien était radicalisée : Saddam Hussein avait utilisé les islamistes comme un levier de légitimation interne après sa débâche contre l'Iran et au Koweït. Le parti Baas n'a jamais été laïc ; sa base était conservatrice. Au reste, les milieux d'État et religieux étaient très largement imbriqués, souvent au sein des mêmes familles.

Le Kurdistan irakien semble renforcé par l'action des peshmergas. Malgré l'opposition turque, la constitution d'un État kurde est-elle envisageable ?
Les autorités religieuses sunnites telles qu'Al-Azhar ne pourraient-elles pas jouer un rôle positif auprès des sunnites irakiens ?
Dans quelle mesure les Frères musulmans sont-ils modérés, comme vous l'avez indiqué ?

Merci pour cet exposé très complet et intéressant. Vous constatez l'absence de direction de la diplomatie française au Moyen-Orient. D'après vous, quelles orientations cette politique devrait-elle adopter ?
Par ailleurs, l'Irak risque-t-il une tripartition entre Kurdes, sunnites et chiites ?
Il me semble que les déclarations kurdes en faveur d'une indépendance visent, en réalité, à obtenir une plus ample marge de négociation, afin de consolider leur autonomie. Les Kurdes sont bien conscients qu'ils ont besoin d'interlocuteurs arabes pour combattre Daesh. En Irak, un accord sur la contribution kurde au budget fédéral, même seulement temporaire, a été trouvé, favorisant la coopération sur le plan militaire. Les Kurdes se trouvent en position de force depuis la débandade de l'armée irakienne, et dans la mesure où le Congrès américain propose de les armer, ce qui leur permettrait de ne pas avoir à transiger avec Bagdad. Cette position de force s'accompagne d'un certain réalisme quant aux soutiens dont ils ont besoin. La Turquie est, notamment, le premier partenaire économique des Kurdes et Erbil n'a aucun intérêt objectif à se mettre à dos Ankara.
L'autonomie kurde est devenue un modèle pour tous les Irakiens, y compris les sunnites. Un certain nombre de tribus accepteraient de prendre les armes contre Daesh, avec l'aide des États-Unis, à condition que leur autonomie soit reconnue. La Constitution irakienne de 2005 prévoit la possibilité d'une telle autonomie régionale, par référendum. Les sunnites en ont déjà fait la demande en 2011, mais Nouri al-Maliki s'y était opposé.
Des rivalités existent par ailleurs entre acteurs informels et conseils de province. Les tribus ne prendront pas les armes pour servir les intérêts d'autorités politiques, celle des gouverneurs en particulier, qui ont déserté et n'ont plus aucune légitimité sur le terrain.
Le gouvernement irakien a systématiquement accusé les Frères musulmans d'être des terroristes. Or ces derniers, de retour en Irak en 2003, ont publié un projet politique jouant le jeu de la démocratie et des élections. La suppression de cette option, même islamiste, est à l'origine aussi de la montée en puissance des salafistes dans le paysage politique et armé.
Quelle que soit la légitimité de l'autorité religieuse d'Al-Azhar, elle ne me paraît pas en mesure de modifier l'attitude des populations sunnites irakiennes. Le seul moyen de convaincre ces populations, actuellement sous le joug de l'État islamique, serait d'améliorer leurs conditions de vie de manière tangible et non plus par d'éternelles promesses non tenues.
Concernant la politique étrangère française à l'égard du monde arabe, elle est faite tantôt de grandes déclarations de soutien à la démocratie, tantôt d'un silence assourdissant, au sujet de l'Égypte par exemple, où le retour actuel au tout-autoritaire ne fera qu'alimenter la radicalisation salafiste. Dans la région, le modèle démocratique occidental est délégitimé, sauf peut-être en Tunisie, encore que les Tunisiens soient aussi nombreux dans les rangs de l'État islamique.
L'approche de la France doit être plus réaliste, quitte à paraître minimaliste, et se fonder sur un soutien concret aux institutions et au rétablissement de la sécurité et des services au plan local, sans pour autant faire le jeu d'un retour à la dictature qui n'est pas une solution. À l'exception de notre participation à la coalition militaire contre Daesh, nous ne menons pas une action susceptible de reconstruire du politique. Nous avons peu de marge de manoeuvre, d'autant que les populations locales, lasses, rejettent les ingérences de l'Occident, jugées néo-coloniales et néfastes. Les autorités en place sont illégitimes et nos interlocuteurs aujourd'hui ne sont donc pas les bons.
- Présidence de M. Jacques Gautier, vice-président -
La commission examine les amendements au texte de la commission n° 447 (2014-2015) pour la proposition de loi n° 277 (2014-2015), adoptée par l'Assemblée nationale, relative au renforcement de la protection des installations civiles abritant des matières nucléaires.

Les amendements au texte de la commission, s'agissant de la proposition de loi relative au renforcement de la protection des installations civiles abritant des matières nucléaires, sont identiques sur le fond à ceux que nous avons discutés la semaine dernière. Nous avions alors rejeté ces amendements et adopté la proposition de loi sans la modifier.

Hormis quelques modifications rédactionnelles, les amendements du groupe écologiste sont effectivement identiques à ceux que nous avons rejetés la semaine dernière.
Je vous rappelle que les six premiers amendements restreignent le champ d'application du texte et vont à l'encontre de son objet même. L'amendement n° 7 vise à informer les élus du passage de convois de matières nucléaires, ce qui ne me paraît pas judicieux. L'amendement n° 8 sanctionne les opérateurs qui ne respecteraient pas les avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. Ce sujet est en cours de discussion dans le cadre du projet de loi relatif à la transition énergétique. Enfin, l'amendement n° 9 vise à élargir l'objet du rapport demandé au gouvernement d'ici au 30 septembre 2015, au risque de diluer la réflexion et d'allonger les délais.
J'envisage, par ailleurs, le dépôt d'une proposition de loi à l'automne, tant pour sécuriser le statut des formations locales de sécurité, que pour répondre aux enjeux soulevés par le développement des drones.

Sommes-nous d'accord pour maintenir un avis défavorable à ces amendements ?

Les six premiers amendements consistent à légitimer des intrusions dites « pacifiques ». Toute intrusion pourra se dire pacifique. Il ne peut pas y avoir d'intrusion, quelle qu'elle soit. Ces amendements doivent être rejetés.

Comme l'a rappelé le rapporteur la semaine dernière, si l'on parvient à mettre fin aux intrusions de militants pacifiques, les terroristes seront dès lors les seuls à même d'en commettre.

L'objet de cette proposition de loi est, en effet, de caractériser les intrusions. Les sanctions ne dissuaderont pas les terroristes, mais permettront aux forces de sécurité d'agir plus efficacement.

Les intrusions dites pacifiques sont souvent multinationales. Comment pourrait-on s'assurer de l'intention réelle de tous leurs auteurs ?

Les organisations militantes sont, en effet, susceptibles d'être infiltrées.
La commission nomme rapporteur :
Joël Guerriau sur le projet de loi n° 2648 (AN-XIVe législature) autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement (sous réserve de sa transmission).
La réunion est levée à 11 h 47.