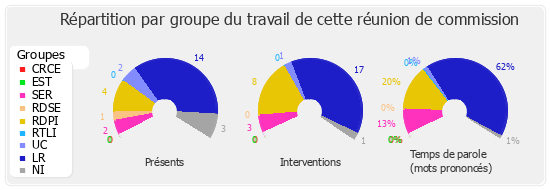Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation
Réunion du 1er juillet 2015 à 9h03
Sommaire
- Réforme du droit d'asile
- Compte rendu du déplacement effectué par une délégation du bureau de la commission au portugal et en espagne du 19 au 23 avril 2015 (voir le dossier)
- Projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2014
- Audition de m. anthony requin directeur général de l'agence france trésor sera publié ultérieurement
- Diplomatie fiscale de la france en faveur de ses entreprises
- Auditions de mme catherine henton directeur fiscal de sanofi-aventis mm. édouard marcus sous-directeur de la prospective et des relations internationales à la direction de la législation fiscale dlf et raffaele russo chef du projet beps centre de politique et d'administration fiscales de l'ocde (voir le dossier)
La réunion
La commission procède tout d'abord à l'examen du rapport pour avis de M. Roger Karoutchi sur le projet de loi n° 566 (2014-2015) relatif à la réforme du droit d'asile, en nouvelle lecture.
EXAMEN DU RAPPORT

Le projet de loi de réforme de l'asile a été adopté par le Sénat en première lecture le 26 mai dernier. La commission mixte paritaire s'est réunie le 10 juin et a échoué. Le projet de loi est donc examiné en nouvelle lecture ; il a été adopté par l'Assemblée nationale jeudi dernier 25 juin et il sera examiné la semaine prochaine en séance au Sénat. Notre commission des lois a établi son texte hier ; le texte de la commission intègre l'essentiel des amendements adoptés par notre commission des finances en première lecture, à l'exception d'un seul, que je vous propose d'adopter, qui concerne l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile. Mon amendement n° 1 vise à supprimer cette disposition de l'article 15 du projet de loi, qui permet aux demandeurs d'asile, lorsqu'il n'a pas été statué par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de neuf mois, d'accéder au marché du travail dans les mêmes conditions que les réfugiés ou les autres étrangers en situation régulière. Cela me semble présenter une injustice par rapport aux étrangers qui obtiennent l'asile.

Sans surprise, nous restons défavorables à cet amendement ; sauf si vous avez une proposition alternative.

Aujourd'hui, l'ouverture du marché du travail aux demandeurs d'asile est faite par la voie réglementaire. Cela devrait rester par voie réglementaire pour limiter l'affichage ainsi fait à l'égard des filières qui vendent cette possibilité, qui serait désormais légale, de venir travailler en France en tant que demandeur d'asile au bout de quelques mois.

Je crois qu'on distribue là un argent que l'on n'a pas, qu'il s'agisse de l'allocation, de l'hébergement des demandeurs d'asile ou des soins médicaux.
À l'issue de ce débat, la commission émet un avis favorable à l'adoption de l'article 15 tel que modifié par son amendement n° FINC1.

Une délégation du Bureau de la commission des finances, composée du rapporteur général, de Marie-France Beaufils, de Dominique de Legge et de moi-même s'est rendue à Lisbonne et à Madrid, du 19 au 23 avril dernier.
Nous souhaitions appréhender la situation de ces pays, qui ont été fortement fragilisés et affectés par la crise dans la zone euro et ont mis en oeuvre un impressionnant programme d'ajustement budgétaire et de réformes structurelles. Il nous semblait intéressant de voir, au moment où ces pays renouent avec une croissance forte, les effets de ces réformes, d'un point de vue budgétaire, économique et financier, mais aussi leurs répercussions sociales et politiques.
Au cours de ce déplacement, nous avons rencontré un grand nombre d'interlocuteurs : hommes d'affaires, représentants d'instituts de recherche, hauts fonctionnaires, banquiers centraux, parlementaires, ministres, qui nous ont permis d'avoir une vision très complète des situations des deux pays ; cette communication s'efforce d'en retracer les principaux enseignements.
Je vous présenterai dans un premier temps des éléments d'analyse commune aux deux pays, au risque de simplifier parfois un peu les choses, avant d'évoquer quelques éléments plus spécifiques à l'Espagne.
Tout d'abord, l'ampleur de la crise dans les deux pays a des causes en partie communes ; ils ont tous les deux connu à la fois un excès d'investissement et une mauvaise allocation de celui-ci depuis les années 1990, tant dans le secteur privé que public.
La presse s'est régulièrement faite l'écho de projets très coûteux et inutiles, notamment en Espagne : construction de villes nouvelles désertes, aéroports flambant neufs qui n'ont jamais vu d'avion de ligne, autoroutes construites en parallèle dont aucune n'est rentable... L'Espagne est ainsi devenue le « champion » européen en kilomètres d'autoroutes et en nombre d'aéroports commerciaux à vocation internationale, mais aussi le numéro deux mondial en kilomètres de lignes ferroviaires à grande vitesse, derrière la Chine !
Le Portugal s'est également, mais dans une moindre mesure, livré à des excès, avec de nombreux projets d'infrastructures financés dans le cadre de partenariats publics privés qui pèsent lourdement sur les finances de l'État, et une spécialisation du privé dans le secteur des biens non échangeables disposant de rentes accordées par l'État.
Les infrastructures ont donc été surdéveloppées alors que l'enseignement et la recherche, par exemple, manquaient de moyens.
Quant aux ménages, ils pouvaient bénéficier de prêts portant sur des montants excédant le coût de leur achat immobilier, accordés pour des durées allant jusqu'à 50 ans sur la base de taux variables. Surtout, les banques ne se préoccupaient pas du risque puisque la valeur des biens augmentait, oubliant que « les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel ».
La croissance remarquable du secteur du bâtiment et des travaux publics a tiré la croissance économique et attiré une importante main d'oeuvre en provenance de l'étranger en Espagne. Elle a également entraîné une augmentation des coûts salariaux très supérieure à l'évolution de la productivité, dégradant la compétitivité des deux pays et contribuant au déséquilibre de leurs échanges extérieurs.
Ces éléments ont conduit à un très fort endettement du secteur privé et en particulier, des ménages.
Avec la crise, les deux pays, et plus particulièrement l'Espagne, ont connu une explosion de la bulle immobilière, qui a rapidement eu des répercussions massives sur le système bancaire, le financement de l'économie et le niveau du chômage, du fait de la diminution de l'activité, de la dévalorisation des actifs immobiliers, et de l'augmentation des taux d'intérêt.
Il s'en est suivi une explosion des créances douteuses et des impayés.
Enfin, les pouvoirs publics ont, comme dans la plupart des pays, mais avec une intensité plus forte encore, vu leurs dépenses sociales exploser et leurs recettes fiscales fortement réduites, tandis que le coût de leur dette était très fortement accru. Je rappelle que le Portugal a été placé sous assistance financière entre 2011 et 2014, faute d'être en mesure de lever des financements sur les marchés extérieurs, et que l'Espagne a reçu une aide financière du mécanisme européen de stabilité (MES) pour ses banques entre 2012 et 2013.
Cette situation a conduit les deux pays à procéder, principalement entre 2011 et 2013, à une très forte consolidation de leurs finances publiques. Ces efforts ont notamment porté sur les dépenses, avec par exemple une révision importante des systèmes de protection sociale et une diminution des salaires des fonctionnaires. L'ensemble des secteurs a été affecté par des coupes importantes. En Espagne, entre 2010 et 2014, les dépenses en termes d'éducation et de santé ont ainsi baissé de plus de 10 %, celles relatives aux services sociaux de 22 %. Les deux pays ont également revu à la baisse - y compris de manière rétroactive en Espagne - leurs subventions aux énergies renouvelables, dont la dynamique était insoutenable.
Ces mesures ont eu un effet récessif très marqué, avec une forte réduction des salaires, une progression très importante du chômage (le taux de chômage a culminé à plus 26 % en Espagne et 17 % au Portugal au début de l'année 2013) et une augmentation des inégalités ; on notera au passage que la très forte proportion de propriétaires, du fait des années de la « folie des grandeurs » immobilière a été par ailleurs un frein à leur mobilité géographique, qui aurait pu contribuer à limiter la progression du chômage.
Le chômage, très élevé chez les jeunes, a entraîné une émigration importante vers d'autres pays européens, notamment le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, mais aussi la Suisse et l'Amérique latine. Elle a notamment concerné les populations les plus qualifiées, qui n'arrivaient plus à entrer sur le marché du travail, et pour lesquelles certains ont parlé de « génération sacrifiée ». Le retournement est à cet égard particulièrement frappant en Espagne : sa population totale avait augmenté de 5,6 millions entre 2000 et 2008, dont 5 millions étaient liés à l'arrivée de travailleurs étrangers. Cette situation s'est inversée en 2012, le solde migratoire devenant négatif pour la première fois depuis 1990, du fait du retour au pays d'un certain nombre de migrants et de l'émigration des jeunes espagnols que je viens d'évoquer.
L'ajustement budgétaire s'est accompagné d'importantes réformes structurelles, concernant notamment le marché du travail, les prestations sociales et les retraites.
Les réformes du marché du travail engagées par les deux pays ont été conçues avec une volonté de favoriser les ajustements du marché en introduisant de la flexibilité et en réduisant la segmentation du marché entre des travailleurs très protégés et d'autres, très précarisés. Elles ont été décidées dans le cadre d'un dialogue social, une partie au moins des syndicats « jouant le jeu » de la négociation jusqu'au bout.
S'agissant des retraites, les départs anticipés ont été pénalisés et les modalités de calcul des pensions ont été réformées afin de tenir compte de l'évolution de la démographie, en retardant l'âge de départ en retraite et en prévoyant une désindexation des pensions par rapport à l'inflation.
S'agissant des prestations sociales, on notera par exemple le durcissement du régime des allocations chômage avec, au Portugal, une durée plafonnée à 12 mois et une diminution des montants des allocations de 10 % par an à compter du sixième mois.
Enfin, il convient de dire un mot du secteur bancaire, qui avait pris, dans les deux pays, des risques excessifs et a été très fortement fragilisé par la crise et l'explosion des bulles immobilières.
Des résolutions d'établissements bancaires ont eu lieu dans les deux pays avant l'entrée en vigueur du fonds de résolution unique (FRU) mais selon des modalités analogues, faisant d'abord appel aux actionnaires des établissements. Cette restructuration du secteur bancaire devrait coûter plus de 40 milliards d'euros au budget de l'État espagnol, qui a consolidé ses caisses d'épargne régionales, responsables pour une large part des excès dont j'ai parlé tout à l'heure.
Une structure de défaisance a été créée en Espagne, la SAREB, afin d'isoler les actifs immobiliers les plus problématiques des banques, pour un total d'environ 50 milliards d'euros. La SAREB fait désormais appel à des structures externes pour commercialiser ses biens. Le marché immobilier semble désormais stabilisé, après une chute des prix d'environ 40 % en moyenne par rapport à leur pic. Le stock de logements invendus serait toutefois de l'ordre de 800 000, et un certain nombre de ces biens ou de chantiers trouvera difficilement preneur en raison notamment de leur situation géographique.
Les banques ont aujourd'hui considérablement renforcé leurs fonds propres et le secteur semble désormais reposer sur des bases solides dans les deux pays, la reprise de l'économie réduisant par ailleurs le volume des créances douteuses en Espagne, alors qu'il se stabilise au Portugal.
L'accès au crédit reste coûteux et difficile pour les petites entreprises tournées vers le marché intérieur ; toutefois, certains de nos interlocuteurs ont évoqué la reprise de pratiques à risque en matière de prêts aux ménages, notamment dans le secteur immobilier.
La période d'ajustement la plus dure est terminée et personne ne doute plus de la capacité des deux pays à faire face à leurs obligations et à se financer sur les marchés. En outre, ils renouent depuis l'an dernier avec une croissance élevée : les dernières prévisions du Fonds monétaire international (FMI) évaluent ainsi la croissance espagnole à 3,1 % contre 1,6 % pour le Portugal. Cette croissance est portée par le rebond de la consommation privée, particulièrement pour les biens durables comme les voitures, l'amélioration des conditions de financement des entreprises, la moindre contraction de la dépense publique et, enfin, l'accroissement des exportations du fait de la baisse conjuguée du coût du travail et de l'euro.
Cette performance est remarquable, mais il faut rappeler que le produit intérieur brut (PIB) espagnol reste inférieur de plus de 5 % à son niveau record de 2008 et les projections montrent que celui-ci ne devrait être rattrapé qu'en 2017 : l'économie est encore en phase de rattrapage, et les Espagnols qualifient déjà la période 2007-2017 de « décennie perdue ».
Cette croissance est notamment tirée dans les deux pays par les exportations, vers la zone euro et en dehors, notamment vers le Royaume Uni et l'Amérique latine. Les deux pays essayent également d'attirer des capitaux, à la fois des investisseurs et des individus relativement aisés, dans un but de relancer l'économie et de générer des recettes pour l'État.
Plusieurs outils ont été mis en oeuvre à cette fin :
- en premier lieu, des privatisations ont été engagées, surtout au Portugal, par exemple dans le secteur des transports. Elles attirent notamment des investisseurs chinois et, français - Vinci ayant notamment racheté tous les aéroports portugais. Dans ce cadre, les investisseurs chinois semblent prêts à payer le prix fort, considérant qu'ils achètent le fait de mettre un pied dans l'Union européenne. Les deux pays accueillent ainsi d'importants investissements chinois, tant dans l'immobilier que dans divers secteurs de l'économie (banque, transports, assurance, santé, énergie ...) ;
- l'attraction des investisseurs passe aussi par la mise en place de dispositifs spécifiques : il s'agit des « golden visas » - dont François Marc nous avait parlé il y a un an et demi suite à un déplacement en Lettonie et qui, je crois, a été précurseur en la matière - à l'attention des investisseurs extra-communautaire - et notamment chinois -, qui permettent de disposer d'un visa Schengen sous condition d'un investissement immobilier, productif ou financier dépassant un certain seuil ;
- le Portugal cherche enfin à attirer des retraités, notamment français, à l'aide d'avantages fiscaux. Depuis 2013, les retraités étrangers qui séjournent au moins 183 jours par an au Portugal sont exemptés d'impôt sur le revenu de personnes physiques pendant dix ans - on notera que cet avantage fiscal ne peut bénéficier qu'aux retraités français du secteur privé.
Pour ces raisons, on trouve, dans les magazines comme dans les rues touristiques de Lisbonne, des publicités en faveur de propriétés immobilières, en français comme en mandarin.
Je veux enfin ajouter quelques considérations concernant plus spécifiquement l'Espagne, qui, à la différence du Portugal, est un État fédéral, et où la crise semble avoir agi comme une forme de révélateur des travers de cette organisation institutionnelle.
Les communautés autonomes espagnoles disposent de pouvoirs étendus, y compris en matière normative ; par exemple, la taille des panneaux d'interdiction de fumer dans les entreprises sont réglementées de manière différente selon les régions, de même que celle du bras des bandits manchots ... ! Les directives européennes sont souvent traduites en 17 règles différentes, comme s'il s'agissait de 17 « mini-États ».
Cette complexité administrative est coûteuse et constitue un obstacle au développement des petites et moyennes entreprises (PME). Une loi d'unification du marché intérieur espagnol a été adoptée en 2013 afin de réduire cette fragmentation, en prévoyant notamment un principe de « validité nationale unique », selon lequel tous les biens et services produits légalement dans une région peuvent être distribués sur tout le territoire espagnol !
Le système institutionnel très fédéralisé a également d'importantes conséquences au plan fiscal et budgétaire :
- du point de vue fiscal, les communautés se livrent à une concurrence pour attirer les investissements ;
- du point de vue budgétaire, les communautés autonomes représentent plus de la moitié des dépenses publiques et sont financées à plus de 80 % par des recettes fiscales. Cette configuration les a conduit dans une situation financière très difficile, dès lors que leurs dépenses en matière par exemple d'éducation et de santé étaient stables tandis que leurs recettes étaient fortement réduites par la récession.
Elles se sont donc retrouvées incapables de se financer sur les marchés, conduisant l'État à « reprendre la main » et à réorganiser l'ensemble de la gouvernance financière, en transposant en quelque sorte les mécanismes de la zone euro au niveau national : des mécanismes extraordinaires de financement ont été mis en place ainsi qu'un examen conjoint de la situation budgétaire des différentes communautés, dans le cadre d'un conseil de politique fiscale et financière ou chacun se prononce sur les projets des autres, à l'instar d'un conseil Ecofin au niveau de l'Union européenne.
Avec la crise, l'Espagne a donc corrigé certains des effets pervers de son système institutionnel, très fortement décentralisé depuis la fin de la dictature. Pour autant, des interrogations demeurent quant à la nécessité de faire évoluer plus profondément les institutions. Ainsi, la montée des nouveaux partis (Podemos et Ciudadanos) n'est pas issue d'un sentiment anti-européen, même s'il y a une forme de « lassitude » par rapport aux efforts demandés depuis maintenant plusieurs années. Ils témoignent davantage du rejet de la classe politique et des deux grands partis traditionnels, et de la volonté de revoir le fonctionnement des institutions. La justice est par exemple critiquée pour son absence d'efficacité, dans un contexte où les affaires impliquant la classe politique sont très sensibles. Il faut dire que les classes politiques sont assez largement discréditées dans les deux pays, suite notamment à plusieurs scandales récents de corruption impliquant des responsables de haut niveau. Au Portugal, cependant, les deux grands partis traditionnels restent largement en tête des sondages et aucun parti protestataire ne semble émerger.
En conclusion, nous avons été impressionnés par le fait que les deux pays restaient très largement pro-européens. D'une part, les citoyens semblent conscients des bénéfices qu'ils ont tirés de l'adhésion à l'Union européenne ; d'autre part, la majorité d'entre eux semble considérer que les excès du passé devaient être corrigés, et voulait envoyer, à travers les efforts consentis, le message selon lequel leur pays était « honnête » et entendait « respecter ses obligations ».
D'ailleurs, dans les deux pays, les citoyens ont nettement plus confiance dans les institutions européennes que dans leurs institutions nationales, même si cette confiance a faibli au cours des dernières années. On nous a ainsi indiqué que l'enthousiasme européen n'était plus le même depuis la crise, et, au Portugal, que « le rêve européen s'était éteint avec la Troïka » ; en dépit des mesures mises en oeuvre, l'Union européenne n'est donc pas devenue « un épouvantail » (plutôt associé aux fonctionnaires de la « Troïka »).
Les réformes ont eu un coût social important en termes de montée du chômage et ont accru les inégalités ; toutefois, les transferts sociaux ont permis de contrer l'augmentation des inégalités de revenu au Portugal, compte tenu notamment de plusieurs décisions de la Cour constitutionnelle invalidant des mesures de réduction de ces transferts.
Aujourd'hui, les deux pays renouent avec une croissance forte et deviennent ainsi des concurrents redoutables pour la France, du fait de l'amélioration de leur compétitivité-prix et du climat des affaires.
On peut toutefois s'interroger sur la pertinence de cette stratégie économique dans la durée. L'Espagne est certes redevenue compétitive par rapport aux pays d'Europe de l'Est, par exemple, pour la construction automobile et a attiré des investissements dans ce secteur ; le Portugal a pour sa part bénéficié de l'implantation de centres d'appels, notamment français, qui avaient été délocalisés en Afrique du nord. Pour autant, ce modèle ne peut évidemment pas être celui de toute l'Europe et risque de faire peser une tension permanente sur les coûts de production en l'absence de montée en gamme des productions.
La question se pose donc de la qualité de la croissance et de la création de valeur ajoutée pour faire évoluer le modèle économique, au-delà de l'ajustement par les coûts. Il semble en effet que si la crise a condamné les entreprises les moins efficaces, les deux pays n'ont pas construit véritablement un nouveau modèle économique au sortir de celle-ci.
Cette montée en gamme suppose des investissements productifs - qui ne pourront se faire que sur la durée et dans un contexte contraint par le surendettement des entreprises - et un effort de formation - à cet égard, le niveau élevé du chômage structurel et la durée de non-activité de la plupart des chômeurs constitue une difficulté importante. De nombreux chômeurs sont en effet d'anciens employés du secteur du bâtiment dont la reconversion apparaît très difficile. Pour l'avenir, la question de la formation initiale et continue apparaît donc cruciale ; à cet égard, les systèmes éducatifs espagnol et portugais affichent des résultats très nettement inférieurs à la moyenne de l'Union européenne.
S'agissant de l'investissement, celui-ci reste faible, compte tenu notamment des difficultés d'accès au financement et de son coût, en particulier au Portugal, les difficultés se résorbant en Espagne. Ce coût, supérieur de plus de 200 points de base au Portugal à celui pratiqué en France ou en Allemagne, explique l'intérêt de certains de nos interlocuteurs en faveur du développement de l'union des marchés de capitaux.
Enfin, deux défis supplémentaires paraissent devoir être signalés :
- les deux pays se sont montrés très sensibles à la question de l'énergie, dont le coût est très élevé du fait notamment du développement des énergies renouvelables. Nos interlocuteurs ont souligné le fait que la péninsule ibérique était une quasi « île énergétique » en Europe et ont fortement insisté sur l'importance de développer une interconnexion énergétique avec la France, avec l'espoir que le plan Juncker puisse permettre son financement ;
- les deux pays vont devoir faire face à un très important problème démographique, le taux de fécondité par femme s'établissant autour de 1,3 ; cette situation, conjuguée avec les conséquences de la crise que j'ai rappelées, va dans le sens d'une nette diminution de la croissance potentielle des deux pays.

Le film « La folie des grandeurs » résume le mieux, selon moi, la situation en Espagne : la bulle immobilière, cette croissance artificielle - avec des fonds européens qui ont sans doute parfois servi d'effet de levier, des crédits largement accordés par les banques mais aussi une industrie relativement faible et un niveau de qualification à améliorer.
En Espagne comme au Portugal, la population a consenti à des efforts considérables et des réformes courageuses ont été menées.
J'ai été frappé par le fait que, contrairement à d'autres pays dont on parle beaucoup en ce moment, les efforts demandés ont été acceptés par la population qui n'a pas développé de sentiment anti-européen.
Aujourd'hui, l'assainissement a sans doute été poussé à son niveau maximum et la principale difficulté que j'ai identifiée a trait au niveau de chômage et à la faible qualification de la population, en particulier celle qui travaille dans le secteur du bâtiment et qui provient d'Amérique latine.
J'ai donc été impressionné par le niveau de l'effort structurel et les réformes structurelles conduites mais je m'interroge sur la capacité à résorber, à l'échelle de quelques dizaines années, le problème de la reconversion de cette population - d'autant plus crucial avec la révolution numérique - ainsi que l'absorption des 52 milliards d'euros d'actifs immobiliers de la SAREB, la structure de défaisance. Par ailleurs, la démographie est très faible en Espagne et au Portugal et il n'y aura pas à terme de besoin de logements ni d'infrastructures supplémentaires dans les prochaines années.

Deux faits m'ont particulièrement marqués au cours de ce voyage : d'une part, selon l'un de nos interlocuteurs, le tissu économique demeurerait fragile en raison d'un marché intérieur insuffisant pour le solidifier. Cette réflexion doit nous interroger quant à notre situation : je trouve que nous sommes très tournés vers l'export et nous ne réfléchissons pas assez à la qualité de notre tissu économique intérieur. D'autre part, ces deux pays ont répondu aux exigences européennes mais ce modèle d'ajustement pose problème du point de vue de l'avenir de l'Europe : si tous les pays conduisent de tels ajustements structurels, il n'y a plus d'Europe. La question cruciale qui nous est donc posée aujourd'hui est celle de l'harmonisation sociale et fiscale au niveau européen.

Au-delà de la folie des grandeurs, je retiens principalement de ce déplacement qu'il existe dans ces pays un consensus sur la nécessité de conduire ces réformes - à la fois de la part des populations mais aussi des responsables politiques, le débat portant davantage sur l'intensité et le rythme des réformes que sur leur nécessité ; qu'il n'y a pas de remise en cause de l'Europe malgré ses exigences, qui sont acceptées - les propos tenus à ce sujet sont différents de ceux qu'on entend en France ; qu'on constate aujourd'hui de bons résultats en ce qui concerne le déficit et la croissance mais que le chômage demeure une source de grande préoccupation ; qu'enfin, la solidarité privée, de proximité et familiale sont un sacré amortisseur de la dégradation des conditions sociales dans lesquelles vivent ces populations.

En vous écoutant, je remplaçais de temps en temps les mots Espagne ou Portugal par le mot France. Il y a quelques années, dans le cadre d'une étude sur le « millefeuilles territorial », je me suis intéressé à l'organisation territoriale espagnole ; l'ambassadeur de France à Madrid nous avait parlé de la bulle immobilière, des problèmes bancaires, de l'immigration dans le secteur du bâtiment et même du rôle joué par les dirigeants du football dans le milieu des banques et du bâtiment. Il avait prédit que la bulle exploserait ; je le trouvais alors pessimiste, mais il avait raison.

Nous avons bien compris que dans le système financier des régions automnes, l'ensemble des acteurs ont contribué à la dégradation de la situation.

Je souhaiterais réagir aux propos d'Éric Doligé : quelles leçons pourrait-on tirer de la crise espagnole et portugaise pour la France ? On ne souhaite à personne, et surtout pas à la France, de vivre ce qui s'est passé en Espagne et au Portugal, de devoir conduire un tel ajustement structurel. Cet ajustement d'une violence terrible, ils l'ont fait au prix d'une baisse significative des retraites, des salaires de la fonction publique avec comme conséquence une mutation politique majeure et l'arrivée de Podemos en Espagne. La seule leçon à en tirer pour la France est de faire en sorte de ne pas avoir à réaliser un ajustement structurel de cette nature. On peut mesurer une leçon de courage de la part du peuple espagnol, mais il ne faut pas voir là des méthodes qui peuvent se reproduire ailleurs. La conclusion, c'est que l'État français a pu gérer les choses plus en douceur, ce qui est heureux pour notre pays.

Je souhaiterais rappeler que la crise financière en Espagne est une crise d'origine privée ayant ensuite entrainé une crise des finances publiques. La dette publique espagnole était en effet faible avant la mobilisation de fonds publics considérables pour « sauver » ce qui pouvait l'être dans le secteur privé. La France est dans une situation très différente, avec une épargne privée abondante. Y compris à ce moment où la Grèce fait face à des difficultés particulièrement graves, nous ne devons pas oublier qu'il y a eu d'abord une crise financière privée dans la plupart des pays et c'est cet enchainement qui rend les conditions de sortie particulièrement difficiles.

Il faut faire attention au rôle joué par les collectivités territoriales en Espagne : la région de Catalogne a construit une autoroute gratuite parallèle à l'autoroute payante, et cette région se retrouve aujourd'hui dans une situation financière intenable. Les collectivités locales en France n'ont pas connu les mêmes dérives qu'en Espagne mais faisons attention, dans nos discours, à ne pas demander encore plus de financement de l'État qui a constitué, en Espagne, une des raisons de cette dérive. Il y a eu la crise financière mais aussi la dérive des collectivités locales...

des régions autonomes, il faut le dire, et de leurs satellites, y compris leurs caisses d'épargne. Le financement des logements pour les ménages n'a rien à voir avec la prudence qui est la nôtre. Nous ne souhaitons à aucun pays de devoir traiter un problème similaire à celui de la SAREB ; j'ai d'ailleurs admiré le stoïcisme de ses dirigeants qui cherchent à vendre en quelques années tous ces actifs qui sont bien peu actifs à notre sens.

Le Portugal attire de nombreux retraités français : ce sont des gens qui ont travaillé et contribué en France mais qui partent ensuite au Portugal dépenser leurs retraites. D'ailleurs, la même question s'est posée entre la France et le Danemark, qui a dénoncé la convention fiscale avec la France en raison des retraités danois vivant en France.

En effet, c'est le principe de la liberté de circulation qui conduit à ces situations, qui ne sont pas nouvelles et que l'on connaît aussi au Maroc ou en Algérie. Ce qui est nouveau, ce sont les conditions favorables offertes par certains pays aux retraités ; il faudrait regarder si ces régimes sont compatibles avec les conventions fiscales.

J'appelle votre attention sur le fait qu'il s'agit là de retraites importantes, qui souvent investissent et construisent.
Ces pays dits périphériques critiquent souvent les exigences posées par l'Union européenne pour leurs comptes publics, mais je me pose la question, à l'inverse, de savoir où en seraient ces pays s'ils n'étaient pas dans l'Union européenne ; je crois que l'Europe a maintenant pour rôle de les aider à retrouver une trajectoire économique saine.
Enfin, je crois que l'on voit là aussi les excès du fédéralisme : l'Assemblée des régions de France, à laquelle je siège, demande de plus en plus de décentralisation et un pouvoir réglementaire ; j'y ai toujours été réticent, car l'on peut se demander si cela ne risquerait pas de conduire aux mêmes excès que l'autonomie en Espagne, sachant que le fédéralisme de chaque pays présente des différences et des réussites variables.

S'agissant des collectivités locales, elles sont dans ces pays pris dans un effet ciseau d'augmentation des besoins et de baisse des recettes. Je fais le rapprochement avec les situations que Claude Raynal et moi avons vues en Autriche et en Italie : dans les États fédéraux, les États fédérés doivent décliner le pacte de stabilité à l'échelle locale, ce qui n'est pas le cas chez nous. Je me demande si cet aspect du fédéralisme n'est pas salutaire, en confrontant directement les collectivités aux difficultés budgétaires, alors que le fonctionnement par dotations masque parfois certaines réalités.

Lors de l'élargissement de l'Union européenne à dix pays, certaines régions du Portugal et de l'Espagne sont quasiment passées du statut de privilégiées à celui de contributrices aux fonds régionaux. Elles ont été contraintes de s'endetter fortement et ont joué sur le levier de la construction immobilière, ce qui a conduit aux excès et aux problèmes actuels. Je crois que cela a été mal pensé au moment de l'élargissement.

Je tiens à préciser que je ne souhaite évidemment pas qu'il arrive la même chose à la France, mais je crois qu'il faut tirer les leçons, positives et négatives, de cette expérience pour la France. S'agissant des collectivités, je crois qu'il faut que nous soyons vigilants pour ne pas arriver à des situations budgétaires qui nous obligeraient à prendre des mesures aussi draconiennes que celles qui ont été prises dans ces pays.
La commission donne acte de sa communication à Mme Michèle André, présidente.

Notre cycle d'auditions préparatoires à l'examen du projet de loi de règlement s'achève avec celle de Anthony Requin, que nous n'avons pas encore eu l'occasion de recevoir depuis sa prise de fonction comme directeur général de l'Agence France Trésor (AFT), le 6 mars.
En 2014, les dépenses au titre de la charge de la dette ont été inférieures à la prévision initiale, dans une conjoncture de taux très bas mais aussi grâce à la politique de gestion active de la dette de l'État par l'AFT. Cette charge étant très sensible au niveau des taux, il est particulièrement intéressant de vous entendre dans le contexte actuel de la zone euro.
Auditions de Mme Catherine Henton directeur fiscal de sanofi-aventis Mm. édouard Marcus sous-directeur de la prospective et des relations internationales à la direction de la législation fiscale dlf et raffaele russo chef du projet beps centre de politique et d'administration fiscales de l'ocde sera publié ultérieurement

Anthony Requin cherche des investisseurs prêts à acheter nos emprunts au prix le plus bas possible, mais il n'est responsable ni de l'inflation, ni de la croissance, ni des taux d'intérêt. Il hérite d'une situation de plus en plus difficile, qu'il ne maîtrise pas. Quel niveau de taux d'intérêt peut-on supporter ? La hausse d'un point entraîne une hausse de dépense de 2,4 milliards d'euros en 2015 et jusqu'à 7 milliards d'euros en 2017, ce qui est considérable. Quel est le niveau de croissance indispensable ? La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) a emprunté 18,2 milliards d'euros en 2014 pour financer les déficits accumulés de la Sécurité sociale. Est-ce raisonnable ? Nous laissons la dette s'accroître, par l'augmentation continue du déficit budgétaire et des emprunts, qu'il faut ensuite rembourser. Nous vivons aux crochets des autres. Nous serons perdus le jour où ils ne répondront plus à nos émissions.
Les emprunts effectués en 2007 et 2008, d'un montant important, devront être remboursés en 2015 et 2016, ce qui augmentera nos emprunts et explique peut-être la hausse de 50 milliards d'euros de la dette.
Le Gouvernement continue d'augmenter les dépenses - nous évoquions le droit d'asile tout à l'heure - et ce, sans aucune efficacité. Nous n'avons plus d'argent, mais nous nous endettons, sans écouter les recommandations de la Cour des Comptes, de la Banque de France ni de l'Union européenne. La situation est grave. Chaque année le budget est construit sur des recettes trop élevées et les réductions de dépense trop faibles.
Quelles seraient les conséquences d'une sortie de la Grèce de la zone euro ? Ne risque-t-on pas une hausse des taux d'intérêt de nos emprunts, menant à une cessation de paiement ? Nous sommes soumis à la bonne volonté des emprunteurs étrangers.
Auditions de Mme Catherine Henton directeur fiscal de sanofi-aventis Mm. édouard Marcus sous-directeur de la prospective et des relations internationales à la direction de la législation fiscale dlf et raffaele russo chef du projet beps centre de politique et d'administration fiscales de l'ocde sera publié ultérieurement

Je pose la même question que le rapporteur spécial, Serge Dassault, sur la sortie de la Grèce de la zone euro. Le stock de dette a augmenté de 50 milliards d'euros en trois mois, ce qui la porte à 2 088 milliards d'euros. En politique d'émission, existe-t-il un phénomène de saisonnalité ? Emprunte-t-on plus au premier trimestre ? Est-ce lié à une situation d'opportunité ? Comment la politique d'émission de dette indexée sur l'inflation est-elle déterminée ? Il est paradoxal d'emprunter à taux variable alors qu'une hausse de l'inflation est annoncée.
La CADES emprunte parfois en devises, contrairement à l'Agence France Trésor. Pourquoi ?
Les collectivités territoriales risquent de se désengager de l'investissement public en raison de la baisse de leurs dotations. Ne pourrait-on pas dégager une marge de manoeuvre en favorisant l'emprunt à de meilleures conditions ? Celles-ci, aujourd'hui, sont plus défavorables pour les collectivités territoriales que pour l'État alors que leur situation est souvent plus saine. Le stock de dettes des collectivités est de 170 milliards d'euros, contre plus de 2 000 milliards d'euros pour l'État. Or elles assurent les deux tiers de l'investissement public civil.
Pour ce qui est de la sensibilité de la charge de la dette à une hausse des taux d'intérêt, je vous renvoie à l'analyse que nous produisons dans le cadre de la préparation de la loi de finances, et qui analyse l'impact d'une hausse des taux de 1 % au 1er janvier. Une augmentation de cent points de base par rapport à notre scénario de référence entraîne, la première année, un alourdissement de la charge de la dette de 2,4 milliards d'euros, en comptabilité maastrichtienne. Cet alourdissement est en partie imputable à la dette de court terme. Ce cas est très théorique, mais donne un ordre de grandeur. Sur les emprunts de moyen et long terme, la maturité moyenne de la dette française étant de sept ans, l'impact se fait sentir progressivement, au fil des renouvellements.
Les chocs de taux ne sont pas si brutaux, même si, entre avril et mai, la hausse a été voisine de 100 points de base. La transmission de ce choc de taux est généralement progressive, avec un décalage d'un an, notamment sur la partie moyen et long terme de la dette. C'est pourquoi la hausse est assez sensible dès la deuxième année, à 5,3 milliards d'euros, au moment où les coupons des titres à moyen et long terme émis en 2015 sont payés, avec une augmentation de cent points de base.
Sans hypothèse particulière sur l'inflation. En étudiant l'évolution des taux à dix ans entre janvier et avril 2015, on constate que, s'agissant de la France, les taux ont d'abord baissé d'environ 0,55 %, jusqu'à 0,33 % (point atteint le 16 avril) avant de remonter. Ils sont actuellement stabilisés autour de 1,20 %.
En allongeant la période de référence au 1er janvier 2014, on relativise cette hausse des taux : nous sommes revenus aujourd'hui aux niveaux connus avant le discours de M. Mario Draghi à Jackson Hole annonçant la mise en place par la Banque centrale européenne (BCE) du quantitative easing, programme d'achats de titres du secteur public (PSPP). Les conditions de taux sont équivalentes à celles qui prévalaient au moment de la construction du budget 2015.
Si l'on recule plus encore la période de référence, pour mettre en perspective les conditions de taux actuelles au regard de celle prévalant en 2007, que constate-t-on ? En 2007, le niveau des taux était de 4 à 4,5 %. Depuis, nous bénéficions de conditions extrêmement favorables, et les hypothèses de la loi de finances initiale pour 2015 ne devraient pas être démenties. Grâce à des taux plus faibles que prévu en début d'année, il est encore possible de réaliser la prévision du Gouvernement établie dans le cadre du programme de stabilité de 1,2 milliard d'économies sur la charge de la dette moyen long terme. Il n'y aura pas de mauvaise surprise. En 2015, grâce à une inflation plus faible que prévu, nous économiserons environ 1,5 milliard d'euros sur la charge de la dette.
Je suis extrêmement prudent au sujet de la Grèce. Il est délicat de prévoir la réaction des marchés. Celle-ci est, à ce stade, modérée et sans panique. Lundi, à l'ouverture des marchés, en raison d'un mouvement de fuite vers la qualité, l'écart de taux a augmenté de 8 points de base entre la France et l'Allemagne, et de 35 à 40 points de base entre l'Allemagne et l'Italie ou l'Espagne. En fin de journée, ces hausses s'étaient réduites à 4 points de base pour la France et environ 20 pour l'Italie et l'Espagne.
En revanche, le niveau absolu des taux a baissé. Le taux d'emprunt à dix ans de la France a perdu 4 à 5 points de base. Sa dette reste perçue comme solide. Si les marchés se montrent calmes c'est aussi peut-être parce que la BCE peut intervenir à tout moment via les programmes PSPP et les opérations monétaires sur titres (OMT), et parce qu'ils avaient déjà intégré l'aggravation de la situation en Grèce.
Une partie de la hausse du stock de dette au premier trimestre résulte du déficit, 74 milliards d'euros pour 2015, qu'il faut financer. Le cycle infra-annuel de trésorerie explique aussi une part de la hausse, car nous accumulons une encaisse. Ce cycle n'est pas propre seulement à l'État mais aussi aux autres entités publiques. La CADES, par exemple, exécute l'essentiel de son programme annuel de financement au premier semestre, ce qui pèse dans le niveau de dette brute émise. D'importants amortissements de l'État sont intervenus fin avril - 34 milliards d'euros d'amortissements de dette (capital et intérêt) dont 15 milliards de coupons d'intérêts devaient être versés - et d'autres auront lieu fin juillet. Aussi doit-on prévoir une encaisse de trésorerie. Il ne s'agit pas d'un dérapage de l'endettement.

Comment l'endettement de l'État a-t-il progressé de plus de 50 milliards d'euros en un trimestre ?
Ce chiffre concerne l'ensemble des administrations publiques, ce qui comprend les collectivités territoriales et les administrations de sécurité sociale.
Les administrations de sécurité sociale dont la CADES et l'ACOSS représentent 16 milliards d'euros et l'État 37 milliards.

Une dette arrivée à maturité financée par une autre dette ne se traduit pas par une augmentation.
Le programme d'émission est linéaire tout au long de l'année, mais il faut bâtir une encaisse de trésorerie pour le mois d'avril. Les 50 milliards d'euros doivent se trouver sur le compte du Trésor à cette date, ce qui suppose d'émettre davantage. Le delta entre la fin du premier trimestre et la fin de l'année précédente correspond à de la dette brute supplémentaire de l'État.

La hausse de 50 milliards d'euros n'est-elle pas due aux remboursements et aux coupons ?
Il n'y a pas de dérive de la charge de coupons ou de principal à rembourser. Je vous renvoie à notre rapport annuel, dans lequel est détaillé le cycle infra-annuel de trésorerie de l'État. Les points hauts et bas dépendent du rythme d'encaissement des impôts, des dépenses et des amortissements sur la charge de la dette. Il n'est pas nécessaire de disposer de grosses encaisses de trésorerie en fin d'année puisqu'aucun amortissement de coupon ou de principal n'est effectué en janvier. Les premiers ont lieu fin février.
À la fin du premier trimestre, elle s'élevait à 2 089 milliards d'euros.
Je ne dispose pas de ce chiffre précis avec moi mais la projection de dette sur PIB devrait être respectée.
Elle devrait représenter 96,3 % du produit intérieur brut (PIB) en fin d'année, toutes administrations publiques confondues. En revanche, les rebasages de niveau de PIB par l'Insee peuvent augmenter légèrement. Il s'agit de la seule variable de nature à modifier l'objectif.
S'agissant de la dette indexée, la France émet des titres indexés sur l'inflation française depuis 1998, et sur l'inflation européenne depuis 2001. Cela représente aujourd'hui 170 milliards d'euros d'encours. Elle possède le marché le plus profond en titres indexés, avec un objectif de 10 % de l'encours total de la dette. Ces titres ont un intérêt particulier pour certains investisseurs qui ont besoin de se couvrir contre le risque d'inflation. Tous les gestionnaires de livrets bancaires et livrets A en achètent ; les fonds de pension néerlandais par exemple en sont friands également, comme les investisseurs de très long terme. L'intérêt de l'État est de capturer la prime d'inflation que les investisseurs sont prêts à payer, afin d'émettre à un coût moindre et de diversifier la base d'investisseurs.
Enfin, l'effet contracyclique est intéressant pour le budget de l'État. En cas de ralentissement de la croissance, celle-ci provoque une baisse des recettes fiscales, mais également un ralentissement de l'inflation. On retrouve pour partie en moindre charge ce qu'on perd en recettes fiscales. La charge d'intérêts de l'État a ainsi été amoindrie de 1,9 milliard d'euros en 2014 par l'indexation d'une partie de la dette sur l'inflation, et de 1,5 milliard d'euros en 2015.
La CADES émet un tiers environ de son programme en devises diverses (dollar, yen, franc suisse, dollar australien, dollar canadien) afin de profiter d'opportunités et de taux d'intérêt attractifs. Elle couvre le risque de change en swappant ses émissions en euros. L'État émet exclusivement en euros, de trois mois à cinquante ans, de façon prévisible et transparente. Émettre en devises, ce serait rompre avec la régularité, réaliser des coups en opportunité, sans pouvoir garantir un volume d'émissions à venir dans cette devise, ni couvrir toutes les maturités. Il s'agirait d'un changement complet d'attitude et de stratégie.
L'État et la CADES se répartissent les univers d'investisseurs. Les États-Unis émettent en dollars américains, la Chine en renminbis, et non dans une autre monnaie. L'Allemagne n'a réalisé qu'une seule opération en devises, en 2009. La France n'a pas ce projet, à ce stade.
Les collectivités territoriales n'ont pas toutes la même notation que l'État. Elles émettent à des coûts plus importants car leurs opérations sont petites et ponctuelles, contrairement à l'État qui est un émetteur régulier, entretenant une courbe des taux entière, avec des souches extrêmement liquides, ce qui est un grand avantage. Une cinquantaine de collectivités se sont rassemblées pour attirer des investisseurs par des émissions groupées à travers l'Agence France Locale. Les taux d'intérêt, la qualité du crédit et la liquidité de la dette attirent les investisseurs.

La qualité du travail et le professionnalisme de l'Agence France Trésor lui confèrent une excellente image à l'extérieur ainsi que sur les marchés financiers. L'opinion des banques spécialistes en valeur du Trésor est extrêmement positive, en partie parce que l'action de l'agence est prévisible et rassurante. Son efficacité réduit de quelques points de base le coût de l'emprunt pour la France.
On dit que la dette très importante du Japon n'est pas grave puisqu'elle est financée par l'épargne japonaise. On dit aussi que les Français épargnent beaucoup et qu'une grande partie de la dette française est étrangère. Quel en est le ratio, et est-il important que l'épargne française couvre la dette de la France ?

Le secrétaire d'État au budget Christian Eckert nous a rassurés il y a quelques semaines en déclarant que le budget de l'État était à l'abri d'une évolution défavorable des taux d'intérêt puisque la quasi-totalité du programme était déjà réalisé. Le confirmez-vous ? À partir de quel niveau de taux la prévision budgétaire des intérêts à payer serait-elle dépassée ?

La part des collectivités territoriales est stable. Elle ne devrait pas être agrégée avec celle de l'État, les deux n'ayant aucun rapport. La première correspond à de l'investissement, la seconde à du déficit. C'est insupportable. Je ne suis pas du tout certaine que cet agrégat pénalise l'État. Il serait important de pouvoir constater ce qu'apportent les collectivités territoriales dans la trésorerie. On leur en demande trop.

Quel est le montant de la dette en valeur absolue ? Les 96,3 % du PIB de fin de l'année signifient-ils un montant supérieur aux 2 089 milliards d'euros cités plus tôt ? La hausse de 1 % des taux en 2015 ajoute 2,4 milliards d'euros de charge d'intérêts. Sur quel taux d'intérêt moyen vous êtes-vous appuyés pour conclure à 1,2 milliard d'euros d'économies ?

J'ai noté que la prévision 2017 montre l'amorce d'une décrue du rapport entre la dette publique et le PIB. Nous sommes proches de 100 %. Cela inquiète nos concitoyens et il faut effectivement une décrue. L'évolution n'est pas liée à une surestimation de l'évolution du PIB, ni volontaire et ni involontaire d'ailleurs. J'imagine donc qu'elle repose sur des hypothèses de taux d'intérêt et de réduction des déficits publics. Comment arrive-t-on à ce recul du ratio d'endettement public ?

Quel est l'impact de l'évolution des taux d'intérêt sur la charge de la dette, qui a été réajustée à la baisse, à 43 milliards d'euros cette année ? Quelle est votre évaluation de l'évolution de la charge de la dette des trois ou cinq prochaines années en cas de hausse de 1 % des taux d'intérêt ?

Votre prévision d'une montée modeste mais régulière des taux est liée à la politique de la BCE. Quelle est votre hypothèse quant à la Federal Reserve, pour 2015-2016 ? Elle danse un tango, je n'ose pas dire argentin mais américain depuis six à huit mois, l'annonce d'une hausse du taux de base n'étant jamais suivie d'effet.

La France tire profit de la fuite vers la qualité, dites-vous. Cela flatte l'ego national. Mais pour combien de temps ? Quelle est la définition de la qualité ? Depuis 2007, 54 pays émergents ont fait l'objet de 189 relèvements par les différentes agences de notation. Le risque émergent devient de plus et plus acceptable. Les hiérarchies peuvent-elles s'inverser, et quand ?

Il faut distinguer entre l'endettement pour investir et l'endettement pour combler le déficit. L'État rembourse la charge, les collectivités territoriales remboursent la charge et le stock. Il serait intéressant d'établir des comparaisons. Avez-vous une solution pour que les collectivités ne remboursent plus que la charge ?

Le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) prévoit que les États-membres transmettent leur programme d'émissions de dettes à la Commission européenne afin que celle-ci en assure la coordination. Comment cette coordination se traduit-elle concrètement ?
Notre dette est détenue à 64 % par des non-résidents. Les 35 % restants sont détenus par des résidents à hauteur de 20 % environ par les compagnies d'assurance, à 10 % par les institutions bancaires, le reste l'étant par des gestionnaires d'actifs, selon des données de la Banque de France. Sur les 65 % détenus par des non-résidents, à travers des enquêtes du FMI, on peut estimer que la moitié l'est par des investisseurs de la zone euro. Les autres appartiennent à des catégories et des zones géographiques diverses. Depuis 2007, la moitié des achats nets de dette française environ est réalisée par des banques centrales, qui ont accumulé d'importantes réserves qu'elles se soucient de ne pas placer uniquement en dollars, et qui recherchent des dettes de qualité, liquides et offrant un rendement. Assez peu sensibles au niveau des taux d'intérêt, elles ont tendance à détenir la dette jusqu'à son échéance, ce qui en fait des détenteurs peu volatils. Ainsi, en 2011, alors que des résidents ont pu vendre notre dette, les banques centrales du monde entier continuaient à en acheter.
Au Japon, l'épargne des ménages est très élevée et supérieure à l'endettement public. Elle finance aisément des déficits importants à des taux d'intérêt très faibles.
Le taux d'exécution de notre programme s'établit aujourd'hui à 68 %, soit un taux d'exécution en ligne avec les années précédentes. La charge de notre dette en 2015 est quasiment fixée, puisque ce n'est qu'à l'année n+1 qu'il faut s'acquitter du coupon plein de la dette émise l'année n. Comme a pu vous l'indiquer Monsieur Eckert, nous sommes en 2015 dans une situation confortable. Comme la charge d'indexation est déterminée par l'évolution des prix de mai à mai, il n'y a plus d'aléas liés à l'inflation pour le reste de l'année. De plus, cette évolution a été significativement inférieure aux prévisions de la loi de finances initiale : en France, 0,3 % au lieu de 0,8 %, et 0,2 % au lieu de 1 % en Europe. Nous économisons environ 1,5 milliard d'euros. La remontée des taux longs ne devrait pas avoir d'impact sur la charge budgétaire, car nous avions prévu un niveau plus élevé qu'il ne l'a été fin 2014 et début 2015, et leur hausse actuelle n'aura un plein impact que dans un an. Aussi la charge budgétaire de la dette en 2015 ne pourrait s'accroître que sous l'effet d'un choc très violent sur les taux courts. Notre dette à moyen ou long terme s'élève environ à 1 400 milliards d'euros, et notre endettement à court terme à 170 milliards d'euros. Les bons du Trésor à trois, six ou douze mois subiraient de plein fouet l'effet d'une hausse des taux courts. Cependant, celle-ci ne semble pas devoir se produire. Actuellement, nous empruntons même à des taux négatifs : environ - 0,19 % pour les emprunts à trois, six ou douze mois, au lieu des 0,05 % prévus au moment de la loi de finances.
C'est la comptabilité maastrichtienne qui agrège l'ensemble des dettes publiques, y compris celles des collectivités territoriales. La loi prévoit qu'en dernier recours, c'est l'État qui est d'une certaine mesure garant en dernier ressort les dettes des collectivités territoriales, c'est pourquoi elles sont incluses dans le périmètre.
Le rapport entre dette et PIB devrait atteindre en 2016 un maximum de 97 %, si l'on tient compte des opérations de soutien aux États de la zone euro, dont la Grèce. Puis il baissera légèrement, à 96,9 %, en 2017. La France a présenté aux autorités européennes sa trajectoire budgétaire, qui repose sur des hypothèses de croissance relativement prudentes : 1 % cette année et 1,5 % l'an prochain, quand l'OCDE, l'Union européenne ou le FMI tablent respectivement sur 1,2 % en 2015 et entre 1,5 et 1,8 % en 2016. Quant aux projections de taux d'intérêt présentées dans le programme de stabilité, elles prévoient, sur les OAT à dix ans, une augmentation des taux longs de 90 points de base en 2016, puis en 2017 et encore 50 points de base l'année suivante. Nous prévoyons un relèvement des taux d'intérêt courts de la Banque centrale européenne (BCE) à la fin des mesures d'assouplissement quantitatif, à partir de septembre 2016. Dans ce scénario, l'augmentation de la charge de la dette serait compensée par la hausse de la croissance et de l'inflation.
Quant à la mesure de la sensibilité de la dette, je vous renvoie aux chiffres mesurant l'impact d'une hausse de 1 % sur la charge de la dette de l'État, puisque celle-ci représente 80 % de la dette publique.
La hausse des taux de la Fed est intégrée dans nos hypothèses d'évolution des taux longs (90 points de base). Le relèvement interviendra-t-il en 2015, en 2016 ? Quelles annonces seront faites ? Quel sera le rythme et l'ampleur du relèvement ? Nous étudierons attentivement les prochaines communications de la Fed, afin d'en tenir compte dans le projet de loi de finances pour 2016.
Combien de temps durera la fuite vers la qualité ? Aussi longtemps que nous tiendrons nos engagements, les marchés continueront à nous faire crédit. Les hiérarchies se transforment lorsque les agences de notation modifient leurs notes ou lorsque les politiques économiques s'infléchissent.
Dans le programme de financement de l'État, sur les 187 milliards d'euros d'émissions à moyen long terme prévus en 2015, 74,4 milliards couvrent le déficit budgétaire, et 116 milliards amortissent la dette de moyen long terme. Comme les collectivités territoriales, l'État doit régulièrement amortir ou « roller » des encours de dette. Si sa comptabilité n'est pas soumise aux mêmes règles que celles d'une collectivité territoriale, il doit cependant respecter les traités européens.
La France communique chaque année en décembre son programme d'émission aux marchés ainsi qu'à la Commission européenne, comme les autres États membres. Nous précisons ensuite chaque trimestre les dates d'adjudication et l'ampleur des émissions que nous entendons réaliser. L'Allemagne annonce avec une grande précision le type d'émission qu'elle réalisera ; nous annonçons simplement aux marchés que, chaque premier jeudi du mois, nous émettrons des titres de maturité comprise entre sept et cinquante ans, et chaque troisième jeudi des titres entre deux et sept ans ainsi que des titres indexés sur l'inflation. Une semaine avant l'émission, nous choisissons la maturité des titres émises, après écoute des recommandations des Spécialistes en Valeurs du Trésor, afin de coller aux besoins du marché et émettre ainsi à meilleur prix.

Merci. Ces questions nous intéressent, et nous aurons l'occasion de vous entendre à nouveau dans l'avenir !
Diplomatie fiscale de la france en faveur de ses entreprises
Auditions de Mme Catherine Henton directeur fiscal de sanofi-aventis Mm. édouard Marcus sous-directeur de la prospective et des relations internationales à la direction de la législation fiscale dlf et raffaele russo chef du projet beps centre de politique et d'administration fiscales de l'ocde

L'audition de ce matin est consacrée à la diplomatie fiscale de la France en faveur de ses entreprises. Le sujet revêt une importance particulière à l'heure où l'OCDE prépare, dans le cadre du projet BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), une série de propositions visant à lutter contre les transferts artificiels de bénéfices. Il s'agit concrètement d'identifier les principales « failles » de la fiscalité internationale qui permettent aux grandes entreprises de minorer leur résultat et de réduire ainsi leur impôt. Ces travaux, auxquels la France prend une part active, seront présentés au G20 de novembre prochain à Antalya en Turquie.
Nous débattons des grands principes de ce projet depuis plusieurs années, et nous parvenons aujourd'hui à la phase de travaux pratiques. Ainsi, les entreprises découvrent concrètement ce qu'impliqueraient pour elles les règles imaginées par l'OCDE, et notamment les nouveaux modes de calcul des « prix de transfert » - ces transactions qui ont lieu entre les entités d'un même groupe et qui déterminent la localisation de la base taxable. L'obligation de « déclaration pays par pays » des bénéfices réalisés et des impôts payés est une autre mesure phare dont il faut étudier les modalités d'application.
Au-delà du seul projet BEPS, la question se pose de savoir si la France dispose d'une doctrine en matière de conventions fiscales, notamment lorsqu'il s'agit de négocier telle ou telle clause applicable aux entreprises. En un mot, la France mène-t-elle une diplomatie fiscale cohérente, active et efficace ?
Afin de nous éclairer sur ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir : Catherine Henton, directeur fiscal de Sanofi-Aventis ; Raffaele Russo, chef du projet BEPS au Centre de politique et d'administration fiscales de l'OCDE, dirigé par Pascal Saint-Amans que nous avons déjà entendu plusieurs fois ; et Édouard Marcus, sous-directeur de la prospective et des relations internationales à la direction de la législation fiscale (DLF). Cette audition n'est pas ouverte à la presse.
Je passe la parole à Catherine Henton, directeur fiscal de Sanofi-Aventis. Ce groupe pharmaceutique fait partie des entreprises les plus concernées par le projet BEPS : il réalise près de 90 % de son chiffre d'affaires à l'international, et la rémunération des brevets et autres incorporels représente pour lui un enjeu crucial.
S'il a réalisé, en 2014, 93 % de ses ventes hors de France, le groupe Sanofi-Aventis est, contrairement à d'autres groupes, ancré dans notre pays : 27 000 de ses 110 000 employés y travaillent, parmi lesquels 6 000 chercheurs, ce qui fait de lui le premier investisseur français en recherche et développement (R&D) en France. En 2013, il a été le quatrième exportateur français, après Airbus et l'industrie automobile, contribuant positivement à notre balance commerciale à hauteur de 5 milliards d'euros.
Sanofi-Aventis est concerné au premier chef par le projet BEPS, puisque les brevets sont, en pharmacie, le nerf de la guerre. Garantissant l'exclusivité sur un marché pendant quelques temps, ils incorporent une valeur considérable. Notre groupe est non seulement très diversifié - vaccins, santé animale, médicaments avec ou sans prescription ou et médicaments hospitaliers - mais aussi très intégré, de la R&D jusqu'à la fabrication, et s'occupe donc de chimie, de pharmacie, de biotechnologies, contrairement à certains groupes qui ont choisi un modèle de développement « sans usines ».
Nous sommes un groupe français, dont le siège est en France, tout comme celui du pôle vaccins et santé animale. Notre groupe s'est beaucoup construit par des acquisitions, d'abord françaises dans les années 1980 et 1990, puis internationales. C'est pourquoi nos brevets ne sont pas tous en France : lorsque nous avons acheté le groupe Genzyme, ses brevets sont restés aux États-Unis. Déplacer de tels incorporels, qui intègrent une telle valeur, coûte cher.
J'illustrerai la problématique des prix de transfert par un exemple.
Nous nous apprêtons à obtenir une homologation d'un vaccin contre la dengue, maladie transmise par le moustique et répandue essentiellement dans l'hémisphère Sud. Si la recherche a été conduite en France, il a fallu effectuer les tests de performance et d'innocuité là où sont les patients, c'est-à-dire à l'étranger. L'Europe ne permet pas de breveter le vivant, mais certains brevets de fabrication sont déposés en France. L'action 5 du projet BEPS, qui conditionnerait l'obtention d'un régime favorable sur un brevet à la réalisation en France de l'intégralité des opérations de R&D, ne manquerait pas de causer des difficultés.
Pour vendre ce vaccin au Brésil, nous devrons d'abord le vendre à notre filiale, le Brésil exigeant - comme de nombreux pays - un interlocuteur local. À quel prix de transfert ? Le vaccin sera réalisé en France, dans une usine que nous avons dû construire avant d'obtenir l'homologation, et qui représente un investissement de 300 millions d'euros. Les dépenses de R&D, elles, se sont étalées sur 20 ans, pour un total d'environ 600 millions d'euros. Si le prix de vente au Brésil est de 100, le prix de revient de 50 et les coûts de commercialisation de 20, le profit consolidé sera de 30. Un prix de transfert de 50 facturé à notre filiale serait inacceptable, car il ne permettrait pas de financer notre R&D. Comment déterminer le bon niveau ? Du point de vue français, cette innovation majeure qui résout un problème de santé publique a une valeur élevée : 70, ou 75. À quoi le Brésil rétorquera que c'est son marché qui paie le médicament, et qu'il a droit, sur un profit de 30, à une base taxable de 20. Les prix de transfert ne sont donc pas des mesures d'optimisation : ce sont des prix de cession, souvent difficiles à fixer.
Jusqu'alors, les principes de l'OCDE, s'ils ont été difficiles à déterminer, l'avaient été dans un consensus. La nouveauté, avec BEPS, est que l'on sort de cette logique consensuelle. Ce n'est pas grave, pourvu que les grands pays acceptent les nouveaux principes, afin d'éviter la double imposition. Il faut se souvenir que BEPS est né du scandale des GAFA (Google, Apple, Amazon, Facebook), qui ont logé leurs incorporels dans des pays à la fiscalité et au climat favorables...
Les plus importants ne sont pas là.
La France est dotée d'un outil législatif puissant, l'article 209 B du code général des impôts, qui lui permet de taxer immédiatement les groupes français lorsqu'ils réalisent des profits importants dans des pays où ils n'ont pas d'activité. Les concurrents de Sanofi-Aventis sont des groupes américains, suisses ou anglais. Les premiers ont des cash boxes dans les Caraïbes ou dans certaines îles d'Asie. Leur régime fiscal le permet : il ne comporte pas de disposition comparable à notre article 209 B du code général des impôts. Nous pensons que les États-Unis souhaiteront conserver leur régime, qui permet à leurs entreprises de stocker à bas coût près de 2 000 milliards de dollars. Puisqu'elles ne peuvent rapatrier ces sommes, elles les utilisent pour mener à l'étranger des politiques d'acquisition très agressives, face auxquelles nous sommes démunis. Ainsi, la concurrence fiscale entrave la concurrence ! Nous ne souhaitons donc pas le statu quo. Mais il importe que les États-Unis, la Chine, l'Inde ou le Brésil appliquent les nouveaux principes, notamment de transparence, en même temps que nous.
Le projet BEPS vise à obliger les entreprises à déclarer à l'administration fiscale la répartition géographique de leurs profits - comme nous le faisons déjà lors des contrôles sur les prix de transferts. Certains proposent même d'aller plus loin en obligeant les entreprises à publier cette information dans leurs rapports annuels, ce qui la rendra accessible au monde entier. Après tout, pourquoi pas ? Nous n'avons rien à cacher. Mais si nous sommes les seuls à le faire, nos concurrents en tireront avantage. Il n'est pas toujours bon d'être le premier ! Certains pays s'opposent au reporting pays par pays. Voyez la lettre du Congrès américain à l'administration fiscale américaine, s'étonnant de la position prise par le fisc américain sur la question. La France doit-elle transmettre ces informations sans réciprocité ? Nous sommes inquiets, même si l'on nous assure que ce reporting n'est pas fait pour conduire à des redressements, mais simplement pour détecter des profils de risque.
Déjà, certains pays, notamment parmi les BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine), s'appuient sur les principes BEPS dans leurs contrôles fiscaux. Ces pays se plaignent du fait que les entreprises ne laissent pas assez de profits taxables dans les pays où elles vendent leurs produits. S'ils décident d'agir pour que nous changions nos prix de transferts, nous qui exportons depuis la France, l'Allemagne et les États-Unis, devrons baisser ces prix pour éviter la double imposition. Nous nous y préparons déjà. Ces pays expliquent que les incorporels ne valent rien sans marchés solvables. Les exemples abondent déjà, comme ceux de BMW ou du lait breton en Chine. Même le Canada nous a redressés sur une répartition de profits.
Vu de l'extérieur, on pourrait croire qu'il suffit, comme le prévoit BEPS, de répartir les profits entre pays en fonction de quelques critères. Mais c'est une vision naïve. Cela suppose l'accord de tous. Actuellement, pour chasser l'abus, on attrape tout le monde ! Il faudrait étudier l'impact des propositions avancées. Par exemple, les principes BEPS permettraient sans doute de mieux taxer les GAFA, mais a-t-on mesuré les pertes de recettes fiscales qu'ils occasionneraient pour des entreprises telles que Sanofi-Aventis ou LVMH ? On ne peut pas à la fois prétendre face à Apple que c'est le marché des consommateurs qui compte, et tenir un discours inverse à la Chine ou au Brésil... Nous participons activement aux discussions sur le projet BEPS. Dans sa mise en oeuvre, il faudra ne pas se hâter et bien veiller à ce que nos partenaires avancent au même rythme.

Merci. La parole est maintenant à Raffaele Russo, chef du projet BEPS, qui nous présentera les propositions de l'OCDE et nous dira comment répondre aux inquiétudes exprimées.
BEPS n'est pas né uniquement du scandale des GAFA mais d'une période de crise, de hausse des impôts et d'austérité ; des journalistes, des commissions d'enquête ou tout simplement la société civile ont dénoncé les montages légaux par lesquels des entreprises déplacent leurs bénéfices dans des pays où elles n'ont aucune activité. Très vite, certains pays ont réagi unilatéralement et sans coordination. Par exemple, la Mongolie a dénoncé ses conventions fiscales, au motif qu'elle ne parvenait plus à collecter suffisamment d'impôts.
Le problème ne vient pas des entreprises, il vient des règles. Or ces règles n'ont pas changé depuis un siècle. Il faut donc tout réexaminer, le faire ensemble, tous en même temps. Tout est mis sur la table : les prix de transferts, les conventions bilatérales contre la double imposition, les dispositions de loi interne ayant un impact direct sur la fiscalité internationale, la déductibilité des intérêts... Un de vos concurrents, un groupe pharmaceutique, a une dette extérieure de 800 millions d'euros et une dette interne de 10 milliards d'euros ! Les pays du G20, ceux de l'OCDE et certains pays en voie de développement travaillent donc de concert à réformer ces règles ; ces pays représentent environ 90 % du PIB mondial.
Nous avons beaucoup écouté les parties prenantes : en un an et demi, nous avons reçu plus de 12 000 pages de commentaires et tenu 21 consultations publiques. Nous présenterons les résultats de nos travaux en novembre. Certes, il n'y a pas de consensus. Peut-être en avons-nous donné à tort l'impression en publiant des versions provisoires de nos textes, qui intégraient toutes les propositions. En novembre 2015, soit il y aura un consensus, soit il n'y aura rien.
Nous avons beaucoup avancé sur les prix de transferts. Une lecture formaliste des règles actuelles aboutit à ce que 2 000 milliards de dollars soient stockés aux Bermudes. Mais respecte-t-elle l'esprit des contrats ? Dans l'application d'un contrat, il faut se tenir à égale distance de l'interprétation littérale et de la méconnaissance. Nous sommes déjà parvenus à un accord sur la manière de taxer les bénéfices tirés de la présence sur un marché où des synergies internes à un grand groupe. Notre but principal est de prévenir les doubles impositions, mais aussi les doubles non-impositions !
La concurrence fiscale doit être encadrée. Les patent boxes, par exemple, doivent être réprimées si elles visent uniquement à attirer artificiellement des bénéfices. Si elles attirent des activités de R&D, aucun problème ! Certes, la complexité des normes n'arrange rien. Chacun veille à ne pas être le premier à les appliquer. Comme disent les Anglais, il faut se jeter tous ensemble dans la piscine.
Après novembre 2015, il faudra aider chaque pays à mettre en oeuvre les nouvelles mesures et surveiller leur application, tout en menant à leur terme les discussions techniques sur une nouvelle convention multilatérale et en modifiant les conventions bilatérales en cours. Des changements fondamentaux sont à l'oeuvre, malgré les divergences entre les pays associés aux discussions, qui sont plus de quarante. Les nouvelles mesures qui seront arrêtées auront un impact sur la fiscalité des entreprises. Ainsi, les États pourront baisser les impôts et favoriser l'investissement de façon transparente.

Bel optimisme ! Édouard Marcus, sous-directeur de la prospective et des relations internationales à la direction de la législation fiscale (DLF), va sans doute nous en dire un peu plus sur la doctrine de la France en matière de conventions fiscales et sur le projet BEPS
La politique fiscale internationale de la France est très active et s'ordonne autour de deux pôles : la coopération fiscale et l'élaboration d'un cadre fiscal international. Ces sujets étant complexes, nous travaillons en concertation avec toutes les parties prenantes, dont l'expérience nous est précieuse. Notre outil principal est la convention fiscale. Ainsi le 1er janvier 2015 est entrée en vigueur notre nouvelle convention fiscale avec la Chine et, le 25 juin dernier, le Premier ministre a signé une convention fiscale avec la Colombie.
À quoi sert une convention fiscale ? Elle crée un cadre sécurisé pour les acteurs économiques, et limite les frottements fiscaux qui représentent un coût pour les entreprises comme pour les États - car ces derniers doivent souvent les compenser par d'onéreux crédits d'impôt. La première question est celle de la résidence ou de la source : dans quel pays l'entreprise est-elle redevable de l'impôt ? Puis viennent les prix de transferts : comment répartir la valeur entre les différentes sociétés d'un groupe ? Nos conventions respectent les règles internationales, qui sont élaborées par l'OCDE. Les conventions traitent aussi de points particuliers, tels que le statut des volontaires internationaux en entreprise (VIE) dont nous nous occupons en ce moment : doivent-ils être imposés en France, comme nous le pensons, ou dans le pays dans lequel ils travaillent ? Les conventions prévoient enfin le règlement des différends. La France défend à cet égard les mécanismes les plus avancés, allant jusqu'à l'arbitrage obligatoire, même si nos partenaires sont parfois réticents.
Nous ne signons pas de convention si notre partenaire n'accepte pas une clause d'échange de renseignements respectant les derniers standards internationaux, et ne démontre pas sa capacité à la respecter. Ainsi, à l'ordre du jour du conseil des ministres d'aujourd'hui figure un avenant à une convention avec la Suisse, qui remet notre dispositif d'échange de renseignements au meilleur niveau. La France est précurseur dans le domaine des clauses anti-abus.
De graves difficultés sont apparues dans le système fiscal international, favorisées par la financiarisation et la dématérialisation de l'économie, et se traduisant notamment par une perte de recettes pour les États, des détournements de trafic et des délocalisations de valeur. L'objectif du BEPS est de rétablir la « neutralité compétitive » entre les ensembles géopolitiques, entre les petits et les grands acteurs économiques, entre les divers secteurs. La justice fiscale est vitale pour endiguer la perte de confiance de nos concitoyens en leurs systèmes fiscaux.
Pour autant, j'insiste sur le fait que le projet BEPS ne remet pas en cause les principes de la fiscalité internationale. Nous devons continuer à respecter les règles communes, si nous ne voulons pas que s'instaure la loi du plus fort. Nous ne modifierons pas non plus l'équilibre général de la répartition des assiettes fiscales entre les États, car cela équivaudrait à des transferts de recettes. Enfin, nous n'envisageons pas de passer à une taxation au marché, comme cela a pu être suggéré. L'impôt sur les sociétés porte sur l'entrepreneur et non sur le consommateur ; il repose sur les fonctions de l'entreprise.
Pour traiter ce grand projet, nous nous sommes considérablement mobilisés à partir de 2012. La France a fait partie des États qui ont lancé BEPS, au G20 de Los Cabos en juin 2012. Un plan en quinze actions a été validé.
La source du problème de l'optimisation fiscale nationale n'est pas en France, car nous avons pris depuis des années des mesures contre ce phénomène. C'est de l'étranger que notre base fiscale est attaquée : elle est aspirée par des trous noirs fiscaux. Nous souhaitons que les profits soient imposés là où ils sont réalisés. Nous plaidons en faveur d'une très large transparence en matière d'information fiscale et de localisation. L'organisation de la valeur au sein des groupes par les prix de transferts ne doit pas être déconnectée de la réalité économique. Nous souhaitons aussi lutter contre les pratiques fiscales dommageables, par lesquelles des États prennent des mesures encourageant l'optimisation fiscale - qu'il ne faut pas confondre avec les dispositifs favorisant la recherche. Il importe enfin de reconnaître que les entreprises du numérique fonctionnent différemment des groupes classiques. Au G7 d'Elmau de juin 2015, la France a fait du développement de l'arbitrage une priorité. Au sein de l'Union européenne, il faut étudier la possibilité d'une imposition minimale et développer une politique commune à l'égard des pays tiers qui attaquent ou érodent les bases fiscales par leur opacité ou leur absence de fiscalité.
Sur la méthode, il est important que tous les États suivent la voie coordonnée de l'OCDE - je songe aux pays émergents, sans lesquels nous ne pouvons pas avancer. En septembre-octobre 2015, tout le monde approuvera sans doute le projet BEPS, mais que recouvrira ce « oui » ? D'où l'importance du monitoring, par lequel il sera possible de s'assurer que l'accord est respecté par tous.

La parole est maintenant à Éric Doligé, rapporteur spécial de la mission « Action extérieur de l'État », et à ce titre rapporteur des conventions fiscales - qui au Sénat relèvent de la commission des finances et non de la commission des affaires étrangères.

Je salue la volonté de trouver un consensus international. Répartir cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) entre les collectivités territoriales est presque plus compliqué... Le travail réalisé est considérable, je suis admiratif.

Si le G20 parvient à un compromis, il pourrait servir de référence pour la CVAE !

L'action 13 du plan BEPS, au-delà de la refonte du calcul des prix de transfert, impose d'établir un document pays par pays. Sanofi-Aventis sera obligé de fournir des informations aux administrations fiscales de chaque pays. La confidentialité de ces données vous semble-t-elle suffisamment garantie, notamment dans les pays émergents ?
Ensuite, la France a-t-elle une doctrine générale en matière de conventions fiscales, ou procède-t-elle au cas par cas ? Au-delà de l'adaptation du modèle de l'OCDE à chaque situation particulière, la France insiste-t-elle sur l'insertion de telle ou telle stipulation ? Le cas échéant, à quel sujet, au-delà des clauses anti-abus ? S'agit-il, d'une manière générale, de défendre les entreprises françaises ?
Quels sont les critères qui amènent la France à demander l'actualisation d'une convention bilatérale ? Existe-t-il un suivi systématique de l'obsolescence des conventions fiscales internationales ?
La diplomatie fiscale est-elle menée en lien avec d'autres aspects de la diplomatie, et notamment de la diplomatie économique, ou bien est-elle menée indépendamment ? Arrive-t-il que des avantages fiscaux soient accordés - par la France ou l'autre partie - en échange, par exemple, d'investissements ou de conditions commerciales favorables ? Avez-vous des exemples précis ? Comment les services de l'État se coordonnent-ils ?

Sanofi réalise l'essentiel de son activité à l'international. Vous semblez défendre la taxation des résultats en France, c'est-à-dire dans le pays du siège, où se trouvent la recherche et les fonctions de direction, plutôt que dans le pays de commercialisation. Pourquoi alors critiquer si souvent le taux de l'impôt sur les sociétés français ?
Lors de notre déplacement « hors les murs » à Toulouse, nous avons discuté du crédit d'impôt recherche (CIR) avec nos interlocuteurs : les sous-traitants en ont besoin, les firmes multinationales aussi car elles localisent grâce à lui leurs activités de recherche en France. Mais les règles de BEPS ne contraindront-elles pas la France à réviser sa réglementation des brevets ?
Qui seront les gagnants et les perdants, lorsque BEPS s'appliquera ? La direction de la législation fiscale a-t-elle dressé un bilan du projet BEPS du point de vue des recettes fiscales ? Celui-ci permettra-t-il de mieux appréhender les activités et les profits des géants de l'économie numérique ?
Une dernière question, plus éloignée du sujet : au Portugal, les retraités du secteur privé ne sont pas imposables pendant dix ans. Ce système très attractif relève-t-il de la convention fiscale franco-portugaise ou existe-t-il un vide juridique ? Que penser de cette concurrence fiscale ?

L'exemple cité par Catherine Henton n'est pas rassurant. L'industrie pharmaceutique continuera-t-elle à s'intéresser aux maladies endémiques dans les pays émergents, si la recherche n'est plus financée par le prix des médicaments ? Le coût de la recherche et du développement médical a cru très fortement et suit la loi des rendements décroissants. Si les pays où les produits sont commercialisés refusent d'en payer une partie, l'avenir sera sombre pour la recherche.
Les Anglo-saxons disent qu'il faut plonger ensemble dans la piscine, mais le plus souvent, ils prennent leur élan avec les autres... puis les laissent sauter seuls. On l'a vu avec la régulation bancaire. C'est pourtant aux plus forts de montrer l'exemple et de partir devant, pour donner confiance aux autres.
L'érosion des bases fiscales est un sujet majeur, qui a à voir avec la justice fiscale, la place de l'industrie, la concurrence, ses implications sont nombreuses. Je souhaite que les nouvelles règles permettent à Sanofi de maintenir sa recherche en France, et en tant que sénateur de la Haute-Garonne, je me réjouirais d'un retour de la recherche à Toulouse.

Les propos que nous avons entendus sont encourageants, ils prouvent que des avancées sont possibles ! Catherine Henton, que pensez-vous de la politique américaine relative qui permet le maintien des bénéfices dans les paradis fiscaux ? Le président Barack Obama a-t-il modifié la dernière loi de finances, comme annoncé, pour rapatrier des milliards de dollars sur le sol américain ?
Cela n'a pas été fait.

Les patent boxes et surtout les marques posent problème. Ce n'est pas le niveau de fiscalisation qui est un problème mais les royalties exigées par la société mère sur ses filiales. Quel contrôle l'OCDE ou l'administration française exercent-elles sur ces taux de redevance ? Les conventions fiscales signées par la France couvrent-elles toutes à la fois les entreprises et les particuliers, ou certaines sont-elles spécifiques ?
Il y a deux semaines, lors de notre visite « hors les murs » à Toulouse, nous avons appris qu'Airbus avait un accord préalable à l'échelle européenne pour la répartition de ses impôts. Disposez-vous d'un tel accord pour encadrer les prix de transfert ?

Considérez-vous que le projet d'assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés (ACCIS) témoigne également d'une certaine naïveté ? Nous confirmez-vous que des pays émergents - par exemple la Chine, l'Inde ou le Brésil - effectuent des redressements fiscaux en nombre croissant, comme nous le signalaient certaines entreprises ? Comment ces pays le justifient-ils ?
Nous nous inquiétons à propos de la confidentialité de nos données : dans certains pays, les transmettre à l'administration fiscale équivaut presque à les rendre publiques... Toutefois, nous sommes convaincus chez Sanofi-Aventis que publication des données n'est qu'une question de temps - peut-être est-ce préférable, et il vaut mieux s'y préparer.
La situation est différente selon les industries, la transparence sur les conditions commerciales pouvant être une bonne chose. Nos prix sont publics, car nous les négocions avec les États. Mon rôle dans l'entreprise est d'abord de m'assurer que nous appliquons les lois correctement partout, et je passe beaucoup de temps sur les contentieux relatifs aux prix de transfert. Ne soyons pas naïfs : les représentants à l'OCDE représentent les administrations, pas les fiscalistes ni les politiques.
Le président Barack Obama a proposé une réforme de la fiscalité américaine en étant certain qu'elle ne serait pas adoptée par le Sénat. La prochaine réforme n'est pas attendue avant 2017-2018, avec une autre administration. Je fais confiance aux industries pharmaceutiques américaines pour faire valoir leurs intérêts. Le système fiscal américain et très spécifique, et témoigne d'une autre philosophie du monde et de la fiscalité.
Pourquoi est-ce dans l'intérêt de Sanofi-Aventis de rapatrier ses profits en France ? Parce que ce pays a une fiscalité favorable sur les brevets depuis 1972. Nous ferons tout notre possible pour que les recommandations de BEPS pérennisent ce régime clef. Avec un taux d'imposition à l'impôt sur les sociétés de 38 % et une base dont beaucoup d'éléments ne sont pas déductibles, le taux de 15 % sur les brevets est fondamental pour contrer Novartis, les Anglais ou les Américains - qui ont un taux de taxation insignifiant aux Bermudes. C'est pourquoi nous sommes très actifs sur l'action 5 du projet BEPS, qui porte sur le sujet.
Nos brevets sont détenus par la société mère française pour la recherche en cours. Toutes ces dépenses sont déduites de la base fiscale française. Nous payons peu d'impôt à 38 % puisqu'il s'agit de recherche. Il est donc intéressant de rapatrier les profits commerciaux à taxer à 38 % pour éponger les frais de recherche, car le surplus est taxé à 15 %.
Le CIR est souvent confondu avec une incitation à la localisation d'actifs incorporels en France, ce qui n'est ni son but ni son effet. Le CIR est subvention à l'emploi de chercheurs en France, il récompense les projets de recherche réalisés en France. Par exemple notre concurrent anglais GlaxoSmithKline dispose de centres de recherche en France mais les résultats de la recherche sont rapatriés car les coûts de la recherche sont également refacturés à la maison mère. Préservons le régime de brevets pour garantir une localisation de la recherche en France.
Vous évoquiez le projet ACCIS et la difficulté de répartir la CVAE. Ce n'est rien cependant à côté de la répartition de la base fiscale entre les États fédérés américains, qui est d'une extrême complexité : nous établissons 350 déclarations par an, sommes contrôlés par chaque État, qui a ses propres règles, en sus des réglementations fédérales ! Dix personnes y travaillent en permanence. Une assiette commune en Europe, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas assez ambitieux. Dans le projet BEPS, les pays de l'Union européenne se battent entre eux tandis que les autres tirent les marrons du feu. Les Américains et les Chinois attendent au bord de la piscine que les autres sautent... Des procédures amiables sont envisagées pour éviter les doubles impositions, mais voyez la réalité ! La Chine se dit d'accord pour éviter les doubles impositions, mais rembourse-t-elle toujours un trop-perçu ?
Quant aux redressements fiscaux opérés par les BRIC, l'Inde a un système très compliqué, le Brésil a mis en place de nouvelles règles en matière de prix de transfert. Des accords préalables sur les prix de transfert (APP) sont possibles, nous en signons avec les États-Unis - 40 % du marché mondial - ainsi qu'avec la France ou l'Allemagne. Ce processus, qui engage l'administration, est très lent et nécessite des moyens : or le bureau de la direction générale des finances publiques qui gère les APP et les procédures amiables (MAP, mutual agreement procedure) ne compte que quatre ou cinq personnes. Ce n'est pas tenable : la France est la plus mauvaise en la matière.
Je suis davantage réaliste qu'optimiste, compte tenu de la situation politique internationale. Les ministres qui ont lancé le projet BEPS nous ont beaucoup aidés. Le reporting américain sera réalisé à partir de janvier 2016, même si le Congrès a encore des difficultés juridiques à résoudre.
Les vrais perdants de BEPS seront les entreprises de conseil, les trust service providers qui ont vendu des structures sans lien avec la réalité économique. Ils devront changer de métier. Parmi les pays, tout dépend du modèle économique : on imagine souvent que les États-Unis exportent beaucoup de capital alors que l'Inde en importerait. La réalité n'est pas aussi simple. Je dirai comme Catherine Henton : vous pouvez taxer Google et Apple mais alors vous ne pourrez empêcher les Chinois de taxer LVMH...
La renégociation d'une convention fiscale est un chantier très lourd, de trois ans environ, qui fixe un nouveau cadre pour des dizaines d'années. Elle est menée parce que l'économie française en a besoin, non pour des contreparties ponctuelles. Les entreprises nous signalent les vides, les problèmes d'application qu'elles rencontrent. Parfois nous découvrons une faille - comme pour l'immobilier, avec le Luxembourg - que nous essayons de combler rapidement. Nous raisonnons aussi en fonction du coût budgétaire d'une convention, certains dispositifs tels que les crédits d'impôt « fictifs » pouvant être très onéreux.
Une convention fiscale porte sur plusieurs thèmes. Nous avons cent vingt conventions qui concernent les revenus des particuliers et des entreprises, avec parfois des clauses sur le patrimoine. Une dizaine de conventions traite des successions et des donations ou mutations à titre gratuit, un chiffre moindre car notre droit interne prévoit la suppression de la double imposition. Les clauses des conventions fiscales sont issues du modèle élaboré par l'OCDE. Le projet BEPS permettra d'éviter les abus, ce dont se soucie l'administration française depuis longtemps.
Une convention doit permettre à chaque État d'appliquer sa législation. La Colombie exonère fiscalement certains secteurs, nous en tenons compte pour éviter une sous-taxation ou une sur-taxation. La nature de l'activité économique et nos relations avec les particuliers importent également. Nous avons besoin de beaucoup d'informations, qui sont fournies par les entreprises et les postes économiques.
Il ne suffit pas qu'une entreprise française rende un service sur un territoire pour y devenir imposable : la notion d'établissement stable s'apprécie au moyen de seuils. Nous essayons également de limiter la retenue à la source sur les flux de paiement, afin de ne pas créer une double imposition qu'il faudra ensuite éliminer.
Les règles fiscales internationales comportent de grandes différences, ce qui créé des tensions importantes. Il faut rééquilibrer ces règles. Dans la mesure où le projet BEPS favorise une bonne application de notre législation sans renverser l'équilibre fiscal international, la France y gagnera puisqu'elle consolidera la taxation de profits réalisés sur son territoire.
La délocalisation des brevets a été considérable, comme le révèlent les chiffres de l'OCDE. Les chefs d'État et les ministres des finances ont décidé d'y mettre un terme. La France, toutefois, favorise la recherche sur son territoire avec le CIR : c'est une démarche différente, qu'il convient de préserver.
L'administration fiscale française promeut les accords préalables de prix de transferts. Il y en a quelques dizaines. L'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés est un élément essentiel du marché intérieur européen mais elle ne répond pas, à court terme, à la problématique de l'optimisation fiscale.
Un mot enfin sur le Portugal : le régime de « vacance fiscale » de dix années a été mis en place dans le cadre du plan d'assistance européen. Un avenant à la convention franco-portugaise nous donnera le droit exclusif de taxer les pensions publiques. Sur les pensions privées, comme nous l'avons expliqué au groupe de travail sur les Français l'étranger réuni par Christian Eckert, le principe international, repris par la convention, est celui de la résidence : un retraité est taxé à l'endroit où il réside, puisque c'est là où il a le plus de liens avec l'économie. Le pays de résidence peut donc décider librement du montant de l'impôt.