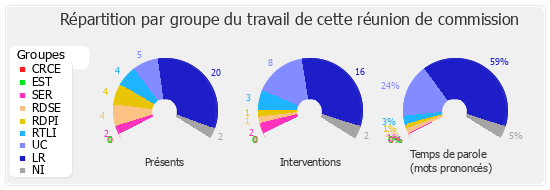Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
Réunion du 3 février 2016 à 9h30
Sommaire
- Ratification du traité de coopération en matière de défense entre la république française et la république du mali
- Statut des forces en visite et coopération en matière de défense
- Approbation de l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la nouvelle-zélande- examen du rapport et du texte de la commission (voir le dossier)
- Coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité
- Approbation de l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de croatie et entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de lituanie - examen du rapport et des textes de la commission (voir le dossier)
- Désignation d'un rapporteur (voir le dossier)
- Référendum britannique sur l'appartenance à l'union européenne et revue de défense et de sécurité britannique
La réunion
La commission examine le rapport de M. Claude Nougein et le texte proposé par la commission pour le projet de loi n° 483 (2014-2015) autorisant la ratification du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République du Mali.

Nous examinons un traité de coopération de défense avec le Mali. Ce traité revêt bien entendu une importance toute particulière compte tenu du rôle que continue à jouer l'armée française dans ce pays avec l'opération Barkhane qui a succédé à l'opération Serval.
Sur le plan juridique, les actions de coopération militaire entre la France et le Mali sont actuellement encadrées par deux accords. D'une part, un accord de coopération militaire technique du 6 mai 1985, dont le champ d'application se limite pour l'essentiel à la mise à disposition du Mali de coopérants militaires techniques français et à la formation et au perfectionnement de cadres des forces armées maliennes dans les écoles militaires françaises.
D'autre part, l'accord sous forme d'échange de lettres des 7 et 8 mars 2013, conclu afin de garantir la sécurité juridique de l'opération militaire Serval.
Le premier accord est désormais obsolète dans la mesure où il reflète un état des relations entre la France et les pays africains désormais révolu. Ainsi, il est rédigé de manière très unilatérale, n'évoque pas les questions de sécurité collective africaine et ne prévoit aucun échange d'informations entre les deux armées.
Le second accord est conçu spécifiquement pour assurer la sécurité juridique des troupes françaises lors de l'opération Serval, puis lors de l'opération Barkhane. Il ne s'applique pas à la coopération militaire ordinaire.
Dès lors, le 16 octobre 2013, le président de la République du Mali nouvellement élu, Ibrahim Boubakar Keita, a appelé de ses voeux la signature d'un nouveau traité de coopération militaire afin de marquer l'engagement dans la durée de la coopération entre les deux États. Un tel accord a été signé le 16 juillet 2014 par les ministres de la défense français et malien à l'occasion d'une rencontre à Bamako.
Quel est le contexte de cet accord ?
En premier lieu, je rappellerai brièvement les événements ayant conduit à l'intervention française. En janvier 2012, le mouvement national de libération de l'Azawad (MNLA) des Touaregs, allié notamment aux groupes djihadistes d'Ansar Eddine et du MUJAO, lance une offensive depuis l'Adrar des Ifoghas vers le Sud du Mali puis proclame le 6 avril 2012 l'indépendance du Nord-Mali. Il contrôle rapidement les régions de Gao, Tombouctou et Kidal. Bientôt, les groupes armés djihadistes affrontent et battent le MNLA, prenant le contrôle des grandes villes et des territoires du Nord. Entretemps, un coup d'Etat a entraîné le départ du Président Amadou Toumani Touré.
Malgré diverses tentatives d'apaisement sous l'égide de l'ONU, la crise s'accélère au début du mois de janvier 2013, des groupes armés terroristes se mettant en mouvement vers le sud, faisant craindre une extension de leur territoire à la plus grande partie du pays et une déstabilisation de la transition politique en cours à Bamako. Les mesures internationales de soutien militaire décidées pour venir en aide à l'Etat malien, à savoir la mission de formation de l'Union européenne au Mali (EUTM Mali) et la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA), risquaient également d'être compromises par cette progression.
À la suite d'une demande d'aide formulée le 10 janvier 2013 par le Président du Mali, adressée à la France et au Conseil de sécurité des Nations unies, et au titre de l'article 51 de la Charte des Nations unies relatif à la légitime défense, la France a engagé, avec le soutien de huit pays (Allemagne, Belgique, Canada, Danemark, Grande-Bretagne, Espagne, États-Unis et Pays-Bas) une intervention militaire, l'opération « Serval », afin de stopper l'offensive des terroristes, retrouver l'intégrité et la souveraineté du Mali et faciliter la mise en oeuvre des décisions internationales.
L'opération Serval a globalement été un succès, le rôle des forces françaises prépositionnées en Afrique ayant été déterminant, en liaison avec les forces spéciales et avec le soutien de l'armée de l'air. Elle a permis de repousser les groupes djihadistes et de récupérer 200 tonnes d'armement et de munitions ainsi qu'une vingtaine de tonnes de nitrate d'ammonium dans l'Adrar des Ifoghas. Enfin, un transfert progressif de la mission aux partenaires maliens de la France ainsi qu'aux forces de l'ONU (mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA) a été opéré.
Aujourd'hui, la situation au Mali est indéniablement meilleure qu'elle ne l'était il y a trois ans. Toutefois, les sujets de préoccupation restent nombreux.
Sur le plan sécuritaire, les groupes terroristes ont été désorganisés par l'opération Serval. L'opération Barkhane, qui lui a succédé en août 2014, a permis de maintenir l'avantage acquis.
L'opération Barkhane doit sa réussite à un aspect essentiel : elle peut s'appuyer sur le G5, c'est-à-dire une coopération étroite de cinq pays du Sahel : Mauritanie, Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso. Dès lors, Barkhane est totalement transfrontière, ce qui est la seule manière de lutter efficacement contre les groupes djihadistes. Ceux-ci sont en effet passés maîtres dans la pratique qui consiste à partir d'un pays pour aller frapper un second pays avant de se réfugier dans un troisième. Les soldats de Barkhane peuvent désormais les pourchasser sur le territoire des cinq pays du G5. Ainsi, les groupes terroristes n'ont plus de sanctuaire leur permettant de reconstituer leurs forces, du moins, j'y reviendrai, dans les pays couverts par l'opération.
Il faut également souligner que, depuis le mois d'octobre 2015, des opérations conjointes de forces africaines sans participation des forces françaises commencent à se dérouler, comme l'opération lancée par le Mali et le Burkina Faso contre le front de libération du Macina. Barkhane a ainsi enclenché un cercle vertueux.
Toutefois, la limite de Barkhane tient au fait qu'elle n'emploie que 3 000 à 3 500 hommes pour un territoire plus grand que l'Europe et à l'impossibilité de poursuivre les djihadistes dans les pays limitrophes du Nord du Sahel. Bien entendu, la situation en Libye est particulièrement préoccupante.
De manière complémentaire à Barkhane, la MINUSMA, établie par la résolution 2100 du Conseil de sécurité de l'ONU le 25 avril 2013, est un acteur majeur dans la stabilisation du Mali, avec plus de 8 000 militaires et 1 050 policiers. Cette force, composée essentiellement de troupes africaines, assure et manifeste la légitimité de l'intervention militaire au Mali, dimension essentielle pour éviter un rejet de la population. En revanche, souffrant notamment de certaines carences logistiques, elle ne joue pas un rôle opérationnel fort, rôle toujours assumé par les troupes françaises.
Enfin, les quelques centaines d'hommes de l'EUTM Mali, c'est-à-dire de la mission européenne de formation de l'armée malienne, apportent un soutien utile à la réorganisation et à la formation des forces armées maliennes. Si l'ensemble de ces forces militaires permettent ainsi à l'Etat malien de subsister et de fonctionner, elles ne peuvent prétendre apporter une réponse de long terme aux problèmes qui touchent ce pays.
Le premier problème est politique. Les fameux accords l'Alger, signés entre la République du Mali et la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA) le 20 juin 2015 à Bamako grâce à la médiation algérienne, constituent certes un succès notable. Sur le plan sécuritaire, la mise en oeuvre de cet accord tend aujourd'hui à se concrétiser avec la création effective de patrouilles mixtes et le début d'une fusion des cantonnements des soldats. Un total de 24 sites de cantonnement devraient ainsi être mis en place, la MINUSMA ayant à ce jour évalué 11 de ces sites et engagé des travaux sur trois d'entre eux.
En revanche, la faiblesse des avancées politiques révèle la grande fragilité de l'accord et les ambiguïtés sur lesquelles il repose. En particulier, les mesures prévues en matière de décentralisation peinent à se traduire dans le droit interne malien.
Le second problème réside dans la situation économique précaire d'une grande partie du Sahel, marquée par l'arrivée, chaque année sur le marché du travail, de centaines de milliers de jeunes que, ni une agriculture profondément fragilisée par les conflits et par les sécheresses, ni une industrie balbutiante, ne peuvent absorber. Dès lors, nombre de ces jeunes s'enrôlent dans des groupes armés qui pratiquent divers trafics depuis l'Afrique de l'Ouest à travers le Sahel ou le Sahara, en particulier les trafics de drogue, d'armes ou d'otages. Pour ces jeunes, avoir une arme, c'est avoir un métier.
Une partie de la solution réside évidemment dans l'efficacité de l'aide au développement. Lors de la conférence du 22 octobre 2015, 3,2 milliards de dollars ont été annoncés par les bailleurs du Mali pour les années 2015-2017. La France a promis 360 millions d'euros. Malheureusement, cet effort significatif n'est absolument pas une garantie de réussite si ces crédits ne vont pas au bon endroit au bon moment. On sait que dans beaucoup de régions du Nord, pas une seule route n'a encore été construite. Tout peut également être remis en cause du fait de la fragilité de l'accord politique et de la situation sécuritaire toujours menaçante.
Après avoir ainsi brièvement décrit le contexte, j'en viens au traité de défense lui-même.
Premier élément, ce traité n'a rien d'original dans son contenu. Il est quasiment identique aux huit autres accords signés au cours des années 2008-2012 avec le Togo, le Cameroun, le Gabon, la République centrafricaine, l'Union des Comores, Djibouti, la Cote d'Ivoire et le Sénégal. Pour mettre fin à certaines dérives du passé, ces accords mettent en place un partenariat ou une coopération de défense fondée sur le respect mutuel de la souveraineté, de l'indépendance et l'intégrité territoriale des États. En particulier, ils ne comportent pas de clause publique ou secrète d'assistance automatique contre les menaces intérieures ou extérieures. Ils ont ainsi permis de refonder la coopération de défense de la France avec ses partenaires africains sur des bases adaptées au contexte contemporain.
Deuxième élément, qui constitue un point essentiel pour comprendre la portée exacte du présent traité, il ne se substitue pas à l'accord par échange de lettres des 7 et 8 mars 2013, conclu pour assurer la sécurité juridique de l'intervention française au Mali. En vertu de l'article 25 du nouveau traité, les actions menées dans le cadre de l'opération Barkhane continuent à relever de cet accord de 2013. De même, les militaires français qui seraient présents au Mali dans le cadre du nouveau traité, mais participeraient à l'opération Barkhane, seraient juridiquement couverts par l'accord par échange de lettres de 2013.
En effet, le présent traité n'est pas conçu pour couvrir une intervention telle que Serval ou Barkhane, pas plus que ne l'était d'ailleurs l'accord de coopération militaire de 1985, qui ne comportait pas de clause publiée ou secrète d'assistance militaire. C'est pourquoi la France a obtenu la pérennisation de l'application de l'accord de 2013, bien plus favorable aux troupes françaises sur le plan de la sécurité juridique. L'article 1er de celui-ci prévoit en effet une large immunité pénale pour nos soldats, comme c'est aussi le cas par exemple dans l'accord avec la République centrafricaine sur le statut du détachement français déployé dans le cadre de Sangaris. Le nouveau traité de défense, lui, prévoit à l'inverse un partage de compétences entre la juridiction française et la juridiction malienne en cas de contentieux.
Autre exemple, l'article 9 de l'accord par échange de lettres comporte une disposition selon laquelle la Partie malienne prend à sa charge la réparation des dommages causés aux biens ou à la personne d'un tiers, y compris lorsque la Partie française en est au moins partiellement à l'origine. Le nouveau traité de défense prévoit au contraire que lorsque le dommage est imputable aux deux Parties, le montant des indemnités est réparti à parts égales.
Pour le reste, le nouveau traité précise les principes généraux sur lesquels se fonde le partenariat de défense et de sécurité, en prenant en considération deux dimensions nouvelles : la dimension régionale de la mission de coopération militaire confiée aux forces françaises et la dimension européenne. Le traité prévoit ainsi que les Parties peuvent conduire des actions de coopération dans toute la région et y associer une contribution d'un ou plusieurs États africains et d'un ou plusieurs États membres de l'Union européenne.
Les domaines de la coopération mise en oeuvre dans ce cadre sont ensuite énumérés : ils couvrent les échanges d'informations, l'organisation, l'équipement et l'entraînement des forces, l'organisation de transits ou de stationnements temporaires, les missions de conseil, la formation dans des écoles françaises ou des écoles soutenues par la France.
Je précise à ce propos que la coopération de défense conduite au Mali par la direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD) du ministère des affaires étrangères et du développement international se décline actuellement en sept projets, dont une école nationale à vocation régionale (ENVR) et une école à statut international, l'école de maintien de la paix (EMP) de Bamako, pour un budget global de 4,6 millions d'euros. Je ne peux ici que souligner l'importance cruciale de cette coopération militaire structurelle et regretter à nouveau, comme l'ont fait nos collègues Christian Cambon et Leila Aïchi lors de l'examen du programme 105 dans le cadre de l'examen de la loi de finances pour 2016, la réduction continue des moyens qui lui sont affectés au sein du budget.
Le traité comporte ensuite des dispositions détaillées sur le statut des personnels engagés dans la coopération et fixe les règles de compétence juridictionnelle en cas d'infractions commises par un coopérant. Il précise aussi que dans le cas où elle serait prévue par la loi, la peine de mort ne serait ni requise, ni prononcée. Le traité prévoit également un certain nombre de facilités pour l'exercice des activités de coopération. Il vise ainsi à permettre des exercices en commun et l'utilisation par nos forces de l'espace aérien du Mali, notamment dans le cas où un détachement français se rendrait sur le territoire malien pour effectuer un exercice.
La quatrième partie prévoit enfin l'abrogation de l'accord de coopération militaire technique du 6 mai 1985 et précise que le nouveau traité est conclu pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.
En conclusion, cet accord modernise et améliore notre coopération militaire avec le Mali comme elle l'a déjà été avec les huit autres pays africains signataires d'un accord semblable. Il contribuera ainsi à la sécurité d'un pays et d'une région dont la stabilité est aujourd'hui un enjeu de premier ordre pour notre pays et pour le monde.
C'est évidemment une nouvelle étape, symbolique, de nos relations de défense avec le Mali, qui a repris en main son destin.

Les premières attaques des groupes armés au Mali ont eu lieu en 2012, la France intervient en 2013, le traité est signé en 2014 et nous le ratifions en 2016. Nous sommes dans la longue durée ! Dès lors qu'il est difficile de contrôler tout le Sahel, pour combien de temps encore la France va-t-elle devoir maintenir sa présence ?

Il a été question dans l'exposé du rapporteur de l'impunité des troupes françaises qui serait garantie par le traité. Est-ce que des faits tels que ceux que l'on reproche à des soldats français dans un autre Etat africain, à savoir des abus sexuels commis par des soldats français sur des enfants, relèveraient de la justice malienne ou de la justice française ?

Soixante ans après les indépendances, nous ne pouvons que nous interroger sur la persistance des difficultés de ces États où des peuples de religion musulmane du Nord désertique sont en conflit avec des populations noires animistes du Sud. Ces conflits perdureront après nos interventions. Le problème majeur de l'Afrique, c'est bien la capacité des États à imposer leur autorité sur les composantes de leurs peuples.

Ce projet de traité a une apparence relativement anodine. Toutefois, compte-tenu des événements qui se déroulent dans cette région du monde, il me semble qu'il serait utile d'avoir un débat en séance publique. Notre groupe a de nombreuses interrogations sur la pertinence et l'efficacité de notre politique de coopération militaire. Les membres de notre groupe s'abstiendront à ce stade et demanderont l'examen en procédure normale en séance publique.

Il y a actuellement une grande inquiétude dans la région. Je me suis rendue dans trois pays. Au Sénégal et en Guinée, les hauts responsables que j'ai rencontrés m'ont fait part de leur grande inquiétude devant la détérioration de la situation. Nos soldats n'ont pas assez de moyens pour intervenir efficacement.

Avons-nous aujourd'hui les moyens d'intervenir en Afrique ? Je pense que compte tenu de leur insuffisance, il faut faire des choix : ne faut-il pas privilégier notre territoire ?

Soixante après les indépendances, le pays n'a pas une route pour relier les régions du Nord et du Sud du pays. C'est en soi une cause de division pour le pays. Devons-nous continuer à mettre en danger nos troupes dans cette région du monde ?

La menace que nous affrontons vient aussi de cette région du monde : il faut y intervenir aussi. Mais je suis inquiet : les choses n'évoluent toujours pas dans le nord du Mali, où je me suis rendu. Il n'y a pas assez d'infrastructures, pas assez de professeurs, etc. Comment assurer la stabilité d'un tel pays ? Il faut absolument que l'Etat fasse l'effort de développer le Nord.

Le rapporteur a judicieusement resitué le présent traité dans l'ensemble des accords de coopération de défense que nous avons avec les pays africains. Les premiers accords de ce genre avaient été signés en même temps que les accords d'indépendance. Ils comportaient des clauses d'assistance un peu particulières, que ne comportent plus les nouveaux accords. Ceux-ci fixent un cadre tout à fait nouveau : celui de la responsabilité première des Africains dans leur propre politique de sécurité et celui de notre non-intervention. Nous nous réjouissons que le Mali, au milieu de ses difficultés actuelles, bénéficie à son tour d'un nouvel accord de coopération. Ce nouvel accord est porteur de clarté politique. Bien entendu, il ne va pas à lui seul régler les problèmes du Mali. L'antagonisme entre populations du nord et du sud du pays est aussi vieux que l'histoire pluricentenaire de ce pays. Ce n'est jamais que la quatrième révolte touareg depuis l'indépendance ! L'Etat est-il assez puissant pour assurer l'unité du pays ? Dès lors, comment parler de décentralisation ? Ainsi, si ce texte ne va pas régler tous les problèmes, au moins normalise-t-il nos relations. Depuis 1995, nous tenons à ce que les organisations africaines s'occupent elles-mêmes de la sécurité de leurs États membres. Elles ne le font pas encore assez, mais nous les y aidons grâce à notre coopération militaire structurelle.

L'article 21 du traité prévoit que des armes peuvent être placées sous la responsabilité de l'Etat malien. N'est-ce pas risqué ? Par ailleurs, nous n'évaluons pas assez les actions de coopération que nous menons. J'ai récemment rencontré le secrétaire général de l'organisation de la coopération islamique, qui était intéressé par l'aide au Mali : comment intégrer ce genre d'organisations dans le dispositif ?

L'article 15 de la convention prévoit que le Mali est compétent par priorité pour les infractions commises sur son sol. Compte tenu de l'état de la justice malienne, nous avons beaucoup de réserves sur cette convention.

Il y a encore une dizaine d'années, le Mali était donné en exemple : notre coopération décentralisée avec ce pays était efficace, la corruption était en baisse et des infrastructures étaient en cours de construction. La situation peut ainsi se dégrader à grande vitesse, mais les pays peuvent aussi très vite repartir vers l'avant. La coopération militaire avec le Mali est stabilisatrice mais elle pourrait aussi inciter les Maliens à ne pas renoncer à certains de leurs errements. En attendant que l'Afrique se dote véritablement de cette architecture de sécurité collective que nous appelons de nos voeux, il faut donc que nos amis maliens profitent de la sécurité que nous leur apportons pour repartir de l'avant. Nous n'en étions pas loin il n'y a pas si longtemps !

Le problème fondamental est celui de notre stratégie de lutte contre Daesh car cette organisation est en train de s'étendre dans le monde entier, en Asie centrale - j'ai pu constater, par exemple, à quel point les responsables du Kazakhstan étaient inquiets - dans le nord de la Chine, en Malaisie, aux Philippines, au Moyen-Orient, en Afrique, et cela ne fera que s'aggraver. Notre intervention en Syrie n'a-t-elle pas pour conséquence le développement de Daesh en Libye ? Il nous faut une réflexion stratégique large sur ce sujet.

Notre débat recouvre en réalité plusieurs sujets : celui du Mali, celui de notre coopération militaire, celui de la situation sécuritaire de l'Afrique en général, voire un débat plus large sur la lutte contre le djihadisme. Compte tenu de leur intérêt, nous pourrions focaliser un de nos débats de politique étrangère en séance, en présence du ministre des affaires étrangères, sur l'Afrique. Ceci permettrait d'aller au fond du sujet, davantage qu'avec les débats -par ailleurs légitimes et opportuns- que nous pourrions avoir à l'occasion du présent traité, dont l'objet est plus étroit.

Hélène Conway et moi-même allons précisément rédiger un rapport sur l'évaluation de l'aide au développement apportée au Mali, qui permettra à la commission de débattre de cette question. Nous avons déjà commencé nos auditions de spécialistes du sujet et nous constatons en effet que le lien entre sécurité et développement est essentiel.

Il n'y a pas de sécurité sans développement et vice-versa. Le travail que nous effectuerons permettra d'avancer sur cette question.

Il est vrai que nous affrontons un problème appelé à durer. Je me souviens d'une audition où un général nous avait dit : « nous ne sommes pas encore au jour où le Nord-Mali aura la tranquillité d'un canton suisse ». Je pourrais le répéter aujourd'hui. Nous en avons encore pour un certain temps !
Concernant les soldats, il s'agit d'une immunité, pas d'une impunité ! Elle protège nos soldats dans le cadre des opérations Serval puis Barkhane. Il n'y a pas d'impunité pour les actes commis dans le cadre de la coopération de défense. La justice malienne peut se saisir d'un certain nombre d'infractions. Il est prévu toutefois que la peine de mort ne pourra pas être requise dans ce cadre et que les garanties d'un procès équitable devront être assurées.
En ce qui concerne le développement du nord du pays, la mission de nos collègues Hélène Conway-Mouret et Henri de Raincourt nous permettra de nous faire une idée plus précise du sujet. Il est vrai que c'est un territoire difficile et complexe.
Les armes confiées au Mali ne sont que celles utilisées dans le cadre de la coopération militaire ordinaire, pas dans le cadre de l'intervention Barkhane.
Ce traité ne résout effectivement pas tout ! Toutefois, je suis persuadé qu'il va dans le bon sens. C'est le neuvième traité et un dixième devrait être signé avec le Tchad. Notre présence au Mali est utile et contribue à lutter contre les bases du terrorisme.
Suivant l'avis du rapporteur, la commission adopte le rapport ainsi que le projet de loi précité (abstention des groupes communiste, républicain et citoyen et écologiste).
La commission examine le rapport de M. Michel Billout et le texte proposé par la commission pour le projet de loi n° 340 (2014-2015) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande concernant le statut des forces en visite et la coopération en matière de défense.

A titre liminaire, je souhaite vous présenter brièvement les enjeux de notre relation bilatérale de défense avec la Nouvelle-Zélande. Je vous rappelle tout d'abord que la France est une puissance riveraine du Pacifique avec ses territoires en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et à Clipperton. 62 % de notre zone économique exclusive, la deuxième du monde avec 11 millions de km2, se situe dans le Pacifique. La Nouvelle-Zélande est dès lors un partenaire-clé pour assurer la stabilité et la sécurité des territoires français en Océanie, ainsi que des États insulaires du Pacifique. En octobre 2015, la Nouvelle-Zélande a ainsi participé, avec l'Australie, au séminaire trilatéral interministériel sur la surveillance maritime intégrée dans le Pacifique Sud que le ministère de la défense a organisé en Nouvelle-Calédonie.
La France s'est fixé comme priorités d'approfondir le dialogue politico-militaire avec la Nouvelle-Zélande, en mettant l'accent en particulier sur la situation des États insulaires du Pacifique Sud et les stratégies régionales d'influence, notamment celle de la Chine en mer de chine et dans le Pacifique, que nous avons déjà évoquée à de nombreuses reprises dans cette commission; d'assurer un suivi attentif de la mise en oeuvre des principaux contrats militaires et d'identifier de nouveaux prospects, notamment pour les hélicoptères NH90 et l'A400M, et de poursuivre sa relation en matière de renseignement.
Pour la Nouvelle-Zélande, la France est le seul pays européen qui représente à la fois un acteur global et un acteur régional, à l'exception du Royaume-Uni, mais qui n'a cependant plus de présence militaire dans la région. La France est donc le troisième partenaire militaire de la Nouvelle-Zélande, après l'Australie et les États-Unis.
Cet accord se présente avant tout comme un accord relatif au statut des forces ou « SOFA », acronyme de « Status Of Forces Agreement », le premier conclu entre la France et la Nouvelle-Zélande.
Dès 2001, la France s'est préoccupée d'obtenir un statut juridique pour les forces françaises appelées à participer à des opérations de coopération en Nouvelle-Zélande, mais ses démarches ont achoppé sur la réticence des autorités néo-zélandaises à modifier leur loi relative aux forces en visite. Le Visiting Forces Act, qui a finalement été révisé en 2004, fournit jusqu'à présent un cadre juridique partiel aux forces armées françaises présentes sur le territoire de la Nouvelle-Zélande. Elle ne répond toutefois pas à toutes les exigences françaises, notamment à la question du règlement des dommages et ne prévoit aucun statut pour les membres des forces néo-zélandaises présentes en France dans le cadre d'activités de coopération, d'où la nécessité d'un statut réciproque des forces armées en visite dans un contexte de coopération grandissante en matière de défense. Les Néo-zélandais ont proposé, à l'automne 2009, un projet d'accord, qui a abouti, après de nombreux échanges, à la signature, en mai 2014, de cet accord, en marge de la 13e session de la Conférence annuelle sur la sécurité régionale de la zone Asie-Pacifique, le fameux « Shangri-La Dialogue ».
Cet accord s'inscrit dans une relation de défense solide et ancienne entre la France et la Nouvelle-Zélande. Cette relation bilatérale repose, depuis 1999, sur un dialogue politico-militaire entre les ministères des affaires étrangères et de la défense (en format dit « 2 + 2 ») qui se tient, tous les deux ans, au niveau des directeurs, alternativement dans une des capitales. La prochaine édition devrait avoir lieu à Wellington au cours du premier trimestre 2016. Depuis mai 2014, ce dialogue est doublé par un dialogue d'état-major qui se déroule le lendemain du « 2+2 ». Conduit par le commandant supérieur des Forces armées de la Nouvelle-Calédonie, le COMPSUP FANC, il a pour objet l'évaluation de l'environnement de sécurité régionale et la coordination des secours aux populations victimes de catastrophes naturelles, en application de l'accord FRANZ (France, Australie et Nouvelle Zélande), signé à Wellington, en décembre 1992. Depuis la conclusion de l'accord FRANZ, les Forces armées de la Nouvelle-Calédonie, les FANC, ont participé à 31 interventions humanitaires, notamment lors des catastrophes récentes au Vanuatu (cyclone Pam en mars 2015) et aux Tonga (cyclone Ian en janvier 2014).
Les FANC comptent environ 1 500 militaires, dont près de 1 000 permanents, répartis à Nouméa, Plum, Tontouta et Nandaï, auquel s'ajoutent environ 200 personnels civils de la défense ainsi que près de 250 réservistes. Les forces opérationnelles néo-zélandaises, quant à elles, comptent 14 135 personnels dont 9 086 militaires d'active et 2 264 réservistes. Pour une description plus détaillée de ces forces, je vous renvoie à mon rapport écrit.
La coopération opérationnelle se déroule également dans le cadre du dispositif QUAD (Quadrilateral Defence Coordination Group), qui rassemble les forces armées de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, des États-Unis et de la France avec l'objectif de « coordonner l'effort de sécurité dans le Pacifique, notamment dans le domaine maritime, en accompagnant les États insulaires vers une gestion saine et durable de leurs ressources naturelles, entre autres halieutiques ». Invitée en tant qu'observateur en 1998, la France est devenue membre du QUAD en 2002. Elle y est représentée par le COMSUP FANC et un officier des Forces armées en Polynésie française. Le champ d'action du QUAD s'est désormais élargi à l'ensemble des missions relevant de l'action de l'État en mer (surveillance maritime, lutte contre les trafics illicites, etc.).
La coopération avec la Nouvelle-Zélande s'exprime également à travers une contribution aux principaux exercices régionaux relevant de la sécurité des espaces maritimes, de l'aide humanitaire, du soutien aux populations victimes de catastrophes naturelles, voire de l'évacuation de ressortissants organisés par nos alliés ou nos partenaires dans la zone. À cet égard, il faut signaler les participations croisées aux exercices français « Croix du sud » et néo-zélandais « Southern Katipo » qui constituent des moments importants de l'entraînement des forces à l'assistance humanitaire et qui sont l'occasion de développer l'interopérabilité entre les différentes nations présentes. Il faut y ajouter l'exercice « Tropic Twilight », qui se déroule les années impaires au profit d'États insulaires de la région et qui s'inscrit dans le cadre de l'opération civilo-militaire américaine « Pacific Partnership ».
Enfin la France et la Nouvelle-Zélande ont signé, en février 2013, un accord relatif à la protection des informations classifiées dans le domaine de la défense, qui est entré en vigueur en août 2013.
Ce SOFA a pour principal objet de garantir un statut juridique protecteur aux éléments des forces françaises présents sur le territoire néo-zélandais, afin de favoriser la coopération en matière de défense et d'alléger les procédures administratives, financières et douanières qui y sont liées.
S'agissant de la coopération, l'accord donne une liste non exhaustive de ses domaines et de ses formes. Ces activités de coopération seront mises en oeuvre, non pas par une structure de pilotage, mais par les organismes de défense nationale des deux Parties, c'est-à-dire, leur ministère de la défense respectif et en particulier l'état-major interarmées néo-zélandais et les forces françaises stationnées en Nouvelle-Calédonie. La coordination se fera par le biais des dispositifs de consultation déjà évoqués : le dialogue politico-militaire et le dialogue entre états-majors. Cet accord, point extrêmement important, exclut toute clause d'assistance afin d'éviter que le personnel d'échange français ne se trouve engagé dans des opérations de guerre, de maintien ou de rétablissement de l'ordre de l'État d'accueil, sans que la France n'ait officiellement donné son accord. Classiquement, chaque Partie supporte ses propres coûts de coopération.
S'agissant du statut des forces en visite, la plupart des stipulations qui y figurent sont très courantes dans les accords SOFA signés par la France Son contenu est proche de celui du SOFA Maroc et du SOFA Brésil, déjà ratifiés. Sont ainsi précisées les conditions d'entrée de la force en visite pour l'accomplissement des activités de coopération en matière de défense ainsi que les priorités de juridictions applicables en cas d'infractions commises par ses membres. Ce SOFA accorde aussi classiquement une série de facilités opérationnelles aux forces en visite comme la reconnaissance de la validité des permis de conduire, des permis de pilotage d'aéronefs ou de navires délivrés par l'État d'envoi, l'autorisation des transports ou des déplacements terrestres, l'autorisation de possession et de port d'arme, la sécurité des installations mises à la disposition de la force en visite, l'autorisation d'installer et de faire fonctionner des systèmes de communications temporaires, un régime d'exonération fiscale et douanière applicable en matière d'importation et d'exportation de matériels destinés à l'usage exclusif des forces en visite. Le régime de prise en charge des soins médicaux et les règles applicables en cas de décès d'un membre des forces en visite sont également précisés, tout comme le régime applicable aux demandes d'indemnité entre les Parties et émanant de tiers.
La seule disposition atypique de ce SOFA est la clause d'aide d'urgence qui y figure à la demande expresse des Parties. Elle permet la fourniture d'un soutien médical, logistique, technique ou autre par les forces armées, lorsque les circonstances rendent rapidement nécessaire un tel soutien, comme en cas de catastrophe naturelle. Elle s'explique par la présence des FANC dans la zone et retranscrit en fait les engagements découlant de l'accord FRANZ déjà évoqué sur la coopération en matière d'urgence en cas de catastrophe naturelle dans le Pacifique Sud.
Enfin, l'accord est conclu pour une période initiale de 20 ans et, sauf dénonciation, demeure en vigueur au-delà de ladite période.
En conclusion, je recommande l'adoption de ce projet de loi qui ne pose pas de problème particulier. Ce SOFA apparaît comme un outil utile pour donner une vraie sécurité juridique aux personnels des forces françaises et néo-zélandaises appelées à coopérer sur le terrain en matière de défense, mais aussi pour faciliter la coordination des secours aux populations victimes de catastrophes naturelles. Je tiens à souligner le calendrier tout à fait raisonnable du Gouvernement dans ce dossier, puisque cet accord a été signé en mai 2014 et que la Commission permanente du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et l'Assemblée de la Polynésie française, consultées, ont émis un avis favorable, au printemps 2015. C'est un net progrès.
Dernier argument pour vous convaincre si cela était encore nécessaire, des commandes d'armement pourraient résulter des priorités opérationnelles que la Nouvelle-Zélande va définir dans son nouveau Livre blanc qui paraîtra début 2016. En conséquence, il importe de lui montrer l'intérêt que la France lui porte, en ratifiant rapidement cet accord, d'autant que la Nouvelle-Zélande l'a déjà fait en octobre 2014 et exprime une forte attente quant à son entrée en vigueur.
L'examen en séance publique est fixé au jeudi 11 février 2016. La Conférence des Présidents a proposé son examen en procédure simplifiée. Je vous propose d'accepter cette proposition.

Merci pour cette présentation. Je donne tout de suite la parole aux orateurs.

Je souhaite intervenir pour illustrer l'amitié franco-néo-zélandaise. L'année 2015 a été l'occasion de célébrer le centenaire de l'engagement de la Nouvelle-Zélande pendant la première guerre mondiale et plus globalement de son implication dans les deux conflits mondiaux. L'État français propose la construction d'un mémorial à Wellington dédié aux combattants de la Grande guerre ainsi qu'à l'amitié entre nos deux pays. Je voterai naturellement ce projet de loi.

Vous avez dit que la Nouvelle-Zélande était un pays voisin or je peux vous dire, pour avoir fait plusieurs fois le voyage, que c'est un voisin lointain. Par ailleurs vous n'évoquez pas le déplacement de notre porte-avion nucléaire qui est interdit dans cette zone. Enfin, je constate que si la coopération fonctionne bien dans le domaine militaire, c'est aussi le cas dans le domaine civil. Quelques sociétés néo-zélandaises travaillent très bien avec des sociétés françaises dans de nombreux domaines. J'ai ainsi pu constater qu'un certain nombre d'hôpitaux français étaient équipés de logiciels néo-zélandais. Je voterai pour ce projet de loi.

Je voulais souligner que si la France est située au deuxième rang pour la taille de sa zone économique exclusive, la Nouvelle-Zélande est, quant à elle, classée cinquième avec une surface de 6 millions de km2. Je souhaiterais savoir si cet accord est un outil de surveillance et de protection de ces surfaces maritimes qui peuvent être à la fois le lieu de convergences mais aussi de divergences.

Le rapporteur a eu raison de souligner le travail accompli par la Nouvelle-Calédonie pour développer des relations dans son environnement. Elle est soutenue en cela par la Quai d'Orsay. Il est vrai de dire que l'on a un certain nombre d'enjeux communs dans cette région du monde. La maritimisation des zones économiques exclusives en est un parmi d'autres. De manière relativement discrète, un certain nombre de partenariats se développent actuellement. De ce point de vue, renforcer la coopération avec la Nouvelle-Zélande est de notre intérêt.

Je ne peux que partager la contribution d'Hélène Conway-Mouret au débat. Il est vrai que la coopération militaire avec la Nouvelle-Zélande s'est faite aussi dans des moments tragiques de notre histoire et c'était bien de le rappeler. Je ne me souviens pas avoir dit que la Nouvelle-Zélande était un pays voisin. J'ai seulement parlé d'un voisinage avec la Nouvelle-Calédonie qui reste un territoire français. À ce titre, la Nouvelle-Zélande est voisine de notre territoire, mais bien évidemment pas de la métropole, nous sommes d'accord. Sur la question de la divergence sur le nucléaire, cela n'a pas beaucoup avancé, mais la France et la Nouvelle-Zélande convergent tout à fait sur la nécessité d'unir leurs forces pour une meilleure protection de leurs espaces maritimes extrêmement vastes et complexes. Il est évident que cet accord ne peut qu'y contribuer.
Suivant l'avis du rapporteur, la commission adopte à l'unanimité le rapport ainsi que le projet de loi précité.
Coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité
Approbation de l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de croatie et entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de lituanie - examen du rapport et des textes de la commission
La commission examine le rapport de M. Jean-Marie Bockel et les textes proposés par la commission pour les projets de loi n° 803 (2013-2014) ) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et n° 74 (2014-2015) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité.

Le Sénat est saisi de deux projets de loi autorisant l'approbation d'accord intergouvernemental entre la France et un pays tiers dans le domaine de la défense. Il s'agit du projet de loi n° 803 autorisant l'approbation de l'accord de coopération dans le domaine de la défense entre la France et la Croatie, d'une part, et du projet de loi n° 74 autorisant l'approbation de l'accord de coopération dans le domaine de la défense de la sécurité entre la France et la Lituanie, d'autre part.
À la question « Pourquoi ces accords de coopérations sont-ils nécessaires ? », il conviendrait de répondre que la coopération militaire entre la France et la Lituanie, et entre la France et la Croatie reposait sur des arrangements techniques de coopération dans le domaine de la défense, signés en 1994 avec la Lituanie et en octobre 1997 avec la Croatie. Ils sont devenus obsolètes depuis l'entrée de chacun de ces pays dans l'Union européenne, en 2004 pour la Lituanie et en 2013 pour la Croatie, et leur adhésion à l'OTAN, en 2004 pour la Lituanie et en 2009 pour la Croatie. Les accords qui nous sont soumis visent donc à actualiser la coopération dans le domaine de la défense compte tenu de ces adhésions.
Il convient d'abord de préciser que ces accords de coopération ne contiennent pas de clauses d'assistance en cas d'agression car tel n'est pas leur objet. Ces pays sont membres de l'OTAN et de l'UE, ils bénéficient donc à ce titre des stipulations de l'article 5 du traité de Washington et de l'article 42.7 du Traité sur l'Union européenne relatifs à l'assistance en cas d'agression extérieure.
La coopération militaire entre les armées, qui est visée par les accords que nous examinons, se traduit surtout par des exercices d'entraînement commun, par de nombreux échanges, visites, stages et séjours de courte ou de longue durée dans les écoles militaires et les centres d'instruction des armées et les unités ainsi que par des échanges et retour d'expérience dans les domaines de l'armement, de l'organisation des forces, de leurs soutiens, etc. Les accords de coopération sont donc de nature technique et visent à organiser ce type de coopération.
Les deux accords de coopération bilatérale s'appuient sur les mécanismes de la convention de Londres du 19 juin 1951 entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, dite convention « SOFA OTAN ». C'est justement le champ d'application de cette convention de Londres qui explique que les projets de loi nécessitent une autorisation parlementaire avant approbation. La convention régit les échanges de personnels entre Alliés. Elle détermine le statut des forces armées des Parties lorsque celles-ci se trouvent en service sur le territoire métropolitain d'une autre Partie.
Elle s'applique aux personnels du ministère de la défense et du ministère en charge de la sécurité intérieure, excluant de fait les personnels civils du ministère des affaires étrangères et du développement international (MAEDI), notamment ceux qui sont en charge des missions de coopération de sécurité et de défense. La situation de ces personnels n'étant pas prévue par le SOFA OTAN, ils relèvent donc actuellement du droit local lorsqu'ils se trouvent sur le territoire de la Croatie ou de la Lituanie. Or, dans le cadre des missions de coopération de sécurité et de défense du ministère des affaires étrangères, des civils de ce ministère peuvent être présents sur les territoires croate ou lituanien. L'extension de l'application du « SOFA OTAN » à ces personnels dans les accords de coopération leur garantit une meilleure protection et permet que tous les agents amenés à effectuer des activités de coopération en matière de défense soient régis par le même statut.
J'en viens maintenant au contenu des accords de coopération. Ces deux accords visent à développer une coopération bilatérale en matière de défense dans des domaines traditionnels, tels que la formation, notamment au français, l'accueil ou l'échange de stagiaires, l'armement, le soutien logistique, la géographie militaire ou tout autre domaine dans lequel des pays signataires décideraient de collaborer. Cette coopération prendra la forme d'échanges bilatéraux annuels de haut niveau entre les ministres de la défense.
Des échanges d'informations classifiées sont prévus par les deux accords, ils sont très encadrés et prévoient que chaque pays protège les informations classifiées de l'autre Partie conformément à sa législation nationale. Selon les informations que j'ai recueillies lors des auditions tenues pour préparer ce rapport, ces échanges d'informations sensibles devraient avoir une influence non négligeable sur un autre aspect de la coopération dans le domaine de la défense : la coopération dans le domaine de l'armement.
Pour la Croatie, les pistes de coopération pourraient être modelées par le fort intérêt manifesté pour certains matériels de défense tels que le système de surveillance maritime Polaris de DCNS et les missiles sol-air Mistral de MBDA.
Outre l'achat de Dauphin d'occasion en 2015, des perspectives de coopération dans le domaine de l'armement avec la Lituanie se dessinent dans les secteurs suivants : défense anti char, équipement en véhicules blindés, modernisation de l'artillerie.
La signature de cet accord permettra de renforcer la coopération avec la Croatie, ce qui est bienvenu compte tenu du fait, notamment, que nous avons un tel accord de coopération avec la Serbie, qui n'est pourtant ni membre de l'Union européenne, ni adhérente de l'OTAN, et que nous sommes le dernier grand pays européen à ne pas avoir établi de document encadrant les modalités de notre coopération militaire avec la Croatie.
Nous avons intérêt à soutenir le rôle stabilisateur que s'efforce de jouer la Croatie dans cette région, impulsant ou soutenant les initiatives de coopération régionale. De plus, la Croatie a également démontré son intérêt pour les opérations de politique de sécurité et de défense commune (PSDC). Outre des engagements sous l'égide de l'ONU et de l'OTAN, l'année 2015 a vu les deux premiers mandats croates sous bannière européenne, qui ont été les suivants :
- participation d'une équipe de protection embarquée (EPE) à l'opération ATALANTE de lutte contre la piraterie de décembre 2014 à avril 2015, avec le soutien des forces françaises à Djibouti,
- et engagement d'un navire dans l'opération TRITON en Méditerranée au second semestre 2015.
Le budget de 6 000 euros environ par an que la France consacre à sa coopération avec la Croatie dans le domaine de la défense ne représente donc qu'une petite part des relations réelles que nous entretenons, comme le montre le soutien des forces françaises à Djibouti. Mais chacun ici connaît -et déplore- l'amaigrissent des ressources de la direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD). L'intérêt que manifeste la Croatie pour la collaboration avec la France dans le domaine de la sécurité maritime et autour du concept d'« action de l'État » en mer montre que cet accord de coopération pourrait renforcer des liens constructifs. Je propose donc d'adopter le projet de loi n° 803 relatif à la coopération avec la Croatie.
Je vous propose de retenir la même position et d'adopter également le projet de loi n° 74 relatif à la coopération avec la Lituanie. Là encore les budgets de coopération sont modestes, de l'ordre de 8 000 euros par an. Mais les convergences avec ce pays sont réelles.
La France a participé aux missions de police aérienne du ciel et de réassurance, dans le cadre de l'OTAN, en 2007, 2010, 2011 et 2013 avec quatre Mirage. Elle y participera de nouveau en 2016 avec quatre Rafale stationnés sur la base de Siaulai. Nous savons tous la sensibilité des Pays Baltes au voisinage russe, perçu comme une menace.
Ces actions ont permis l'instauration d'une relation bilatérale confiante. Depuis 2004 la France et la Lituanie oeuvrent ainsi généralement de concert au sein de l'Union européenne et de l'OTAN.
Je vous propose d'adopter ces textes et de les examiner, comme proposé par la conférence des Présidents en forme simplifiée.

Je voulais féliciter le rapporteur pour sa présentation aussi concise qu'efficace, et lui demander si des accords de coopération dans le domaine de la défense ont été signés entre la France et les deux autres Pays Baltes : la Lettonie et l'Estonie.

Il me semble que tel est bien le cas pour l'Estonie, sans que je sois sûr toutefois des dates de ratification. Pour la Lettonie, je ne suis pas certain que les négociations aient abouties à ce jour. Je vous propose de vous transmettre ces renseignements après vérification.
Suivant l'avis du rapporteur, la commission adopte à l'unanimité le rapport ainsi que le projet de loi précité.
La commission nomme Mme Joëlle Garriaud-Maylam rapporteur sur la proposition de résolution n° 346 (2015-2016), en application de l'article 73 quater du Règlement, sur les demandes de réforme de l'Union européenne présentées par le Royaume Uni.

Mes chers collègues, nous sommes heureux d'accueillir Mme Bermann, notre ambassadrice au Royaume-Uni, ainsi que nos amis de la commission des affaires européennes et leur président, Jean Bizet. Je précise que la commission a désigné Joëlle Garriaud-Maylam comme rapporteur de la proposition de résolution européenne sur les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.
Nous sommes, madame, très heureux et très honorés de vous recevoir. Nous apprécions votre action, celle d'aujourd'hui comme celle d'hier. Vous avez marqué de votre empreinte et de manière extrêmement positive les relations franco-chinoises, dont on voit aujourd'hui qu'elles connaissent des succès, grâce notamment au travail que vous avez conduit.
Nous voudrions vous saluer pour cela, ainsi que pour l'action qui est aujourd'hui celle de la France au Royaume-Uni, et étudier avec vous un sujet qui nous préoccupe plus particulièrement - je le cite parce que c'est un point sur lequel un certain nombre de collègues de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées pourraient vous interroger - celui de la revue de défense britannique, qui est en fait l'équivalent de notre « Livre blanc », qui prévoit une montée en puissance des moyens militaires, avec une perspective de budget de défense représentant 2 % du PIB, norme fixée par l'OTAN. C'est sans doute aussi pour nous une exigence si l'on veut tenir les engagements militaires qui sont les nôtres.
La revue de défense britannique choisit un format des armées qui inclut une dissuasion nucléaire renouvelée, avec 40 milliards de livres d'investissements pour le renouvellement des sous-marins nucléaires, les SNLE. C'est donc un sujet qui nous intéresse beaucoup. Pouvez-vous nous dire comment vous voyez la démarche britannique ? Quelles sont notamment les capacités que le Royaume-Uni a aujourd'hui de pouvoir réaliser les objectifs qu'il affiche dans la revue de défense ?
Nous voudrions naturellement ensuite vous entendre - vous choisirez l'ordre des sujets - sur le Brexit. Notre commission vient d'en parler à l'instant. Nous voudrions connaître votre point de vue...
Il est clair que, vu de Paris, on est pris entre deux préoccupations majeures, d'une part éviter des processus de déconstruction de l'Union, qui seraient des signaux assez catastrophiques envoyés au monde et qui constitueraient un processus dont on ne sait pas où il pourrait s'arrêter et, d'autre part, éviter d'agir sous la pression d'un rapport de force.
Ce « paquet Tusk », on le voit bien, nous met devant un dilemme, dont il faudra peser les termes lors de notre débat qui précédera le Conseil européen, les 18 et 19 février.
Voilà, Madame l'ambassadeur, les sujets qui nous préoccupent - mais mes collègues vous poseront leurs propres questions, aussi bien en matière d'affaires étrangères, d'Europe, que de défense.
Je laisse maintenant la parole à mon collègue et ami Jean Bizet, président de la commission des affaires européennes.

Merci, monsieur le président. Nous sommes particulièrement heureux de vous recevoir, madame l'ambassadeur. M. le président Raffarin a déjà tout dit mais, au travers de cet échange, nous prolongerons en quelque sorte ceux que nous avons déjà eus il y a une quinzaine de jours avec vous et Fabienne Keller, qui est l'auteure d'un rapport que la commission des affaires européennes a récemment examiné. Il est à votre disposition dès ce matin.
Je crois pouvoir résumer brièvement notre position, en disant tout d'abord que, dans un contexte difficile, comme l'a souligné le président Raffarin, où la cohésion européenne doit être préservée, nous souhaitons que le Royaume-Uni reste dans l'Union. C'est un débat qui va nous retenir pendant quelque temps, notamment en plénière, le 17 février prochain, dans le cadre d'un débat préalable au Conseil européen. Toutefois, si nous sommes ouverts au dialogue - et nous avons regardé avec attention les dernières propositions du Conseil, qui semblent satisfaire M. Cameron, qui lui-même a encore demandé quelques avancées pour positionner le curseur - notre compréhension ne peut aller jusqu'à remettre en cause les acquis de la construction européenne auxquels le Sénat, vous le devinez, est particulièrement attaché !
C'est à l'aune de cette ligne directrice que nous souhaitons que le prochain Conseil européen fixe sa position.
Nous voudrions donc connaître les évolutions de l'opinion publique britannique, même si nous connaissons déjà un peu la pensée de ceux qui sont « aux responsabilités ». Voilà pourquoi nous sommes particulièrement attentifs à votre présence aujourd'hui et à vos propos. Merci encore, madame l'ambassadeur, d'être présente aujourd'hui au Sénat.
Messieurs les présidents, mesdames et messieurs les sénateurs, merci de me recevoir ce matin. Le sujet est d'actualité, comme vous le voyez. Vous avez bien choisi la date, puisque le président Tusk a fait ses propositions hier.
Le référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne mobilise toute la classe politique britannique depuis plusieurs mois, plus particulièrement David Cameron qui, depuis les élections, a entamé un périple à travers l'Europe. Il s'est rendu au moins deux ou trois fois dans les différents pays. Il est venu voir le Président de République au mois de mai dernier, dès l'adoption du discours de la Reine, qui annonçait ce référendum. Il l'a reçu à Chequers en septembre pour préciser ses demandes, et également à Paris pour un petit-déjeuner à la suite des attentats du 13 novembre. Je tiens à le dire, les Britanniques nous ont accordé un soutien exceptionnel à la suite des attentats de Paris. David Cameron lui-même a dit : « La France est un allié et un ami, et on doit tout faire pour l'aider ». C'est la raison pour laquelle il a lancé le débat au Parlement sur les frappes en Syrie, qu'il a mis à notre disposition la base d'Akrotiri à Chypre, et que les Britanniques sont prêts à nous aider en Afrique, à la suite de la demande du ministre de la défense.
Pourquoi ce référendum ? Tout d'abord, il existe un euroscepticisme ambiant au Royaume-Uni, qui n'a jamais tellement adhéré à l'Europe telle que nous la concevons, mais l'envisage essentiellement sous l'angle du marché commun. Dans le contexte électoral, face à la poussée du mouvement nationaliste UKIP qui fait un lien entre l'Europe et les problèmes d'immigration, David Cameron s'est engagé dès 2013 à organiser un référendum sur l'Europe.
Il pensait, s'il gagnait les élections - ce qui n'était pas sûr - être en coalition avec le parti des Libéraux démocrates. Mais il a gagné les élections d'une courte majorité et le manifesto, qui est le programme du parti, s'applique donc intégralement, et le référendum aura donc bien lieu.
La situation pour le premier ministre est difficile, parce qu'il a doit faire face au sein de son parti aux backbenchers, des députés qui ne sont pas eurosceptiques mais europhobes, et qui veulent sortir de l'Union européenne quoi qu'il arrive.
Le sujet, pour eux, n'est pas celui de l'immigration, mais de la souveraineté intégrale du Parlement : tout doit se décider à Westminster. Ils ne peuvent accepter, surtout pour un pays qui n'a pas de Constitution écrite, qu'une partie de la loi soit rédigée à Bruxelles, d'où un risque de scission du parti.
Une autre difficulté vient de l'incertitude du nouveau leadership du parti travailliste, le Labour, encore qu'il vienne de se prononcer de manière assez claire. Je parlerai de l'opinion publique après.
Dans ce contexte, David Cameron s'exprime de manière de plus en plus positive sur l'intérêt du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, pas seulement en termes de prospérité économique, mais aussi en termes d'influence et de sécurité du pays. Si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, il deviendrait pour Washington un partenaire moins important et la relation spéciale avec les États-Unis n'aurait plus beaucoup de sens. David Cameron sait aussi que, vis-à-vis de la Russie et de la Chine, le Royaume-Uni n'a pas intérêt à paraître isolé.
Les principaux ministres - le ministre des affaires étrangères en particulier - sont également de plus en plus convaincus des mérites de rester dans l'Union européenne.
David Cameron a donc essayé de formuler un certain nombre de propositions. Les choses ont beaucoup évolué en un an, d'abord parce que les partenaires européens ont exprimé leur point de vue, dont Angela Merkel et le Président de la République. Je crois que ce qui a changé la perception de David Cameron vis-à-vis de la France - à un moment où il considérait un accord avec Berlin suffisant - c'est le rôle qu'a joué le Président de République lors de la crise grecque, qui a démontré que la France avait également un poids dans la négociation.
Le premier ministre ne demande plus de révision du traité, mais souhaite un accord juridiquement contraignant, ce qui peut être fait par le biais d'une déclaration des chefs d'Etat et de gouvernement au Conseil européen.
Il ne réclame plus exactement de limites à la circulation - encore que la formule du frein d'urgence soit assortie d'un certain nombre de conditions, du fait de la nécessité d'une proposition de la Commission et d'une décision du Conseil. Il doit toutefois impérativement obtenir quelque chose sur ce sujet-là, qui intéresse les électeurs britanniques.
S'agissant des liens entre zone euro et non-zone euro, il a dit très clairement qu'il ne s'opposait pas à l'intégration de la zone euro, qu'il n'entendait pas y mettre de veto, et que c'était d'ailleurs l'intérêt du Royaume-Uni que la zone euro soit viable économiquement.
D'autres demandes concernent une meilleure réglementation, une moindre bureaucratie, l'achèvement du marché unique dans le domaine des capitaux et de l'économie digitale, ainsi qu'un certain nombre de dispositions allant dans le sens de l'intérêt général. Une sortie du Royaume-Uni risque d'affaiblir l'Union européenne. C'est une des économies les plus dynamiques, avec près de 65 millions d'habitants, le seul pays qui ait une capacité de projection militaire et qui est souvent à nos côtés. Ce serait très mauvais pour la France, pour l'Union européenne, et pour le Royaume-Uni, bien sûr. Si l'on veut peser face à des États continents comme les États-Unis ou la Chine, on a besoin de ce marché commun, de ces 500 millions d'habitants. On est plus forts ensemble.
Mon expérience en tant qu'ambassadeur en Chine me l'a clairement démontré : lorsque la France, l'Allemagne ou d'autres pays ont essayé de résoudre seuls leurs contentieux commerciaux, ils n'ont pas eu gain de cause. C'est la Commission qui a pesé, grâce à ses prérogatives. Le plus grand marché économique du monde, ce n'est pas celui que représentent les États-Unis, c'est l'Union européenne. C'est donc notre intérêt que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne.
On va examiner les propositions qui ont été formulées par le président du Conseil européen. Il va donc y avoir, le 5 et le 11 février, des réunions des sherpas. Il y a eu bien sûr de nombreux contacts préalables avec le Trésor et le sherpa français. David Cameron a appelé plusieurs fois le Président de la République.
Restent les crochets dans le texte, en particulier les questions de rédaction concernant la zone euro, l'Union sans cesse plus étroite. En fait, ceci figure dans le préambule, on ne va donc pas le supprimer du traité, mais les Britanniques vont dire que cela ne s'applique pas à leur cas. Il aurait été évidemment inacceptable de la retirer du traité, mais je pense qu'on approche quand même d'un compromis qui ne franchit pas nos lignes rouges, qu'on a exprimées très clairement, sous réserve, je le répète, d'une rédaction vérifiée par les juristes.
L'échéance pour trouver un accord est fixée au 18 février, lors du Conseil européen.
Après l'accord, il faut quatre mois de procédure législative, et David Cameron a dit qu'il la lançait immédiatement, la limite étant fin juin. On parle donc de la date du 23 juin pour tenir le référendum. Ensuite les Écossais partent en vacances - il vaut mieux qu'ils soient là car ils sont plutôt pro-européen dans l'ensemble, puis c'est au tour des Anglais.
Le rapport de force est actuellement difficile à déterminer, parce que les sondages sont très serrés. Un Britannique m'a dit que cela allait être chaotique, mais qu'à la fin, il était convaincu que le Royaume-Uni resterait dans l'Union européenne. Je partage cette opinion, parce que je pense que la conjonction des intérêts pour le Royaume-Uni, pays dont on fait remarquer qu'il est à la fois pragmatique et conservateur, fera que les Britanniques ne voudront peut-être pas sauter dans l'inconnu. De plus, comme le dit fort justement David Cameron, le Royaume-Uni a le meilleur des deux mondes. C'est ce que vous disiez tout à l'heure : ils sont dedans, et ils sont dehors. C'est vrai qu'ils ne sont pas dans les programmes qui posent des difficultés, comme l'euro et Schengen. Ils en tirent donc des avantages. D'ailleurs, le gouverneur de la Banque d'Angleterre a fait une étude sur ce sujet et, de plus en plus, les hommes d'affaires s'expriment.
Pour le moment, il est difficile de voir le rapport de force, parce que les partisans du non, qui veulent sortir, sont déjà intervenus à voix haute, même s'ils n'ont pas de grand porte-parole pour le moment. Leurs arguments ne sont pas très crédibles. Ils disent par exemple que l'Union européenne peut être remplacée le Commonwealth, ou qu'ils pourraient avoir le statut de la Norvège. Le Premier ministre norvégien leur a dit : « Nous, nous payons à l'Union européenne. Nous sommes obligés d'en respecter les règles, et nous ne sommes pas à la table des négociations pour les élaborer. Nous ne voyons donc pas bien l'intérêt pour vous ! ».
Pour le moment, les partisans du non ont du mal à trouver des arguments ou des alternatives, mais dans ce que l'on peut appeler l'Angleterre profonde, le thème de l'immigration a une résonance. Les Britanniques y ont le sentiment qu'on leur prend leurs emplois, qu'ils ont plus de mal à trouver de la place pour leurs enfants dans les écoles, ou à aller dans les hôpitaux.
Le camp du oui ne s'est pas encore exprimé de manière claire. David Cameron veut précisément jouer sur les succès qu'il aura remportés vis-à-vis de l'Union européenne, mais le monde des affaires, l'équivalent du MEDEF, la Confederation of British Industries (CBI) sont dans les starting-blocks. C'est pour eux une évidence, mis à part les 20 % qui ne sont pas sur cette ligne-là parce qu'ils ont une activité plus concentrée géographiquement sur le Royaume-Uni. Cela étant, ces derniers sont souvent fournisseurs de grands groupes, comme Airbus ou autres, et leur intérêt pourrait donc être également mis en cause.
Je pense que cette campagne va commencer sérieusement après l'adoption du paquet européen. Encore une fois, in fine, si l'on considère l'épée de Damoclès que constitue un nouveau référendum écossais en cas de sortie de l'Union européenne, je suis plutôt optimiste.
Pour finir, quel est l'intérêt pour la France que le Royaume-Uni demeure dans l'Union européenne ? C'est notre meilleur partenaire sur les questions de défense et de sécurité en termes d'échanges de renseignements.
Il existe un sujet difficile, celui de Calais, même si on a développé notre coopération. On pourra y revenir.
En matière de défense, ils sont membres permanents du Conseil de sécurité, comme vous l'avez dit, monsieur le président, et ont confirmé l'objectif de 2 % de dépenses militaires dans le budget. David Cameron a dit, après les élections : « Britain is back ! ». Le premier ministre veut se réinvestir dans les affaires internationales. Je dis souvent que, en matière de défense européenne, les Britanniques sont pratiquants mais non croyants. En réalité, ils n'aiment pas le concept de défense européenne, mais quand on leur demande d'y aller, ils y vont, que ce soit au Mali ou dans le cadre de l'opération Sofia, en Méditerranée. Ils dirigent toujours l'opération Atalante de lutte contre la piraterie. En réalité, ils nous aident.
La coopération bilatérale est étroite. On va avoir un sommet franco-britannique début mars, dont grande partie sera consacrée à la sécurité, à la défense et aux programmes d'armement communs, comme l'avion du futur, le FCAS, les programmes de missiles.
Dans la revue de défense, après les États-Unis, c'est la France qui est leur meilleur partenaire. Beaucoup de chercheurs britanniques remarquent la place qui a été prise par la France en matière de défense.
Ce sujet va être un des sujets prioritaires, à côté du nucléaire, avec la centrale d'Hinkley Point et la coopération dans ce domaine. Je signale ici - je l'ai proposé, j'espère que ce sera retenu - notre intention de développer également les relations transfrontalières avec les provinces limitrophes dans tous les domaines, ainsi que le programme Young Leaders, comme on l'a fait avec les États-Unis et, récemment, avec la Chine.
On a souvent l'illusion, beaucoup de Français passant leur week-end à Londres et beaucoup de Britanniques - 12 millions, en fait - venant en vacances chaque année en France, que l'on se connaît bien, mais je crois que ce n'est pas le cas. On aimerait développer le tissu de nos relations. J'espère que cette suggestion sera retenue. Ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait des échanges. Je pense que c'est important : encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est proches que nous nous connaissons aussi bien qu'on l'imagine. Je suis à présent prête à répondre à vos questions.

Merci beaucoup. La parole est à Mme Garriaud-Maylam, puis à Mme Keller.

Madame l'ambassadeur, chère Sylvie Bermann, je voudrais d'abord vous remercier de tout ce que vous faites en Grande Bretagne, depuis un an, au service des relations franco-britanniques, dans un contexte qui n'est pas toujours facile. Vous avez toujours fait la preuve de la qualité de votre engagement.
Cette question du Brexit, nous en avons souvent parlé ensemble dans différentes réunions, au Conseil franco-britannique et ailleurs. Là encore, je voudrais vous remercier d'avoir bien positionné ce sujet dans le contexte britannique, avec les différents éléments.
J'aurai quand même un certain nombre de questions plus précises à vous poser...
En ce qui concerne le projet de loi d'organisation du référendum, quels aménagements ont été réalisés et comment cela pourrait-il nous aider à maintenir le Royaume-Uni dans notre ensemble européen ?
Deuxièmement, les acteurs de la campagne électorale me paraissent constituer un sujet fondamental, 6 millions de livres sterling devant être répartis entre les deux camps. Comment les choses vont-elles se passer au niveau de la presse ? C'est vraiment notre « ennemi » le plus important. Cela fait des années et des années que la presse britannique s'oppose à tout ce qui concerne la construction européenne, l'Union européenne, avec des messages extrêmement négatifs en permanence. On l'a vu encore ce matin avec la une des journaux britanniques, qui considère par exemple les positions de Donald Tusk comme « a joke », ce qui est extrêmement fort ! Il faut donc les moyens de contrecarrer ce message, et cela ne peut bien sûr venir que des Britanniques eux-mêmes, parce que nous, Européens, serions immédiatement soupçonnés de défendre nos intérêts.
Un simple exemple : quand on voit les sondages, même parmi les parlementaires, l'ignorance des questions relatives à l'Union européenne est frappante. Quand 61 % des parlementaires disent - c'est un sondage de la semaine dernière - qu'ils ne savent même pas qui exerce la présidence du Conseil européen, c'est extrêmement grave !
Parmi eux, 11 % des Tories veulent sortir de l'Union européenne, 25 % envisagent la sortie, et 69 % se disent très mal à l'aise sur cette question. C'est inquiétant, mais ce qui l'est davantage encore, ce sont les sondages relatifs à la perception qu'a le peuple britannique de l'Union européenne, vous l'avez très bien dit, madame l'ambassadeur.
En un mot, le lien entre l'immigration et l'Union européenne est le handicap le plus important. 16 % seulement des Britanniques pensent que c'est la question la plus importante - ou une des questions les plus importantes. 46 % estiment que l'immigration est la question fondamentale.
Vous avez abordé la question de l'Écosse. J'ai déjà travaillé pour la commission des affaires européennes sur ce sujet : il faut effectivement l'utiliser comme un levier. On sait très bien que des voix, en Écosse, se sont élevées pour un nouveau référendum écossais en cas de décision de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Espérons que cela fera réfléchir les Britanniques. Il existe aussi des questions économiques liées à l'Écosse, mais les enjeux de sécurité et de défense sont essentiels.

C'est toujours un grand plaisir, madame Bermann, de vous retrouver, à Londres ou à Paris.
Je salue votre implication et votre vision mondiale. Vous avez rappelé votre parcours en Chine, et votre présentation éclaire aussi l'enjeu que constitue la présence du Royaume-Uni en Europe.
Nous sommes au terme d'un processus qui a démarré il y a plus de trois ans, avec la Review of competences, un exercice d'analyses magnifique mené par les Britanniques, très consensuel - 32 chapitres, de mémoire - destiné à savoir ce que l'Union européenne fait bien et ce qu'elle pourrait faire mieux, avec beaucoup de contributions, notamment des forces vives britanniques. Puis, lors du discours de Bloomberg, David Cameron, préparant ces élections, face à l'aile conservatrice du parti, qui n'est pas pro-européenne, a pris l'engagement du référendum... Nous y voilà à présent !
Madame l'ambassadrice, vous avez rappelé les deux étapes - négociation au Conseil européen, puis référendum. Ceci rend notre posture très compliquée. En effet, si la négociation au Conseil européen peut constituer un gain et permettre de rester ferme avec les Britanniques, elle pourrait aussi se révéler un piège dans la relation entre David Cameron, qui sera forcément le leader du camp du oui, et sa population.
Tout en soutenant évidemment la position très prudente de la France, qui vise à ne pas compliquer la campagne référendaire, pourriez nous donner quelques précisions sur les négociations en cours quant au rôle des parlements nationaux ? On a appris dans la presse ce matin que 55 % des parlements pourraient créer un blocage autour d'un texte engagé par la Commission au niveau du Conseil, avec obligation de l'amender. Est-ce la voie vers laquelle la négociation s'oriente ? C'est d'ailleurs un sujet sur lequel il y a plutôt adhésion de notre côté.
La question de la mobilité intra-européenne est le sujet central pour le peuple britannique, avec l'accès au système de complément de revenus, dont on sait qu'il n'a pas de conditions de durée. Pourriez-vous nous en dire un peu plus, cette clause pouvant être utilisée en cas de déstabilisation des services publics britanniques ? Je vous remercie.

Madame l'ambassadeur, merci de votre présentation.
Je voudrais revenir sur le volet défense. Les Britanniques viennent de terminer leur revue stratégique défense et sécurité avec, disons-le, des analyses géopolitiques, géostratégiques et, en même temps, des décisions assez voisines de celles de la France, que ce soit par rapport au Livre blanc ou à l'actualisation, en juillet dernier, de notre loi de programmation militaire (LPM). Toutefois, l'ambition affichée par les Britanniques est beaucoup plus importante que la nôtre : 2 % de PIB, pensions comprises bien entendu, mais deux porte-avions et surtout 41 milliards d'euros sur la durée - soit plus de 2 milliards d'euros par an pour remplacer la force de dissuasion nucléaire. Je le dis pour mes collègues : si la France suit cette voie, c'est au minimum ces sommes que nous devrons payer à notre tour le moment venu. Croyez-vous que les Britanniques aient les moyens, budgétairement, année après année, de faire un tel effort - surtout sans le support d'une programmation pluriannuelle par une LPM ?
Deuxièmement, dans le cadre du suivi parlementaire des accords de Lancaster House, Phil Hamond, qui était, il y a un peu plus de deux ans, ministre de la défense, disait : « Nous sommes usés par les expéditions en Afghanistan et en Irak. Nous avons des problèmes budgétaires. Nous avons le référendum sur l'Écosse et des élections législatives générales. Nous voulons bien intervenir dans le civilo-militaire et dans la logistique à vos côtés, mais ne nous demandez pas d'intervenir réellement sur le terrain ». Pensez-vous que ce point de vue a changé aujourd'hui ?

Madame l'ambassadeur, merci pour votre exposé.
Une simple question : quand on évoque le Brexit et les eurosceptiques, on parle essentiellement des Britanniques, mais pouvez-vous nous donner une idée des forces extérieures ou des groupes extérieurs, publics ou privés, qui auraient intérêt à ce que la Grande Bretagne sorte de l'Union européenne ? J'imagine que cela doit exister et que les moyens ne doivent pas manquer.

Madame l'ambassadeur, je souscris bien entendu aux remerciements qui vous ont été adressés par mes collègues.
Vous avez évoqué la révision du traité. On partait de loin, mais on est passé à quelque chose de plus raisonnable. Vous évoquez des lignes rouges. Cela va-t-il jusqu'à l'acceptation de la privation de droits sociaux à des ressortissants européens, et n'y a-t-il pas, dans les compromis en cours, un risque de créer de ce point de vue deux catégories de ressortissants européens ?
Puisque nous n'avons aucune certitude sur l'issue du référendum de juin prochain, ne doit-on pas craindre d'ouvrir une boîte de Pandore, de voir d'autres pays revendiquer un certain nombre d'assouplissements et, de ce fait, d'assister au détricotage de l'Union européenne ?

Merci, madame l'ambassadrice. Existe-t-il une perception du sentiment dans l'opinion au Royaume-Uni - je ne parle pas de la presse - du fait que d'autres Européens sont agacés par la demande britannique ?
Une génération s'est employée à construire un édifice européen aussi harmonieux que possible. Il ne répond naturellement pas totalement à nos souhaits, mais cela a été un exercice très compliqué, auquel les Britanniques ne se sont joints que tardivement - d'aucuns disent, en forçant le trait, que si le général de Gaulle était resté plus longtemps au pouvoir, ils n'y seraient toujours pas !-. Un référendum, en 1973, les a fait rejoindre l'Union européenne, et des craintes se sont alors exprimées que, dès lors qu'ils allaient être à l'intérieur, ils « pourriraient le fruit », en quelque sorte. Les Britanniques perçoivent-ils ce sentiment d'agacement ? Évidemment, ce qui se passe avec la Grande Bretagne peut se passer avec d'autres pays. On n'a aucune garantie que des pays qui viennent d'entrer récemment dans l'Union ne demandent pas exactement la même chose. De détricotage en détricotage, d'acceptation en acceptation, on démontera l'édifice que nous avons construit.
J'ai toujours été un Européen convaincu. C'est le sens que j'ai donné à la construction politique de ma vie. C'est donc la crainte que j'ai actuellement ! Les Britanniques en sont-ils conscients ?
J'ajoute un deuxième point - et cela rejoint ce que disait mon collègue Jacques Gautier - à propos de la défense. Certes, avec la France, on a un partenariat en matière de défense extrêmement profitable. Il faut dire que ce sont les deux pays qui, essentiellement, ont la capacité, en Europe, d'avoir une action de défense efficace, une action militaire. Ils sont d'ailleurs en ce moment en train de mettre en place un corps expéditionnaire que l'on va porter sur les fonts baptismaux officiellement dans deux mois. C'est une excellente coopération depuis plusieurs années, après le traité de Lancaster House, y compris sur le plan nucléaire mais, les Britanniques ne voulant pas de défense européenne, contrairement à nous, rien ne permet de penser qu'une sortie du Royaume-Uni de l'Europe interdirait une coopération bilatérale en la matière.
Je ne crois pas du tout à l'argument qui consiste à dire que s'ils sortent de l'Europe, on perd un partenaire en matière de défense. On ne perd pas un partenaire de défense : les choses ne se feront simplement pas dans le cadre que l'on imagine, et que l'on ne parvient d'ailleurs pas à construire avec eux. Puis-je avoir des précisions sur ces deux points ?

Merci, madame. Vous nous avez apporté des éléments intéressants. Ma question porte sur la relation spéciale entre le Royaume-Uni et les États-Unis : ceux-ci pourraient-ils voir des avantages à un affaiblissement de l'Europe ?

Madame l'ambassadeur, je souhaite me joindre aux remerciements qui vous ont été adressés et évoquer la Norvège, ainsi que celui de l'espace économique européen, sujets que vous avez abordés. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune prise de conscience des Britanniques à ce sujet, pour en avoir parlé avec certains.
Ils ne se rendent pas compte que, s'ils entraient dans l'espace économique européen, il faudrait qu'ils s'acquittent d'un certain nombre de devoirs, financiers en particulier, qu'ils renégocient les traités sans participer aux décisions, ce qui est aussi, vous l'avez dit, un point qu'ils n'envisagent certainement pas.
Y a-t-il une information au Royaume-Uni sur ce point ? La presse en parle-t-elle ? Je ne le crois pas...
Ma collègue Joëlle Garriaud-Maylam a fait part de la position de la presse : je crois cette dernière assez fermée aux aspects positifs de l'Union européenne. Que faudrait-il faire ? C'est un sujet important, car les Britanniques pensent qu'ils seront toujours présents en Europe, même s'ils ne sont pas membres de l'Union européenne.

Madame l'ambassadeur, pour tirer profit du cheminement de votre magnifique carrière, je voudrais savoir ce que pensent les Chinois d'un tel avatar dans la construction chaotique de notre Europe ?

Madame l'ambassadrice, on a le sentiment, à écouter nos collègues, que la Grande Bretagne est un frein dans la construction européenne, et ce depuis des années. La difficulté à construire une Europe de la défense commune a été évoquée, mais on pourrait ajouter aussi toutes les difficultés que l'on rencontre au plan économique et social, les problèmes d'harmonisation de la fiscalité, de défense de la City - sans oublier le « I want my money back ! » de Mme Thatcher. On se demande, quand on entend les éléments évoqués ici, quel va être le résultat de ce référendum. Je crains, connaissant les réponses qu'apportent souvent les électeurs aux référendums, que le Brexit soit possible.
Vous nous dites que ce serait une difficulté pour l'Europe. Pourrait-ce être aussi une chance de pouvoir avancer vers quelque chose d'un peu plus cohérent et d'un peu plus solidaire dans beaucoup de domaines ? Je vous pose la question, parce que je rejoins Daniel Reiner quand il dit qu'en termes de coopération militaire, cela ne changerait sûrement pas grand-chose. Je pense qu'en termes d'avancées économiques, sociales et fiscales, cela permettrait peut-être à l'Europe d'avancer beaucoup plus vite.

Monsieur le président, mes chers collègues, le général de Gaulle disait qu'il voulait l'Angleterre « toute nue » dans l'Europe. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait ainsi qu'on l'a eue ! Quelques années plus tard, un gaulliste très anglophile et très européen, Maurice Schumann, a contribué à ce que le Royaume-Uni entre dans l'Europe : on espérait à ce moment-là que les Britanniques joueraient pleinement le jeu.
Les Britanniques font des demandes en fonction de leur sensibilité, de leur volonté de conserver une nation britannique. On peut les comprendre : l'Europe des nations, cela ne nous est pas non plus tout à fait étranger. Sont-ils capables de comprendre qu'ils doivent également tenir compte des réactions des autres, et qu'ils ont provoqué de l'irritation chez beaucoup d'Européens qui tiennent à la construction européenne ?
Vous avez fait allusion, madame, à Calais. Étant de cette région, j'aimerais bien que vous nous expliquiez où on en est, et si on peut, en ce moment, faire bouger les choses car, dans ma région, la montée de l'extrême droite aux dernières élections traduit une irritation à l'égard de nos voisins. Vont-ils changer ?
Je suis tout à fait d'accord avec ce que pensent les habitants de ma région, et ce que dit le nouveau président de la région et j'estime qu'il n'y a guère de raison que nous soyons chargés de faire à Calais ce que les Britanniques ne souhaitent peut être pas faire à Douvres...
Je dois vous dire ma perplexité face à certaines manifestations de ressortissants britanniques à Calais pour exprimer solidarité et compréhension aux réfugiés, alors que leur gouvernement exige de nous que nous édifiions des barbelés partout autour du port de Calais !

Madame l'ambassadeur, je voudrais vous poser une question concernant la sécurité : suite aux attentats de Paris, les services anglais ont adapté, modifié, transformé leurs modes et leurs dispositifs de surveillance. La question du contrôle des frontières, la lutte contre le trafic d'armes, la surveillance - on le sait tous - sont plus que jamais d'actualité, mais je voudrais aller plus loin concernant le contrôle et la surveillance des réseaux sociaux, ainsi que des communications électroniques. Comment cette question est-elle appréhendée dans ce pays, qui est connu pour son libéralisme et son attachement aux libertés individuelles ?

Madame l'ambassadeur, merci pour vos propos. Je voulais aborder la question de l'immigration, qui ne l'avait pas été avant que Jacques Legendre ne le fasse. Je ne reviendrai pas beaucoup plus sur le sujet. Vous avez dit tout à l'heure qu'une nouvelle vague d'immigration, fin juin, risquait d'avoir des conséquences sur l'opinion publique. Je voudrais que vous puissiez nous donner quelques informations sur l'état de l'opinion publique en Grande Bretagne vis-à-vis de la question des migrants. Ils sont hors Schengen, les conséquences sont donc peut-être moins importantes, mais quand même...
On voit bien comment nous vivons les choses de ce côté la Manche, et j'aimerais que vous puissiez nous dire un peu plus en détail ce qui se passe de l'autre côté.

J'ai tendance à penser que la démarche britannique peut présenter des éléments positifs, notamment cette volonté des Anglais d'avoir une Europe plus compétitive, ce qui obligera peut-être la France à conduire les réformes qu'on reporte depuis longtemps.
Cette remarque, je l'ai faite en commission des affaires européennes, et je la réitère devant la commission des affaires étrangères.

Dans l'hypothèse où il y aurait un Brexit, que nous redoutons tous et que nous ne souhaitons pas, y aurait-il automatiquement une question sur un nouveau référendum pour l'Écosse ? Si je me souviens bien de l'entretien que nous avons eu avec lui, l'ancien chancelier de l'échiquier, Lord Lawson, considérait qu'ils étaient en train de mettre en place une mesure dilatoire pour éviter cette question. Je n'ai pas tout à fait compris comment. Avez-vous quelques précisions sur ce point ?
Merci à Mme Garriaud-Maylam et à Mme Keller des propos qu'elles ont tenus. Je me réjouis toujours de les recevoir à Londres.
La difficulté, pour l'adoption du projet de loi d'organisation du référendum, au mois de décembre, a d'abord été d'élaborer un projet, ce qui n'était pas évident. Au début, la question était : « Souhaitez-vous être dans l'Union européenne ? ». Ils se sont aperçus que c'était dangereux, beaucoup de Britanniques ne sachant pas qu'ils sont membres de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle la question est à présent en deux parties, in et out. Ce sera effectivement plus facile pour les électeurs de se prononcer.
Par ailleurs, des financements ont été accordés aux partisans du in et du out, mais il existe également beaucoup de financements privés. Par exemple, Sainsbury soutiendra les partisans du maintien dans l'Union européenne, alors que les partisans du non bénéficient déjà de l'appui d'un certain nombre de grands financiers.
En ce qui concerne la presse, il existe le meilleur et le pire au Royaume-Uni. Les meilleurs, comme le Financial Times, ou The Economist, sont plutôt pro-européens. Certains journaux n'ont pas encore pris de décision, mais ils sont conservateurs et soutiennent David Cameron. La position de David Cameron sera donc assez déterminante.
La presse dite « de caniveau » est très anti-européenne. Là aussi toutefois, certains soutiennent David Cameron. On dit qu'un ou deux de ces journaux pourraient in fine se rallier à lui. Pour le moment, ce sont des spéculations. On n'en sait rien, mais le rôle de la presse est souvent toxique, car ils sont naturellement anti-européens.
Quelqu'un posait la question de savoir si les Britanniques se rendent compte de l'agacement qu'ils provoquent. Pas vraiment ! La question qu'ils posent souvent aux pro-européens est inverse : « Comment pouvez-vous trouver l'Union européenne parfaite ? Ce que l'on demande n'est-il pas aussi dans votre intérêt ? ». C'est leur perception. Ils n'ont pas le sentiment qu'ils ennuient les autres et qu'ils en demandent trop. Pour eux, l'Union européenne ne fonctionne pas, elle est trop bureaucratique, trop interventionniste. Selon eux, on devrait accorder davantage de poids au principe de subsidiarité, au rôle des parlements nationaux. Ils ne sont pas dans la même logique que nous.
Pour ce qui est des arguments et des moyens de les contrecarrer, il existe bien sûr la voix des politiques, mais également celle des groupes de pression. Beaucoup se sont organisés, comme Business for Europe, et d'autres.
Une de leur dirigeante m'a dit qu'ils allaient également mener campagne en province car, à Londres, 40 % des gens ne sont pas nés au Royaume-Uni. C'est une ville très multiculturelle et plutôt pro-européenne. Ailleurs, c'est évidemment beaucoup plus difficile. Cette dirigeante m'a par exemple expliqué qu'ils allaient essayer de détourner les slogans des partisans du non, en disant « Brexit is for the rich », alors qu'on a l'impression que c'est l'inverse, ou en démontrant que les hedge funds peuvent être n'importe où dans le monde sans que cela change quoi que ce soit pour les moins nantis.
Tout ceci est en train de se préparer et sera plutôt réalisé en dehors de Londres.
Vous avez évoqué la question de la revue de compétences. C'était effectivement un très bel exercice pour savoir si l'Union européenne bénéficiait ou non au Royaume-Uni et si tout était bien respecté. Le résultat a été très positif, mais ce n'est plus aujourd'hui le sujet des experts : il appartient désormais à une opinion publique. C'est là le résultat de ce que Nigel Farage a réussi à faire. À l'époque, l'Europe venait au dixième rang des préoccupations britannique. À cause du lien qu'il a établi entre l'immigration et l'Europe, elle est passée au premier rang des préoccupations.
Le problème vient de l'immigration intérieure à l'Union européenne, non de celle en provenance d'ailleurs, qu'ils sont en mesure de contrôler, mais plutôt de Pologne et d'autres pays. Le Royaume-Uni compte aujourd'hui un million de Polonais. Au moment de l'élargissement, nous n'avons pas voulu du « plombier polonais ». Ils se moquaient alors de nous, affirmant que la libre circulation était une très bonne chose ; à présent, ils jugent que la ville de Rugby compte une majorité de Polonais, et affirment que même les pancartes y sont en polonais. Le ressentiment est donc réel.
Toutefois, certains eurosceptiques et parlementaires réalisent que le problème vient du fait que, sans les ouvriers polonais, on ne pourrait rien faire, les ouvriers britanniques ne voulant pas des emplois en cause. La perception populaire est plutôt que « les Polonais prennent les emplois des Britanniques » et les places de leurs enfants à l'école. Il est très difficile d'expliquer qu'en réalité, l'immigration polonaise ou celle d'Europe de l'Est est dans leur intérêt - ce que savent bien les dirigeants.
S'agissant des prestations sociales, ne pouvant mettre fin à la libre circulation, ils ont essayé de trouver d'autres formules, comme le délai de quatre ans, ou de deux ans renouvelables. Les choses sont en cours de négociation, afin de pouvoir annoncer aux Britanniques que le Gouvernement est en mesure de contrôler cela.
Pour ce qui est du rôle des parlements nationaux, les Britanniques voulaient un carton rouge, un veto absolu. On leur a dit que ce n'était pas possible. Ils ont essayé d'élever le seuil à 55 %, ce qui est déjà assez conséquent. Ceci serait pris en considération par la Commission et par le Conseil.
S'agissant du traité de Lancaster House, la force expéditionnaire conjointe est en effet très importante. Elle sera pleinement opérationnelle au printemps. Il s'agit de mille hommes, ce qui est loin d'être négligeable.
Je pense qu'ils sont aujourd'hui dans une logique de réengagement. Je rappelais que David Cameron disait : « Britain is back ». Des déclarations de réengagement dans les opérations ont été également faites lors de l'assemblée générale des Nations unies. Aujourd'hui, les Britanniques interviennent en Syrie ; ils sont par ailleurs prêts à s'investir davantage dans d'autres opérations des Nations unies.
A la suite du traumatisme irakien, il y a deux ans, il n'y avait pas eu d'accord sur l'intervention en Syrie mais la situation a évolué et ils ont effectivement commencé à se réengager.
Quant aux groupes de pression extérieurs, je ne les connais pas nécessairement et je n'ai pas de contact avec eux. Les Britanniques comprennent-ils l'agacement des Européens ? Non. Ils considèrent qu'on devrait être sur la même ligne qu'eux.
On parle de détricotage. Je crois qu'il y a eu une évolution très forte au cours des dernières années, qui n'est pas uniquement le fait du Royaume-Uni. L'euroscepticisme touche la plupart des pays, les reproches en matière de bureaucratie et d'intrusion sont très forts, même en Allemagne. Je crois qu'il y a eu une renationalisation des politiques.
À l'époque où j'étais à Bruxelles, il y a dix ans, les institutions européennes avaient le vent en poupe, la Commission en particulier. On pensait à une communautarisation de l'Union européenne : c'est l'inverse qui s'est produit, et ce n'est pas à cause des Britanniques. On a maintenant une Europe différenciée, qui ne pourra nécessairement pas aller à la même vitesse sur tous les sujets.
Il faut le reconnaître : ce sont aujourd'hui les Conseils européens qui décident ; à l'époque, ils se réunissaient deux fois par an. En plus de sessions informelles, ils sont maintenant convoqués régulièrement sur tous les sujets - l'immigration, etc. Je crois que ce sera effectivement la ligne.
Les Britanniques sont entrés à un moment - je ne sais pas si c'est par hasard - où l'Union européenne était performante, et où eux-mêmes étaient dans une situation économique difficile. C'était un peu un rêve d'Eldorado. C'est l'inverse aujourd'hui, et c'est pourquoi beaucoup de Britanniques estiment ne pas avoir besoin de l'Union européenne, pensant que le Royaume-Uni sera beaucoup plus prospère sans elle.
On a évoqué la Chine et les États-Unis. Le président Obama est très clair. Il a déjà dit - et il l'a répété hier - que les États-Unis, qui se sentent plus proches des Britanniques que d'autres pays, en particulier des pays du Sud, voulaient une Grande-Bretagne forte et influente au sein de l'Union européenne. La France a un peu évolué, puisque nous sommes partenaires sur les questions de défense, mais il est certain que les États-Unis sont beaucoup plus proches du Royaume-Uni. Le président Obama devrait encore le redire clairement.
Xi Jinping l'a dit également au moment de sa visite au Royaume-Uni, lors de la signature de très nombreux contrats. Il a estimé que, pour la Chine, le Royaume-Uni était la porte d'entrée sur l'Union européenne, et qu'il était important pour eux d'avoir un Royaume-Uni fort dans l'Union européenne.
Encore une fois, ma conviction est qu'on aura besoin de l'Union européenne quand on négociera avec les puissances d'aujourd'hui et de demain, qui seront des États continents. Je n'ai pas de doute quant à moi sur notre intérêt.
Je suis arrivée au Royaume-Uni directement de Chine trois semaines avant le référendum sur l'Écosse, au moment où le territoire risquait d'être amputé d'un tiers. Les Chinois se demandaient comment on pouvait se fragmenter ainsi, alors que la puissance consiste à être ensemble. Cela génère beaucoup d'interrogations.
Les Chinois sont très favorables à l'Union européenne. Pour eux, c'est un contrepoids aux États-Unis. Ils ont toujours soutenu la construction européenne et l'euro. 26 % de leurs réserves sont en euros et, pendant toute la crise grecque, les Chinois disaient publiquement à tous les dirigeants français, allemands ou autres qu'ils croyaient à l'Union européenne et à l'euro. En fait, ils ont acheté de la dette et sont assez clairs sur ce plan. Ils n'hésiteront pas à s'exprimer.
S'agissant de la Norvège, c'est toute la difficulté des partisans du non. À chaque fois qu'ils ont avancé un contre-modèle - la Norvège, la Suisse, le Commonwealth - ils ont été démentis pas les responsables mêmes de ces pays. Certains rêvent en pensant pouvoir s'appuyer sur le Commonwealth, mais les Australiens regardent la Chine, les Canadiens regardent les États-Unis.
Il y a beaucoup d'illusions et de réactions passéistes. Il existe deux sujets différents. D'un côté, les parlementaires et les membres des Tories sont sur la ligne de la grandeur de l'empire britannique, n'ayant pas vu l'évolution du monde, de l'autre la population est plus préoccupée par le risque de perte d'emploi.
Je ne pense donc pas que le Brexit puisse être « une chance pour l'Europe », car je ne crois pas qu'un tête-à-tête avec l'Allemagne, alors que la performance économique française est moins bonne, soit réellement dans notre intérêt. Si l'Allemagne est plus sur nos lignes en théorie, elle ne l'est pas dans la pratique.
J'ai été ambassadeur à Bruxelles il y a dix ans au Comité politique et de sécurité. Si la discussion était très difficile avec les Britanniques quand on a lancé les premières opérations de l'Union européenne, elles ont été faciles en théorie avec l'Allemagne, mais la participation a été britannique. Il y a donc la position de principe et la réalité. Selon mon expérience, les Britanniques ont des positions de départ qui semblent éloignées parfois mais, in fine, nous aident.
Évidemment, il est hors de question de parler de la défense européenne avant le résultat du référendum, car c'est une phobie totale, alors qu'à l'époque ils prétextaient un risque de découplage avec l'OTAN ou avec les Américains, qui avaient très peur de la défense européenne.
Aujourd'hui, ils plaident pour celle-ci, parce qu'ils ne veulent pas faire ce travail à notre place, et ont fait des campagnes de promotion pour les opérations au Tchad ou en Méditerranée. Ils ont donc évolué et sont les seuls à rester sur cette ligne.
En matière de sécurité, les Britanniques ont beaucoup évolué. Ils étaient très attachés au respect total des libertés publiques. Ils ont pris conscience des dangers qui les menacent et savent que la France n'est pas seule dans ce cas. David Cameron, quand il a vu le Président de la République, a dit que c'était comme si cela était arrivé aux Britanniques, et que cela pouvait d'ailleurs leur arriver. Ils ont mis en place un dispositif équivalent à celui de Sentinelle.
Ils sont en train de revoir leur dispositif de sécurité à la suite des attentats du 13 novembre. Il y a maintenant des policiers armés dans les rues de Londres, ce qui n'était pas concevable auparavant. Ils sont favorables à la surveillance et vont également adopter une loi pour la renforcer, ainsi que celle des réseaux sociaux, mais cela a été très compliqué parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler WhatsApp et les applications de ce genre. Pour ce qui est de la question de l'Écosse, celle-ci pourrait demander un nouveau référendum, mais ne le redemandera qu'à condition que l'Écosse vote oui et que le reste du Royaume-Uni vote non. Si eux-mêmes votent non pour des raisons tactiques, cela ne fonctionnera pas. Je pense que la situation actuelle de l'Écosse, avec la baisse des prix du pétrole, peut aussi faire réfléchir. C'est un levier des partisans du oui.
Un mot sur le Brexit. Je parlerais ensuite de Calais.
Lors d'un récent colloque franco-britannique, quelqu'un, plutôt que de parler de Brexit, qui suppose que l'on va sortir, a choisi d'évoquer le « Bremain », - contraction des mots « Britain » et « remain ». C'est certes moins populaire et on a tendance à parler de Brexit mais, personnellement, je parle toujours du référendum sur l'Europe et non du Brexit. C'est une nuance, mais qui compte car le but n'est pas de sortir de l'Europe.
Quant à la question de Calais, il s'agit d'un sujet qui est également très difficile au Royaume-Uni. J'ai été, fin juillet-début août, fortement sollicitée par la presse britannique, qui montrait les photos non seulement des réfugiés qui prenaient le tunnel ou les camions attaqués, mais aussi des pneus brûlés, en disant que la police ne faisait pas son travail. J'ai dû à chaque fois répondre et rectifier les choses, en essayant de leur expliquer que, de l'autre côté de la frontière, la perception était totalement différente et que beaucoup d'autorités régionales et locales se demandaient pourquoi elles feraient le travail de police pour les Britanniques. Ce sont là les résultats des accords du Touquet.
J'ai également relativisé les choses en rappelant qu'à Calais, il s'agissait de 4 000 personnes, mais qu'un million était entré en même temps dans l'Union européenne. J'ai dit tout ce que la France faisait sur le plan financier, j'ai évoqué le centre d'accueil des migrants, mais c'était très difficile. Eux nous parlaient des camionneurs, des grèves.
Il y a une incompréhension très forte. Elle demeure. Nos ministres de l'intérieur s'entendent très bien. Ils ont pris des mesures de sécurité communes, en renforçant énormément la sécurité, à l'entrée du tunnel en particulier. Il n'y a plus de passage par le tunnel, mais les migrants se déportent évidemment vers le port ou vers d'autres ports.
On insiste pour que les Britanniques financent également les mesures de sécurité - ce qu'ils ont fait - ainsi que les mesures de protection des migrants, et qu'ils prennent en particulier des migrants qui ont des familles au Royaume-Uni. Ce sont souvent des Soudanais, des Érythréens et, quoi qu'on fasse, même si on leur propose l'asile, ils ne veulent pas rester chez nous, préférant aller au Royaume-Uni, où il y a plus d'emplois et où ils ont soit de la famille, soit des communautés très importantes.
David Cameron, dans le contexte du référendum, a décidé d'accueillir quelques réfugiés dans les camps du Liban ou de Jordanie, pour éviter ce qu'il appelle « l'appel d'air » et inciter les gens à ne pas venir jusqu'à Calais. Mais un jugement d'un tribunal britannique concernant les enfants qui ont de la famille au Royaume-Uni fait qu'ils vont être obligés d'en accueillir un certain nombre. Même s'ils vont faire appel, l'immigration est actuellement la question la plus sensible.
Il existe un sujet international, qui est celui de l'euro et de la place de la City, mais le sujet qui sera déterminant pour le référendum réside dans l'immigration et dans la manière dont seront perçues ces questions migratoires.
Je ne sais si j'ai répondu à toutes les questions, mais j'ai essayé d'être exhaustive.

Vous considérez donc qu'il existe des avancées pratiques significatives dans les positions britanniques auxquelles nous devons être attentifs. Les choses ne vont-elles pas en sens inverse avec les États-Unis ? Au fond, les États-Unis nous envoient des messages positifs mais certaines décisions récentes nous interrogent. Ainsi, pour l'Iran, au-delà de la normalisation affichée, nous avons appris qu'il faudrait dorénavant un visa spécial pour les patrons de PME ou les parlementaires français ou européens qui seront allés en Iran et qui voudront ensuite se rendre aux États-Unis. D'une certaine manière, les États-Unis rendent l'Iran respectable, mais gardent ce pays pour eux...

Je vais dans le sens du président Raffarin. J'ajoute que nos amis américains nous ont incités à nous engager davantage dans les sanctions vis-à-vis de la Russie. Or, c'est précisément le secteur agroalimentaire européen qui est fragilisé.
C'est la même chose pour la définition de la Chine en tant qu'économie de marché, sur laquelle ils se gardent bien de se déterminer. J'ai eu l'occasion de rencontrer l'ambassadeur américain auprès de l'OMC, M. Punk, hier midi. J'aimerais qu'on ait une réponse cohérente ! Seule l'Union européenne est appelée à se prononcer avant le 31 décembre 2016. On sait combien les mesures de rétorsion de la Chine sont brutales et rapides. Je n'ose pas dire que nos amis américains nous tendent un piège, mais enfin, ils nous poussent au front !

Sur ce point, il faut faire la différence, s'agissant des visas pour l'Iran, entre la position du Congrès et celle du département d'État, en désaccord sur ce sujet, dans le contexte de la préparation de l'élection présidentielle...
En même temps, le président américain est comme Gulliver empêtré. Cela a déjà été dit il y a quelque temps par un grand spécialiste, mais cela reste vrai. Le poids du Congrès dans la définition de la politique américaine est toujours déterminant.
Je crois que les relations des Américains avec les Français se sont considérablement améliorées, grâce à nos capacités d'intervention militaire et à notre détermination. Cela dit, ils se sentent effectivement plus en phase avec les Britanniques.
Encore une fois ma conviction est que notre intérêt réside dans le poids de l'Union européenne face aux États-Unis et à la Chine. Nous avons une capacité de négocier, ainsi qu'une capacité normative de fixer un certain nombre de règles, et je crois qu'on ne devrait pas se priver de cette influence.

Mes chers collègues, je vous propose que nous exprimions collectivement nos remerciements à Bermann pour cette heure et demie très intéressante et très fertile que nous avons passée ensemble. Nous souhaitons que nos collègues Fabienne Keller et Joëlle Garriaud-Maylam abordent tous ces points dans le débat qui aura lieu en préalable au Conseil européen, à l'initiative de la commission des affaires européennes présidée par Jean Bizet, à qui je cède la parole.

Je voudrais simplement donner la tonalité du rapport de Fabienne Keller, en soulignant qu'à l'occasion de ce référendum britannique, sur lequel nous n'avons bien évidemment pas de prise, les questions posées par nos amis d'outre-Manche sont l'occasion d'améliorer le fonctionnement de l'Union européenne. Madame l'ambassadeur, vous avez parlé d'une Europe différenciée : si nous ne jouons pas cette carte de la coopération renforcée, on n'aura qu'une Europe uniforme, paralysée et paralysante.
Enfin, vous avez mis l'accent sur la dimension européenne dans les négociations commerciales internationales. C'est fondamental. Le prochain traité, qui nous occupe dès à présent, est le traité de libre-échange transatlantique (TTIP) : si nous n'avions pas cette dimension, ce serait dramatique pour les différents États membres.

Si j'ai bien compris, la commission des affaires étrangères devrait examiner la proposition de résolution la semaine prochaine. Son objectif est de rappeler les principes de l'Union européenne, mais aussi les éléments de souplesse auxquels on peut adhérer, comme le fait de pouvoir renforcer les parlements nationaux. Cette PPRE ne comporte pas beaucoup de détails techniques, car il faut laisser une marge de négociations aux sherpas en charge de la discussion jusqu'au Conseil européen.