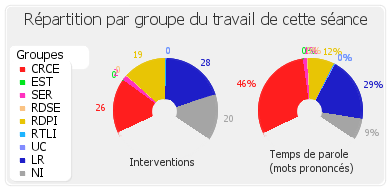Séance en hémicycle du 28 octobre 2013 à 21h30
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures trente.

La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Nous en sommes parvenus à la discussion des articles.
I. – L’article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations. Le système de retraite par répartition assure aux retraités le versement de pensions en rapport avec les revenus qu’ils ont tirés de leur activité.
« Les assurés bénéficient d’un traitement équitable au regard de la durée de la retraite comme du montant de leur pension, quels que soient leur sexe, leurs activités et parcours professionnels passés, leur espérance de vie en bonne santé, les régimes dont ils relèvent et la génération à laquelle ils appartiennent.
« La Nation assigne également au système de retraite par répartition un objectif de solidarité entre les générations et au sein de chaque génération, notamment par l’égalité entre les femmes et les hommes, par la prise en compte des périodes éventuelles de privation involontaire d’emploi, totale ou partielle, et par la garantie d’un niveau de vie satisfaisant pour tous les retraités.
« La pérennité financière du système de retraite par répartition est assurée par des contributions réparties équitablement entre les générations et, au sein de chaque génération, entre les différents niveaux de revenus et entre les revenus tirés du travail et du capital. Elle suppose de rechercher le plein emploi. »
II. – L’article L. 161-17 A du même code est abrogé.
III §(nouveau) . – Au quatrième alinéa de l’article L. 1431-1 du code de la santé publique, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au I de ».

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’article 1er complète l’article L. 111–2–1 du code de la sécurité sociale, pour y faire figurer l’exposé des principes fondateurs de notre système de retraites : répartition et solidarité entre générations.
Ces principes fondateurs étaient préalablement définis au début du chapitre de ce code consacré à l’assurance vieillesse.
Or la rédaction du texte adopté par l’Assemblée nationale pour ces objectifs du système de retraites pose problème.
Dans la rédaction issue des travaux de la commission des affaires sociales de l’Assemblée, quatre objectifs avaient été assignés par la Nation au système de retraites : la solidarité entre les générations et au sein de chaque génération, la garantie d’un niveau de vie satisfaisant, la pérennité financière et – c’est l’objet de mon intervention – l’égalité des pensions entre les femmes et les hommes.
S’agissant de cet objectif précis, le texte adopté par l’Assemblée nationale en séance plénière est nettement réducteur puisqu’il ne se réfère plus à l’égalité des pensions entre les femmes et les hommes comme un objectif en soi du système de retraites.
Or, si tout le monde convient qu’il est urgent de parvenir à une nouvelle avancée pour l’égalité des droits entre les femmes et les hommes, il faut aussi s’emparer de la question des pensions, pour le droit à une retraite digne et décente.
En effet, les écarts de pension entre les femmes et les hommes demeurent persistants et inacceptables, comme l’a rappelé tout à l’heure Laurence Rossignol, rapporteur de la délégation aux droits des femmes.
Nous savons qu’ils proviennent d’une insuffisance pour les femmes de droits propres, liée aux inégalités salariales, à la prégnance des stéréotypes de genre dans l’accès à l’emploi, aux carrières hachées, au temps partiel subi, etc.
Cette situation impacte lourdement et négativement non seulement le niveau des pensions, mais aussi l’âge de départ en retraite : il est plus tardif chez les femmes, avec une décote plus fréquente et davantage de titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Pourtant, la réduction des inégalités entre hommes et femmes en matière de retraite constitue un aspect central, nous dit-on, de ce projet de loi.
De surcroît, dans le texte dont nous débattons, l’égalité entre hommes et femmes n’est plus que l’un des aspects qui permettent au système de retraites de remplir son objectif de solidarité entre les générations. À cet égard, l’usage de l’adverbe « notamment » est très significatif.
C’est pourquoi, avec mon groupe, je soutiendrai des amendements de réécriture de cet article et de propositions, tout particulièrement celle qui vise à faire en sorte qu’aucune pension ne soit inférieure au SMIC.

Incontestablement, nos régimes de retraite, assis sur la solidarité entre les générations et le principe de répartition, connaissent des difficultés financières. Toutefois, ces dernières sont bien moins insurmontables que ne tendent à le faire croire ce projet de loi et les propositions injustes qu’il contient.
Comme l’ensemble de notre système de protection sociale, notre système de retraites connaît une crise financière persistante qui, tout en affaiblissant sa portée et son avenir, tend à semer le doute dans les esprits de nos concitoyens quant à sa pertinence et sa pérennité. En effet, nombreuses et nombreux sont ceux qui pensent que, demain, il leur faudra se constituer personnellement une retraite, c’est-à-dire épargner pour se constituer une retraite privée.
Cette inquiétude légitime, il nous faut la combattre. L’article 1er de ce projet de loi est, à cet égard, de nature à générer l’espoir. Il réaffirme l’attachement de la Nation à un mécanisme de retraites qui continuerait à unir les générations entre elles. Il fait explicitement référence à un régime de retraite par répartition et se fixe pour objectif de garantir aux retraités un niveau de vie satisfaisant. Nous serions tout prêts à souscrire à ces déclarations de principe pour autant qu’elles ne soient pas vides de tout contenu et qu’elles ne constituent pas des vœux pieux.
Comment prétendre en effet vouloir garantir notre système de retraites par répartition sans répondre au mal premier, fondamental, dont souffre notre système de retraites, à savoir son insuffisance de financement ?
Ce dont souffre la sécurité sociale, ce n’est pas d’un excès de dépenses, mais d’une insuffisance chronique de recettes, organisée par des politiques successives et continues d’exonérations de cotisations sociales, lesquelles n’ont jamais eu d’autres effets que l’accroissement des bas salaires, de la précarité et des déficits publics et sociaux.
Force est de constater que, en la matière, contrairement à ce que nous aurions pu attendre, votre gouvernement a fait sienne la logique de la réduction du coût du travail portée par la droite et les libéraux.
Comment prétendre vouloir garantir un haut niveau de retraites quand vous avez non seulement renoncé à interdire les licenciements boursiers mais que vous avez, pire encore, à la demande du MEDEF, contribué à faciliter le licenciement des salariés pour motif économique ? Je renvoie à notre divergence fondamentale sur l’accord national interprofessionnel, l’ANI.
Comment croire que ces salariés, sacrifiés sur l’autel de la finance, pourront, de périodes de chômage indemnisé en période de chômage non rémunéré, de stages en formations, atteindre à soixante-deux ans le nombre d’annuités nécessaires pour bénéficier d’une retraite à taux plein ?
Comment faire croire que, pour l’avenir, notre système de protection sociale doit reposer sur un financement mettant le capital à contribution quand, tout de suite après avoir annoncé une hausse très modérée de la part patronale de cotisations sociales, vous annoncez une exonération de cotisations sociales sur la branche famille, afin que la hausse décidée soit au final indolore – pour le patronat en tout cas, car l’article 2 de ce projet de loi, qui prévoit l’allongement de la durée de cotisations, impactera fortement le monde du travail ?
Pour toutes ces raisons, le groupe CRC ne votera pas en faveur de cet article et s’abstiendra.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à l’image de mon collègue, je m’abstiendrai sur cet article, non que les principes avancés dans celui-ci ne me séduisent pas, mais parce que je mesure précisément combien ces principes, rapportés à ce projet de loi, sont au mieux un cap infranchissable, au pire une succession de promesses intenables.
En réalité, en faisant le choix de faire porter l’essentiel du financement de cette réforme des retraites sur les salariés et en allongeant la durée de cotisation, vous poursuivez la logique débutée en 1993 sous M. Balladur, continuée en 2003 par M. Fillon et poursuivie en 2010 par M. Woerth.
L’allongement de la durée de cotisation prévue à l’article 2 rapportera, selon l’étude d’impact associée à ce projet de loi, 5, 4 milliards d’euros, une somme importante à laquelle il conviendra également d’ajouter les millions d’euros d’économies qui résulteront des décotes imposées à celles et ceux qui, usés par une vie de travail faite de précarité, de périodes de chômage et de conditions de travail abîmant le corps et réduisant l’espérance de vie en bonne santé, n’auront d’autre choix que de faire valoir leurs droits à la retraite, y compris s’ils ne sont pas parvenus à cumuler tous les trimestres leur permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein.
Mais c’est également sans compter sur les effets désastreux de cette mesure sur d’autres branches de notre système de protection sociale – je pense par exemple aux dépenses liées à l’indemnisation accordée aux salariés privés d’emplois. Dans la mesure où les employeurs continuent à exclure les salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans du marché du travail, l’adoption de l’article 2 aura mécaniquement pour effet d’accroître les périodes de chômage, et donc une partie des dépenses publiques. Mais je pense également à la branche famille, déjà déficitaire et victime d’une tuyauterie complexe qui l’appauvrit et qui ne poursuit qu’un objectif : satisfaire chaque année un peu plus que la précédente l’exigence du MEDEF de soustraire les entreprises au financement de cette branche.
Au final, avec ces effets secondaires sur l’indemnisation du chômage comme sur la branche famille, le Gouvernement creuse un trou pour en boucher d’autres, plutôt que de sauver notre système de retraites. Celui-ci connaît effectivement une situation de déficit, mais ce dernier est tout relatif. En 2020, le déficit de la branche vieillesse atteindra à peine 1 % de notre produit intérieur, c’est-à-dire, pour parler en chiffres et non en pourcentage, 20 milliards d’euros, exactement la somme que le Gouvernement vient d’offrir sur un plateau au patronat au nom du plan compétitivité.
Il y a bien, d’un côté, une ponction de 5, 4 milliards d’euros à la charge des salariés, sur la seule base de l’application de l’article 2 et, de l’autre, un cadeau fiscal de 20 milliards d’euros accordé au patronat. Et ce, alors même que l’article 1er, que vous nous invitez à adopter, prétend vouloir faire financer une partie de nos retraites sur ce même capital que vous épargnez !
Parce que vos actes en la matière sont à l’opposé de vos discours, je ne voterai pas en faveur de cet article.

La sénatrice que je suis ne peut naturellement rester insensible à la déclaration de principe figurant dans cet article 1er, qui confère à notre système de retraites, selon les mots mêmes de son alinéa 6, « un objectif de solidarité entre les générations et au sein de chaque génération, d’égalité des pensions entre les femmes et les hommes ».
Pourtant, madame la ministre, je dois dire qu’il y a pour le moins une confusion.
Dans la mesure où ce même article prévoit que les pensions perçues sont en rapport avec les revenus du travail, comment voulez-vous que notre régime de retraite puisse garantir une égalité de pensions entre celles versées aux femmes et celles versées aux hommes ?
C’est bien parce que les salaires des femmes sont inférieurs d’un quart en moyenne à ceux qui sont perçus par les hommes que leurs retraites le sont aussi de 42 %.
C’est bien parce que les femmes sont plus exposées que les hommes aux temps partiels, particulièrement aux temps partiels subis, que les carrières des femmes sont plus incomplètes que celles des hommes, et qu’elles subissent mécaniquement – hélas ! – des décotes plus fortes que les hommes.
Or salaire et durée de carrière sont les deux composantes principales du calcul de la pension de retraite.
C’est pourquoi, quand bien même je voudrais croire en cet alinéa 6, je vois mal comment, sans mécanisme de redressement permettant de compenser une précarité plus grande au travail et une sous-rémunération constante, les femmes de notre pays pourraient, demain, prétendre bénéficier d’un niveau de pension égal à celui des hommes.
Certes, il y a bien l’article 13, relatif aux droits familiaux, qui, bien que largement insuffisant, est positif, comme je l’ai souligné dans mon intervention en discussion générale.
Mais son effet demeure limité au point que, comme le précise Christiane Marty, membre du conseil scientifique d’ATTAC et animatrice de sa commission « Genre et mondialisation », les écarts de pensions seraient au mieux, dans les meilleurs des cas, ramenés à 28 % entre les pensions des femmes et des hommes. Or, 28 % d’écart, vous en conviendrez, madame la ministre, ce n’est pas, loin s’en faut, l’égalité de traitement que vous appelez de vos vœux au travers de cet article 1er.
C’est pourquoi, à mon tour, je précise que je ne voterai pas en faveur de cet article 1er, considérant que les actes sont plus importants que les déclarations et que vos actes, particulièrement l’article 2, relatif à l’allongement de la durée de cotisation, et l’article 4, qui repousse de six mois la revalorisation des retraites, affecteront les plus modestes et les plus fragiles économiquement, dont les femmes. Ces dispositions viennent donc en contradiction avec les principes énoncés dans cet article 1er.

L'amendement n° 25, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
retraite
insérer le mot :
solidaire
La parole est à M. Dominique Watrin.

Les mots ont un sens et il importe de bien choisir, notamment quand il s’agit d’établir la loi.
La reconnaissance d’un droit au travail, à un vrai salaire, est indissociable du droit à la retraite et du choix du système par répartition et de solidarité entre les générations que nous défendons.
« Je n’ai jamais séparé la République des idées de justice sociale dans la vie privée, sans lesquelles elle n’est qu’un mot », a dit Jean Jaurès. Avec cet amendement, nous souhaitons ainsi remettre véritablement le mécanisme de répartition au cœur de notre système de retraites afin qu’il continue d’être juste et solidaire.
Nous ne désirons pas individualiser la retraite en fonction des revenus, ni maintenir les conditions de l’inégalité entre les retraités. Pour nous, en effet, quels que soient sa condition sociale et le déroulement de sa carrière, chacun doit pouvoir disposer d’un revenu qui lui permette de vivre décemment la dernière période de sa vie.
Pour apporter cette garantie, la solidarité et la répartition sont nécessaires dans les faits. Pourtant, entre recul de l’âge de départ à la retraite et accroissement du nombre d’annuités, c’est une autre voie qui est ici confortée. En effet, madame la ministre, la vérité est que le présent texte ne fait que renforcer la réforme Balladur de 1993, celle de M. Fillon en 2003 et, la plus récente, celle de 2010.
L’augmentation de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite à taux plein, les modalités de détermination du salaire moyen, les conditions de revalorisation des pensions, tout concourt à raboter progressivement le niveau des prestations versées en contrepartie des cotisations prélevées auprès des actifs.
La réforme Balladur de 1993 a, déjà, occasionné un sensible décrochage de la progression des dépenses d’assurance vieillesse : depuis vingt ans, les retraités ont en effet subi de plein fouet un décrochage sensible de leurs pensions au regard de ce qu’elles auraient pu être sans cette prétendue réforme.
Pour l’heure, hélas, la présente réforme ne semble conduire qu’à une nouvelle décote des pensions à moyen et long termes. Nous devons, tout au contraire, affirmer nos valeurs de solidarité, ne serait-ce que pour que le reste de ce texte soit à la hauteur des attentes de nos concitoyens dans ce domaine.
Tel est le sens de cet amendement.

Cet amendement vise à préciser que la retraite par répartition revêt un caractère « solidaire ».
Cette précision ne paraît pas utile, car le principe même de la retraite par répartition repose sur la solidarité entre les générations et sur un principe contributif, ainsi que le précise déjà l’alinéa 6 de l’article 1er. La commission a donc émis un avis défavorable.

Nous avons tenu, à travers cet amendement, à réaffirmer notre attachement au principe de solidarité qui fonde notre système de retraites.
En ce sens, toute réforme doit préserver les valeurs essentielles de justice sociale en maintenant la solidarité. Ce faisant, elle répond à l’exigence de maintien de la cohésion de la société. Remettre en cause ce principe même de solidarité, c’est incontestablement faire reculer significativement notre civilisation.
Il ne faudrait pas oublier que ce principe de solidarité, qui est à la base de notre système de protection sociale, s’est développé au cœur même de la Résistance. De même, n’oublions pas que toutes les avancées sociales de l’après-Seconde Guerre mondiale furent aussi une réponse au libéralisme sauvage des années vingt et à la déflation des années trente.
C’est donc dans une période particulièrement troublée qu’un système de protection sociale aussi novateur a été progressivement élaboré et a pu émerger après la guerre.
Malgré une situation particulièrement difficile, alors qu’il fallait reconstruire et consacrer de grands efforts au redressement économique de notre pays, nous avons su mobiliser les mesures nécessaires à la mise en place d’un régime d’assurance vieillesse permettant à tout un chacun, indépendamment de ses origines sociales et de sa trajectoire de vie, de bénéficier d’une sécurité pour ses vieux jours.
C’est donc avec perplexité que je constate que, sous la pression d’un vieillissement démographique relatif, on développe des discours alarmistes tendant à faire croire que notre système actuel de retraites est condamné ou que sa préservation passe par une réduction permanente et continue du niveau des pensions versées.
Je suis inquiète de voir prospérer de telles idées. À l’issue de la Seconde Guerre mondiale, en réponse à la grande crise des années trente, nous avons cherché à réguler nos économies en réduisant le poids des mécanismes de marché, qui avaient montré toute leur inefficacité sur les plans économique et social.
J’ai l’intime conviction qu’aujourd’hui nous faisons un grand pas en arrière en abandonnant progressivement la régulation de notre économie aux seules forces du marché, car c’est bien ce renoncement qui est à l’œuvre quand on examine, au-delà du présent projet de loi, une bonne partie des choix politiques qui sont actuellement opérés.
Mes chers collègues, nous ne croyons pas plus en les vertus méconnues des fonds de pension, des plans d’épargne entreprise ou des plans d’épargne pour la retraite collectifs, les PERCO, qu’en de multiples décisions fiscales et financières censées, en préservant notre compétitivité, sauver notre protection sociale.
Les secousses financières depuis 2008 ont montré que le capitalisme actionnarial n’est nullement capable d’assurer la régulation dont nous avons besoin. La domination des marchés financiers, toujours présente, est une machine à produire des inégalités, à affaiblir notre croissance et à créer du chômage.
On l’aura bien compris, à terme et au-delà du présent texte, c’est l’ensemble de notre système de protection sociale qui sera atteint dans ses fondements mêmes. Or, et je tiens à attirer l’attention sur ce point, croire que le marché et l’individualisme peuvent constituer des facteurs de régulation de nos sociétés, c’est commettre une grave erreur d’appréciation et d’analyse économique.

Avec ces amendements et les arguments avancés pour les défendre, vous posez les termes du débat entre nous.
Comme vous l’avez rappelé, le système de retraites en vigueur durant l’entre-deux-guerres, et cela d’ailleurs depuis l’instauration du régime des retraites ouvrières et paysannes de 1910, était fondé sur la capitalisation.

C’est un fait, monsieur Watrin, et il en allait de même des assurances sociales de 1930. C’est aussi un fait que la crise des années trente a ruiné un certain nombre d’épargnants et de retraités qui n’ont jamais pu toucher leurs pensions.
Il a effectivement été à l’honneur de la Libération et du Conseil national de la Résistance de mettre en place un régime de retraite par répartition. Mais c’était il y a soixante ans !

M. Jean-Pierre Caffet. Il est tout à fait logique qu’un système par répartition, à ses débuts, puisse être extraordinairement généreux, tout simplement parce que le nombre des cotisants est très supérieur à celui des retraités. Mais, au fur et à mesure que le temps passe, du fait des évolutions démographiques de nos pays, le rapport entre le nombre de cotisants et le nombre de retraités se dégrade progressivement
M. Jean-François Husson s’exclame.

Voilà le problème auquel nous sommes confrontés. Il faut donc bien tenir compte de l’évolution de ce rapport démographique, qui conditionne l’évolution de nos systèmes de retraites par répartition.
J’ajouterai un autre élément. S’il n’y avait pas eu les précédentes réformes des retraites, celle de 1993, celle de 2003 et celle de 2010, cette dernière ne pesant d’ailleurs que faiblement dans l’évolution de l’équilibre des régimes de retraite – je vous renvoie à la page 27 du rapport de Yannick Moreau –, à l’heure actuelle, en 2013-2014, les régimes de retraite verseraient trois points de PIB de plus en prestations.

Trois points de PIB de plus en prestations ! Cela représente quelque 60 milliards d’euros. Imaginons la situation des régimes de retraite en 2013, où ils verseraient 60 milliards d’euros de prestations supplémentaires, sans recettes nouvelles !
Car il y a deux possibilités. Premièrement, dans l’hypothèse où cette évolution aurait été compensée par des recettes supplémentaires, les prélèvements obligatoires seraient supérieurs à leur niveau actuel de trois points de PIB, indépendamment de la manière dont entreprises et ménages se répartiraient l’effort. À supposer, par exemple, que l’effort ait été supporté pour l’essentiel par les ménages par le biais des cotisations salariales, les actifs paieraient aujourd’hui 60 milliards d’euros de plus de cotisations, et les retraités recevraient 60 milliards de plus en prestations.
En revanche, dans l’hypothèse où les recettes n’auraient pas suivi cette évolution, nous ferions face aujourd’hui à un déficit de l’ensemble des régimes de retraite accru de 60 milliards d’euros. Comment ferait-on ? Faudrait-il augmenter de 60 milliards d’euros les prélèvements obligatoires en 2013-2014 ? Il faut donc bien voir la réalité du phénomène.
Du reste, comment peut-on soutenir que la situation des retraités ne s’est pas améliorée depuis la Libération, date de création des régimes par répartition ? Il suffit là encore de lire le rapport Moreau. Force est de constater que, depuis les années cinquante, le niveau de vie des retraités a progressivement rejoint celui des actifs.

Je vais citer des chiffres – je ne parle que de moyennes, parce que ce sont les seuls chiffres dont je dispose, et je reconnais volontiers l’existence de grandes disparités en matière de retraites, qui peuvent être très modestes, comme le minimum vieillesse, ou bien relativement confortables. En 2006, sans tenir compte du patrimoine, le niveau de vie moyen d’un actif s’élevait à 18 700 euros et celui d’un retraité à 15 800 euros.

Si maintenant on tient compte du patrimoine, et chacun reconnaîtra que le patrimoine accumulé par un retraité est plus important que celui d’un actif, pour la même année 2006, le revenu moyen s’établissait à 21 600 euros pour un actif et à 21 200 euros pour un retraité.

Plus près de nous encore, en 2010, et toujours en moyenne, les actifs disposent d’un revenu mensuel de 2 000 euros et les retraités de 1 900 euros. Je vous renvoie encore une fois au rapport Moreau, page 37.
Voilà où nous en sommes ! Dire que les réformes qui ont été menées ces dernières années et qui, d’une certaine manière, je l’assume, sont poursuivies par la réforme actuelle…
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 26, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Pasquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première et seconde phrases
Après le mot :
répartition
insérer les mots :
à prestations définies
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Alors que cet article 1er réaffirme l’attachement de la Nation à un système de retraite par répartition, l’ensemble des articles qui suivent, et singulièrement l’article 3, conduisent à mettre en œuvre un changement majeur, à peine dissimulé : celui du basculement d’un système à prestations définies vers un système à cotisations définies.
Or les régimes à cotisations définies ne garantissent pas aux salariés un niveau de pensions une fois atteint l’âge de la retraite. Le montant de la pension constitue la première variable d’ajustement qui permet aux responsables publics de les augmenter ou, plus souvent, de les réduire, en général dans le but de diminuer les dépenses publiques.
L’équation est alors claire : quand les retraités deviennent nombreux, vivent plus longtemps et que le montant des retraites représente une part trop grande de la dépense sociale et publique, la réduction de cette dernière passe par une réduction des pensions.
À rebours de cette logique financière, notre système de protection sociale et le régime de base obligatoire de la sécurité sociale se sont constitués sur l’idée qu’il fallait impérativement que les salariés, en débutant leur carrière professionnelle, aient la garantie de pouvoir disposer d’une retraite minimum.
Or l’article 3 du présent projet de loi autorise explicitement le comité de suivi à proposer la réduction des pensions ; il est, d’ailleurs, précisé que celle-ci doit être limitée. Alors que nos concitoyens sont de plus en plus nombreux à s’inquiéter d’être privés du droit à bénéficier, comme nous demain et comme nos anciens hier, d’une retraite collective et solidaire, le signal envoyé par cet article 3 est anxiogène.
Qui plus est, si en vertu de cet article 3 les pensions peuvent être réduites, l’augmentation des cotisations sociales notamment celles qui sont supportées par les employeurs, apparaît comme une solution marginale. De toute évidence, ce n’est pas la solution que votre gouvernement privilégie puisque la faible hausse de cotisations patronales est aujourd’hui immédiatement compensée par une baisse significative du financement de la branche famille.
Madame la ministre, lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, vous avez, sans réelle explication, donné un avis défavorable à cette proposition d’amendement. Si le député Michel Issindou a, quant à lui, répondu à nos collègues du groupe GDR, sa réponse nous inquiète plus qu’elle ne nous rassure. En effet, selon lui, l’article 3 constitue « un principe de tunnel, qui ne fait pas de notre système un système à cotisations définies, puisque les recommandations du comité de suivi ne s’imposent pas au Gouvernement ni au Parlement ». Pour autant, il n’a pas exclu que les propositions du comité puissent aller dans ce sens, et pour cause !
Tout converge vers un possible basculement du système. Pour reprendre l’expression de notre collègue député, le bout du « tunnel » nous inquiète. C’est la raison pour laquelle il nous semble souhaitable que l’article 1er définisse le type de système de retraites par répartition que nous voulons pour notre pays, à savoir un régime à prestations définies.

Cet amendement vise à préciser dans l’article 1er que le système de retraites par répartition est bien un système à prestations définies. Cependant, les paramètres de calcul des pensions de retraite ne constituent pas un objectif du système de retraite, mais un moyen au service de cet objectif. Ils n’ont donc pas leur place dans l’article 1er.
Par ailleurs, le mécanisme de pilotage prévu à l’article 3, que vous avez évoqué, chère collègue, garantit le principe des prestations définies puisque les recommandations du comité de suivi sont strictement encadrées. Elles doivent notamment respecter un taux de remplacement plancher.
Aussi, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
L’avis est défavorable, pour les mêmes raisons.
Il n’est absolument pas question, dans le cadre de cette réforme, d’engager l’évolution de notre système vers un système à cotisations définies – au lieu d’un système à prestations définies. Cette inquiétude n’a pas lieu d’être.
Comme cela vient d’être indiqué par Mme la rapporteur, l’article 3 vise simplement à encadrer les limites dans lesquelles des ajustements pourront intervenir.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.

Je voudrais à nouveau expliquer la nature de nos inquiétudes.
Si nous sommes opposés aux mécanismes de retraites à prestations définies, c’est parce que nous en connaissons les effets, notamment sur le montant des pensions.
L’exemple Suédois est à ce titre éclairant et devrait logiquement nous prémunir de la tentation de passer d’un modèle à prestations définies à un modèle à cotisations définies. En effet, dans un tel système, les cotisations sont définies au début de la carrière professionnelle et sont censées ne pas évoluer durant celle-ci. En conséquence, l’équilibre des caisses de retraites, qu’elles soient publiques ou privées, s’opère mécaniquement par la seule variable d’ajustement possible : le montant de la pension. Cet ajustement se fait soit en augmentant la durée de cotisation et l’âge de départ à la retraite – ce qui provoque des décotes –, soit en agissant sur la valeur des points. L’évolution de ceux-ci dépendant de la croissance, un ralentissement économique ou une crise – comme celle que nous connaissons depuis quelques années – entraîne une importante baisse du taux de conversion, donc une baisse notable des pensions.
Là encore, l’exemple suédois est intéressant. La crise qui a débuté avec l’affaire dite des « subprimes » a conduit à une crise économique mondiale qui s’est traduite par un fort ralentissement de la consommation privée et une contraction massive de la dépense publique. La croissance étant en berne, les retraites ont baissé de 3 % en 2010, cette baisse ayant atteint 7 % en 2011. Sur cinq ans, les retraites des Suédois ont ainsi connu une baisse cumulée de près de 40 %.
Voilà le scénario que nous souhaitons éviter à nos concitoyens, et que nous voulions rappeler ici.
En outre, les régimes de retraite à cotisations définies entraînent une conséquence trop souvent éludée : ils interdisent le débat sur le partage des richesses, auquel nous sommes attachés. En effet, dès lors que les cotisations sont figées, la part de richesses prélevée pour financer les retraites est appelée à ne plus évoluer. Au contraire, la part de richesses créées destinée à la spéculation et à la rémunération des actionnaires profite de l’amélioration de la productivité et des nouvelles technologies qui réduisent les coûts et participent à l’augmentation des marges bénéficiaires.
Cette situation ne peut nous satisfaire dans la mesure où, pour notre part, nous considérons que les actionnaires ne sont pas les seuls propriétaires des richesses créées par le travail. Ainsi, la question de sa répartition constitue un enjeu démocratique et de société et une issue pour la pérennité que nous souhaitons tous.
Enfin et pour conclure sur cette question, je ne partage pas l’analyse selon laquelle cette disposition n’aurait pas sa place dans le présent article, au motif que la question de notre modèle de retraite – à prestations ou à cotisations définies – ne constituerait pas un objectif, mais un moyen. C’est en réalité tout le contraire : l’objectif est bien le maintien d’un système à prestations définies, car seul ce système est protecteur pour les retraités.

Je suis un peu surpris des explications que vous venez de nous fournir, madame Gonthier-Maurin. Dans un système de répartition, ce sont les actifs qui paient pour les inactifs.

Effectivement !
Cependant, au travers de votre amendement, on touche bien le flou, entretenu par les uns ou par les autres, sur l’objet même de notre système de répartition. Certains en portent une part de responsabilité.
En effet, que nous disent généralement nos concitoyens ? Lorsqu’ils estiment que le niveau de retraite qu’ils perçoivent ne correspond pas à leurs attentes ou à leurs espérances, ils affirment : « Avec ce que j’ai cotisé, j’ai droit à tel ou tel montant ». Je suis alors désolé de le leur dire aujourd’hui, comme je le leur disais hier et comme je le leur dirai demain, dans un système par répartition, les cotisations actuelles financent les retraites actuelles. Ainsi, lorsque l’on arrive soi-même à la retraite, on bénéficie des pensions permises par cotisations des actifs et non pas de sa propre cotisation.
Par conséquent, lorsque la pyramide des âges est moins favorable et que l’espérance de vie est allongée, le système n’est pas un système à prestations définies. Le système repose sur un équilibre démographique entre actifs et retraités. Dès lors, si le montant des cotisations reste inchangé et que le nombre de cotisants baisse par rapport au nombre de retraités, la somme à répartir est forcément moindre.
Finalement, lorsque vous appelez de vos vœux un dispositif à prestations définies, vous plaidez pratiquement pour un système par capitalisation, ou au moins pour un système mixte qui combinerait prestations définies et capitalisation. Or ce système ne répondrait plus à ce à quoi vous êtes attachés : un système par répartition.
En ce début de débat, on ne peut pas continuer à utiliser des arguments de marchands d’illusions. Nous avons intérêt à poser calmement et sereinement les termes du débat pour assumer demain ensemble nos décisions devant nos concitoyens.
Or ce n’est pas la voie que nous empruntons quand Mme la ministre et certains collègues défendent aujourd’hui des positions diamétralement opposées à celles qu’ils tenaient voilà encore deux ans-deux ans et demi : il était alors hors de question d’accepter le principe que je viens d’évoquer, à savoir l’équilibre entre les actifs et les retraités, financés par la répartition. À preuve, cet amendement qui me paraît à contre temps des nécessités du débat d’aujourd’hui, autour du régime de répartition.
Pour ma part, j’aurai l’occasion de continuer à prêcher, si j’ose dire, pour un système favorisant des formes de capitalisation, notamment par la possibilité de financement par les entreprises – y compris pour les faibles revenus. Je fais ici référence à une réforme, portée en 1997 par le député lorrain Jean-Pierre Thomas et qui malheureusement n’a pas pu aboutir. Cette réforme aurait permis de compléter le dispositif de retraites par répartition par un abondement salariés-entreprises au bénéfice de la capitalisation nécessaire eu égard, notamment, à l’allongement de l’espérance de vie.

Chère collègue, votre inquiétude est totalement infondée. Je ne vois pas en quoi la présente réforme déboucherait inéluctablement – car c’est ce que vous semblez dire – sur un système à la suédoise.
Le système suédois est simple. Les cotisations sont libellées en euros, sans conversion en points – comme c’est le cas dans un système par points. Ces cotisations abondent un compte notionnel. Dans ce type de système, on fait en sorte que, via des paramètres, le montant des cotisations, bien sûr actualisées, corresponde peu ou prou au montant moyen de la retraite attendue compte tenu de votre espérance de vie.

Néanmoins, qu’il s’agisse d’un régime à compte notionnel, par annuités – comme notre régime de base –, ou par points – comme nos régimes complémentaires –, nous nous situons toujours dans un système par répartition. Ce sont toujours les actifs qui financent les retraites.
Ainsi, vous avez raison, le système à compte notionnel est soumis – comme les autres systèmes – aux chocs démographiques comme aux chocs de croissance. Dans ce système, par construction équilibré, les prestations ne peuvent excéder les cotisations. Dans le cas d’un choc de croissance, lorsque les cotisations baissent, les prestations doivent donc être ajustées en fonction du nouveau niveau de cotisations. C’est la raison pour laquelle, après la crise de 2008, les retraites suédoises ont effectivement diminué de 1 à 3 % en 2010. Toutefois, cette baisse a fait l’objet d’un grand débat national, qui a amené le gouvernement suédois à mettre en place des abattements supplémentaires sur l’impôt sur le revenu – ou son équivalent suédois – de façon à maintenir à peu près le pouvoir d’achat des retraités.
Néanmoins, aucune mesure de la présente réforme – qui repose sur une augmentation des cotisations et un allongement de la durée de cotisation – ne laisse présager un changement systémique de nos régimes de retraite, pour basculer dans un régime à la suédoise.
Vos craintes me paraissent donc infondées. C’est pourquoi je comprends mal la nature de votre amendement.

Autant j’ai voté l’amendement précédent, qui visait à accoler l’adjectif « solidaire » au terme « retraite », autant cet amendement peut être interprété de manière différente.
Les gens croient souvent que le système par répartition repose sur une répartition égalitaire. Mais c’est faux : le montant des pensions est basé sur le salaire perçu pendant la période de travail. Si on avait un haut salaire, on a une haute retraite – en plus du patrimoine que l’on s’est constitué –, on fait partie de ceux dont a parlé Jean-Pierre Caffet, qui disposent d’un revenu mensuel dépassant 1 900 euros.

Il en est de même des actionnaires.
Dans une société solidaire, s’il faut fournir un effort collectif à cause d’une conjoncture économique difficile, on ne peut pas maintenir des « prestations définies » pour les retraités, car les actifs ne bénéficient pas d’un tel avantage.
On comprend bien le sens de votre amendement, qui vise à rappeler qu’il faut garantir le mode de vie, le pouvoir d'achat des retraités. Je dirais plutôt qu’il faut garantir le pouvoir d'achat des retraités modestes, car, dans une conjoncture difficile, on pourrait tout de même exiger un effort des retraités qui ont des revenus importants du fait de leur patrimoine et de leur pension de retraite.

C'est pourquoi il me semble problématique de prévoir des « prestations définies » pour l’ensemble des retraités.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 31, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
unit
insérer les mots :
entre elles
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

L’article 1er de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites dispose : « La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations. »
L’ensemble de nos amendements tendent à renforcer cette conquête sociale majeure qu’est la mise en œuvre de la solidarité nationale en matière de retraites et à confirmer ainsi la retraite comme un droit, ce qui suppose que ce droit soit ouvert à soixante ans et que les pensions versées ne puissent être inférieures au SMIC.
Nous voulons aussi garantir, par des mesures précises, la solidarité intergénérationnelle, pour tourner clairement la page de la réforme de 2010, qui avait fait le choix du « chacun pour soi », et plus précisément du « chacun selon ses moyens ». Cet amendement vise ainsi à ajouter, à la fin de l’alinéa 4, les mots « entre elles » après le mot « unit ». Il nous paraît indispensable de préciser ce point, car l’objectif est bien d’assurer la solidarité à la fois entre les générations et au sein de chaque génération.
Le système de retraite par répartition a été instauré en France pour garantir des ressources à tout affilié après la cessation de son activité professionnelle. Ce système s’appuie sur la solidarité intergénérationnelle : les actifs paient des cotisations pour financer les retraites des personnes âgées tout en acquérant des droits qui, à leur tour, seront financés par les générations suivantes d’actifs. En optant pour ce système, le législateur est devenu le garant de sa pérennité sociale.
Parce que le système s’appuie sur la règle de la cotisation sociale, c’est aussi de solidarité horizontale qu’il s’agit. En effet, chacun contribue en fonction de ses ressources. C’est tout l’intérêt du principe de la cotisation, qui implique directement le citoyen dans le partage des richesses : de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins.
Ajoutons que le financement des retraites est assis sur la richesse produite. Dans les entreprises, cette richesse double tous les trente ans, c’est-à-dire à un rythme supérieur à celui du nombre de retraités. Nous aurons donc largement les moyens financiers d’assumer nos retraites futures, à condition, évidemment, de répartir équitablement la richesse produite. Voilà pourquoi il me semble important de rappeler ce ferment solidaire.

Cet amendement est bien plus précis que le propos de notre collègue. Il s’agit d’insérer des mots dans le projet de loi pour renforcer le lien entre les générations. La commission a émis un avis favorable.

Je suggère que le groupe UMP vote votre amendement, madame Pasquet. En effet, la rédaction actuelle, qui évoque « le pacte social qui unit les générations », comporte une ambiguïté. S’agit-il d’unir chaque génération en son sein ou, comme vous souhaitez le préciser par votre amendement, les générations « entre elles » ? C’est bien ce second objectif qui est le nôtre.
Nous voterons cet amendement avec d’autant plus de bonne volonté que le Gouvernement nous propose exactement le contraire :…

nous convient parfaitement.
Nous sommes favorables à la solidarité des générations. Il faut faire en sorte que les vieux d’aujourd'hui ne chargent pas impunément les jeunes de demain, c'est-à-dire ceux qui, ayant aujourd'hui moins de quarante ans, devront cotiser jusqu’à soixante-six ans en raison d’un report de l’âge minimal de départ à la retraite que vous n’osez pas afficher mais qui s’impose de fait, comme l’a rappelé le Président de la République dans sa communication à Bruxelles le 1er octobre dernier. §
L'amendement est adopté.

Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 18, présenté par Mmes Cohen, Gonthier-Maurin et Cukierman, M. Watrin, Mmes David et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 4, seconde phrase
Après le mot :
pensions
insérer les mots :
au moins
La parole est à Mme Laurence Cohen.

L’article 1er indique, à son alinéa 4, que les pensions des retraités devront être en rapport avec les revenus qu’ils ont tirés de leur activité professionnelle Je veux voir dans cette rédaction la volonté du Gouvernement de s’inscrire dans la continuité des travaux du Conseil national de la Résistance, le CNR, qui ont débouché en 1946 sur les ordonnances instituant la sécurité sociale, aux termes desquelles les revenus tirés du travail servent à alimenter notre système. Je me réjouis que tout le monde soit d'accord, et je souscris pleinement à ce principe, qui impose de prendre des mesures pour que tous les revenus du travail soient soumis à cotisations sociales. Il faut donc mettre fin aux exonérations de cotisations sociales comme aux exemptions d’assiettes.
Notre système de retraite est complexe. Il est fondé sur un socle obligatoire et sur un socle complémentaire. Pour notre part, nous ne pouvons nous résoudre à l’idée que les retraites ne soient assises que sur les revenus perçus par les salariés. En effet, dans un tel système, les salariés qui ont connu des périodes de précarité, marquées par le chômage, le travail à temps partiel ou les emplois particulièrement mal rémunérés – ces difficultés pouvant se cumuler –, sont sanctionnés une seconde fois à l’âge de la retraite.
Depuis le début de nos travaux, nous sommes nombreuses et nombreux à dire que l’objectif de notre système de retraite doit notamment être de garantir à chacun une retraite en bonne santé. Or cette notion de bonne santé ne doit pas être appréhendée seulement sous l’angle médical. Il y a bien évidement un aspect social et financier, car comment espérer avoir une longue espérance de vie en bonne santé si les retraites et les pensions, parce qu’elles sont calquées sur les revenus du travail, ne permettent ni de payer un loyer décent, ni de se nourrir correctement, ni même de se soigner ?
Si, pendant des années, les mesures courageuses prises, je tiens à le souligner, par des gouvernements de gauche, ont permis d’assurer un niveau de vie moyen des retraités équivalant à celui des actifs, les choses commencent clairement à changer et la courbe commence, hélas, à fléchir. Les mesures et réformes mises en œuvre depuis la fin des années 1980, et plus encore des années 1990, qui étaient destinées à rendre plus flexible le marché du travail, ont engendré simultanément une baisse continue du niveau des retraites au moment de leur liquidation et une baisse des salaires.
Ces mécanismes, que nous observons toutes et tous, nous invitent à sortir de cette logique selon laquelle les pensions devraient être en rapport avec les revenus tirés de l’activité professionnelle. Le financement de notre système doit effectivement dépendre du travail, en étant alimenté par les richesses créées par les entreprises, mais les pensions ne doivent pas être limitées à une fraction des salaires perçus, faute de quoi elles marqueraient un net décrochage de pouvoir d’achat par rapport à la période de travail.
Afin d’éviter que certains ne perçoivent des pensions misérables, nous proposons donc que l’alinéa 4 indique que le système de retraite assure aux retraités le versement de pensions « au moins » – j’y insiste – en rapport avec les revenus tirés de l’activité : tout en n’étant pas sans lien avec les revenus, les pensions doivent pouvoir être plus importantes que le salaire de référence si ce dernier est manifestement trop bas.

L'amendement n° 19, présenté par Mmes Cohen, Gonthier-Maurin et Cukierman, M. Watrin, Mmes David et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 4, seconde phrase
Remplacer les mots :
en rapport avec les
par les mots :
au moins proportionnelles aux
La parole est à M. Thierry Foucaud.

Cet amendement prévoit, dans la continuité de l’amendement précédent, de remplacer à l’alinéa 4 les mots « en rapport avec les » par les mots « au moins proportionnelles aux ».
En effet, l’alinéa 4 de l’article 1er, qui constitue en quelque sorte le préambule du projet de loi, indique que la retraite perçue est en rapport avec les revenus tirés de l’activité. Il écorche ainsi un peu plus le pacte social élaboré, comme vient de le rappeler notre collègue, en 1945, selon lequel notre régime de retraite est un régime par répartition. Du reste, ce même article 1er le reconnaît ; je le rappelle compte tenu du débat qui a eu lieu il y a quelques minutes.
Or nous voyons mal comment notre régime pourrait demeurer un régime par répartition si les retraites servies sont seulement en rapport avec les revenus tirés de l’activité. Tout cela génère du doute et tend à assimiler les retraites à un risque assurantiel comme les autres, le montant des pensions dépendant, au final, non pas de critères cumulatifs – durée de cotisation, taux de cotisation, salaire annuel de référence, etc. –, mais d’abord et avant tout du montant des salaires.
Qui plus est, dire que le montant des retraites est fixé en rapport avec les revenus tirés de l’activité nous interroge quant à la capacité de notre système à compenser à l’avenir les inégalités de revenus que connaissent les femmes.
À rebours de la portée solidaire et collective qui a prévalu lors la création de notre système de protection sociale, l’alinéa 4 renvoie à la notion d’individualisation, ignorant ainsi les fondements de notre système, qui repose sur une double solidarité entre les actifs et entre ceux-ci et les retraités.
Parce que notre système est solidaire, il fonctionne par la répartition, et c’est parce qu’il participe à une mise en commun des cotisations qu’il permet de compenser les inégalités, de sorte que les pensions peuvent être plus importantes qu’elles ne l’auraient été si elles avaient été calculées uniquement en référence aux salaires perçus.

L'amendement n° 18 vise à préciser que la mise en œuvre du principe contributif du système de retraite est complétée par des dispositifs de solidarité. Cette précision n’est pas utile, car la complémentarité entre les prestations contributives et les prestations non contributives du système de retraite ressort déjà de la rédaction de l’article 1er, et en particulier de son alinéa 6, qui prévoit la prise en compte des périodes éventuelles de privation involontaire d’emploi. La commission émet donc un avis défavorable.
L’amendement n° 19 a pour objet d’introduire un principe de proportionnalité entre les pensions et les revenus professionnels passés de l’assuré. La rédaction actuelle traduit mieux le fait que les niveaux des pensions respectent un certain taux de remplacement. L’avis est également défavorable.

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote sur l’amendement n° 18.

Malgré les éléments de réponse détaillés, dont je remercie Mme la rapporteur, je tiens à maintenir l’amendement n° 18. Comme nous allons le démontrer tout au long de notre débat, nous voulons vraiment insister pour renforcer le lien entre le financement de notre protection sociale et le travail.
Dans ce cadre, il est nécessaire de garantir des niveaux de pension permettant de vivre dignement. En effet, comme certains orateurs l’ont dit, nous vivons plus longtemps, donc nous devrions travailler plus longtemps, ce qui exige que nous vivions en bonne santé et dignement.
Pour le seul régime de base, il faut que le niveau de pension ne soit pas inférieur au SMIC. C’est pour cette raison que nous proposons de renforcer le financement de la sécurité sociale en instaurant une cotisation sociale sur les revenus financiers, en soumettant les revenus du capital au même taux de cotisation que les salaires, ou encore en majorant le taux des cotisations sociales des entreprises qui ne respectent pas l’égalité salariale, privant ainsi les femmes de salaires corrects, ou qui généralisent les temps partiels.
À ceux qui se demanderaient quel est le rapport avec notre amendement, je répondrai que je veux démontrer ici la logique qui sous-tend nos prises de position, car celles-ci correspondent non pas à postures, mais bel et bien à notre projet de société. Tout au long du débat, nous allons travailler sur ces questions et défendre des amendements allant dans ce sens.
Ainsi, nous pensons que les ressources qui pourraient résulter de la mise en œuvre de nos propositions permettraient de revaloriser les pensions, et même de porter les plus petites au niveau du SMIC, ce qui aurait pour effet de déconnecter mathématiquement le montant des pensions de celui des salaires réellement perçus.
Personne ne pouvant prétendre qu’une telle mesure serait injuste, nous maintenons notre amendement.

Je ne souhaite pas revenir en détail sur l’argumentation de nos collègues, mais je m’interroge sur la rédaction de la seconde phrase de l’alinéa 4 telle qu’elle résulterait de l’adoption de l’amendement. À mon sens, la formulation « au moins en rapport » affaiblit beaucoup le lien entre pensions et revenus, et, partant, la portée du texte.

Je ne voterai pas cet amendement, car je ne suis pas spécialement favorable à des pensions proportionnelles aux revenus, comme je l’ai dit tout à l’heure.
Je considère que la solidarité doit se traduire par un montant minimal des pensions, complété par un système de lissage.
Est-on obligé d’avoir une pension proportionnelle aux revenus perçus en activité ? Sachant qu’il y a déjà une inégalité importante durant la vie professionnelle, pourquoi devrait-on la reproduire après la retraite ?

Oui, mais l’expression « au moins en rapport » signifie bien qu’il y a proportionnalité !
Pour nous, écologistes, à la différence de certains, ici, …
Sourires sur les travées de l’UMP.

M. Jean Desessard. Il est évident que, au train où nous allons vers une importante catastrophe économique, ce ne sont pas nos idées qui sont écoutées…
Oh ! sur les travées de l’UMP.

C’est bien dommage ! Nous vivons dans une civilisation qui ne veut pas réfléchir à son avenir, à la pénurie annoncée de ressources naturelles. Nous aurons des problèmes d’énergie, de pollution, et la planète est condamnée si nous continuons de produire autant. Mais les gens n’ont pas envie de l’entendre…
Rires sur les travées de l’UMP.

Mes chers collègues, avez-vous lu la presse ces derniers jours ? Les centres commerciaux se plaignent, dans certains endroits, de ne plus pouvoir vendre. C’est quand même formidable : dans le passé, on m’a reproché de m’opposer à leur développement – je n’étais pas le seul à les critiquer –, au motif qu’il fallait favoriser la création de ces centres commerciaux pour le bien de l’économie, avant de s’apercevoir qu’ils sont maintenant trop nombreux et qu’on a fait des erreurs en détruisant des espaces naturels. On ne sait plus quoi en faire, car même le commerce est en « surproduction ».
Nous allons de plus en plus assister à une course au travail, à une course à la production, laquelle entraînera une raréfaction des matières premières, une utilisation massive d’énergie alors que nous n’en aurons pas suffisamment. Arrêtons…
Ah ! sur les travées de l’UMP.

Un système des retraites fondé sur l’accumulation fait que les gens vont travailler le plus possible pour avoir la pension de retraite la plus élevée possible à la sortie. Si l’on pousse à la production maximale, tout le monde est incité à travailler davantage, alors que, pour nous, écologistes, c’est le partage du travail et la redistribution qu’il faut encourager aujourd’hui.

M. Jean Desessard. Arrêtons cette course au travail, ici ou dans d’autres pays, la nuit, le dimanche… Ce qui importe, c’est la coopération internationale et la redistribution, en bref le partage du travail.
Exclamations sur les travées de l’UMP.

Mes chers amis, je sais que vous ne partagez pas le même point de vue. Nous ne sommes pas productivistes et c’est ce qui nous différencie. Nous pensons justement que, sur une planète limitée, nous devons limiter notre production et notre consommation…

M. Jean Desessard. Pour ce faire, il nous faut trouver un projet convivial, qui ne soit pas fondé sur la consommation des biens matériels, mais sur l’échange culturel.
Exclamations amusées sur les travées de l’UMP.

Ce fut un bien beau moment de convivialité…
Sur les deux amendements présentés par le parti communiste, je vais soutenir la commission et le Gouvernement. Je suis d’ailleurs étonné que le parti communiste…

… prenne le risque de défendre ces positions. De votre point de vue, il me semble que le système des retraites du régime général devrait avoir une fonction redistributrice. Si vous exigez que les pensions soient proportionnelles aux revenus…

… ou « au moins en rapport » avec les revenus, vous allez être obligés d’abandonner le caractère redistributeur d’un régime qui permet à des gens qui ont moins travaillé de bénéficier de droits à la retraite plus importants.
C’est notamment le cas des femmes mariées qui ont choisi de travailler à temps partiel – Mme Rossignol pourrait nous en parler – pour concevoir et élever des enfants, condition indispensable pour la survie des régimes par répartition. Dans ce pays, il n’est de richesse que d’hommes !
Si vous renoncez à cette fonction redistributrice en ne versant des retraites que strictement ou « au moins » proportionnelles aux revenus d’activité, vous allez pénaliser les familles ou les salariés qui ont été frappés par des chômages de longue durée en raison de reconversions technologiques. En tout cas, vous allez supprimer une base politique et juridique de ce droit à la retraite. C’est la raison pour laquelle, compte tenu des valeurs que vous revendiquez, vous devriez abandonner ce « au moins ».
Applaudissements sur les travées de l’UMP.
L’amendement n’est pas adopté.

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote sur l’amendement n° 19.

Le débat que nous venons d’avoir sur la manière dont doit être calculé le montant des retraites en rapport ou proportionnellement aux revenus tirés de l’activité professionnelle est plus important qu’il n’y paraît.
Avec l’amendement n° 18, nous entendions renforcer les deux piliers de notre système en conservant son aspect contributif, c’est-à-dire assis sur les cotisations sociales, et ses dimensions redistributive et solidaire.

Permettez-moi de revenir un instant sur l’amendement précédent : ne dites pas que l’expression « au moins en rapport » est réductrice par rapport à la rédaction initiale du projet de loi, alors que tel n’est pas le cas !
J’en reviens à l’amendement n° 19 : un système qui ne serait que contributif, c’est-à-dire dans lequel les pensions dépendraient étroitement de la somme des cotisations versées par le salarié, donc du montant des salaires, aurait immanquablement pour effet de reproduire sur les pensions les inégalités de revenus qui existent entre actifs.
À l’inverse, en faisant intervenir d’autres sources de financement que les salaires, nous serions en mesure de favoriser un système plus redistributif susceptible de gommer les inégalités existantes qui pèsent sur les salariés aux carrières incomplètes ou aux faibles revenus.
Nous connaissons bien la tentation de certains parlementaires de tendre un peu plus vers le « big-bang social » et de faire primer les retraites par points, à savoir un régime dans lequel toute contribution, c’est-à-dire toute cotisation, doit se traduire par l’obtention mécanique de points de retraite qui servent de base de calcul pour les droits à pension, celle-ci étant au final en proportion directe avec les efforts réalisés par les salariés.
Pour toutes ces raisons, nous maintenons l’amendement n° 19.
L’amendement n’est pas adopté.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 40, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
À ce titre, il est progressivement mis fin, dans un délai de deux ans, aux mécanismes individuels ou collectifs, de retraite faisant appel à la capitalisation.
La parole est à M. Dominique Watrin.

Notre pays a fait de longue date le choix de la retraite solidaire par répartition, ce dont nous nous félicitons, en raison du constat plus que mitigé ayant résulté de l’échec des régimes par capitalisation qui existaient avant la Seconde Guerre mondiale. Le législateur, à la Libération, s’est donc tourné vers la mutualisation.

M. Gérard Longuet. Il y a quand même eu des circonstances historiques particulières, notamment le pacte germano-soviétique !
Protestations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Monsieur Longuet, voulez-vous qu’on vous rappelle votre histoire personnelle dans les années soixante ?

Nous parlons vraiment du sujet des retraites ! Vous voudriez sans doute nous voir revenir vers les pensions de retraite du début du siècle dernier, mais nous avons un autre projet de société. Nous souhaitons que notre pays fasse le choix intégral du système par répartition, qui est un gage de solidarité. Vous ne nous détournerez pas de cet objectif par des affirmations complètement hors sujet.
Certes, ce système de répartition ne fait pas que des heureux, et votre réaction en est la preuve.

Dans notre pays, comme dans d’autres, les marchés financiers exercent leur emprise et ils n’abandonnent pas. Bien évidemment, ils lorgnent toujours sur les milliards d’euros qui sont en jeu, au-delà d’ailleurs, de toute autre considération, notamment des prétextes démographiques qui occultent la persistance du chômage dans notre pays. Et c’est bel et bien ce qui fait enrager les libéraux ! Ah, ce serait tellement mieux si, comme au Chili en 1973, tous les salariés étaient soumis à un régime par capitalisation !
Je vous propose une brève analyse de ces « pousses » de capitalisation qui existent dans notre système français, c’est vrai. Un certain nombre de produits d’épargne retraite sont proposés : je pense, par exemple, aux PERCO issus de la loi Fillon de 2003. C’est un fait, cette formule, fondée notamment sur l’alimentation du compte des salariés par des versements de l’entreprise, entre en concurrence directe avec le mode de financement de notre système de retraite fondé sur des cotisations mutualisées.
Dix ans après le lancement de cette formule, quel est le bilan ? Selon des sources concordantes, à la fin de 2011, l’encours total des PERCO atteignait environ 5 milliards d’euros, partagés parmi un million de porteurs, soit une moyenne de 5 000 euros par souscripteur ; 5 187 euros par porteur, pour être tout à fait exact ! Il n’y a pas là de quoi faire face, malheureusement, le moment venu, à la modification de la situation financière d’un salarié qui accuserait une baisse de ses revenus au moment de partir à la retraite ! Ce n’est pas donc pas la solution.
Dans ce contexte, il est souhaitable de faire disparaître ces dispositifs d’épargne retraite qui privent le système de répartition des sommes placées dans le système capitalisation.
Selon nous, garantir la pérennité de nos systèmes de retraite par répartition doit passer aussi par l’extinction progressive des mécanismes de capitalisation, qui représentent autant de sommes retirées à notre régime de retraite solidaire.

L’amendement n° 246, présenté par MM. Longuet et Cardoux, Mmes Boog, Bruguière, Bouchart, Cayeux, Debré et Deroche, M. Dériot, Mme Giudicelli, MM. Gilles et Husson, Mme Hummel, MM. Fontaine, de Raincourt, Laménie et Milon, Mme Kammermann, M. Pinton, Mme Procaccia, MM. Savary, Karoutchi et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le système de retraite français est composé des régimes de base obligatoire par répartition, des régimes de retraite complémentaire obligatoire et le cas échéant des régimes par capitalisation à travers notamment l’épargne retraite collective ou individuelle.
La parole est à M. René-Paul Savary.

Cet amendement, qui vise à insérer un alinéa après l’alinéa 4, va complètement à l’encontre des thèses défendues par M. Watrin. Il est donc sans rapport aucun avec ce que nous venons d’entendre !
Pour notre part, nous souhaitons rappeler, contrairement à M. Watrin, que le système des retraites repose sur trois piliers.
Le premier pilier est celui de la répartition, que nul ne conteste, et qui est constitué par les régimes obligatoires de base.
Le deuxième pilier est constitué des régimes de retraite complémentaires, collectifs, dédiés à certaines professions ou installés au niveau de l’entreprise.
Enfin, le troisième pilier est celui de l’épargne retraite individuelle qui passe, soit par un plan d’épargne retraite populaire, soit par un contrat d’assurance-vie, soit par une formule de capitalisation comme le PERCO, mis en place dans le cadre d’un plan d’épargne retraite populaire en application de la réforme précédente.
Ces amendements témoignent d’approches fort différentes, qui méritent d’être débattues au sein de cette assemblée.

Ces deux amendements sont, en effet, très antinomiques, ai-je envie de dire.
Au sujet de l’amendement n° 40, qui prévoit l’extinction progressive de la retraite supplémentaire par capitalisation, je rappelle que la retraite supplémentaire constitue le troisième étage de notre système d’assurance vieillesse. Elle n’a pas vocation à se substituer à la retraite obligatoire de base ni à la retraite complémentaire, auxquelles elle s’ajoute à titre facultatif. J’émets donc, au nom de la commission, un avis défavorable.
Quant à l’amendement n° 246, qui tend à mentionner l’existence des trois étages du système de retraite, les retraites de base, les retraites complémentaires et les retraites supplémentaires, il précise non les objectifs du système de retraite, mais son organisation, qui est un moyen au service de ces objectifs. Pour cette raison, j’émets également, au nom de la commission, un avis défavorable.
Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements, dont les objectifs sont radicalement, diamétralement opposés.
Le Gouvernement n’a aucunement l’intention de mettre en place un système de retraite par capitalisation, pas même de façon partielle. L’enjeu du projet de loi qui vous est soumis est bien de consolider notre système fondé sur la répartition, de telle sorte qu’il garantisse à chacun, au regard de sa carrière professionnelle et des mécanismes de solidarité qui interviennent, un niveau de retraite décent et digne.
Dans le même temps, si nos concitoyens souhaitent pouvoir constituer une épargne complémentaire dans la perspective de leur retraite, nous n’avons aucune raison de nous y opposer, dès lors que ces mécanismes de retraite, tels que les PERCO en entreprise, sont souscrits individuellement et ne viennent pas se substituer à la retraite par répartition.
Nous ne voulons pas aller à l’encontre de la liberté contractuelle, de la liberté individuelle de nos concitoyens, qui peuvent constituer une épargne destinée à venir en complément de la retraite qui lui sera servie par notre mécanisme par répartition.
C’est la raison pour laquelle j’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur ces deux amendements.

La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote sur l’amendement n° 40.

Cela fait déjà quelque temps qu’une certaine partie du patronat, notamment les représentants de la banque et de l’assurance, et quelques idéologues, réunis au sein de l’Institut de l’entreprise ou de l’Institut Montaigne, présentent la capitalisation comme la panacée aux maux rédhibitoires de notre système de retraite par répartition, dont l’avenir serait indéfiniment voué à un déficit grandissant.
Je crois qu’il faut, à un moment donné, revenir aux fondamentaux mêmes de la capitalisation, des fondamentaux exactement inverses de ceux de notre système solidaire de retraite.
En effet, dans le système de la capitalisation, l’intérêt des actifs qui veulent épargner est de disposer de revenus élevés qui leur permettent de soustraire des sommes au-delà de leur consommation. Dans le même temps, l’intérêt des rentiers-retraités est d’obtenir la meilleure rémunération immédiate de leur capital investi.
En clair, le système par capitalisation oppose donc les actifs aux retraités. La persistance des outils de capitalisation conduit à pérenniser non notre système de retraites, mais cet antagonisme entre actifs et retraités.
De plus, la capitalisation dessert l’intérêt général, car sa logique globale tient dans un accroissement continu du capital et dans une progression du rendement du capital. À ce titre, c’est un système qui joue contre la consommation et contre l’emploi. Le prélèvement opéré à un moment donné sur les richesses produites est retiré de la consommation et n’y revient qu’après un circuit long et fortement hasardeux.
Le système par capitalisation est, en effet, plein d’aléas. Les placements opérés aujourd’hui peuvent ne pas se révéler judicieux quelques années plus tard. Il s’agit bel et bien de confier sa retraite à la bourse, ce qui n’est pas très rassurant. Tout le monde peut en juger aujourd’hui au vu des fluctuations, voire des crises boursières.
Ainsi, la capitalisation peut paraître rentable pendant la montée en puissance du système. Tel est le cas, par exemple, quand la demande d’actifs financiers est importante, c’est-à-dire quand les actifs sont nombreux en période d’épargne-capitalisation.
À l’inverse, quand les personnes arrivent à l’âge de la retraite, elles ont tendance à vouloir liquider leur pension. Elles souhaitent, très logiquement, vivre sur leur capital et vont vendre une partie de leurs avoirs, qui sera offerte sur les marchés. Supposons qu’il y ait alors moins de jeunes et de revenus pour acheter ces titres, la tendance du marché sera à la baisse. En conclusion, ces titres vont s’effondrer et ni les retraités ni les actifs ne pourront bénéficier des bienfaits supposés de la capitalisation.
Il ressort donc de ce qui précède que le recours à la capitalisation n’empêche pas les effets du fameux « choc démographique », on y revient, auquel vous vous référez pour l’imposer. La capitalisation n’est efficace ni pour créer de la solidarité, ni pour répondre aux variations démographiques, ni pour engendrer du revenu. Elle n’est efficace que pour organiser sa disparition !
C’est bel et bien pour ces motifs de fond que nous vous proposons l’adoption de cet amendement.
L’amendement n’est pas adopté.

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote sur l’amendement n° 246.

Nous arrivons à un rendez-vous important de la réflexion collective sur l’avenir de nos retraites.
Il n’est pas complètement inutile de revenir en arrière. Si les régimes par capitalisation ont connu, dans notre pays, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une image négative, c’est parce que, rappelons-le, deux événements importants ont marqué l’histoire monétaire française : la Première Guerre mondiale, dont l’année prochaine marquera le centenaire du déclenchement, puis, la Seconde Guerre mondiale que j’évoquais à titre incident.
La Première Guerre mondiale a mis fin à un siècle de stabilité monétaire pendant lequel les travailleurs, qu’ils soient salariés, alors minoritaires, ou travailleurs indépendants, dans le monde agricole, mais aussi dans le monde commercial et artisanal, ont pu se constituer des retraites par capitalisation. On les appelait les rentiers et ils étaient d’ailleurs assez nombreux dans notre pays. En plaçant leurs économies en rente d’État, d’une part, et dans l’immobilier, d’autre part, ils accédaient, après une période de vie de labeur, à une certaine indépendance.
Cette retraite par capitalisation, qui n’était pas formalisée, a évidemment été balayée par l’inflation issue de la Première Guerre mondiale et toutes les tentatives de stabilisation ont tué le rentier, qui a disparu sociologiquement de notre pays.

En 1945, en effet, le CNR a lancé une sorte de nouveau contrat social. La répartition est l’enfant de l’inflation, puisqu’il s’agit de payer immédiatement, sans attendre, des retraites avec les ressources des cotisations – ce qu’a évoqué René-Paul Savary précédemment – et de faire en sorte que les retraites versées correspondent aux cotisations immédiatement versées. À l’époque, en effet, la fuite devant la monnaie, en raison du risque permanent d’inflation, rendait tout système de capitalisation à peu près impossible.
Ce qui n’a d’ailleurs pas empêché un certain nombre de nos compatriotes, qui avaient des revenus suffisants pour dégager une marge ou qui pouvaient accéder au crédit, d’échapper à l’inflation et de se constituer ainsi une retraite par l’accumulation d’actifs – notamment d’actifs immobiliers – qui, eux, étaient des biens réels, protégés de l’inflation. Pendant ce temps, le salarié ou le retraité, lui, courait après l’inflation, faisant dire aux syndicalistes que « les prix prennent l’ascenseur et les salaires prennent l’escalier. »
Aujourd’hui, la situation a complètement changé en France et ce, pour deux raisons.
La première, c’est que nous avons une monnaie nouvelle, l’euro, dont l’objectif est la stabilité – on peut regretter cet objectif ; on peut, au contraire, s’en féliciter. C’est un fait que, depuis la mise en place de l’euro – et la majorité de cette assemblée souhaite maintenir l’appartenance de la France à la zone euro –, nous connaissons la stabilité. Le regard de nos compatriotes face à la sécurité des vieux jours change, parce que change également la relation qu’ils ont avec la monnaie, dans la mesure même où l’inflation a disparu. C’est un premier élément dont vous ne pouvez pas ne pas tenir compte.
La seconde raison extrêmement importante de ce changement – et je suis très surpris, madame le ministre, que vous ne lanciez pas une réflexion publique sur ce thème – est la globalisation.
La globalisation économique mondiale présente des avantages et des inconvénients. Le régime de répartition est nécessairement exclusivement national, puisque l’autorité de la loi ne peut jouer qu’à l’intérieur d’un espace, de l’espace national, qui est l’espace de l’imperium de la loi.
Pourquoi priver les générations actuelles de Français des bienfaits des performances économiques, du développement et de la croissance que connaissent d’autres parties du monde, et que seul l’investissement français, réalisé à l’extérieur par le biais de la capitalisation, permettrait de rapatrier dans notre pays ?
Après tout, la France vieillit, contrairement à ce que vous pensez. Or, dans le même temps, des pays jeunes deviennent puissants et connaissent une expansion économique. L’intérêt bien compris des jeunes générations françaises serait d’associer leurs économies et leur prévoyance au développement de pays qui ont des perspectives affichées de croissance que nous n’avons pas, puisqu’il est prévu – c’est indiqué dans le rapport – que le taux de croissance de notre pays serait de l’ordre de 1, 5 % par an dans les vingt prochaines années. Ce taux est certes extrêmement raisonnable, comme l’a rappelé M. Caffet en commission, mais il est aussi très largement inférieur à la performance économique réalisée ailleurs dans le monde.
Je ne nie pas qu’il y ait dans la démarche de capitalisation la perspective d’un risque, mais il y a également celle d’un succès. Lorsque nous rappelons le principe de la capitalisation, nous ne voulons pas simplement énoncer l’évidence qui est, comme vous l’avez rappelé, madame le ministre, que chacun d’entre nous a le droit à se constituer une épargne, si possible non taxée, dès lors que l’on a déjà acquitté l’impôt sur le revenu. Nous nous demandons simplement pourquoi on devrait priver la société française de la perspective d’être associée, au travers de placements collectifs judicieux, à la réussite d’autres pays, auxquels nous souhaitons d’ailleurs qu’ils connaissent une forte croissance.
Prolétaires et consommateurs de tous les pays, unissez-vous pour une croissance mondiale harmonieuse et pacifique !
Sourires et applaudissements sur les travées de l’UMP.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, vous ne serez pas surpris que je partage l’analyse de Gérard Longuet.
Je veux redire l’importance que j’accorde à ces trois piliers, et ce d’abord pour une raison pratique : les tabourets à trois pieds sont les plus stables !
Sourires sur les travées de l’UMP . – Exclamations sur les travées du groupe socialiste.

Mais restons sérieux...
Le premier de ces piliers auxquels nous sommes attachés est le principe de la répartition.
Le deuxième pilier est formé par les régimes de retraite collectifs réservés à certaines professions, comme la Préfon pour les fonctionnaires.
Or ceux qui ont cotisé à la Préfon, dispositif présenté comme particulièrement vertueux, ont été victimes au cours des dernières années d’erreurs de gestion – et cela fait penser aux préoccupations que soulève le système de retraite par points – qui ont grandement diminué les prestations qu’ils en attendaient, prestations qui étaient donc loin d’être « définies ». Cela ne manque pas de nous interroger.
Les contrats Madelin, en revanche, me semblent répondre parfaitement à l’objectif d’un complément de retraite. Ils s’adressent en effet aux professionnels indépendants, auxquels leurs cotisations dans le cadre du seul régime par répartition ne permettent pas, compte tenu de la pyramide des âges, de s’assurer des pensions décentes globalement proportionnelles à leurs revenus. L’avantage de ces contrats Madelin est de prévoir une sortie obligatoire en rente. Il s’agit donc bien d’un système collectif de retraite complémentaire.
Le troisième pilier auquel nous sommes attachés regroupe divers dispositifs de retraite individuels, parmi lesquels je citerai le plan d’épargne retraite populaire, le PERP, qui permet également des sorties en rente. Dans la mesure où il s’agit de rente et non de sortie en capital, nous parlons bien d’un système de retraite, et non d’un dispositif de capitalisation.
Si l’on regarde dans le rétroviseur, il y avait encore mieux que le PERP voilà quelques années : le PEP, le plan d’épargne populaire. Le PEP était plus intéressant que le PERP car, tout en s’inscrivant dans une même logique, il permettait de récompenser les efforts de ceux qui, tout au long de leur vie, faisaient un effort d’épargne individuelle par le versement d’une rente nette d’impôt.
J’espère, madame la ministre, que vous allez nous rassurer et ne pas remettre en cause la spécificité de ces contrats, à savoir la possibilité d’obtenir une sortie en rente nette d’impôt. Ce serait une mauvaise nouvelle, qui s’ajouterait aux mesures que vous avez annoncées, et qui me paraissent aller dans un très mauvais sens, sur la nouvelle fiscalité applicable à certains contrats d’assurance-vie retraite. À mon humble avis, de telles dispositions ne seraient d’ailleurs pas constitutionnelles.
Il est donc possible que coexistent le régime de retraite par répartition, les régimes de retraite complémentaire qui permettent le versement d’une rente par le biais de l’entreprise – ce sont les deux premiers piliers, qui ressortissent de l’effort collectif et, me semble-t-il, d’une forme de solidarité bien comprise – et les dispositifs de retraites individuels dont bénéficient ceux de nos concitoyens qui ont souhaité se constituer, par leur propre arbitrage et en fonction de leurs capacités contributives, un complément de retraite. Les investissements immobiliers donnent bien droit à des avantages fiscaux !
Quoi qu’il en soit, il me paraît normal, sain et salutaire d’autoriser la capitalisation personnelle, notamment en actions, car ce type de produit offre une meilleure rentabilité dans le temps.
Enfin, dois-je rappeler que la capitalisation contribue au financement de l’économie française, et donc à son bon fonctionnement ?
Je ne doute pas, madame la ministre, mes chers collègues, que vous saurez vous ranger à nos arguments et soutenir notre amendement n° 246.

Avec ces deux amendements, le n° 40, qui a été repoussé, et le n° 246 que nous examinons, nous sommes en plein débat dogmatique et idéologique.
Je n’étais pas favorable à l’amendement n° 40, car je ne vois pas pourquoi ne pourraient pas exister un certain nombre de produits d’épargne faisant appel à la capitalisation.
Cette proposition posait, par ailleurs, un certain nombre de questions. Comment mettre fin aux contrats qui existent déjà ? Fallait-il rembourser, et dans quelles conditions, ceux qui n’avaient plus le droit de cotiser à tel ou tel produit ? Le Gouvernement aurait dû dénouer cette situation compliquée.
Enfin, où aurait-on mis la barre ? Comment définir ce qui ressortit, ou non, à la capitalisation ? L’assurance-vie, par exemple, relève-t-elle de la capitalisation ? Fallait-il mettre fin à l’ensemble des contrats d’assurance-vie, ou à un certain nombre d’entre eux ?
L’amendement n° 40 posait donc des problèmes inextricables.
S’agissant de l’amendement n° 246, j’ai bien entendu le plaidoyer de Gérard Longuet, dont j’ai préféré la fin au début. J’ai cru en effet, à un moment donné, qu’il était nostalgique du rentier d’avant-guerre !

M. Jean-Pierre Caffet. Et même d’avant la guerre de 1914, et non d’avant celle de 1940 !
Sourires sur les travées du groupe socialiste.

Vous avez fait une véritable apologie du rentier avisé de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle, avant qu’il ne soit ruiné, dans l’entre-deux-guerres, par la crise des années 1930.
Je ne partage pas votre point de vue, monsieur Longuet, sur les raisons de cette ruine. Elle n’était pas due, selon moi, à l’inflation, mais à la baisse du rendement des actifs. C’est d’ailleurs la limite des régimes par capitalisation : leur problème n’est pas l’érosion de l’épargne par l’inflation, mais précisément le rendement des actifs, car personne n’a réussi à démontrer jusqu’à présent que le rendement des actifs, donc le régime par capitalisation, était supérieur à long terme, sous ce rapport, au régime par répartition.

Je suis d’accord avec Mme la ministre : qu’un certain nombre de produits d’épargne puissent être utilisés pour la retraite ne me gêne absolument pas !

Ce que je conteste, c’est que le régime par capitalisation ait, comme vous le dites, des performances supérieures, ou tout au moins équivalentes, à celles du régime par répétition. Ce n’est pas vrai ! Sur le long terme, le rendement des actifs est, au mieux, nul.

Sur une vie de cotisation, ce que vous pouvez tirer de ces placements tend a priori vers zéro. Regardez le rendement de la Préfon !

Est-ce un régime particulièrement compétitif ? Non ! Or il s’agit bien de capitalisation.

Pas simplement...
Encore une fois, que l’on propose des produits d’épargne pouvant servir à améliorer la retraite d’un certain nombre de nos concitoyens, je n’y vois aucun inconvénient. Mais écrire dans la loi – car il s’agit de cela ! – que la capitalisation est un étage presque obligatoire de notre système de retraite, même si vous prenez la précaution d’ajouter les mots « le cas échéant », c’est un pas que je ne saurais franchir personnellement.
Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Je tiens à porter une information à votre connaissance : 4, 5 % du montant total des cotisations sociales sont détournés vers la capitalisation au détriment de la sécurité sociale, soit la bagatelle de 10 milliards d’euros de pertes...
Poursuivons sur le régime par capitalisation, puisqu’il ne faut pas bouder un débat lorsqu’il est intéressant. Les banques n’ont pas confiance dans la capitalisation, car c’est un système à cotisations définies.

Si elles avaient confiance dans ce système, elles proposeraient des systèmes à prestations définies. Or tel n’est pas le cas. Les banques font donc supporter les risques uniquement aux assurés, tandis qu’elles n’en prennent aucun.

Je m’étais promis de ne pas intervenir sur ce type d’amendements, car ils n’apportent en général pas grand-chose. Mais, en l’occurrence, je me sens non pas obligé, ...
Sourires sur les travées de l’UMP.

... mais tenu d’apporter mon concours.
Lorsque notre système de retraite par répartition a été créé à la Libération, il était fondé sur deux principes, l’un dépendant de l’autre : la solidarité, qui est le plus important, et l’obligation, ...

... principe lié au précédent.
L’alinéa 4 de l’article 1er concerne les systèmes de retraite « obligatoires », un mot que, selon moi, il aurait fallu écrire dans la loi. Cet article dispose toutefois que le choix de la retraite par répartition est « au cœur du pacte social qui unit les générations entre elles », ce qui signifie bien que ce régime est obligatoire.
Les auteurs de ces deux amendements adoptent deux points de vue complètement opposés. Ils ne prennent pas en compte ce caractère obligatoire, et s’éloignent donc du sujet qui nous intéresse dans cet alinéa.
En ce qui concerne le choix entre la répartition ou la capitalisation, chacun a raconté son histoire à sa façon. La capitalisation n’est pas un gros mot. Ce système a été employé – je l’ai dit dans mon intervention lors de la discussion générale – avant même le fonctionnement par répartition. Vous seriez surpris de constater qu’à la création du système par répartition, à la Libération, le sujet a été l’objet d’un débat intense et très difficile, parce que la capitalisation comptait des partisans, parmi lesquels la SFIO, la CGT et les mineurs.
Pourquoi les mineurs étaient-ils favorables à un système par capitalisation ? Parce qu’ils disposaient déjà d’un régime de retraite, fonctionnant par capitalisation, auquel ils tenaient. Les mineurs ont accepté le système par répartition et renoncé à la capitalisation, car ils ont obtenu en contrepartie que le régime ne soit pas unique.

Je tenais à faire ce rappel, parce que le souvenir de ces débats m’a été transmis au cours de conversations autour de la table familiale.

Nous sommes vraiment dans le vif du sujet et tous les éléments historiques abordés par nos collègues sont tout à fait intéressants. Il résulte de cette discussion qu’il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
Par cet amendement, nous vous proposons quelque chose de très simple : « Le système de retraite français est composé des régimes de base obligatoires par répartition, » – c’est une affirmation incontestable, largement partagée sur toutes nos travées –, « des régimes de retraite complémentaire obligatoire » – que l’on ne peut pas remettre en cause – « et, le cas échéant, des régimes par capitalisation à travers notamment l’épargne retraite collective ou individuelle ».
Nos concitoyens ont besoin de transparence et de confiance. Ce n’est pas le signe que vous leur donnez, madame le ministre, d’autant plus que la stabilité fiscale est régulièrement remise en cause par des mesures rétroactives portant sur ces placements. C’est dangereux, et cela effraie nos concitoyens.
Il est important, à travers cet article 1er et les objectifs qui y sont définis, de rappeler les efforts qu’ont faits certains et les garanties qu’ils doivent obtenir pour avoir une retraite décente.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Quand on entend nos collègues de l’UMP, je réalise que l’on a beau chasser le naturel, il revient au galop.
Marques d’approbation sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

J’accepte que l’on m’explique l’histoire des régimes de retraite, mais, en tout cas, la position de la gauche depuis la Libération est constante : nous sommes défavorables à un régime de capitalisation, fût-il marginal. Nous soutenons un régime par répartition, ce qui ne signifie pas que les Français ne placeront pas leurs économies, afin de mettre du beurre dans les épinards au moment de leur retraite. De tels placements ont toujours existé, mais ne correspondent en rien à la mise place d’un régime par capitalisation.
Quand une part de capitalisation vient compléter un régime par répartition, elle finit par le remplacer. Ceux qui doivent contribuer fortement trouvent en effet illégitime de payer pour les autres, puisqu’ils peuvent placer leur argent, ce qui leur apporte un rendement supérieur. Tous les exemples de système mixte ont fini par basculer vers des régimes où la part de capitalisation était majoritaire.

La seule chose qui a freiné cette dynamique, et qui vous a amenés à plus de modération, c’est la crise financière. Dans les autres pays, tous ceux qui avaient des retraites par capitalisation se sont effectivement retrouvés dépouillés. Vous êtes d’un seul coup plus nuancés, mais dès que la financiarisation repartira de l’avant, vous serez de nouveau pour la capitalisation.
Lorsque la retraite fonctionne par capitalisation, le système s’oriente fondamentalement vers la recherche d’un rendement élevé du capital, ce que l’on constate avec l’arrivée de fonds de pension en France. Il faut alors légitimer ce rendement maximal du capital au détriment du travail, au nom de la capitalisation. Pour financer les retraites de nos anciens, il faut exploiter les travailleurs d’aujourd’hui, afin que le prélèvement capitalistique soit supérieur au prélèvement sur le travail.
Lorsque le financement des retraites repose sur d’autres critères que la seule capitalisation, le système prélève des fonds sur l’ensemble des richesses produites par la nation, en particulier le travail – qui doit être mieux rémunéré –, pour financer les retraites. Il existe donc, de fait, une solidarité intergénérationnelle entre salariés et retraités. Les travailleurs en activité n’ont pas à subir un prélèvement plus important, afin d’assurer la rémunération du capital qui permet de verser leurs retraites aux anciens salariés.
Ce système est donc fondamental dans notre République depuis la Libération. La gauche et le parti socialiste sont hostiles à toute évolution vers un fonctionnement par capitalisation. Les dispositifs de capitalisation existants ne doivent pas être développés ni bénéficier d’aides fiscales. S’il n’est pas facile de revenir en arrière, il faut se garder de permettre le développement de la capitalisation, qui représente un danger mortel pour la répartition. Je voterai évidemment contre l’amendement proposé par M. Longuet.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Je voudrais m’inscrire dans la continuité de ce que vient de dire Mme Lienemann, à travers deux remarques.
Premièrement, un certain nombre de pays d’Europe centrale, ayant mis en place une part de capitalisation dans leurs retraites, comme vous le suggérez par cet amendement, reviennent sur ces réformes pour une raison simple : lorsque les ressources sont insuffisantes pour financer la part du système fonctionnant par répartition, les déficits publics se creusent au profit des citoyens bénéficiant d’un régime par capitalisation. Par conséquent, la capitalisation aggrave les déficits publics.
Deuxièmement, comment qualifier une société qui, au lieu d’appeler à la solidarité, dirait aux citoyens que le travail de toute une vie ne permet pas d’avoir le droit à une retraite décente ? Comment appeler une société où il faudrait que chacun pense à sa propre retraite en la constituant seul, sans compter sur la solidarité ? Il ne s’agirait plus réellement d’une société.

Si vous croyez à la valeur travail et à la solidarité, il faut absolument garder le fonctionnement par répartition, en l’affirmant clairement et précisément. Faire un tel choix témoigne que l’on croit à la valeur travail et que le travail fait progresser la société, pour assurer qu’à la fin d’une vie de travail le système sera capable de verser des retraites. On se refuse alors de dire aux travailleurs qu’ils doivent faire des économies chacun de leur côté, parce que la société ne leur garantit rien.
Quelle société voulez-vous finalement construire ? Une société solidaire ou une société égoïste ? Croyez-vous à la valeur travail ? Si tel est le cas, il faut reconnaître que le travail enrichit la société, permet la solidarité, et qu’il faut donc opter pour le système par répartition !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n° 11 rectifié bis, présenté par Mmes Lienemann et Claireaux et M. Rainaud, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il garantit à chaque génération un âge de départ offrant une durée de retraite au moins égale à la moitié de la durée de l’activité professionnelle.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

J’aurai l’occasion de le rappeler, je ne suis pas favorable à l’allongement de la durée des cotisations. J’ai déposé des amendements en ce sens, car j’y suis hostile depuis toujours.
Je rappelle à mes collègues que, dans l’opposition, je prends des orientations que j’estime réalisables par la gauche, une fois au pouvoir. Je formule donc toujours les mêmes critiques sur les réformes faites par MM. Balladur, Juppé, Raffarin et Fillon. Elles n’ont pas résolu les problèmes, ont accru les inégalités et affaibli les retraités. Je garde la même analyse.

Je reste fidèle à ce que j’ai toujours voté, conformément à mon opposition aux allégements de cotisations sociales, surtout dans un contexte de chômage massif des jeunes. Indépendamment de mon hostilité, je crains que cette mesure ne soit mise en place.
À l’instar de ce qu’a proposé mon collègue Jean-Marc Germain à l’Assemblée nationale, je pense qu’il faut prévoir un garde-fou pour le futur. Chaque génération doit avoir un âge de départ offrant une durée de retraite au moins égale à la moitié de la durée de l’activité professionnelle.
Vous me ferez la même réponse qu’à mon collègue Jean-Marc Germain, madame la ministre, en m’objectant que ce ratio est actuellement respecté en moyenne. Il faut néanmoins l’inscrire dans le texte de l’article 1er du projet de loi, parce que nous y fixons le cadre de notre régime de retraite et que, pour plusieurs raisons, ce qui est vérifié aujourd’hui ne le sera plus nécessairement demain.
Premièrement, en neuf ans, de 2001 à 2010, l’âge moyen de départ en retraite s’est élevé de deux ans. Dans la même période, nous n’avons pas tous gagné deux années d’espérance de vie. Un décalage se creuse donc entre l’allongement de l’espérance de vie et celui de la durée de l’activité professionnelle. Il s’agit d’un risque majeur : les textes proposaient d’affecter les deux tiers de l’allongement de l’espérance de vie à la durée de l’activité professionnelle contre un tiers seulement à la durée de retraite. A minima, il faudrait que 50 % de cette augmentation se traduise dans la durée de retraite.
J’ai l’impression que l’on découvre seulement maintenant une tendance pourtant séculaire. Depuis que l’humanité existe, on vit plus longtemps, et on travaille moins longtemps ! C’est le progrès humain ! Je ne vois pas pourquoi en 2009, 2010, 2011 ou 2014, il faudrait soudainement inverser cette donne, à rebours des positions historiques de la gauche. Cette dernière n’a jamais allongé ni la durée de cotisation ni le temps de travail. Pour résumer, les années de vie gagnées sont essentiellement consacrées au travail. Quel progrès !
Deuxièmement, la durée de vie moyenne diminue dans certains pays. Contrairement à une opinion répandue, plus la durée de l’activité professionnelle est longue, plus l’espérance de vie baisse. De surcroît, il faut prendre en compte que l’on vivra moins longtemps en bonne santé. J’évoquerai le sujet au moment de la discussion de l’article 2.
Comme l’espérance de vie risque de baisser et que la durée de cotisations devrait s’accroître, à long terme, une divergence entre la durée de l’activité professionnelle et la durée de retraite pourrait se faire jour.
Troisièmement, la durée de la vie active des jeunes est menacée. Effectivement, depuis les années 2008-2009, concomitamment à la montée en flèche du travail des seniors, le taux d’activité des autres actifs, et surtout des jeunes, baisse.
En conclusion, puisque nous serons obligés de travailler plus longtemps, le temps passé à la retraite sera proportionnellement grignoté par le temps passé au travail.
Personnellement, je me contenterai de la suppression de l’article 2. Dans la mesure où, selon moi, le projet de loi risque tout de même de conserver les dispositions relatives à l’allongement de la durée de cotisation, il est nécessaire, par précaution, de mettre en place le cliquet évoqué : la durée moyenne de la retraite doit être au moins égale à la moitié de la durée de l’activité professionnelle.

Madame Lienemann, vous proposez de garantir à chaque génération une durée de retraite au moins égale à la moitié de la durée de l’activité professionnelle.
Je vous signale que la prise en compte de l’espérance de vie est déjà prévue à l’alinéa 6 de l’article 1er du projet de loi. En outre, cette espérance fait partie des paramètres au regard desquels le comité de suivi formulera chaque année des recommandations publiques.
Dans ces conditions, la commission vous demande de retirer votre amendement ; si vous le maintenez, elle émettra un avis défavorable.
Madame Lienemann, j’ai bien entendu vos arguments et les objectifs que vous visez, mais, pour des raisons de cohérence, je sollicite le retrait de votre amendement et, si vous le maintenez, j’y serai défavorable.
Le projet de loi comporte, dans son article 1er, la réaffirmation du principe d’un système de retraite par répartition, dont il est rappelé avec la plus grande clarté qu’il repose sur l’équité et sur la solidarité.
En ce qui concerne la durée d’assurance, notre détermination va de pair avec l’attachement à trois principes : la prévisibilité, parce qu’il nous paraît absolument nécessaire que nos concitoyens sachent à quoi s’en tenir, la justice et l’équité. Oui, madame Lienemann, l’article 2 du projet de loi prévoit l’allongement de la durée de cotisation ; mais cet allongement est prévisible, puisqu’il se produira à partir de 2020 et à un rythme fixé par la loi, et il sera modulé selon les caractéristiques de la vie professionnelle.
Par ailleurs, cette hausse la durée de cotisation étant inscrite dans la loi, une éventuelle évolution en la matière, dans un sens ou dans l’autre, devrait être soumise au Parlement. En d’autres termes, si le comité de suivi des retraites instauré par l’article 3 peut formuler des recommandations portant sur cette durée, dans un sens ou dans l’autre – j’insiste sur cette précision –, toute décision supposerait l’adoption d’une loi.
Madame Lienemann, hormis la question de principe de l’allongement de la durée de cotisation, dont nous débattrons à l’article 2, vos objectifs sont satisfaits par le projet de loi : le principe de solidarité est réaffirmé, la lisibilité et la prévisibilité sont assurées, les caractéristiques de la carrière professionnelle seront prises en compte et le contrôle par le pouvoir politique sera garanti avec l’intervention nécessaire du Parlement. Par rapport à ce dispositif, votre amendement ne me semble pas apporter d’éléments nouveaux.

Oui, monsieur le président, car j’estime nécessaire de fixer des garde-fous pour éviter que le pouvoir politique, sous prétexte que l’argent manque, décide d’allonger la période de cotisation d’une durée supérieure à celle de l’allongement de l’espérance de vie. La disposition que je propose représente, à mes yeux, une balise a minima !
Je risque d’être assez seule, car j’imagine que nos collègues hostiles à l’allongement de la durée de cotisation pourraient être tentés de ne pas voter cet amendement. Néanmoins, je pense que je prends date pour l’histoire en défendant une mesure qui me paraît cohérente avec les combats que j’ai menés, et que le parti socialiste a menés, pendant de nombreuses années.

L’amendement n° 246 et l’amendement n° 11 rectifié bis font apparaître le décalage entre le pragmatisme, le réalisme, le bon sens et la rêverie.
L’amendement de bon sens déposé par Gérard Longuet affirmait la nécessité d’un système obligatoire par répartition, d’un système obligatoire de retraite complémentaire et, le cas échéant, d’un régime par capitalisation. Franchement, je suis surpris qu’on ait pu voter contre ; nul doute que ceux qui liront nos débats le seront aussi.
Voilà que, quelques instants plus tard, notre collègue Marie-Noëlle Lienemann, pour qui j’ai le plus grand respect, propose un système de son invention, à la fois audacieux et généreux. Il est audacieux puisqu’il consiste à décréter, par une disposition législative, que chacun doit avoir un temps de retraite au moins égal à son temps de travail.

Il est évidemment généreux, puisqu’il s’agit de donner une assurance-vie à toute personne à l’issue d’une carrière de 40 ans ou 42 ans, ce qui suppose un pouvoir considérable, que certains jugeront peut-être surnaturel… Pour ma part, ayant cotisé depuis l’âge de 18 ans, je peux envisager, si cet amendement est adopté, de vivre une longue retraite !

Soyez un peu réaliste : à tout instant, l’un d’entre nous peut disparaître. De grâce, donc, ne trompez pas l’opinion française en laissant entendre que la loi pourrait assurer à chacun une retraite paisible, d’une durée au moins égale à la moitié de sa vie active !

Madame Lienemann, je ne sais pas si vous prenez date pour l’histoire, mais je ne souscris pas à votre vision optimiste de l’histoire de l’humanité. En effet, je ne crois pas que cette histoire ait été, comme vous l’affirmez, un long mouvement vers la diminution du temps de travail et l’augmentation du temps passé en retraite dans le bonheur.
À la vérité, ma chère collègue, ce phénomène est extrêmement récent : il date du XIXe siècle et résulte des premières lois sociales…

… et de la mise en place, par Bismarck, des premières assurances sociales en Europe. Auparavant, on travaillait toute sa vie ou, lorsqu’on arrêtait, on ne bénéficiait d’aucune assurance sociale.
La vision d’une longue marche de l’humanité vers le temps heureux à la retraite ne correspond pas à la réalité ! Il a fallu attendre le XIXe siècle et, en ce qui concerne la France, la loi de 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes, fondée sur un système de capitalisation, qui a été combattue, si je ne m’abuse, par Jean Jaurès…

À présent, où en sommes-nous ? Là est la question importante, madame Lienemann ! Pour ma part, j’ai la conviction, même s’il faudrait s’en assurer, que le cliquet que vous proposez existe aujourd’hui dans les faits.
Du reste, je vous fais observer que les dispositions de l’article 2 du projet de loi, relatives à la durée de cotisation, sont plus protectrices que la législation de 2003. Celle-ci, en effet, prévoit le maintien d’un rapport constant entre le temps passé au travail et la durée de la retraite, mais d’une manière indéfinie : c’est un décret qui, pour chaque génération, lorsqu’elle atteint 58 ans, fixe la durée de cotisation.
Le présent projet de loi présente l’avantage de mettre un terme à ce mécanisme, à l’horizon de 2035. Il prévoit qu’à partir de la génération née en 1973, la durée de cotisation ne sera pas supérieure à 43 ans, alors que, dans le système issu de la réforme de 2003, comme Yannick Moreau l’a signalé dans son rapport, la génération née en 1989, par exemple, aurait pu être obligée de cotiser jusqu’à 44 années, sans avoir la certitude que le rapport que Mme Lienemann veut imposer par la loi serait respecté.
Ma chère collègue, le projet de loi va plus loin que la réforme de 2003 en mettant un terme à l’augmentation de la durée de cotisation. Votre amendement est donc satisfait et, en ce qui me concerne, je ne le voterai pas.

Je dois dire que nous sommes très intéressés par ce débat interne au parti socialiste.

Nos collègues ont l’immense mérite d’essayer de clarifier les engagements contradictoires pris lors de la campagne pour l’élection présidentielle de 2012.
Il faut reconnaître que l’intervention de Mme Lienemann avait quelque chose d’émouvant dans sa sincérité et dans sa fidélité aux engagements de 1982. Ces engagements ont été répétés, puis écartés, ou transmutés dans leurs conséquences, mais il y a un gardien de l’authenticité : c’est Mme Lienemann, et on ne peut pas lui adresser de reproche à cet égard !
En tout cas, son intervention nous montre que le régime de retraite par répartition n’offre pas toutes les sécurités louées par M. Leconte.
Nous sommes tout à fait d’accord pour reconnaître l’impératif de la solidarité.

En effet, pour instaurer une solidarité nationale dans le cadre d’une communauté républicaine, il faut un régime obligatoire de base.
Pour les retraites complémentaires, c’est déjà plus surprenant. Pourquoi diable sont-elles obligatoires ? MM. Caffet et Domeizel pourront peut-être nous en expliquer les raisons historiques. Pour ma part, je suis profondément convaincu que les retraites complémentaires sont nées du développement industriel des Trente Glorieuses : à une époque où la main-d’œuvre était rare, il a fallu la drainer vers des activités nouvelles pour nombre de nos compatriotes. Aussi a-t-on on a mis en place cet effort, généralisé à tous les secteurs, si je me souviens bien, dans les années 1970.
Seulement, le principe d’un régime par répartition, c’est qu’on ne peut payer que ce que l’on gagne. Or pour gagner quelque chose, il faut des cotisants, qui perçoivent des revenus suffisants pour dégager des marges. C’est une vérité que certains, accrochés à l’idée que la répartition garantit tout, ne veulent pas accepter.
Que se passe-t-il si la démographie régresse, ce qui peut se produire ? À ce jour, le renouvellement des générations n’est pas assuré dans notre pays. Sans doute, la France gagne de la population, mais c’est surtout par l’allongement de la durée de la vie ; qu’elle gagne de la population par le solde démographique n’est pas certain.
Sans compter qu’il existe un phénomène extrêmement préoccupant, sous-estimé par nos collègues de la majorité : la France, terre d’immigration, est devenue aussi une terre d’émigration. C’est ainsi que plus de 300 000 Français vivent aujourd’hui à Londres : ils ne sont pas des millionnaires ou des milliardaires, ni de riches rentiers qui fuient l’ISF, mais de jeunes actifs issus des écoles d’ingénieurs et des écoles de gestion, ou qui ont simplement leur enthousiasme pour réussir.
Ces jeunes, dont nous avons financé la formation, ont décidé d’aller tenter leur chance ailleurs ; qui nous prouve que cet exode des talents ne va pas se prolonger durablement, au détriment des forces vives de notre pays ?
Comment pourrez-vous alors assurer la répartition, si vous n’avez pas fait l’effort de réfléchir à des formules complémentaires ? Si vous n’avez pas la volonté d’attirer les capitaux ? Après tout, ce mot n’est pas grossier !
Mme Cécile Cukierman proteste.

Je sais que vous n’êtes pas capitaliste, ma chère collègue. Le livre de Marx sur cette notion est d’ailleurs absolument passionnant. Simplement, il faudrait choisir entre le rendement décroissant du capital, que nous servent les sociaux-démocrates, et l’accumulation croissante et indéfinie des capitaux, que nous servent les marxistes de stricte obédience.

La vérité, c’est que les emplois modernes nécessitent des capitaux. Or il n’y pas de capitaux sans épargne et il n’y a pas d’épargne sans incitation à une épargne de retraite par capitalisation.
Madame Lienemann, je le crains, la véritable réponse à votre demande consiste soit en l’abandon des thèses socialistes traditionnelles, soit en l’acceptation d’une nouvelle réalité : le taux de remplacement des revenus, et non plus le montant des cotisations, devient la variable d’ajustement, ce qui permet de préserver, comme vous le souhaitez, le ratio de un à deux.
Ce n’est pas un cadeau que vous faites aux futurs retraités !
Très bien ! et applaudissements sur les travées de l’UMP.

Permettez-moi une remarque, cher collègue Gérard Longuet. Vous parlez du départ des talents. Pour ma part, je dis que nous devons aussi accueillir les talents des autres pays, car nous avons tendance à nous refermer sur nous-mêmes !

On exporte des bac+5 ! Je ne suis pas sûr que l’on importe au même niveau !

Si vous trouvez qu’on accueille bien, aujourd’hui, les étudiants étrangers, vous avez une vision optimiste de la situation ! En réalité, il y a beaucoup à faire.

Je ne suis pas sûr d’être d’accord avec l’amendement n° 11 rectifié bis, qui vise à mettre en place une prestation définie. Un tel dispositif rejoint celui qui a été proposé par le groupe CRC, lequel souhaite que le temps de retraite corresponde a minima à la moitié du temps travaillé.
Quoi qu’il en soit, nous devons conserver, et je rejoins les auteurs de ces amendements sur ce point, une volonté de progrès social. Car la situation est pour le moins extraordinaire ! Est-il nécessaire de travailler autant qu’il y a un siècle ? Faut-il revenir en arrière ? Travailler le samedi et le dimanche ? Ne plus compter les heures supplémentaires, mais les considérer comme des heures normales ? Travailler plus longtemps ? En avons-nous vraiment besoin ?
On pourrait répondre par l’affirmative, comme le fait d’ailleurs notre collègue Jean-Pierre Caffet, rapporteur pour avis de la commission des finances. Il a indiqué tout à l’heure quel aurait été le déficit des retraites s’il n’y avait pas eu de réformes. Certes ! Mais n’oublions pas le déficit de l’assurance chômage. Ainsi, pendant qu’on faisait travailler les gens plus longtemps pour, justement, réduire le coût du système des retraites, le coût de l’assurance chômage, quant à lui, a explosé. Il a fallu prévoir des cotisations supplémentaires et une moindre indemnisation des chômeurs, ce qui a amputé leur pouvoir d’achat. Une partie de l’économie en a souffert.
Par conséquent, avons-nous vraiment besoin de travailler autant qu’il y a cinquante ans ? N’y a-t-il pas eu des améliorations permettant aux industries de produire des biens manufacturés avec moins d’heures de travail ? L’informatique ne nous a-t-elle pas dégagés d’un certain nombre de tâches répétitives ? Certes, nous avons besoin de services supplémentaires dans la santé et l’éducation, domaines, où, au contraire, on n’a de cesse de vouloir réduire les effectifs !
Le monde tourne à l’envers ! On a réalisé des gains de productivité dans les services informatiques et dans le monde industriel, mais on ne sait pas les utiliser ! En revanche, là où il faudrait créer des emplois, c’est-à-dire dans l’éducation, la culture ou la santé, on préconise des réductions de personnels, afin de réaliser des économies.
Franchement, la gauche et les écologistes ne peuvent pas se contenter, face à un tel système, qui laisse 10 % des gens au chômage, de dire : il faut travailler plus ! Nous devons prendre à bras-le-corps cette conception de la société. Je n’oublie pas, bien sûr, que nous sommes dans une période de crise. Mais celle-ci est créée par les banques, par un système économique qui nous asphyxie, par un transfert important des ressources vers le capital.
Amis de gauche, un sursaut est nécessaire ! Le progrès social, c’est une notion qui existe encore ! Avons-nous besoin de plus de temps aujourd’hui pour construire des immeubles ? Bien sûr que non ! Conservons donc ces idées de progrès et d’avancées sociales !
Je comprends, chers collègues de l’UMP, que vous ne vous sentiez pas associés à cette discussion. Nous discutons en effet entre personnes partageant un idéal humain, une rêverie, une utopie, je vous l’accorde. C’est cela qui fait avancer l’histoire sociale !
Applaudissements sur certaines travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n° 32, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La solidarité intergénérationnelle passe par une politique de l’emploi favorisant notamment l’intégration sociale et professionnelle des jeunes, le remplacement des salariés partant en retraite, la reconnaissance des qualifications initiales et acquises, la prise en compte de la pénibilité des tâches et des métiers.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Par cet amendement, nous souhaitons compléter l’alinéa 4 de l’article 1er, en rappelant que notre système de protection sociale et le régime de retraite qui lui est associé reposent sur une double solidarité.
Il s’agit tout d’abord d’une solidarité intergénérationnelle. L’une des spécificités de notre modèle social est que son financement repose sur des cotisations sociales, prélevées sur la valeur ajoutée, mises en commun au sein d’un organisme n’appartenant pas à l’État, mais aux travailleurs eux-mêmes. Personne n’est donc propriétaire de ces cotisations et les quatre branches qui constituent la sécurité sociale obéissent à des règles assurantielles très différentes de celles qui sont applicables au secteur marchand.
Elles se distinguent notamment des régimes de retraite complémentaire, nous en avons déjà beaucoup discuté, en ce sens que, dans ces derniers, les cotisations alimentent un compte individuel ouvrant des droits exclusivement en fonction des apports personnels en capital.
À l’inverse, notre système de protection sociale repose sur le principe d’une mise en commun, dont le fruit sert à financer les retraites des aînés. De cette sorte, ces derniers peuvent prétendre, lors du passage de l’activité à la retraite, à un bon niveau de vie leur permettant de vivre dignement, et aussi de consommer. Or c’est cette consommation qui permet à l’économie française de fonctionner, en engendrant des commandes et, donc, des emplois.
Ce mécanisme de solidarité intergénérationnelle met ainsi en place une boucle vertueuse que ne permettent pas les retraites par capitalisation, lesquelles, à l’inverse, individualisent à l’extrême, empêchant ainsi toute solidarité.
Ce mécanisme de solidarité entre les générations est d’autant plus important qu’il repose sur un pacte social, nous l’avons rappelé, permettant à toutes et tous de prendre leur place dans la société tout au long de leur vie et de s’y épanouir.
Anne-Marie Guillemard, sociologue, professeur à l’université Paris V René Descartes, membre de l’Institut universitaire de France, décrit ainsi ce pacte : « un temps d’inactivité pensionné a été accordé à la vieillesse sous forme de retraite, en échange de quoi les jeunes adultes et les adultes se réservaient l’emploi de manière stable et durable, après une courte période de formation. »
C’est précisément pourquoi, nous aurons l’occasion d’y revenir et d’en débattre au moment de l’examen de l’article 2, l’allongement de la durée de cotisations constitue à nos yeux une mesure inefficace et injuste, car elle contraint les salariés les plus âgés à travailler plus longtemps et, en même temps, empêche les plus jeunes d’accéder à l’emploi, rompant ainsi ce lien de solidarité intergénérationnelle.
L’argument mathématique que l’on a entendu ce soir, selon lequel l’allongement de l’espérance de vie rendrait légitime le relèvement de la durée de cotisations, élude en réalité le débat majeur qu’il nous faut avoir, d’un point de vue économique comme sociétal : celui de l’évolution de la répartition des temps de travail et d’inactivité dans le parcours des âges.
Qui plus est, notre système repose également sur une solidarité entre les actifs eux-mêmes, la mutualisation des cotisations sociales permettant de garantir aux salariés les plus précaires et les moins bien rémunérés que, le temps de la retraite venu, ils pourront, grâce à cette mise en commun, bénéficier d’un mécanisme redistributif leur garantissant une pension minimale.
C’est bien ce double système de solidarité que nous voulons préserver et réaffirmer par cet amendement.

Chère collègue Cécile Cukierman, de manière plus concrète que ce que vous avez dit, cet amendement vise à préciser les caractéristiques que doit revêtir la politique de l’emploi pour servir la solidarité entre les générations.
Il a semblé à la commission qu’il était effectivement important d’apporter une telle précision. Elle a donc émis un avis favorable, sous réserve de l’insertion de cette disposition après l’alinéa 6 plutôt qu’après l’alinéa 4.

Madame Cukierman, que pensez-vous de la suggestion de Mme la rapporteur ?

Je suis donc saisi d’un amendement n° 32 rectifié, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La solidarité intergénérationnelle passe par une politique de l’emploi favorisant notamment l’intégration sociale et professionnelle des jeunes, le remplacement des salariés partant en retraite, la reconnaissance des qualifications initiales et acquises, la prise en compte de la pénibilité des tâches et des métiers.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement ainsi rectifié ?
Le Gouvernement était plutôt défavorable à cet amendement, car il estimait une telle précision redondante…

Je n’avais pas l’intention de prendre la parole sur cet amendement. Toutefois, après avoir écouté sa présentation par notre excellente collègue Cécile Cukierman, j’ai souhaité à la fois réagir sur ce que j’estime être une inexactitude et, puisque notre collègue a évoqué le difficile problème de l’emploi des jeunes, apporter la démonstration que son refus de la capitalisation est un mauvais service qu’elle rend aux jeunes.
Certes, l’étymologie du mot capitalisation renvoie au mot latin caput, capitis, qui signifie la tête. Pourtant, rien n’interdit qu’un système collectif capitalise l’épargne de l’ensemble de ses adhérents. Il n’y a donc pas nécessairement une individualisation. Au contraire, c’est l’absence de régime de capitalisation organisé par la loi – certains existent actuellement, mais sont, de notre point de vue, trop marginaux –, qui aboutit à des efforts strictement individuels. Ceux de nos compatriotes qui veulent consolider leur épargne le font en effet dans un schéma souvent personnel, alors que des systèmes collectifs d’entreprise existent et que des systèmes collectifs plus larges devraient exister.
L’individualisme et l’égoïsme ne constituent pas les compléments nécessaires de la capitalisation. Au contraire, la possibilité de systèmes collectifs existe. Si 40 % des entreprises du CAC 40 sont détenues par des investisseurs étrangers, une bonne partie de ces 40 % appartient à des fonds de retraite de pensionnés. Le plus connu d’entre eux, le fonds de retraite des enseignants californiens, qui n’a rien d’individualiste, est un mouvement collectif faisant en sorte que les retraités californiens bénéficient de la croissance dans le monde, y compris en France, ce qui prouve qu’il ne faut pas être défaitiste sur l’image de nos entreprises ! Il est vrai, celles du CAC 40 travaillent, pour l’essentiel, en dehors de France.
Mme Marie-Noëlle Lienemann proteste.

Mais revenons au problème des jeunes, qui nous mobilise à l’occasion de l’examen de cet amendement. Pour créer des emplois, on le sait, il faut des capitaux. Les machines-outils d’aujourd’hui sont non plus le tour, la machine à coudre, …

… ou la débiteuse du scieur, mais des tours numériques à douze têtes qui valent chacun, par emploi créé, de 300 000 euros à 500 000 euros. Si nos entreprises n’ont pas de capitaux, si elles ne peuvent pas s’adresser à des prêteurs de long terme souhaitant leur succès, elles ne pourront pas financer en France les emplois d’avenir.
Je suis, hélas, un parlementaire déjà ancien, seule la confiance des électeurs explique ma longévité. Or je constate que, là où il fallait, voilà trente ans, 20 000 euros pour créer un emploi, il en faut aujourd’hui, entre l’outil de travail et le fonds de roulement, plusieurs centaines de milliers.
Si vous n’organisez pas au plan national un système de drainage de l’épargne de long terme vers l’emploi industriel, vous jeunes n’auront pas d’emploi en France…

… et les meilleurs d’entre eux iront les chercher à l’étranger, ce qui affaiblira d’autant le potentiel du système de retraites par répartition, qui n’est pas intangible, mais peut être également menacé.
C’est la raison pour laquelle, ma chère collègue, si vous voulez aider à l’emploi des jeunes, aidez à l’investissement dans les entreprises et à une orientation de l’épargne de long terme vers des investissements productifs, par la capitalisation collective.

Mme Cécile Cukierman. Mon cher collègue, je suis tout de même un peu surprise par votre réponse. Tout d’abord, mes collègues du groupe CRC et moi-même ne sommes pas les utopistes que vous décrivez – et personne ne l’est dans cet hémicycle.
M. Gérard Longuet s’exclame.

Mon cher collègue, les reproches que vous nous faites sont en léger décalage par rapport au contenu de l’amendement et par rapport à la présentation que j’en ai faite. Sur le fond, vous êtes en décalage complet par rapport à nos positions sur l’emploi des jeunes. Bien évidemment, il faut investir, mais il faut aussi s’interroger sur le système de retraite par répartition et par capitalisation. C’est bien sur ce sujet que nous ne sommes pas d’accord. Je dis que le système par capitalisation impose une approche individualisée ; pour autant, je n’ai pas parlé d’égoïsme : c’est vous qui l’interprétez ainsi. Pourquoi ? Parce que l’individualisation entraîne l’égoïsme ? C’est vous qui faites cet amalgame.
En revanche, un jeune qui voudrait bénéficier d’une retraite par capitalisation doit effectivement pouvoir capitaliser. Jusque-là, nous sommes d’accord. Il faut qu’il ait un travail et qu’il perçoive des revenus suffisamment importants à la fois pour satisfaire ses besoins et couvrir ses dépenses, souvent plus importantes au début d’une vie professionnelle qu’à la fin. Soit il peut capitaliser, si sa situation le lui permet, soit il ne peut pas, auquel cas il le paiera toute sa vie. À mesure qu’il avancera dans sa vie professionnelle et qu’il vieillira, le décalage ne fera que s’accroître, rompant ainsi avec le principe de solidarité entre les générations et de solidarité entre les actifs que nous défendons avec cet amendement.
De fait, nous soutenons des projets de société différents. Nous voulons non pas renier, mais préserver et réaffirmer ce principe de solidarité. Comme d’autres ici, mes collègues du groupe CRC et moi-même estimons que le progrès, ce n’est pas de vivre plus longtemps pour travailler plus longtemps, c’est de pouvoir travailler moins longtemps pour vivre plus longtemps, pour le bénéfice de toute la société !
Applaudissements sur les travées du groupe CRC . – Mme la présidente de la commission applaudit également.
L’amendement est adopté.

L’amendement n° 33, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les assurés bénéficient d’un traitement équitable au regard de la durée de la retraite comme du montant de leur pension, quels que soient leur sexe, leurs activités et parcours professionnels passés, les régimes dont ils relèvent et la génération à laquelle ils appartiennent. Tout est mis en œuvre pour leur garantir l’allongement de leur espérance de vie en bonne santé.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

La référence à l’espérance de vie en bonne santé ne nous semble pas pertinente dans cet alinéa. En effet, celui-ci prévoit que « les assurés bénéficient d’un traitement équitable au regard de la durée de la retraite comme du montant de leur pension […] ». Or ce traitement équitable doit être la réalité, quelle que soit l’espérance de vie qui reste aux salariés, que celui-ci soit ou non en bonne santé. Maintenir cette disposition reviendrait à dire, a contrario, que le traitement pourrait être inéquitable en fonction de la qualité de l’espérance de vie des salariés.
La volonté du Gouvernement a sans doute été de mettre en lumière son attachement à la notion d’espérance de vie en bonne santé, ce qui est louable. Mais alors, il serait plus juste de dire que l’objectif de notre système de retraite est de garantir à tous un allongement de l’espérance de vie en bonne santé et non pas un traitement équitable en fonction de l’espérance de vie.
Nous serons tous d’accord pour reconnaître que, pour profiter de la retraite, il ne suffit pas d’être vivant.

Ma chère collègue, votre amendement vise à garantir aux assurés les moyens mis en œuvre pour allonger leur espérance de vie en bonne santé. L’objectif d’un tel allongement n’est pas en soi un objectif du système de retraite, mais plutôt un objectif des politiques de santé publique, à la fois en matière de prévention et de soins. Pour cette raison, la commission émet un avis défavorable.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.

Je voudrais citer quelques chiffres pour que l’on comprenne bien de quoi nous parlons.
Depuis quelques années, la France connaît un recul de ce qu’on appelle « l’espérance de vie sans incapacité », selon une étude de l’Institut national d’études démographiques d’avril 2012. Cette étude compare les données des 27 pays que comptait alors l’Union européenne. Si l’on se concentre sur le cas de la France, on observe qu’en 2010, les hommes pouvaient espérer vivre en bonne santé 79, 1 % de leur espérance de vie totale, soit 78, 2 ans, contre 80, 6 % en 2008. Les femmes pouvaient espérer vivre en bonne santé 74, 4 % de leur existence, contre 76, 1 % en 2008. Dit autrement, l’espérance de vie sans incapacité des hommes est de 61, 9 ans en 2010 et de 63, 5 ans pour les femmes.
Si nous poussons l’examen encore un peu plus loin, nous constatons que les inégalités sociales face à la mort, elles, persistent également. L’écart d’espérance de vie entre les hommes cadres et ouvriers est de 6, 3 années. Les hommes cadres de 35 ans peuvent espérer vivre encore 47 ans, soit jusqu’à 82 ans, et les hommes ouvriers 41 ans, soit jusqu’à 76 ans.
L’écart existe de la même manière pour les femmes. L’espérance de vie d’une femme cadre de 35 ans est de 52 ans, soit jusqu’à 87 ans, tandis que celle d’une ouvrière n’est que de 49 ans, soit jusqu’à 84 ans. Si bien que l’espérance de vie des ouvrières d’aujourd’hui correspond à celle des femmes cadres au milieu des années 1980.
II y a trois ans, nous étions unis pour rappeler cette évidence ; nous pourrions l’être encore aujourd’hui. C’est la raison d’être de notre amendement.

Il serait tout de même assez curieux d’introduire dans la loi, par le biais d’un amendement, une disposition selon laquelle tout est mis en œuvre pour garantir à nos concitoyens l’allongement de leur espérance de vie en bonne santé. Encore heureux ! On ne va quand même pas prendre des mesures qui iraient dans le sens contraire ! Véritablement, ce serait un leurre de leur faire croire que, au terme d’un débat parlementaire, on pourrait répondre à cette préoccupation naturelle et légitime qu’est l’accroissement de l’espérance de vie en bonne santé. Faisons preuve d’une grande humilité dans notre approche de cette question.
Effectivement, des facteurs de risque ont été relevés, responsables d’une diminution de la longévité. On pense bien sûr au cholestérol, même si des efforts considérables ont été faits pour réduire l’artériosclérose, on pense à la lutte contre l’hypertension artérielle, contre le tabagisme, contre l’alcoolisme, autant de facteurs sur lesquels la société peut agir par des mesures de prévention, par l’éducation de nos concitoyens de façon qu’ils n’altèrent pas leur espérance de vie. L’hygiène de vie contribue à allonger la durée de vie.
Il existe néanmoins d’autres facteurs de risque, incontournables, en particulier l’âge, bien évidemment. De fait, il faut combattre un certain nombre de préjugés.
Je le répète, l’espérance de vie de nos concitoyens est aussi liée à leur hygiène de vie.

On ne peut pas considérer que le travail influe particulièrement sur l’espérance de vie plus que d’autres facteurs, en particulier ceux que j’ai cités.
C’est la raison pour laquelle nous ne soutenons pas cet amendement qui, par le débat qu’il suscite, loin d’informer nos concitoyens en toute transparence, entretient en réalité ce fantasme selon lequel il serait possible d’agir, d’un coup, sur l’espérance de vie de nos concitoyens.
Mouvements de désapprobation sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste.

Je vais contredire notre collègue.
Il faut distinguer deux sujets : l’espérance de vie, qui est un enjeu de santé publique, c’est incontestable, et l’espérance de vie en bonne santé, qui soulève la question de la pénibilité des conditions de travail.
Dominique Watrin ne me contredira pas : les conditions de travail des mineurs de fond qui sont morts à cinquante ans des suites d’une silicose ou d’une anthracose ont eu une influence sur leur espérance de vie. La très grande majorité d’entre eux n’ont pas bénéficié du tout de leur retraite.
La rédaction de l’amendement de nos collègues, qui introduit la notion de la pénibilité dans les conditions de travail, me paraît plus explicite que celle de l’alinéa 5. C’est pourquoi je voterai cet amendement.

Mon cher collègue Savary, vos propos me surprennent. Vous dites que l’espérance de vie dépend de l’hygiène de vie. Cela signifie donc, selon vous, que les cadres ont une meilleure hygiène de vie que les ouvriers, si l’on en juge par les statistiques qui viennent d’être citées.

On le voit bien en réalité : les conditions de travail ont une incidence sur l’espérance de vie.
Voilà bien la différence entre la droite et la gauche. Moi, monsieur Longuet, je suis marxiste, car je ne crois pas simplement à la volonté individuelle.

Mais si ! Vous dites qu’on vit plus longtemps si l’on a une bonne hygiène de vie. Sauf que l’espérance de vie des ouvriers est inférieure de dix ans à celle du reste de la population ! Comment l’expliquez-vous ? Ce n’est pas simplement parce que leur hygiène de vie est moins bonne, c’est parce que leurs conditions de travail sont plus pénibles, …

… parce qu’ils touchent de bas salaires, en effet, parce que leurs conditions sociales sont mauvaises. Vous, vous donnez une explication individuelle ; quant à nous, à gauche, par tradition, nous mettons en avant des explications sociales et sociologiques.
C’est bizarre, les enfants d’ouvriers fréquentent moins l’université que les enfants de cadres ! Sans doute une question d’hygiène culturelle…
Rires sur les travées du groupe CRC.

Bien sûr, tous les ouvriers et tous les cadres ne sont pas logés à la même enseigne, mais les pesanteurs sociales sont une réalité. C’est ce que dénoncent les auteurs de cet amendement.
L’amendement est adopté.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mardi 29 octobre 2013 :
À neuf heures trente :
1. Questions orales
Le texte des questions figure en annexe.

À quatorze heures trente et le soir :
2. Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, garantissant l’avenir et la justice du système de retraites (n° 71, 2013-2014) ;
Rapport de Mme Christiane Demontès, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 95, 2013-2014) ;
Rapport d’information de Mme Laurence Rossignol, fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes (n° 90, 2013-2014) ;
Résultat des travaux de la commission (n° 96, 2013-2014) ;
Avis de M. Jean-Pierre Caffet, fait au nom de la commission des finances (n° 76, 2013-2014).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le mardi 29 octobre 2013, à zéro heure quinze.