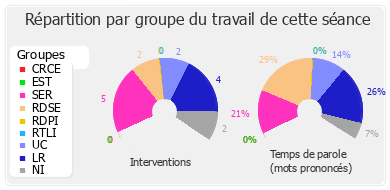Séance en hémicycle du 24 mars 2015 à 14h30
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à douze heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Claude Bérit -Débat.

La séance est reprise.

Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, un terrible accident aérien est survenu ce matin dans les Alpes-de-Haute-Provence.
De nombreuses victimes sont à déplorer.
À la demande de M. le président du Sénat, le Sénat tout entier s’associe à la douleur des familles cruellement touchées par cette catastrophe.
Nous pouvons avoir une pensée de recueillement à la mémoire des personnes décédées. (

Les circonstances tragiques que je viens d’évoquer requièrent la présence sur les lieux du secrétaire d’État chargé des transports, M. Alain Vidalies, qui devait représenter le Gouvernement lors de deux de nos débats de cet après-midi : celui sur l’avenir industriel de la filière aéronautique et spatiale face à la concurrence et celui sur les risques inhérents à l’exploitation de l’huître triploïde.
En accord avec les groupes CRC et écologiste, qui les avaient respectivement demandés, ces deux débats sont reportés à une date ultérieure.

L’ordre du jour appelle le débat sur le thème : « Internet et la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse », organisé à la demande du groupe du RDSE.
La parole est à M. Jacques Mézard.

au nom du groupe du RDSE. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, même s’il intervient entre les deux tours d’une élection, ce débat, qui porte sur un sujet appelant la prise de décisions dans les mois à venir, nous paraît important.
Entre la couverture par les médias des drames de janvier – pour laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a relevé trente-six manquements justifiant des mises en demeure – et la multiplication des messages d’apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux, les dérives et incertitudes pesant sur la liberté d’expression ont été mises au jour.
Acquis démocratique majeur, la liberté d’expression sert aujourd’hui de parapluie nucléaire à toutes sortes d’idées et de manipulations. Lieux de sociabilité, les réseaux sociaux sont souvent détournés et sont parfois devenus des lieux de perdition pour une partie de notre jeunesse, en servant de relais à la propagande djihadiste ou aux théories « conspirationnistes ».
À l’ère du numérique, la rumeur, fama, est devenue infâme et gangrène nos valeurs et notre confiance en la puissance publique, en essaimant son poison de manière exponentielle. Face à cela et au déploiement de la théorie du complot – la ministre de l’éducation nationale en a d’ailleurs parlé à juste titre il y a quelques semaines –, plusieurs condamnations « pour l’exemple » ont été prononcées à l’encontre d’individus ayant fait l’apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux. Mais, selon une étude publiée au début du mois de mars, entre 46 000 et 90 000 comptes Twitter ont été utilisés à l’automne dernier pour diffuser la propagande de l’État islamique : un travail herculéen pour nos services de police et de renseignement transformés en Sysiphe…
La liberté d’expression, pharmakon démocratique, contient en elle à la fois son poison et son médicament. De nombreux textes nationaux et internationaux la protègent. L’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, auquel notre groupe est profondément attaché, la range parmi les « droits les plus précieux de l’homme », au fondement même de nos démocraties libérales. Cependant, cette liberté – comme toute liberté – s’arrête là où commence celle des autres : « tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté ».
Or si les textes limitant la liberté d’expression s’appliquent de plein droit à l’expression sur internet, leur efficacité pose aujourd’hui question. La loi de 2004 a étendu aux éditeurs de services de communication au public en ligne le champ d’application du chapitre IV de la loi de 1881, qui punit notamment la provocation aux crimes et délits, en particulier la provocation à la discrimination ou à la haine en raison de l’origine, de la religion ou de l’orientation sexuelle.
Plus radicalement encore, internet redéfinit les contours de la liberté d’expression, tant pour les journalistes que pour les simples citoyens, en rendant caducs certains moyens d’intervention des pouvoirs publics. Votée sous la IIIe République – celle-là même à laquelle nous devons et tenons tant –, la loi de 1881 avait été conçue comme une « loi d’affranchissement et de liberté ». Elle révolutionnait la logique des textes précédents, qui prévoyaient des systèmes de contrôle préalable d’autorisation et de censure.
Jusqu’à l’émergence d’internet, il y avait parfaite superposition entre la forme d’expression, le moyen technique employé et le régime juridique : la presse, diffusée sous la forme de journaux imprimés, est régie par loi du 29 juillet 1881 ; la communication téléphonique est régie par le code des postes et télécommunications ; enfin, la communication audiovisuelle est régie par la loi du 30 septembre 1986.
L’émergence d’internet, qui a démultiplié à l’infini l’information, a remis en cause ces distinctions traditionnelles, puisque le même médium permet de diffuser des contenus relevant de la correspondance privée, de la presse ou de l’audiovisuel. Ces spécificités conduisent donc à s’interroger, d’une part, sur ce qui relève pour les journalistes et les citoyens du droit à l’information, et, d’autre part, sur l’efficacité des mesures prises par les pouvoirs publics à l’encontre des contenus illicites. La protection des personnes privées est pour nous quelque chose de très important. En tant qu’élus, nous connaissons les attaques sous pseudonyme : jusqu’à quand allons-nous tolérer tout et n’importe quoi ?
En ce qui concerne plus particulièrement les contenus illicites, nous avions eu ce débat lors de l’examen, en novembre dernier, de la loi visant à renforcer la lutte contre le terrorisme. Les délits de provocation à la commission d’actes terroristes et d’apologie du terrorisme ont été transférés de la loi de 1881 au code pénal, au motif que ces actes ne constituent plus essentiellement un abus de la liberté d’expression, mais plutôt un maillon dans la chaîne des activités des groupes terroristes. Cela permettait aussi d’exercer des poursuites en dehors du régime procédural contraignant, et donc protecteur de la liberté d’expression, de la loi de 1881.
Faut-il considérer que l’intégralité des infractions commises par le biais d’internet et des réseaux sociaux doit être soumise à un régime dérogatoire à la loi de 1881 ? C’est là un débat qu’il est urgent et nécessaire d’ouvrir. Nous ne le ferons pas aujourd’hui, mais il importe de définir rapidement des solutions respectueuses de la liberté de chacun. À tout le moins, il faudra que le législateur s’empare sans ambages de ces problématiques touchant au numérique, de manière systématique et sectorielle.
Une autre question est celle du rôle des acteurs d’internet. La loi de 2004 pour la confiance dans l’économie numérique a créé un régime marqué par une grande liberté pour les acteurs d’internet. À la différence de ce que prévoit le régime de la communication audiovisuelle, l’édition d’un contenu numérique n’est pas soumise à autorisation préalable et aucune obligation ne s’impose a priori aux fournisseurs de contenus.
Deux catégories d’acteurs sont définies dans cette loi.
Les éditeurs de services sur internet, en premier lieu, sont soumis à un régime voisin de celui de la presse : ils n’ont aucune obligation de déclaration préalable ou d’autorisation ; les seules limites à leur liberté d’expression sont celles que définit le chapitre IV de la loi de 1881, les infractions étant poursuivies et réprimées ; ils doivent désigner un directeur de publication et un droit de réponse est prévu par la loi, qui transpose à internet le régime défini par l’article 13 de la loi de 1881.
Les hébergeurs, en second lieu, bénéficient d’un régime de responsabilité civile et pénale atténué par rapport à celui des éditeurs. Ils sont, en effet, considérés comme n’exerçant pas de contrôle sur les contenus accessibles par le biais des sites hébergés. Par conséquent, il est très difficile d’engager leur responsabilité.
La loi de novembre 2014 a étendu le champ d’application des obligations des fournisseurs d’accès et des hébergeurs en matière de signalement des contenus illicites. En outre, elle a créé une possibilité de blocage administratif des sites internet faisant l’apologie du terrorisme.
Les premiers blocages de sites ont eu lieu il y a quelques jours, non sans quelques difficultés prévisibles, du fait notamment de l’absence de contrôle par le juge. Ce blocage ne fut que partiel. Certains opérateurs français, et non des moindres, n’ont pas appliqué le dispositif du Gouvernement. Par ailleurs, de nombreuses stratégies de contournement existent, permettant à certains internautes et aux propagandistes de jouer au chat et à la souris avec les pouvoirs publics. Liberté d’expression contre censure : l’opposition simpliste brandie par une certaine propagande est flatteuse pour ceux qui se réclament de la première…
La domiciliation de beaucoup d’acteurs d’internet à l’étranger complique encore toute action. Si certains réseaux sociaux, comme Twitter, ont défendu une conception radicalement libérale de la liberté d’expression avec la doctrine de freedom of speech, l’idée qu’une trop grande liberté d’expression permet de se dérober à ses responsabilités se fait jour…
La diffusion sur internet de vidéos insoutenables qui visent à enrôler de nouveaux djihadistes, qui glorifient les terroristes, qui les montrent exécutant leurs victimes, relève-t-elle vraiment de la liberté d’expression ? Avec plus d’un milliard d’utilisateurs pour Facebook et plusieurs centaines de millions pour Twitter, les grandes plateformes du web sont érigées en arbitres de la liberté d’expression et doivent assumer leur rôle.
Si les pouvoirs publics peuvent inciter les plateformes à mettre en œuvre des mesures de surveillance générale des contenus, la légitimité de cette intervention d’acteurs privés pose question : peut-on parler de privatisation de l’exécution de la loi, ce qui serait à nos yeux inacceptable ? Le départ entre le droit à l’excès, à l’outrance et à la parodie à des fins humoristiques, d’un côté, et l’apologie au terrorisme, de l’autre, devra-t-il être fait par des acteurs privés ?
Dans ce combat de David contre Goliath à l’ère numérique, le juge français a ainsi dû déterminer si le fait qu’un site proposant un contenu en infraction avec la loi soit accessible depuis la France suffisait pour considérer que l’infraction avait été commise sur le territoire national. Nos juridictions pénales ont d’abord considéré que l’accessibilité depuis la France du site internet suffisait à fonder la compétence du juge français. À l’inverse, la Cour de cassation juge aujourd’hui que le site internet en cause doit être destiné au public français pour que le juge français soit compétent.
Récemment, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré abusive une clause de compétence signée par les utilisateurs de Facebook et précisant que, en cas de litige, seul un tribunal de Californie – État américain où est domicilié le réseau social – est compétent.
Mes chers collègues, nous ne prétendons pas apporter de réponse à une réalité protéiforme et sans cesse mouvante. Non seulement les États sont fondés à réglementer internet, mais ils en ont aussi la capacité et, plus que jamais, le devoir. La logique répressive ne doit pas conduire à éluder la question de la prévention de la radicalisation et celle de l’éducation des esprits à la critique. L’école de la République, fondée sur la maxime Sapere aude – « ose savoir » –, doit sensibiliser aux nouveaux dangers d’internet. La capacité d’intervention des États doit ainsi être utilisée, en amont comme en aval, pour combiner notre passion de la liberté avec le sens de la responsabilité.
Mes chers collègues, comme jadis les pères fondateurs de la République, comme nos prédécesseurs de 1881, qui ignoraient l’existence future d’internet et des réseaux sociaux, il nous faut trouver, et vite, le juste équilibre entre la nécessaire liberté d’expression sur internet et la responsabilité de chacun pour ses paroles, ses écrits et ses actes. Il n’est pas concevable que l’on puisse continuer à écrire, à dire n’importe quoi et à susciter le terrorisme, avec les conséquences que l’on sait.
Ce débat voulu par le groupe RDSE n’a d’autre objectif que d’engager la réflexion sur la définition de cet équilibre indispensable, qui nous permettra de nous protéger des ennemis de la liberté et de la démocratie sans porter atteinte aux libertés d’opinion et d’expression qui sont au fondement de l’idéal démocratique et de la tradition radicale.
Applaudissements sur de nombreuses travées.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, internet, promesse d’une liberté d’expression sans frontières, est-il en passe de devenir un outil de surveillance sans limite ? J’ai choisi de poser en ces termes notre débat sur internet et la liberté de la presse, laquelle ne doit pas être confondue avec la liberté d’expression dont jouissent l’ensemble des citoyens.
Depuis la loi du 29 juillet 1881, la France protège ses journalistes par une législation ad hoc leur assurant un exercice libre de leur profession et la protection de leurs sources, en contrepartie du respect de certaines interdictions visant à garantir la fiabilité et l’« honorabilité » des informations diffusées et proscrivant notamment la provocation à la violence et à la haine, la publication de faux, la diffamation et l’injure, la diffusion d’informations sur une procédure judiciaire en cours, la violation du droit à l’image.
Cinq siècles après Gutenberg et moins de cent ans après l’invention du tube cathodique, ces règles demeurent, même si l’émergence du numérique a révolutionné les modalités de partage de l’information, en termes de vitesse de diffusion ou de facilité d’accès aux contenus. Internet a profondément ébranlé le modèle économique et bouleversé les méthodes de travail de la presse, obligée de se réinventer face à de nouvelles concurrences.
Aux côtés des organes traditionnels, une multitude de journalistes indépendants et de blogueurs « citoyens » a émergé, proposant au monde une information nouvelle, dans des conditions parfois périlleuses, en particulier en provenance de pays où la presse traditionnelle peine à œuvrer librement. Je citerai l’exemple de l’Iran, où, sous l’administration du président Ahmadinejad, un grand nombre de reporters et de chroniqueurs de renom de la presse écrite se sont tournés vers internet pour éviter la censure, contribuant à l’édification de la blogosphère en farsi. Le rapport annuel du Comité pour la protection des journalistes, faisant état des journalistes incarcérés de par le monde, estime que plus de la moitié de ceux qui ont été privés de parole étaient publiés sur le web.
Si internet représente une opportunité pour la presse, il constitue aussi une menace : les événements tragiques du mois de janvier ont rappelé combien la diffusion planétaire d’une information rendait nos journalistes vulnérables, jusque dans un pays chantre de la liberté de la presse et de la liberté d’opinion.
Mais ne nous y trompons pas : la menace que j’évoque ne se limite pas au danger, si grand soit-il, que les ennemis de la liberté font peser sur ceux qui défendent un exercice pleinement indépendant du journalisme d’information et d’opinion ; elle peut également être institutionnelle et politique, lorsque les États, au nom de la sécurité, multiplient les systèmes de surveillance.
Alors, bien sûr, nos démocraties ne censurent ni n’intimident ou n’emprisonnent les journalistes, comme elles n’empêchent pas l’échange d’informations entre citoyens en multipliant les restrictions techniques sur la Toile. Il n’en demeure pas moins que de légitimes interrogations se font jour dès lors qu’internet semble devenir un redoutable outil de surveillance.
En facilitant le stockage et le traitement des données, le big data a incité, de fait, à une collecte exponentielle de données, notamment personnelles, exploitées tant par les géants du net que par les services de renseignement, comme l’affaire Snowden l’a amplement révélé.
Jusqu’à présent, la France semblait protégée de tels abus : qu’en sera-t-il demain ?
Pour l’application de l’article 20 de la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire, le Gouvernement a discrètement pris, le 24 décembre dernier, un décret relatif à l’accès administratif aux données de connexion. Or cet article, qui autorise la collecte de données personnelles et la surveillance des communications téléphoniques et sur internet en temps réel par l’administration, porte atteinte à la vie privée des citoyens, ainsi qu’à la liberté d’information et au secret des sources. On peut relever trois motifs d’inquiétude : l’absence de contrôle du juge pendant la procédure de mise sous surveillance, des objectifs fort larges justifiant la surveillance et un spectre très étendu des données recueillies. La commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat prendra connaissance avec intérêt de la décision que rendra le Conseil d’État sur le recours en annulation de ce décret déposé par Reporters sans frontières le 24 février dernier.
Le projet de loi relatif au renseignement pose également question. Dans son avis publié mercredi dernier, la Commission nationale de l’informatique et des libertés déplore la présence, dans ce texte, de « mesures de surveillance beaucoup plus larges et intrusives » que celles qu’autorise l’actuelle législation, citant notamment la possibilité de « collecter, de manière indifférenciée, un volume important de données, qui peuvent être relatives à des personnes tout à fait étrangères à la mission de renseignement ». Le Conseil national du numérique a, pour sa part, exprimé au Gouvernement son inquiétude quant à l’extension significative du périmètre de la surveillance prévue par le projet de loi, selon des critères jugés flous : la prévention des violences collectives et la défense des intérêts de politique étrangère.
Je partage les craintes exprimées par ces deux institutions, dont chacun connaît ici la compétence et l’indépendance de vues. Le risque de surveillance de masse existe et nous concerne tous, mais plus encore les journalistes, pour qui l’anonymat des sources pourrait ne plus être garanti.
Mme Sylvie Goy- Chavent approuve.

Je n’ignore nullement les impératifs de protection de la société qui s’imposent à l’État, plus particulièrement en ces temps troublés par la perpétuelle menace d’attaques terroristes, et la nécessité, dans ce contexte, de mettre en œuvre des dispositifs de lutte contre l’incitation à la violence et la propagande sur internet.
J’alerte aussi sur une potentielle dérive dans l’utilisation des outils mis en place au regard de la liberté de la presse. Bien sûr, cette liberté, dont doit continuer de jouir tout journaliste, ne peut faire l’économie de la déontologie de l’information. La recherche du « scoop » à tout prix fait parfois oublier l’indispensable vérification des informations : souvenez-vous de l’annonce erronée par l’Agence France-Presse du décès de Martin Bouygues…
Les journalistes doivent être responsabilisés, mais également identifiés en tant que tels sur le web, afin que l’internaute puisse juger aisément de la fiabilité d’une information. À cet égard, l’équilibre économique des organes de presse en ligne constitue un enjeu majeur pour garantir, dans la durée, la diffusion d’une information professionnelle de qualité, au sein d’une myriade de sites et de blogs amateurs.
Un juste équilibre doit donc être trouvé entre liberté et sécurité : il est à cet égard indispensable que les dispositifs de sécurité sur internet tiennent compte des spécificités du métier de journaliste, notamment de la nécessaire protection des sources.
La Cour européenne des droits de l’homme ne dit pas autre chose lorsque sa jurisprudence rappelle régulièrement que les États membres du Conseil de l’Europe ont l’obligation de créer un cadre normatif permettant d’assurer la protection efficace de la liberté d’expression des journalistes sur internet et, plus largement, de l’ensemble de leurs citoyens. Ainsi, dans son premier arrêt portant sur le blocage de l’accès au web, rendu en décembre 2012, elle a conclu à la violation, par la Turquie, de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à la liberté d’expression, estimant notamment que les mesures limitant l’accès à des contenus sur internet doivent se fonder sur une loi suffisamment précise et être accompagnées d’un contrôle juridictionnel. Prenons garde à ce que notre propre législation ne s’éloigne de ces principes.
La France ne doit pas renier l’esprit de la loi de 1881 et doit demeurer fidèle à ses engagements internationaux en faveur de la liberté d’expression et de la liberté de la presse. Rappelons que, il y a moins d’un an, au mois de mai 2014, nous avions activement soutenu l’adoption, par l’Union européenne, de lignes directrices pour les droits de l’homme consacrées à la liberté d’expression en ligne et hors ligne.
Il convient d’éviter, à mon sens, les distinctions artificielles dans l’exercice des libertés d’information et d’expression en fonction du support de diffusion des contenus. Le caractère diffus d’internet ne doit en aucun cas servir de prétexte à l’instauration de nouvelles limitations en matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales, s’agissant notamment du droit de recevoir et de communiquer des informations.
Madame la secrétaire d’État, il incombe à l’État de protéger ces libertés, à l’instar de celle des journalistes d’exercer leur métier en toute indépendance. À cet effet, au-delà de la législation applicable, il est indispensable d’instaurer un dialogue avec les autres acteurs de la gouvernance d’internet, y compris les grandes entreprises du numérique. À défaut, la garantie d’une libre circulation des informations sur internet et de la proportionnalité des mesures de restriction qui, parfois, s’imposent ne pourra être effective.
Applaudissements sur les travées de l'UDI -UC et de l'UMP.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, lorsqu’internet est né, le monde s’est émerveillé. C’était la promesse d’un espace d’échange d’informations, de communication et même d’éducation. En réalité, internet est une perpétuelle révolution pour l’humanité et, surtout, la promesse d’un espace de liberté absolue s’affranchissant de toutes les frontières, géographiques, juridiques, voire morales.
Pour la presse, internet est un outil essentiel et une promesse de développement, en particulier dans les pays où la liberté d’expression est bafouée. En cet instant, permettez-moi de rendre hommage à tous les journalistes qui, parfois, risquent leur vie pour exercer leur métier.
En 2015, soit plus de trente ans après sa création, internet offre au monde un autre visage : celui d’un espace sans foi ni loi, permettant la diffusion du pire de ce que l’humanité a pu produire. Internet favorise l’expression de tous, peu importent leur opinion et leurs croyances. Aujourd’hui, le pire a atteint son paroxysme.
Les islamistes les plus radicaux ont épousé le projet politique d’instaurer un califat mondial, assassinant quiconque s’y opposerait, mais l’État islamique mène aussi une autre guerre, dont le théâtre ne connaît pas de frontières : le web leur permet de bénéficier d’une existence médiatique sans limites.
Dès lors, internet n’est plus un simple moyen de communication ; c’est une sphère d’expansion inouïe, où les propagandes les plus fanatiques peuvent être distillées en toute légitimité.
Pis, internet est un « sergent-recruteur » aussi discret qu’efficace, comme en témoigne le nombre de jeunes Français partis faire le djihad. C’est un outil de radicalisation et de recrutement de terroristes en herbe. Internet est aussi la sphère d’une tragique émulation, d’une macabre concurrence entre mouvances terroristes.
Lors de la tuerie de Charlie Hebdo, l’un des auteurs de ce crime affreux n’a pas hésité à faire la publicité de son appartenance à Al-Qaida au Yémen. La diffusion de vidéos insoutenables et la mise en scène de l’exécution des otages sont des exemples de cette ignoble politique de communication.
Dès lors, internet est une « couveuse » pour apprentis terroristes, un vivier pour les ennemis de la liberté, laquelle est pourtant l’un des fondements de notre République.
Aujourd’hui, internet est un nouveau théâtre d’opérations dans notre lutte contre le terrorisme. Ne nous y trompons pas, l’objectif des terroristes est de mettre à l’épreuve les démocraties dans ce qu’elles ont de plus cher : l’attachement aux libertés publiques, dont la liberté de la presse est l’un des fleurons. Oui, elle est une conquête, une belle conquête, achevée sous la IIIe République par sa grande charte qu’est la loi du 29 juillet 1881, mais elle reste fragile : aujourd’hui, elle est détournée sciemment.
La problématique est claire : comment concilier ce précieux acquis de la loi de 1881 avec la diffusion de publications glorifiant le génocide des chrétiens d’Orient et des Yézidis en Irak, la destruction de lieux de culte et les autodafés de livres ancestraux ?
Pouvons-nous laisser fleurir et prospérer sur internet, au nom de cette liberté, ce type de littérature, dont les atours sont les mêmes que ceux de nos magazines électroniques ? Il s’agit d’éviter ce piège intellectuel qui tend à opposer liberté et sécurité. On ne peut glorifier la liberté jusqu’à la déraison.
Notre responsabilité est de comprendre les enjeux du terrorisme et d’y répondre sans nous renier. Ainsi, la vraie question dépasse celle de la seule liberté de la presse sur internet ; la vraie question, c’est celle de la gouvernance d’internet et des actions que peuvent mener tant les responsables politiques que les grands acteurs du web. À cet égard, je veux saluer l’initiative de M. Cazeneuve, qui s’est entretenu avec les représentants des géants de l’internet que sont Facebook et Google.
En France, des mesures pour bloquer les sites internet faisant l’apologie du terrorisme ont été adoptées, et je m’en réjouis. C’est un signe fort envoyé à nos concitoyens, mais aussi aux terroristes. Internet ne doit pas rimer avec impunité. C’est également la preuve que nous prenons nous aussi notre part de responsabilités sur le web.
Il n’est pas envisageable que les publications de l’État islamique en langue française, téléchargeables par un simple « clic », puissent être à la portée de tous, en particulier des plus jeunes.
Néanmoins, une autre question se pose pour nos services de renseignement. Ces publications et ces sites nous permettent aussi de remonter des filières entières et de démontrer les connections existant entre les différents réseaux. Supprimer ces sites et empêcher la diffusion de ces publications ne nuirait-il pas en définitive à nos services ? Je ne le crois pas, à condition que nos agents disposent de toutes les ressources techniques et logistiques.
En outre, l’action de la France ne peut être isolée. Il faut mettre en place une politique européenne, à tout le moins, et même mondiale.
Souvenons-nous que tous les supports d’information peuvent être utilisés à de mauvaises fins. Une radio a poussé à la perpétration du génocide rwandais. Si la radio a pu servir d’instrument de destruction, il en va de même pour internet : n’importe quel médium peut véhiculer la haine.
Nous ne pouvons nous abriter derrière la liberté de la presse et la loi de 1881 pour justifier notre passivité. La liberté de la presse est au service de l’homme, de la promotion de sa dignité et de sa conscience, et non pas de sa destruction et de desseins nihilistes. Donner aux terroristes l’accès à cette liberté, ce n’est plus défendre la liberté : c’est la confier à ses fossoyeurs.
Nous devons être vigilants, car nous avons vu que n’importe quel support peut être utilisé à des fins de radicalisation. Des jeunes ont succombé à la violence et au djihad par l’exploration du web et la consultation de sites. Leur voyage virtuel a ainsi débouché sur une violence réelle.
Notre arsenal législatif doit donc être adapté et modernisé. Plus généralement, soyons vigilants : la responsabilité n’est pas la censure, car la liberté est inséparable de la dignité humaine.
N’attendons pas. Ne nous laissons pas enfermer dans des querelles qui nous conduiraient à détruire la liberté sous prétexte de la défendre. Ne laissons pas les libertés devenir l’instrument de leur propre disparition !
Je récuse toute contradiction qui nous empêcherait justement de combattre le terrorisme au nom du respect de la liberté de la presse. Aussi je soutiens, avec le groupe UMP, toute initiative sérieuse pour promouvoir une liberté responsable, une liberté vigilante, et non pas une liberté à genoux.
Enfin, je ne doute pas que, lors de l’examen du projet de loi relatif au renseignement, nous serons au rendez-vous pour créer les conditions de la sauvegarde de la liberté de la presse et de la loi de 1881, qui nous est si chère, pour la concilier avec une autre liberté : celle de vivre en sécurité.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, c’est un débat fondamental qui nous réunit aujourd’hui, car il touche à nos valeurs universelles, notamment à la liberté d’expression, véritable pilier de la République et de la démocratie.
C’est aussi un débat contemporain puisque, dans la tradition française, la liberté d’expression est étroitement liée à la législation sur la presse, en particulier à la loi fondatrice de 1881, conçue à une époque où le véhicule essentiel de la liberté d’expression était la presse papier, l’imprimerie.
C’est enfin un débat moderne, car la révolution numérique a complètement transformé les conditions et les possibilités d’expression et de communication, percutant de plein fouet la presse, mettant en question sa pérennité, son modèle économique, le métier de journaliste, ainsi que sa place spécifique dans la fabrication et la transmission d’information, du fait de la possibilité nouvelle, offerte à tout un chacun à travers internet, de s’exprimer sans retenue tout en bénéficiant des dispositions légales qui protègent les journalistes, sans être pour autant soumis aux mêmes contraintes que ces derniers, en termes notamment de responsabilité et de déontologie. C’est bien là que réside le problème !
Il s’agit d’un débat difficile, car il y va de la liberté d’expression, bien précieux qu’il faut préserver et défendre sans relâche, sans compromis ni compromission.
Il n’est pas question de pratiquer le « deux poids deux mesures ». Tout dernièrement, Charlie Hebdo a payé au prix le plus fort l’exercice du droit à la libre expression. C’est la liberté d’expression, en effet, qui était visée à travers cet organe de presse. À ce propos, j’observe que l’attentat contre Charlie Hebdo a été préparé par une campagne, menée prétendument au nom de cette même liberté d’expression, selon laquelle Charlie Hebdo stigmatisait une catégorie de la population et pouvait presque être taxé de racisme. Dans le même temps, les auteurs de ces accusations s’indignaient que l’on sanctionne Dieudonné, considérant que la liberté d’expression implique celle d’être raciste ! Opérant un véritable retournement, ils défendent Dieudonné au nom de la liberté d’expression et accusent faussement Charlie Hebdo de racisme. Ce journal pratique depuis toujours la caricature et la moquerie envers les religions, qui relèvent de la liberté d’expression.
Il ne faut donc pas entretenir les confusions. La liberté d’expression et la liberté de la presse doivent être garanties, défendues. Pour ce faire, le meilleur moyen est de recadrer le débat et de s’attaquer aux « dents creuses », si je puis dire, apparues dans notre législation à la suite de la révolution d’internet.
En 1998 déjà, le Conseil d’État estimait que l’ensemble de la législation, notamment celle qui garantit l’ordre public, avait vocation à s’appliquer aux acteurs d’internet. La loi de 1881, pierre angulaire de notre droit de la presse, pose pour principe, dans la continuité de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, que la presse est libre, mais que cette liberté est encadrée afin de sanctionner les abus, tels que la diffamation ou l’injure. Plus tard, s’attachant à épouser l’évolution de notre société, le législateur a réprimé l’incitation à la haine raciale avec la loi Pleven de 1972 ou le négationnisme, concernant en particulier les crimes perpétrés par le régime nazi, avec la loi Gayssot de 1990.
Notre droit n’empêche pas la libre expression, il la limite quand elle est inspirée par la volonté de s’attaquer au pacte républicain, aux principes qui fondent la République. En la matière, il ne serait pas bon de verser dans le libéralisme à tout crin. Notre droit, prenant acte de certaines dérives qu’a connues la presse – pensons à l’affaire Salengro, par exemple –, permet d’éviter que le journalisme ne retourne ses armes contre lui-même.
Aujourd’hui, on constate la mise en ligne de textes ou de vidéos remettant en cause l’interprétation de certains épisodes de notre histoire ou attisant une concurrence mémorielle qui n’a pas lieu d’être, le développement de théories conspirationnistes, tout internaute ayant la possibilité de trafiquer des images ou de réaliser des montages. Toutes les informations sont mises sur le même plan, qu’elles émanent de journalistes professionnels ou de n’importe quel internaute disposant de quelques moyens techniques. La contestation croissante des élites, la mise en question des politiques, des journalistes, qui contribuent à nourrir le populisme, en France comme dans d’autres pays, conduisent même à considérer les informations délivrées par les médias traditionnels comme moins crédibles que celles qui sont diffusées sur internet par un simple citoyen anonyme…
Devant une telle situation, on ne peut pas rester les bras croisés. La loi de 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet dispose que l’éditeur est pleinement responsable des informations publiées sur son site, mais bénéficie d’un régime atténué, par rapport à celui de la presse écrite, pour les contributions de ses lecteurs, par exemple les commentaires de ceux-ci sur les contenus mis en ligne. Hélas, ces forums de discussion sont vite devenus les viviers du n’importe quoi, ce qui oblige les sites d’information responsables à les fermer, faute de pouvoir les modérer. Cela illustre la nécessité d’apporter certaines limites à la liberté d’expression et à la possibilité, pour tout citoyen, de participer à l’élaboration de l’information.
Concernant les sites basés à l’étranger, les hébergeurs sont trop longs à réagir, quand ils réagissent. Le Gouvernement commence à apporter des réponses, notamment avec le décret relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l’apologie pris le mois dernier en application de la loi de novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Les sociétés gestionnaires des réseaux sociaux, les hébergeurs et les fournisseurs d’accès doivent être pleinement responsabilisés et agir de façon plus efficace et plus directe quand cela est nécessaire. Eu égard aux bénéfices énormes qu’ils réalisent, ils ont les moyens financiers et humains d’assurer une telle régulation. Ils doivent cesser de considérer qu’il ne s’agit là pour eux que d’une responsabilité accessoire.
Dans ce débat très sensible, difficile, les républicains doivent éviter deux écueils.
Le premier consiste à restreindre la liberté d’expression pour l’ensemble de la société, voire à attenter à la liberté de la presse, au nom de la nécessaire lutte contre le racisme, l’antisémitisme et le djihadisme. Internet est un outil très ambivalent, ce n’est ni la pire ni la meilleure des choses. Il ne faut pas le diaboliser. L’imprimerie était une invention géniale, mais, si elle a permis d’éveiller les esprits et de réaliser des avancées considérables dans le domaine de la pensée et de la science, elle a aussi servi à diffuser à grande échelle des textes ignobles. Dans le même esprit, la télévision, souvent dénoncée comme un facteur d’abêtissement, recèle des potentialités gigantesques. Il en va de même pour internet.

Le second écueil est de renoncer à tout encadrement de la liberté d’expression. Il est nécessaire de poser des limites à celle-ci, afin que les valeurs de la République puissent être préservées, tout en étant attentifs aux pratiques de l’État et des grands groupes privés en matière de collecte et de stockage des données personnelles, de big data, de surveillance du citoyen, souvent réduit à la condition de consommateur.
Nous devons être les défenseurs résolus de la liberté d’expression, de la liberté de la presse, mais aussi des combattants infatigables pour les valeurs de la République, contre le racisme, l’antisémitisme, le terrorisme et les thèses conspirationnistes.
Applaudissements sur certaines travées du groupe socialiste.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je voudrais en préambule remercier le groupe RDSE d’avoir demandé l’inscription à l’ordre du jour de ce débat sur le thème : « Internet et la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
Dans bien des cas, les propos tenus sur internet suscitent la stupéfaction. Je suis convaincue que, si l’on veut lutter efficacement contre le racisme, l’antisémitisme, le terrorisme et l’homophobie, qui gangrènent notre société, il est urgent de s’attaquer à la prolifération des discours haineux sur la Toile. Ces discours, ces propos, qui rappellent des pages douloureuses de notre histoire, entament jour après jour notre cohésion républicaine et portent atteinte aux principes fondateurs de notre « vivre ensemble ».
Je veux le souligner ici sans aucune ambiguïté, ces discours ne relèvent pas d’une rhétorique sans effet sur le réel ; ils peuvent engendrer la violence, et parfois entraîner la mort : nous en avons fait la terrible expérience en janvier dernier. Les événements survenus alors, qui ont bouleversé la France et le monde, doivent assurément nous encourager à agir, mais nous devons au préalable nous poser les bonnes questions, afin d’opter pour les solutions les plus efficaces, sans oublier jamais que la liberté d’expression est consubstantielle à la démocratie et à l’État de droit.
La première interrogation à laquelle nous, parlementaires, ne pouvons nous soustraire, est claire : les politiques de lutte contre les discours haineux sur internet actuellement mises en œuvre sont-elles suffisantes ? L’arsenal juridique existant, notamment son volet répressif, est-il effectif ?
Au premier rang de ces dispositifs et au cœur de notre débat se trouve la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui protège la liberté d’expression et en définit les limites. Elle s’inspire de l’article XI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Certes, les nouvelles technologies du web permettent la diffusion massive, sur les réseaux sociaux, comme Facebook et Twitter, de discours à haute teneur de haine qui n’avaient pas jusqu’ici leur place dans les médias traditionnels et dont la visibilité est bien sûr accrue par l’effet démultiplicateur de ces réseaux.
Le groupe écologiste n’en considère pas moins que les infractions en la matière doivent continuer à relever de la loi de 1881. S’ils doivent être combattus et réprimés, les abus de la liberté d’expression présentent une spécificité telle qu’ils ne peuvent être sanctionnés par le code pénal. Une seule exception à cette règle peut être envisagée : le cas où l’expression de haine dévie, par exemple, vers la provocation publique aux actes de terrorisme, notamment suivie d’effets. C’est la position que nous avons défendue lors des débats sur le projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, et que nous défendons aujourd’hui encore.
En revanche, si la loi du 29 juillet 1881 est un pilier de notre démocratie, il est certain que son cadre procédural n’est pas adapté à ce qu’il convient d’appeler le « web 2.0 » et sa profusion de blogs, de réseaux sociaux et autres plateformes de discussion. L’urgence est d’améliorer la lisibilité de cette loi, de réformer son cadre procédural, de préciser les notions d’espace public et d’espace privé. C’est notre rôle – et même notre devoir – de législateur.
Beaucoup reste à faire pour que la lutte contre les discours haineux sur internet ait de réelles retombées positives, en matière de législation, bien entendu, mais également, et peut-être surtout, en matière d’éducation. Il est ainsi fondamental d’enseigner aux plus jeunes à faire la différence entre ce qui relève du délit et ce qui relève de la liberté d’expression, de leur faire comprendre que si le net doit demeurer un espace de liberté, il n’est pas pour autant un espace d’impunité.
M. Jacques Mézard applaudit.

L’exercice de la liberté d’expression comporte des devoirs et implique, pour chacun, une juste prise de conscience de ses responsabilités, notamment celle d’en proscrire tout usage susceptible de ruiner les fondements de l’État de droit. En réalité, mes chers collègues, il est urgent de créer, comme le demande la Commission nationale consultative des droits de l’homme, un « ordre public numérique ».
Pour conclure, je voudrais avoir une pensée toute particulière pour tous ces jeunes gays ou lesbiennes victimes souvent silencieuses d’une homophobie rampante, particulièrement active sur le net, qu’il est de notre devoir de combattre avec autant de détermination que tous les autres discours de haine.
Applaudissements sur certaines travées du groupe socialiste.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la loi du 29 juillet 1881 garantit, d’un côté, la liberté de la presse et une information transparente, libre et pluraliste, et, de l’autre, le respect des personnes et des fonctions. Son adoption a conforté les missions des publications écrites, véritables outils de démocratie. Les citoyens obtenaient, quant à eux, l’assurance d’accéder à un large panel de publications, sans censure étatique préalable.
Cependant, la loi posait des limites, afin d’assurer le respect de la dignité de chaque citoyen. Cinquante-cinq ans après son adoption, l’affaire Salengro, « jeté aux chiens », pour reprendre une expression célèbre, montrera la fragilité de l’équilibre sur lequel repose cet idéal démocratique.
Pour ce qui concerne internet, le strict respect de cet équilibre est également une nécessité. Les internautes doivent pouvoir savoir qui publie l’information qu’ils lisent, les éditeurs pouvoir se couvrir en cas de recours juridique : comment les autorités judiciaires pourraient-elles statuer dans l’opacité ?
De même, un propos délictueux peut relever de la responsabilité de l’auteur du post, de celle du modérateur, mais l’hébergeur doit, en tout état de cause, rester le garant de la légalité de son site. L’ensemble de ces mesures doit permettre le contrôle a posteriori des publications, mais on ne saurait admettre un contrôle préalable, qui risquerait de déboucher sur un système de censure.
Les lois du 29 juillet 1982 et du 30 septembre 1986, relatives aux nouveaux médias de masse – télévision et radio –, n’ont fait qu’adapter la législation à la société, tout en conservant l’esprit de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article XI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Internet s’inscrit dans cette dynamique, avec l’émergence de nouveaux acteurs : les internautes, qui reçoivent des informations et en produisent.
À propos des nouveaux acteurs de l’information, je souhaiterais évoquer ici la question des lanceurs d’alerte, souvent débattue mais jamais vraiment tranchée. Le lanceur d’alerte est un acteur alternatif de la production de l’information. La protection des lanceurs d’alerte est aujourd’hui un enjeu majeur, au regard tant de leur activité que de ce qu’ils représentent. L’organisation non gouvernementale Transparency International considère qu’une soixantaine de pays seulement disposent d’une législation efficace couvrant les lanceurs d’alerte.
En France, aucune définition globale du statut de lanceur d’alerte n’a été élaborée : seules des définitions partielles et de toute évidence perfectibles l’ont été, couvrant de fait peu de domaines, et surtout protégeant peu les lanceurs d’alerte des menaces et des représailles. Les discussions sur le secret des affaires, tant en France qu’au sein du Conseil européen, viennent rappeler le chemin qui reste à parcourir pour assurer une réelle liberté d’expression au sein de notre pays, dans l’esprit de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article XI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Pourtant, des avancées ont pu être constatées, grâce à l’intégration de cinq textes dans notre législation. Mais leur caractère sectoriel prive une grande partie de nos concitoyens d’une couverture efficace en cas de lancement d’une alerte. De plus, la définition même de l’alerte et la procédure de lancement, à force de rigidité, montrent clairement leurs limites, exposant de fait les lanceurs d’alerte à de potentielles représailles.
Il faut relever que, dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la CEDH, ainsi que dans les standards internationaux, le lanceur d’alerte est associé à la presse. Il peut informer, au titre de l’intérêt général, des citoyens, en particulier des salariés.
Cependant, cela a été occulté dans les textes français, à l’exception notable de la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Dans les autres domaines, les textes de 2007, de 2012 et de 2013 excluent le recours à la presse. Ainsi, seules les autorités régulatrices, ainsi que la hiérarchie du lanceur d’alerte, sont en droit d’être informées de l’alerte. Cette situation, dangereuse pour le lanceur d’alerte, inefficace pour les citoyens et contraire à l’esprit de la loi sur la liberté de la presse, constitue aujourd’hui une limite à la liberté de l’information. Sous prétexte de lutter contre l’espionnage industriel, on s’accommode en fait de l’opacité du monde des affaires.
L’apport des lanceurs d’alerte pourrait être considéré comme une bouffée d’oxygène démocratique. Leur action doit certes être encadrée par la loi, mais dans un esprit d’émancipation.
À ce propos, l’élaboration de la loi relative au renseignement devra mobiliser toute notre vigilance, afin que les libertés fondamentales des citoyens soient préservées. Si la recherche de sécurité, motivée par les menaces terroristes, doit et peut être efficace, elle ne doit pas remettre en cause ces libertés.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, en 2012, dans une décision concernant la Turquie, la CEDH énonçait qu’« internet est aujourd’hui devenu l’un des principaux moyens d’exercice par les individus de leur droit à la liberté d’expression et d’information ».
Internet est au cœur de toutes les interrogations juridiques et sociales. Son développement exponentiel, ouvrant des possibilités d’échanges infinies entre internautes du monde entier, mêlant des informations en tous genres, a permis une immense liberté d’expression sur la Toile. L’enjeu est colossal.
Si internet est un outil formidable de communication et d’échange collaboratif, il peut malheureusement aussi se révéler un véritable instrument d’endoctrinement de l’opinion. L’efficacité de la propagande obscurantiste affinée de Daech, pour ne prendre qu’un exemple, ou la prolifération des théories complotistes à chaque événement, sapant littéralement les bases de la confiance en l’État, doivent nous inciter à adapter notre droit.
Nous devons nous doter des outils législatifs pertinents et efficaces pour prendre en compte ce nouveau facteur du numérique. Lors de l’examen de la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, nous avions déjà eu ce débat. La loi de 1881 a montré ses limites face aux nouveaux moyens de communication que sont les réseaux sociaux, les sites internet, les vidéos diffusées en ligne.
Cette loi a procédé au transfert du régime des délits de provocation au terrorisme et d’apologie du terrorisme de la loi du 29 juillet 1881 vers le code pénal, permettant de durcir considérablement le régime applicable à de tels délits. Par ailleurs, elle a autorisé le blocage administratif des sites djihadistes.
Les premiers blocages sont intervenus voilà quelques jours. Il s’agit d’un pas en avant dans la lutte contre le terrorisme, mais d’un petit pas : il reste encore une longue route à parcourir pour contrer cette menace devenue permanente. Les biais de ces blocages administratifs avaient été soulignés. Ils apparaissent avec netteté aujourd’hui. Première conséquence prévisible des blocages intervenant en dehors de toute décision de justice, les propriétaires de sites incriminés peuvent se poser en victimes de la censure. Où commence la liberté d’expression, où s’arrête-t-elle ? L’absence de contrôle de ces blocages par le pouvoir judiciaire est préjudiciable, ainsi que nous l’avions souligné au mois de novembre dernier.
Par ailleurs, outre qu’il existe de nombreuses manières de le contourner – je pense à l’accès aux pages « en cache », à l’utilisation de serveurs DNS alternatifs pour échapper à la redirection des fournisseurs d’accès à internet ou au recours à un réseau chiffré –, le blocage des sites n’a été que partiel. Certains opérateurs, et non des moindres, n’ont pas appliqué le dispositif du Gouvernement. À ces difficultés bien connues s’ajoute immanquablement la publicité faite aux sites concernés à cette occasion…
En France, la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique avait permis de créer un équilibre dans le cadre d’une responsabilisation de l’hébergeur. Ce dernier n’est pas responsable par principe des contenus qu’il héberge, mais il peut le devenir si, ayant connaissance d’un contenu manifestement illicite, il n’agit pas promptement pour le retirer.
Toutefois, il est aujourd'hui difficile de contraindre les hébergeurs à retirer rapidement les contenus illicites, notamment lorsqu’ils sont basés à l’étranger. Aux États-Unis, les hébergeurs se réfugient souvent derrière la protection du freedom of speech, la liberté d’expression entendue dans sa conception la plus large, telle que la définit le premier amendement de la Constitution des États-Unis. Ainsi, Twitter a longtemps refusé de bloquer ou de censurer des mots clés antisémites ou homophobes, avant de nouer un partenariat avec des associations pour tenter de mieux contrôler la diffusion de tels propos. Si ce géant du net, notamment, a annoncé des mesures contre la propagande djihadiste, les évolutions de cette conception restent à confirmer.
Alors que le groupe Anonymous a publié récemment une liste de plus de 9 000 comptes Twitter liés à l’État islamique, afin d’exercer une pression sur cet hébergeur, la puissance publique peut-elle se contenter de se reposer sur la société civile ? Ne peut-elle anticiper certaines évolutions, reconquérir un pouvoir, ou tout au moins une influence sur le cours des choses ?
Le ministre de l'intérieur, M. Bernard Cazeneuve, doit réunir au mois d’avril les géants du net, afin de conclure un code de bonne conduite, mais nous pouvons légitimement nous demander si de telles mesures seront suffisantes pour endiguer un mouvement toujours croissant. Aujourd’hui, Google, Facebook, Twitter et d’autres règnent sur la Toile. Mais d’autres apparaîtront certainement demain et se développeront sans être signataires de ce code de bonne conduite.
Notre société rencontre aujourd'hui des difficultés tenant à la fragilité de l’équilibre entre la préservation des libertés individuelles, d’un côté, et la sécurité, de l’autre. À ce titre, la question de la gouvernance d’internet est plus que jamais prégnante ! Elle touche aussi à la manière dont nous voulons redéfinir les contours de la liberté d’expression.
La loi du 29 juillet 1881 offre un régime trop protecteur à ceux qui portent atteinte aux valeurs de la République. Cependant, le délit d’apologie du terrorisme peut devenir contestable, donc dangereux pour les libertés publiques si son utilisation n’est pas nettement définie. Pourrait-on l’invoquer quand il s’agit d’une simple contestation sociale de l’ordre en place ? Ou pourrait-on, comme cela s’est vu dernièrement, mettre en cause un enfant de huit ans sur la base de cette infraction, en ignorant les vertus préventives de l’éducation ou de la construction d’un lien social sur la base d’une confiance réciproque ?
La tendance naturelle au renforcement de l’arsenal législatif pour contrer les débordements de la liberté d’expression ne doit pas faire oublier que l’action publique a vocation à agir en amont et en aval, dans le respect des principes du droit. Nous ne souhaitons absolument pas, bien sûr, que l’on en arrive à élaborer un Patriot Act à la française. Éducation, civisme, égalité des chances : voilà les thèmes sur lesquels les difficultés rencontrées dans l’application de la loi de 1881 doivent nous amener aujourd’hui à réfléchir. Se poser les bonnes questions, c’est déjà y répondre partiellement.
Applaudissements sur les travées du RDSE.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, pour ma part, je ne pense franchement pas qu’il faille remettre en question la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse à la suite du développement exponentiel de l’information sur internet.
Qu’il s’agisse d’internet ou de la presse écrite, il n’y a pas de contrôle a priori de ce qui paraît. C’est seulement après publication que des poursuites seront engagées en cas de diffamation, par exemple. Il serait d’ailleurs encore plus difficile d’exercer un contrôle a priori pour internet que pour la presse écrite. Il s’agit bien d’un contrôle a posteriori, et je ne vois pas pourquoi il faudrait changer notre législation sur la presse, qui a permis de garantir plutôt efficacement à la fois la liberté d’expression, à laquelle nous sommes très attachés, et le respect du droit des individus, à la suite d’une évolution technologique des supports d’information.
Au fond, la question est aussi de savoir comment protéger et revaloriser le travail des professionnels de l’information à l’heure d’internet. Aujourd'hui, avec internet, des amateurs contribuent à « informer ». Dès lors, comment l’internaute peut-il distinguer les sources d’information fiables des autres ?
Pour ma part, je suis partisan de l’instauration d’une « traçabilité », d’une labellisation de l’information, afin de valoriser le travail des professionnels. Il me paraît vain d’essayer de censurer les informations diffusées par des non-professionnels sur un réseau mondialisé.
La question de la sécurité a également été soulevée, à la lumière du rôle joué par certains sites dans les récents événements. Je pense qu’elle doit être envisagée à l’échelon international. Cela étant, elle relève davantage de la politique de sécurité –nous serons bientôt saisis d’un texte portant sur ce sujet – que du domaine de la presse stricto sensu. La seule solution efficace est la surveillance permanente des sites, ce qui excède le cadre de la législation sur la presse.
Je ne crois pas non plus qu’il faille modifier les dispositions législatives relatives au respect de la vie privée du fait de l’essor d’internet, qui ne me semble pas poser davantage de problèmes de ce point de vue qu’un certain nombre d’organes de presse écrite. La législation en vigueur prévoit là aussi un contrôle a posteriori.
En fait, nous assistons avec le développement d’internet à l’émergence d’une nouvelle culture : nous passons d’une société très verticale, avec une information descendante, élaborée par un petit nombre d’acteurs, à une société totalement horizontale, où l’information s’échange entre citoyens.
En tout état de cause, il me semblerait hasardeux de modifier la législation pour atteindre des objectifs qui demeurent encore très flous. Nous devons encourager le professionnalisme, mettre en place une régulation à l’échelon international pour ce qui concerne la sécurité, et par-dessus tout protéger la liberté d’expression. Pour le reste, je crois prématuré de faire évoluer la législation. En tant qu’ancien journaliste, j’appelle à la plus grande prudence à cet égard : toucher à la législation sur la presse, c’est toucher à la démocratie et à la République.
Applaudissements sur certaines travées de l'UMP et de l'UDI -UC.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je commencerai par remercier le groupe RDSE d’avoir pris l’initiative d’un débat sur ce sujet si important et sensible.
De prime abord, il pourrait paraître anachronique de lier internet, ce nouveau monde du XXIe siècle, et la loi du 29 juillet 1881, qui date d’une époque où la révolution économique et sociétale, c’était la Révolution industrielle.
Pourtant, à l’ère de la révolution numérique, la loi du 29 juillet 1881 demeure, me semble-t-il, le pilier auquel nous pouvons nous adosser quand nous voulons traiter de la liberté d’expression et de ses limites. En effet, il faut le rappeler, si la liberté d’expression est un droit absolu, elle n’en demeure pas moins, comme toute liberté, relative et encadrée. Le « tout est permis » d’Ivan Karamazov est toujours fatal à l’humanité.
Ainsi, la loi sur la liberté de la presse a traversé le turbulent « siècle des excès », s’ajustant aux évolutions du secteur, comme aux mutations de la société. Sa cohérence, sa clarté, son équilibre en font, je le pense, un repère toujours important, à l’heure où les valeurs démocratiques et nos convictions profondes quant au progrès social et civilisationnel sont quotidiennement en butte à des actes et à des discours de haine.

L’appel au meurtre sur la Toile, au nom d’une divergence d’opinions, ou même la destruction du patrimoine culturel universel en plein désert irakien constituent malheureusement notre quotidien. Face à ce déferlement de violence et de haine sur le web, je le dis nettement : tout n’est pas permis !

Toutefois, dans ce climat parfois délétère, il faut se garder de répliquer à l’extrémisme par des mesures extrêmes et rapides. La maturité démocratique d’un État s’estime à l’aune de sa capacité à répondre avec sang-froid, réflexion, pondération et retenue.
C’est pourquoi, par exemple, la future loi relative au renseignement devra maintenir un certain équilibre entre efficacité opérationnelle et sauvegarde des libertés fondamentales.
Au lieu de « détricoter » la loi de 1881, il convient, me semble-t-il, de la préserver, peut-être de le renforcer, mais, surtout, de l’adapter à internet.
En effet, en un sens, internet et la loi sur la liberté de la presse sont inextricablement unis par l’esprit libertaire qui les caractérise. Ils sont avant tout des instruments au service de l’un des « droits les plus précieux de l’homme », en l’occurrence la « libre communication des pensées et des opinions », affirmée à l’article XI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Cependant, en lien avec les « solitudes interactives », les pseudonymes qui masquent les véritables identités, les écrans qui s’interposent comme des barrières protectrices, le sentiment d’impunité croît dans l’espace du web, ce qui favorise la prolifération de discours nauséabonds, tant sur les forums que sur les réseaux sociaux.
Dans ce contexte, il serait peut-être opportun de réfléchir précisément à la notion d’ordre public numérique, afin que l’espace internet ne soit plus synonyme d’impunité pour les individus, tout en étant évidemment régi par des considérations englobant l’ensemble des droits fondamentaux.
Par-delà la belle loi sur la liberté de la presse, le dispositif du II de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, obligeant les acteurs d’internet à coopérer avec les autorités judiciaires et administratives pour permettre l’identification de personnes ayant contribué à la création de contenus illicites, doit, à terme, s’imposer aux grandes entreprises américaines qui hébergent des discours de haine sur leurs sites et qui revendiquent l’extranéité juridique, eu égard au lieu de domiciliation de leur siège social. Le dialogue avec ces hébergeurs, entrepris par le ministre de l’intérieur, est une première étape vers la régulation de l’espace internet.
Pour autant, l’arsenal répressif ne sera jamais suffisant. Il faut s’attaquer aux racines des maux et donc toujours s’attacher à l’éducation. En matière de numérique, la réflexion interministérielle doit continuer à prospérer. À mon sens, il serait bénéfique que le plan numérique, qui verra le jour d’ici à 2016, comprenne un volet relatif à la formation des élèves à l’utilisation d’internet afin de leur apprendre à appréhender cet espace, à exploiter ses ressources et les informations qu’il contient. L’objectif est qu’ils s’approprient ce formidable outil, tout en ayant conscience de la responsabilité citoyenne qui est la leur quand ils participent à l’« expression publique généralisée ». Les mots ont un sens, et toutes les opinions ne se valent pas ; l’expression de certaines d’entre elles constitue même un délit. Internet n’est pas une zone de non-droit.
Enfin, que l’on me permette de souligner l’importance de la responsabilité éthique et déontologique de certains journalistes, que nous rappelle le traitement par certaines chaînes de télévision des événements récents.
Madame la secrétaire d’État, peut-être faudrait-il distinguer entre ce qui relève de la liberté d’expression des individus et ce qui relève de celle des médias ? Quoi qu’il en soit, on perçoit une fois encore, mes chers collègues, que, dans tout débat de société, les réponses sont affaire d’équilibre et de positionnement du curseur.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du RDSE.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est sans doute une des lois les plus connues de notre République, et pas seulement parce qu’elle est inscrite sur certains murs pour rappeler qu’il est interdit d’afficher sur la voie publique. Elle est aussi l’une des plus symboliques, puisqu’elle touche aux libertés et aux responsabilités de la presse française, imposant un cadre légal à toute publication.
On pourrait évoquer, comme cela a été fait par de précédents orateurs, les nouveaux enjeux de cette liberté d’expression.
L’enjeu législatif est d’autant plus important que tout encadrement de la liberté d’expression est suspecté de porter atteinte aux libertés fondamentales de l’homme. En tant que législateur, nous devons faire preuve de la plus grande prudence et n’intervenir dans ce domaine que d’une main tremblante.
En préambule, il est important de réaffirmer que la France s’honore d’être le pays de la liberté d’expression. C’est un principe absolu, très normalement consacré par plusieurs de nos textes fondamentaux, à commercer par l’article XI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la Convention européenne des droits de l’homme.
Bien sûr, un premier débat porte sur les exceptions au principe de la liberté d’expression, envisagées comme autant de limites à celle-ci.
La loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme est venue sanctionner plus durement l’apologie du terrorisme, mais l’usage d’internet bouleverse nécessairement notre façon d’affirmer notre attachement à la liberté d’expression sur le web.
Chaque intervenant dans ce débat a présenté internet comme un « formidable outil de communication », favorisant les échanges et rapprochant les individus, voire les peuples. Néanmoins, il me semble que l’outil internet recèle une ambivalence fondamentale, qui bouleverse notre conception des choses. Cela ne relève pas véritablement d’une modification législative, mais plutôt d’une dimension ontologique.
L’idée même de « régulation du numérique » est selon moi trompeuse. Il faut dire que nous sommes tous victimes d’une certaine illusion face à internet. Un philosophe bien inspiré parlait d’« inquiétante extase », devant la fascination exercée par internet sur les esprits qui se piquent de modernité. Prenons l’exemple des cinq sites faisant l’apologie du terrorisme qui ont été bloqués. Bien sûr, cette mesure était nécessaire, mais il y a une forme d’illusion, voire d’ hubris, à croire que l’on peut contrôler la Toile. Certains experts estiment que ces nouvelles mesures pourraient même être contreproductives, en incitant les acteurs concernés à passer à la clandestinité et à des technologies plus difficiles à surveiller. Le blocage peut être contourné puisqu’il est techniquement facile de reconfigurer sa connexion à l’internet.
Plus largement, l’illusion dont je parlais tout à l’heure s’agissant d’internet est précisément de croire qu’il ne s’agit que d’un outil. Internet transforme insidieusement notre rapport au monde, par la substitution du virtuel au réel, la soumission à ses caprices et à ses humeurs, parfois les plus volatils, la réduction du temps de présence. Internet fait de nous des usagers compulsifs, comme en témoigne notre rapport à l’information ; c’est l’ordre du bon plaisir, qui ne rencontre aucun frein, c’est aussi l’arasement de toute hiérarchie des valeurs et des œuvres. En effet, ne nous y trompons pas : comme cela a été souligné, internet contribue à l’émergence d’une société horizontale.
Je suis heureux, madame la secrétaire d’État, de votre présence parmi nous aujourd'hui, mais je me demande si la ministre de la culture, eu égard au mouvement de disparition des notions d’auteur et d’œuvre, et la ministre de l’éducation nationale, compte tenu de l’affaiblissement de l’école et de l’autorité des professeurs, n’auraient pas dû également participer à ce débat. Car internet produit des effets considérables, qui affaiblissent l’idée même de médiation et d’autorité.
Cela vaut, on l’a dit, pour les journalistes. Hier, ils étaient des médiateurs qui analysaient les faits. Aujourd’hui, ils sont de plus en plus des « modérateurs » au sein des réseaux sociaux, …

… tant les citoyens, connectés sans relâche, sont soumis à un flux permanent d’informations.
Madame la secrétaire d’État, je vous ai entendue évoquer à la télévision, voilà quelques jours, la « République numérique ». Cette formule constitue peut-être un oxymore. En effet, pour illustrer votre propos, vous avez parlé du plan numérique pour l’école. Aujourd'hui, tout est numérique : c’est notre nouveau totem ! Quel élu d’ailleurs ne se glorifie pas d’offrir des tablettes numériques aux collèges, comme si c’était la solution miracle pour remédier à l’affaiblissement de l’école ? Puis vous avez ajouté que cela implique que le professeur ne soit plus le « sachant », l’élève l’« apprenant ». Il y aurait déjà beaucoup à dire sur l’utilisation de la « novlangue » administrative de l’éducation nationale, qui substitue au terme « professeur » ce nouveau barbarisme de « sachant », et le terme « apprenant » au beau mot « élève ». Cela en dit long sur ce mouvement de déliquescence et vers l’horizontalité qui n’épargne pas même l’école…
En fait, madame la secrétaire d’État, votre propos est significatif de l’affaiblissement par internet, à l’œuvre de manière insidieuse, de toute forme de verticalité, affectant en premier lieu les différentes institutions de la République, à commencer par l’école et ses professeurs, la presse en général, pas seulement écrite, et ses journalistes. Même le médecin, dont le diagnostic est aujourd'hui mis en doute par les patients, qui accordent de plus en plus d’autorité aux sites médicaux, est touché.
Dès lors, madame la secrétaire d’État, je n’ai qu’une requête, pour ne pas dire une supplique, à vous adresser : ne cédez pas à cette illusion du « tout connecté » et de la « République numérique » !
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie d’avoir inscrit ce sujet à l’ordre du jour des travaux de votre assemblée. Je remercie en particulier Jacques Mézard d’avoir posé les termes du débat.
À titre liminaire, je vous prie excuser Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, et Mme Fleur Pellerin, ministre de la culture et de la communication, qui auraient souhaité être présentes aujourd'hui. Je ferai de mon mieux pour répondre à vos questions, sans doute influencée par mon passé de juriste. Quoi qu’il en soit, beaucoup de ces questions n’ont pas encore fait l’objet d’un arbitrage.
La loi sur la liberté de la presse est une grande loi, mais elle doit être modernisée. Au demeurant, il existe d’autres outils que cette loi pour protéger nos concitoyens et préserver la liberté d’expression sur internet.
La liberté d’expression figure parmi les grandes victoires de la Révolution française. Elle est le socle de nos démocraties modernes et figure à l’article XI de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ».
La liberté de la presse a, quant à elle, dû attendre un siècle de plus pour être reconnue et consacrée par une loi, en 1881. Tout comme la liberté d’expression, la liberté de la presse est loin d’être absolue. Le législateur de 1881 a cherché un point d’équilibre entre le principe de la liberté d’expression et la répression des abus dans l’exercice de cette liberté ; à mon sens, cette recherche d’équilibre vaut pour toutes les grandes lois,
Une société démocratique ne peut condamner pénalement l’usage de la parole sans dresser de solides garanties contre la censure. C’est bien là l’esprit de la loi de 1881, qui soumet la procédure à des conditions qui la rendent à la fois complexe et protectrice des personnes poursuivies : délais de prescription courts, encadrement des conditions de saisine du tribunal, exclusion de la procédure de comparution immédiate.
Par ailleurs, la loi de 1881 exige d’aborder la question de la liberté de la presse et de la répression de ses abus avec toutes les garanties que peuvent offrir les règles de procédure pénale. L’infraction de presse, par exemple, doit être interprétée strictement, les débats sont oraux, les témoins sont auditionnés. En outre, la primauté est donnée aux droits de la défense.
La loi de 1881 a donné lieu à plus de cent vingt ans de jurisprudence. En d’autres termes, c’est un texte qui a fait ses preuves dans la pratique. Comme d’autres grandes lois républicaines – même si le parallèle n’est pas évident, je pense à la loi sur la laïcité –, c’est un texte qui a su s’adapter.
En 2015, qu’en est-il de cette loi ?
Avec internet, l’élan démocratique peut s’amplifier, trouver une caisse de résonance mondiale. Les nouvelles technologies n’ont-elles pas vu émerger la participation, non pas virtuelle, mais bien réelle, des citoyens à la vie de la cité, à travers des milliers de contributions écrites sur des blogs, sur les réseaux sociaux, les forums de discussion, les sites de notation et de recommandation.
Internet et les réseaux sociaux changent la donne du monde dans lequel nous vivons, souvent pour le meilleur, il ne faut pas l’oublier, car internet est un véritable outil d’émancipation. Les révolutions du printemps arabe n’auraient jamais eu lieu sans les réseaux sociaux.
Aujourd’hui, grâce au numérique, chacun peut se former et apprendre avec une facilité sans pareille dans l’histoire de l’humanité. On l’oublie parfois, mais on n’a jamais autant lu et écrit qu’à notre époque !
L’accès au savoir s’est démocratisé.
Cependant, internet peut être aussi l’outil du pire, comme nous l’avons vu tout récemment dans notre pays.
L’avènement du pire doit-il sonner le glas de la loi de 1881 ?
Jusqu’à présent, des réponses assez tranchées avaient permis la sanction des propos haineux, car internet n’est pas une zone de non-droit. Même si les cas demeurent assez peu nombreux, je citerai quelques exemples : condamnation à 10 000 euros d’amende du responsable d’un blog sur lequel des commentaires racistes ont été publiés ; condamnation à quarante heures de travaux d’intérêt général et à 300 euros d’amende de deux jeunes qui avaient créé une page Facebook appelant à l’euthanasie d’un jeune handicapé ; condamnation à 1000 euros d’amende d’une personne qui avait créé, au nom de quelqu’un d’autre, une fausse page Viadeo contenant des propos diffamatoires.
Mais alors, pourquoi un sentiment d’impunité subsiste-t-il ? Pourquoi a-t-on parfois l’impression, aujourd'hui, que tout peut être dit et écrit sur les réseaux sociaux et que les victimes, à moins de se lancer dans des combats judiciaires longs et onéreux, n’obtiendront pas justice ?
Il est clair que, à l’heure du numérique, la loi de 1881 mérite d’être réformée.
Au-delà du travail législatif, le Gouvernement prépare un plan de lutte contre le racisme qui abordera en partie ce sujet.
La Commission nationale consultative des droits de l’homme, autorité administrative indépendante, vient aussi de me remettre un avis sur les discours de la haine sur internet. Dans cet avis, la CNCDH considère qu’un certain nombre de dispositions procédurales incluses dans la loi de 1881 sont aujourd’hui manifestement en décalage avec l’expression publique sur internet et elle recommande des améliorations.
J’en mentionnerai quelques-unes, qui ont particulièrement retenu mon attention et feront l’objet d’un travail interministériel.
Il faut d’abord préciser et actualiser les notions d’espace public et d’espace privé sur le web.
Il paraît également nécessaire d’envisager la numérisation des procédures. Les assignations, les significations, les dépôts de plainte peuvent et doivent se faire en ligne. Il faut simplifier et faciliter les procédures de référé par la création d’un référé numérique. Aujourd’hui, grâce aux outils numériques, la justice peut être accessible à tous, plus rapide et plus efficace.
Il conviendrait aussi de prévoir un droit de réponse effectif sur internet au profit des associations antiracistes.
Il faut par ailleurs énoncer dans la loi le pouvoir du juge d’ordonner la suspension d’un compte utilisateur, et non pas d’un simple message, car cela permet aujourd’hui à des auteurs de propos très outrageants, extrêmes, dont le message a été annulé, de le republier le lendemain.
Je souhaiterais que nous engagions une réflexion sur l’augmentation pertinente et l’harmonisation des délais de prescription.
Enfin, la possibilité d’engager la responsabilité pénale des personnes morales en dehors des seuls organes de presse doit être envisagée.
Ces propositions sont à l’étude ; je tiens à ce qu’elles soient expertisées pour que je puisse, en accord avec le ministère de la culture et la Chancellerie, retenir celles qui nous semblent apporter des solutions satisfaisantes et, le cas échéant, les inclure dans le projet de loi numérique actuellement en préparation.
Pour l’heure, la Chancellerie relève deux blocages majeurs engendrés par l’application de la loi de 1881 dans la sphère numérique.
Le premier a trait à la requalification des faits. Si un plaignant, lorsqu’il porte plainte, a mal qualifié les faits – s’il parle, par exemple, de « diffamation » au lieu d’ « injures » –, le tribunal ne pourra pas requalifier les faits et l’action en justice ne pourra pas prospérer.
Le second blocage identifié par la Chancellerie est lié à la trop grande complexité de la procédure de saisine des tribunaux. Le réquisitoire à fin d’information et la citation directe du plaignant sont soumis à des règles trop strictes ; ainsi, il faut que le plaignant non seulement qualifie correctement les faits, mais encore mentionne dans sa plainte le numéro des articles de loi et même des alinéas applicables aux faits qui le concernent. La violation d’une seule de ces obligations procédurales est sanctionnée par la nullité.
En réalité, très peu de poursuites pénales sont engagées à la suite de signalements. Ceux-ci sont d’abord le fait des utilisateurs eux-mêmes, ensuite des plateformes numériques, puis de PHAROS – plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements –, qui traite les signalements, les transmet éventuellement au procureur de la République, lequel ne dispose aujourd’hui ni de l’information ni des moyens nécessaires pour traiter un contentieux de masse. Et le problème est bien là ; il suffit de voir ce qui s’est passé au lendemain des attentats qui ont profondément heurté notre pays : des dizaines de milliers de signalements étaient transmis chaque jour à la plateforme PHAROS, alors que les officiers de police chargés de les traiter ne sont guère qu’une petite quinzaine.
On le sait, l’expression publique généralisée à l’heure d’internet n’est plus filtrée exclusivement en amont par des médias professionnels responsabilisés et soumis à un encadrement déontologique. D’ailleurs, M. Assouline et M. Abate ont à juste titre insisté sur la protection des journalistes et sur la question des lanceurs d’alerte.
Vous l’aurez compris, je considère qu’il est temps de réformer cette grande loi de 1881, sans pour autant remettre en cause son esprit et son équilibre. Il s’agit finalement de la moderniser, de la « numériser ». J’ai d’ailleurs le sentiment que c’est la préoccupation des orateurs qui se sont exprimés cet après-midi ; je pense en particulier à M. Joyandet.
J’ai apprécié la formulation juridique qui a été avancée par Mme Benbassa et Mme Robert quant à un ordre public numérique. Effectivement, la question de l’ordre public, cet ensemble de lois applicables au-delà du socle juridique classique, pourrait inclure une dimension numérique. On peut citer, outre la nécessité de combattre les propos racistes et antisémites, l’importance de la lutte au quotidien contre les expressions homophobes, très présentes, trop présentes, sur internet et sur les réseaux sociaux.
Mais cette loi de 1881 n’est pas et ne doit pas être le seul moyen de lutter contre les discours de haine sur internet. Il existe d’autres recours et d’autres outils.
J’ai eu de nombreux échanges avec les représentants des plateformes numériques, les modérateurs privés, les policiers de PHAROS, les magistrats. Si nous arrivons à peu près à trouver un mode de coopération avec les géants de l’internet, il n’en demeure pas moins que certaines plateformes ne répondent pas ou ne répondent que très peu aux sollicitations des enquêteurs. Je pense à Twitter, par exemple, qui peut mettre, en dehors des cas hautement sensibles politiquement, jusqu’à huit mois pour répondre aux sollicitations d’enquêteurs de police français concernant des données de connexion en cas d’injure raciste sur internet. Je pense également à ces policiers qui sont contraints de faire leur requête en anglais auprès des plateformes américaines dont le siège se situe aux États-Unis.
Beaucoup d’entreprises continuent à se réfugier derrière leur loi nationale pour ne pas intervenir de manière proactive. Elles appliquent ainsi les critères de la loi américaine, invoquant le premier amendement à propos du racisme exprimé, mais, paradoxalement, interdisent la publication d’un tableau comme L’Origine du monde de Courbet au motif qu’il heurte certaines sensibilités…
M. Pierre-Yves Collombat s’exclame.
C’est pourquoi – et M. Robert Hue l’a souligné – il faut certainement réformer l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, afin d’imposer notre loi territoriale à tout opérateur étranger qui s’adresse à un public français. Il ne faut pas le faire uniquement sous l’angle jurisprudentiel, sous l’angle de la sanction des clauses abusives en droit de la consommation. Il ne s’agit pas pour autant, comme M. Mézard l’a fort bien dit, de privatiser la justice française ; il s’agit bien de responsabiliser l’ensemble des acteurs concernés.
À cet effet, il est urgent d’ouvrir un dialogue permanent avec les plateformes étrangères, en vue d’établir des règles communes et acceptées de tous ; il faut créer un espace de dialogue en France, et non pas dans la Silicon Valley.
Oui, madame Morin-Desailly, les grandes plateformes doivent être plus collaboratives : elles doivent faciliter à la fois le retrait des propos et l’action de la police et de la justice en France.
Il nous faut aussi renforcer les moyens nécessaires à la mise en œuvre d’une politique ambitieuse : il faut plus de personnes, plus d’équipements et des dispositifs de signalement plus simples. Vous l’imaginez bien, la productivité humaine nécessaire au traitement des signalements actuels par PHAROS a ses limites !
C’est avec détermination que le Gouvernement lutte contre le sentiment d’impunité qui a trop souvent cours et qu’éprouvent ceux qui vont jusqu’à faire l’apologie du terrorisme.
L’objectif de lutte contre la diffusion de ce type de propos est triple : il s’agit, bien sûr, d’assurer la sécurité publique et la sanction des atteintes à la dignité humaine, de lutter contre l’autoradicalisation et la mise en lien par les réseaux, mais aussi de lutter directement contre les mouvements fondamentalistes.
La communication est à la fois l’arme et la composante première du terrorisme, qui se différencie des autres formes de criminalité en ce qu’il recherche la publicité pour se légitimer, qu’il utilise des vecteurs de propagande, d’apologie et de provocation qui sont systématisés, qui font partie intégrante de la stratégie de l’État islamique ou d’Al-Qaïda.
La loi sur le terrorisme permet ainsi de recourir aux moyens spéciaux d’enquête de l’antiterrorisme et de mettre fin à une situation qui n’était pas normale. La France était en effet le seul pays de l’Union européenne où la répression de la provocation aux actes de terrorisme relevait encore de la loi sur la presse. Vous avez eu raison, monsieur Charon, de souligner l’action du Gouvernement en ce domaine.
S’agissant de l’application de la loi sur le terrorisme, lorsque nous aurons le recul nécessaire, nous devrons déterminer si elle est correctement appliquée. Cela signifie qu’il faut l’appliquer sans céder aux passions, qu’il s’agisse de la fermeture administrative de sites internet ou de la répression par l’emprisonnement de ceux qui tiennent des propos d’apologie du terrorisme.
Plus largement, gardons à l’esprit que faire disparaître et sanctionner un propos sur internet, ce n’est qu’un premier pas. Pour ne pas se contenter d’intervenir a posteriori, il faut inventer une citoyenneté numérique. C’est bien par l’éducation et la pédagogie que nous empêcherons, en amont, la propagation de propos racistes et antisémites. Nos enfants ne doivent pas être des consommateurs passifs qui ne savent pas « digérer » l’information qui vient à eux ; au contraire, dans cet environnement numérique, ils doivent devenir des citoyens lucides et critiques.
C'est d’ailleurs tout le sens des mesures annoncées par la ministre de l’éducation nationale, qui s’est associée avec la ministre de la culture pour proposer des modifications appelées à être intégrées dans les programmes en vigueur à compter de la rentrée de septembre 2016. Au-delà du déploiement des réseaux, de l’équipement en outils adaptés et de la formation des enseignants, le numérique à l’école doit aussi passer par l’éducation au numérique.
Enfin, dernier élément pour lutter contre les discours de haine, il faut produire des contre-discours. Ces initiatives doivent venir de la société civile. L’identification par le mouvement Anonymous des comptes Twitter de Daech en est une. Il se trouve que, dans ce qui était ma circonscription – l’Europe du nord –, l’élaboration des politiques de construction de contre-discours en ligne avec la société civile fait partie des stratégies des gouvernements nationaux. J’aimerais que l’ensemble des citoyens se saisissent de ces enjeux.
Internet est un outil formidable d’information, d’expression et d’émancipation, mais ce n’est qu’un outil. Chacun d’entre nous doit apprendre à l’utiliser. Le Gouvernement doit aussi empêcher que cet outil soit perverti, dévoyé, sabordé. La lutte contre les propos illicites sur internet doit devenir l’affaire de tous, dans le respect des libertés fondamentales.
Vous l’aurez compris, mesdames, messieurs les sénateurs, dans ce domaine, il faut certes légiférer d’une main tremblante, mais notre main doit ensuite être ferme dans l’application des décisions prises.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – Mme Cécile Cukierman applaudit également.

Nous en avons terminé avec le débat sur le thème : « Internet et la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

Mes chers collègues, les conseils départementaux issus des élections des 22 et 29 mars 2015 tiendront leur première réunion le jeudi 2 avril prochain.
Dès lors, sur la proposition de M. le président du Sénat et en accord avec le Gouvernement, nous pourrions : annuler la séance de questions d’actualité au Gouvernement du jeudi 2 avril et avancer à 14 heures 30 le débat sur la préparation de la révision de la loi de programmation militaire et à 16 heures 15 les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative à la modernisation du secteur de la presse ; organiser une séance de questions orales le mardi 31 mars, afin de respecter l’obligation constitutionnelle d’une séance de questions au moins par semaine ; et remplacer la séance de questions cribles thématiques du jeudi 9 avril par une séance de questions d’actualité au Gouvernement.
Il n’y a pas d’opposition ?...
Il en est ainsi décidé.
En conséquence, l’ordre du jour des séances des mardi 31 mars, jeudi 2 avril et jeudi 9 avril s’établit comme suit :
Mardi 31 mars
À 9 heures 30 :
- Questions orales.
À 14 heures 30 et, éventuellement, le soir :
- Suite de la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel.
Jeudi 2 avril
De 9 heures à 13 heures :
Ordre du jour réservé au groupe écologiste :
- Suite de la proposition de loi autorisant l’usage contrôlé du cannabis ;
- Proposition de loi visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques ;
- Proposition de résolution pour un guide de pilotage statistique pour l’emploi.
À 14 heures 30 :
- Débat sur la préparation de la révision de la loi de programmation militaire.
À 16 heures 15 :
- Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de la loi relative à la modernisation du secteur de la presse.
Jeudi 9 avril
À 9 heures 30 :
- Suite du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
À 15 heures :
- Questions d’actualité au Gouvernement
À 16 heures 15 et le soir :
- Suite de l’ordre du jour du matin.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 25 mars 2015 :
À seize heures quinze :
Débat sur l’influence de la France à l’étranger.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à seize heures quinze.