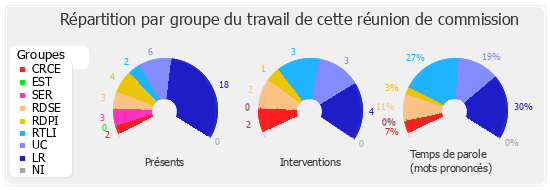Commission des affaires sociales
Réunion du 2 mars 2016 à 9h30
Sommaire
La réunion
La réunion est ouverte à 9 h 30.

Nous entamons aujourd'hui une série d'auditions sur la question des essais cliniques. La loi relative aux recherches impliquant la personne humaine a été adoptée à l'unanimité des deux chambres en mars 2012 après un parcours législatif complexe qui a vu se succéder au Sénat deux rapporteurs : Marie-Thérèse Hermange puis Jean-Pierre Godefroy.
Cette loi entend faciliter la mise en oeuvre des essais cliniques tout en renforçant la sécurité des personnes y participant.
Tant que les dispositions réglementaires n'auront pas été prises, ces garanties resteront très incomplètes. Notre commission a donc déploré chaque année depuis 2013 l'absence de parution des décrets relatifs aux modalités de saisine des comités de protection des personnes (CPP).
Je rappelle que les CPP, qui sont au nombre de quarante en France, sont des instances paritaires réunissant scientifiques et usagers. Ils ont pour mission de contrôler les protocoles d'essais cliniques lorsqu'ils portent sur l'être humain et de donner un avis sur la mise en oeuvre de l'essai. C'est l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) qui accorde l'autorisation de commencer un essai dès lors qu'il a obtenu l'avis favorable d'un CPP.
La loi pose le principe de la répartition aléatoire des protocoles entre CPP par opposition au libre choix par le promoteur entre les CPP territorialement compétents. Faute de décret, cette mesure est restée lettre morte.
Dans le contexte de l'accident tragique survenu à Rennes, il nous a semblé particulièrement utile de faire le point sur les règles en vigueur et celles qui restent pour le moment inappliquées. Il va de soi que notre sujet n'est pas spécifiquement ce qui est survenu à Rennes. L'accident fait l'objet d'une instruction judiciaire et un rapport d'étape de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) a déjà été remis - que la ministre a évoqué lors de la séance de questions au Gouvernement.
Deux présidents de CPP nous ont spontanément interpellés et nous les accueillons ce matin. Le Pr Jean-Louis Bernard, qui présidait jusqu'à il y a peu le CPP Sud-Méditerranée de Marseille, et le Dr Patrick Peton, président du CPP Est III de Nancy.
Ayant participé aux travaux relatifs à la loi dite Jardé, qui représentait une importante avancée, j'ai reçu, à la suite de l'accident de Rennes, beaucoup de témoignages d'émotion. La non-application de certaines des dispositions de ce texte a probablement contribué à cet accident.
Pour avoir participé, dès l'origine, en avril 1991, aux comités de protection des personnes, j'estime que la loi française relative à la recherche clinique, que nous devons, initialement, aux sénateurs Huriet et Sérusclat, est un modèle pour l'Europe et pour le monde. Mais le problème, c'est que certaines des dispositions majeures de cette législation ne sont pas appliquées. Ainsi de la distribution aléatoire des protocoles aux comités de protection des personnes, comme l'a rappelé le président Milon, disposition qui constituerait pourtant un moyen puissant de prévenir les conflits d'intérêts. Mais je pourrais également citer la disposition de la loi de 2004 qui prévoyait l'évaluation des comités sur le fondement d'un référentiel produit par la Haute Autorité de santé. J'ai été chargé de projet pour l'élaboration de ce référentiel, qui a été remis au ministère de la santé à l'été 2008 : il n'est toujours pas mis en oeuvre.
Je suis membre du CPP de Nancy Est III depuis plusieurs années et le préside depuis 1992. Pour avoir suivi l'évolution de la législation, depuis la loi Huriet-Sérusclat de 1988, j'ai pu relever deux problèmes. Le premier est que les CPP fonctionnent avec beaucoup d'autonomie... et très peu de concertation. Ensuite, il ne faut pas oublier que cette loi, qui est une grande loi, n'en a pas moins été combattue par un certain nombre de nos confrères, notamment dans les domaines très particuliers de la réanimation et de la chirurgie. Si bien qu'au fil du temps, ces remises en cause ont suscité des demandes de modification. La transposition de la directive européenne, qui pour l'heure, nous gouverne, fait de l'examen des protocoles par les comités la règle. Mais l'arrivée du règlement européen a introduit un biais dans le fonctionnement des comités, soumis, dans cette phase pilote, à deux législations distinctes. Ils peuvent ainsi être amenés à examiner des protocoles de recherche clinique selon les modalités prévues par ce règlement européen, qui ne s'applique, pour l'instant, qu'au médicament. Quant à la loi Jardé, votée en 2012, elle ne trouve toujours pas à s'appliquer puisque manquent les décrets d'application. Si bien qu'au total, sachant que les procédures sont appelées à évoluer dans le temps, les comités, manquant de visibilité, ont du mal à statuer.
A quoi il faut ajouter un troisième paramètre, qui n'est sans doute pas étranger à ce qui est arrivé à Rennes : les comités se trouvent dans un environnement concurrentiel. On a même parlé à un moment d'un « Gault et Millau » les concernant ! Soumis aux règles de la comptabilité publique, ils connaissent de grandes difficultés financières, ce qui ne facilite pas la tâche de leurs membres, bénévoles. Quand on se trouve amené, pour sécuriser son financement, à examiner davantage de protocoles, comment mener ces examens avec équanimité ? Il est important de le souligner.
Certes, des réponses peuvent être apportées, mais encore faut-il qu'elles ne tardent pas trop. Or, voilà deux ans que l'on attend la promulgation des décrets. Mieux répartir l'examen des protocoles permettrait ainsi à chaque comité de n'être pas chargé de plus de 70 examens - ce qui paraît un chiffre raisonnable. Mais dans les rapports successifs de l'Igas, on constate que certains comités déclarent examiner plus de 100 protocoles par an, quelques-uns même jusqu'à 200. On peut comprendre, à ce compte, que ceux qui n'en examinent pas plus de 45 se sentent un peu menacés et que le déroulé de leurs examens s'en trouve affecté.

Je vous remercie de vos éclairages. La loi Jardé, dont j'ai eu l'honneur d'être l'un des rapporteurs, a fait l'objet d'une navette approfondie : la discussion a duré une année. Marie-Thérèse Hermange, François Autain et moi-même avions beaucoup insisté sur la nécessité du choix aléatoire. Je regrette que les décrets d'application qui permettraient la mise en oeuvre de cette disposition ne soient pas pris.
Vous avez parfaitement résumé notre inquiétude de l'époque. Nous craignions alors, sachant que les promoteurs souhaitaient choisir eux-mêmes le CPP saisi, que l'on n'en arrive à une indépendance factice. Nous nous inquiétions de voir certains CPP traiter beaucoup de dossiers - pour des raisons... multiples - et d'autres très peu : on nous faisait du même coup valoir que ces derniers n'étaient peut-être pas habilités à recevoir de nouveaux protocoles...
L'absence des décrets d'application de ce texte, qui se voulait une refonte partielle de la loi Huriet-Sérusclat de 1988, a-t-elle pu avoir une incidence sur le malheureux accident de Rennes ? Lorsque les CPP sont saisis d'une recherche, quels moyens ont-ils, une fois qu'ils ont donné leur accord, d'assurer un contrôle suivi ? Nous avons un peu le sentiment que ces moyens leur manquent, et qu'ils se trouvent dans l'incapacité de vérifier que les choses se passent correctement.
Sans porter de jugement sur l'accident de Rennes, je m'interroge : vu le résultat des essais réalisés sur des animaux, le CPP n'aurait-il pas du alerter le promoteur et surtout, ceux qui se sont portés volontaires ?
On ne peut s'en tenir à la situation actuelle. Une commission nationale devait être chargée de la répartition des protocoles. Pour que le dispositif soit aussi protecteur que possible, nous avions admis que le promoteur puisse refuser une fois, avec des arguments valables, l'attribution à un comité, mais il était obligé d'accepter le second choix. J'aimerais connaître votre sentiment sur tout cela.
Cette question de l'affectation aléatoire est en effet centrale. Mais elle a un préalable : la nécessaire harmonisation des pratiques des comités. Ce qui s'est passé à Rennes porte, de fait, à s'interroger. A l'aune du travail que nous avions réalisé sur les bonnes pratiques, et au vu du rapport de l'Igas, il est clair qu'il y a eu dysfonctionnement - ou dérapage. On lit ainsi dans le rapport de l'Igas que le CPP, en première lecture, avait émis un certain nombre d'observations, parmi lesquelles deux réserves, l'une, de nature scientifique, concernant le critère d'inclusion ou d'exclusion des patients, l'autre, de nature éthique, relative au niveau d'information à délivrer au patient une fois la dose prévue fixée par les premières étapes. Moyennant quoi, le comité avait émis un avis sous réserve. L'investigateur - le laboratoire Prial - a répondu en supprimant le point qui posait problème en matière de critères d'inclusion mais, s'agissant de l'information des sujets, il était allé jusqu'à écrire qu'il n'acceptait pas la demande, compte tenu de la planification très serrée de l'étude - cela fait froid dans le dos. Il n'est pas normal que le comité ait donné son feu vert sans que ce refus d'obtempérer soit examiné en séance. C'est une façon de procéder regrettable, qui m'a fait violemment réagir. Si l'harmonisation des pratiques prévue par la loi de 2004 avait été mise en oeuvre, ce comité n'aurait probablement pas procédé ainsi.
Mais un autre point a également attiré mon attention. Le rapport de l'Igas nous apprend que le personnel de ce comité compte un mi-temps d'« assistant scientifique » - ce n'est pas là une appellation banale. Je me suis donc reporté au rapport précédent, celui de 2014, dans lequel ce comité Ouest-VI avait, avec d'autres, fait l'objet d'un audit. La seule réponse apportée à l'inspecteur de l'Igas qui l'interrogeait sur ses propositions pour améliorer la situation est la suivante : « disposer d'un pharmacien ou d'un médecin chargé d'évaluer la pertinence scientifique et méthodologique des dossiers tout au long de l'année ». Et voilà qu'en 2016, on apprend que ce comité dispose en effet d'un salarié qualifié d'assistant scientifique. Cela pose un gros problème. Car si le législateur a prévu des dispositions destinées à prévenir les conflits d'intérêts pour les membres siégeant aux CPP, rien n'est prévu pour garantir l'indépendance des personnels salariés de ces comités.
Je reviens, à présent, sur l'affectation aléatoire. Son objectif est double. Il s'agit, d'abord, d'harmoniser la charge de travail des comités. Il est insupportable de constater, en lisant le rapport de 2014, que certains comités se penchent sur 25 nouveaux protocoles par an quand d'autres sont saisis de 300. Comment le ratio peut-il être de 1 à 14 dans des instances qui comportent le même nombre de membres, devraient toutes porter la même attention à l'analyse et disposer du même temps pour la conduire ? On peut se demander pourquoi certains comités sont si attractifs aux yeux des promoteurs - je n'en dirai pas plus.
Comment prévenir les conflits d'intérêts ? Les déclarations publiques d'intérêt - dont je note au passage qu'elles ne sont pas publiques pour le comité Ouest VI, puisqu'il n'est pas possible, en consultant le site internet, de connaître le nom de ses membres - sont centrées sur les intérêts financiers. Mais c'est oublier, en particulier pour les membres appartenant au corps médical, les conflits non financiers qui ont trait aux relations hospitalières et universitaires. L'affectation aléatoire était aussi un moyen de neutraliser ce risque - de complaisance voire de conflit d'intérêts dans l'examen du protocole émanant d'un collègue du même CHU ou de la même région.
Pour toutes ces raisons, il est extrêmement urgent que l'affectation aléatoire soit mise en place. Le rapport de l'Igas l'a, après enquête, souligné, confirmant que cette pratique serait souhaitable et donnant quelques pistes de mise en oeuvre. Cela fait 18 mois que ce rapport a été rendu, et rien n'a bougé. Il est devenu urgent de passer aux actes.
Les comités n'ont pas la possibilité, monsieur le sénateur Godefroy, de suivre le déroulement clinique des protocoles. Nous sommes informés par les rapports annuels et le retour d'incidents éventuels, mais le suivi à proprement parler n'est pas assuré.
L'harmonisation fait partie des voeux que nous avions très tôt formulés, dès la mise en place des comités au début des années 1990. J'avais été à l'initiative, avec un collègue lyonnais, de l'idée d'une commission destinée à assurer cette harmonisation. Malheureusement, la Conférence des comités a totalement dérapé et ne s'est jamais inquiétée du sujet. Le rapport de l'Igas en témoigne. Comme l'a souligné mon confrère, on se demande ce que peut bien être le rôle d'un salarié chargé d'étudier la recevabilité des dossiers - ce qui est précisément le rôle des comités. On délègue ainsi à un « super spécialiste » le soin d'analyser les protocoles. Ce n'est pas admissible, même si je crois savoir que le cas est isolé. Par où l'on rejoint ce que je faisais observer tout à l'heure : nous sommes dans un univers concurrentiel. Les comités de la région Bretagne ont peut-être quelques difficultés. Quand on voit que sur 45 protocoles examinés par le comité de Brest, plus d'une dizaine...
près d'une vingtaine, donc, émanaient du même centre de recherche, on est porté à s'interroger. Comment mettre au moins en place, à brève échéance, cette disposition de la loi Jardé, concernant la répartition aléatoire des protocoles ? C'est à vous que la question est posée.

Les non-spécialistes connaissent mal la question des essais cliniques. Pourtant, l'innovation thérapeutique nous concerne tous. Comment mettre cette question à la portée de chacun et parvenir à plus de transparence, pour le grand public, sur les essais cliniques ?
Le nombre d'essais cliniques, en Europe, a baissé de 25 %. Comment situer l'innovation thérapeutique dans un monde concurrentiel ? Comment cela se passe-t-il aux Etats-Unis ou en Asie ? Comment faire évoluer notre législation et les règlements européens pour nous rendre concurrentiels ?
Pourriez-vous rappeler, car nous ne sommes pas tous des spécialistes, comment se passent les choses aujourd'hui, comment elles pourraient mieux se passer et à quel niveau de législation on pourrait les faire évoluer ?
Depuis la promulgation de la loi, j'ai remarqué une inversion dans la proportion des protocoles émanant respectivement de l'industrie et des institutions. Indéniablement, l'industrie nous soumet moins de protocoles. Mais il est vrai que nous sommes loin du temps des grandes découvertes dans le domaine du médicament, des grandes heures des antibiotiques. A part quelques nouveautés en hépato-gastro-entérologie, ce sont essentiellement à des recombinaisons de molécules que l'on s'essaie, comme on le voit en cardiologie.
On reproche aux comités de ne pas répondre assez rapidement. Les entreprises du médicament (Leem) ont publié un rapport dans lequel il est écrit qu'ils répondent sous 50 jours. C'est totalement faux. Les comités répondent, conformément aux délais imposés par la législation, sous 20 à 30 jours.
Un rapport de l'Igas établit que sur les années 2011 à 2013, 1 600 protocoles ont été proposés en France, dont 600 sur médicament, 600 hors médicament et 250 sur dispositifs médicaux. Ce ne sont pas les comités qui retardent l'examen des protocoles. Faut-il réviser notre législation pour raccourcir les délais ? Les anglo-saxons répondent, il est vrai, dans des délais extrêmement courts mais ils disposent d'une force de frappe sans comparaison avec celle de la France. Au moment de la transposition, en 2004, de la directive européenne, on nous disait que l'on allait retarder la recherche en Europe. Je ne crois pas que cela soit le cas. En revanche, l'industrie américaine donne aux Etats-Unis une réelle force de frappe.
Je souscris à cette analyse. Un mot, en complément, sur les essais de phase 1. Ces essais, qui constituent, après des études de laboratoire sur certains animaux, la première expérimentation d'un produit sur l'homme, sont à très haut risque. On ne peut jamais inférer de façon certaine la tolérance par le corps humain d'un produit médicamenteux à partir d'un essai sur le chien ou le rat. D'où une réelle incertitude quant au risque.
Surtout, nous sommes appelés à évaluer l'essai de phase 1 à partir des études de laboratoire, qui sont pour nous une zone grise : le promoteur ne présente dans son dossier que les données qui plaident en faveur d'une première utilisation chez l'homme. On peut comprendre qu'il ne s'étende pas sur tout ce que pourrait entrainer un refus de son projet. Cette zone grise est pour nous un vrai problème.
La pression de l'industrie, au-delà, est importante. Il est assez troublant de constater que cette pression porte essentiellement sur les essais de phase 1, qui sont pourtant très éloignés, dans le temps, du retour sur investissement pour le laboratoire : il y a de nombreuses autres étapes à franchir avant la mise sur le marché du médicament. Autant on peut comprendre qu'une pression s'exerce au moment de la demande d'autorisation de mise sur le marché, autant il est plus difficile de comprendre la pression au stade de ces essais de phase 1. Mais c'est qu'en réalité, ces essais sont la première étape d'un processus de type industriel. Or, c'est aussi le moment le plus dangereux pour l'être humain qui va autoriser la société à faire usage de sa personne sans en attendre aucun bénéfice sanitaire individuel. Alors que cela pose une question éthique aiguë, il est totalement malvenu qu'une pression s'exerce à ce moment-là. Cette pression n'est pas liée au temps, mais à de lourds enjeux industriels, touchant à la vente de brevets. Il s'agit d'enjeux financiers importants au sein de petites start up, qui de surcroît se vendent entre elles des licences - ce qui complique d'autant la traçabilité du processus.
Notre législation, dans la recherche sur l'homme, distingue ce qui relève du promoteur - celui qui conduit la recherche - et ce qui relève de l'investigateur - celui qui est au contact des participants. Dans les phases suivantes des essais cliniques, les investigateurs, qui sont des médecins, sont face à des malades : ils portent à la fois la responsabilité du soignant et celle du chercheur. Mais en phase 1, le médecin n'est pas soignant, il n'est que chercheur. Sa relation avec le sujet se prêtant à la recherche n'est pas la même. C'est aussi pourquoi le risque éthique est fort.
J'ai sous les yeux quelques copies d'écran, datant du 18 janvier, après l'accident, prises sur le site internet de Biotrial. Parmi les rubriques d'emblée proposées, celle qui s'intitule « S'agit-il de tests cliniques indemnisés ? » laisse songeur. On y lit : « Nos études sont indemnisées de 100 à 4 500 euros. Cette indemnité est non imposable » - en gras. Et en bas de page : « Outre cette indemnité, devenir volontaire dans le cadre de nos études pharmaceutiques est une belle occasion de participer aux progrès de la recherche. » La hiérarchie mise en avant est claire. Et cela continue par des témoignages. Celui de « Jean-Marie, infirmier et cobaye humain », dont on apprend que « ce statut de ?cobaye humain ? lui convient bien : il se sent bien accompagné et suivi par le personnel soignant. Et il peut ainsi offrir des vacances à sa famille ». Et à nouveau : « Outre l'aspect financier qui est assez motivant, c'est aussi une période où l'on peut se poser et discuter avec d'autres personnes ». Vient ensuite « Isabelle, étudiante », qui précise : « Avant de me lancer, j'ai posé des questions au personnel médical qui nous a présenté l'étude. » Ecoutez bien : « L'indemnité versée à l'issue de l'étude est-elle plus intéressante qu'un job étudiant bien rémunéré ? La réponse est oui, sans hésiter. D'autant que ça demande beaucoup moins d'heures de travail pour une même rémunération. » Faut-il rappeler que le législateur a veillé à bannir toute « rémunération » pour participation à un essai clinique ? « Quels sont les risques ? J'ai été particulièrement rassurée sur ce dernier point. On m'a dit que je ressortirai de cette étude comme j'y suis entrée. »
Je suis allé voir, ensuite, le site du CPP Ouest VI. Sous la rubrique « Volontariat », on trouve un texte stupéfiant : « Toute personne majeure, volontaire sain, a la possibilité de contacter un centre de recherche spécialisé pour participer aux recherches biomédicales. Dans la région Bretagne, ces études peuvent être réalisées au sein du laboratoire Biotrial, centre agréé par le ministère de la santé. » Suit le téléphone du centre. Il y a là des dérapages en cascade, qu'il faut absolument se donner les moyens d'interdire. Comment un comité de protection des personnes peut-il faire de la publicité pour un centre de recherche !

Nous sommes tous conscient de la nécessité des essais cliniques pour parvenir à une balance bénéfices-risques à l'avantage du patient. La question du contrôle tant au niveau national qu'européen, est posée. Or, le fait est que les Etats membres considèrent qu'une absence de réponse sous deux mois vaut accord tacite. Le principe de précaution ne voudrait-il pas plutôt qu'une absence de réponse vaille refus tacite ?
C'est une particularité étrange, en effet, dans un domaine aussi dangereux.
Tout à fait d'accord. La publication à venir des décrets doit être l'occasion, j'y insiste, de se prononcer une fois pour toutes sur la répartition du travail entre l'Agence nationale de sécurité du médicament et les CPP. Il y a quelques années, lorsque l'on posait une question, d'ordre purement technique, à l'Agence, la réponse arrivait largement au-delà des 30 jours, ce qui nous mettait en difficulté vis à vis des promoteurs. Si bien que l'on ne posait plus de questions. Or, depuis ce malheureux accident de Rennes, l'Agence a repris la main et, dans le cadre de la phase pilote d'examen des protocoles selon le règlement européen, il est arrivé, alors que le comité que je préside avait donné un accord, qu'elle le refuse, au motif que l'expérimentation sur l'animal était insuffisante. On ne peut en rester à cette ambivalence. Ne pas répartir clairement les rôles, c'est mettre les comités, qui n'ont pas d'experts à disposition dans tous les domaines, en difficulté.
La publication des décrets devrait aussi être l'occasion de lever une autre ambiguïté. Car comment décider de ce qu'est un « risque minime » ? Qui en sera chargé ? Le ministère y pourvoira tous les ans par arrêté ? Je n'y crois pas, et je crains que l'on ne se trouve confrontés à d'énormes difficultés. Ce qui pourrait amener une prudence extrême, au risque de voir à nouveau les comités accusés de freiner la recherche sur le territoire national.

Il faut trouver le juste équilibre entre le principe d'innovation et le principe de précaution. Nous regardons rarement du côté du premier, car c'est toujours lorsque surviennent des drames que l'on se penche sur les problèmes. Les propos mercantiles que vous avez extraits du site internet de Biotrial ne datent pas de janvier et pourtant, aucun de ceux qui ont une responsabilité dans ce domaine ne s'en était, auparavant, préoccupé. Il a fallu un accident pour que l'on s'en soucie.
Au stade préindustriel de la phase 1, ne pourrait-on opérer une présélection des sujets, sachant que l'étude du génome a rendu certaines prédispositions décelables. Une sorte de pré-phase 1 ne permettrait-elle pas de déceler les personnes les moins susceptibles d'être réactives au produit, avant un élargissement de l'essai ?
La phase 1 est une phase d'escalade de dose. Cela suppose une très grande prudence du protocole quant à l'administration des doses, même s'il est vrai que les temps ont tendance à se comprimer. Je vois mal, cependant, comment on pourrait diviser cette phase grâce à une sélection génomique.
Il est très difficile de sélectionner au sein d'une population des personnes présentant une plus ou moins grande susceptibilité à un produit. La médecine s'y essaie depuis de nombreuses années, avec très peu de succès, dans la phase de traitement : on peine à sélectionner, parmi les patients atteints d'une maladie donnée, ceux qui sont susceptibles de bien répondre à un médicament nouveau. Alors que l'on n'y parvient pas en bout de chaîne, je vois mal comment on y parviendrait en amont, à un moment où l'on est encore totalement dans le brouillard sur les imprévus.
Que peut faire un CPP dans le cours d'une recherche, a demandé M. Godefroy ? Il ne fait guère que rendre un avis en cas de modification substantielle demandée par le promoteur. En revanche, il reçoit, comme l'Agence, l'ensemble des effets indésirables et imprévus graves qui se produisent autour de l'utilisation du produit. Non seulement pour l'essai qu'il gère, mais pour l'ensemble des recherches sur le produit en cause, dans le monde entier. Si bien que pour les essais sur des médicaments en développement, comme les biothérapies, à haut risque - l'essai de Rennes en était un - il existe des quantités phénoménales d'évènements indésirables. Le comité reçoit ainsi des masses d'information très au-dessus de ses moyens d'appréciation. Ce que nous souhaiterions, c'est que les évènements indésirables graves inattendus soient signalés d'office au comité, car ce sont des signaux d'alerte. En revanche, pour les évènements indésirables graves attendus, du fait de toxicités potentielles identifiées, un rapport de synthèse suffirait : le comité pourrait alors apprécier si la quantité de ces évènements justifie une modification du protocole. Il s'agit, en somme, de faire le ménage dans ce qui est communiqué au comité, pour le rendre plus efficace.

J'ai, comme le professeur Bernard, été regarder sur internet : dans les résultats de recherche sur les mots « essais cliniques », on tombe ainsi sur la page d'un site dédié aux « bons plans à Paris », intitulée : « Tester des médicaments (indemnisation jusqu'à 4 500 euros) ». « La loi française permet de recevoir jusqu'à 4 500 euros par an, non imposables », peut-on y lire. C'est effarant.
S'agissant des essais cliniques, vous avez clairement rappelé que les essais sur l'animal ne préjugent pas nécessairement de ce qu'il en sera sur l'homme. Soit, mais à Rennes, des animaux testés sont morts. Les raisons n'en sont pas, semble-t-il, d'ordre neurologique, mais comment imaginer qu'un tel produit puisse ne pas être dangereux pour l'homme - même si les doses administrées ne sont pas comparables ? Où est le principe de précaution ?

Même question. N'y a-t-il pas moyen de mieux évaluer les essais précliniques sur les animaux, pour en tirer de meilleurs enseignements ?

Vous avez parlé, docteur Peton, d'autonomie des CPP. Quelle différence faites-vous entre autonomie et indépendance ?
Vous avez évoqué, professeur Bernard, les « zones grises » que sont, pour les CPP, les recherches précliniques. Serait-il pertinent de prévoir des sanctions à l'encontre des laboratoires si preuve est faite que des résultats d'essais précliniques n'ont pas été communiqués en totalité ?
Je siège au conseil d'administration de l'ANSM. Cette énorme machine nous oppose, dans ce dossier, le secret médical. Mais où est le secret médical en ce qui concerne l'expérimentation de médicaments ?

J'ai été moi aussi frappé par les termes de « zone grise » que vous avez employés. N'est-ce pas là qu'il faut faire porter l'effort, pour assurer plus de transparence ?
Quand on voit l'attractivité du gain pour les volontaires dans un pays développé comme le nôtre, on se demande ce qu'il en est dans des pays beaucoup plus pauvres. N'y aurait-il pas là matière à réflexion pour l'Organisation mondiale de la santé ?

J'habite le Haut-Rhin, frontalier de la Suisse où l'industrie pharmaceutique se porte bien. Que se passerait-il pour un citoyen français qui, s'étant soumis à des essais cliniques dans un autre pays, aurait eu des problèmes ?

Le docteur Peton a fait référence aux « risques minimes ». Nous avions longuement débattu pour décider s'il fallait retenir trois catégories de recherche ou seulement deux. Nous avions opté pour trois catégories, dont celle des recherches interventionnelles ne portant pas sur le médicament, en précisant qu'étaient seules visées celles qui ne comportent que des « risques et des contraintes minimes », et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence du médicament. Nous posions ainsi une limite, tout en ayant bien conscience que la notion n'est pas simple à circonscrire.
Autre sujet qui a beaucoup fait débat à l'époque : la recherche sur des personnes non couvertes par un régime de sécurité sociale.

On dit souvent que le risque zéro n'existe pour aucune activité. Pensez-vous néanmoins que dans le domaine des essais cliniques, on puisse s'en approcher ? Existe-t-il des précédents de décès lors de tels essais ? J'ai lu, dans la littérature sur le sujet, que les leçons de l'accident de Londres en 2006 ne semblent pas avoir été tirées. J'aimerais entendre vos commentaires sur ce point.

La question de la reconnaissance financière a été à plusieurs reprises évoquée. La présentation qui en est faite, dans l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, est de fait particulièrement choquante. Vous avez également souligné le flou de la notion de « risque minime ». Avez-vous des propositions à faire pour que l'on sorte, dans l'un et l'autre cas, de cette ambiguïté ?
Le plafond annuel d'indemnisation, introduit, dès l'origine, par la loi Huriet-Sérusclat, visait à éviter la professionnalisation du don de son corps. Mais faute, là aussi, d'harmonisation européenne, certains volontaires, quand ils atteignent le plafond de 4 500 euros en France, vont en Belgique, en Suisse, en Espagne, où tout est ouvert. Il est temps, sur ce point comme sur d'autres, que l'Europe s'accorde.
L'accident de Londres a eu lieu en 2006, au sein d'un hôpital public, mais sous la responsabilité d'un investigateur privé qui louait les locaux. Il s'agissait d'un essai de phase 1, sur une biothérapie, comme à Rennes. La prudence aurait voulu plus de progressivité dans l'entrée des patients dans la recherche, afin de ne pas exposer plusieurs personnes à la fois au même risque. Il n'y a pas eu alors décès, mais amputation des extrémités. La leçon méthodologique de cet accident n'a pas été tirée, en effet, à Rennes, où la bonne pratique aurait voulu que les patients ne soient exposés que successivement aux augmentations de doses, et que l'on prenne le temps de s'assurer que tout se passait bien pour l'un avant d'exposer le suivant. Il faut ajouter que les conditions de l'expérimentation menée à Londres font frémir. Une start up allemande avait en effet vendu à une start up anglaise la licence sur le produit testé, sans avertir qu'un essai de phase 1 avait été mené qui avait mal tourné. Ce n'est qu'après coup, une fois l'accident survenu, qu'on l'a découvert. C'est bien pourquoi publier les résultats de recherche chez l'homme est une exigence essentielle. En France, nous avançons très lentement. Le registre national est loin d'être exhaustif et j'invite les représentants que vous êtes à réfléchir sur cette question : on sait que 30 % des recherches chez l'homme ne sont pas publiées. Les causes de cette situation ont été parfaitement analysées, au niveau international, au début des années 2000 : elles tiennent, pour une part, à l'invocation du secret industriel, pour une autre, au fait que les investigateurs rechignent à mettre leurs échecs sur la place publique, pour une autre enfin, aux revues scientifiques, dont les éditeurs préfèrent publier sur ce qui est nouveau et porteur plutôt que sur ce qui n'a pas fonctionné.
Il me semble qu'au-delà de la publication, par l'Agence du médicament, des résultats de recherche que les promoteurs veulent bien lui confier - sachant qu'ils peuvent toujours se retrancher derrière le droit au secret, il faudrait réfléchir à une obligation, sous contrainte, de publication - tout en acceptant une part de censure sur le contenu. Car le simple fait de savoir que tel produit a fait l'objet d'un essai de phase 1 qui a été interrompu serait déjà une avancée. Aujourd'hui, une entreprise peut garder une telle information sous le coude et s'empresser de vendre sa licence à une autre, qui va recommencer.
En phase 1, il faut en effet faire preuve de la plus grande prudence : l'escalade de doses doit se faire patient par patient.
Tous les chercheurs vous diront que la physiologie humaine ne se rapproche pas de la physiologie animale. Celle du singe est sans doute la plus proche, mais généraliser les tests sur ces cousins de l'homme poserait un double problème, financier et éthique. Ce n'est pas par des dispositions législatives que l'on règlera la question.
Dans les décrets d'application à venir, il serait bon de prendre en considération le financement des comités. Car s'ils doivent appliquer la loi Jardé à la lettre, ce qui suppose l'examen de tous les protocoles, qu'il s'agisse d'essais de phase 1 ou d'un simple travail de recherche mené par un thésard, ils se trouveront dans l'incapacité, eu égard aux moyens qui leur sont alloués, de tout examiner avec la même pertinence.

Il est indispensable de corriger tous les défauts que vous avez pointés, mais comment fera-t-on, demain, pour attirer des volontaires dans des expérimentations sur lesquelles planera toujours la crainte de risques majeurs potentiels ?
M. Huriet avait à l'époque évoqué l'idée de faire connaître la loi via une publication à destination du grand public, afin de conjurer les appréhensions que peuvent faire naître un terme comme celui de « cobaye », que l'on a encore récemment vu apparaître dans les journaux. Il est clair que le volontariat va probablement connaître un recul. Cela dit, le comité Nancy Est III s'est toujours refusé à valider les propositions de publicité des promoteurs pour leur recherche : cela n'entre pas dans notre mission. Il est clair cependant, si tel avait été le cas, que nous n'aurions pas agréé des présentations telles que celle qu'a décrite de professeur Bernard.
Il me semble que dans les essais hors phase 1, c'est à dire ceux qui portent sur des patients, le recrutement via des associations pourrait, voire devrait être validé par le CPP : il s'agit d'inciter les malades à participer, sans cependant les tromper. Le comité serait dans son rôle en examinant les appels à participation à des protocoles de soins de phase 2 ou phase 3. Pour les essais de phase 1, il serait à mon sens souhaitable d'interdire aux prestataires de mener une telle publicité. C'est à l'autorité publique, dans ce cas, qu'il revient de délivrer une information équilibrée, transversale. Il s'agit de rappeler que la recherche a besoin de personnes saines, en listant l'ensemble des prestataires, sur l'ensemble du territoire, menant de telles recherches. Il n'est pas normal que le CPP de Rennes fasse la publicité d'un centre privé alors qu'existe aussi un centre d'investigation clinique de l'Inserm, dont il ne dit rien.

Le risque zéro n'existe pas, certes, mais comment comprendre qu'en dernière instance les comités dépendent financièrement des promoteurs ? Ce qui nous ramène au problème des conflits d'intérêts. Je n'oublie pas que dans l'affaire du Médiator, un professeur signalait, dès 2006, dans un article que j'ai lu, que le médicament était très actif sur les hypertriglyceridémies.
Il serait en effet utile de contraindre à la publication des résultats des essais menés sur l'homme. Et cela au niveau européen. On a vu ce qu'il s'est passé à Londres ; de tels accidents ne devraient pas survenir.

J'aimerais connaître la proportion respective, parmi ceux qui prennent le risque de participer à ces essais, d'hommes et de femmes.
Dans les protocoles classiques, sachant que sont exclues les femmes dans des situations particulières, comme les femmes enceintes, le ratio est de l'ordre de deux tiers d'hommes pour un tiers de femmes.
Jusqu'à 2004, une taxe était versée par le promoteur pour l'examen de son protocole par le comité et par l'Agence du médicament - avec un tarif très préférentiel pour les promoteurs publics. Puis, une loi de finances a supprimé cette taxe pour lui préférer un financement par l'augmentation de la taxe sur les produits médicamenteux et dispositifs médicaux. Ce n'est pas neutre. Si l'on considère que le payeur est, au bout du compte, le décideur, l'industrie du médicament se trouve fondée à dire, depuis cette modification, que c'est elle et elle seule qui assure le financement de la recherche, dans lequel les opérateurs publics ne sont pour rien. C'est une considération qu'il faut avoir présente à l'esprit.
Permettez-moi d'ajouter une remarque très pratique. Nous sommes actuellement soumis aux règles de la comptabilité publique. Un comptable examine nos comptes, établit les budgets prévisionnels. Or, depuis trois ans, on nous demande de valider un budget en déficit. A Nancy, l'arriéré est de 30 000 euros sur un budget de fonctionnement de 90 000 euros. Et le ministère l'admet. Je ne suis pas spécialiste de la comptabilité publique, mais dans une optique de « bon père de famille », je comprends mal.
Cadre législatif et réglementaire applicable aux essais cliniques
Audition du pr olivier jardé professeur agrégé de chirurgie orthopédie et de droit de la santé et du pr françois lemaire ancien chargé de mission auprès la ministre de la santé pour la recherche biomédicale

Nous entendons à présent le Pr Olivier Jardé et le Pr François Lemaire, qui ont été à l'initiative puis ont porté, à l'Assemblée nationale et au Gouvernement - puisque M. Lemaire était alors chargé de mission auprès de la ministre de la santé - la proposition de loi qui a été largement adoptée par les deux chambres en mars 2012 et est devenue la loi relative aux recherches impliquant la personne humaine, dite « loi Jardé ». Ils sont à la fois chercheurs et acteurs particulièrement impliqués dans l'élaboration de ce texte. Il nous a donc semblé important d'entendre leur analyse sur son défaut d'application.
Nous avons abordé beaucoup de sujets au cours de l'audition précédente : le choix aléatoire, les moyens de contrôle permanent, l'harmonisation des pratiques, la transparence des essais cliniques, la chute des essais en Europe, la répartition du travail entre l'Agence du médicament et les CPP, l'articulation entre principe d'innovation et principe de précaution et même les moyens financiers des CPP.
La loi Jardé a mis trois ans à aboutir, mais rétrospectivement, j'estime que les échanges ont beaucoup enrichi ce texte, et lui assurent pérennité.
Pourquoi fallait-il revoir le texte de 1988 ? La loi Huriet avait trouvé un équilibre intéressant entre sécurité du patient et encadrement de la recherche clinique française. Cependant, de nombreux textes votés depuis, sans aborder directement la question des recherches cliniques, ont eu un impact sur ce texte. La directive européenne de 2001, puis la loi Kouchner de 2002, la révision, en 2004, des lois de bioéthique - votée en même temps que la loi de santé, non sans quelques contradictions sur certains points concernant la recherche. Puis est venue la loi sur la recherche de 2006, la loi relative à la Cnil, la deuxième révision des lois de bioéthique.
En deuxième lieu, la recherche clinique a beaucoup évolué. Le texte de Claude Huriet était essentiellement centré sur la recherche lourde sur le médicament. Or, une nouvelle forme de recherche, sur laquelle la France ne doit pas être en reste, connaît un important développement : il s'agit de la recherche observationnelle. Pourquoi certains de ceux qui portent des stent font-ils à nouveau une thrombose ? Faut-il l'attribuer à leur alimentation ? A un excès de sédentarité ? A des causes génétiques ? On ne le sait pas. La recherche observationnelle suit des cohortes sur dix ans pour tenter de le déterminer. A l'hôpital Antoine Béclère, on arrive à faire vivre des prématurés de cinq mois. Leur QI sera-t-il équivalent, à 20 ans, à celui de l'ensemble de la population française ? Voilà encore un sujet de recherche observationnelle pertinent. On veut aujourd'hui manger bio dans toutes nos cantines. Les enfants concernés, parvenus à l'âge adulte, auront-ils moins de risques à supporter ? Encore un autre sujet. Or, la loi française ignorait jusqu'alors tout ce pan de recherche.
Au-delà, la loi était devenue imprécise, voire incohérente. Un prélèvement identifiant exige-t-il un consentement écrit ? Une prise de sang après une intervention chirurgicale est considérée comme soin de suite, mais pour un prélèvement épidémiologique, elle entre dans la catégorie de la recherche et relève d'une procédure beaucoup plus lourde. Autre problème, celui des conflits pouvant survenir entre les avis rendus par le CPP et le Comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche (CCTIRS). Il risquait de devenir plus simple, à force d'incohérences, de mener une recherche à Shanghai plutôt qu'en France, avec les répercussions que l'on imagine sur les équipes de recherche.
La loi que l'on me fait l'honneur d'appeler loi Jardé visait à assurer un bon équilibre entre le patient et la recherche. Elle retient trois niveaux de recherche. La recherche interventionnelle lourde, telle qu'encadrée par la loi Huriet, la recherche interventionnelle avec risque minime, et la recherche observationnelle, enfin. Face à quoi étaient prévus trois niveaux de consentement. Un consentement écrit circonstancié dans le premier cas, un consentement libre et éclairé au sens de la convention d'Oviedo dans le deuxième, une information dans le troisième - il s'agit que le patient sache qu'il va se trouver sur un fichier, qu'il est susceptible d'être à nouveau convoqué dix ans plus tard, etc. Il faut savoir que dans ce type de recherche, les cohortes peuvent être de 500 à 1 000 cas : on ne peut pas monter un si grand nombre de dossiers pour une procédure qui n'est au fond rien de plus qu'un interrogatoire.
Le CPP assurait, dans cette logique, la protection du patient. Il était chargé de classer la recherche en fonction du risque évalué et des listes à constituer pour la classification. A quoi s'ajoutait le problème des collections génétiques : vous savez qu'à l'AP-HP de Paris, il existe des milliers de prélèvements, dans des congélateurs, que l'on ne peut utiliser, bien que les patients soient décédés, parce qu'ils n'ont pas donné leur accord. C'est malheureux, car on peut faire des expérimentations sur des tissus. Mais il faudra attendre que cette loi soit applicable pour que cela soit rendu juridiquement possible.
Après des échanges, notamment au Sénat, que j'ai alors jugé un peu trop nourris - mais je fais ici amende honorable, car j'estime, in fine, qu'ils ont été fructueux - la loi a été votée, en mars 2012. Pourquoi n'est-elle pas appliquée depuis quatre ans ? C'est que l'Europe, face à ce texte novateur voté par la France, n'a pas voulu être en reste. Jugeant que la directive de 2001 était un peu à la traîne, le Parlement européen a chargé Mme Wilmott, présidente de la commission environnement, santé publique et sécurité alimentaire, d'évaluer la nécessité d'une refonte. Ces travaux, entamés en juillet 2012, ont abouti à une réponse positive en septembre 2013, qui plaidait, au-delà d'une simple révision de la directive, pour l'édiction d'un règlement. Si bien que les décrets d'application de la loi, qui dès l'automne 2012 étaient rédigés, ne pouvaient plus sortir.
Le processus, heureusement, n'a pas traîné en longueur. Le trilogue, sous une présidence lituanienne qui a beaucoup oeuvré pour aboutir, a permis de parvenir à un accord le 20 décembre 2013, qui a débouché sur un vote du Parlement le 4 avril 2014 - avant l'échéance de l'élection parlementaire prévue en mai, qui aurait tout retardé. Il nous a fallu trouver, ensuite, un support législatif : ce fut l'article 53 du projet de loi de modernisation de notre système de santé habilitant le Gouvernement à mettre en concordance, par ordonnance, les dispositions de la loi avec le nouveau règlement. Les décrets pourront ainsi voir le jour une fois le texte de l'ordonnance revenu du Conseil d'Etat.
En effet. Avec François Lemaire, nous nous sommes rencontrés pour la première fois dans le bureau de Roselyne Bachelot en 2008. Il aura donc fallu huit ans pour voir aboutir ce texte.
Il est vrai qu'il s'agit d'un texte de fond. Ce qui me satisfait, c'est que les patients comme les chercheurs y sont favorables ; je pense donc que l'on a trouvé un équilibre. Les décrets devraient sortir, je l'espère, à l'automne.
La loi n'a pas entendu toucher aux CPP, mais le fait est qu'en prévoyant que les trois types de recherche devraient être soumis à leur examen, elle leur apporte un surcroît de travail. Mais quand je vois qu'un pays comme la Belgique, où la recherche est loin d'être plus importante que chez nous, compte 200 comités, quand la France n'en compte que 40, je me dis qu'on a un peu de marge...
Le tirage au sort aura également un impact lourd sur les CPP. Ce n'est pas ce que j'avais prévu au départ. Comme chercheur, j'apprécie de pouvoir discuter avec mon CPP. Même à l'époque de l'internet, il me semble que la proximité et le dialogue donnent lieu à des allers-retours intéressants. Il en a été décidé autrement, parce qu'il est vrai que la distribution aléatoire assure plus de transparence. Mais elle suppose l'existence d'une commission nationale d'harmonisation. Quand on mène une recherche en oncologie pédiatrique, sur 40 CPP, deux seulement sont capables de mener l'analyse. Beaucoup dépend des personnalités présentes dans le CPP. S'il y a tirage au sort, il faut absolument qu'une commission nationale d'harmonisation établisse une sorte de jurisprudence. Et cette commission ne doit pas être un « super CPP ». Si tous les membres de cette commission étaient issus de CPP, ils apparaîtraient comme les procureurs de leurs propres collègues, ce qui pourrait être gênant. C'est pourquoi nous avions prévus un tiers de personnalités qualifiées.
J'ajoute que toute la méthodologie est passée à l'ANSM, ce qui a également un impact important. Sans parler des lourdeurs de Bercy... qui compliquent un peu la tâche des membres des CPP.
Sans doute faudra-t-il un nombre plus important de CPP. Cela dit, pour tout ce qui est observationnel, nous avions, avec François Lemaire, imaginé une voie express, à l'américaine. Est-il bien nécessaire de mener une lourde analyse quand il n'est question que de constituer un fichier ? Il est vrai que nos collègues psychiatres, que j'ai rencontrés, estiment que ce n'est pas chose légère, pour quelqu'un qui est suivi au plan psychiatrique, de se savoir dans un fichier. On pourrait imaginer de les placer en classe 2 au lieu de les laisser en classe 3. Peut-être François Lemaire pourra-t-il en dire plus.
Il est vrai que nous avons connu, naguère, quelques passes d'armes, mais le texte s'est beaucoup enrichi de la navette.
Les décrets étaient en effet rédigés à l'automne 2012. Ce n'est pas le Gouvernement qui a bloqué, mais l'administration : l'ANSM, à la demande du Leem, jugeait qu'imposer aux investigateurs de modifier leurs habitudes pour tout changer à nouveau deux ou trois ans plus tard n'était pas raisonnable. Et je pense qu'elle avait raison. L'Europe n'a pas tardé à édicter ce règlement : il ne lui a fallu que deux ans.
Beaucoup de l'intérêt actuel pour les essais cliniques vient de l'accident de Rennes, que je me garderais de commenter avant la publication du rapport de l'Igas, qui nous fera connaître dans le détail ce qu'il s'est passé. Mais pour ce que l'on en sait, la réglementation était adaptée. L'application des textes aurait permis que tout se passe comme prévu. La loi Jardé n'est pas en cause en cette affaire, puisque qu'elle n'a pas touché à ce qui concerne le médicament, domaine qui relevait de la législation européenne. Elle porte essentiellement sur les recherches observationnelles, les collections biologiques, bref, tout ce que vient de rappeler Olivier Jardé. Elle n'a pas touché au noyau dur du médicament et de la sécurité. On ne peut donc pas dire que si on l'avait appliquée avant, l'accident de Rennes n'aurait pas eu lieu.
M. Peton, que vous venez d'entendre et que je connais bien, vous aura sans doute mis au fait du lamento des CPP - qui correspond à une réalité, notamment en ce qui concerne leurs problèmes financiers, qui auraient dû être résolus il y a bien longtemps.
Le traumatisme du tirage au sort ? Je rappelle que c'est le Sénat qui est à l'origine de cette mesure. Nous étions alors en pleine affaire du Médiator. La facilité de contact entre investigateur et président de CPP était ici vue comme connivence, d'où votre choix, qui représentera un bouleversement considérable. Nous serons le seul pays au monde doté d'une mesure de ce type puisque la proximité entre les investigateurs et leur comité de contrôle est la règle dans le monde entier.
Troisième traumatisme, l'évaluation de la méthodologie. Depuis la loi Huriet, c'est à dire depuis vingt-cinq ans, ce sont les CPP qui en sont chargés. Tout le détail de l'essai est analysé non pas par l'Agence du médicament mais par eux. Et il en va de même dans le monde entier. Cela procède de l'idée que l'on ne peut pas juger de l'éthique d'un projet si l'on ne connaît pas son contenu scientifique. Le Pr Jean Bernard disait que tout ce qui n'est pas scientifique n'est pas éthique. Et ce principe est inscrit dans la déclaration d'Helsinki, dans laquelle on voit l'origine et de la loi Huriet et de la législation européenne. Or, le règlement européen recommande - ce n'est pas une obligation - que toute l'évaluation méthodologique soit réalisée par l'Agence du médicament. En France, cela représente une révolution copernicienne. D'autant que l'Agence fait observer que non seulement elle ne l'a jamais fait, mais qu'elle n'a pas les moyens de le faire, étant donné que l'on réduit tous les ans son budget.
Le Gouvernement a, sur ce point, rendu un arbitrage, puisque dans le projet d'ordonnance soumis à consultation publique en juillet dernier, il est prévu, comme le recommande le règlement européen, de confier toute l'évaluation méthodologique à l'ANSM. Dans tous les pays européens, c'est une question qui fait débat, et l'on ne peut préjuger de ce que décideront les autres Etats membres.
Le Sénat s'était beaucoup inquiété de la demande d'habilitation de l'article 53 du projet de loi Touraine, et avait voté contre cet article, considérant qu'il s'agissait d'une chose trop sérieuse pour être confiée au Gouvernement. Dans votre exposé des motifs, vous parliez exclusivement des CPP. Et vous avez été entendus, puisque la rapporteure à l'Assemblée nationale n'a donné son accord qu'avec réserve, en spécifiant qu'il ne fallait pas toucher à la loi Jardé. Le projet d'ordonnance propose donc des adaptations à la marge pour transposer le règlement, mais ne touche pas à la loi Jardé. Il est finalisé, a reçu l'accord du cabinet, et sera transmis au Conseil d'Etat dans les jours qui viennent. Le texte devrait donc revenir sous quelques mois devant le Parlement pour ratification. A partir de là, le décret pourra repartir devant le Conseil d'Etat et l'on peut espérer qu'à l'automne 2016, la loi Jardé s'appliquera. Sauf pour ce qui concerne le médicament, puisque le règlement européen ne sera pas mis en application avant début 2018.

Nous avons discuté près d'un an avant de tomber d'accord, et je vous remercie de souligner l'apport du Sénat. Le retard imputable à l'Europe est regrettable, car le texte issu de la navette était novateur. Cela dit, s'il a pu servir d'exemple, c'est quelque chose. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure au docteur Peton, nous avions exclu les recherches sur le médicament au deuxième alinéa de l'article 1er. Je suis d'accord avec vous lorsque vous dites que le retard pris n'a pas eu d'incidence dans l'affaire de Rennes. Une précision cependant : nous avions prévu que les modalités relatives aux désignations aléatoires n'entreraient en vigueur que dans un délai de deux ans suivant la publication des décrets d'application. C'est une mention qu'il faudra supprimer pour ne pas retarder encore de deux ans.
Quant à la commission nationale, nous avions bien précisé qu'elle ne devait pas devenir une commission d'appel. Il était prévu que si le promoteur pouvait, en l'argumentant, refuser un premier choix, il devrait accepter une nouvelle décision, prise sous un mois. Ce qui permettait de répondre à l'inquiétude que vous avez formulée sur le risque qu'un CPP se trouve mal armé pour l'analyse de telle recherche à lui confiée.
Il est bon de rappeler que nous étions alors en pleine affaire du Médiator. Le soupçon de « magouille » était partout, et c'est pourquoi nous avions retenu le principe du tirage au sort, dans l'esprit que vous avez rappelé. Et si nous avions retenu la période assez large de deux ans que vous évoquez, c'est que nous ne savions pas comment l'Agence allait mettre en place les choses. Soyez rassuré, cette mention sera supprimée.

Je m'inquiète du délai lointain d'application du règlement européen, pour ce qui concerne le médicament. Quand on voit la pression qu'exercent les Etats-Unis sur les pays européens dans la négociation du traité transatlantique - au point que six pays seulement épousent les vues de la France, tandis que les vingt-deux autres penchent plutôt du côté des thèses ultralibérales américaines - on se demande si les progrès de ce traité ne sont pas de nature à perturber les positions des Etats membres en matière de médicament.
Je ne crois pas. Le règlement a été formellement voté. Vu la lourdeur de la mécanique bruxelloise, on n'y touchera plus avant dix ou quinze ans. Je comprends que le délai de mise en application vous inquiète, d'autant qu'il faudra de surcroît un délai de six mois pour la mise en oeuvre du portail informatique européen, auquel les vingt-huit agences auront accès, et par lequel vont transiter tous les dossiers. Quand on sait qu'en France, moins d'un tiers des CPP sont informatisés, on mesure l'effort qu'il faudra fournir. Cela risque, là encore, d'être un facteur de retard.

Quand on voit le retard qu'a pris le DUME, le document unique pour les marchés européens, qui doit favoriser l'accès des PME à la commande publique, il y a de quoi s'inquiéter.

Pour avoir participé, la semaine dernière, au conseil d'administration de l'ANSM, je puis témoigner que l'Agence est dans une grande inquiétude. On lui demande, comme à toutes les agences, d'assumer toujours plus de missions avec des moyens toujours plus réduits. Aura-t-elle les moyens de remplir cette nouvelle mission ? Mon interrogation est, je crois, largement partagée.
C'est en effet un souci que tout le monde partage. L'Agence a clairement indiqué au ministère de la santé qu'elle avait besoin de moyens supplémentaires. Or, comme toutes les institutions publiques en ce moment, elle voit réduire ses crédits et ses moyens en personnel.

On sait qu'un certain nombre de dispositifs de santé sont directement soumis au comité économique des produits de santé sans passer par un protocole d'expérimentation. Comment tout cela va-t-il s'articuler, in fine ?
En matière de dispositifs, un règlement européen est en préparation. Il ne devrait plus tarder, puisqu'il est en phase trilogue, et nous devrons aussi l'intégrer dans notre droit national.

S'agissant du choix aléatoire, le texte est-il satisfaisant au regard des problèmes que vous avez évoqués ?
Le texte est à mon sens équilibré. Nous ne voulions pas que la commission nationale soit un « super CPP ». Son président ne pourra pas en être issu. Il aura un oeil extérieur. Cela dit, si l'on procède par tirage au sort, la commission nationale est indispensable, pour harmoniser. J'estime que le texte retenu après des discussions approfondies est applicable, qu'il confère aux patients une sécurité et donne un cadre lisible aux chercheurs. Nous jouissons d'une expertise en matière de recherche médicale : si on ne propose pas un cadre clair, elle partira à Shanghai ou ailleurs. D'autant que la loi du nombre ne joue pas en notre faveur. Quand, dans une communication internationale, je présente une recherche sur 100 ou 150 cas, je suis content. Mais les Indiens arrivent avec 500 ou 1 000 cas. C'est pourquoi il me paraît important de libérer la recherche observationnelle, une recherche d'avenir susceptible de nous maintenir dans la compétition internationale. Vous savez tous, pour en connaître dans vos départements, combien les laboratoires de recherche sont importants au plan économique. C'est pourquoi il est temps que ce texte entre en application.

Si j'ai bien compris ce qui s'est dit lors de l'audition précédente, l'indépendance des personnels scientifiques salariés des comités n'est pas garantie. Vous indiquez que le Gouvernement français a choisi de confier à l'ANSM la responsabilité de la méthodologie. A Rennes, vous dites que la réglementation a été respectée, mais il reste que des animaux sont morts lors de la phase préclinique. L'agence aura-t-elle connaissance, dans un cas comme celui-là, de ce qui se sera passé avant l'expérimentation sur l'homme ?
L'affaire de Rennes a soulevé une émotion justifiée mais nous ne disposons pas encore de tous les rapports. Nous n'avons pas encore celui de l'ANSM, ni le résultat de l'enquête judiciaire. Plusieurs problèmes sont posés : lien diagnostic entre le décès et l'expérimentation, mise en route du protocole sur huit autres personnes, ce qui représente un nombre important, retard de quatre jours à la déclaration. Mais sans doute le Pr Lemaire est-il mieux à même que moi de vous répondre.
Je n'ai pas dit que la réglementation avait été respectée, mais que la réglementation était en soi adéquate. Un fait nouveau implique une déclaration à l'Agence dans les 24 heures, ce qui n'a pas été fait. En ce qui concerne la mort des chiens, Dominique Martin, le directeur de l'Agence, a clairement expliqué qu'au cours des phases précliniques, les doses administrées aux animaux sont considérablement plus importantes que celles qui seront administrées aux humains. C'est bien parce que l'on ne connaît pas le dosage à ce stade que l'on augmente les doses jusqu'au stade létal, celui où des signes graves apparaissent chez l'animal.

Nous avions insisté, à l'époque, sur l'harmonisation et la mise à niveau des CPP, indispensables l'une et l'autre. Transférer une compétence des CPP à l'Agence ne risque-t-il pas de les affaiblir, en les vidant de leur substance ?
C'est tout le problème. Les CPP vont devoir affronter et le tirage au sort et l'abandon de la méthodologie, une prérogative à laquelle ils sont pourtant très attachés. Alors que l'Agence ne dispose pas de méthodologiste pour faire ce travail, les CPP en ont chacun deux. Ces 80 méthodologistes travaillent depuis vingt-cinq ans sans qu'aucun scandale lié à un défaut de compétence soit à ma connaissance survenu. Il y a donc réellement un problème.
Cela dit, il ne faut pas caricaturer. Les CPP arguent qu'ils ne pourront pas rendre un avis éthique s'ils ne rendent pas un avis scientifique. En fait, ils disposeront de tous les documents leur permettant d'exercer leur expertise scientifique. Simplement, c'est l'Agence qui délivrera l'avis, lequel doit rassembler en un acte unique les considérations scientifiques et éthiques, ainsi que le stipule le règlement européen. Il est donc faux de dire que les comités vont perdre tout regard sur la méthodologie. Mais ce ne sont pas eux qui rendront l'avis final.

Les CPP et, a fortiori, l'Agence, auront-ils connaissance de l'ensemble des essais précliniques ? Si j'ai bien compris, ils disposent plus souvent d'une synthèse que d'une liste complète qui leur permettrait de juger sur pièces de l'intérêt de poursuivre. C'est du moins ce qui nous a été dit dans un autre cadre - il semble que la transparence ne soit pas totale.
Tous ces éléments sont contenus dans ce que l'on appelle la brochure de l'investigateur, un document substantiel. C'est un document distinct du protocole, qui relate dans le détail tout le préclinique, la chimie, la toxicologie, etc. Ces documents sont-ils complets ? Sans doute pas, car le secret industriel peut être invoqué. C'est ce qui s'est passé en l'espèce. Pour avoir été attaché du député européen Philippe Juvin, je puis vous dire qu'à l'échelle européenne, les discussions ont été vives sur ce point, les tenants de l'open data poussant de toutes leurs forces en faveur de la transparence totale tandis que les industriels faisaient valoir qu'ils devaient préserver une part de secret.
Cela se retrouve dans le texte final : la transparence est un leitmotiv du règlement européen.

Il me reste à vous remercier. Nous poursuivrons la semaine prochaine nos auditions sur le sujet. Nous recevrons le Dr Alain Masclet, président de l'association AR2S (Améliorer les relations soignants-soignés), puis Mme Geneviève Chêne, directrice de l'Institut de santé publique de l'Inserm.
La réunion est levée à 11 h 38.