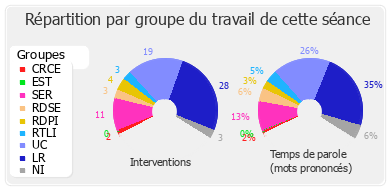Séance en hémicycle du 14 janvier 2020 à 9h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Demande d'inscription à l'ordre du jour d'un projet de loi
- Questions orales (voir le dossier)
- Risque routier et sanitaire lié au trafic de poids lourds entre poitiers et bordeaux (voir le dossier)
- Abus de faiblesse liés à la généralisation de la signature électronique à distance (voir le dossier)
- Consultations externes proposées par les hôpitaux de proximité dans les territoires sous-dotés (voir le dossier)
- Extension de l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » à la commune de port-jérôme-sur-seine (voir le dossier)
- Demande de reconnaissance de catastrophe naturelle émise par la commune de leforest (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 9 janvier 2020 a été publié sur le site internet du Sénat.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté.

Par lettre en date du 9 janvier, le Gouvernement demande l’inscription des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire à l’ordre du jour du jeudi 30 janvier, à quatorze heures trente.
Acte est donné de cette demande.

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, auteure de la question n° 993, adressée à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Madame la ministre, ma question porte sur l’application de la loi Littoral et ses conséquences sur le développement des projets portés par les communes du territoire seinomarin.
En effet, les services de l’État opposent parfois une lecture stricte des dispositions de cette loi à de nombreux élus porteurs de projets. Cette situation est d’autant plus difficile à comprendre que la loi ÉLAN, conformément à la volonté du législateur, a apporté des assouplissements à la loi Littoral pour accompagner l’urbanisation des communes littorales.
J’ai été notamment saisie par le maire de Sassetot-le-Mauconduit, commune de l’agglomération Fécamp Caux Littoral, laquelle a souhaité établir son document-cadre en matière d’urbanisme. Le travail mené a été exemplaire en tous points, comme l’a souligné le préfet.
Les services de l’État ont toutefois émis des réserves sur l’arrêt de projet, ce qui soulève des inquiétudes. Il n’est en aucun cas question de remettre en cause les observations formulées sur la bande des 100 mètres ou sur les zones proches du rivage, dont la protection est légitime et tout à fait souhaitée. Les points d’inquiétude portent sur ce qui s’apparente à des incohérences dont, faute de temps, je ne peux dresser la liste – je pourrai vous la faire parvenir, madame la ministre – et sur une interprétation stricte de la loi Littoral ignorant les termes de la loi ÉLAN.
Je m’en suis ouverte au préfet, lequel a pris soin, et je l’en remercie, de me répondre en détail. Si j’ai bien compris, dans le cadre d’un système transitoire, des autorisations d’urbanisme pourraient être accordées. Mais plus largement, madame la ministre, cette question de surinterprétation demeure. Ma collègue Agnès Canayer est d’ailleurs en train de travailler sur cette question avec la DDTM (direction départementale des territoires et de la mer).
De très nombreuses communes nous saisissent. C’est le cas, par exemple, de la commune de Cauville-sur-Mer, qui souhaiterait requalifier en « habitations » des bâtiments agricoles à caractère architectural remarquable afin de les préserver et qui s’est vu opposer un refus. De même, à Yville-sur-Seine, un agriculteur dont un des bâtiments agricoles a été endommagé à la suite d’inondations n’a pas été autorisé à le reconstruire, ce qui nuit à son activité. Je pourrais multiplier les exemples.
Madame la ministre, je souhaitais vous alerter et connaître votre état d’esprit et votre interprétation de la loi sur ces questions, qui, je le sais, remontent à vous de toute part.

Madame la sénatrice, je tiens d’abord à saluer le travail accompli par la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral dans le cadre de l’élaboration de son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI).
L’État a reconnu la qualité du projet et a émis un avis favorable, assorti d’observations. Ces dernières ne constituent nullement une remise en cause du caractère urbain de plusieurs des secteurs, comme vous l’évoquez. Elles visent à renforcer la sécurité juridique du PLUI, notamment au regard des évolutions récentes apportées à la loi Littoral par la loi ÉLAN et du SCOT (schéma de cohérence territoriale) applicable sur la zone depuis 2014.
Ainsi, lors de l’examen du projet arrêté, l’État a constaté que la communauté avait retenu une qualification différente du SCOT pour certains secteurs, à savoir celle de village. Ces observations visaient donc simplement à répondre à l’exigence de compatibilité du PLUI arrêté avec le SCOT en vigueur.
Un autre point d’achoppement portait sur la qualification de certains secteurs en zones urbaines dans une période transitoire au cours de laquelle cette qualification n’a pas encore été confirmée dans le SCOT.
Après examen, il semble que le zonage urbain de ces secteurs ne soit pas remis en cause par l’avis de l’État. C’est un point important, parce que ce zonage ouvre la possibilité de délivrer, sous réserve de l’accord du préfet, des autorisations de construire.
Les règles de constructibilité prévues par le projet de PLUI pour ces secteurs ne répondaient pas tout à fait à ce qu’autorise la loi ÉLAN. Des ajustements étaient donc nécessaires.
La mise en place d’un Stecal (secteur de taille et de capacité d’accueil limitées) s’est avérée incompatible avec la loi Littoral. Il convenait donc de requalifier le secteur concerné.
Dans cette période où les documents d’urbanisme évoluent pour tenir compte des nouvelles dispositions de la loi ÉLAN, certains territoires peuvent rencontrer des difficultés pour faire aboutir leurs projets d’urbanisation. Toutefois, point positif à souligner, les préfets et leurs services demeurent pleinement mobilisés pour apporter leur appui et leur expertise aux communes qui les solliciteraient pour les accompagner. Il ne s’agit en aucun cas de les freiner.
La communauté d’agglomération de Fécamp Caux Littoral a d’ailleurs eu, et continue d’avoir, de nombreux échanges avec les services déconcentrés de l’État.
J’insiste sur l’importance de faire évoluer concomitamment les SCOT et les PLU ou PLUI. La loi ÉLAN attribue au SCOT un rôle majeur dans la traduction, à l’échelon local, des principes de la loi Littoral. Aussi, j’invite les porteurs de SCOT, aux côtés des intercommunalités, à s’engager dès que possible dans une démarche d’adaptation de leur schéma.
J’entends également, madame la sénatrice, le besoin de souplesse que vous évoquez.

Je vous remercie, madame la ministre, des précisions que vous m’avez apportées.
Je souhaitais simplement vous alerter, comme certains autres de mes collègues, sur les freins parfois apportés à des projets de développement économique, touristique et d’aménagement, ainsi que sur les problèmes de requalification de certains bâtiments dans les territoires.
Mais je crois que vous êtes parfaitement consciente de ces questions et que nous allons poursuivre le travail avec les services de l’État. Notre préfet y est attentif.

La parole est à Mme Christine Herzog, auteure de la question n° 1030, adressée à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Madame la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, j’appelle votre attention sur le déploiement des maisons France services (MFS), annoncé par le Premier ministre le 4 mai dernier.
Il existe aujourd’hui 1 340 maisons de services au public (MSAP). Avec l’annonce du Premier ministre, 500 maisons France services vont être mises en place – requalifiées ou créées – dans les zones rurales. Or il ne faudrait pas que les MSAP fassent les frais d’une telle mise en place et finissent par disparaître.
La Cour des comptes souligne, dans son rapport de mars 2019, le risque pour les MSAP de devenir « des structures de délestage de l’État et des opérateurs qui y verraient l’occasion de réduire leurs coûts de réseaux en les transférant aux collectivités ». Autrement dit, une charge financière supplémentaire pour les territoires.
De plus, elle dénonce « l’impasse du financement des MSAP », dont les fonds, qui reposent pour moitié sur les collectivités, ne seraient « pas de nature à en garantir la pérennité ».
À titre d’exemple, la commune de Kédange-sur-Canner, en Moselle, a créé une MSAP – la seule de son canton – en engageant d’importantes dépenses. Le Gouvernement ayant décidé qu’il n’y aura dorénavant qu’une seule MFS dans chaque canton, que deviendra cette MSAP si elle n’est pas labellisée ? Je pense également aux MSAP d’Albestroff, de Dabo et de Lorquin, toujours en Moselle. Que vont-elles devenir ? Devront-elles fermer ?
Je souhaiterais donc savoir, madame la ministre, quel sera l’avenir des MSAP. Que compte faire le Gouvernement pour compenser et réparer le préjudice financier des communes qui ont déjà investi dans ces structures ?
Par ailleurs, pouvez-vous nous dire comment vous allez aider les communes à financer ces maisons France services, notamment dans les zones rurales ?

Madame la sénatrice, les choses sont claires.
Les maisons de services au public ont été créées par le gouvernement de Manuel Valls, alors Premier ministre. Les 1 340 MSAP présentes sur le territoire sont, dirais-je, de qualité extrêmement diverse. Or la démarche France services vise justement à améliorer le niveau des services publics offerts dans les territoires au travers de la création de maisons France services et de la labellisation de l’existant. Il n’est aucunement question de fermer les MSAP, mais simplement de les faire monter en gamme pour les labelliser, comme nous avons déjà eu plusieurs fois l’occasion de le dire.
Ce que nous voulons, ce n’est pas qu’il n’y ait qu’une MFS par canton, c’est qu’il y en ait « au moins » une, d’autant que certains cantons se sont notablement agrandis depuis la dernière réforme.
Sur les 460 premières MFS qui ont vu le jour en début d’année, environ 70 sont des créations et les autres des labellisations de MSAP existantes. Nous allons en labelliser au fil de l’eau : si une MSAP est prête, une fois que nos services auront vérifié que tout est conforme à la charte, nous la labelliserons.
En Moselle, me semble-t-il, à l’issue de la procédure de labellisation des projets proposés par la préfecture, la structure d’Entrange, qui répondait aux trente critères de qualité de service, a été labellisée. Un nouvel audit va être effectué dans les prochaines semaines pour les structures de Boulay-Moselle et de Morhange, particulièrement proches de la labellisation.
Si l’objectif, je le répète, est d’avoir au moins une structure par canton, je connais certains cantons où l’on trouve trois ou quatre MSAP dont certaines ont été labellisées. Nous n’avons pas l’intention de les fermer. Au contraire, nous voulons multiplier la présence des services publics dans les territoires. Nous signons de nouveaux partenariats, notamment avec la mutualité sociale agricole (MSA), pour porter des MFS en sus des collectivités territoriales – mairies, départements ou intercommunalités –, des associations ou de La Poste.
En ce qui concerne le financement, l’État et les opérateurs présents versent 30 000 euros par MSAP. De même, les partenaires qui portent les maisons contribuent aussi à leur financement. Nous verrons s’il faut augmenter ce montant dans le cadre de la pérennisation des maisons France services.

Merci beaucoup de ces précisions, madame la ministre.
Pourquoi avoir lancé ce nouveau dispositif qui vient s’ajouter aux MSAP, créées en 2016 et qui n’ont pas eu le temps de se déployer ? Les élus locaux sont inquiets et ils ont besoin de garanties.

La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, auteur de la question n° 1043, adressée à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Madame la ministre, ma question rejoint celle de Mme Herzog sans que nous nous soyons concertées, ce qui témoigne des inquiétudes exprimées sur l’ensemble de nos territoires quant au déploiement des maisons France services, plus particulièrement quant au financement des emplois dans ces MFS.
Depuis le 1er janvier dernier, 460 maisons France services doivent être théoriquement ouvertes. Elles ont été créées pour répondre aux besoins des Français dans leurs démarches administratives, principalement en zones rurales et périurbaines, afin de conserver un lien physique avec un certain nombre d’organismes et de services de l’État.
Ces nouvelles structures labellisées seront ouvertes au moins cinq jours par semaine et chacune d’entre elles devra disposer de deux personnes formées à l’accueil du public, capables d’apporter une aide dans les démarches. Or les collectivités locales s’inquiètent de leur financement.
Les préfets ont dû fournir la liste des maisons de services au public existantes « qui pourraient présenter les garanties de qualité et d’accueil pour être labellisées ». À défaut d’homologation, les structures « ne recevront plus de financement de l’État ».
Par ailleurs, comme vous l’avez rappelé, madame la ministre, le financement de chaque nouvelle structure par l’État « sera forfaitisé à hauteur de 30 000 euros par an », ce qui correspond au coût d’un seul agent d’accueil dans chaque maison.
En outre, la Cour des comptes a souligné l’effet de ciseau qui atteint le réseau d’avant 2020, formaté pour 1 000 maisons seulement. Son budget de fonctionnement, à hauteur de 60 millions d’euros, repose à 50 % sur les collectivités ou les associations qui portent ou hébergent les maisons, à 25 % sur les fonds de l’État, restés stables depuis 2014, et à 25 % sur un fonds abondé par certains opérateurs dont se sont retirés la SNCF ou GRDF.
Les labellisations de MSAP au nouveau réseau France services se traduiront-elles par des charges nouvelles ou supplémentaires pour les communes ou les intercommunalités, compte tenu, par exemple, de l’obligation de disposer de deux agents pour recevoir le public ?
Que compte faire le Gouvernement pour le réseau actuel de maisons de services au public non labellisées et éviter qu’elles ne ferment ? Il s’agit de pérenniser ces emplois sur nos territoires.

Madame la sénatrice, je vais préciser certains points.
Je veux tout d’abord souligner la volonté du Gouvernement de développer la qualité des services publics proposés dans les maisons. Je me déplace beaucoup dans les territoires et j’ai vu des MSAP qui n’en ont que le nom. Il était nécessaire d’y remettre de la qualité. D’autres, formidables, ont été labellisées immédiatement.
Pour répondre à votre question, les MSAP qui n’ont pas été labellisées seront accompagnées financièrement jusqu’au 31 décembre 2021. Nous nous y engageons. Durant cette période, nous aiderons celles qui n’ont pas le niveau souhaité – je ne peux pas le dire autrement – à l’atteindre pour obtenir leur labellisation, ce qui laisse encore du temps et ne doit pas vous faire craindre de fermeture.
Le nouveau plan de financement pour les années 2020-2022 repose sur une convention avec les opérateurs partenaires. La Banque des territoires, par exemple, qui émane de la Caisse des dépôts et consignations, investit ainsi 30 millions d’euros pour assurer le déploiement de France services. Sur cette enveloppe, 17 millions sont alloués à La Poste, 10 millions à l’animation globale du réseau et 3 millions d’euros permettront le déploiement de structures France services mobiles.
L’État apporte un soutien financier aux structures France services labellisées, ainsi qu’aux MSAP en cours de montée en gamme : sa participation aux dépenses de fonctionnement de la structure consiste en un forfait de 30 000 euros, contre 25 000 euros par an en moyenne aujourd’hui. L’État accompagne également les collectivités dans leur investissement au travers des différentes dotations de soutien : on peut, par exemple, mettre de la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) sur les équipements au profit d’une commune ou d’une intercommunalité qui ouvre une maison France services.
La formation dite « métier » des agents polyvalents est conduite par l’institut 4.10, qui relève de la sécurité sociale et qui met à disposition tous les outils nécessaires pour cette formation.
À l’échelon national, une équipe de douze personnes, composée d’agents de l’État, de la Banque des territoires et de La Poste, pilote ce programme d’appui au sein de l’Agence nationale de la cohésion des territoires.
Nous ferons un point financier dans un an. Je le redis, nous ne sommes pas opposés, par principe, à revaloriser notre soutien, le cas échéant.

Madame la ministre, la qualité dépend aussi de la présence de personnels sur les lieux. Or le financement du poste de deuxième agent d’accueil n’est pas garanti. Cet emploi risque d’être à la charge des collectivités territoriales, ce qui ne sera pas toujours possible, au détriment de la qualité.

La parole est à M. Jean-François Rapin, auteur de la question n° 1070, adressée à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Madame la ministre, en créant l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) afin de remédier aux disparités constatées dans notre pays, le Gouvernement a souhaité améliorer la cohésion territoriale. Nous ne pouvons que nous en réjouir.
L’article 3 de la loi du 22 juillet 2019 portant création de cette agence spécifie que « le conseil d’administration doit être composé de manière à favoriser une juste représentation de la diversité des territoires métropolitains et ultramarins ».
Pourtant, à la lecture du décret du 18 novembre 2019 relatif à cette agence, il s’avère qu’aucun représentant spécifique du littoral n’a été identifié. Ce sont tous les territoires littoraux de la France hexagonale et des outre-mer, reconnus par la loi Littoral de 1986 pour leur spécificité et le caractère exceptionnel de leur richesse en biodiversité, qui sont ici oubliés. Je ne peux m’y résoudre en tant que sénateur d’un département disposant d’une frange littorale importante et président de l’Association nationale des élus du littoral.
En parallèle, plusieurs associations d’élus bénéficient d’un siège, notamment l’Association nationale des élus de la montagne. Une telle situation interroge : si les spécificités de la montagne sont prises en compte, pourquoi celles du littoral ne le sont-elles pas ? Submersion marine, érosion côtière, changement climatique, biodiversité, préservation du patrimoine, économie bleue… Ces sujets ne méritent-ils pas d’être pleinement considérés dans le cadre d’une telle agence ?
Après plusieurs courriers vous alertant sur ce sujet, dont un émanant de députés de votre majorité, et une tribune signée par plus de 140 parlementaires, la situation n’a malheureusement pas évolué.
Pour une cohésion nationale forte, qui vous est chère, madame la ministre, et dans l’intérêt des 6 millions d’habitants résidant sur nos littoraux, ce décret doit être modifié. Une révision indispensable pour redonner au littoral, ainsi qu’à ses nombreux acteurs, la juste place qu’ils doivent naturellement avoir.
Quelles sont donc vos intentions à ce sujet ?

Monsieur le sénateur, le conseil d’administration de l’Agence nationale de la cohésion des territoires, qui s’est réuni pour la première fois le jeudi 12 décembre 2019, est composé de manière à concilier deux impératifs presque antagonistes : une taille réduite et pilotable, d’une part ; la fidèle représentation des multiples enjeux du territoire national, d’autre part.
Je vais essayer de vous répondre franchement, monsieur le sénateur, sans vouloir formuler le moindre reproche.
M. Jean-François Rapin s ’ étonne.

Si les élus du littoral font défaut dans la composition du conseil d’administration, les torts me semblent quelque peu partagés.

Je vous le dis gentiment et amicalement.
J’ai essayé de répondre à votre préoccupation, évoquée d’ailleurs lors de la première réunion du conseil d’administration. Plusieurs administrateurs, titulaires ou suppléants, sont issus de collectivités territoriales littorales. Votre association n’a certes pas été consultée, mais nous avons fait en sorte d’assurer la présence d’élus du littoral au sein du conseil.
Je me suis battue pour assurer la présence du plus grand nombre de représentants d’associations d’élus locaux au sein de ce conseil d’administration, tout en lui conservant une taille suffisamment réduite pour ne pas nuire à son efficacité. C’est la raison pour laquelle nous n’envisageons pas, aujourd’hui, de modifier le décret.
Je sais que cette réponse ne vous convient pas, monsieur le sénateur. Toutefois, j’aurai des propositions très concrètes à vous faire sur les thématiques que vous évoquez et les politiques que vous défendez pour faire en sorte que vos préoccupations soient vraiment défendues au sein de l’ANCT.

Madame la ministre, votre réponse ne me convient absolument pas. Quand bien même vous ne le souhaitiez pas, vous m’avez vexé !
La loi portant création de l’Agence nationale de la cohésion des territoires précise que « le conseil d’administration doit être composé de manière à favoriser une juste représentation de la diversité des territoires métropolitains et ultramarins ».
Faut-il, pour être reconnu par le Gouvernement ou même par l’État, en passer par du lobbying ? C’est bananier ! Faut-il se battre pour réclamer le droit de siéger dans ce conseil d’administration ? Je suis désolé de vous le dire, mais votre réponse montre une méconnaissance des territoires. Les élus du littoral ne peuvent s’en satisfaire.

La parole est à M. Dany Wattebled, auteur de la question n° 1025, transmise à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Madame la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, dans le cadre des élections municipales et communautaires de mars 2020, les élus locaux s’interrogent sur la portée des modifications de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issues de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain.
En effet, cet article relatif aux organes délibérants des EPCI prévoit : « Après le renouvellement général des conseils municipaux, l’organe délibérant se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires. »
Depuis la loi du 28 février 2017 susvisée, l’article L. 5211-6 du CGCT dispose désormais : « Lors de la première réunion de l’organe délibérant, immédiatement après l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, le président donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1. »
Les élus locaux s’interrogent sur le caractère obligatoire de procéder le même jour, et lors de la même séance, à l’élection du président de l’EPCI, des vice-présidents et des autres membres du bureau.
En effet, les métropoles comportent un nombre important d’élus et leurs représentants ne sont connus qu’à l’issue du deuxième tour des élections municipales. À l’échelle d’une métropole, il est donc difficile d’organiser une gouvernance en amont du résultat des élections municipales, contrairement à ce qui peut être fait à l’échelle d’une commune.
Dès lors, il est de pratique courante, au sein des métropoles, de procéder, dans un premier temps, à l’élection du président puis, dans un second temps, lors d’une autre séance – généralement une quinzaine de jours après –, à l’élection des vice-présidents et du bureau.
La modification de l’article L. 5211-6 du CGCT a eu pour finalité de rendre obligatoire la lecture de la charte de l’élu local lors de l’élection du président et des vice-présidents de l’EPCI.
Peut-on considérer que les dispositions de cet article sont respectées si l’élection du président et des vice-présidents a lieu lors de deux séances distinctes, mais que la charte de l’élu local est lue par le président lors de chacune de ces séances ? Ou faut-il considérer qu’il est désormais obligatoire de procéder à l’élection du président de l’EPCI, des vice-présidents et des membres du bureau le même jour et lors de la même séance ?

Monsieur le sénateur Dany Wattebled, l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales dispose en effet : « Lors de la première réunion de l’organe délibérant, immédiatement après l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, le président donne lecture de la charte de l’élu local […] »
Cet article a été modifié par l’article 2 de la loi du 31 mars 2015 pour intégrer la lecture de la charte de l’élu local après l’élection de l’exécutif intercommunal.
L’intention du législateur était de mettre en œuvre la proposition n°°24 du rapport de la mission d’information sur le statut de l’élu, en créant une charte de l’élu local comme cadre déontologique.
Lors des débats parlementaires en commission des lois, le rapporteur avait précisé que les conseils municipaux et les conseils communautaires seraient concernés de la même façon par cette disposition.
Je vous confirme ainsi que, après le prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires de mars 2020, le président, les vice-présidents et les autres membres du bureau d’un EPCI à fiscalité propre seront élus lors de la même réunion du conseil communautaire.
J’attire votre attention sur le fait que la disposition prévoyant que, « après le renouvellement général des conseils municipaux, l’organe délibérant se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires » demeure au sein de l’article L. 5211-6 du CGCT.
Cette disposition permet de laisser un temps d’échange aux élus des conseils communautaires pour procéder à l’élection de leurs exécutifs.
Dès lors, en prévoyant un délai de près de cinq semaines entre l’élection des conseillers communautaires et l’élection de leurs président, vice-présidents et membres du bureau, le législateur a reconnu la nécessité, pour les EPCI à fiscalité propre, de bénéficier d’un temps plus long pour constituer leurs exécutifs.
Par comparaison, l’article L. 2121-7 du CGCT ne laisse qu’une semaine aux conseils municipaux pour procéder à l’élection des maires et des adjoints.
Il reste enfin loisible, de façon concrète, tout en organisant l’élection des vice-présidents et des autres membres du bureau dans la continuité de celle du président et lors de la même réunion, de réserver une suspension de séance dans le déroulement de ces scrutins.

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, auteure de la question n° 1040, adressée à M. le secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports.

Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite attirer votre attention sur l’importance du trafic poids lourds, plus particulièrement celui en transit sur la RN10 entre Poitiers et Bordeaux.
Certains de ces poids lourds ne respectent ni les distances de sécurité, ni l’interdiction de doubler, ni la limitation de vitesse, au point que les routiers eux-mêmes disent prendre un risque pour leur vie et celle des automobilistes.
À l’insécurité routière s’ajoutent la pollution sonore ainsi que la pollution de l’air et des sols, si bien que les agriculteurs, soucieux de produire de la qualité, sont contraints de cultiver à plus de 300 mètres de la RN10 et à plus de 500 mètres pour les cultures bio, compte tenu des métaux lourds retrouvés dans les sols.
Au regard des conséquences de ce trafic sans cesse grandissant en termes de sécurité routière, sanitaire, environnementale, sociale et économique, sans oublier le coût d’entretien de la chaussée et la mobilisation des forces de l’ordre, plus de 7 000 personnes ont signé une pétition citoyenne demandant que les poids lourds en transit empruntent l’autoroute A10 adaptée à ce trafic et non plus la RN10. Par ailleurs, 126 communes ont délibéré dans le même sens.
Vous le savez, monsieur le secrétaire d’État, l’autoroute A10 est parallèle à la RN10. Les poids lourds en transit quittent cette autoroute et traversent notamment mon département de la Charente en empruntant la RN10, ce afin d’économiser une cinquantaine d’euros de péage.
Une telle situation n’est ni tenable ni acceptable. Le 19 novembre dernier, Mme la ministre Élisabeth Borne, que j’interpellais sur ce sujet, me répondait qu’« il fallait se préoccuper des poids lourds en transit pour faire en sorte qu’ils n’aient pas la tentation d’emprunter des itinéraires gratuits ».
Ma question est simple : que comptez-vous faire, monsieur le secrétaire d’État, pour régler ce problème ?
Madame la sénatrice, la restriction complète sur la route nationale 10 entre Poitiers et Bordeaux du trafic de poids lourds serait contraire au principe de libre circulation des marchandises sur le réseau structurant national. Vous le savez, la jurisprudence du Conseil d’État est constante sur ce point, afin de garantir un principe fort de la réglementation européenne.
Pour autant, les services de l’État chargés du contrôle sont mobilisés sur le terrain pour assurer le respect des réglementations applicables au transport routier, afin de prévenir les risques de surcharge. Il s’agit de contrôler notamment le temps de conduite et de repos des chauffeurs, ainsi que le respect de leurs conditions de travail.
Le Gouvernement entend donc prendre des mesures d’amélioration des infrastructures. Une telle politique est mise en œuvre sans porter préjudice aux concertations qui pourraient intervenir à l’avenir.
De nombreuses opérations de sécurisation de cet axe ont d’ores et déjà été engagées : la mise en service de la 2x2 voies entre Reignac et Chevanceaux ; l’étude du remplacement de six carrefours dans la Vienne par des échangeurs dénivelés avec mise à 2x2 voies dans le secteur de Croutelle ; l’étude de la suppression des derniers carrefours en Charente, notamment sur la commune de Mansle ; le diagnostic de sécurité sur la rocade d’Angoulême, en vue d’améliorer, dès 2020, les modalités d’information des usagers de la route, en particulier sur les congestions récurrentes et les risques d’accidents ; enfin, le diagnostic de sécurité sur la section entre Virsac et Angoulême.
Au regard de ces nombreux projets d’amélioration de l’infrastructure routière, le Gouvernement va demander à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine de s’assurer que chaque calendrier d’opération soit respecté au mieux.
Par ailleurs, le Gouvernement mandatera la préfète de la Charente, afin que des dispositifs de contrôle fixes et mobiles soient déployés de façon privilégiée sur cet axe, de manière à renforcer la répression contre les poids lourds qui ne respecteraient pas les différentes réglementations.

Je connais, monsieur le secrétaire d’État, les investissements réalisés pour améliorer la RN10. Je sais aussi, parce que je l’ai déjà entendu, que l’interdiction des poids lourds serait contraire au droit européen en matière de libre circulation des biens et des marchandises. En revanche, des dérogations ou des expérimentations sont possibles, et il faut y travailler ensemble.
La préfète de région, que j’avais interrogée sur ce sujet, était tout à fait favorable à l’étude d’une expérimentation ou d’une dérogation.
Je vous le répète, 7 000 personnes ont signé la pétition en question, dont 140 maires. Il y a donc là un vrai problème, qui va grandissant, y compris concernant la sécurité. Faut-il attendre qu’il y ait des morts pour que la situation évolue ?
Enfin, dans la loi LOM (loi d’orientation des mobilités), vous avez donné la possibilité, sur des routes départementales ou nationales, de créer des voies propres. Très bien, mais nous serions exclus de la politique de transition écologique ! En effet, jamais nous ne pourrons dédier tout ou partie de la RN10, qui est uniquement consacrée aux poids lourds, à une voie propre.
C’est un vrai problème, que je souhaite évoquer avec vous, à l’extérieur de l’hémicycle si vous le voulez, en prenant un rendez-vous. Certains de mes collègues rencontrent les mêmes difficultés, il convient donc de trouver une réponse.

La parole est à Mme Corinne Imbert, auteure de la question n° 977, adressée à M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, ma question concerne les abus de faiblesse liés à la généralisation de la signature électronique à distance.
Ce phénomène est principalement constaté dans le secteur des assurances. En effet, un contrat d’assurance peut être souscrit en quelques minutes par téléphone après la simple expression du consentement.
Ce dernier se matérialise généralement par un code reçu par SMS qu’il faut répéter à voix haute au courtier ou encore par une touche de téléphone sur laquelle il faut appuyer. Nous en conviendrons tous, cette spécificité accordée aux assurances est pratique lorsqu’il s’agit d’assurer dans l’urgence sa nouvelle voiture. Mais force est de le constater, elle est bien souvent utilisée à mauvais escient. Ce type de vente est souvent expéditif, afin que le client n’ait pas le temps de prendre la mesure de la situation.
Les personnes isolées, en particulier les personnes âgées et les personnes handicapées, sont bien souvent démunies face à des professionnels de la vente qui n’hésitent pas user de tous les stratagèmes possibles afin de parvenir au plus vite à la signature d’un contrat aux modalités hasardeuses. Bien souvent, ces personnes ne réalisent pas qu’elles viennent de souscrire à un contrat d’assurance, ce qui rend la tâche des familles qui les accompagnent bien plus difficile que dans le cas d’un simple démarchage, en porte-à-porte.
Ainsi, le délai de rétractation de 14 jours n’est souvent pas suffisant pour débusquer la supercherie. Sur la seule année 2018, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a contrôlé 92 entreprises et en a épinglé 27. Dans la plupart des cas, les démarcheurs recourent à des allégations mensongères, afin de recueillir l’accord verbal du consommateur ou obtenir la signature électronique du contrat.
Ma question sera la suivante, madame la secrétaire d’État : au regard des nombreux cas constatés d’arnaques et de ventes forcées, en particulier auprès des personnes âgées ou handicapées, je souhaiterais connaître les intentions du Gouvernement concernant la lutte contre ce phénomène inquiétant.
Madame la sénatrice Corinne Imbert, vous avez raison, cette pression téléphonique est insupportable pour nos concitoyens, en particulier pour les personnes âgées.
C’est pourquoi le Gouvernement a manifesté à plusieurs reprises sa volonté de renforcer la protection des consommateurs contre les pratiques de démarchage téléphonique abusif et intrusif.
Il a ainsi demandé au Conseil national de la consommation (CNC) d’établir un état des lieux des pratiques de démarchage téléphonique et de proposer des mesures pour mieux lutter contre les appels téléphoniques non sollicités et la fraude auxquels ils peuvent donner lieu, qu’il s’agisse de numéros surtaxés ou de contrats non souhaités.
Les travaux du CNC, qui se sont déroulés de septembre 2018 à janvier 2019 dans le cadre d’un groupe de travail dédié, ont fait l’objet d’un rapport qui a été diffusé le 22 février 2019. Ce dernier a nourri les travaux sur ce sujet, en particulier la proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux. Ce texte a fait l’objet d’un premier examen par l’Assemblée nationale le 6 décembre 2018, puis par le Sénat le 21 février 2019. Il sera examiné de nouveau par l’Assemblée nationale à la fin du mois.
Parallèlement, nous avons sollicité le CCFS (Comité consultatif du secteur financier) sur le cas particulier des contrats d’assurance, pour lesquels – c’est un élément qui était remonté dans le cadre de l’analyse effectuée avec la DGCCRF et le CNC – le simple démarchage téléphonique permet d’aboutir à la signature d’un contrat.
Le CCFS et, donc, les professionnels des assurances se sont engagés à ce qu’il ne puisse plus y avoir de signatures de contrats d’assurance par le simple enchaînement de décisions non tracées. Ils se sont donc engagés à respecter un minimum de formalisme, par le biais d’un écrit validant la décision de signature d’un contrat d’assurance.
Sur la base de ces éléments, nous poursuivrons le dialogue avec l’Assemblée nationale, en nous assurant que l’engagement pris par la profession est clairement respecté.
Vous avez raison, madame la sénatrice, il n’est pas légitime qu’un accord sur un sujet aussi complexe qu’un contrat d’assurance soit obtenu sans traçabilité écrite permettant de réagir dans le cadre de la protection des consommateurs.

Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, de votre réponse. Je me réjouis que la proposition de loi que vous venez d’évoquer soit examinée de nouveau par l’Assemblée nationale. J’espère que l’engagement pris par les professionnels sera respecté. La traçabilité écrite, qui est indispensable pour la sécurité et le respect des personnes, lesquelles ne doivent pas être abusées à longueur de semaine, doit faire l’objet d’un suivi par vos services.
D’aucuns pourraient dire que les personnes victimes de ces agissements le sont « à l’insu de leur plein gré » ; c’est bien là tout le problème. Il faut vraiment une traçabilité écrite, car le public dont il est question est fragile et les appels téléphoniques incessants deviennent insupportables. Je sais que ma collègue Catherine Deroche s’apprête à vous interpeller sur ce sujet juste après moi.

La parole est à Mme Catherine Deroche, auteure de la question n° 1022, adressée à M. le ministre de l’économie et des finances.

Madame la secrétaire d’État, ma question s’inscrit dans le prolongement de celle de Corinne Imbert et concerne en effet le démarchage commercial par téléphone.
Depuis plusieurs mois, chacun le constate au quotidien, nous assistons à une explosion du nombre d’appels non sollicités, qui s’apparente à une forme de harcèlement. Le phénomène a pris une ampleur exponentielle concernant les opérateurs téléphoniques mandatés par diverses sociétés exploitant des listings commerciaux pour joindre les occupants – principalement les propriétaires – de maisons individuelles qui pourraient bénéficier de travaux d’isolation à 1 euro.
En juin dernier, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a dû émettre une mise en garde à destination du public français à l’encontre de sociétés peu scrupuleuses cherchant à profiter de ce dispositif très utile.
Ces correspondants opèrent, la plupart du temps, depuis des plateformes basées à l’étranger, avec des numéros qui ne s’affichent pas ou ne peuvent être rappelés. C’est le cas pour les téléphones fixes, mais aussi, désormais, les téléphones portables. Parfois, des numéros commençant par 06 s’affichent, ce qui fait qu’on ne s’attend pas à un démarchage.
Je le sais pour l’avoir mis en place à titre personnel, le dispositif Bloctel ne fonctionne pas.
Certes, une proposition de loi est en cours d’examen par le Parlement. Pour autant, pourriez-vous, madame la secrétaire d’État, nous apporter des précisions sur ce sujet ? En effet, certains de nos concitoyens, à cran, développent une forme d’agressivité dans le cadre de ce type d’appels, qui peuvent se répéter jusqu’à quatre fois en une heure.
Madame la sénatrice Catherine Deroche, votre question s’inscrit effectivement dans le prolongement de celle qu’a posée Mme Imbert.
Nous nous sommes engagés à réduire le nombre d’appels téléphoniques non souhaités, dont il s’avère qu’ils ne respectent pas le droit. Notre difficulté est donc non pas de renforcer la législation, déjà assez dure, concernant l’autorisation des appels, mais de poursuivre les personnes ne la respectant pas.
C’est la raison pour laquelle nous avons travaillé sur un texte qui permettra notamment de renforcer un certain nombre de sanctions. Il autorisera également l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) à se saisir d’un contrôle s’agissant des numéros n’apparaissant pas directement, afin d’agir avec les opérateurs téléphoniques concernant les intervenants peu scrupuleux. Tel est le cas dans le cadre du plan de lutte contre la fraude à la rénovation thermique. En effet, la DGCCRF a recensé une augmentation de 20 % du nombre de plaintes pour fraude en la matière.
Nous voulons mener ce combat. Nous traiterons ce sujet le 30 janvier prochain à l’Assemblée nationale, dans le cadre de l’examen en deuxième lecture de la proposition de loi que j’ai évoquée.
En 2019, 1 000 établissements ont été contrôlés et 70 démarcheurs ne respectant pas le dispositif Bloctel ont été sanctionnés par des amendes, dont le montant total a atteint 2, 3 millions d’euros. Ces amendes seront renforcées, ce qui devrait contribuer à rendre très désagréable, pour les auteurs de ces appels, le fait de démarcher téléphoniquement nos concitoyens.
De la même manière, nous avons généralisé, à ma demande, le name and shame, afin de rendre les Français plus attentifs. Nous diffusons un certain nombre de conseils dans le cadre d’une campagne de sensibilisation aux bons réflexes face aux actes de démarchage téléphonique ou physique, pour ce qui concerne les thématiques complexes de la rénovation thermique.
Nous avons également saisi le CNC (Conseil national de la consommation) sur le démarchage téléphonique dans le cadre de la rénovation thermique, et nous devrions avoir un retour dans quinze jours.

Nous allons donc attendre l’inscription à l’ordre du jour de ce texte, madame la secrétaire d’État.
Je le souligne, les opérateurs se présentent souvent au nom du conseil régional, du conseil départemental ou du ministère, leur discours étant toujours très ambigu. La mise en place d’un indicatif pour cibler le démarchage publicitaire pourrait apporter un certain nombre de solutions, puisque nous pourrions ainsi éviter de répondre en permanence à des gens avec lesquels nous ne souhaitons pas entrer en communication.

La parole est à M. Daniel Laurent, auteur de la question n° 959, adressée à M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

Madame la secrétaire d’État, en octobre dernier, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) permettait aux États-Unis de prendre des sanctions contre des biens européens, dans le cadre du conflit sur les subventions accordées à Airbus.
Début décembre, les États-Unis ont formulé de nouvelles menaces, à savoir des sanctions visant à imposer de nouveaux droits de douane additionnels jusqu’à 100 %. Était en cause le projet de taxe sur les géants du numérique. Les vins pétillants, dont le champagne, épargnés par les premières sanctions, seraient également concernés, ce qui représente 700 millions d’euros supplémentaires.
Le chiffre d’affaires réalisé sur le marché américain s’est élevé à un milliard d’euros en 2018. Sur les six premiers mois de 2019, les exportations étaient en hausse de 10 % en valeur et de 2 % en volume. Or, depuis bientôt trois mois, la profession enregistre une chute drastique des importations américaines, de l’ordre de 30 % en valeur, sur les vins en bouteilles, par comparaison avec le mois de novembre 2018.
Les exportateurs ont réduit leurs marges, mais ils redoutent de perdre des parts de marchés qui seront difficiles à reconquérir, d’autant que ces mesures entraîneront des distorsions de concurrence.
Le 16 décembre dernier, lors du Conseil Agriculture et pêche à Bruxelles, le ministre de l’agriculture a demandé à la Commission de renforcer les soutiens à la filière vitivinicole. Si les mesures proposées vont dans le bon sens, elles demeurent insuffisantes pour faire face aux conséquences directes pour la filière.
En conséquence, qu’en est-il de la mise en œuvre d’un fonds de compensation des mesures d’aides à la promotion ou de la résolution du conflit avec les États-Unis ? Le 6 janvier dernier, M. Bruno Le Maire a une nouvelle fois appelé les États-Unis à la raison. Toutefois, pour l’heure, on ne constate aucun effet.
Madame la secrétaire d’État, il y a urgence à agir, afin de ne pas fragiliser l’ensemble de la filière, victime d’un conflit qui ne la concerne pas.
M. Antoine Lefèvre applaudit.
Monsieur le sénateur Daniel Laurent, dans le conflit opposant les États-Unis et l’Union européenne au sujet des subventions accordées à Airbus, l’OMC a tranché et autorisé les États-Unis à appliquer des sanctions à l’encontre de biens européens importés sur leur territoire.
Dans la mesure où il est vraisemblable que l’OMC sanctionne aussi, dans quelques semaines, les produits américains importés en Europe, pour des subventions accordées à Boeing, l’Union européenne a d’abord tenté de négocier avec les États-Unis, pour éviter une escalade de sanctions qui mette à mal l’économie de nos territoires respectifs.
Ces négociations continuent d’être menées de manière intense, pour limiter au maximum dans le temps l’application de ces taxes sanctions. Néanmoins, depuis le 18 octobre dernier, les États-Unis ont effectivement appliqué, ce que nous regrettons vivement, leur droit de sanctions.
Pour la France, les produits les plus touchés sont les vins tranquilles en deçà de 14 degrés conditionnés dans des contenants de moins de 2 litres, auxquels est imposée une taxe additionnelle de 25 %.
Toutes les régions viticoles françaises sont visées, à hauteur de 306 millions d’euros annuels. Les exportations françaises aux États-Unis des vins taxés ont représenté 25 % de l’ensemble des exportations européennes de vins vers les États-Unis.
Pour aider au plus vite la filière, injustement frappée et en difficulté, le Gouvernement a immédiatement mis en œuvre des mesures de soutien : doublement du budget de la promotion business to consumer des vins français développés aux États-Unis et dans plusieurs autres pays stratégiques, notamment en Asie, dans le cadre de la concession de service public Sopexa ; renforcement des actions de promotion business to business conduites par Business France, notamment sur les indications géographiques et les appellations d’origine contrôlée ; opérations collectives de promotion à l’export sur 38 marchés à potentiel en 2020 ; mise en œuvre de mesures de bienveillance concernant des délais de paiement ou des remises et de l’assurance prospection portée par Bpifrance.
Au-delà des mesures nationales, c’est bien sûr au niveau européen que doit se porter le soutien le plus fort. Ainsi, à notre demande, l’Union européenne a déjà accordé diverses mesures de souplesse et de simplification des fonds de promotion. Mais la France, notamment par la voix de Didier Guillaume, continue de solliciter, lors de chaque Conseil européen de l’agriculture, la mise en place d’un mécanisme européen de compensation de pertes constatées, et demande la levée des barrières non tarifaires pour faciliter l’export vers d’autres pays tiers, notamment le Canada, le Japon et la Corée du Sud.

Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, de votre réponse, ainsi que des mesures de soutien à la filière. Certes, nous sommes favorables à la négociation. Pour autant, vous n’êtes pas sans savoir que, si on perd des marchés, on ne les retrouve pas toujours. Vous n’êtes pas non plus sans savoir combien pèsent, positivement, dans la balance du commerce extérieur, les vins et spiritueux.
Il est donc urgent de trouver une solution, faute de quoi la situation deviendra dramatique pour cette filière économique française.

La parole est à Mme Christine Bonfanti-Dossat, auteur de la question n° 961, adressée à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, ma question porte sur le financement des structures d’aide et d’accompagnement à domicile.
Je pensais que la fameuse loi Grand âge serait le grand soir des financements. Or je m’aperçois que nous sommes toujours dans les petits matins précaires des renoncements.
Les structures d’aides à domicile sont en effet désemparées : elles refusent de s’habituer à des effets d’annonces non suivies de résultats dans des délais raisonnables. La situation est pourtant désastreuse et alarmante : alors que 600 millions d’euros sont nécessaires pour rattraper le retard et améliorer un contexte tendu, seuls 50 millions d’euros ont été octroyés en 2019, 50 autres millions étant promis pour 2020, soit deux fois moins que ce qui avait été prévu en 2018.
En Lot-et-Garonne, les tarifs horaires appliqués pour les structures d’aide et d’accompagnement à domicile sont toujours fragiles et évidemment non pérennes : 20, 73 euros pour un prix de revient de 21 euros. Dans le même temps, les 520 000 euros fléchés en 2019 posent question : le département ne se prononce pas pour 2020, les conditions d’attribution à remplir par le biais des appels à candidatures étant toujours inconnues. Imaginez le désarroi de toutes ces structures et de leur personnel !
À quand une réforme ambitieuse de la tarification des services d’aide à domicile ? À quand une remise à plat des modèles d’intervention ? À quand un financement à la hauteur des enjeux, alors qu’il faut treize ans à un intervenant à domicile pour être rémunéré légèrement au-dessus du SMIC ?
Madame la secrétaire d’État, quand pourrons-nous espérer passer des promesses, des commissions et des rapports aux actes réels, responsables et immédiats ?
Madame la sénatrice, vous appelez l’attention du Gouvernement sur le financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD).
Le financement des SAAD relève de la compétence des conseils départementaux. Le décret n° 2019-457 du 15 mai 2019, pris pour l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, vise à préfigurer un nouveau modèle de financement des SAAD, afin d’assurer l’accessibilité financière et géographique des services pour les bénéficiaires, de permettre une plus grande équité de traitement, de rendre l’offre plus lisible, d’assurer une meilleure transparence tarifaire, et de mieux maîtriser les restes à charge pour les usagers.
Le modèle rénové que nous envisageons repose sur un tarif de référence nationale applicable à tous les SAAD, et un complément de financement appelé « modulation positive ».
Dans le cadre de la préfiguration de ce nouveau modèle de financement, la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) a fixé la répartition de l’enveloppe de 50 millions d’euros entre les départements concernés, dont 520 000 euros pour le Lot-et-Garonne, et les modalités de leur versement.
Il appartient aux départements de répartir ces crédits entre les SAAD retenus dans le cadre d’un appel à candidatures et dont le cahier des charges a été précisé dans le décret. Les critères de sélection des candidatures portent notamment sur le profil des personnes prises en charge, l’amplitude horaire d’intervention et les caractéristiques du territoire d’intervention, afin de renforcer l’attractivité des métiers du secteur.
La détermination du montant de la dotation complémentaire allouée aux SAAD à l’issue de l’appel à candidatures relève de la négociation entre le département et les SAAD lors de la signature du CPOM (contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens) ou d’un avenant à ce contrat.
Les départements bénéficiaires de ces crédits devaient transmettre à la CNSA les données relatives à l’utilisation des crédits au plus tard le 15 octobre 2019.
Concernant les ARS (agences régionales de santé), leurs seuls financements qui pourraient intervenir en faveur des SAAD seraient les financements alloués dans le cadre de l’accompagnement à la constitution d’un service polyvalent d’aide et de soins à domicile, regroupant les services d’aide et d’accompagnement à domicile et les services de soins infirmiers à domicile.

Madame la secrétaire d’État, j’entends bien ce que vous dites. Pour autant, je suis intimement convaincue que le Gouvernement a la responsabilité de répondre au souhait de 95 % des Français, qui désirent vivre le plus longtemps chez eux, à domicile. Ne pas les entendre serait ne pas entendre une évolution majeure de notre société.

La parole est à Mme Agnès Constant, en remplacement de M. Bernard Buis, auteur de la question n° 883, adressée à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je vais vous lire la question que souhaitait poser mon collègue Bernard Buis à Mme la ministre des solidarités et de la santé :
« Madame la ministre, nous vous alertons régulièrement sur les carences en matière de professionnels de santé dans différents secteurs. On pense évidemment aux déserts médicaux dus au manque de renouvellement des médecins généralistes tant en secteur rural qu’en ville ou dans les services d’urgence des hôpitaux. On pense aussi à la difficulté d’avoir un rendez-vous avec un médecin spécialiste ou de trouver un médecin traitant.
« Je souhaite aujourd’hui vous alerter et attirer votre attention sur le déficit constaté partout en France de candidats aux sessions de formation d’aide-soignant, métier de santé pourtant indispensable dans le dispositif de prise en charge des malades.
« En effet, si je me réfère à l’exemple de mon département, il y avait encore récemment en Drôme deux sessions de formation, avec chacune 60 stagiaires qui se dirigeaient ensuite vers le métier d’aide-soignant. Il n’y a eu cette année qu’une seule session, qui n’a même pas fait le plein de stagiaires.
« La situation est identique dans de nombreux départements et on peut légitimement craindre une pénurie dans le cadre du renouvellement des postes d’aides-soignants.
C’est pourquoi je me permets de vous interpeller, madame la ministre, sur cette problématique. Quelles mesures envisagez-vous pour enrayer la pénurie et rendre plus attractif le métier d’aide-soignant, en particulier pour ce qui concerne la rémunération ? »
Madame la sénatrice, je vous remercie pour votre question. Le Gouvernement partage le constat global que vous dressez au sujet de la perte d’attractivité de cette formation.
En effet, les données publiées par la Drees (direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) révèlent une diminution du nombre des inscrits à la formation d’aide-soignant pour la deuxième année consécutive – la baisse est de 6 % entre 2016 et 2018 –, ainsi qu’une forte baisse du nombre de candidats au concours d’entrée, qui est de l’ordre de 40 % depuis 2014. Toutefois, l’évolution du nombre des diplômés est restée quasi stable : il était de 22 800 en 2018.
Afin de favoriser l’accès à cette formation et de mieux reconnaître les compétences des aides-soignants dans leur pratique professionnelle, plusieurs actions ont été engagées depuis 2018. Leur mise en œuvre se poursuit, notamment dans le cadre des plans Ma santé 2022 et Investir pour l’hôpital.
La valorisation de la formation et, par là même, de la profession d’aide-soignant est au cœur des mesures portées par le ministère.
Un groupe de travail associant tous les acteurs concernés s’est constitué en avril 2019. Il a engagé une refonte des référentiels métier et formation, qui est en cours de finalisation en vue d’une mise en place à la rentrée de septembre 2020. La réforme est aussi l’opportunité de mettre en place des passerelles avec d’autres professions et, donc, de décloisonner l’exercice de la profession d’aide-soignant.
Les travaux du groupe s’articulent autour des préconisations de la mission conduite par Myriam El Khomri. Dans son rapport remis à l’automne 2019, elle recommande une simplification des modalités d’accès à la formation, qui garantisse malgré tout une diversité des profils, indispensable. Mme El Khomri envisage aussi la mise en place de critères de sélection nationaux pour suivre la formation. Les arbitrages devraient être rendus publics prochainement.
La mobilisation continue au niveau des agences régionales de santé (ARS) pour valoriser le métier et desserrer le calendrier des concours existants, qui était trop étalé dans le temps. J’en veux pour preuve qu’il fallait attendre près d’un an entre son inscription au concours et l’entrée dans la formation, ce qui ne permettait pas aux jeunes intéressés par le métier d’aide-soignant de se projeter aussi loin.
À plus long terme, la réflexion se poursuit avec le ministère de l’enseignement supérieur, afin de rendre la formation d’aide-soignant beaucoup plus visible et lisible aux yeux des lycéens, notamment sur la plateforme Parcoursup.
Concernant les professionnels en activité, une revalorisation indemnitaire est prévue dès le début de cette année dans les conditions prévues par le plan Investir pour l’hôpital.

Je vous remercie de ces éléments, madame la secrétaire d’État. Faire passer les aides-soignants de la catégorie C à la catégorie B serait une bonne chose pour la reconnaissance et l’attractivité du métier.

La parole est à M. Jean-Yves Roux, auteur de la question n° 888, adressée à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Madame la secrétaire d’État, en juillet 2019, à la suite du congé maladie d’un médecin et des départs en vacances, les urgences de l’hôpital de Sisteron ont fermé la nuit. Cette situation devait être temporaire, ce qui a obligé le service à bricoler un peu et à s’en remettre à la très bonne volonté de chacun, notamment du SAMU (service d’aide médicale urgente), du SMUR (service mobile d’urgence et de réanimation) et des élus de Sisteron.
Or, depuis cet été, les urgences de Sisteron n’ont jamais rouvert la nuit. Or le bricolage comme la bonne volonté ne sont pas des politiques acceptables, surtout quand la sécurité des patients mais aussi la nécessaire accessibilité aux services publics sur tout le territoire et dans les mêmes conditions sont en jeu.
Élu des Alpes-de-Haute-Provence, je ne peux pas accepter d’être le sénateur d’un département où le service public de la santé n’existe que le jour. Je ne peux accepter non plus que, à terme, ce service public de nuit soit assuré dans d’autres départements, ce qui contraindrait les patients à des déplacements encore plus longs, dans des conditions parfois plus difficiles – nous nous situons dans un territoire de montagne –, qui seraient inadaptées à la gravité de certaines pathologies.
Des discussions ont eu lieu avec l’ARS (agence régionale de santé) pour trouver des solutions. Or, dans leur rapport sur les urgences hospitalières remis le 19 décembre dernier à Mme la ministre des solidarités et de la santé, le docteur Thomas Mesnier, député de Charente, et le professeur Pierre Carli, patron du SAMU de Paris, suggèrent d’ores et déjà d’autoriser la fermeture des urgences la nuit dans certains hôpitaux.
Madame la secrétaire d’État, la publication de ce rapport laisse entendre à tous les acteurs de la santé du département que l’hôpital de Sisteron ou d’autres services d’urgence du département, eux aussi fragilisés, pourraient être les premiers concernés par ces fermetures permanentes la nuit.
Pourtant, des solutions existent, à titre expérimental s’il le faut, pour que nos habitants bénéficient d’un réel accès aux soins les plus vitaux à proximité de leur domicile.
Concernant les difficultés de recrutement des médecins, puisque le salaire des médecins intérimaires doit être plafonné, le salaire des nouveaux médecins concourant à la permanence des soins dans ces structures pourrait bénéficier d’une surprime permanente en cas de travail de nuit.
On peut également envisager l’ouverture de maisons médicales de garde sans condition d’un nombre moyen de passages aux urgences, ou encore l’aménagement du temps partagé de médecins salariés dans des centres de santé à l’hôpital.
En outre, on pourrait prévoir l’implantation systématique de plateaux techniques, radiologiques et biologiques dans tous les déserts hospitaliers la nuit.
Enfin, des urgences gérontologiques pourraient elles aussi être expérimentées dans notre département, avec une nouvelle approche de la dépendance.
Madame la secrétaire d’État, pouvez-vous me confirmer que l’hôpital de Sisteron et les autres hôpitaux du département auront bien des urgences de nuit ? Allez-vous soutenir la mise en place d’un nouveau modèle pour les urgences hospitalières de nuit dans nos territoires ruraux, fondé sur la proximité et adapté aux réalités géographiques et humaines de notre pays ?
Comme vous l’avez rappelé, monsieur le sénateur, le service d’accueil des urgences du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud à Sisteron (Chicas) est en effet fermé de 20 heures à 8 heures du matin depuis le début de l’été. Cette fermeture est due à une absence médicale qui n’a pu être compensée.
De fait, l’établissement est confronté à des difficultés de recrutement dans un contexte national et départemental de raréfaction des ressources médicales, notamment urgentistes.
Seul le service d’accueil des urgences est fermé la nuit. Le SMUR de l’établissement ainsi que l’unité d’hospitalisation post-urgences continuent de fonctionner. La prise en charge urgente des patients sur le territoire est assurée.
Le Chicas, dont dépend l’établissement de Sisteron, prévoit la mutualisation des postes d’urgentistes entre sites : une clause obligatoire a été ajoutée dans les contrats de recrutement des nouveaux praticiens intégrant l’établissement. Environ 20 % du temps de travail des urgentistes venant travailler à Gap devra être effectué sur le site de Sisteron.
Par ailleurs, un projet de mutualisation des centres d’appel 15, du SAMU 04 et du SAMU 05 a vocation à apporter une réponse rapide à ce manque de ressources médicales. Dans cette hypothèse, la régulation médicale s’effectuerait en alternance dans les locaux du SAMU de l’un ou l’autre des départements. Cette organisation, vous en conviendrez, permettra de libérer du temps médical dans les services des urgences.
Ces mesures au niveau local viennent s’ajouter aux dispositions structurelles qui ont été annoncées dans le cadre du pacte de refondation des urgences. Parmi les douze mesures annoncées, la simplification des procédures de recrutement médical et l’encadrement de l’intérim médical viennent conforter le travail engagé localement par la direction du Chicas et l’ARS PACA (Provence-Alpes-Côte d’Azur), afin de favoriser le recrutement d’urgentistes.
Par ailleurs, le service d’accès aux soins déployé dès l’été 2020 doit garantir une réponse médicale de qualité en tous points du territoire.
Soyez assuré, monsieur le sénateur, que nous sommes pleinement mobilisés pour apporter à nos concitoyens les résultats qu’ils attendent légitimement. Les services de l’ARS PACA suivent avec une attention très particulière la situation des urgences de Sisteron.
Mme Catherine Troendlé remplace Mme Hélène Conway-Mouret au fauteuil de la présidence.

La parole est à M. Hugues Saury, auteur de la question n° 1032, adressée à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Madame la secrétaire d’État, ma question porte sur le nouveau modèle tarifaire des allocations de solidarité.
À la suite de la réunion du comité de pilotage de l’aide à domicile le 11 février 2019, et après concertation avec les dix fédérations nationales et les départements, le principe d’un nouveau modèle tarifaire a été arrêté.
Ce dernier repose sur un tarif de référence national plancher pour l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) et la PCH (prestation de compensation du handicap), ainsi qu’un complément de financement sur objectif, appelé modulation positive, dans le cadre d’un CPOM (contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens).
Dans l’attente de cette réforme globale, vous avez annoncé une enveloppe de 50 millions d’euros, qui permettrait aux conseils départementaux volontaires de commencer à mettre en œuvre cette modulation positive à titre expérimental.
Le décret n° 2019-457 du 15 mai 2019 est venu fixer le cadre de cette démarche. Après avoir postulé auprès de la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie), mon département, le Loiret, a engagé une concertation avec les sept fédérations présentes sur son territoire pour définir un cahier des charges conjoint, puis lancer un appel à candidatures. Une enveloppe de 664 140 euros a depuis été notifiée par la CNSA.
Jusque-là, tout va bien, sauf que le préfet du département, saisi dans le cadre du pacte de Cahors – et c’est bien là ma question –, a indiqué qu’il n’était « pas prévu de retraiter les dépenses exposées par les départements dans le cadre de la réforme de financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile qui ne correspondent ni à un transfert de compétences ni à un élément exceptionnel ».
Or il semblerait que cette position diverge d’un département à l’autre.
Je souhaite donc savoir, madame la secrétaire d’État, si les dépenses engagées par le département du Loiret et qui correspondent à l’enveloppe allouée relèvent du plafond défini par l’article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, ou si elles en sont exclues
Monsieur le sénateur, je vous remercie pour votre question, qui me donne l’occasion de compléter ma précédente réponse et de rappeler que le Gouvernement est pleinement mobilisé sur les enjeux liés au vieillissement de la population.
L’aide à domicile constitue l’un des piliers de la réforme Grand âge et autonomie à venir. Elle vise à répondre à la préférence exprimée par nos concitoyens de pouvoir continuer à vivre chez eux.
Je profite de cette réponse pour remercier les professionnels de l’aide à domicile, qui font un métier indispensable, très gratifiant, mais difficile, comme l’a encore montré cet automne Myriam El Khomri dans son rapport.
Nous avons souhaité que, dès 2019, une enveloppe de 50 millions d’euros soit allouée aux services d’aide et d’accompagnement à domicile, afin de préfigurer la mise en place d’un nouveau modèle de financement visant à améliorer la qualité du soutien à domicile, tant pour les personnes accompagnées que pour les professionnels.
Cette enveloppe a été versée aux départements volontaires qui, comme vous le savez, sont chefs de file des politiques sociales, et dont nous voulons faire des acteurs de premier plan du maintien à domicile. Agnès Buzyn a récemment eu l’occasion d’évoquer ce sujet devant eux lors d’un séminaire organisé par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Le département du Loiret s’est engagé dans cette voie de l’amélioration des services à domicile, initiative qu’il faut saluer. Je précise que ces crédits, qui financent des dépenses de fonctionnement, relèvent bien du plafond défini par la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
Désormais, nous souhaitons construire un partenariat renouvelé et renforcé avec les conseils départementaux. La réforme à venir pour le grand âge et l’autonomie doit nous permettre de renforcer les coopérations dans les territoires, pour garantir la qualité de l’accompagnement de nos aînés et de leurs aidants.

Madame la secrétaire d’État, je vous remercie pour votre réponse mais, vous vous en doutez, celle-ci ne me convient pas, non plus qu’aux départements ou probablement aux associations.
En réalité, le Gouvernement engage une politique, la finance, la délègue aux départements, qui sont prêts à l’appliquer dans les territoires mais, en définitive, il reprend d’une main ce qu’il avait donné de l’autre. Les départements sont lésés, les associations leurrées, et ce sont les usagers qui pâtissent de la situation. J’espère que le bon sens permettra de revenir à un dispositif plus approprié.

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, auteur de la question n° 1041, adressée à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Madame la secrétaire d’État, je souhaiterais que vous vous penchiez sur la situation des victimes d’accidents médicaux, mais aussi sur celle des médecins qui peuvent être les auteurs de tels accidents au cours de vies professionnelles, par ailleurs, parfaitement honorables.
Ma question porte sur l’extension du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral, et aux accidents médicaux faisant l’objet d’une réclamation au sens de l’article L. 251-2 du code des assurances, afin que celui-ci s’applique à compter du 1er janvier 2011, en lieu et place du 1er janvier 2012.
Madame la secrétaire d’État, il s’agit de combler une espèce de « trou » législatif, qui a subsisté malgré deux dispositions légales datant de 2002, et une disposition votée en 2011.
À l’époque, des discussions affreusement compliquées ont eu lieu entre le Gouvernement, le Parlement et les compagnies d’assurance pour essayer de trouver une solution à l’insuffisance des garanties données par les contrats d’assurance qui avaient pu être souscrits à l’étranger. Pour faire bref, il s’agissait de trouver une solution à un problème de défaut partiel d’assurance.
Après l’adoption des dispositions légales de 2002, il est apparu qu’il restait encore des trous. Il a donc été mis en place un fonds de garantie, financé par la profession, s’agissant en particulier des actes de gynécologie.
Pour des raisons techniques de calcul de prescription, il reste une dernière zone non couverte par le fonds : elle concerne des accidents ayant fait l’objet d’une déclaration, à compter non pas du 1er janvier 2012, mais du 1er janvier 2011. En clair, une douzaine de médecins, essentiellement des gynécologues-obstétriciens, ne seraient aujourd’hui pas couverts.
Seuls les professionnels de santé financent ce fonds. Si cette extension n’est pas accordée, ce sont les caisses primaires d’assurance maladie qui devront couvrir les dommages.
Je ne parviens pas à aborder le nœud du débat puisque, lorsque l’on examine le projet de loi de financement de la sécurité sociale, on me répond qu’il faut aborder le sujet au moment de la loi de finances et que, en loi de finances, on m’oppose l’article 40 de la Constitution.
Le Gouvernement pourrait-il étudier et, de mon point de vue, accepter cette extension de la couverture du fonds de garantie au 1er janvier 2011 ?
Monsieur le sénateur, je vous remercie pour votre question.
Le ministère de la santé a également été informé des difficultés auxquelles sont confrontés plusieurs médecins qui font face à des défauts de couverture assurantielle. Nous sommes sensibles à la situation de ces médecins et de leurs familles.
Néanmoins, une extension de la garantie du fonds ne peut se faire que sous deux conditions : le respect absolu de l’indemnisation des patients et le maintien de l’équilibre financier du fonds. L’assurance fournie à certains praticiens pour des litiges passés ne doit pas nous pousser à prendre le moindre risque pour la viabilité de l’assurance future de leurs confrères et des victimes.
Des travaux sont actuellement en cours pour évaluer les modalités de mise en œuvre de cette extension : il faudrait s’assurer que le fonds puisse couvrir le coût de l’extension de la garantie dans le temps. Cette extension des effets du fonds au 1er janvier 2011, voire même antérieurement si d’autres médecins que ceux qui sont aujourd’hui identifiés étaient concernés, pourrait faire peser un risque d’insolvabilité au fonds si les projections présentées étaient sous-estimées et les ressources mobilisées insuffisantes.
Ce risque ne doit pas être pris. Il est dans l’intérêt des patients qu’un financement complémentaire soit envisagé en cas d’extension des garanties couvertes par le fonds, ce que ne prévoyaient pas les amendements présentés lors de l’examen des textes budgétaires.

La parole est à Mme Marie-Françoise Perol-Dumont, en remplacement de M. Didier Marie, auteur de la question n° 1042, adressée à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Avant de commencer, madame la présidente, je me permets de préciser que, si M. Didier Marie est absent, c’est parce qu’il est retenu dans les transports.
Je le remplace donc au débotté pour poser une question à laquelle il est très attaché. Elle porte sur la situation particulièrement préoccupante dans laquelle se trouve le centre hospitalier du Rouvray à Sotteville-lès-Rouen depuis 2018.
Ce centre hospitalier vit effectivement une période de crise durable qui ne cesse de s’aggraver à tous les points de vue.
Tout d’abord, les locaux ne permettent plus d’assurer un accueil digne des personnes. L’occupation des lits dépasse largement la capacité de l’établissement. Ainsi, certains patients se retrouvent à dormir dans la salle de visite des familles ou dans des bureaux ; d’autres sont obligés de cohabiter dans des chambres très exiguës, le nombre de patients étant parfois trois fois plus élevé que l’unité prévue.
Parallèlement, les conditions matérielles d’habitation sont déplorables : absence systématique de lunettes sur les cuvettes des toilettes, pas de sanitaires individuels. Les patients n’ont pas d’intimité : absence de serrure aux portes des chambres, portes avec des fenêtres transparentes, pas de dispositif de fermeture des placards.
Par ailleurs, la liberté fondamentale d’aller et venir des patients est bafouée. La libre circulation des patients en soins libres dépend de la disponibilité des soignants : ils sont donc très souvent soumis à un enfermement injustifiable. Les patients en soins sans consentement sont privés de leurs droits ipso facto, bien que les textes prévoient que toute restriction individuelle doit être décidée en fonction de l’état clinique du patient, après évaluation médicale.
En outre, les pratiques d’isolement sont complètement illégales. L’isolement doit être une procédure de dernier recours. Or, dans de nombreux cas, la contention est la règle, et la liberté l’exception. Les conditions de rétention de ces patients sont particulièrement avilissantes : sans accès aux sanitaires, vous imaginez comment les choses se passent ! Sans accès aux personnels soignants, ils sont condamnés à se blesser physiquement en frappant à la porte autant de temps que nécessaire.
Les patients sont également dessaisis de leur statut d’hospitalisation et de leurs droits. Ils ne disposent d’aucune information de la part des soignants sur l’offre de soins et les conditions de vie pendant leur séjour.
Enfin, il faut y insister, les droits des enfants sont constamment et consciemment foulés au pied. Cette situation ne peut plus durer. Il est incompréhensible que des enfants de moins de 12 ans soient enfermés dans la même chambre que des adultes. Selon le rapport de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, ces enfants ont pu être violentés, parfois sous l’emprise de stupéfiants, ou encore victimes de sévices sexuels.
Cette situation est inadmissible et injustifiable. Les plaintes et les patients en souffrance ne peuvent plus être ignorés. Il est de la responsabilité du Gouvernement d’agir. Aussi, madame la secrétaire d’État, M. Marie vous demande comment le Gouvernement entend-il restaurer une situation d’accueil des patients digne de ce nom.
Madame la sénatrice, cette visite de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté s’est déroulée dix-huit mois après le conflit social intervenu en 2018.
Comme vous le savez, le protocole d’accord signé entre la direction et les syndicats en juin 2018 prévoyait la création en priorité de trente nouveaux postes de soignants, dont le déploiement était prévu sur une année. La création de ces postes a fait l’objet d’un accord de financement intégral avec l’ARS Normandie pour un montant de 1, 35 million d’euros.
Conformément au protocole, les crédits correspondant aux vingt premiers postes ont été délégués et les recrutements intégralement effectués entre juin 2018 et juin 2019. L’ARS a délégué les crédits relatifs aux dix derniers postes en octobre 2019. Les professionnels concernés sont en cours de recrutement.
Au-delà de ces moyens supplémentaires, le protocole prévoyait également la mobilisation des équipes médicale et soignante pour formaliser des projets en vue de l’amélioration des prises en charge.
Ainsi, le projet de création d’une unité dédiée à la prise en charge des adolescents a été transmis par l’établissement à l’ARS au début du mois d’octobre 2019. Cette unité devrait voir le jour dans des locaux adaptés et rénovés en novembre 2020, à l’issue des travaux nécessaires à son installation.
Dès la communication des recommandations de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, une réunion de travail entre le directoire de l’établissement et l’ARS s’est tenue. Elle a permis d’identifier les premières actions à mettre en œuvre en urgence.
Tout d’abord, il faut une accélération du plan de rénovation de l’établissement visant l’humanisation des conditions d’hébergement. Le plan actuel, prévu sur cinq ans, sera adapté pour permettre sa mise en œuvre complète d’ici à douze mois. Les surcoûts liés à la mise en place de ce plan feront l’objet d’un accompagnement budgétaire à hauteur de 1 million d’euros : ces crédits viennent d’être délégués par l’ARS.
Il faut également accélérer le déploiement de nouveaux dispositifs de réhabilitation psychosociale selon un calendrier à définir.
Enfin, il faut une actualisation du projet médical : l’établissement engagera dès le mois de janvier une révision de son projet médical avec l’appui d’un conseil extérieur, dans l’objectif de limiter strictement les restrictions à la libre circulation des patients à la mise en œuvre du traitement requis.
Soyez assurée, madame la sénatrice, que le ministère, comme l’ARS, suit avec beaucoup d’attention la situation de cet établissement et accordera les moyens nécessaires.

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, auteure de la question n° 1045, adressée à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Madame la secrétaire d’État, je souhaite attirer votre attention sur l’inégalité de traitement entre la ville et l’hôpital concernant le financement des consultations externes.
Dans un contexte de désertification médicale grandissante, nombreux sont les hôpitaux de proximité qui proposent des consultations réalisées par les praticiens exerçant au sein de ces établissements, ou bien par des médecins retraités qui acceptent de redevenir salariés des hôpitaux. Ils assurent ainsi l’offre de soins dans des secteurs en grande carence.
Certes, l’activité externe n’est pas le cœur de métier de l’hôpital public, mais, si l’on s’en tient à la conception de l’hôpital de proximité telle que la développe votre gouvernement, ces établissements ont plus que jamais vocation à combler les manques existants, tout en favorisant bien sûr un partenariat et une dynamique avec les médecins libéraux locaux.
Ces activités diversifiées, consultations auprès de spécialistes, de généralistes, actes de biologie, sont de même nature que celles que réalisent les praticiens libéraux en cabinet de ville. Les tarifs de ces actes et consultations externes à l’hôpital sont déterminés de façon exogène par les conventions liant l’assurance maladie aux professionnels de santé libéraux.
Pourtant, à ce jour, les majorations tarifaires issues de ces conventions ne sont pas appliquées aux établissements de santé. En effet, un dispositif réglementaire limite nominativement les majorations transposables à l’activité d’actes et consultations externes des établissements de santé.
Cette discrimination de traitement entre la ville et l’hôpital pour des soins pourtant similaires est injuste et préjudiciable, non seulement aux populations locales déjà dépourvues de médecins libéraux, mais également au budget de ces établissements de santé, souvent de petits hôpitaux en grande difficulté financière du fait de la tarification à l’activité (T2A) toujours pratiquée à ce jour.
Cette discrimination entraîne la remise en cause de ces activités par ces petits hôpitaux largement sous-rémunérés selon l’inspection générale des affaires sociales.
À l’heure où le financement au parcours est un élément constitutif de la stratégie nationale de santé, madame la secrétaire d’État, pensez-vous accorder aux établissements de santé un financement équitable de leurs actes et consultations externes, de manière à permettre cet ultime recours aux populations souvent rurales, qui n’ont d’autre solution que leurs hôpitaux de proximité ?
Madame la sénatrice, votre question porte sur le financement des consultations de spécialités dans les hôpitaux de proximité.
Nous sommes, tout comme vous, attachés à ce que l’accès à un spécialiste soit garanti à tous, et ce sur tous les territoires. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a souhaité, dans la loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé votée l’été dernier, confier obligatoirement aux hôpitaux de proximité la mission de proposer des consultations de spécialités.
Ces consultations pourront être assurées par des praticiens hospitaliers d’autres établissements dans le cadre de consultations avancées, ou par des praticiens libéraux du territoire via des coopérations avec les cabinets de ville. Celles-ci pourront également être réalisées par télémédecine, notamment dans les territoires isolés.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a permis de poser un modèle de financement adapté aux missions de ces hôpitaux, qui rompt avec la logique de la T2A. En effet, le financement de leur activité de médecine fera désormais l’objet d’une garantie pluriannuelle, qui assure à l’établissement de ne pas perdre de recettes sur la durée d’un cycle de trois ans, même si son activité venait à baisser.
Ces hôpitaux bénéficieront aussi de crédits supplémentaires : la dotation de responsabilité territoriale leur permettra d’exercer les missions d’appui au premier recours, de prévention, de prise en charge globale des personnes âgées qu’ils assurent en coopération avec l’ensemble des acteurs de leurs territoires.
Vous avez raison de noter que l’offre de consultations externes, du fait de ses modalités techniques de financement, est parfois déficitaire pour des établissements de petite taille. Aussi l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 précise-t-il explicitement que cette dotation de responsabilité territoriale vise à soutenir l’offre de consultations de spécialités.
Enfin, vous soulignez à juste titre l’asymétrie qui prévaut actuellement entre la ville et l’hôpital concernant l’application des majorations des conventions médicales. Ces dernières ne s’appliquent en effet aux établissements de santé que dès lors qu’elles ont été expressément prévues par un arrêté.
À la suite de la publication de la convention médicale du mois d’août 2016, une réflexion sur l’ouverture progressive aux établissements de santé de l’ensemble des majorations tarifaires applicables aux actes et consultations externes a été lancée.
Les travaux de transposition des majorations se poursuivent. Nous continuerons à mieux valoriser cette activité de prise en charge externe, notamment dans les territoires isolés et ruraux, où l’on en mesure bien toute la nécessité.

Nous allons suivre de près les évolutions que vous évoquez, madame la secrétaire d’État. J’attire simplement votre attention sur le fait qu’il s’agit souvent de consultations non pas de spécialistes, mais de généralistes.
En effet, il n’y a plus de généralistes de proximité et les hôpitaux ne peuvent plus assumer les dépassements de forfait kilométrique pour se rendre au domicile de personnes âgées, qui ne disposent pas d’autre moyen de transport.

La parole est à Mme Brigitte Micouleau, auteure de la question n° 1046, adressée à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Madame la secrétaire d’État, la situation est dramatique.
Alors que, le 8 juillet 2019, le Gouvernement a présenté vingt-huit mesures pour lutter contre les pénuries et améliorer la disponibilité des médicaments en France, s’inspirant des conclusions du rapport présenté le 27 septembre 2018 par la mission d’information du Sénat sur les pénuries de médicaments et de vaccins, la situation ne s’améliore pas. Elle s’est même encore aggravée depuis la fin de l’été.
Membre de cette mission d’information, je peux témoigner qu’un constat alarmant avait été dressé. Il y a plus d’un an, nous dénoncions déjà une mise en danger préoccupante de certains patients. Ceux-ci sont à présent confrontés, tout comme les pharmaciens, à une grave pénurie de médicaments.
Corticoïdes, antibiotiques, vaccins, la liste des médicaments en rupture de stock est longue. En mars 2018, j’alertais le Gouvernement sur le risque d’une rupture d’approvisionnement du BCG intravésical, utilisé dans le traitement du cancer de la vessie. Aujourd’hui, la rupture de stock du BCG-medac est effective. En France, les patients ne peuvent plus suivre leur traitement. Les urologues leur répondent qu’il faut patienter sans leur donner plus de précisions.
Devant une telle situation d’urgence, madame la secrétaire d’État, je vous interroge sur les actions efficaces que le Gouvernement entend prendre pour garantir à ces patients la légitime continuité de leurs soins et pour remédier à ce grave enjeu de santé publique.
Madame la sénatrice, vous l’avez rappelé et vous le savez, les ruptures de stock de médicaments sont une préoccupation majeure des pouvoirs publics. C’est un phénomène ancien qui ne date pas d’aujourd’hui.
Selon l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les signalements de tensions d’approvisionnement de médicaments ont été multipliés par vingt en dix ans.
Face à ce constat et afin d’améliorer rapidement la situation, la ministre des solidarités et de la santé a présenté, le 8 juillet 2019, une feuille de route « lutter contre les pénuries et améliorer la disponibilité des médicaments en France », construite autour de quatre axes et de vingt-huit actions opérationnelles.
Le comité de pilotage chargé de la stratégie de prévention et de lutte contre les pénuries de médicaments a été installé au mois de septembre. Il rassemble les associations de patients, tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, les médecins, les pharmaciens et les autorités nationales compétentes. Cette instance suivra l’évolution des travaux de la feuille de route menés dans le cadre des différents groupes de travail mis en place, et se réunira trois fois par an.
En parallèle, compte tenu de l’impact des ruptures de stock dont vous avez rappelé l’effet pour certains médicaments, des mesures de prévention et de régulation ont été introduites à l’article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.
D’une part, ces mesures visent à imposer, pour tout industriel, l’obligation de constituer un stock de sécurité qui ne peut excéder quatre mois pour tout médicament. D’autre part, le texte prévoit une obligation d’importation, aux frais de l’industriel, en cas de rupture d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur pour lequel une rupture ou un risque de rupture de stock présente pour les patients un risque grave ou immédiat, ou en cas de rupture de stock d’un vaccin.
J’ajoute que les sanctions concernant les manquements des industriels en cas de rupture de stock sont renforcées.
Pour simplifier le parcours du patient, nous avons rendu possible le remplacement de médicaments par le pharmacien d’officine en cas de rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur.
Par ailleurs, le Premier ministre a confié à M. Jacques Biot une mission visant à procéder à l’analyse des causes profondes de cette situation en matière de choix industriels. Il doit analyser les processus de production et logistiques en vue d’en identifier les points de faiblesse et de proposer des solutions qui viendront s’ajouter à la feuille de route.
La difficulté n’est donc pas ignorée. Le Gouvernement, dans la loi de financement de la sécurité sociale, a prévu des mesures de financement qui sont en train de se mettre en place.

Madame la secrétaire d’État, j’entends bien votre réponse et vos arguments, mais je doute qu’ils satisfassent les patients, notamment ceux qui sont atteints d’une tumeur à la vessie.
Les informations communiquées par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sont effrayantes : après les conseils de limiter la rétrocession de médicaments, de distribuer les unités par deux et non plus par six, la rupture de stock au 7 janvier 2020 est effective. Elle perdure depuis le 2 décembre 2019 et la remise à disposition n’interviendrait qu’à la fin du mois de février 2020. Il est urgent d’agir !

La parole est à Mme Catherine Procaccia, auteur de la question n° 554, adressée à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Madame la secrétaire d’État, j’ai posé cette question par écrit il y a un an. Faute de réponse, je l’ai reposée sous la forme d’une question orale. J’espère que la difficulté dont je faisais état est aujourd’hui en partie résolue.
Depuis janvier 2019, les honoraires de dispensation des pharmaciens sont de 50 centimes par ordonnance. Cette somme est augmentée de 2 euros pour des médicaments spécifiques – anxiolytiques et hypnotiques, par exemple – et de 50 centimes selon l’âge du malade – moins de 3 ans et plus de 70 ans.
Tout cela, reconnaissez-le, est déjà bien compliqué. Comment font les patients dont les complémentaires ne prennent pas en charge les médicaments remboursés à 15 % ou à 30 % par la sécurité sociale ? Les 33 % d’honoraires de dispensation ne seront donc pas payés par les mutuelles, mais ils seront acquittés par les malades.
Comme la prise en charge de la mutuelle n’est déclenchée qu’en cas de demande de remboursement à la sécurité sociale, certains patients n’ont-ils pas intérêt à régler intégralement le prix du médicament pour éviter de payer un prix plus élevé en raison de l’honoraire du pharmacien, lequel ne sera pas pris en compte ? Sans compter que les sur-honoraires pour les médicaments prescrits aux enfants et aux personnes âgées sont passés à 3, 5 euros et à 1, 55 euro pour les anxiolytiques.
Il y a un an, je demandais déjà si l’information des patients sur cette situation pour le moins compliquée était prévue. Depuis un an, je suis allée un certain nombre de fois chez le pharmacien : je n’ai jamais eu aucun éclaircissement. Par conséquent, lorsque je paie un médicament, je ne sais pas quelle est la part du médicament, d’autant qu’il n’y a pas d’étiquette, et quelle est celle des honoraires du pharmacien. Pourrions-nous obtenir des éléments de réponse ?
J’aimerais également que le patient puisse choisir chez le pharmacien de ne pas demander le remboursement à la sécurité sociale d’un seul des médicaments mentionnés sur l’ordonnance.
Madame la sénatrice, permettez-moi tout d’abord de rappeler brièvement le contexte de mise en place de ces nouveaux honoraires.
Une réforme du mode de rémunération des pharmaciens a été engagée avec la mise en place, en 2015, d’un honoraire au conditionnement et d’un honoraire pour ordonnance dite « complexe », facturé dès lors que les pharmaciens exécutent une prescription comportant au moins cinq lignes de médicaments différents remboursables, facturés à l’assurance maladie.
Une seconde étape a été engagée avec l’avenant n° 11 en 2017, qui prévoit la mise en place de trois nouveaux honoraires de dispensation en plus de ceux qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
S’agissant des conditions de prise en charge de ces honoraires par l’assurance maladie obligatoire, elles diffèrent selon le type d’honoraire. Pour l’honoraire au conditionnement, le taux de prise en charge est le même que celui du médicament dispensé, lequel dépend du niveau de service médical rendu (SMR). Pour les médicaments à SMR important, le taux est fixé à 65 % ; pour ceux à SMR modéré, le taux est de 30 % ; pour ceux à SMR faible, le taux est de 15 %.
Pour l’honoraire pour ordonnance dite « complexe », la participation de l’assuré est supprimée.
Pour les trois nouveaux honoraires de dispensation, le taux de prise en charge par l’assurance maladie est de 70 %, soit une participation de l’assuré de 30 %.
Pour ce qui concerne les modalités d’information sur les prix des médicaments et les honoraires de dispensation dans les officines de pharmacie, elles sont fixées par un arrêté du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique, datant du 28 novembre 2014 et publié le 4 février 2015. Ce texte sera mis à jour en 2020 pour, notamment, intégrer les nouveaux honoraires de dispensation mis en place depuis le 1er janvier 2019.
Enfin, la liste des médicaments dit « spécifiques » faisant l’objet d’un honoraire de dispensation particulière figure en annexe II.4 de l’avenant n° 11 de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie.
La Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) est chargée de la mise à jour hebdomadaire de cette liste.

Je n’ai rien compris à votre réponse, madame la secrétaire d’État. Je présume que mes collègues ici présents se seront rendu compte que le sujet était horriblement complexe. Nul ne sait ce qui est à la charge du patient. Publier en 2020 un texte pour des mesures qui s’appliquent depuis 2019 prouve bien qu’il n’y a aucune transparence !

La parole est à Mme Marie-Françoise Perol-Dumont, auteure de la question n° 1068, adressée à Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées.

Madame la secrétaire d’État, la grande majorité des associations représentatives des personnes handicapées est très défavorable à l’intégration de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) dans le revenu universel d’activité (RUA) annoncée par le Gouvernement.
Ces associations estiment à bon droit que l’AAH est non pas un minimum social, mais une prestation sociale liée à la reconnaissance d’une incapacité spécifique souvent, hélas, pérenne.
Intégrer l’AAH dans le RUA serait non seulement une remise en cause fondamentale des droits des handicapés et du cadre législatif acté en 1975 et en 2005, mais entraînerait de surcroît très vraisemblablement une dégradation des droits des bénéficiaires de cette prestation, alors même que, dans le cas d’une politique réellement inclusive, le montant actuel de l’AAH mériterait grandement d’être réévalué au regard des besoins des personnes handicapées.
Entendez-vous prendre en compte ces inquiétudes et renoncer à l’intégration de l’AAH dans le RUA ?
Madame la sénatrice, je vous remercie de me donner l’occasion de m’exprimer sur cette question importante du revenu universel d’activité et de l’inscription de l’allocation aux adultes handicapés au sein des concertations ouvertes en juin dernier sur le revenu universel d’activité.
Ce minimum social, témoin de la solidarité nationale, a été très fortement revalorisé par le Gouvernement. Comme vous le savez, la hausse s’élève à plus de 11 %.
L’AAH étant un minimum social, elle fait logiquement partie de la réflexion sur le revenu universel d’activité, qui vise à simplifier le système de prestations sociales afin de renforcer sa cohérence, son accessibilité, son équité et sa lisibilité. Il a également pour objet de procurer systématiquement un gain lors de la reprise d’un emploi pour encourager le retour à l’activité.
Cette réforme fait l’objet d’une concertation institutionnelle et citoyenne afin de permettre une large consultation de l’ensemble des personnes intéressées. La concertation institutionnelle s’appuie sur différents collèges. Le 4 juillet dernier, Sophie Cluzel a lancé les travaux du collège thématique dédié aux personnes en situation de handicap. Ce n’est qu’à l’issue de cette concertation que le périmètre de la réforme sera arrêté. Aucune décision n’est donc prise concernant l’AAH.
L’objectif du revenu universel d’activité étant de lutter contre la pauvreté et de la faire reculer, le Gouvernement ne portera en conséquence aucune réforme qui pénaliserait les plus vulnérables.
Cependant, exclure de cette réflexion transversale à l’ensemble des bénéficiaires des minima sociaux le champ du handicap fermerait a priori le dialogue sur les questions de la pauvreté et de l’accompagnement des personnes en situation de handicap, privant notamment les jeunes d’un accompagnement vers l’activité.
Je rappelle que le revenu universel d’activité vise deux objectifs très clairs : l’accompagnement vers l’activité et l’assurance qu’une reprise d’activité se traduira par un gain. Il n’a pas vocation à précariser davantage ceux qui sont les plus fragiles et qui se trouveraient temporairement ou durablement très éloignés de l’emploi.
À cet égard, Sophie Cluzel et moi-même avons pris des engagements, notamment dans le cadre des concertations. Les allocataires de l’AAH ne s’inscrivent pas dans une conditionnalité de reprise d’activité. Le bénéfice du revenu universel d’activité ne sera donc pas attaché à une obligation de recherche et de reprise d’activité pour les personnes en situation de handicap.
Concernant l’accompagnement vers l’activité, un groupe de travail complémentaire est en cours depuis le début de l’année. Cette réforme tiendra compte évidemment de ces travaux. Je me suis également engagée à ce que l’ensemble de l’enveloppe allouée au handicap demeure consacré aux personnes en situation de handicap.

Madame la secrétaire d’État, j’aimerais savoir chanter pour vous faire des gammes !
Non, l’AAH n’est pas un minimum social, c’est une prestation spécifique définie dans la loi de 1975 et dans celle de 2005, que je vous invite à relire !
Les bénéficiaires de l’AAH perçoivent cette allocation au regard de critères médicaux objectifs, qui établissent un taux d’incapacité les éloignant durablement de l’emploi, voire, hélas, très durablement pour beaucoup d’entre eux.
Vous n’ignorez pas que 20 % seulement des bénéficiaires de l’AAH travaillent, majoritairement dans des établissements et services d’aide par le travail, car ils ont besoin de ces structures.
La société inclusive dont le Gouvernement parle très souvent, madame la secrétaire d’État, ce n’est pas seulement une belle formule pour des effets de tribune. Une société inclusive, c’est une société qui s’adapte aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap que la vie n’a pas épargnées. Elle met en place pour chacune et pour chacun les mesures adaptées pour tendre vers l’équité. Telle n’est pas, à l’évidence, la philosophie du RUA. On verra d’ailleurs bien ce qu’il en adviendra.
Quoi qu’il en soit, je vous en conjure : l’AAH ne peut pas et ne doit pas disparaître au profit du RUA, car – je le répète – l’AAH n’est pas un minimum social !

La parole est à M. Philippe Mouiller, auteur de la question n° 985, adressée à Mme la ministre du travail.

Ma question s’adresse à Mme la ministre du travail.
Le dispositif « Territoires zéro chômeur de longue durée », créé par la loi du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée, a d’ores et déjà fait la preuve de son efficacité. Il s’inscrit dans le préambule de notre Constitution, qui dispose que « chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi ».
Ainsi, sur les 1 849 volontaires retenus pour expérimenter ce nouveau dispositif, plus de 850 personnes durablement privées d’emploi ont été embauchées dans le cadre d’un contrat de travail classique ou ont retrouvé un emploi. Plus de 20 % d’entre elles avaient un handicap qui rendait leur insertion professionnelle encore plus difficile.
De plus, cette expérimentation a un effet d’émulation sur chacun des territoires concernés, comme j’ai pu le constater à Mauléon, dans mon département des Deux-Sèvres.
Madame la secrétaire d’État, je suis étonné que le projet de loi d’extension de ce dispositif ne soit toujours pas inscrit à l’ordre du jour du Parlement.
Le Président de la République avait annoncé en septembre 2018, lors de la présentation de la stratégie de lutte contre la pauvreté, l’extension de l’expérimentation à 50 nouveaux territoires. Il a également insisté le 1er mars 2019, à Bordeaux, lors d’un grand débat, sur l’urgence d’étendre le dispositif.
Plus d’une centaine de territoires se sont déjà déclarés volontaires et sont dans l’attente de l’adoption de ce texte. Par ailleurs, 200 parlementaires soutiennent cette initiative et la Belgique s’apprête à expérimenter le projet.
Le président du Sénat lui-même vient de saisir le CESE (Conseil économique, social et environnemental) d’une demande d’avis sur la prévention et la réduction du chômage de longue durée, faisant référence à cette expérience.
L’extension du dispositif restait suspendue aux conclusions de rapports qui, aujourd’hui, sont connues. Ma question est simple : dans quel délai la deuxième loi d’expérimentation tant attendue sera-t-elle présentée au Parlement ?
Monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser l’absence de Muriel Pénicaud, retenue dans le cadre des concertations sur les retraites.
L’essaimage, ainsi que l’ouverture du dispositif « Territoires zéro chômeur de longue durée », est une mesure de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté.
Lutter contre le chômage de longue durée constitue l’une des priorités du Gouvernement et des réformes qu’il mène depuis deux ans.
S’agissant de l’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée prévue par la loi du 29 février 2016, elle a été lancée de manière opérationnelle en janvier 2017. Nous en sommes donc à trois années tout juste de mise en œuvre.
Depuis 2017, douze entreprises à but d’emploi (EBE) ont été créées sur les dix territoires qui ont été retenus après appel à projets. Ce sont 900 personnes privées d’emploi qui ont pu être recrutées, dont 750 sont actuellement salariées. Je puis vous assurer à ce titre que le ministère du travail apporte son plein soutien à cette démarche expérimentale.
Ainsi, 1 000 équivalents temps plein supplémentaires seront financés en 2020, en cohérence avec la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.
La contribution totale de l’État s’élève à 28, 5 millions d’euros dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2020, soit une progression de 6, 13 millions d’euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2019.
Cette expérimentation est intéressante, car elle permet de tester des modalités innovantes de lutte contre le chômage de longue durée. Comme toute expérimentation, il est désormais important de prendre du recul pour l’évaluer et partager avec tous les acteurs un diagnostic.
C’est dans ce sens que Muriel Pénicaud a réuni lundi 25 novembre dernier Laurent Grandguillaume, l’association qui porte l’expérimentation, le comité scientifique qui a remis son évaluation intermédiaire et les inspecteurs de l’IGAS (inspection générale des affaires sociales) et de l’IGF (inspection générale des finances) qui ont conduit une évaluation économique. Les rapports, comme vous l’avez rappelé, sont maintenant publics. Lors de cette réunion, chacun a pu partager ses conclusions. Elles convergent pour une grande part, qu’il s’agisse des fragilités comme des points positifs.
C’est pourquoi Muriel Pénicaud a demandé à l’association qui porte l’expérimentation et à ses services de poursuivre le travail de diagnostic – une réunion a eu lieu en décembre – pour permettre, dans les prochaines semaines, de faire des annonces sur les suites à donner à cette expérimentation.

Madame la secrétaire d’État, je vous remercie de votre réponse. Je prends bonne note de votre volonté affichée de soutenir cette expérimentation, ce que vous avez confirmé par les travaux menés.
J’ai également relevé les chiffres de mobilisation lors du budget. Je rappelle néanmoins que la demande vise avant tout à étendre le nombre des territoires concernés, même si force est de constater que les engagements financiers sont de plus en plus importants sur la durée. En effet, puisque l’expérimentation fonctionne, des recrutements ont lieu dans les différentes EBE.
J’ai pris bonne note de votre programmation. Vous avez fait référence à la fois aux réunions de bilan et aux réunions de concertation. Je connais bien l’association concernée : les diagnostics sont prêts. Je sais aussi que les textes sont déjà analysés. Il y a donc des allers-retours. Toutes les conditions sont donc sur la table pour décider par voie législative de l’extension de cette expérimentation.
Il est important de continuer dans cette dynamique : une rupture, une interrogation ou des non-réponses pourraient avoir des conséquences dramatiques sur les territoires. Nous avons un outil qui fonctionne. Les retours et le bilan sont plutôt favorables, la mesure ayant une incidence directe sur l’emploi. Au vu de l’état d’esprit du Gouvernement, il y a urgence à accélérer le déploiement du dispositif…

La parole est à Mme Agnès Canayer, auteur de la question n° 1072, adressée à Mme la ministre du travail.

Ma question risque d’être quelque peu redondante avec celle de mon collègue Philippe Mouiller puisqu’elle porte également sur l’extension de l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée », mais c’est la preuve qu’il s’agit d’une mesure attendue sur l’ensemble des territoires.
L’extension de cette expérimentation, comme l’a souligné à juste titre mon collègue, permettrait aux territoires de mettre en place des actions au plus proche des enjeux et des chômeurs de longue durée.
Je suis présidente d’une mission locale en Normandie et de l’association régionale des missions locales : on voit bien que ce sont les actions d’accompagnement global, menées en lien avec les différents enjeux territoriaux de proximité, tant en matière de développement économique, de création d’emplois que de soutien des personnes les plus en difficulté pour connecter la demande à l’offre, qui sont efficaces. Les résultats de l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » vont dans le bon sens.
La commune de Port-Jérôme-sur-Seine, en Seine-Maritime, et son agglomération Caux Seine Agglo ont développé une méthodologie tendant à mettre en place cette expérimentation sur un territoire extrêmement dynamique. L’engagement des collectivités locales est fort pour trouver des solutions innovantes en parallèle des actions de développement économique et d’attractivité du territoire de la vallée de la Seine. Il existe donc une forte attente sur le territoire pour bénéficier également du dispositif.
Je comprends parfaitement l’enjeu d’expérimentation et surtout d’évaluation du dispositif. Néanmoins, veillons à ce que l’évaluation ne retarde pas trop la mise en œuvre de mesures nécessaires et ne freine pas les énergies qui montent aujourd’hui dans nos territoires.
Madame la secrétaire d’État, il y a véritablement urgence, comme l’a souligné mon collègue Philippe Mouiller, à étendre rapidement cette expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » aux 105 projets validés qui sont en attente.
Madame la sénatrice, permettez-moi de revenir sur mes propos et de compléter ma réponse précédente.
Le Gouvernement est pleinement mobilisé pour lutter contre le chômage de masse. Les résultats sont encourageants. Le taux de chômage, certes encore très élevé dans notre pays, a baissé de 9, 6 % à 8, 6 %, soit son plus bas niveau depuis dix ans.
Le nombre de créations d’emplois nettes s’élève à 258 000 cette année et à 540 000 depuis deux ans et demi. S’agissant de l’apprentissage, les résultats sont historiques : 458 000 apprentis, soit 8, 4 % de plus au premier semestre 2019.
Ces résultats nous invitent à poursuivre l’effort, notamment à l’égard des jeunes, sujet que vous suivez attentivement au travers de l’action des missions locales.
Comme je l’ai souligné précédemment, nous apportons dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté des moyens importants aux missions locales pour accompagner plus de personnes dans le cadre de la garantie jeunes. Nous consacrons aussi des moyens financiers au titre de l’insertion, je pense à l’allocation Pacea (parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie). Il s’agit de leviers pour éviter que des jeunes n’entrent dans la précarité et la pauvreté.
Enfin, à partir du 1er septembre 2020, entrera en vigueur l’obligation de formation des 16-18 ans. Le rapport a été remis hier au Premier ministre, à la ministre du travail, Muriel Pénicaud, et à Jean-Michel Blanquer. C’est en faisant de la prévention pour que ces jeunes ne deviennent pas invisibles que nous pourrons lutter efficacement contre le chômage.
Je tiens également à réaffirmer le soutien total et entier du ministère du travail et du ministère des solidarités et de la santé à cette démarche expérimentale visant à résorber le chômage de longue durée.
Ainsi, 1 000 équivalents temps plein supplémentaires seront financés en 2020, en cohérence avec la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. La contribution totale de l’État s’élève à 28, 5 millions d’euros, soit 6, 13 millions d’euros de plus qu’en 2019. C’est un financement quasi exclusif de l’État.
Cette expérimentation est innovante, comme je viens de le rappeler. Elle permet de tester des dispositifs nouveaux pour lutter contre le chômage de longue durée.
Pour compléter mes propos, je souhaite insister sur l’ensemble des moyens supplémentaires apportés aux 99 départements qui ont contractualisé avec l’État dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Le Gouvernement apporte donc des moyens financiers supplémentaires pour permettre un accompagnement global par le biais d’un travailleur social et d’un conseiller de Pôle emploi. Tout cela est nécessaire lorsqu’il s’agit de chômeurs de longue durée.
C’est une nouvelle dynamique puisque chaque bénéficiaire du RSA peut être accompagné en moins d’un mois. Tel est l’ensemble des enjeux, au-delà de l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée ».

La stratégie de lutte contre le chômage de longue durée est extrêmement difficile. Elle nécessite, vous le savez, madame la secrétaire d’État, une réelle collaboration et un travail collectif.
Certes, le taux de chômage est aujourd’hui en baisse, mais ceux qui restent très éloignés de l’emploi sont aussi ceux qui sont les plus difficiles à accompagner, qu’il s’agisse des jeunes ou des moins jeunes. Tout le monde doit donc se mettre autour de la table. Il faut un accompagnement global et des expérimentations qui partent des territoires, de la base. Il est urgent d’étendre cette expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée », d’autant qu’elle est très attendue. Il s’agit pour nous d’un levier supplémentaire.

La parole est à M. Jean-Claude Luche, auteur de la question n° 674, adressée à M. le ministre de l’intérieur.

Monsieur le secrétaire d’État, en mai 2019, le ministre de l’intérieur proposait dix mesures pour tenter de faire baisser le prix du permis de conduire de l’ordre de 30 %. À cette occasion, de nombreux gérants et personnels d’auto-écoles avaient affirmé leurs inquiétudes lors d’importantes manifestations.
Les auto-écoles dites « traditionnelles » subissent la concurrence de nouveaux prestataires sur internet, qui proposent des prix paraissant plus attractifs. Effectivement, ce ne sont pas les mêmes charges qui pèsent sur les uns et sur les autres. Les auto-écoles telles que nous les connaissons assurent un emploi stable à leurs personnels, paient des charges sociales, les véhicules, le carburant et les assurances.
Sur internet, les prestataires mettent en relation les élèves avec un moniteur auto-entrepreneur ou indépendant qui exerce à son compte. Avec ce mode de fonctionnement, l’État perd des ressources fiscales et sociales ; pour les personnels, les emplois deviennent précaires.
Si, par exemple, les auto-écoles traditionnelles venaient à disparaître dans mon département de l’Aveyron, il n’est pas sûr que des auto-entrepreneurs viennent proposer des heures de conduite. Pour passer le permis de conduire, les élèves devraient effectuer de nombreux kilomètres avant de pouvoir trouver un de ces nouveaux moniteurs.
C’est pourquoi je souhaite attirer l’attention du ministre de l’intérieur sur l’importance de maintenir des auto-écoles dites « traditionnelles » dans nos territoires ruraux. Sur les dix mesures annoncées en mai, trois ont été mises en place et d’autres sont expérimentées dans plusieurs départements. Que donnent ces expérimentations ? Quand les prochaines mesures entreront-elles en vigueur ?
Monsieur le sénateur, la mobilité est une priorité du Gouvernement, car le permis de conduire constitue un véritable passeport vers l’insertion professionnelle et sociale.
Comme vous le savez, le secteur de l’éducation routière a été profondément bouleversé ces dernières années. L’émergence des nouveaux modèles en ligne, à condition qu’ils s’inscrivent dans le cadre de la loi et d’un apprentissage de qualité, peut constituer un complément à l’offre proposée dans nos territoires.
Mais il ne s’agit pas de remettre en cause le modèle auquel nous sommes attachés et qui favorise le lien social.
Les réformes entreprises depuis la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ont permis de nombreuses avancées. Je pense, par exemple, à la réduction significative des délais de passage aux examens. À cet égard, je tiens à saluer l’engagement de nos 1 400 inspecteurs du permis et leur capacité à s’adapter en permanence aux nouveaux défis.
Dans la continuité des travaux engagés, un plan de réforme constitué de dix mesures, vous l’avez rappelé, a été présenté le 2 mai 2019 par le Premier ministre. Sur ces dix mesures, trois sont déjà entrées en vigueur : le développement de l’usage du simulateur de conduite dans la formation, qui requiert un local, le développement de l’apprentissage de la conduite sur boîte automatique et l’abaissement de l’âge de passage de l’examen dans le cadre de l’apprentissage anticipé de la conduite.
Les sept autres mesures sont en cours de déploiement. Portées notamment par la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, elles concernent la gratuité de l’examen théorique pour les volontaires du service national universel, la mise en place d’une plateforme gouvernementale dédiée au choix de son auto-école, le développement des apprentissages accompagnés de la conduite, la mise en place d’une nouvelle épreuve théorique moto du code de la route, la modernisation de l’inscription à l’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire ou encore la mise en place d’un livret d’apprentissage numérique.
Vous le constatez, le Gouvernement poursuit sa politique innovante et veille à ce que, quel que soit le modèle économique choisi, soient garantis un enseignement de qualité et la sécurité des apprentis conducteurs.

La parole est à Mme Sabine Van Heghe, auteure de la question n° 957, adressée à M. le ministre de l’intérieur.

Je souhaite interroger M. le ministre de l’intérieur sur la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle émise par la commune de Leforest au titre de la sécheresse de 2018.
Du fait des sécheresses qui ont marqué les trois dernières années, des habitations ont été touchées par des mouvements de terrain, ce qui provoque de véritables drames humains.
Confronté à un risque d’effondrement, le maire de Leforest n’a eu d’autre choix, sa responsabilité étant engagée, que de prendre un arrêté de péril imminent, synonyme, pour les habitants concernés, d’expulsion, donc de désarroi moral et matériel, les intéressés devant continuer à rembourser leur crédit immobilier.
Jusqu’en décembre dernier, leur seul espoir était que l’état de catastrophe naturelle soit reconnu pour 2018, afin que les assurances puissent les indemniser. Cependant, sous l’impulsion d’un collectif de parlementaires issus de différents groupes politiques, a été adopté un amendement au projet de budget pour 2020 visant à dégager une somme de 10 millions d’euros pour parer aux situations les plus urgentes – les cas de grande détresse et d’urgence sociale. La commune de Leforest s’inscrit tout à fait dans ce cadre.
Je vous demande donc, monsieur le secrétaire d’État, d’agir avec diligence afin que les dégâts occasionnés par les sécheresses sur le territoire de la commune de Leforest puissent être réparés au mieux, sachant que le régime d’indemnisation de 1982 n’est plus du tout à la hauteur des enjeux.
Les sénateurs du groupe socialiste et républicain présenteront d’ailleurs demain, dans cet hémicycle, une proposition de loi réformant le régime des catastrophes naturelles. Ce texte vise à renforcer les droits des assurés, à accroître le montant des indemnisations dont ils bénéficient et à renforcer la prévention des dommages, en diminuant le reste à charge pour les particuliers. Il tend également à soutenir les élus, qui se trouvent en première ligne lors de la survenance d’une catastrophe naturelle, par exemple en instaurant, dans chaque département, une cellule de soutien aux maires confrontés à une telle catastrophe.
Madame la sénatrice, vous avez appelé mon attention sur la situation de la commune de Leforest, dans le Pas-de-Calais, qui a déposé une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse de 2018. Par arrêté interministériel du 15 octobre 2019, publié au Journal officiel le 15 novembre 2019, cette commune n’a pas été reconnue en état de catastrophe naturelle.
Je souhaite vous préciser que, pour décider de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour une commune, l’autorité administrative est tenue de se prononcer sur l’intensité anormale de l’agent naturel à l’origine des dégâts, et non sur l’importance des dégâts eux-mêmes. Ces critères techniques sont fondés sur des études approfondies réalisées par les services d’expertise mandatés par l’administration. Chaque commune touchée par le phénomène et ayant déposé une demande fait l’objet d’un examen particulier.
Compte tenu de la cinétique lente qui caractérise l’aléa de sécheresse et des connaissances scientifiques disponibles à ce jour, il est considéré que ces phénomènes, engendrés par le retrait et le gonflement des argiles, ne peuvent se produire que si deux conditions se trouvent conjointement remplies : d’une part, une condition géotechnique – un sol d’assise des constructions constitué d’argiles sensibles au phénomène de retrait et de gonflement –, et, d’autre part, une condition de nature météorologique, à savoir une sécheresse du sol d’intensité anormale.
La méthode appliquée pour instruire les demandes communales formulées au titre de ce phénomène a été révisée par une circulaire datée du 10 mai 2019 afin, d’une part, de tenir compte des progrès les plus récents dans la modélisation hydrométéorologique réalisée par Météo France, et, d’autre part, de fixer des critères plus lisibles, pour les municipalités et pour les sinistrés, de caractérisation de l’intensité d’un épisode de sécheresse et réhydratation des sols.
Cette nouvelle méthode a été mise en application pour traiter l’ensemble des demandes communales déposées au titre de l’épisode de sécheresse de 2018. Sur son fondement, dix-huit communes du Pas-de-Calais ont été reconnues en état de catastrophe naturelle au titre de ce phénomène.
La présence importante dans le sous-sol de Leforest d’argiles sensibles au phénomène de retrait et gonflement est confirmée. En revanche, au regard des données recueillies par Météo France, les niveaux d’humidité des sols superficiels de Leforest ne relèvent d’une sécheresse géotechnique anormale pour aucune des quatre saisons de l’année 2018.
Je ne méconnais pas les effets des mouvements différentiels de terrain provoqués par la sécheresse et la réhydratation des sols sur certains immeubles de Leforest, mais seuls les épisodes de sécheresse présentant une intensité anormale avérée donnent lieu à une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, ce qui n’est malheureusement pas le cas de cette commune pour l’ensemble de l’année 2018.

Merci de ces explications techniques, monsieur le secrétaire d’État, mais je demande la prise en compte en urgence de la situation dramatique vécue par certains habitants de la commune de Leforest.

La parole est à Mme Véronique Guillotin, auteure de la question n° 962, transmise à M. le ministre de l’intérieur.

Monsieur le secrétaire d’État, je vis en Meurthe-et-Moselle, à Villerupt, une commune d’environ 10 000 habitants située à une trentaine de kilomètres, par la route, de la centrale nucléaire de Cattenom, en Moselle, et à 5 kilomètres de la ville d’Esch-sur-Alzette, au Luxembourg. La commune de Villerupt est adhérente à une communauté de communes dont certaines communes membres sont éligibles à la distribution gratuite de pastilles d’iode.
Selon la réglementation, les habitants de Villerupt, comme d’ailleurs ceux d’autres communes voisines, sont exclus de ce dispositif, puisque le centre-ville est situé à 22 kilomètres, donc à plus de 20 kilomètres, de la centrale nucléaire. Le rayon retenu pour la distribution de pastilles d’iode, fixé auparavant à 10 kilomètres, a en effet été récemment porté à 20 kilomètres par les autorités.
C’est une sage décision, mais des questions demeurent. On constate que, chez nos voisins européens, la réglementation en la matière est bien plus protectrice. À titre d’exemple, en Belgique, à quelques kilomètres de chez nous, il est possible d’obtenir des pastilles d’iode gratuitement dans un rayon de 100 kilomètres autour des installations nucléaires. Au Luxembourg, à deux pas de notre collectivité, toute la population est progressivement dotée de pastilles d’iode en prévision d’un éventuel accident à Cattenom : un comble quand on sait que les habitants du Luxembourg sont plus éloignés de la centrale que ceux de ma commune et de nombreuses autres communes de mon département ! Comme je le disais, la règle retenue, qui repose sur le seul kilométrage, exclut, au sein d’une même intercommunalité, les habitants de certaines communes membres.
Alors que nos centrales nucléaires sont vieillissantes, que les phénomènes climatiques s’intensifient et que la population s’intéresse toujours plus, et à juste titre, aux questions environnementales, il paraît nécessaire d’engager une réflexion plus poussée sur la protection sanitaire des populations éventuellement exposées. Si la prise de pastilles d’iode ne permet pas, on le sait, de parer à un accident, elle constitue une solution d’urgence permettant d’éviter en partie le développement de cancers et de troubles de la thyroïde après une exposition radioactive. Je pense que vous serez d’accord avec moi pour affirmer, monsieur le secrétaire d’État, que, en matière de santé, il n’y a pas d’économies à réaliser.
Ma question est double : peut-on envisager une évolution de la réglementation et une mise à niveau par rapport à nos voisins européens dans les années à venir ? À court terme, est-il possible d’étendre la distribution gratuite de pastilles d’iode à l’ensemble des habitants d’une intercommunalité dès lors que l’une de ses communes membres est comprise dans le rayon de 20 kilomètres, règle qui pourra, je l’espère, évoluer à l’avenir ?
Madame la sénatrice, depuis 1997, des campagnes de distribution de comprimés d’iode aux riverains des centrales nucléaires sont régulièrement organisées. Elles concernent effectivement les zones situées dans un rayon de 10 kilomètres autour d’une centrale et intégrées au plan particulier d’intervention (PPI).
Depuis 2019, la prédistribution a lieu dans un rayon de 20 kilomètres et concerne plus de 3 millions de personnes, les écoles, les administrations et les entreprises. Ces campagnes se déroulent au moins tous les sept ans. La dernière, dans un rayon de 10 kilomètres, a été organisée en 2016 et une campagne complémentaire, concernant les populations habitant entre 10 et 20 kilomètres d’une centrale, est en cours.
Cette campagne a permis l’information des maires concernés au premier trimestre 2019, via des courriers, des kits d’information, des réunions en préfecture dans les dix-huit départements concernés. Une précampagne d’information a été menée auprès des riverains en juin dernier et une campagne de distribution le 17 septembre dernier, avec des communiqués de presse, des courriers contenant des bons de retrait en pharmacie. Toute personne n’ayant pas reçu ce courrier peut néanmoins retirer une boîte de comprimés en pharmacie, sur simple présentation d’un justificatif de domicile. Fin novembre, le nombre total de retraits s’élevait à 150 000. Des actions de relance et de communication sont prévues jusqu’en juin 2020.
Dans le cadre de l’organisation de la réponse de sécurité civile (Orsec) aux échelons zonal et départemental, cette prédistribution est complétée par le prépositionnement de 110 millions de comprimés. Le prépositionnement, instauré dans les zones où l’urgence est moindre, offre une meilleure traçabilité et de meilleures conditions de stockage ; il permet surtout de déplacer rapidement les stocks, lesquels sont suffisants pour couvrir l’ensemble de la population.
Ce sont les préfets qui organisent les plans de distribution des comprimés. S’ils estiment que la situation nécessite la prise de comprimés, les stocks sont déployés vers des points de distribution.
Les campagnes de distribution de comprimés d’iode permettent de sensibiliser aux risques et de mobiliser les citoyens, dont l’implication est indissociable d’une gestion efficace des crises. De nombreux acteurs de terrain – maires, commissions locales d’information, professionnels de santé – sont également mobilisés aux côtés des pouvoirs publics et d’EDF.

Monsieur le secrétaire d’État, vous avez fait un rapide rappel de la législation en vigueur, mais ma question était tout autre : comment éviter des « trous dans la raquette » au sein d’une intercommunalité et comment parvenir à nous mettre au niveau des autres pays européens ? En Belgique, je le redis, les pastilles d’iode sont distribuées dans un rayon de 100 kilomètres.

La parole est à M. Rachid Temal, auteur de la question n° 898, transmise à M. le ministre de l’intérieur.

Notre démocratie repose sur une promesse d’égalité – un citoyen, une voix –, mais cette promesse s’estompe.
En effet, monsieur le secrétaire d’État, qui décide du contenu du débat démocratique dans notre pays ? Les citoyens ? Les médias ? Ou bien encore les partis ? En tout cas, nul ne penserait aux banques… Pourtant, ce sont elles qui tiennent entre leurs mains les clés du financement de nos campagnes électorales ; ce sont elles qui décident de notre avenir, sans jamais se présenter à une élection.
Le gouvernement auquel vous appartenez avait pourtant pris une bonne initiative avec la création, au travers de la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, d’une banque publique de la démocratie ; mais, depuis lors, ni son ni image !
J’ai donc interrogé, en juillet 2018, la garde des sceaux sur ce sujet. Elle m’indiqua en retour que la « condition de “défaillance de marché” posée par le législateur ne paraissait pas caractériser la situation actuelle ». Pourtant, lors de la campagne pour les élections européennes, voilà quelques mois, il ne s’est pas passé une semaine sans qu’une liste ne fasse part de ses difficultés à trouver des financements ou ne lance une souscription.
Monsieur le secrétaire d’État, notre démocratie a besoin de pluralisme et les carences sont bien réelles. La banque publique de la démocratie doit devenir une réalité, utile non aux seuls partis, mais bien à notre démocratie. Les pistes sont nombreuses et les formes peuvent varier, s’articulant autour d’outils connus de tous ; je pense à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque publique d’investissement.
Monsieur le secrétaire d’État, quelles mesures concrètes le Gouvernement compte-t-il prendre pour faire aboutir cette belle promesse de la banque publique de la démocratie ?
Monsieur le sénateur, la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a institué un médiateur du crédit afin de favoriser le pluralisme politique par la facilitation de son financement. Ce médiateur a pour mission de contribuer à rapprocher les candidats, partis et groupements politiques et les banques.
Dans son rapport rendu le 30 septembre dernier, à la suite des élections européennes du 26 mai 2019, le médiateur n’a pas relevé de difficultés systémiques, corroborant ainsi l’analyse menée en 2017 par l’inspection générale des finances et l’inspection générale de l’administration.
Toutefois, ce rapport a mis en lumière que, sur les trente-quatre listes de candidats aux élections européennes, huit ont été confrontées à des difficultés pour obtenir l’ouverture d’un compte bancaire, alors même que le législateur garantit un droit au compte, tandis que neuf partis ont essuyé un refus de prêt bancaire.
Ces chiffres révèlent une situation perfectible et le médiateur a fait plusieurs propositions de nature à la faire évoluer. Il appelle notamment à la réduction des délais pour les ouvertures de comptes bancaires, pour la délivrance des moyens de paiement et pour l’instruction des demandes de prêt.
À l’inverse, il est important que les candidats et les partis connaissent mieux les critères et exigences des établissements bancaires. Le site internet de la médiation, en cours de construction, devrait faciliter l’information sur les dispositifs en vigueur ou en cours de mise en place.
Au-delà de ces actions de sensibilisation, le médiateur a fait plusieurs recommandations visant à élargir l’accès de tous les candidats à la propagande, ce qui passe notamment par un surcroît de dématérialisation.
Par ailleurs, le rapport du 30 septembre 2019 met l’accent sur la nécessité, pour les candidats et les partis politiques, de recourir aux autres modalités de financement qui leur sont ouvertes, au-delà des aides publiques : appels aux dons de sympathisants et militants, emprunts auprès des partis et, désormais, auprès des particuliers. Cette dernière modalité a d’ailleurs été largement mise en œuvre lors des récentes élections européennes.
De même, en application de la loi du 2 décembre dernier, qui entrera en vigueur le 30 juin 2020, les partis et candidats pourront recueillir des fonds via un financement participatif.

Monsieur le secrétaire d’État, vous nous dites que, finalement, il n’y a pas de difficultés, tout en admettant que neuf listes en ont connu pour accéder à un financement… Nous savons tous ici combien il est difficile d’obtenir un prêt bancaire pour financer une campagne ; on le voit notamment à l’approche des élections municipales.
Il faut donc agir ! Monsieur le secrétaire d’État, votre réponse m’inquiète d’autant plus qu’elle renvoie à d’autres sources de financement, les banques n’ayant aucune obligation. Je considère pour ma part qu’il revient à l’État de mettre en place la banque publique de la démocratie – c’était d’ailleurs le sens de l’article 30 de la loi du 15 septembre 2017 –, de sorte que chaque Français puisse être candidat à une élection. Sans cela, c’est encore une fois l’argent qui décide de qui peut ou non être candidat dans notre démocratie ; c’est très grave.

La parole est à Mme Céline Brulin, auteure de la question n° 994, transmise à M. le ministre de l’intérieur.

Conformément à l’arrêté du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de défense extérieure contre l’incendie, un règlement départemental a été approuvé par la préfecture de Seine-Maritime en octobre 2017.
Ce règlement engage la responsabilité des maires au travers de nouvelles obligations particulièrement strictes relatives aux réserves incendie. En effet, désormais, les habitations doivent se situer à moins de 200 mètres d’une borne incendie, ou de 400 mètres dans le cas d’habitations isolées.
Dans bien des communes, ces distances sont souvent impossibles à respecter. Un maire du département dont je suis élue m’a par exemple informée que la mise en conformité avec ces normes représenterait dix fois son budget annuel d’investissement, y compris en optant pour des bâches extérieures, pourtant moins coûteuses.
Le référentiel national ne tient pas compte des spécificités locales, ce qui complexifie encore la situation. Il interdit par exemple le recours aux dispositifs mobiles des sapeurs-pompiers, qui serait pourtant particulièrement adapté pour les habitations isolées.
Encore une fois, les élus locaux ont l’impression que les décisions prises sont déconnectées de la réalité des territoires ; c’est pourquoi ils avaient unanimement rejeté, en 2017, une première proposition de règlement départemental. L’application stricte des distances retenues rend la situation intenable en Seine-Maritime. Pour beaucoup de maires, cela implique de cesser d’accorder des permis de construire et même, souvent, de se retrouver hors la loi.
Monsieur le secrétaire d’État, l’État ne peut pas renvoyer la responsabilité aux autorités départementales et aux services départementaux d’incendie et de secours (SDIS). Comptez-vous apporter une réponse à cette question, qui constitue l’une des principales préoccupations des maires du département de Seine-Maritime ?
Madame la sénatrice, l’efficacité des opérations de lutte contre les incendies dépend notamment de l’adéquation entre les besoins en eau et les ressources disponibles.
La défense extérieure contre l’incendie (DECI), placée sous l’autorité du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale chargé d’un pouvoir de police administrative spéciale, a pour objet d’assurer, en fonction des besoins résultant des risques à couvrir, l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours, par l’intermédiaire de points d’eau identifiés à cette fin. Il s’agit d’un appui indispensable pour permettre aux sapeurs-pompiers d’intervenir rapidement, efficacement et dans des conditions optimales de sécurité.
La réforme de la DECI, conduite en 2015, a instauré une approche novatrice : la DECI ne répond plus à une norme nationale, mais relève d’un règlement départemental élaboré par le préfet. Elle répond à un double objectif : un renforcement de la concertation avec les collectivités territoriales et une plus grande souplesse dans la définition et l’application des mesures, adaptées à la réalité et à la diversité des risques incendie propres à chaque territoire.
La distance maximale séparant les points d’eau et les risques à couvrir est déterminée au regard des enjeux en matière de protection et des techniques opérationnelles des sapeurs-pompiers. La fixation de ces distances est déterminée par l’analyse du risque d’incendie et elle conditionne les délais de mise en œuvre des dispositifs d’extinction.
J’ai parfaitement conscience que cette réglementation, nécessaire pour garantir une lutte efficace et rapide contre les incendies, peut parfois être contraignante dans certaines communes, notamment rurales. Ce règlement peut évoluer par le biais de nouveaux échanges avec les partenaires et selon les procédures applicables.
J’ajoute que la DECI ne doit pas altérer la qualité sanitaire de l’eau distribuée ni conduire à des dépenses excessives, au regard, notamment, du dimensionnement des canalisations. Si le réseau d’eau potable ne permet pas d’obtenir le débit nécessaire à la DECI, d’autres ressources sont utilisables : points d’eau naturels, réseaux d’irrigation agricole, citernes fixes, cuves ou encore réservoirs réalimentés par l’eau de pluie.
La DECI repose sur un équilibre entre les impératifs de la sécurité des populations, sa constante amélioration et un coût financier supportable, notamment pour les communes rurales, le tout étant apprécié à l’échelon local.

Je retiens de vos propos, monsieur le secrétaire d’État, que ce règlement peut encore évoluer.
Vous avez parlé de souplesse ; c’est précisément ce dont nous manquons en Seine-Maritime, où l’application du référentiel est extrêmement stricte et rigoureuse. Je vous remercie donc de bien vouloir intervenir pour qu’une souplesse soit concrètement apportée. On constate aujourd’hui des situations totalement aberrantes, ubuesques, qui, c’est le moins que l’on puisse dire, ne renforcent pas le crédit de la parole de l’État ni les liens de confiance entre celui-ci et les élus locaux.
Je conclurai en exprimant un sentiment de « deux poids, deux mesures ». En effet, sans entrer dans les détails, l’incendie de Lubrizol a tout de même fait apparaître des manquements à la réserve incendie sur certains sites industriels. On ne peut pas être plus exigeant à l’égard de communes disposant de peu de moyens qu’on ne l’est à l’égard d’industriels dont les possibilités sont autrement plus importantes.

La parole est à M. Michel Canevet, auteur de la question n° 998, adressée à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

Je suis heureux, monsieur le secrétaire d’État, que vous soyez au banc du Gouvernement aujourd’hui pour me répondre, car vous êtes particulièrement concerné par les questions de patronymie.
En Bretagne, une affaire fait grand bruit. Un couple a décidé de prénommer son enfant Fañch, avec un tilde sur le « n », et, depuis lors, les procédures judiciaires s’enchaînent, sur l’initiative du procureur de la République. Si le tribunal de grande instance de Quimper a donné raison à ce dernier, tel n’a pas été le cas de la cour d’appel de Rennes et de la Cour de cassation.
Mon vœu le plus cher est que la circulaire de la Chancellerie du 23 juillet 2014 établissant les signes diacritiques utilisables dans la patronymie française puisse être modifiée. En effet, si le décret dit « Robespierre » du 2 thermidor de l’an II préconise l’utilisation du français pour la rédaction des actes de l’état civil, on peut aussi se référer à l’ordonnance royale de Villers-Cotterêts de 1539, dont le texte même comprend un grand nombre de tildes. C’est dire que ce signe appartient bien à la langue française !
Je souhaite donc savoir si le Gouvernement est enfin décidé à modifier la circulaire précitée pour admettre l’usage du tilde dans la langue française.
Monsieur le sénateur, vous avez souhaité appeler l’attention de la garde des sceaux, que je représente ici, sur la reconnaissance du tilde dans les actes de l’état civil et sur la date prévisible de l’ajout de ce signe à la liste des signes diacritiques admis en langue française au travers de la circulaire du 23 juillet 2014.
Tout d’abord, il faut souligner que la promotion des langues régionales est assurée de diverses manières et, ainsi que le rappelle notamment le contrat d’action publique pour la Bretagne, elle passe principalement par le biais de l’enseignement et de la culture.
La circulaire du 23 juillet 2014 de la Chancellerie que vous évoquez dresse la liste des voyelles et consonne accompagnées d’un signe diacritique souscrit – placé au-dessous de la lettre, telle la cédille – ou suscrit – placé au-dessus de la lettre, tels l’accent et le tréma – connues de la langue française. Cette liste, ne comprenant pas le tilde, a été validée en 2014 par l’Académie française, qui a confirmé sa position en novembre 2018.
Le 17 octobre 2019, dans l’affaire Fañch, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi en cassation formé par le procureur général près la cour d’appel de Rennes, au motif que les parents de l’enfant n’avaient été appelés qu’en leur qualité personnelle, et non en leur qualité d’administrateurs légaux de l’enfant. Ainsi, la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur le fond de l’affaire ni sur la possibilité d’employer le tilde dans les actes de l’état civil, en l’occurrence sur la lettre « n ».
Néanmoins, nous souhaitons indiquer que, pour ce qui concerne l’état civil, les services de l’État étudient la faisabilité d’une intégration de signes diacritiques pour permettre la prise en compte de l’orthographe de certains prénoms issus de langues régionales au regard, d’une part, des enjeux normatifs et informatiques, et, d’autre part, de la charge de travail des officiers de l’état civil.
Enfin, dans la continuité des actions de promotion des langues régionales de France, les textes en vigueur, confortés par la jurisprudence, autorisent les officiers de l’état civil à délivrer, sur la demande des intéressés, des livrets de famille et des copies intégrales et extraits d’actes de l’état civil bilingues ou traduits dans une langue régionale.

Mais qu’en pensez-vous personnellement, monsieur le secrétaire d’État ?

Monsieur le secrétaire d’État, c’est une toute petite ouverture que vous faites, mais je regrette l’entêtement du Gouvernement en cette matière. Le procureur près la cour d’appel de Rennes a précisément indiqué ce matin qu’il faudrait que le législateur s’empare du sujet. Je remercie à cet égard ceux de mes collègues, dont Jean-Pierre Sueur, Françoise Gatel, Agnès Canayer et Jean-Luc Fichet, qui ont soutenu mon amendement à la proposition de loi qui sera examinée jeudi prochain. J’espère que nous parviendrons enfin, par la loi, à faire que le tilde puisse figurer dans le prénom de certains petits Bretons. Ce ne serait que logique.

La parole est à M. Guillaume Chevrollier, auteur de la question n° 573, adressée à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

Les violences exercées à l’encontre des professionnels du secteur agricole, qu’il s’agisse d’actions d’intimidation, d’intrusions dans des lieux de production ou d’agressions physiques, notamment par des activistes « végans » anti-viande et anti-élevage, sont de plus en plus fréquentes. Ces violences sont inacceptables. Entre 2017 et 2018, plus d’une centaine d’actions illégales ont eu lieu partout en France.
Bien évidemment, je respecte les idées de ces militants, mais eux doivent respecter nos agriculteurs, dont les activités sont, elles, légales. Dans leur immense majorité, nos agriculteurs veillent au bien-être animal.
Compte tenu du poids économique du secteur agroalimentaire et de l’implication des hommes et des femmes qui remplissent avec cœur la mission vitale de nourrir la population, nous avons la responsabilité de défendre nos agriculteurs et nos modèles agricoles. Une prise de conscience et une mobilisation collectives des professionnels et des élus sont indispensables pour dénoncer ces agissements.
Dans mon département, la Mayenne, un observatoire de l’agri-bashing a été mis en place. Il rassemble les services de l’État, les syndicats agricoles et la chambre d’agriculture en vue de lutter contre les intrusions dans les exploitations. Les filières agricoles et agroalimentaires attendent des réponses très concrètes de la part de l’État : une évolution de la loi doit permettre de prononcer des sanctions fermes contre les malfaiteurs qui, par leurs intrusions dans les exploitations, bafouent la propriété privée.
Monsieur le secrétaire d’État, comment mieux protéger, de façon concrète, les agriculteurs en cas d’intrusion et comment lutter, en outre, contre la diffusion numérique de fausses informations sur l’agriculture ?
Monsieur le sénateur, je vous confirme que la garde des sceaux, que je vous prie d’excuser, le ministre de l’intérieur et moi-même suivons avec la plus grande attention cette question, qui concerne tout notre territoire. Le Gouvernement est pleinement engagé dans la lutte contre les actions violentes que subissent certains professionnels de la filière agroalimentaire.
À ce titre, la direction des affaires criminelles et des grâces a diffusé, le 22 février 2019, une dépêche sur le phénomène des actions violentes de mouvements animalistes radicaux, afin de mobiliser les parquets et de leur rappeler les qualifications pénales pouvant être retenues dans ces situations.
Ces agissements font ainsi l’objet de la plus grande attention de la part des procureurs, qui diligentent systématiquement des enquêtes pénales minutieuses, aux fins d’établir le contexte de la commission des faits, d’en identifier les auteurs et de présenter ces derniers à une juridiction. Ils sont épaulés, à cette fin, par les services d’enquête judiciaire, plus particulièrement ceux de la gendarmerie nationale, qui a récemment créé une cellule nationale spécifique, appelée « Demeter », chargée de centraliser les informations disponibles sur ce type d’affaires et de réaliser des rapprochements en vue de faciliter l’identification des auteurs de ces agissements.
Certains faits similaires à ceux que vous évoquez, qui ont pu avoir lieu ailleurs sur notre territoire national, ont d’ailleurs déjà conduit à des condamnations. Par exemple, en décembre 2018, six personnes ont été condamnées par le tribunal correctionnel de Roanne du chef de violation de domicile alors qu’elles avaient pénétré sur un site d’abattage sans autorisation ; en juin 2019, le tribunal correctionnel de Paris a condamné deux individus à trois mois et six mois d’emprisonnement pour des dégradations commises dans une boucherie parisienne et des violences sur les personnes d’un boucher et de fromagers.
Ces réponses judiciaires attestent de la prise en compte par les parquets du trouble à l’ordre public inacceptable ou de l’entrave à l’exercice professionnel qu’occasionnent de tels agissements, nécessitant, lorsque les éléments de preuve recueillis le permettent, une réponse pénale ferme et adaptée.
Le ministère de la justice estime que le cadre juridique actuel permet, dans la plupart des cas, de répondre efficacement aux actions violentes subies par les professionnels de la filière animale.
Toutefois, la garde des sceaux a rencontré, il y a quelques jours, les représentants de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA). Sensible à leurs inquiétudes, elle a chargé les services de son ministère d’engager une réflexion sur une éventuelle adaptation législative de la rédaction du délit de violation de domicile pour lever toute ambiguïté sur le fait que ce délit trouve bien à s’appliquer, y compris en cas d’intrusion dans les locaux professionnels d’une exploitation agricole.

Monsieur le secrétaire d’État, j’entends votre réponse et vous en remercie.
Effectivement, des précisions concernant la notion de violation de domicile sont attendues. Je rappelle que nos agriculteurs, qui sont déjà fragilisés sur le plan économique et dont les revenus ne sont pas à la hauteur de la charge de travail, attendent vraiment un soutien des pouvoirs publics. Ils veulent pouvoir exercer leur métier, être respectés par la société et être préservés des actions de minorités excessivement violentes et parfois radicalisées. Il est important que l’État soit au rendez-vous pour apaiser certaines tensions dans nos territoires, notamment ruraux.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, auteur de la question n° 1003, adressée à Mme la ministre des armées.

Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite appeler votre attention sur l’assassinat le 2 novembre 2013 dans la région du Kidal, au Mali, de deux journalistes de Radio France Internationale, Ghislaine Dupont et Claude Verlon.
Ces deux journalistes ont été enlevés par quatre hommes armés, avant d’être abattus, quelques kilomètres plus loin. Selon les enquêteurs, le véhicule des ravisseurs serait tombé en panne et ces quatre hommes auraient éliminé les deux otages avant de prendre la fuite.
Plusieurs zones d’ombre demeurent dans cette affaire tragique.
Premièrement, il a été découvert que le chef du commando était connu des services de renseignement, qu’il avait été auditionné par la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) quelques mois avant le rapt et l’assassinat des journalistes et qu’une seconde entrevue était prévue, ce qui pourrait laisser penser qu’il aurait été recruté comme informateur par les services de la DGSE. Qu’en est-il, monsieur le secrétaire d’État ?
Deuxièmement, différentes enquêtes effectuées par les journalistes mettent en avant un lien possible, et même probable, entre cet assassinat et l’affaire Arlit, désignant l’enlèvement d’employés d’Areva en 2010 au Niger. Selon ces enquêtes, leur libération aurait été négociée en échange d’une rançon de 30 millions d’euros et l’enlèvement des deux journalistes aurait été commis par des membres d’un bataillon considérant avoir été floués dans la répartition de cette rançon. Qu’en est-il ?
Troisièmement, il existe deux versions contradictoires sur un fait essentiel : les autorités françaises ont formellement assuré que les militaires étaient arrivés sur place après le drame et qu’ils n’avaient jamais eu de contact avec les ravisseurs ; un rapport des Nations unies affirme strictement le contraire. Quelle est la vérité ?
Enfin, je veux vous interroger sur une enquête menée par des journalistes, qui montre que les gendarmes chargés de l’établissement du procès-verbal sur place ont indiqué être intervenus sur une scène de crime largement souillée et modifiée, alors que le détachement de Serval avait reçu l’ordre de ne toucher à rien. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?
Monsieur le sénateur Jean-Pierre Sueur, vous évoquez dans votre question l’assassinat, le 2 novembre 2013 à Kidal, des journalistes de RFI Ghislaine Dupont et Claude Verlon.
Ces faits d’enlèvement et d’assassinat font l’objet d’une information judiciaire, dans le cadre de laquelle le ministère des armées a apporté et continue d’apporter son plein concours. Les forces françaises ont toujours appuyé l’action judiciaire, que ce soit sur place, à Kidal, au lendemain des faits, ou à Paris.
Je rappelle que c’est avec le concours de l’armée française, dans un contexte sécuritaire tendu, que les gendarmes de la prévôté ont été projetés sur les lieux, pour effectuer les premières constatations et fournir à la justice le maximum d’éléments de preuve. Les enquêteurs français de la direction centrale du renseignement intérieur de l’époque et de la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire ont également pu intervenir très rapidement. Cet appui logistique assuré dès le départ s’est poursuivi à mesure des besoins exprimés par les magistrats.
En effet, le ministère des armées a été requis à plusieurs reprises, en 2015 et en 2016, par les magistrats chargés de l’enquête. Toutes les demandes de déclassification successives formulées par la justice ont donné lieu à la fourniture de documents du ministère des armées, en parfaite conformité avec les avis de la Commission du secret de la défense nationale, qui est une autorité administrative indépendante.
Si des documents ou extraits de documents n’ont pas été déclassifiés, c’est uniquement, comme le prévoit la loi, pour préserver les capacités et méthodes des services, mais aussi assurer la continuité des opérations ou la protection des personnels. Conscient de la douleur des proches des journalistes assassinés, le ministère des armées a, autant que le lui permet l’impératif de protection du secret de la défense nationale et de l’instruction, répondu directement aux interrogations de ces derniers.
Je vous le redis, monsieur le sénateur, le ministère des armées continue à appuyer les investigations judiciaires en cours et répond avec une extrême diligence aux sollicitations des magistrats. En revanche, cet appui n’a pas vocation à être exposé publiquement, car il est couvert par le secret de l’enquête et de l’instruction. Je pense que vous le comprendrez.

Monsieur le secrétaire d’État, j’entends ce que vous dites. Vous concevrez toutefois notre déception de n’avoir reçu aucune réponse précise aux quatre questions précises que je vous ai posées et que se posent les journalistes de Radio France Internationale. Ces questions demeurent.

La parole est à M. Yannick Vaugrenard, auteur de la question n° 1053, adressée à Mme la ministre des armées.

Ma question concerne ceux que nous pourrions appeler les « oubliés de la Nation ».
Selon le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, la mention « mort pour le service de la Nation » peut être attribuée à une personne décédée « du fait de l’accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles ». Cependant, l’appréciation des « circonstances exceptionnelles » est laissée au ministre en fonction.
Or, avant 2017, les attributions de la mention « mort pour le service de la Nation » ont confirmé la reconnaissance des militaires décédés « accidentellement » lors d’exercices opérationnels. Mais depuis cette date, les décisions de la ministre vont à l’encontre de l’esprit initial du décret du 28 décembre 2016. En effet, les demandes de mention « mort pour le service de la Nation » pour des militaires qui décèdent accidentellement lors d’exercices opérationnels ou en missions intérieures sont désormais systématiquement rejetées.
Ces décisions, outre l’incompréhension qu’elles suscitent, instaurent une injustice à l’égard des militaires qui décèdent à l’entraînement. Les enfants de ces derniers ne sont pas reconnus comme « pupilles de la Nation », leur conjoint ne perçoit que 50 % de la pension de réversion et leur nom ne sera pas gravé sur le monument aux morts de leur commune.
L’un de mes collègues députés a déposé, le 22 mai dernier, une proposition de loi visant à octroyer le statut de « mort pour le service de la Nation » aux militaires décédés en exercice, ce qui permettrait d’assainir la situation actuelle et de la rendre plus juste.
Monsieur le secrétaire d’État, je souhaiterais connaître votre position sur cette proposition de loi et, plus globalement, que vous clarifiiez les conditions d’attribution de la mention « mort pour le service de la Nation » afin de supprimer l’arbitraire et d’intégrer les militaires décédés accidentellement lors d’exercices opérationnels ou en missions intérieures. Cela permettrait d’assurer notre soutien fraternel aux familles de ceux qui s’engagent pour défendre notre pays.
Monsieur le sénateur, je vous remercie de votre question, qui permet au Gouvernement de préciser les conditions d’attribution de la mention « mort pour le service de la Nation ».
Cette mention a été créée en 2012, au lendemain des attentats commis par Mohammed Merah contre la communauté juive et contre l’armée. Elle vise à honorer la mémoire des militaires et des agents publics tués en raison de leurs fonctions ou de leur qualité par l’action volontaire d’un tiers.
Vous avez évoqué le décret de 2016, qui est venu inclure le décès « dans des circonstances exceptionnelles », appréciées comme des situations présentant un caractère de gravité particulière ou anormale et imprévisibles.
Les mesures symboliques prises par la République n’ont de valeur que si elles sont précisément ordonnées. Le décret de 2016 a créé des incertitudes, et le ministère des armées réfléchit à la façon dont il peut y mettre fin pour éviter toute confusion et tout sentiment d’injustice.
Cependant, il n’est pas souhaitable, pour la mémoire et la reconnaissance des militaires tués au combat ou celle des agents publics victimes d’actes de terrorisme, d’étendre de façon indéfinie l’attribution des marques de reconnaissance. Les armées sont légitimement attachées à ces distinctions et à leur sens.
Toutes les morts sont tragiques. Le ministère des armées s’attache à apporter un soutien sans faille aux familles endeuillées. Les ayants cause peuvent ainsi se voir attribuer une allocation du fonds de prévoyance. Les enfants mineurs peuvent également bénéficier d’un régime de protection particulier. Une aide à l’éducation et/ou une allocation d’entretien peuvent ainsi leur être attribuées, pour un an renouvelable, via l’intervention de l’action sociale des armées.
Soyez assuré que le ministère des armées – et, à travers lui, le Gouvernement – apporte un soutien fraternel aux familles de tous les militaires décédés, que ce soit en combat ou en accident de service. Toutefois, il n’envisage pas d’étendre à ce dernier cas l’attribution de la mention « mort pour le service de la Nation ».

Monsieur le secrétaire d’État, vous vous en doutez, je ne suis pas totalement satisfait par votre réponse.
Vous avez évoqué une extension indéfinie : ce n’est pas de cela qu’il s’agit ! Il s’agit de mettre fin à une distinction, presque de principe, faite au détriment des militaires décédés accidentellement à l’entraînement. L’entraînement est indispensable pour assurer la défense de notre pays et de ses habitants. Je souhaiterais que cette distinction soit atténuée.

La parole est à M. Jean-Pierre Decool, auteur de la question n° 1028, adressée à M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.

Ma question porte sur l’enseignement des langues minoritaires et régionales de France.
Je prendrai l’exemple du flamand occidental, parlé dans mon territoire des Flandres françaises, mais je pense aussi au picard, cher à mon ami Jérôme Bignon, et à toutes les autres langues de France.
Le Gouvernement tente de mettre en œuvre, depuis 2017, le programme défendu par Emmanuel Macron lors de la campagne pour la dernière élection présidentielle et les engagements pris à cette occasion.
Les défenseurs des langues minoritaires et régionales, dont je fais partie, avaient alors pris bonne note d’une promesse qui a été oubliée, depuis, par le Gouvernement. Le candidat Emmanuel Macron entendait en effet encourager, une fois élu Président de la République, l’enseignement de ces langues.
Cette promesse, nous y tenions ! L’enseignement est la seule et unique garantie de la survie des langues minoritaires et régionales, qui appartiennent au patrimoine national.
Cette promesse, nous y tenons toujours ; c’est pourquoi j’interroge de nouveau M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Depuis 2017, les moyens de l’enseignement scolaire de ces langues régressent… et la promesse du Président de la République est bafouée.
Un exemple illustre le renoncement du Gouvernement à protéger les langues minoritaires. Dans les Hauts-de-France, le flamand occidental bénéficiait d’un enseignement depuis dix ans. Expérimenté pendant trois ans, celui-ci avait été validé après une évaluation rigoureuse. Suivi dans plusieurs écoles de l’arrondissement de Dunkerque, cet enseignement était très apprécié des jeunes et de leurs familles et complété par des activités extrascolaires, preuve de l’intérêt de la population.
L’heure de la retraite est venue pour l’enseignant ; l’heure de son remplacement, pensait-on : erreur ! Le rectorat renvoie aux acteurs locaux la responsabilité de la fin de cet enseignement. En irait-il de même pour le départ à la retraite d’un professeur d’anglais ? Ailleurs en France, en irait-il de même pour le départ à la retraite d’un enseignant de la langue basque à Biarritz ?
Cette hypocrisie est symptomatique du mépris du Gouvernement et de l’éducation nationale pour les langues minoritaires et régionales, que confirme, malgré toute l’estime que je vous porte, monsieur le secrétaire d’État, le fait que vous représentiez le Gouvernement pour répondre à cette question.
Ces langues ne sont pas une menace pour l’unité de la République. Elles relèvent de l’identité de ses territoires. C’est la raison pour laquelle nous sommes nombreux à attendre votre réponse à la question suivante : que compte faire le Gouvernement pour encourager l’apprentissage des langues régionales sur les territoires qui ont la chance d’en posséder une ? Plus précisément, pour le cas du flamand occidental, entendez-vous remplacer le professeur ayant fait valoir ses droits à la retraite, afin de ne pas rompre la continuité de l’enseignement du flamand dans le département du Nord ?
Monsieur le sénateur Jean-Pierre Decool, la préservation et la transmission des diverses formes du patrimoine – linguistique et culturel – des régions françaises font l’objet de la plus grande attention de la part du ministère de l’éducation nationale.
C’est dans cet esprit qu’est examinée la situation du flamand occidental, qui ne fait pas l’objet d’un enseignement de langue et culture régionales tel que décrit dans la circulaire du 12 avril 2017.
Rappelons d’abord que l’introduction d’un nouvel enseignement de langue vivante dans notre système scolaire, de l’école primaire au baccalauréat, doit être étudiée au regard de nombreux critères, tels que sa zone d’implantation et de diffusion, le nombre de locuteurs potentiels et le degré d’imprégnation et d’utilisation de la langue par la population, le corpus disponible dans les différents registres littéraires ou encore la demande des familles. Ainsi, la situation du flamand occidental doit être appréciée avec finesse et discernement au regard de l’ensemble de ces éléments.
En outre, vous le savez bien, monsieur le sénateur, l’enseignement du néerlandais, langue de communication avec la Région flamande de Belgique et les Pays-Bas, est une priorité de l’académie de Lille, notamment pour le département du Nord, aussi bien pour l’enseignement primaire que pour le collège et le lycée. L’apprentissage de cette langue répond notamment à de forts enjeux économiques et d’employabilité. De fait, c’est la connaissance de la langue néerlandaise qui permet aux élèves de la zone frontalière de trouver des débouchés professionnels, ce qui n’exclut pas, bien sûr, une connaissance de ses variations dialectales.
La sensibilisation à la langue et à la culture du flamand occidental peut trouver une place à l’école. Le code de l’éducation dispose que les enseignants des premier et second degrés « sont autorisés à recourir aux langues régionales, dès lors qu’ils en tirent profit pour leur enseignement. Ils peuvent également s’appuyer sur des éléments de la culture régionale pour favoriser l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes scolaires. »
Cette sensibilisation peut intervenir en classe, durant le temps scolaire, dans le cadre de plusieurs enseignements, notamment de langues vivantes, par exemple en cours de néerlandais, d’histoire, d’enseignement artistique ou d’histoire de l’art.
Ainsi, la proximité linguistique de la langue régionale flamande avec la langue néerlandaise peut être avantageusement mise à profit lors des séances consacrées à l’apprentissage de cette dernière, avec un travail sur les nuances dialectales et sur les réalités culturelles de l’espace linguistique du franco-flamand. Les enseignements pratiques interdisciplinaires du collège, qui réunissent plusieurs disciplines autour de projets communs, souvent ancrés dans les réalités locales, offrent un cadre propice à une telle sensibilisation.
Signalons aussi qu’un enseignement de la variante française du flamand occidental est dispensé dans trois écoles primaires publiques dans le cadre d’une expérimentation. La poursuite de cette expérience sera fonction des conclusions de l’évaluation qui sera conduite par les services de l’académie de Lille.
Enfin, à l’école primaire, la sensibilisation au flamand occidental et à la culture qu’il porte peut aussi faire l’objet d’activités éducatives et culturelles complémentaires, conduites dans les temps périscolaires, en lien, par exemple, avec des associations locales bénéficiant d’un agrément pour intervenir en milieu scolaire.

Monsieur le secrétaire d’État, votre réponse ne peut me satisfaire. Je vous interroge tout simplement sur le devenir du poste de l’enseignant qui est parti à la retraite.
Il n’y a pas d’antagonisme entre le néerlandais et le flamand. Le flamand est d’ailleurs antérieur au néerlandais. Pourquoi réserverait-on un traitement particulier à cette langue régionale qu’est le flamand occidental ?

La parole est à M. Dominique Théophile, auteur de la question n° 1019, adressée à M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

Ma question porte sur le développement de l’agroforesterie.
En Guadeloupe, la culture de la banane et celle de la canne à sucre sont fragilisées, depuis plusieurs années, par un contexte économique et social difficile, ainsi que par l’âpre concurrence des pays d’Afrique, de la Caraïbe et du Pacifique.
Il convient, dans ce contexte, de repenser en partie le développement de notre filière agricole. Certaines cultures traditionnelles de niche – je pense notamment au café, au cacao et à la vanille – offrent, par exemple, des perspectives intéressantes. Principalement destinées à l’exportation, ces cultures de sous-bois, en nombre limité aujourd’hui, pourraient permettre à la Guadeloupe de diversifier sa production agricole sans rogner sur les cultures déjà existantes, et ce malgré la réduction du foncier disponible.
L’agroforesterie est également pourvoyeuse d’emplois, puisque les exploitations, non mécanisées, doivent recourir à de nombreux salariés agricoles. Son développement permet, en outre, de répondre à certaines considérations environnementales.
Un projet d’implantation d’un parc agroforestier et agrotouristique a ainsi vu le jour sur le territoire de Bouillante, en Guadeloupe. D’autres ne demandent qu’à émerger. Cependant, le fait que l’agroforesterie relève de la foresterie, et non pas de l’agriculture, freine son développement, en Guadeloupe comme ailleurs. Il en résulte une baisse importante des financements alloués à ces projets. Envisagez-vous, monsieur le ministre, de faire évoluer cette classification, afin de favoriser le développement de cette activité ?

Monsieur le sénateur Dominique Théophile, je souhaite vraiment que nous parvenions à faire évoluer les dispositifs existants afin de permettre une meilleure prise en compte de l’agroforesterie, notamment dans les territoires ultramarins. Comme vous l’avez dit, la filière agroforestière revêt une importance particulière.
Nous devons effectivement travailler sur les cultures de niche. Les territoires d’outre-mer en général, et la Guadeloupe en particulier, doivent absolument diversifier leur agriculture et préparer la transition agroécologique. Il importe de mettre en place de nouvelles filières résilientes, qui apporteront de la valeur ajoutée et permettront aux habitants de trouver des emplois durables. Les territoires ultramarins ont besoin de tendre vers l’autonomie alimentaire.
Les filières agricoles et agroforestières représentent une opportunité de développement très importante en outre-mer. Nous devons progresser vers des pratiques vertueuses, qui permettent de lutter contre le réchauffement et le dérèglement climatiques. Elles peuvent prendre des formes variées : bocages, alignements interparcellaires, prés-vergers ou, plus spécifiquement, jardins créoles, cultures sous forêt…
Vous évoquez particulièrement l’agroforesterie, qui est très importante pour la Guadeloupe. Dans le cadre de la politique agricole commune, deux types d’aides permettent de financer l’agroforesterie : les aides à l’entretien des infrastructures agroécologiques, via les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC), et surtout les aides à l’investissement. Parmi celles-ci, outre les dispositifs visant les investissements dits « non productifs », l’agroforesterie bénéficie d’un régime spécifique : l’aide à la mise en place et à l’entretien des systèmes agroforestiers.
Nous travaillons dans cette direction dans le cadre du plan stratégique national. Je souhaite, au titre de la transition agroécologique, promouvoir l’agroforesterie, qui doit avoir toute sa place sur le territoire national, notamment en outre-mer. J’espère que nous parviendrons à trouver des financements adéquats dans le cadre de la future politique agricole commune.

Je vous remercie de ces indications, monsieur le ministre.
Le développement des cultures historiques de la canne à sucre et de la banane est désormais limité sur notre territoire. Il nous faut donc imaginer une diversification pour maintenir les emplois du secteur agricole. Sur le terrain, le travail réalisé par la chambre d’agriculture et d’autres acteurs permet à des jeunes d’intégrer ce secteur d’activité, qui reste pourvoyeur d’emplois.
Le financement est au cœur des préoccupations des porteurs de projets. Un soutien des pouvoirs publics et de la PAC est souhaitable.

La parole est à M. Max Brisson, auteur de la question n° 881, adressée à M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

Camembert, reblochon, roquefort, picodon, banon, et bien d’autres encore… Ces fromages au lait cru sont-ils définitivement bannis de nos cantines scolaires ?
En effet, en mai 2019, le ministère de l’agriculture et de l’alimentation a diffusé une instruction rappelant notamment « la nécessité d’éviter la consommation de ces denrées par les jeunes enfants, particulièrement en restauration collective », « que les enfants de moins de 5 ans ne doivent en aucun cas consommer ces produits » et que « les qualités nutritionnelles de ce type de produits » ne peuvent « occulter le risque sanitaire ».
Bien entendu, je ne remets pas en cause le bien-fondé de ces recommandations. Il est vrai qu’une trentaine de cas d’infections et un dramatique décès ont été portés à la connaissance des pouvoirs publics en mai 2018 et en avril 2019. Il est évidemment responsable et attendu que le ministère de l’agriculture et de l’alimentation prévienne ces risques et alerte à leur sujet.
Néanmoins, vous devinez, monsieur le ministre, que cette application stricte du principe de précaution conduit une grande partie des responsables de restauration collective à ne prendre aucun risque et donc à ne plus offrir ces produits.
Dans un contexte où la défiance envers les agriculteurs et les éleveurs est telle qu’ils dénoncent l’agri-bashing dont ils sont victimes, cette mesure distend un peu plus le lien entre société et agriculteurs.
Pourtant, de nombreuses collectivités locales sont engagées avec les producteurs locaux dans une démarche de circuits courts et d’intégration de leurs produits dans la restauration collective.
Ainsi, le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, comme beaucoup d’autres, est le promoteur, auprès des communes et des intercommunalités, de la belle démarche « Manger bio & local, labels et terroirs ».
L’éducation nationale, quant à elle, favorise l’éducation au goût. Les semaines du goût dans les établissements scolaires connaissent un grand succès.
Il serait donc paradoxal que l’instruction de votre ministère freine le recours à la production locale et conforte la prééminence de la nourriture industrielle dans la restauration collective, laquelle n’est pas non plus imperméable aux difficultés sanitaires.
Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer si l’impact économique de cette instruction a été appréhendé ou sera étudié prochainement par les services de votre ministère ? Combien de temps durera l’interdiction de la consommation de fromages au lait cru en restauration collective ? Envisagez-vous de la lever afin que ces produits, auxquels les Français sont attachés, puissent être exempts de soupçons ?

Monsieur le sénateur Max Brisson, vous êtes vraisemblablement, comme moi, un amateur de bonne chère. Nous avons la chance d’avoir, dans ce pays, une bonne agriculture, qui fournit une alimentation saine, sûre, tracée et durable. Ses produits sous signes de qualité sont absolument remarquables.
Je suis comme vous favorable à la consommation de bons fromages au lait cru, le plus emblématique étant sans doute le camembert ! Cela étant, il convient de ne pas opposer les uns aux autres. Vous avez évoqué la démarche du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, qui promeut le manger bio et local. Cette initiative est absolument remarquable : il faut aller dans ce sens. C’est l’avenir de l’agriculture et de l’alimentation collective, notamment de la restauration scolaire.
Plus spécifiquement, je soutiens de toutes mes forces les producteurs de fromages au lait cru. Les aliments de qualité typiques ou élaborés dans le respect de l’environnement et du bien-être animal font partie du patrimoine alimentaire français. En outre, les fromages au lait cru renferment une flore bactérienne vivante et variée qui peut être favorable à la santé, comme l’a récemment déclaré l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.
En revanche, ils peuvent aussi contenir des agents pathogènes – salmonelles, Escherichia coli… –, qui ont provoqué dans le passé un certain nombre de maladies et, malheureusement, de décès.
Les spécialistes de la santé, saisis par le ministère de l’agriculture, nous ont recommandé, en application du principe de précaution, d’éviter de faire manger aux enfants de moins de cinq ans du fromage au lait cru. En effet, le risque est assez faible pour les adultes, mais, pour les enfants de zéro à cinq ans, il existe un sur-risque significatif : la probabilité que survienne un syndrome hémolytique et urémique est 110 fois plus élevée.
C’est la raison pour laquelle cette instruction a été donnée. Nous n’avons pas encore de retour d’expérience ; il y a de toute façon assez peu de fromages au lait cru, me semble-t-il, dans les cantines d’écoles maternelles ou primaires, mais le principe de précaution nous oblige à être vigilants.
Néanmoins, je tiens à réaffirmer que le ministère de l’agriculture et de l’alimentation veut promouvoir l’ensemble des fromages, en particulier ceux qui sont au lait cru.

M. Max Brisson. J’apprécie la manière dont M. le ministre parle des bons produits. J’espère que ce n’est pas mon embonpoint qui l’inspire…
Sourires.

Néanmoins, il faut conserver un équilibre, me semble-t-il. Les responsables de la restauration collective, y compris quand celle-ci est destinée aux adultes, ne doivent pas aller trop loin par rapport aux souhaits exprimés dans cette instruction, dont je ne remets pas en cause la nécessité.

La parole est à M. Jean-Marie Mizzon, auteur de la question n° 821, transmise à M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

Monsieur le ministre, en janvier dernier, vous déclariez que l’enseignement agricole était au cœur de vos priorités. C’est une ambition que nous ne pouvons que partager.
Or, force est de constater que cette filière de formation, qui prépare à plus de deux cents métiers dans de nombreux domaines, demeure, hélas, peu attractive.
À l’heure actuelle, l’enseignement agricole, qui est piloté par votre ministère, mais qui fait partie du service public de l’éducation, est bien le deuxième réseau éducatif français. À ce jour, ce sont 806 établissements répartis sur l’ensemble du territoire qui accueillent 160 000 élèves de la classe de quatrième au brevet de technicien supérieur, chiffre auquel s’ajoutent quelque 35 000 apprentis.
Quelque 40 % des formations proposées sont en lien avec la nature – agriculture, forêt, environnement, agroalimentaire, paysage, horticulture, viticulture – et ouvrent sur une très large gamme de métiers ou permettent d’intégrer l’enseignement supérieur agricole, qui, avec douze écoles publiques, délivre des diplômes de vétérinaire, d’ingénieur agronome, de paysagiste ou encore de professeur de l’enseignement agricole.
Dernière précision, et non des moindres, l’enseignement agricole, très largement ouvert sur le monde, avec des échanges européens et internationaux via Erasmus et la coopération, permet aux jeunes de trouver facilement un emploi au terme de leur scolarité. Aussi la confidentialité entourant cette filière est-elle d’autant plus incompréhensible.
Ma question est donc simple : pourquoi, avec votre collègue de l’éducation nationale, ne communiquez-vous pas davantage et plus efficacement sur l’enseignement agricole et ne valorisez-vous pas plus cette filière auprès des jeunes ?

Monsieur Mizzon, vous parlez d’or : l’enseignement agricole est un joyau, une pépite.
Laissez-moi vous expliquer comment nous communiquons. Lorsque j’ai été nommé à mon poste, j’ai immédiatement déclaré que la réussite de la transition agroécologique et l’avènement de nouvelles pratiques agraires passeraient par la formation.
Vous l’avez dit, nous avons plus de 800 lycées techniques agricoles, mais, depuis dix ans, le nombre d’élèves dans ces établissements diminuait sans cesse. J’ai voulu mettre fin à cette hémorragie.
C’est pourquoi, avec Jean-Michel Blanquer, l’année dernière, lors du Salon de l’agriculture, nous avons lancé une immense campagne, que nous avons baptisée « L’aventure du vivant », pour intéresser les jeunes. En effet, au lieu d’être un second choix, l’enseignement agricole doit devenir un primo-choix, que ce soit dans un lycée public, dans un lycée privé ou dans une maison familiale rurale – je ne fais pas de différence entre les trois familles d’établissements.
Cela a fonctionné. Alors que nous perdions environ 4 000 élèves par an, pour la première fois, cette année, nous avons enregistré 750 élèves en plus ; le delta est là.
L’enseignement agricole est devenu une force, parce que nous avons lancé une communication sur internet qui a été vue par 12 millions de personnes et parce que nous avons créé le site « L’aventure du vivant », que je vous invite à consulter. Vous avez raison, monsieur le sénateur, il y a plus de 200 métiers possibles à la clé. Vous l’avez compris, je suis un ardent défenseur de l’enseignement agricole et je suis fier d’avoir inversé la tendance.
Cette année, nous allons lancer au Salon de l’agriculture un tour de France des bus de « L’aventure du vivant ». Ces véhicules vont sillonner la France pour faire la promotion de l’enseignement agricole, en zone rurale comme dans les quartiers urbains.
Cet enseignement est une solution, car ses résultats aux examens et au baccalauréat sont très bons. Lorsque l’on entre dans un établissement de la filière enseignement agricole, on en sort avec une formation et un emploi. Que l’on soit fort ou moins fort à l’école, on peut être accueilli dans cet enseignement, la palette de nos formations permettant d’intégrer tout le monde, les élèves de la ruralité comme ceux des villes.
Monsieur le sénateur, je partage totalement votre enthousiasme. L’enseignement agricole – public, privé ou assuré par les maisons familiales rurales –, tous ses lycées, toutes ses formations constituent un vivier, pour que, demain, l’agriculture française soit résiliente, des jeunes venant s’installer pour travailler selon les principes de l’agroécologie.

Monsieur le ministre, je ne vous surprendrai pas en disant que l’agriculture doit être accompagnée à tous les échelons, et singulièrement à celui de l’éducation et de la formation.
J’entends votre réponse. Vous me dites que la courbe est inversée et que les effectifs sont désormais en hausse. Je n’ai pas de raison d’en douter et je ne puis que vous encourager à poursuivre sur cette voie. Un premier pas a été accompli, et il faut maintenir l’effort, voire l’amplifier, pour que cette filière, qui débouche sur des emplois, soit traitée de la meilleure manière possible.

La parole est à M. Gilbert Roger, auteur de la question n° 1058, adressée à Mme la ministre des sports.

Madame la ministre, j’attire votre attention sur les risques de réalisation hors délais de certains équipements des jeux Olympiques de 2024, mais aussi sur les surcoûts, relevés en mars 2018 dans un rapport de l’inspection générale des finances remis au Gouvernement et conforté par un récent article de presse très documenté.
La métropole du Grand Paris a voté, le 4 décembre dernier, la prolongation des négociations en vue de l’attribution du chantier du centre aquatique et d’une passerelle piétonne enjambant l’autoroute A1 pour le relier au Stade-de-France, les projets des entreprises candidates étant jugés trop coûteux. On évoque des offres qui se situeraient au moins entre 25 % et 30 % au-dessus du budget prévisionnel de 113 millions d’euros…
Le calendrier prévoyait initialement que le chantier soit attribué à la mi-novembre 2019, la construction du centre aquatique devant commencer au début de 2021, pour une livraison dans les temps pour les JO.
Madame la ministre, je souhaiterais que vous puissiez renouveler l’engagement du Gouvernement à tenir les délais et le budget du projet olympique, tout en en maintenant l’ambition et l’utilité de ces équipements pour les habitants du territoire.
Monsieur le sénateur, vous évoquez la question du centre aquatique et de la passerelle de Saint-Denis. Effectivement, nous devons veiller en permanence à ce que la construction des équipements entre dans les délais prévus pour une livraison dans les temps, mais également à ce que les coûts restent dans l’enveloppe prévue.
Permettez-moi de vous rassurer : tout est aujourd’hui maîtrisé ! La Société de livraison des ouvrages olympiques, la Solideo, est totalement en phase avec le calendrier des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Aujourd’hui, les travaux se déroulent normalement, la Solideo collaborant très bien avec les collectivités locales et avec l’ensemble des parties prenantes, comme le comité d’organisation. J’ai pu rencontrer quasiment toutes les collectivités à la préfecture de Saint-Saint-Denis pour m’en assurer personnellement.
L’État, premier financeur de la Solideo, va évidemment assurer un suivi et un accompagnement permanents pour que l’on arrive à tenir non seulement les délais, mais aussi les enveloppes.
Pour vous donner plus de détails, sachez que l’année 2019 a été marquée par une forte activité juridique liée aux procédures d’urbanisme et foncières.
Aujourd’hui, la quasi-totalité du foncier nécessaire à l’accueil des sites olympiques a pu être sécurisée. La Solideo a avancé sur la sélection des prestataires devant intervenir sur les différents sites, et nous avons pu, le Premier ministre et moi-même, lancer les travaux du village olympique le 4 novembre dernier, à l’occasion du comité interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques.
Un grand nombre de permis de construire seront déposés au cours du premier semestre 2020, et les opérations d’aménagement seront engagées durant l’année, pour que l’on puisse avancer par rapport au calendrier prévisionnel.
Sur le plan budgétaire, plus précisément, les engagements financiers sont aujourd’hui maîtrisés. Pourtant, comme le signalent tous les acteurs du secteur, le contexte est marqué par une forte tension sur les prix du BTP en Île-de-France ; il faut donc rester vigilant à cet égard.
C’est pourquoi le Premier ministre et l’ensemble des parties prenantes ont validé, le 14 juin 2018, un nouveau protocole financier, qui prévoit un programme optimisé d’ouvrages à construire et qui reste, je puis vous l’assurer aujourd’hui, dans l’enveloppe budgétaire initialement prévue. Vous le voyez, nous restons attentifs à ces questions, notamment à l’évolution du budget du centre aquatique que vous avez évoqué.
Nous sommes trois ministères clairement engagés sur le sujet – le ministère de l’action et des comptes publics, le ministère de la ville et le ministère des sports –, au travers de la Dijop, la délégation interministérielle aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

La parole est à M. Bernard Fournier, auteur de la question n° 1035, transmise à M. le ministre de la culture.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaite attirer l’attention du Gouvernement sur les règles applicables en matière architecturale, notamment dans le périmètre de protection d’un bâtiment classé.
La loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine avait pour objectif de conforter et de moderniser la protection des patrimoines en simplifiant le droit des espaces protégés, tout en rendant ce dernier plus intelligible pour les citoyens.
Dans le cadre des débats organisés lors de l’élaboration de ce texte par la commission de la culture du Sénat, la présidente du Conseil national de l’ordre des architectes convenait que « la loi, intelligemment, prévo[yait] désormais un périmètre réfléchi selon les perspectives et les abords d’un monument classé, au lieu des systématiques 500 mètres » et que « la loi port[ait] une ambition nouvelle pour la qualité architecturale. » Elle reconnaissait qu’il était « nécessaire de marier l’architecture contemporaine et les sites classés ».
Dans les faits, malheureusement, le traitement réalisé par les services des directions régionales des affaires culturelles et des unités départementales de l’architecture et du patrimoine ne va absolument pas dans ce sens.
Sur le terrain, dans nos départements respectifs, le développement des communes, notamment rurales, est très largement contraint aujourd’hui en matière de consommation des espaces agricoles, avec un empilement de réglementations : PLU, SCOT, PLH, etc.
Que nous réserve l’avenir ? Nous n’avons qu’une seule certitude : les restrictions seront de plus en plus fortes et les contraintes encore plus grandes.
Le Premier ministre a d’ailleurs déclaré au congrès de l’Association des maires ruraux de France, en 2019, que le Gouvernement souhaitait « lutter contre l’artificialisation des sols, ce qui impliqu[ait] de renforcer les outils disponibles pour réhabiliter le bâti ancien ou pour mieux réguler les activités commerciales. » Il a ajouté : « Il faut faire attention au développement des espaces urbains ou périurbains ».
Si les communes rurales et périurbaines veulent continuer d’être dynamiques, il faut permettre une réhabilitation du bâti existant, même dans les périmètres de protection d’un bâtiment classé. Sinon, des communes seront totalement privées de toute perspective d’évolution en matière architecturale.
Aujourd’hui, les rejets des demandes de permis semblent beaucoup trop systématiques et bien souvent déconnectés des réalités locales. Il est indispensable de se donner les moyens de rénover et de moderniser de nombreuses habitations. On ne peut pas mettre des secteurs entiers de nos communes « sous cloche ». Les élus attendent une réponse adaptée à cette situation.
En conséquence, madame la ministre, je souhaiterais connaître l’analyse et les intentions du Gouvernement en la matière.
Monsieur le sénateur Bernard Fournier, la loi relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine, voulue par le Gouvernement, a introduit un nouveau dispositif de protection des abords de monuments historiques, que vous avez détaillé.
L’objectif était de remplacer progressivement, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France, les périmètres automatiques de 500 mètres autour des monuments historiques par des périmètres délimités des abords (PDA), définis dans le code du patrimoine et plus adaptés à la réalité et aux enjeux locaux.
Depuis l’adoption de la loi, plus de 300 PDA de monuments historiques ont été institués. Les collectivités territoriales se sont bien approprié ce dispositif, qui tend à préserver un espace cohérent avec les monuments historiques qu’ils englobent. Notons que ces périmètres sont aussi validés après concertation avec la population, via l’enquête publique.
En leur sein, tous les travaux sont soumis à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. Les projets doivent concilier la préservation du patrimoine et la qualité architecturale du bâti, en tenant compte des enjeux d’habitabilité et de développement durable.
L’un des objectifs est d’éviter l’étalement urbain et les évasions commerciales, dans le cadre du plan national « Action cœur de ville ».
Nous pensons que le projet architectural contemporain de qualité participe de la démarche patrimoniale, de son dynamisme et de sa pérennité. Le patrimoine peut ainsi évoluer grâce à la création architecturale : il s’agit de réhabiliter des bâtiments en leur donnant une nouvelle fonction, en agrandissant des architectures existantes ou en s’y insérant. C’est l’un des enjeux de la lutte contre l’étalement urbain.
Ainsi, l’architecture contemporaine a pu être introduite au sein de nombreux sites protégés au titre de code du patrimoine. Nous pouvons, notamment, citer les exemples du Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de Sedan, du musée des Beaux-arts de Dijon ou encore de l’école de musique de Louviers.
Enfin, comme a pu le dire le ministre de la culture à l’occasion des dernières Journées nationales de l’architecture : « Penser transformation et adaptation, […] c’est sortir peu à peu de la logique du jetable au profit du recyclable et du réparable, sur le plan culturel comme sur le plan environnemental. »

Nous en avons terminé avec les réponses à des questions orales.
Mes chers collègues, l’ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures quarante-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.