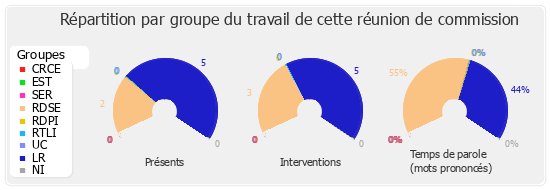Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
Réunion du 6 mai 2009 : 1ère réunion
Sommaire
- Conséquences de la crise économique et financière en matière de sécurité et de défense
- Audition de m. pierre lévy directeur de la prospective au ministère des affaires étrangères et européennes (voir le dossier)
- Accord entre la france et le saint-siège sur la reconnaissance des diplômes
- Accord entre la france et la croatie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure
- Siège en france du bureau international des expositions
- Accord relatif à la garantie des investisseurs entre la france et monaco
- Nomination d'un rapporteur (voir le dossier)
- Audition de m. pierre lellouche représentant spécial de la france pour l'afghanistan et le pakistan (voir le dossier)
La réunion
Lors d'une première séance tenue dans la matinée, la commission a procédé à l'audition de M. Pierre Lévy, directeur de la prospective au ministère des affaires étrangères et européennes, sur les conséquences de la crise économique et financière en matière de sécurité et de défense.
a tout d'abord souligné que, de même que l'ancien centre d'analyse et de prévision (CAP) était inséré au sein du ministère des affaires étrangères et européennes mais développait une analyse autonome, il s'exprimerait sans engager les autorités françaises.
Il a indiqué que la direction de la prospective était très mobilisée par la crise en raison, d'une part, de l'inquiétude suscitée par le souvenir de la terrible séquence de 1929 à 1939, mais aussi, d'autre part, de l'espoir que la mémoire de ces événements et la volonté d'éviter des situations de conflit puissent renforcer des mécanismes de coopération. Les leçons du passé doivent se traduire par un surcroît d'action coopérative à l'exemple de la réunion du G20 de Londres.
Il a estimé que la question centrale posée par la crise était celle des menaces qu'elle fait peser sur la stabilité et la sécurité.
A court terme, la principale menace est celle de l'augmentation de l'instabilité des Etats fragiles sous l'effet d'une montée générale du mécontentement et des frustrations. Devant cette situation, l'élément crucial est la qualité du leadership politique et la capacité des dirigeants à inspirer confiance. De ce point de vue, les pays démocratiques ont un avantage déterminant. Dans les Etats autoritaires, on observe des tensions croissantes, au sein des élites dirigeantes, pour l'accès à des ressources raréfiées, et la montée des violences politiques lorsque le contrat qui lie la paix sociale à l'accès aux ressources et à l'enrichissement général se trouve rompu.
Ces difficultés peuvent conduire les gouvernements à rechercher des dérivatifs sous la forme d'ennemis intérieurs ou extérieurs, avec un nationalisme exacerbé. Le fait que la crise financière ait pris naissance aux Etats-Unis nourrit un discours anti-occidental.
La très forte réduction des flux commerciaux conduit à la dégradation des conditions d'existence des populations. Les risques d'instabilité sont particulièrement importants dans les Etats producteurs et exportateurs de matières premières. La zone « Afrique du Nord et Moyen-Orient » pourrait ainsi se trouver fragilisée, même si elle dispose d'importantes réserves de change. On a ainsi constaté un éclatement de la bulle immobilière à Dubaï. Un Etat comme l'Egypte souffre également de la baisse des recettes du canal de Suez. D'une manière générale, on observe aussi une importante baisse des transferts de migrants. Les pays les plus vulnérables sont les Etats autoritaires qui souffrent d'une raréfaction de la rente. Certains peuvent également être tentés par l'appropriation des ressources de leurs voisins.
a souligné que la contraction de la rente avait néanmoins certains effets positifs. Si la politique agressive de certains Etats (Venezuela, Iran, Russie) a été encouragée par « l'hubris » liée à la rente énergétique, on observe une évolution de leur rhétorique depuis quelques mois.
Il a estimé que la sécurité globale et celle des pays-membres de l'UE pouvaient être affectées de manière directe par la crise, car celle-ci accentuait les tendances existantes. C'est en particulier le cas pour les activités criminelles ou terroristes qui affectent la bande sahélienne et la Corne de l'Afrique. Pour ce qui concerne l'impact sur les flux migratoires, peu d'éléments précis sont disponibles, mais l'on sait que l'une des principales motivations au départ est d'ordre économique.
a indiqué que la crise suscitait également un débat sur les valeurs et affectait l'image de l'Occident en nourrissant parfois des discours radicaux.
A plus long terme, ses effets se feront sentir en termes de redistribution de l'influence sur la scène mondiale. Là encore, a considéré M. Pierre Lévy, il s'agit davantage d'une accentuation des tendances existantes que d'une véritable rupture.
Le rattrapage économique des pays émergents devrait se poursuivre mais dans le cadre d'un jeu à somme potentiellement négative.
On devrait observer un recul de la puissance économique des pays du G7 et un déplacement du centre de gravité vers l'Asie. Dans les pays du G7, le poids des contraintes budgétaires peut avoir un impact négatif sur le développement des capacités de défense, alors que certains régimes autoritaires pourraient être tentés de renforcer leur outil militaire.
On observe également le repli des Etats sur leur sphère régionale et la création de zones d'influence et de coprospérité.
La question de la puissance américaine est à nouveau posée, mais le différentiel de puissance en sa faveur demeurera considérable à l'horizon de 2020, voire 2025.
L'intégration européenne, qui connaît une période de transition, pourrait connaître un sursaut ou s'installer dans le statu quo.
La crise affecte la qualité des relations internationales et la capacité d'action collective. Les Etats ont tendance à privilégier des solutions nationales qui pourraient avoir un effet délétère sur la relation entre l'Asie et l'Europe. Le G2, qui comprendrait la Chine et les Etats-Unis, est fréquemment évoqué, mais on peut le considérer plus comme un effet de mode que comme un axe déterminant. Il a une signification économique mais ne repose pas sur une vision politique commune du monde.
Enfin, les institutions de gouvernance de la mondialisation sont mises en question. L'Organisation mondiale du commerce (OMC) est affectée par le blocage du cycle de Doha et l'on assiste au développement d'un protectionnisme de basse intensité.
a estimé que l'intérêt commun des pays industriels et des pays émergents à réformer le système en faveur d'une plus grande ouverture et d'une meilleure régulation pouvait susciter un certain espoir. Dans un marché global, les pays industrialisés pourraient faire une plus grande place aux pays émergents dans les institutions internationales en contrepartie de leur entrée dans une logique de responsabilité. Cette évolution ne s'inscrit pas dans un horizon de court terme, mais elle ouvre une perspective politique.
Il a considéré, en conclusion, que ces évolutions validaient les grands choix de politique étrangère de la France en faveur du renforcement de la gouvernance mondiale et de la promotion de la sécurité dans toutes ses dimensions.
Un débat a suivi l'exposé de M. Pierre Lévy.

évoquant les problèmes monétaires et l'avenir du dollar, a souhaité savoir si l'accroissement des écarts de taux serait supportable pour la zone euro. Il a souligné que le protectionnisme pouvait prendre diverses formes, comme la dévaluation de près de 40 % de la livre britannique, ou encore une dimension environnementale, avec l'exemple de la taxe carbone. Il s'est interrogé sur la signification du libre-échange dans un monde où les écarts de salaire vont de 1 à 20, appelant à une réflexion plus ouverte alors que le protectionnisme est tout à la fois vilipendé et toléré. Il a observé que, en dépit du renforcement de la coopération, des stratégies non coopératives persistaient, y compris au sein de l'Union européenne, comme en Allemagne par sa politique de pression sur les salaires.

soulignant que l'Organisation des Nations unies ne semblait plus être en mesure de faire face à la multiplication des conflits, a souhaité savoir quelles solutions alternatives pourraient être développées, notamment pour les besoins de la lutte contre la piraterie. Prenant l'exemple de l'Afrique du Sud, il a souligné le haut degré d'acceptation de personnalités pourtant très discutables dans certains pays en développement.
a apporté les éléments de réponse suivants :
- la crise a fait resurgir de grandes questions comme celle du rôle du dollar. Dans le cadre des réflexions d'ensemble sur l'architecture du système international, la question du rôle du dollar comme monnaie de réserve est de nouveau examinée. Pour les Etats concernés, c'est une question politique, mais elle témoigne aussi du souci de protéger leurs actifs. Il faut rappeler que, dans l'histoire, les Etats-Unis n'ont jamais connu de défaut sur leur dette publique. Le recours à des solutions alternatives, comme les droits de tirage spéciaux, suppose que les pays participants se soumettent à certaines contraintes ;
- la Chine cherche avant tout à préserver la valeur de ses avoirs. Sa relation avec les Etats-Unis est la relation structurante mondiale, mais elle n'est pas adossée à une vision politique commune à la différence de la relation transatlantique ;
- la lutte contre la piraterie doit avant tout être menée à terre. C'est en très large partie une question de développement ;
- l'atonie du débat politique dans certains pays et l'absence totale d'alternative peuvent expliquer la popularité des dirigeants concernés.

a souligné que les organismes internationaux aujourd'hui mis en avant portaient une part de responsabilité dans la crise. On observe un attachement intellectuel au multilatéralisme qui ne doit pas faire l'économie de l'efficacité. La participation accrue des pays émergents dans ces enceintes peut ainsi conduire à une certaine dilution.

s'est interrogée sur la place du continent africain dans les réflexions actuelles. Ce continent, qui a été un lieu d'expansion privilégié, suscite aujourd'hui un total désintérêt, comme s'il s'agissait de liquider un héritage. Elle a souhaité savoir quelle réflexion nouvelle pourrait s'appliquer à ce continent.
a apporté les précisions suivantes :
- le système multilatéral peine effectivement à combiner légitimité et efficacité, comme le montre l'exemple de l'élargissement du Conseil de sécurité des Nations unies auquel la France est favorable. Le paysage multilatéral ne sera plus « un jardin à la française ». Francis Fukuyama parle ainsi de « multi-multilatéralisme », ce qui pose, avec une acuité renforcée, la question de la coordination des différentes instances. Le G20 a été choisi en quelque sorte par défaut pour agir vite, dans la mesure où cette structure existait déjà dans le domaine financier. Il faudrait une instance plus légitime et plus efficace, qui puisse donner les impulsions nécessaires au travail des différentes institutions compétentes et se réunisse dans des formats différents en fonction des sujets traités ; ce pourrait être un G13, 14 ou 15 ;
- l'Afrique est effectivement un grand sujet d'inquiétude. Elle a, dans un premier temps, été protégée par sa faible intégration dans les échanges internationaux, moins globalisée et moins financiarisée, mais, dans un second temps, elle risque d'être abandonnée. Les transferts de migrants, de l'ordre de 20 milliards de dollars par an, devraient enregistrer une croissance nulle, voire négative. L'aide publique au développement devrait se réduire en même temps que les flux d'investissements. Le Fonds monétaire international (FMI) a révisé ses prévisions de croissance à 3,3 %. Il faut rappeler que la perte d'un point de croissance se traduit par 20 millions de pauvres supplémentaires, ce qui pourrait affecter une génération entière.

a souligné que, en l'absence d'une masse monétaire suffisante pour les échanges internationaux, il n'existait pas d'alternative au dollar comme monnaie de réserve.
a indiqué que l'on constatait néanmoins une croissance très forte de la part de l'euro dans les réserves, qui atteignait aujourd'hui 1/3 des réserves déclarées au Fonds monétaire international.

a noté que l'euro ne cherchait pas à devenir une monnaie de réserve et qu'il était dépourvu de la capacité politique nécessaire.
a souligné les contraintes posées pour une monnaie de réserve, en particulier que la demande externe de devises ne peut être contrôlée.

s'est interrogé sur le devenir de l'Union européenne comme ensemble politique, alors qu'elle est confrontée à des forces centrifuges et qu'elle ne dispose pas d'un gouvernement économique.
a considéré que la construction européenne se trouvait depuis très longtemps dans une période de transition. L'examen des questions essentielles a été différé. Paradoxalement, l'incertitude sur le traité de Lisbonne gèle le débat. De nombreuses difficultés dans la crise économique actuelle relèvent cependant de la responsabilité des Etats nationaux. Les grandes questions devront être examinées lorsque les conditions politiques seront plus favorables.

Puis la commission a entendu une communication de M. Josselin de Rohan, président, sur l'accord entre la France et le Saint-Siège portant sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l'enseignement supérieur, signé le 18 décembre 2008.
a souhaité apporter des précisions au sujet de l'accord entre la France et le Saint-Siège portant sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l'enseignement supérieur, signé le 18 décembre 2008 et publié au Journal officiel le 19 avril 2009, cet accord ayant fait l'objet d'une polémique dont la presse s'est fait l'écho et ayant soulevé des interrogations de la part de certains membres de la commission.
a d'abord indiqué que l'accord entre la France et le Saint-Siège, signé le 18 décembre 2008, portait sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l'enseignement supérieur et qu'il s'inscrivait dans le cadre de la construction d'un « espace européen de l'enseignement supérieur », engagée par les ministres européens de l'enseignement supérieur à Bologne en 1999, qui se traduit notamment par l'harmonisation des cursus universitaires autour du modèle LMD (Licence-Master-Doctorat) et qui vise à favoriser la reconnaissance des diplômes dans l'espace européen et la mobilité des étudiants et des professeurs.
Il a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une initiative de l'Union européenne mais d'une coopération intergouvernementale, qui regroupe aujourd'hui 46 Etats européens, dont la France et le Vatican.
a indiqué que l'accord signé entre la France et le Saint-Siège, qui fait suite à plusieurs accords bilatéraux conclus par la France notamment avec l'Espagne ou l'Italie, a pour objet de reconnaître les périodes d'études, les grades et les diplômes de l'enseignement supérieur délivrés par l'une des deux parties et de permettre ainsi la poursuite d'études dans l'autre partie.
Il a précisé que cet accord s'applique, pour la France, aux grades et aux diplômes délivrés sous l'autorité de l'Etat par les établissements d'enseignement supérieur, et concernant le Vatican, aux grades et diplômes délivrés par les universités catholiques, les facultés ecclésiastiques et les établissements d'enseignement supérieur habilités par le Saint-Siège. La liste précise des institutions et des disciplines concernées devrait être transmise prochainement par le Vatican aux autorités françaises.
Soulignant que cet accord avait soulevé des interrogations, tant sur la procédure, que sur le fond, M. Josselin de Rohan, président, a ensuite voulu apporter des précisions sur ces deux points.
Tout d'abord, en ce qui concerne la procédure et la question de savoir si cet accord devait ou non être soumis au Parlement, il a rappelé que l'article 53 de la Constitution énumère les traités ou accords qui doivent faire l'objet d'une procédure d'autorisation parlementaire, qui comprennent les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, les traités qui engagent les finances de l'Etat, ceux relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire et, enfin, les traités qui modifient des dispositions de nature législative.
Faisant observer que cet accord n'était à l'évidence ni un traité de paix, ni un traité de commerce, ni un traité ou accord portant cession, annexion ou échange de territoire, qu'il ne concernait pas une organisation internationale et n'engageait pas non plus les finances de l'Etat, il a indiqué que la seule interrogation était de savoir si cet accord ne portait pas sur une matière législative.
A cet égard, il a rappelé que le Conseil constitutionnel avait jugé, dans sa décision du 19 juin 1970, qu'un traité ou accord devait être soumis à l'autorisation parlementaire de ratification ou d'approbation, dès lors qu'il portait sur une matière législative, sans qu'il soit besoin de considérer si ce traité ou accord modifie une telle matière.
Il a fait remarquer que la jurisprudence du Conseil constitutionnel privilégiait donc une interprétation large, allant au-delà de la lettre de l'article 53 de la Constitution, qui revenait à soumettre un grand nombre de traités ou accords à une procédure d'autorisation parlementaire, puisque dès lors qu'un traité ou accord porte sur une matière législative, il doit être soumis au Parlement.
Il a toutefois estimé que tel ne semblait pas être le cas de l'accord entre la France et le Saint-Siège, puisque cet accord porte uniquement sur la reconnaissance mutuelle des grades et diplômes de l'enseignement supérieur et qu'il ne touche pas aux principes fondamentaux de l'enseignement, qui seuls relèvent de la loi, en vertu de l'article 34 de la Constitution.
Rappelant que le Conseil d'Etat avait jugé, dans un arrêt du 10 mars 1993, que la création d'un nouveau diplôme ne touchait pas aux principes fondamentaux de l'enseignement, il a estimé qu'il en allait de même a fortiori, de la simple reconnaissance des diplômes. Il a, en outre, fait observer que cet accord avait été pris sur le fondement de la convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur, signée à Lisbonne le 11 avril 1997, et que cette convention n'avait fait l'objet d'aucune autorisation du Parlement préalablement à sa ratification, car il avait été considéré à l'époque qu'elle ne comportait aucune disposition de nature législative. Il a donc estimé qu'il serait surprenant que la procédure soit différente concernant l'accord entre la France et le Saint-Siège qui vise à mettre oeuvre cette convention. Il a en outre indiqué que les précédents accords de reconnaissance des diplômes signés par la France, par exemple avec l'Espagne ou l'Italie, n'avaient pas été soumis à une procédure d'autorisation parlementaire.
Évoquant ensuite le fond, M. Josselin de Rohan, président, a indiqué que dès sa publication au Journal officiel, cet accord avait suscité des protestations de plusieurs syndicats ou associations au nom de la défense du principe de laïcité.
Il a indiqué que, sans vouloir entrer dans cette polémique, il convenait de ne pas exagérer la portée de cet accord.
Il a rappelé que la France était liée par une trentaine d'accords portant sur la reconnaissance des diplômes, dans le cadre du processus de Bologne, avec des pays européens comme l'Espagne, mais aussi extra-européens, comme la Chine ou la Colombie, et que l'accord avec le Saint-Siège n'était pas différent des précédents.
Il a ensuite fait observer que, si le texte de l'accord était assez ambigu en ce qui concerne les institutions et les diplômes concernés et que leur liste n'avait pas encore été publiée, le ministère des affaires étrangères et européennes avait précisé, dans un communiqué de presse, que seuls devraient être concernés les diplômes canoniques délivrés par les universités catholiques ou les établissements d'enseignement supérieur habilités par le Saint-Siège, ainsi que les diplômes ecclésiastiques directement délivrés par les facultés ecclésiastiques sous l'autorité du Saint-Siège.
Ainsi, il a indiqué que cet accord concernerait, à ce stade, des études ou des diplômes dans des matières ecclésiastiques, comme la théologie, le droit canon, les langues anciennes ou encore la philosophie scolastique, et qu'il ne devrait pas s'appliquer aux matières « profanes », comme le droit, les sciences ou la médecine.
Il a cependant fait observer que l'accord et son protocole ne visaient pas une liste limitative mais posaient un principe général de reconnaissance et que, à l'avenir, la question pourrait se poser d'élargir ou non cette liste à d'autres matières.
Il a également indiqué que l'accord ne devait s'appliquer qu'aux diplômes délivrés par les cinq facultés catholiques françaises, comme l'Institut catholique de Paris, auxquelles il faut ajouter le Centre Sèvres, géré par les Jésuites, et l'Ecole cathédrale, instance de formation du diocèse de Paris.
Enfin, il a rappelé que chaque université française conservait le droit de reconnaître ou non le diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur catholique pour la poursuite des études, cette reconnaissance n'étant ni automatique, ni de droit, ce qui préserve le principe de l'autonomie des universités.
A la suite de cette communication, un débat s'est engagé.

s'est étonné que l'accord entre la France et le Vatican, eu égard à son importance, n'ait pas été soumis à une procédure d'autorisation parlementaire. Il a rappelé que, en France, la législation en vigueur réserve à l'Etat le monopole de la délivrance des diplômes universitaires et ne permet pas d'habiliter les établissements d'enseignement supérieur privés à délivrer des diplômes nationaux. Estimant que la qualité des diplômes délivrés et des formations assurées par les universités catholiques n'était pas en cause, il a toutefois fait part de ses interrogations au sujet du respect du principe de laïcité de la République et du monopole de l'Etat de délivrance des diplômes nationaux.

a regretté l'empressement des autorités françaises à signer cet accord avec le Vatican, expression préférable, selon lui, à celle de « Saint-Siège », qui semble davantage liée au discours du Président de la République de Latran du 20 décembre 2007 qu'au processus dit « de Bologne », ainsi que le manque de transparence du Gouvernement sur le déroulement des négociations et sur le contenu de cet accord. Il a estimé indispensable que cet accord soit soumis à un débat et à un vote du Parlement conditionnant son approbation, compte tenu de la nature et de la sensibilité particulières de ce sujet.
Relevant que l'article 2 de l'accord et l'article 1er du protocole stipulaient qu'une liste des institutions ainsi que des grades et diplômes concernés serait élaborée par la Congrégation pour l'éducation catholique, régulièrement tenue à jour et communiquée aux autorités françaises, il s'est interrogé au sujet de cette liste, et notamment sur les matières concernées.

a indiqué que l'accord entre la France et le Saint-Siège visait uniquement à mettre en place un système de reconnaissance mutuelle des grades et diplômes entre les deux parties et qu'il ne saurait, dès lors, être considéré comme portant sur une matière législative, et devoir être soumis à une procédure d'approbation parlementaire en vertu de l'article 53 de la Constitution. Il a rappelé que ni la convention de 1997 ni les précédents accords de reconnaissance des diplômes n'avaient fait l'objet d'une telle procédure.
Faisant observer qu'il fallait distinguer la reconnaissance et la délivrance des diplômes, M. Josselin de Rohan, président, a souligné que la reconnaissance des diplômes accrédités par le Saint-Siège en France ne leur conférait pas la valeur d'un diplôme national et que cette reconnaissance n'était ni automatique, ni de droit, puisque chaque université restait libre de reconnaître ou non l'équivalence de grades ou de diplômes pour la poursuite d'études.

a rappelé que le Saint-Siège était l'appellation officielle de l'Etat du Vatican, que la France entretenait des relations diplomatiques avec cet Etat et qu'un ambassadeur de France était accrédité auprès du Saint-Siège.

a estimé que, dans la mesure où la reconnaissance était distincte de la délivrance et que chaque université conserverait la liberté de reconnaître ou non les diplômes délivrés par les établissements catholiques, cet accord ne lui paraissait pas contraire au principe de laïcité.

a confirmé que de nombreux accords conclus par la France portant sur la reconnaissance des diplômes ou des qualifications professionnelles, par exemple en matière vétérinaire, et parfois avec des pays dont les pratiques apparaissent contestables, n'avaient pas fait l'objet d'une procédure d'approbation parlementaire. Il a également estimé que le fait que chaque université serait libre de reconnaître ou non le diplôme d'une institution catholique, constituait, à ses yeux, une garantie suffisante.
La commission a ensuite procédé à l'examen du rapport de M. Didier Boulaud sur le projet de loi n° 348 (2008-2009) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure.

a rappelé que la France avait déjà conclu une quarantaine d'accords de coopération en matière de sécurité intérieure, dont une vingtaine avec des pays européens, six avec des pays africains, six sur le continent américain et neuf en Asie. Il a précisé que leurs dispositions étaient fondées sur un accord-type élaboré en 2002, adaptées si nécessaire aux spécificités du pays partenaire.
Il a indiqué que le présent accord avait été rédigé à partir d'une proposition croate de 1998 et avait été signé en octobre 2007, à Paris, par les deux ministres de l'intérieur. Il a estimé que, alors que des négociations étaient en cours depuis 2004, en vue de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne, ce texte contribuait à renforcer les capacités de ce pays en matière de lutte contre la criminalité.
Puis il a retracé la situation actuelle de la Croatie, qui se présente comme une démocratie stabilisée, comme en témoigne l'alternance démocratique du pouvoir.
Il a rappelé que cette ancienne république de la Fédération yougoslave avait acquis son indépendance en 1991 au prix d'un conflit meurtrier, la « guerre patriotique » terminée en 1995, mais qui s'était traduite par le départ de l'essentiel de la minorité serbe.
Retraçant l'évolution politique du pays depuis 2000, M. Didier Boulaud, rapporteur, a fait valoir qu'il progressait dans son projet d'adhésion à l'Union européenne, et qu'il avait rejoint l'OTAN au début du mois d'avril 2009.
Il a rappelé que la France appuyait la Croatie dans son objectif de rejoindre l'Union européenne et finançait à ce titre la formation de fonctionnaires croates aux affaires européennes, tout en soutenant la réforme des systèmes judiciaire et policier.
Un poste d'attaché de sécurité intérieure a ainsi été créé au sein de l'ambassade de France à Zagreb et un projet est à l'étude pour la création d'une école de la magistrature sur le modèle de l'Ecole nationale de la magistrature française.
Un pôle régional de lutte contre la criminalité organisée originaire du sud-est de l'Europe, réunissant des représentants de plusieurs administrations françaises, a été créé à Zagreb en 2004, et sa compétence s'étend à onze pays du sud-est de l'Europe : les Etats de l'ex-Yougoslavie, la Bulgarie, la Roumanie, la Moldavie, l'Albanie, la Turquie et Chypre.
s'est félicité que cet instrument, au service de l'engagement diplomatique de la France dans le sud-est de l'Europe, témoigne d'une volonté de lutter, avec les autorités de l'ensemble des Etats intéressés, contre la criminalité transnationale organisée qui entrave la stabilité politique et le développement économique de ces nouveaux Etats.
Puis il a rappelé que l'établissement d'un accord-type dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée transnationale permettait de donner une base juridique solide à la coopération opérationnelle et technique et de renforcer son intensité pour les pays considérés comme essentiels pour la France.
Après en avoir présenté les dispositions principales, le rapporteur a rappelé que le Parlement croate avait ratifié le présent accord en novembre 2008 puis il a souhaité que la France en fasse de même.
Un débat s'est alors ouvert.

s'est enquis du degré d'intégrité caractérisant la Croatie par rapport à ses voisins ou à des pays comme la Bulgarie ou la Roumanie.

a répondu que ce degré était difficile à évaluer, mais que le présent accord visait à le réduire, avec l'aide de la France.

a souhaité savoir si cet accord avait fait l'objet d'une concertation préalable avec nos partenaires de l'Union européenne.

a rappelé qu'il s'agissait d'un accord bilatéral mais que, avant de devenir membre à part entière de l'Union européenne, la Croatie aurait naturellement satisfait aux conditions de reprise de l'acquis communautaire dans ces domaines.

s'est félicité de l'attitude coopérative de la Croatie dans la recherche des criminels de guerre poursuivis par le Tribunal spécial pour l'ex-Yougoslavie.
Puis la commission a adopté le projet de loi, en prévoyant son examen en séance publique sous forme simplifiée.

Puis la commission a examiné le rapport de M. Raymond Couderc sur le projet de loi n° 350 (2008-2009) autorisant l'approbation de l'avenant à l'accord de siège du 11 janvier 1965 entre le Gouvernement de la République française et le bureau international des expositions relatif au siège du bureau international des expositions et à ses privilèges et immunités sur le territoire français.
a rappelé que les grandes expositions internationales s'étaient développées au XIXe siècle, et que c'est à Londres qu'eut lieu, en 1851, la première exposition universelle au sens où nous l'entendons actuellement. Paris organisa à son tour quatre expositions de ce type entre 1867 et 1900. Il fut observé que ces manifestations suscitaient parfois des conflits d'intérêt, accentués par un défaut de règles d'organisation. Les gouvernements cherchèrent donc à établir une réglementation propre à éviter ces écueils.
Un accord international semblant nécessaire, l'Allemagne convoqua en 1912 les gouvernements intéressés afin de rechercher les bases d'une entente. La conférence diplomatique réunie à Berlin élabora une convention internationale destinée à régir les expositions internationales, mais le traité qui en résulta ne put être ratifié en raison de la guerre de 1914-1918.
C'est donc seulement en 1928 qu'une nouvelle conférence rassembla à Paris les délégués de trente et un pays qui signèrent, le 22 novembre, la première convention régissant l'organisation des expositions internationales. Cette convention réglemente la fréquence de ces expositions, et définit les droits et obligations des exposants et des organisateurs. Pour veiller à l'application de ce traité, elle crée le bureau international des expositions (BIE).
Le contexte économique qui suivit la Seconde Guerre mondiale conduisit à une profonde révision de la convention de 1928. Entreprise en 1965, elle aboutit à la signature du protocole du 30 novembre 1972, entré en vigueur le 9 juin 1980, qui régit actuellement l'organisation des expositions internationales.
L'objectif du bureau international des expositions (BIE) est de réglementer la fréquence des expositions qui relèvent de sa compétence, et de veiller à leur qualité. Toutes les expositions internationales d'une durée supérieure à trois semaines et de caractère non commercial, organisées par un Etat, et pour lesquelles des invitations sont envoyées aux autres Etats par la voie diplomatique, entrent dans le champ de compétence du BIE. Le siège du secrétariat général est à Paris, et la France est puissance dépositaire de la convention. Le BIE compte actuellement 154 membres. Le BIE exerce un contrôle sur les conditions faites aux participations étrangères, par la procédure de l'enregistrement.
Le présent texte découle d'une demande faite par le BIE à la France, à l'occasion de l'acquisition et de l'aménagement de son nouveau siège, en vue d'obtenir le remboursement de la TVA sur ses dépenses de caractère immobilier. La France, qui acquitte une cotisation annuelle de 15 000 euros au BIE, a estimé le coût de ce remboursement à environ 250 000 euros, un montant qui paraît raisonnable au regard des avantages que procure à Paris la localisation de ce siège.
Un avenant en ce sens à la convention de 1965 a donc été conclu le 4 février 2008 entre le secrétaire général du ministère des affaires étrangères et européennes et celui du BIE.
a présenté le dispositif de l'accord, et a estimé qu'il confortait le rôle majeur joué par le BIE dans la bonne organisation des expositions. Il a donc recommandé son adoption.
Sur la proposition de son rapporteur, la commission a alors adopté le projet de loi et prévu son examen en séance publique sous forme simplifiée.

Enfin, la commission a examiné le rapport de M. Jacques Blanc sur le projet de loi n° 354 (2008-2009), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres relatives à la garantie des investisseurs entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco.
a indiqué, en préambule, que l'accord sur la garantie des investisseurs entre la France et la Principauté de Monaco participait à la modernisation des relations franco-monégasques, engagée par le traité du 24 octobre 2002, destiné à adapter et à confirmer les rapports d'amitié et de coopération entre les deux pays.
Il a souhaité d'abord rappeler l'état des relations franco-monégasques en matière financière, notamment en ce qui concerne le secret bancaire et la lutte contre le blanchiment de capitaux.
a indiqué que les établissements de crédit installés dans la Principauté étaient soumis en principe à la réglementation bancaire française, depuis la convention franco-monégasques du 14 avril 1945, et qu'ils étaient donc placés dans le champ de compétence des organes de tutelle français, dont le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la Commission bancaire.
Il a toutefois indiqué que, selon l'échange de lettres du 27 novembre 1987, les dispositions propres à la France étaient applicables à Monaco uniquement lorsqu'elles concernent strictement la réglementation et l'organisation des établissements de crédit, mais que, en revanche, le contrôle de l'application de ce dispositif restait sous la responsabilité des seules autorités monégasques, notamment en matière de prestation de services d'investissement et de dispositif anti-blanchiment.
a donc noté que la réglementation française relative à la lutte contre le blanchiment ne s'appliquait pas à la Principauté de Monaco, celle-ci disposant de ses propres règles en matière de blanchiment et de contrôle des services d'investissement.
a toutefois tenu à souligner les avancées réalisées ces dernières années par la Principauté en matière de transparence bancaire et de lutte contre le blanchiment de capitaux. Il a indiqué que le secret bancaire existant à Monaco n'était pas absolu, car il ne pouvait être opposé ni à la Commission Bancaire, ni à la Banque de France, ni à l'équivalent monégasque du service TRACFIN français, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
Il a également rappelé que, en vertu de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, la France et Monaco avaient mis en place un dispositif d'échange de renseignements et d'assistance administrative qui permet à l'administration fiscale française d'obtenir des autorités monégasques tous les renseignements qu'elles détiennent sur les revenus, dividendes et créances détenus en Principauté par des personnes fiscalement domiciliées en France, dont des renseignements d'ordre bancaire.
a par ailleurs indiqué que la Principauté de Monaco s'était également engagée à prendre des mesures d'effets équivalents à la directive communautaire relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Il a fait observer qu'un comité mixte avait été créé pour procéder à des échanges de vue et prendre des décisions relatives à la réglementation monégasque en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et que, à la suite de la publication, le 6 décembre 2007, du rapport d'évaluation du comité Moneyval du Conseil de l'Europe, Monaco avait renforcé sa législation sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme par une ordonnance du 30 avril 2008 et qu'une nouvelle ordonnance visant à transposer la troisième directive de lutte contre le blanchiment était en cours d'adoption.
a toutefois indiqué que, malgré ces progrès, de nombreuses organisations internationales, comme le Conseil de l'Europe, le FMI ou l'OCDE, qualifiaient encore Monaco de « paradis fiscal ». Monaco figure, par exemple, sur la « liste grise » des paradis fiscaux non coopératifs de l'OCDE, même si cet Etat considère que les flux financiers qui circulent sur son territoire ne sont pas comparables à ceux d'autres grandes places financières internationales, comme Singapour par exemple. Le rapporteur a également mentionné la réunion conjointe organisée en novembre 2008 dans la Principauté par le GAFI et le comité Moneyval, ainsi que le message adressé par le Prince Albert II de Monaco, le 19 avril dernier, à la suite de la réunion du G20, qui rappelle la détermination des autorités monégasques à s'aligner sur les normes internationales.
a indiqué ensuite que l'accord, signé le 8 novembre 2005, sous forme d'échange de lettres entre la France et la Principauté de Monaco, relatif à la garantie des investisseurs, visait principalement à permettre l'adhésion des établissements de crédit exerçant dans la Principauté au mécanisme français de garantie des titres.
Il a rappelé que ce mécanisme, géré par le Fonds de garantie des dépôts, couvrait les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, et qu'il permettait d'indemniser les clients en cas d'incapacité de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement concernés à restituer les titres ou les espèces leur appartenant.
Faisant observer que, selon une disposition de cet accord, les autorités monégasques s'étaient engagées à assurer la cohérence de leur réglementation avec les évolutions de la réglementation française, il a estimé que cette disposition marquait une concession de la France, qui reconnaît ainsi implicitement l'absence d'applicabilité directe à Monaco du droit financier français non bancaire.
Il a cependant souligné que, en contrepartie, la France avait obtenu de Monaco l'adoption d'un dispositif, désormais effectif depuis la loi monégasque et l'ordonnance souveraine des 7 et 10 septembre 2007, fusionnant, d'une part, les deux anciennes autorités de contrôle monégasques compétentes pour les activités boursières et les OPCVM, et assurant, d'autre part, l'indépendance de la nouvelle commission de contrôle des activités financières, notamment en matière de sanctions.
Il a indiqué que ces garanties d'indépendance provenaient notamment de :
- l'indépendance de la commission monégasque de contrôle des activités financières, qui ne dépend plus du Ministre d'Etat, auparavant titulaire du pouvoir de sanction ;
- la marge de manoeuvre dont dispose la commission pour effectuer sa mission : accès aux documents, contrôle sur pièces et sur place, droit de procéder à la convocation et à l'audition des dirigeants et représentants des sociétés agréées ;
- la protection de la commission et de ses agents, quant au risque de poursuite pénale, d'action en responsabilité civile ou de sanction professionnelle.
a indiqué que les autorités françaises estimaient désormais que l'évolution juridique monégasque répondait à leurs exigences d'équivalence des contrôles et des sanctions encourues par les établissements installés dans la Principauté par rapport à ceux qui sont installés en France, dès lors que ceux-ci adhèrent au même mécanisme, cette équivalence constituant un point fondamental pour les autorités françaises, mais aussi pour le Fonds de garantie et pour les établissements qui cotisent au fonds.
En conclusion, M. Jacques Blanc, rapporteur, a estimé que cet accord améliorait la garantie des investisseurs, ainsi que l'indépendance de l'autorité monégasque de contrôle des activités financières, même s'il reste encore des progrès à faire par Monaco en matière de transparence bancaire et de lutte contre le blanchiment de capitaux.

a indiqué que les membres du groupe socialiste ne s'associeraient pas à l'adoption de ce texte, compte tenu des incertitudes qui subsistent sur les progrès réalisés par Monaco en matière de transparence bancaire et de lutte contre le blanchiment de capitaux.
Sur proposition de son rapporteur, la commission a alors adopté le projet de loi, le groupe socialiste s'abstenant, et proposé que ce texte fasse l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en séance publique.
La commission a nommé M. René Beaumont rapporteur sur la proposition de résolution européenne n° 366 (2008-2009) de Mme Nathalie Goulet sur les relations entre l'Union européenne et l'Etat d'Israël.
Lors d'une seconde séance tenue dans l'après-midi, la commission a procédé à l'audition de M. Pierre Lellouche, représentant spécial de la France pour l'Afghanistan et le Pakistan.
a tout d'abord rappelé les évolutions importantes que le Président Nicolas Sarkozy avait imprimées à la politique française à l'égard de l'Afghanistan depuis son élection.
En février 2008, le Président de la République a adressé à ses vingt-cinq homologues de l'OTAN une lettre appelant à une nouvelle stratégie pour l'Afghanistan, fondée notamment sur une approche globale combinant le volet sécuritaire et le développement économique, sur un transfert progressif des tâches sécuritaires aux autorités afghanes et sur la prise en compte de la dimension régionale de la crise. Cette approche intégrée a été approuvée par les chefs d'Etat et de gouvernement de l'OTAN lors du sommet de Bucarest, en avril 2008, puis confirmée lors du sommet de Strasbourg en avril dernier.
Le 12 juin 2008 s'est tenue à Paris, à l'initiative de la France, une conférence sur l'Afghanistan, à l'issue de laquelle les Etats donateurs se sont engagés à hauteur de plus de 20 milliards de dollars en faveur de la reconstruction et du développement économique. Elle a été suivie, le 14 décembre 2008, par la conférence de La Celle Saint-Cloud, organisée par M. Bernard Kouchner, qui, pour la première fois, prenait en compte la dimension régionale, avec, en particulier, la présence du Pakistan. L'Iran, invité, n'a pas été présent mais a participé aux réunions ultérieures.
Dans le même temps, l'arrivée d'une nouvelle administration aux Etats-Unis a donné lieu à trois « revues » au terme desquelles la politique américaine s'articule pleinement autour de l'approche intégrée et de la dimension régionale.
Début 2009, M. Richard Holbrooke a été nommé par le Président Barack Obama envoyé spécial pour l'Afghanistan et le Pakistan.
Le Royaume-Uni et l'Allemagne ont également désigné un représentant spécial.
a précisé que c'est dans ce contexte qu'il avait été désigné représentant spécial de la France pour l'Afghanistan et le Pakistan par le Président de la République, à la fin du mois de février. Sa fonction s'exerce sous l'autorité du ministre des affaires étrangères et européennes, dans le cadre d'une mission temporaire confiée par le Président de la République. Conformément à la loi, cette mission est compatible avec un mandat parlementaire pour une période ne pouvant excéder six mois. En tout état de cause, la France maintiendra un représentant spécial au-delà de ce délai.
Aujourd'hui, une vingtaine de pays ont désigné un émissaire spécial pour l'Afghanistan.
a rappelé que, précédemment à sa nomination, il avait été chargé, par la commission de la défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale, d'effectuer, avec M. François Lamy, député, une mission d'information sur la participation militaire française aux opérations en Afghanistan. Il s'agissait, notamment, d'assurer le suivi de l'engagement français après la réorganisation de notre dispositif décidée par le Président de la République. Nos effectifs, auparavant concentrés à Kaboul, ont été renforcés et en partie redéployés dans le district du Surobi, qui dépend du commandement régional Centre (Kaboul), sous l'autorité d'un général français, et dans la vallée de Kapisa, qui dépend, quant à elle, du commandement régional Est, sous la responsabilité d'un général américain. Parallèlement, les avions de combat français ont été déplacés du Tadjikistan vers l'Afghanistan, sur la base de Kandahar, et nos moyens aéromobiles ont été renforcés par des hélicoptères Caracal et Gazelle.
a indiqué que le rapport d'étape présenté à la fin du mois d'octobre 2008, suite à un déplacement sur place, avait mis en lumière les inconvénients de la répartition du contingent français sous l'autorité de deux commandements distincts, alors même que le déploiement hors de Kaboul l'engage dans des missions plus difficiles. D'autre part, il avait également souligné la disproportion entre les moyens, de l'ordre de 200 millions d'euros, que la France consacre à sa participation militaire, et ceux dévolus à l'aide civile, limités à 11 millions d'euros.
Le renforcement de l'effort interministériel est l'un des objectifs poursuivis par la désignation d'un représentant spécial pour l'Afghanistan et le Pakistan. L'équipe constituée autour de lui compte une douzaine de personnes, qui ne proviennent pas seulement des ministères des affaires étrangères et de la défense, mais comptent également des spécialistes du développement ou de la lutte contre la drogue.
D'ores et déjà, un quadruplement du montant de l'aide civile française en direction de l'Afghanistan a été décidé, puisqu'elle atteindra environ 40 millions d'euros en 2009. L'objectif est d'atteindre en 2010 le niveau moyen observé dans les autres pays européens comparables, compris entre 60 et 100 millions d'euros.
Un certain nombre de projets concrets ont été relancés, notamment en matière de santé et d'éducation. Il est également nécessaire de conduire des projets de développement rural au plus près de nos forces, afin que les populations constatent le lien entre la sécurité et le développement.
a ensuite indiqué que l'un des axes de l'action de la France visait à aider les autorités afghanes à prendre en charge la sécurité du pays, à travers la formation de l'armée nationale afghane et des forces de sécurité. Il a évoqué les insuffisances constatées en matière de police et précisé que, sur initiative française, la force européenne de gendarmerie serait mobilisée pour former des forces de sécurité.
La coordination de l'aide internationale constitue un deuxième enjeu majeur. M. Pierre Lellouche a cité, à ce propos, les chiffres avancés par des rapports du Congrès américain, établissant qu'à peine 20 % de cette aide est réellement dépensée sur le terrain au profit des populations. Il a ajouté qu'hormis quelques pays comme le Canada ou les Pays-Bas, peu de gouvernements étaient réellement capables d'établir avec précision le tableau de leur aide financière. Faute de contrôle opérant, l'efficacité de cette aide a été très limitée. La France a donc préparé une initiative internationale pour faire en sorte que la Banque mondiale procède à un audit de l'aide internationale en Afghanistan et dresse une première cartographie de cette aide dans ce pays : qui dépense quoi et où ?
Enfin, M. Pierre Lellouche a évoqué la préparation de l'élection présidentielle, dont le premier tour a été fixé au 20 août alors que le mandat du Président Karzaï arrive à échéance le 22 mai prochain. La France est particulièrement attentive à ce que ce processus électoral se déroule dans de bonnes conditions, avec une garantie d'égal accès des différents candidats aux médias et aux moyens publics.
a ensuite abordé l'évolution récente de la situation au Pakistan. Il a rappelé les positions que les taliban étaient parvenus à établir dans les zones tribales (Federally administered tribal areas - FATA), à la faveur du statut particulier de ces provinces, hérité de la période coloniale, qui donne peu de prises au gouvernement central. Il a souligné l'élément nouveau que constituait l'expansion des taliban vers l'est, hors des zones tribales, et la perte de contrôle des autorités d'Islamabad sur des régions comme la vallée de Swat (la province de la frontière du nord-ouest).
Il a indiqué que lors d'une conférence internationale sur l'aide au Pakistan tenue mi-avril à Tokyo, il avait fait part aux autorités pakistanaises des inquiétudes que suscitait l'accord intervenu dans la vallée de Swat avec les taliban, alors que ceux-ci n'ont pas désarmé les milices et ont imposé l'application de certains éléments de la charia. M. Richard Holbrooke n'avait pas évoqué le problème. Une semaine plus tard, le Secrétaire d'Etat américain, Mme Hillary Clinton, s'alarmait de la progression des taliban en direction d'Islamabad et des risques pour la stabilité du Pakistan, avec les conséquences qui en découleraient pour le reste du monde...
Il a ajouté que les autorités pakistanaises semblaient avoir réagi en programmant de nouvelles actions en direction des zones tribales. Il a toutefois souligné que ces actions étaient mal perçues par l'opinion publique pakistanaise, qui considère majoritairement qu'elles servent surtout les intérêts des Etats-Unis. Il a également insisté sur les divisions au sein des forces politiques pakistanaises.
a insisté sur la nécessité de l'implication de l'ensemble des acteurs internationaux concernés pour aider le Pakistan à préserver sa stabilité. La Chine, l'Inde, la Russie, l'Iran, l'Arabie Saoudite ou les Emirats Arabes Unis ont vocation à participer à un véritable « groupe de contact » qui permettrait d'agir en commun en direction du Pakistan. Le fait que la situation de la région ait été à l'ordre du jour de la réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Moscou au mois de mars, de la conférence de La Haye le 31 mars dernier, du sommet de l'OTAN à Strasbourg ou encore de la réunion des donateurs, à Tokyo, au mois d'avril, témoigne d'une prise de conscience plus affirmée, au sein de la communauté internationale, des enjeux liés à la stabilité de l'Afghanistan et du Pakistan.

s'est interrogé sur le rôle du représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour l'Afghanistan, M. Kai Eide, en matière de coordination de l'action internationale. Il a évoqué la mission confiée à M. Richard Holbrooke. Il s'est également demandé dans quelle mesure l'Inde pouvait peser sur la situation en Afghanistan et au Pakistan.
a rappelé que, en s'opposant à la nomination de M. Paddy Ashdown, le Président Karzaï avait souhaité marquer les limites dans lesquelles devaient s'inscrire les prérogatives du représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU, au regard de celles du gouvernement central. M. Kai Eide ne ménage pas ses efforts, mais sa tâche reste difficile. Il dispose depuis peu d'un adjoint américain à ses côtés. S'agissant de la politique américaine, elle est en accord avec la vision française en termes de diagnostic et d'orientations. M. Richard Holbrooke n'est pas le seul acteur de sa mise en oeuvre qui implique la Maison blanche et le conseiller à la sécurité nationale, le Département d'Etat et le Pentagone. En ce qui concerne les relations indo-pakistanaises, elles restent tendues après l'attentat de Bombay. L'état d'esprit des dirigeants politiques et militaires pakistanais a, depuis toujours, été façonné dans la perspective de la confrontation avec l'Inde. Il importe que le Pakistan relativise le facteur indien au regard de la menace immédiate que représente l'islamisme radical.

a souhaité des précisions sur la mise en place des renforts militaires américains en Afghanistan et sur un éventuel appel à des contributions européennes supplémentaires. Il a également évoqué la politique américaine à l'égard de la sécurisation des capacités nucléaires militaires du Pakistan.
a indiqué que les Etats-Unis avaient envoyé 10 000 hommes supplémentaires en Afghanistan sous l'administration précédente, auxquels s'ajoutaient 17 000 hommes engagés à la suite de la décision du Président Obama. Il a indiqué qu'il ne voyait pas aujourd'hui de perspectives d'accroissement des effectifs, ni de la part des Américains, ni de la part des Européens, la priorité portant moins sur le volume des forces internationales que sur la formation d'une armée et d'une police afghanes capables de prendre en charge des missions de sécurité sur le terrain. Il a évoqué le récent collectif budgétaire américain pour les opérations extérieures, dont une part très minime sera consacrée à l'action diplomatique et civile. Enfin, il a indiqué que les autorités pakistanaises assuraient avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité de leurs installations nucléaires militaires. On ne dispose d'aucune information officielle sur le concours qu'auraient pu apporter les Etats-Unis à cette sécurisation.

s'est interrogée sur les raisons de l'apparente déliquescence du pouvoir pakistanais.
a rappelé l'histoire politique tourmentée du Pakistan, au cours de laquelle les périodes de gouvernement civil ont été brèves. Il a estimé que, face aux combattants taliban, le gouvernement central serait en mesure de préserver le contrôle du territoire national s'il pouvait agir dans un climat moins conflictuel entre les forces politiques, si l'opinion publique comprenait mieux les enjeux du combat contre l'islamisme radical et si l'armée mesurait que les risques de déstabilisation interne sont au moins aussi élevés que ceux qu'elle attribue à la relation avec l'Inde. Une action concertée de la communauté internationale à l'égard du Pakistan est également nécessaire.

a constaté qu'aucun des objectifs que s'était assignée la France en s'engageant en Afghanistan n'était aujourd'hui en passe d'être atteint. Il a souhaité connaître le sentiment et les attentes de la population afghane à l'égard des forces internationales.

s'est alarmée de l'insuffisance de l'aide civile et des déficiences dans sa gestion, l'impact auprès des populations bénéficiaires étant très atténué.
a indiqué que les attentes de la population portaient sur la satisfaction des besoins de base, tels que l'alimentation électrique et l'eau potable, l'irrigation, la fourniture d'engrais et de semences. La faiblesse de l'Etat central et le peu de progrès visibles dans ces domaines essentiels servent objectivement les taliban, même si la population, dans sa majorité, ne souhaite pas leur retour au pouvoir. Quelle que soit l'évaluation sévère que l'on peut effectuer sur la stratégie menée jusqu'à présent par la communauté internationale, celle-ci ne peut se retirer d'Afghanistan avant d'avoir assuré les conditions minimales de la sécurité du pays.