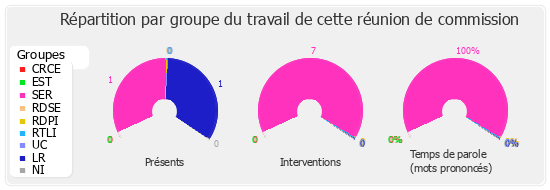Mission d'information sur les pesticides
Réunion du 11 septembre 2012 : 1ère réunion
Sommaire
- Audition de m. sylvain maestracci et de mme karen bucher secrétariat général des affaires européennes sgae (voir le dossier)
- Audition de m. daniel roques président de l'association des utilisateurs et distributeurs de l'agro-chimie européenne audace et de m. stéphane delautre-drouillon secrétaire général (voir le dossier)
- Audition de m. dominique bricard directeur général de nutréa de m. michel le friant responsable des métiers du grain caliance et de m. joël pennaneac'h coordinateur du pôle sécurité triskalia (voir le dossier)
- Audition du dr. vincent peynet de kudzu science (voir le dossier)
La réunion

Nous entamons aujourd'hui notre dernière journée d'auditions. Celles-ci ont été très nombreuses. Nous souhaitions à présent avoir un éclairage européen sur notre sujet, car l'Union européenne est au coeur du processus d'évaluation des substances actives, préludant à l'autorisation de mise sur le marché des produits, sans parler des fraudes qui sont, nous a-t-on dit, considérables. Quel est, par exemple, le rôle de l'Union européenne concernant les protocoles de tests, les équipements de protection individuelle, les douanes, etc ?
Mme Karen Bucher est notre experte sur tous les sujets sanitaires et phytosanitaires, des OGM aux pesticides. Quant à moi, je suis ici plutôt le porte-parole du Secrétariat.
La réglementation européenne repose sur trois textes fondateurs : le règlement 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, qui couvre toutes les procédures d'évaluation et d'autorisation ; le règlement 396/2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ; enfin, la directive européenne 2009/128 sur l'utilisation durable des pesticides.
L'approbation se fait au niveau européen pour les substances actives. Le dossier est déposé par le pétitionnaire, un État membre est désigné comme rapporteur, l'évaluation des risques est conduite par l'Agence européenne de sécurité alimentaire (AESA ou EFSA). Après avis des Etats membres, c'est la Commission européenne qui prend la décision d'autorisation de mise sur le marché.
Chaque État compte un représentant au Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (CPCASA), qui traite de tous les sujets sanitaires et phytosanitaires. Après négociations, le comité vote sur la proposition de la Commission.
Oui : pour la France, ce sont des membres de la direction générale de l'alimentation (DGAL) ou de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Le Secrétariat général des affaires européennes (SGAE) veille à ce que l'information circule, pour que la position donnée au comité soit bien celle qui a été avalisée par tous les ministères, le cas échéant après arbitrage.
Non, mais le SGAE s'appuie sur les avis scientifiques de l'AESA pour élaborer la position française. La Commission européenne peut également consulter des scientifiques de manière informelle, en tant que de besoin.
S'agissant des produits phytopharmaceutiques, l'autorisation de mise sur le marché relève des États membres. En France, c'est la direction générale de l'alimentation, au sein du ministère de l'agriculture, qui est chargée de délivrer ces autorisations. Le SGAE ne les voit pas passer.

Vous n'êtes donc pas informés de l'interdiction de tel ou tel produit dans un autre état de l'Union européenne, en Allemagne, par exemple ?
Si ! Il y a un échange d'information au niveau européen sur les produits phytosanitaires interdits par un État membre pour des raisons de santé publique ou de protection de l'environnement. Un exemple récent : lorsque le ministère de l'agriculture a retiré l'autorisation de mise sur le marché du Cruiser OSR dont la substance active est le thiamethoxam, il en a informé la Commission européenne et les autres États membres.
Dans le cas du Cruiser OSR, nous avons également demandé à la Commission de retirer l'autorisation du principe actif, le thiamethoxam, ce qui suppose de passer par la procédure de comitologie.
Si un État membre demande à la Commission de réévaluer une substance active, l'avis de l'AESA est sollicité. C'est le cas pour le thiamethoxam.
Pour la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, on s'appuie sur une évaluation scientifique : en France, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) qui est chargée de donner un avis.
Quant aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides dans l'alimentation, elles sont également déterminées au niveau communautaire, sur la base d'une analyse par l'AESA.

Quel est votre avis sur le système d'évaluation de toxicité des matières actives ?
Le fonctionnement du dispositif repose sur les avis de l'AESA. Les critères sont revus régulièrement, mais nous restons tenus par des limites techniques ainsi que par des limites de coût. Les autorités françaises sont dans l'ensemble plutôt satisfaites du travail de l'AESA, même si nous préférons nous appuyer sur les avis de l'ANSES pour fonder nos propres analyses.
Les données sont fournies par les industriels pétitionnaires ; les agences n'effectuent qu'un travail de réévaluation : il n'y a pas de recherche, de contre-expertise.

Les agences d'évaluation ne font-elles donc que contrôler les données sur le dossier ?
Oui. Le règlement 1107/2009 fixe aux agences nationales un cahier des charges assez strict, un canevas pour l'évaluation des données scientifiques fournies par les pétitionnaires. Il paraît difficile de revenir sur ce dispositif, qui est identique dans le domaine du médicament vétérinaire.

Il est donc d'autant plus important que l'ANSES dispose des données brutes, pour pouvoir les réinterpréter.
Mme Karen Bucher. - En effet.

Les perturbateurs endocriniens, les effets cocktail, les mélanges sont-ils pris en compte dans les évaluations ?
Les perturbateurs endocriniens sont pris en compte dans le règlement sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides mais non dans les effets cocktail et les mélanges, chaque substance active étant examinée indépendamment. En outre, la réalisation de tels tests poserait problème.
La réglementation européenne fixe la liste des données que les pétitionnaires doivent fournir, ce afin d'uniformiser l'application du droit européen dans les différents États membres. On ne dispose pas d'avis scientifique robuste sur l'effet des mélanges.
La clé d'entrée du dispositif européen demeure l'approche par substance.
Il s'agit d'assurer la sécurité du consommateur dans un marché intérieur uniformisé. D'où l'approche « produit », cette compétence étant communautaire. En revanche, le traité européen donne peu de compétences à l'Union en matière de santé humaine, le sujet étant du niveau des États membres. Le prisme communautaire favorise donc une approche par substance active.

Selon l'ANSES, que nous avons longuement auditionnée, le nombre de demandes d'homologation de produits phytosanitaires augmente. La France serait notamment très sollicitée par ricochet en raison des difficultés budgétaires des États du sud de l'Europe. Jouez-vous un rôle de régulateur en la matière ?
Le rôle du SGAE est de coordonner les administrations françaises, il n'a pas vocation à aller vers les autres États membres, par exemple, pour influer sur la répartition des évaluations entre ceux-ci. Personne n'a demandé à ce que le texte communautaire prévoie qu'un État membre puisse freiner ces demandes d'homologation... Sans doute cela pose-t-il des difficultés pratiques mais il n'y a pas de solution technique, sinon la bonne coopération entre États membres, de gré à gré.

Quelles sont les conséquences du dépassement des délais impartis aux évaluations ?
Dans le cas de la reconnaissance mutuelle, l'État membre receveur s'appuie sur l'évaluation faite par l'État membre d'origine. Il n'existe pas de délai à respecter à ma connaissance.
Si l'AESA, qui est en charge de l'évaluation des matières actives, prend du retard, il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre : les délais, s'ils existent, ne sont qu'indicatifs. En revanche, l'examen des autorisations de mise sur le marché est soumis à un délai.
Mme Karen Bucher. - Qui est de douze mois.
L'administration a une approche prudente car, en cas de dépassement du délai en matière d'importations parallèles, elle est réputée avoir refusé la demande d'autorisation - ce qui ouvre la possibilité d'un recours. En outre, l'administration a toujours la possibilité de poser des questions, ce qui interrompt le délai.
Je ne saurais vous répondre. Ces délais doivent être suffisamment longs pour laisser aux agences et à l'administration le temps de travailler.
Un État membre a également la possibilité de délivrer une autorisation provisoire pour faire face à une urgence phytosanitaire comme l'apparition subite d'un nouveau ravageur. Les Etats ont ainsi la possibilité d'être réactifs.

Pour les importations parallèles, le délai d'examen est bien de quarante-cinq jours ?

Quelles protections la Commission européenne prévoit-elle contre les conflits d'intérêts ?
A la suite de remous au Parlement européen - à propos de conflits d'intérêts sur un tout autre sujet - l'AESA a durci ses règles. Chaque membre du conseil d'administration, du forum consultatif, du comité scientifique, des groupes scientifiques et des groupes de travail doit désormais fournir une déclaration qui est publiée dans une base de données. Cette publicité assure un contrôle par les pairs et les citoyens. Les instances européennes, notamment la Commission, sont très sensibles à ces questions de transparence et d'information des citoyens, et particulièrement sourcilleuses.
Le contrôle intervient plutôt en amont, lors du processus de nomination.
On l'a vu récemment lors du renouvellement du conseil d'administration de l'AESA : certaines candidatures ont été retirées, pour cause de liens d'intérêts.
Elle dispose d'un comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts.

Le système est proche. Un membre ne peut siéger lors d'une séance d'un comité que s'il n'a pas de liens d'intérêts dans le domaine concerné.
Aux termes de la directive 2009/218 sur l'utilisation durable des pesticides, l'épandage aérien est interdit, sauf dérogation. La possibilité de dérogations a été réclamée avec insistance par de nombreux États membres ; puis le Conseil européen et le Parlement européen ont élargi la portée du « sauf »...

Vous n'avez pas d'informations sur l'application concrète sur le terrain ?
Il n'existe pas de base de données européenne, pas de procédure d'information sur les dérogations accordées dans tel ou tel État membre. Aucun État membre ne refuse systématiquement les dérogations; aucun ne s'était prononcé contre en 2009.
Non. La Commission n'a pas annoncé pas de rapport sur ce point.
La directive 2009/128 prévoit la définition d'indicateurs visant à vérifier la bonne application du texte. À ce stade, ils n'ont toujours pas été définis. La mise en oeuvre ou non des dispositions dérogatoires pourrait en faire partie.
Cette réglementation a été transposée en droit national par le Grenelle II et par un arrêté du 31 mai 2011. Les autorisations sont données au niveau départemental, sous réserve d'une évaluation scientifique par l'ANSES.
Il n'y a pas, en la matière, de coopération policière et judiciaire systématiques. Il est difficile d'être informé. Quelques commissions rogatoires ont été lancées, quelques saisies effectuées par les douanes. Ces dernières contrôlent les entrées sur le marché européen, c'est-à-dire l'importation de produits phytopharmaceutiques provenant de pays tiers. A l'intérieur de l'Union, le principe est celui de la libre circulation. En cas de doute, c'est la DGCCRF qui est chargée des contrôles. Les douanes, que nous avons interrogées, se disent satisfaites des pouvoirs douaniers actuels. Leur contrôle porte sur les 15 % de produits phytopharmaceutiques importés de pays extracommunautaires.

Prenons, par exemple, le cas de céréales provenant d'Ukraine et infestées d'insectes : elles sont nettoyées à coup de pesticides, dans le bateau puis, sans doute, à nouveau dans la coopérative où elles sont stockées... avant d'être transformées pour l'alimentation animale ou humaine. Est-il possible de faire entrer en France ces céréales de mauvaise qualité et infestées ?
Toute denrée destinée à l'alimentation animale ou humaine peut faire l'objet de contrôles.
Le contrôle est orienté, en fonction de l'analyse de risque.
Il y a toujours un contrôle documentaire. Quant au contrôle physique, il s'appuie sur l'analyse de risque, en fonction de la provenance, de la nature du produit, de l'importateur, etc.
Mme Karen Bucher. - Cela arrive.
Il faudrait interroger les douanes et les points d'entrée communautaires (PEC), qui sont des postes d'inspection frontaliers spécifiques pour les produits végétaux, pilotés par la direction générale de l'alimentation. En cas de non-conformité, le produit est soit détruit sur place, soit refoulé mais cela peut entraîner des difficultés financières.

Des céréales infestées deviennent-elles « conformes » si elles sont nettoyées à coup de pesticides ?
Si le ravageur qui infeste le blé est déjà endémique en France, il n'est pas sûr que l'on puisse refouler le produit pour ce seul motif.
Lorsqu'un organisme nuisible nouveau est détecté sur un produit importé, nous le notifions à la Commission européenne.

Je retiens qu'un produit infesté de nuisibles connus ne peut être rejeté. Il faut donc le traiter, dans les cales et dans la coopérative !
Si le produit est traité dans les cales, il sera soumis au contrôle de limites maximales de résidus de pesticides.
Il n'y aura jamais de systèmes de barrage absolu à l'import : on l'a vu avec le lait contaminé à la mélanine, qui provenait de Chine - même si, en l'occurrence, les contrôles ont permis de retracer les lots et de limiter l'impact sur la santé humaine. Le droit international et les accords de l'OMC prévoient que l'on peut faire obstacle aux échanges à partir de critères sanitaires et phytosanitaires dès lors que les mesures prises sont proportionnées aux risques. Mais nous ne pouvons simplement fermer nos frontières : les accords internationaux limitent nos marges de manoeuvre. Voilà pour la réponse de principe ; le ministère de l'agriculture pourrait vous donner davantage d'informations concrètes.

Quelles seraient vos recommandations pour améliorer les procédures d'autorisation de mise sur le marché ?
Il est difficile de répondre : le SGAE est avant tout un relais. Les difficultés d'application de la réglementation européenne, les manquements au principe de précaution sont gérés par les trois administrations de contrôle : les douanes, la DGCCRF et la DGAL. Nous n'avons pas été saisis de difficultés majeures. J'ajoute que la directive de 2009 et le règlement concernant la mise sur le marché ont été négociés sous présidence française... Le Gouvernement et les administrations avaient défendu avec beaucoup de volontarisme les intérêts de notre pays.
L'application de cette réglementation ne semble pas poser de difficultés. Les administrations utilisent et maîtrisent les mesures de sauvegarde : le mécanisme est rodé, elles connaissent les rouages pour notifier à la Commission tout problème scientifique relatif à une substance active.
C'est ce qui a été fait dans le cas du Cruiser OSR : il est possible, en cas de risque pour l'environnement et la santé, d'interrompre la commercialisation d'une substance, en informant la Commission.
Par ailleurs, pour répondre à une interrogation de votre questionnaire relative aux équipements de protection individuelle (EPI), le règlement d'application 547/2011 sur l'étiquetage des produits phytopharmaceutiques comporte une annexe qui prévoit des mesures de sécurités spécifiques pour les opérateurs : les équipements de protection individuelle sont bien pris en compte dans les textes règlementaires.
Une autre de vos questions demandait si les évaluations étaient de nature à garantir l'innocuité des substances et produits pesticides pour la santé.
L'impact sur la santé humaine fait partie des critères d'évaluation de l'AESA et de l'ANSES : c'est ce qui a conduit à l'interdiction de l'épandage aérien. Mais l'approche européenne demeure une approche par produit, non par utilisateur.

S'agissant des équipements de protection individuelle, les règles instaurées vous paraissent-elles efficaces ?
Les services de la DGAL et de la DGCCRF effectuent des contrôles à différents stades de la chaîne, du grossiste à l'utilisateur. Un rapport a récemment été publié par l'Office alimentaire et vétérinaire (OAV), qui est l'autorité de la Commission chargée de s'assurer que les États membres font bien respecter la réglementation.

Auriez-vous des propositions, des recommandations à suggérer à la mission ?
Nous ne sommes guère bien placés pour en faire. Le dialogue entre les institutions françaises et communautaires se passe bien. Des garde-fous, des alertes existent pour protéger au mieux la santé humaine et l'environnement, par exemple les abeilles. La réglementation européenne laisse une certaine latitude aux États membres, ce qui leur permet d'avoir une approche prudentielle adaptée à leur territoire.

La France est-elle plus ou moins active que les autres États ? Des réformes relatives aux pesticides sont-elles en vue au niveau européen ?
Il n'y a aucune réforme en vue. Nous sortons à peine de celle de 2009. La Commission est censée produire, en 2014, un rapport sur l'application du règlement concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques : ce sera sans doute l'occasion de revoir la réglementation. La Commission est censée publier, en 2015, un rapport sur le règlement concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides, qui conduira également sans doute à une révision.
Ces rapports sont communiqués au Parlement européen et au Conseil. Ceux-ci adoptent des recommandations. Lesquelles peuvent se traduire dans une réforme... C'est une perspective de long terme !
Nous sommes encore en train d'absorber la dernière réforme. Du point de vue technocratique, les choses fonctionnent bien. Quant à la réalité du terrain, nous ne la voyons guère, ni en amont, ni en aval...
La France fait sans doute partie des États les plus exigeants : elle dispose des capacités administratives et scientifiques nécessaires pour suivre tous les sujets, d'autant qu'elle est concernée par toutes les productions. Les États du Nord de l'Europe sont sans doute ceux qui se préoccupent le plus de l'environnement.
Il est difficile de vous répondre. De manière générale, la France n'est jamais extrémiste, et s'inscrit dans l'équilibre communautaire. Son opposition découle toujours d'une analyse raisonnée.
Audition de M. Daniel Roques président de l'association des utilisateurs et distributeurs de l'agro-chimie européenne audace et de M. Stéphane delauTre-drouillon secrétaire général
Audition de M. Daniel Roques président de l'association des utilisateurs et distributeurs de l'agro-chimie européenne audace et de M. Stéphane delauTre-drouillon secrétaire général
AUDACE a été créée en 1998 : je constatais depuis plus de vingt ans des dysfonctionnements relatifs aux produits phytopharmaceutiques en France. De nombreux États membres avaient pris des dispositions pour organiser la libre circulation, mais les fabricants français et la direction générale de l'alimentation s'y opposaient fermement. J'ai donc attaqué la France et ai eu satisfaction car le décret du 4 avril 2001 a régularisé les importations dites parallèles de produits phytosanitaires. Très vite, des organisations agricoles telles que la Coordination rurale ont estimé que nous défendions l'intérêt général de l'ensemble des utilisateurs et nous ont demandé d'élargir notre action aux médicaments vétérinaires, aux semences et à d'autres intrants ainsi qu'à tous les sujets qui constituent la vie quotidienne des entreprises agricoles.
L'association a rapidement acquis une représentativité auprès des institutions européennes. Tous les États membres, la Commission européenne, et même la FAO nous consultent. Nous intervenons partout dans le monde, jusqu'en Inde ou en Chine, pour présenter la réglementation communautaire sur les produits phytosanitaires, et celles des différents États membres - car il n'y a pas d'harmonisation complète.
Du reste, nous souhaitons que la FAO ou l'OMC - hélas compétente en matière de productions agricoles, l'Europe en sait quelque chose, je songe aux protéines animales - travaillent à l'instauration de normes internationales très strictes de fabrication, d'utilisation et d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
Depuis 1999, AUDACE demandait la révision de la directive cadre 91/414 d'harmonisation des AMM. Le programme de révision a été accepté par la Commission et, aux termes de dix années de travail, un nouveau règlement 1107/2009 est entré en application, au 15 juin 2011. Ce ne fut toutefois pas un grand succès pour nous, puisque 10 % seulement de nos propositions ont été retenues. De nombreux dysfonctionnements majeurs, dans la fabrication, la distribution ou l'utilisation, ont perduré.

Parmi vos propositions non retenues, lesquelles vous semblaient les plus importantes ?
Dans le mémorandum que nous avions adressé à la Commission en 2002 - nous vous en transmettrons un exemplaire - figurait un point essentiel sur lequel je voudrais attirer votre attention.
Conserver un système d'AMM nationales est une absurdité et une aberration. Depuis environ quarante ans que je travaille dans ce secteur, j'ai demandé à tous les ministres successifs de l'agriculture, à tous les commissaires européens, de me citer un seul produit phytosanitaire utilisé dans un pays qui ne pourrait pas l'être dans un autre. Il n'y en a pas !
C'est uniquement pour cloisonner le marché communautaire et pouvoir pratiquer des prix différents que les fabricants ont artificiellement multiplié les formulations, certaines plus nocives que d'autres, pour les applicateurs et pour les consommateurs.

Cette division du marché est-elle donc uniquement à visée commerciale ?
En France, on a longtemps mis en avant la souveraineté des États en matière de mise sur le marché. Jusqu'à la fin du siècle dernier, notre pays se considérait comme un grand pays fabricant - avec, souvenez-vous, un État-actionnaire de Roussel-Uclaf ou de Rhône-Poulenc. Au comité d'homologation de l'INRA, mon idée suscitait des réactions très vives. « La France a ses critères de sécurité alimentaire », disait-on... Le Royaume-Uni et l'Allemagne affectaient la même philosophie.
La France prétendait à tort - et j'ai osé l'affirmer, en 1996 - posséder une administration d'une exceptionnelle compétence, impartialité, indépendance à l'égard de tout lobbying. Impossible puisque l'ensemble des demandes était traité par trois personnes ! Leurs locaux du 251, rue de Vaugirard n'avaient pas besoin de murs, les piles de dossiers en tenaient lieu. Dossiers bien sûr ultra confidentiels, exposés à la vue de tous.
Certes, les choses ont changé à partir de 2000-2001, avec la création de la Structure scientifique mixte (SSM) et, surtout, le transfert des compétences à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), devenue l'ANSES.
J'avais également souligné, en 1996, que le système national servait à justifier l'existence des postes de fonctionnaires qui deviendraient inutiles en cas de création d'une AMM européenne. Ces propos étaient mal accueillis.
Oui, avec les restrictions budgétaires...
L'affaire Zera/Montedison a mis en lumière une pratique courante des fabricants : un produit était distribué sous une forme beaucoup plus toxique dans un pays, l'Allemagne en l'occurrence, qu'ailleurs. La Commission européenne a pris une décision sévère et a rappelé la firme italienne à un minimum d'éthique.
Notre mémorandum date de 2002. Des évolutions ont sans doute eu lieu depuis, mais les différences dans la composition des produits demeurent. Non pas dans la substance active mais dans les co-formulants, les adjuvants, les solvants, là où réside l'essentiel des facteurs toxiques.

Votre combat consisterait donc à obtenir que l'AMM des produits formulés - et non de la seule substance active - devienne européenne ?
Tout à fait. Or, on observe, de la part de la Commission ou du Conseil, les mêmes réticences que lorsqu'une administration refuse de reconnaître ses torts. La Commission a décidé de diviser l'Europe en trois zones (sud, médiane et nord) sur la base d'une prétendue unité de climat, de pédologie, de cultures agricoles... Le résultat est bien sûr aberrant. Les différences sont déjà très importantes entre Lille et Marseille ; que dire de celles entre la France et la Grèce, Chypre, Malte ou la Bulgarie !
Sans instituer d'AMM de zone pour autant, la Commission a adopté le principe de la reconnaissance mutuelle obligatoire par zone : une AMM obtenue à Malte s'impose à la France. Or le système d'homologation de Malte, par exemple, n'a rien à voir avec celui de la France.

Les fabricants semblent préférer une homologation française, si l'on en juge par le nombre des demandes, qui provoque un engorgement à l'ANSES.
Oui, car ils savent que la reconnaissance mutuelle, pourtant obligatoire, n'est pas appliquée. L'ANSES ne veut pas en entendre parler ! En cas de demande de reconnaissance mutuelle, elle soumet les produits à des études complémentaires, certes d'un coût moindre : 50 000 € pour une reconnaissance mutuelle contre 200 000 € pour une première homologation, mais tout de même.
Les entreprises ont plutôt tendance à demander la première autorisation en France, en Allemagne ou au Royaume-Uni, qui représentent 80 % du marché phytosanitaire européen. A lui seul, notre pays en représente 33 %. Il peut y avoir des États co-rapporteurs. Les demandeurs arbitrent entre l'excellence de l'évaluation et le coût ; ils s'adressent aussi à la Belgique, aux Pays-Bas ou aux pays d'Europe du Nord. L'ANSES se considère toutefois comme le phare de l'Europe dans ce domaine.
L'absence d'AMM communautaire nous met en porte-à-faux vis-à-vis d'autres États ayant des réglementations similaires, tels les États-Unis d'Amérique. La directive 91/414 est la traduction presque conforme de la réglementation américaine de dix ans antérieure ! Et la Commission entretient des relations permanentes avec les autorités américaines pour aller vers une harmonisation des critères et des méthodes.
Soit dit en passant, les polémiques relatives aux contrôles réalisés dans le passé sont vaines : il y a encore dix ans, on ne disposait pas d'appareils d'analyse des résidus au niveau du microgramme....

Est-ce à dire que vous rêvez d'une grande agence d'homologation européenne, voire mondiale ?
Une agence européenne, oui.
Au niveau mondial, ce pourrait être le rôle de la FAO qui définit déjà les spécificités techniques à respecter pour les produits phytopharmaceutiques. Ces exigences sont reprises par les normes de l'OCDE. Si une plus grande implication de la FAO est souhaitable, il faut aussi étendre les compétences de l'AESA (EFSA). Elle autorise déjà les substances actives, pourquoi ne serait-elle pas aussi en charge des produits formulés ? On a vu dans des affaires judiciaires récentes que la dangerosité peut provenir de co-formulants tels que le monochlorobenzène.
En général, comme Français, je détesterais l'idée de remettre la santé publique dans des mains autres que françaises ; mais dans ce cas précis, la France participe !
Ce type de préférence existe aussi chez les Allemands : de leur côté, à Hanovre l'an dernier, des représentants du ministère de l'agriculture allemand me confiaient être favorables à la reconnaissance mutuelle, dès lors qu'elle signifiait que les autres États acceptaient leurs décisions...
Plus sérieusement, les États membres participent déjà au comité phytosanitaire permanent institué auprès de la direction générale de la santé et de la protection des consommateurs (DG SANCO). Rien, absolument rien, ne s'oppose à la création d'une AMM communautaire.
Du reste, elle aurait l'avantage d'améliorer le sort des agriculteurs, aujourd'hui forcés de se muer en bureaucrates. Celui qui a le malheur de pratiquer la polyculture, l'élevage et un peu de maraîchage risque de subir, pour peu que les administrations ne se coordonnent pas, près d'une soixantaine de contrôles par an. L'agriculteur est mieux employé aux champs qu'au bureau.
Une agriculture durable suppose que l'agriculteur se consacre à l'agronomie, se concentre sur la plante, le sol. Dans ses actions de prévention auprès des utilisateurs, AUDACE a de plus en plus de mal à faire passer le message du respect de la réglementation, tant celle-ci est à la fois lourde et changeante. Pas une semaine sans un nouvel arrêté ! Les agriculteurs comprennent de moins en moins pourquoi ils devraient respecter des règles plus strictes qu'ailleurs. Comment oublier que la Cour de Luxembourg a condamné la France, qui bloquait des importations de viande bovine en provenance du Royaume-Uni, à l'époque où l'ESB y faisait rage.

Quel est votre point de vue sur les importations parallèles et la fraude ?
D'aucun considèrent que, dans la mesure où je serais le père des importations parallèles, les fraudes seraient de ma faute. Eh bien, pas du tout !
Certes, je me suis battu pendant vingt ans pour qu'un produit dûment homologué dans un État membre puisse être utilisé dans un autre. Il y a encore dix ans, les différences de prix pouvaient atteindre 40 % d'un pays à l'autre. La France a finalement reconnu ses torts et un décret du 4 avril 2001 a modifié la procédure.
Le ministre de l'agriculture de l'époque, M. Jean Glavany, m'avait adressé le projet de décret pour recueillir mon avis : le texte me semblait parfait sur la forme, mais sur le fond, nous n'en avions jamais demandé autant ! J'ai, en vain, réclamé des barrières pré-contrôles afin d'éviter les dérives... qui n'ont pas manqué de se manifester, immédiatement.
Les autorisations de mise sur le marché d'importations parallèles (AMMIP), aujourd'hui rebaptisées permis de commerce parallèle (PCP), ne donnent pas les mêmes droits que l'AMM. Or, des entreprises mafieuses se sont constituées, ont obtenu, dès 2002, des autorisations nationales grâce à des filiales qui n'étaient que des boîtes postales et ont commercialisé des produits n'ayant fait l'objet d'aucune évaluation. Ces entreprises, à partir d'une substance active homologuée en Europe, et souvent achetée en Inde ou en Chine, font formuler un produit par des formulateurs que tout le monde connaît.
Le seul droit attaché à L'AMMIP est celui de commercialiser un produit acheté au fabricant titulaire de l'AMM, certainement pas de fabriquer un produit. Mais tous ces mafieux sont issus des grandes firmes internationales, ils connaissent parfaitement l'aspect que doit avoir le produit et leurs productions sont parfois de meilleure qualité que l'original - ce qui dissuade le groupe lésé d'engager des actions en justice, par peur d'être ridiculisé. Certes si ces produits non autorisés peuvent être de bonne qualité, en revanche, un seul produit de mauvaise qualité peut entraîner des effets calamiteux sur la santé publique. Leur taux de résidus de pesticides est inconnu !
Nous avions prévu cette situation et demandé que les évaluations soient fondées non seulement sur les produits mais aussi sur la qualité des demandeurs. Dans notre secteur, des sociétés boîtes postales ne sont pas acceptables. N'ayant pas obtenu gain de cause sur ce point, nous avons, dès 2002, engagé des poursuites judicaires contre ces sociétés. Le procureur d'Arras m'ayant indiqué que la priorité de ses deux seuls juges d'instruction allait aux affaires criminelles, le dossier fut transféré au pôle de sécurité alimentaire de Paris, avant d'aboutir sur le bureau de Mme Le Goff, procureur de Marseille.
Nous voulions certes, à l'origine, que les importations parallèles deviennent licites, mais nous voulions aussi qu'elles soient encadrées. Or le système actuel autorise toujours les fraudes. Je regrette que le ministère de l'écologie n'ait pas soutenu fermement nos recommandations quant à la régulation.
Il est bien difficile de faire condamner les entreprises mafieuses : les firmes lésées sont réticentes à engager des procédures pénales, pour ne pas voir leurs secrets industriels dévoilés. Et les parquets n'ont pas les moyens d'évaluer les dangers des produits. Finalement, le parquet a sur une affaire pourtant grave, libéré une vingtaine de produits, après deux ans de procédure, au motif que, au vu des analyses chromatographiques, les courbes des produits en question étaient très similaires à celles des produits homologués. Or, de telles analyses ne disent rien de la composition et donc de la toxicité du produit !
Comme je l'ai dit à Mme Le Goff en janvier dernier, il est très difficile d'avancer sans la volonté des industriels. Eux seuls sont capables d'orienter les recherches. Sans leur aide, on est contraint de chercher dans le vague, de procéder par éliminations successives, ce qui peut coûter plusieurs millions d'euros, alors que le parquet de Marseille, le plus pauvre de France, dit-on, peine déjà à financer son fonctionnement quotidien.
On a accusé les importations parallèles de tous les maux alors que 95 % des opérateurs sont sérieux. En revanche, les 5 % de fraudeurs représentent 90 % du marché. Nous incitons nos adhérents agriculteurs à se méfier d'un prix trop bas. Une différence de 15 ou 20 % est normale, un écart de un à cinq ne l'est pas !

Dans certains départements du sud-ouest de la France, les importations parallèles représenteraient 70 % des produits utilisés...
Et le ministère de l'écologie est à 100 % responsable de cette situation. Il s'agit ici non de fraudes mafieuses mais d'achats transfrontaliers effectués par les agriculteurs. Oui, en Languedoc-Roussillon, ces importations pourraient représenter 70 % d'un marché total évalué à 30 millions d'euros. Il s'agit principalement de produits génériques achetés sous le couvert d'une AMM espagnole, qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'homologation en France ou, plus grave, de produits interdits en France mais vendus en Espagne par dérogation obtenue au motif de nécessité locale absolue. Tel a été, pendant des années, le cas de l'arsenic de sodium interdit en France depuis 2002.
Aussi avons-nous proposé que le certificat « distributeur et applicateur de produits antiparasitaires » (DAPA) soit opposable aux agriculteurs. Ceux qui se fourniraient auprès d'un distributeur sans numéro d'agrément seraient donc fautifs. Cela n'est pas possible, nous a-t-on répondu, on ne peut exiger d'un distributeur étranger qu'il soit titulaire du certiphyto. Faux, a estimé la Commission européenne, si la France l'impose à ses propres entreprises, elle a le droit de le demander aux autres. C'est ainsi que la loi de finances de juillet 2010 prévoit - enfin ! - que le numéro d'agrément doit figurer sur tous les documents émanant du distributeur, français ou étranger, en particulier sur les factures.
Il n'est toujours pas question, en revanche, de rendre cette obligation opposable aux agriculteurs. Dans le même temps, ces derniers sont soumis au paiement de la redevance pour pollution diffuse, alors qu'elle devrait être payée par les distributeurs. Tout cela est absurde. Lorsque je demande aux agences de l'eau, en charge du recouvrement, combien d'agriculteurs ont, depuis le 1er janvier 2011, déclaré devoir payer cette redevance pour avoir utilisé des produits importés, elles répondent : aucun ! Mme Odile Gauthier, directrice de l'eau, à qui j'ai fait part de mes propositions, m'a dit qu'il était trop tard pour les intégrer à la nouvelle réglementation. Pourtant, tous les problèmes liés aux achats transfrontaliers seraient réglés.
A partir de 2001, à l'initiative de son nouveau président M. Bernard Charlot, nous avons normalisé nos relations avec l'UIPP. Nous avons décidé de nous communiquer à l'avance nos positions respectives sur les différents sujets, d'essayer de gommer les désaccords... et de nous affronter uniquement sur nos divergences irréductibles.
AUDACE est la seule organisation professionnelle qui n'hésite pas à intenter des procès contre des entreprises membres de l'UIPP, comme dans l'affaire Paul François. Pour nous, il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur les entreprises du secteur, mais de dénoncer l'absence d'éthique, en l'occurrence de la part de Monsanto. Cette entreprise a prétendu devant le tribunal de Lyon n'avoir jamais connu le moindre problème avec le Lasso. Or elle a eu les pires ennuis aux États-Unis en raison de la mortalité liée à ce produit. Et son AMM lui a été retirée en Belgique en 1992. En outre, les rapports ayant permis l'obtention de la première AMM aux États-Unis dans les années 1970 étaient tronqués, voire mensongers, au point que le directeur du laboratoire a été mis en prison !
Dans d'autres domaines, comme celui des médicaments vétérinaires, les titulaires d'AMM sont soumis à une indispensable obligation d'épidémio-surveillance constante. Ils doivent déclarer tous les effets constatés non intentionnels apparus après la mise sur le marché. Pourquoi ne pas appliquer la même exigence, et au niveau mondial, ici ?
D'où la nécessité de rendre les déclarations obligatoires.
Audition de M. Dominique Bricard directeur général de nutréa de M. Michel Le friant responsable des métiers du grain caliance et de M. Joël Pennaneac'h coordinateur du pôle sécurité triskalia
Audition de M. Dominique Bricard directeur général de nutréa de M. Michel Le friant responsable des métiers du grain caliance et de M. Joël Pennaneac'h coordinateur du pôle sécurité triskalia

Merci de participer à une de nos dernières auditions. Nous sommes d'autant plus impatients de vous entendre que nous avons été alertés au sujet d'une affaire qui vous concerne lors d'un de nos déplacements en Bretagne. Sans vouloir nous immiscer dans le ou les procès en cours, nous voudrions connaître le point de vue des dirigeants des entreprises concernées, comprendre ce qui s'est passé et les leçons qui en ont été tirées. Nous nous intéressons aussi aux conditions de stockage et de nettoyage des céréales dans les grandes coopératives françaises.
Merci de nous recevoir. Vous me permettrez, en préalable, de présenter notre groupe. Je suis directeur général de Nutréa qui employait les salariés que vous avez rencontrés.
Je suis responsable des activités céréales de Caliance, union de coopérative qui commercialise les céréales de plusieurs coopératives de l'Ouest.
Non, c'est une filiale de Triskalia spécialisée dans la fabrication d'aliments pour bétail.
Triskalia a la particularité d'être une entreprise toute jeune : créée le 1er octobre 2010, elle a moins de deux ans.
Pas tout à fait, Triskalia est issue de la fusion de trois coopératives bretonnes concurrentes : Coopagri Bretagne, dont l'histoire a commencé en 1911, Eolys et la coopérative des agriculteurs du Morbihan, la Cam 56. La collecte de céréales est réalisée par Triskalia et la commercialisation réalisée par une union de coopératives.
De Bretagne et de Mayenne.
Aucune.
Nous importons seulement dans l'alimentation.
Triskalia exerce trois grands métiers : d'abord, l'agriculture, où elle exerce une activité de conseil de vente de produits, ainsi que la collecte des céréales et d'autres produits agricoles : légumes frais, légumes surgelés, légumes pour la conserve appertisée, bref, toutes les productions liées aux productions végétales ; ensuite, l'agro-alimentaire, qui regroupe les productions bretonnes : lait, boeuf, porc, oeufs, légumes frais ou transformés. Enfin, Triskalia exerce une activité de distributeur grand public avec notamment les enseignes Gamm Vert, Magasin Vert, Point Vert... Parallèlement à ces trois pôles, elle dispose d'un laboratoire d'analyse, Capinov, qui s'est spécialisé dans la sécurisation des productions de la coopérative : conseil en amont pour les analyses de sol, sécurisation des produits mis sur le marché par les filiales agro-alimentaires. Ce laboratoire mène des analyses très poussées notamment sur les résidus de pesticides.
Cinquante, essentiellement des scientifiques.
Elles sont effectuées en fonction du plan de contrôle des différentes filiales et à la demande des producteurs ; nous intervenons en amont, pour sécuriser la production des agriculteurs, et en aval, lors de la mise sur le marché des produits agricoles.

Le contrôle des céréales est-il également effectué pour l'alimentation animale ?
Oui, toujours par Capinov.
Une autre particularité de Triskalia réside dans son fonctionnement très démocratique, avec 400 producteurs élus issus de tous les métiers de la coopérative pour représenter les 18 000 agriculteurs adhérents, et une organisation verticale par filières (animale, végétale...). Chaque section spécialisée possède son propre conseil d'administration : ainsi, le président de la section céréales fait vivre, avec vingt-quatre élus, l'activité céréales. Les 400 élus représentent donc verticalement les filières et horizontalement le territoire. A leur tête, le président de Triskalia, M. Denis Manac'h. L'organisation du groupe doit-elle évoluer ? C'est aux agriculteurs d'en décider.
Concrètement, Triskalia regroupe 18 000 agriculteurs, compte 4 200 salariés équivalent temps plein et représente 300 sites en Bretagne, du petit point de collecte au grand Magasin Vert.
La chance de la Bretagne est sa grande diversité d'activités.
La sécurité est un processus totalement intégré au quotidien dans toutes nos organisations. Nous faisons nôtre le principe de l'amélioration continue, type roue de Deming : planification, mise en oeuvre, vérification, éventuellement réaction. Dans notre gestion de risque, nous allons toujours de l'amont jusqu'à l'aval ; si nous ne pouvons supprimer le risque, nous le diminuons, nous l'évaluons pour mettre en place des protections collectives, bien sûr, mais aussi individuelles in fine. En termes d'organisation, chaque manager est responsable de la sécurité au sein de son activité. Enfin, il existe un pôle sécurité.

Le cadre est donc à la fois responsable de son économie locale et de sa sécurité.
Le pôle sécurité apporte son expertise sur la protection des personnes et des biens. Il dépend de la direction des ressources humaines et de la communication et a mis en place de nombreux partenariats, notamment avec les pompiers. Autre point fort de Triskalia, elle compte cinq CHSCT, un par direction opérationnelle et un pour l'ensemble des fonctions support. Chaque CHSCT est composé de représentants du personnel, d'un représentant de l'inspection du travail, d'un médecin du travail et d'un préventeur de la MSA et est présidé par le directeur de la direction opérationnelle, le CHSCT des fonctions support étant présidé par le directeur des ressources humaines. Les CHSCT s'occupent de protection de la santé et d'amélioration des conditions de travail, par exemple en termes d'environnement, d'aménagement des postes, de durée et horaires du travail. Dans un monde qui va de plus en plus vite, ils s'occupent aussi de l'impact des nouvelles technologies sur nos activités. Ils sont également consultés sur les actions de travail et sur les projets d'entreprise : chaque année, ils doivent valider le plan d'investissement annuel.
Nous avons donc trois éléments forts, manager, pôle sécurité et CHSCT, qui travaillent main dans la main. Vous trouverez dans le rapport que je vous ai remis quelques chiffres sur les accidents de travail, en taux de fréquence et en taux de gravité, et sur la formation.
Le taux de gravité est le rapport entre le nombre de jours d'arrêts de travail et le nombre d'heures travaillées. Ce chiffre est inférieur à la moyenne nationale des autres industries. Le taux de fréquence calcule le nombre d'accidents par rapport au nombre d'heures travaillées. Nos taux sont bien en deçà des moyennes nationales.
Notre budget formation représente 3,38 % de la masse salariale, le double de l'obligation légale, avec un quart des formations liées à la sécurité. Dans le cas particulier des métiers du grain, dix-huit responsables de silos viennent de recevoir une formation aux bonnes pratiques de conservation des céréales et de sécurité par Coop de France et des intervenants internes.

Si nous comprenons bien la chronologie, Nutréa-Triskalia a racheté une coopérative qui avait des pratiques particulières ?
Coopagri Bretagne était le plus important des trois groupes...
En 2009, il y avait, d'une part, Coopagri et, d'autre part, Unicopa, qui regroupait notamment Eolys et Cam 56. Coopagri, Eolys et Cam 56 ont fusionné en octobre 2010 pour devenir Triskalia. Dans le groupe Unicopa, les activités aliment du bétail ont été reprises par Coopagri Bretagne et Terrena pour former le nouveau Nutréa, le 1er janvier 2010.

Quand ont eu lieu les incidents rapportés par les salariés rencontrés par la mission ?
En 2009, et ils ont concerné Eolys pour la partie collecte et UCA pour la fabrication d'aliments.
Non, nous étions Coopagri Bretagne. Mais nous pouvons en parler, car les salariés concernés ont été transférés dans le nouveau Nutréa.
Nutréa. Ils ont été déclarés inaptes au travail à l'été 2010 après avoir refusé leur redressement puis licenciés. En septembre 2011, des procédures sociales et pénales ont pris le relais.

Ces salariés déclarent avoir dû utiliser des produits non autorisés. Vous êtes-vous interrogés sur une possible contamination des lieux traités avec ces produits ?
Ces salariés n'ont pas manipulé de produits chimiques ; ils étaient chargés de la réception des céréales et c'est à ce moment qu'ils ont été potentiellement indisposés par des poussières pouvant contenir des pesticides. A aucun moment ils n'ont manipulé de pesticides.
Des procédures sont en cours. Encore une fois, ces salariés ex-UCA ont ressenti des troubles lors des opérations de transfert et de réception des céréales.
Il faut distinguer la partie stockage et la partie usine. La particularité du site de Plouisy est qu'il contenait une partie stockage et collecte et une partie fabrication des aliments où travaillaient les deux salariés en question. Cette partie, que je préside, a fait l'objet de nombreuses transformations que je vous détaillerai, mais je laisse M. Michel Le Friant nous présenter la partie stockage et collecte.
La collecte est réalisée en Bretagne par type de produits (blé, orge, sarrasin...). Les céréales qui nous parviennent peuvent être sèches ou humides. Triskalia collecte au total 750 000 tonnes de céréales auprès de producteurs généralement petits (le producteur moyen apporte à Triskalia 80 à 90 tonnes : 20 tonnes de blé, 30 tonnes de triticale, 5 tonnes de sarrasin...) et doit les répartir en fonction de leur humidité sur les bons silos : si les graines sont humides, le passage au séchoir est nécessaire. Notre métier consiste à placer ces céréales au bon endroit pour les conserver. Nous avons deux cents points de collecte et quarante-huit sites de stockage aux capacités très différentes : vingt-neuf sites de proximité, avec une capacité inférieure à 5 000 tonnes, recueillent 53 000 tonnes et ne disposent que de deux séchoirs ; treize sites, avec une capacité comprise entre 5 000 tonnes et 20 000 tonnes, recueillent 124 000 tonnes et disposent de six séchoirs ; enfin six sites, avec une capacité supérieure à 20 000 tonnes, recueillent 241 300 tonnes et disposent de cinq séchoirs. Mais seuls certains sites sont équipés d'appareils de désinsectisation, les pompes doseuses pour traiter les grains.
Ces pompes doseuses sont utilisées pour positionner l'insecticide sur le grain.
J'y viens. On compte sept pompes doseuses pour les vingt-neuf petits sites, autant pour les treize sites de taille moyenne et quatre pour les six plus gros sites.
Le séchoir de l'usine Nutréa du site de Plouisy appartenait à Eolys. Aujourd'hui Plouisy n'est plus équipé et c'est Nutréa qui est prestataire de séchage pour le compte de Triskalia.
En ce qui concerne les débouchés des céréales, 72 % vont à l'alimentation animale, le reste étant soit exporté, soit livré aux industries ou aux meuneries. Une grosse partie de la collecte est directement livrée aux éleveurs adhérents de Triskalia.
Le travail des céréales dépend largement de l'âge et de la configuration de chaque site, qui sont très variables. Aujourd'hui, les opérations de nettoyage constituent la clé de voûte de leur bon fonctionnement. On nettoie les silos lorsqu'ils sont vides ; lorsqu'un site a été pollué, par exemple par des charançons, des sylvains ou des capucins, on le désinsectise à vide. Un prestataire extérieur applique de l'insecticide sur les parois : un mur de béton comportent des petits trous où les charançons peuvent se cacher. Mais toutes les précautions sont prises pendant les opérations de nettoyage, et la désinsectisation n'est réalisée, fin mai ou début juin, qu'une fois le nettoyage effectué.

Cela signifie-t-il que, lorsqu'on remplit le silo à nouveau, les parois sont pleines d'insecticide ?
Les prestataires extérieurs travaillent en bonne et due forme : les parois ne sont pas pleines d'insecticides. Le produit est pulvérisé, sans utiliser d'arrosoir ! Grosso modo, 95 % de la collecte étant faite à la moisson : les charançons ne viennent donc pas des récoltes.
On commence par nettoyer le silo quand il est vide.

Combien de temps s'écoule-t-il entre la pulvérisation du silo et le stockage ?
Un minimum de quinze jours, car le prestataire intervient en juin et on collecte fin juillet. En moyenne, il s'écoule plutôt un mois.
Cette année, nous avons eu recours à Farago. Ce sont des sociétés spécialisées dans la lutte contre les nuisibles qui ont pignon sur rue.
On n'utilise plus de DDT ; les produits actuels sont homologués, utilisés aux doses homologuées, et sans rémanence.

Peut-être n'avez-vous jamais utilisé de produits interdits, mais je crois savoir qu'il n'en a pas été de même pour Eolys...
C'était du dichlorvos. Eolys a utilisé ce produit référencé en 1985 début 2009 alors qu'il a été retiré du marché en 2008.

Cela signifie que vous utilisez des bâtiments aspergés naguère de produits interdits : peut-on imaginer que ces lieux de stockage soient peut-être contaminés ?
Le dichlorvos agissait par vapeur et son efficacité était immédiate. Il était donc parmi les plus utilisés, notamment parce qu'il pouvait être utilisé au moment de l'expédition des céréales. Avant 2008, on pouvait consommer les céréales traitées pour l'alimentation animale ou pour l'export au bout de 72 heures.

N'existe-t-il aucune réglementation ni aucun contrôle sur la contamination des lieux de stockage ?
Il faudrait que les pesticides soient utilisés à l'excès.
Dans le plan de contrôle que nous réalisons en tant que collecteurs, nous recherchons dans les céréales mises sur le marché les résidus des produits utilisés dans une analyse multi-molécule.
Oui, mais ce pourrait être un autre... Nous avons une confiance totale dans ses résultats. Notre plan de contrôle nous sécurise sur l'absence de résidus.

N'y a-t-il jamais eu d'accident concernant des animaux ayant ingurgité des pesticides via leur alimentation ?
Pas à ma connaissance. Il arrive seulement qu'on trouve des traces d'un insecticide sur du colza passé dans un silo ayant été traité, alors même que le colza n'a pas d'insecticide référencé. Dans ce cas, les doses sont très faibles, mais c'est la preuve que les graines de colza peuvent être contaminées par contact lors du stockage ou du convoyage.
Elles sont demandées par nos clients.

Cela était-il en place du temps d'Eolys, sur le site, au moment des incidents ?
Je n'ai pas les éléments de réponse à cette question.

Et qu'en est-il du port des équipements de protection individuelle (EPI) ? Je crois que du temps d'Eolys, les salariés ne les utilisaient pas systématiquement...
Il est difficile d'en parler car nous n'y étions pas. Aujourd'hui, quand un produit est utilisé, il suffit de consulter sa fiche de données de sécurité qui comporte seize points ; le point 8 signale les équipements de protection individuelle à porter.
C'est important qu'ils le soient.

Dans un courrier du préfet des Côtes d'Armor, en date du 18 juillet concernant l'entreprise Nutréa, il est noté que l'inspecteur du travail « a eu l'occasion de constater en 2010 et 2011 l'absence de port d'EPI par des salariés, malgré la consigne donnée par l'entreprise en mai 2009 d'utiliser ces EPI ». Cet inspecteur a également constaté « l'utilisation de masques inadaptés (absence de protection des yeux). Cette constatation a donné lieu à une mise en demeure de l'entreprise de fournir des EPI adaptés et d'établir une consigne d'utilisation de ces équipements ». Il y a quand même un souci avec les EPI !
Des audits ont constaté que les EPI étaient disponibles et utilisés.
Je ne m'exprime qu'au sujet de Triskalia à compter d'octobre 2010.
Il n'existe pas de risque pesticides en tant que tel, mais un risque poussières. En 2011, les consignes ont été rappelées aux salariés. Certains salariés, c'est vrai, ne portent pas d'EPI, désagréables à porter ; de plus, ils réceptionnent des céréales, pas des produits chimiques...
En majorité de Bretagne, mais elles sont aussi importées, d'Ukraine par exemple.
Oui, elles arrivent directement par bateau.
Non. Elles font l'objet de plans de contrôle, mais on n'y a pas trouvé trace de produits interdits depuis deux ans.
Oui, sur la base des contrôles effectués conformément à la réglementation.
Dans ce cas, elles sont refusées.
Tous les acheteurs les refusent.
Lorient, Brest, Saint-Malo...
Non : le traitement a lieu dans les pays exportateurs. Il existe aussi dans les bateaux un système de protection par gaz.

Vous pouvez donc refuser un produit si vous découvrez des insectes après avoir ouvert la cale ?
Pas individuellement. C'est l'association Qualimat regroupant les fabricants d'aliments qui a mis en place des procédures de contrôles.
Oui.
Grâce à nos pompes doseuses, nous avons les moyens de traiter 56 % de la collecte de Triskalia. En fait, en 2012, nous n'avons traité que 95 900 tonnes, soit 23 % des céréales stockées. Si la céréale passe au séchoir, - le four est un insecticide - il ne sert à rien de la désinsectiser. Si le produit rentre dans un site dangereux, avec un historique de pollution, on désinsectise à titre préventif lors de la réception des céréales.
Sur le site de Plouisy, les céréales sont systématiquement désinsectisées, à l'exception de celles envoyées à notre prestataire séchoir, Nutréa.
La clé de voûte du système est la ventilation. Les céréales arrivent après la moisson, à une température de 20° à 30°C et à moins de 15 % d'humidité. L'objectif est de les amener, le plus vite possible, en dessous de 12°C, pour éviter la propagation ou le déplacement des insectes. En Bretagne, nous avons un handicap : les hivers sont doux. Il est plus facile d'abaisser la température des céréales en Mayenne ! Pour détruire les insectes, l'idéal est d'atteindre 5°C.

Qu'est-ce qui a changé sur le site de Plouisy depuis la reprise de la coopérative ?
Grâce aux procédures Triskalia, les pratiques de collecte et de stockage ont évolué. On ne traite plus les céréales en urgence en sortie. Les traitements sont préventifs, à la réception. Ce qui s'est passé à Plouisy est lié à cette problématique. Concernant Nutréa, j'ai eu connaissance des événements mi-2010 alors que nous étions en pleine réorganisation. Nous avons néanmoins mis en place un groupe de travail pour comprendre ce qui s'était passé et fait appel au bureau Véritas. L'objectif était de réaliser un arbre des causes et de mieux évaluer les risques à gérer.
Pour nous, il s'agit d'un risque poussières, pas nécessairement poussières de pesticides, mais poussières au sens large : poussières de céréales, poussières de protéines, poussières de minéraux, poussières de micro-toxines... Ce risque peut être supprimé en amont en mettant en place des cahiers des charges sur la qualité des céréales à la réception, ou réduit grâce à des investissements.
C'est ce que nous avons fait à Plouisy où plus d'1 million d'euros ont été investis en 2012 pour refaire les automatismes et l'électricité afin d'éviter au maximum la présence de salariés en zone sensible. Des mesures de poussières et d'exposition ont été réalisées à la réception et à l'expédition des marchandises, avant et après les travaux. Des bureaux ont été déplacés, le poste commande de la partie réception a été mis en surpression, les caleçons sont systématiquement utilisés pour décharger les camions, les vestiaires ont été déplacés, des zones de ventilation ont été mises en place à la réception... Tout devrait être terminé en octobre.
Pas depuis 2010. Les salariés touchés à cette époque sont suivis.
Non. Nous avons bien sûr également pris des mesures de protection lors des opérations de nettoyage. Et nous avons mesuré, toujours avec Véritas, le taux de charge des poussières. A condition de porter le masque, il est inférieur aux normes. Un gros effort de formation a également été réalisé. Il a été insisté sur l'obligation de porter le masque.

Vos céréales servent-elles essentiellement à l'alimentation des animaux ?
Nous en vendons surtout pour les poules pondeuses ; nous commercialisons environ un milliard d'oeufs, sur les quatorze milliards d'oeufs consommés en France. Nous fabriquons également des aliments pour les porcs, les ruminants, le lapin, mais aussi pour d'autres animaux, dont ceux de compagnie.

Vous avez beaucoup investi ; le site était-il en retard ? D'autres sites présentent-ils les mêmes risques ?
Depuis le 1er janvier 2012, nous avons investi 10 millions à Plouizy et à Languidic ; nos sites seront à niveau fin 2012.
La répartition des tâches était différente.
Lors du démarrage de Nutréa, il a fallu assurer la survie de l'entreprise, tout en se préoccupant, bien sûr, de la sécurité des produits et des salariés. L'un de nos objectifs, maintenant, est de rendre nos sites exemplaires en matière de risque.
Moi, non.
Moi, oui : nous collectons des produits bio et nous les commercialisons auprès de fabricants d'aliments spécialisés dans le bio.
En bio, le principal insecticide, c'est le séchoir. En revanche, il nous arrive d'avoir recours à des insecticides homologués par la filière bio, mais qui contiennent du pyrèthre : c'est arrivé récemment à Loudéac.

Merci de préciser que ce n'est pas parce que c'est bio que ce n'est pas traité.
Oui, mais en suivant les préconisations de la filière.
Dr. Vincent Peynet. - Merci de me recevoir.
Notre entreprise, créée en 2010, effectue des analyses de pesticides à partir des cheveux. C'est le concept du Home testing : il suffit de commander un kit d'analyse sur Internet. Les prélèvements effectués sont envoyés à notre laboratoire qui procède aux analyses dans les quinze jours et les rend disponibles sur Internet. Notre objectif est de rendre accessible au plus grand nombre des méthodes qui étaient jusqu'à présent réservées aux seuls professionnels. Ces analyses coûtent assez cher, car les appareils qui permettent d'y procéder sont onéreux. Divers laboratoires et certaines professions agricoles ont fait appel à nous. Nous souhaitons développer ces outils afin de prévenir les risques professionnels. Les pesticides sont présents dans la nourriture, l'eau, les produits de jardinage, les insecticides mais aussi les épandages agricoles : ils sont absorbés par inhalation, contact cutané ou ingestion. Lors de nos analyses, nous recherchons quarante-trois composés.
Pourquoi chercher des pesticides dans les cheveux ? Les composés chimiques absorbés par l'organisme sont véhiculés par le système sanguin et les cheveux incorporent les composés chimiques présents dans le sang. Les cheveux poussant d'un centimètre par mois, il est possible de retracer sur une durée d'environ trois mois l'exposition de l'organisme aux composés chimiques, qu'il s'agisse d'une exposition chronique ou ponctuelle. L'avantage de cette méthode par rapport à un prélèvement sanguin est qu'elle n'implique pas la présence d'un personnel médical qualifié. De plus, la conservation et le transport des échantillons sont aisés. Enfin, la présence de toxine dans les cheveux est presque illimitée puisque l'on a pu déceler l'intoxication à la cocaïne de momies mayas ou encore celle à l'arsenic de Napoléon.
Nos kits se vendent de plus en plus et nous en proposerons un conçu pour les viticulteurs en décembre. Nous espérons qu'il sera proposé par les médecins et par la MSA.
Nous n'en sommes pas là. Un kit coûte 99 € pour un particulier et 169 € pour un professionnel. Si une personne veut être suivie sur une année complète, il suffit de procéder à quatre prélèvements. Il va de soi que nos tarifs diminueraient si nous passions des accords avec la MSA ou la médecine du travail.
Chaque kit est rattaché à un identifiant unique pour préserver l'anonymat et les résultats sont disponibles une dizaine de jours après l'envoi de l'échantillon.
Notre kit a été commercialisé à partir d'avril 2011 ; nous comptons un millier de clients, surtout des particuliers. L'analyse se passe de la manière suivante : les cheveux sont découpés en segments de un à deux millimètres. Après centrifugation, le surnageant est prélevé pour être analysé par chromatographie couplée à une détection par spectrométrie de masse.
En outre, nous avons procédé à une campagne de mesure : plus de quatre-vingts prélèvements ont été effectués en métropole et en outre-mer pour rechercher les quarante-trois composés. Nous avons trouvé du Dicamba, qui est un herbicide, dans 83 % des échantillons, avec une concentration importante. De même, de l'acide nonanoïque et du MCPA, qui sont tous deux des herbicides, ont été retrouvés dans, respectivement, 86 et 61 % des échantillons. Cette étude a permis aussi de trouver dans près de 78 % des cas du pentachlorophenol - interdit, cancérogène possible et perturbateur endocrinien -, utilisé comme insecticide et fongicide, du mecoprop et du fipronil dans 58 et 75 % des échantillons.
Tous ces composés ont des effets variables sur la santé : ils peuvent être cancérogènes, perturbateurs endocriniens, reprotoxiques ou mutagènes. La plupart des données sur les pesticides proviennent des producteurs eux-mêmes et sont assez anciennes, mais nous commençons à disposer de données plus récentes et indépendantes.
Cette campagne de mesure, qui n'était pas anonyme, nous a permis de constater la présence de pesticides dans tous les prélèvements - urbains et ruraux confondus - la médiane se situant à onze, le minimum à un et le maximum à vingt-trois. Notre étude n'a porté que sur quarante-trois pesticides dont 25 % ont été retrouvés et nous ne saurions dire si elle reflète la réalité ou si elle ne montre que la partie émergée de l'iceberg. Nous souhaiterions la poursuivre, notamment pour la chlordécon outre-mer.
Notre société met en place une base de données qui recense les produits utilisés par chaque profession, ce qui nous permettra de savoir s'il y a des différences d'intoxication entre les professionnels et les particuliers.
Notre projet Batitox sur les pesticides dans les habitations est financé par la région Alsace et la communauté urbaine de Strasbourg : nous proposons une méthodologie simple pour évaluer et prévenir l'exposition aux polluants. De même, nous avons noué un partenariat avec le Dr. Eric Benbrik, responsable de l'unité de consultation de pathologies professionnelles et environnementales (UCPPE) du CHU de Poitiers.
Nous souhaiterions lancer une campagne test avec la MSA, mais nous ne sommes pas parvenus à nouer de contacts jusqu'à présent : le milieu professionnel agricole semble avoir du mal à franchir le pas.
Nos rapports comportent trois parties : d'abord, un bilan, avec la liste des substances qui ont été décelées ; ensuite, des fiches détaillées pour chacune des substances trouvées lors de l'analyse ; enfin, des conseils pour minorer l'exposition future aux pesticides, comme de laver les fruits et légumes au vinaigre blanc afin de mieux dissoudre les substances toxiques. Nous sommes bien conscients que ces rapports sont anxiogènes.
Pour établir un bilan annuel de l'exposition aux pesticides, deux méthodes sont disponibles : la nôtre, avec quatre prélèvements pour un coût total de 400 €, ou bien cinquante-deux prélèvements sanguins, chacun coûtant entre 60 € et 80 €, soit un coût total supérieur à 3 000 €.