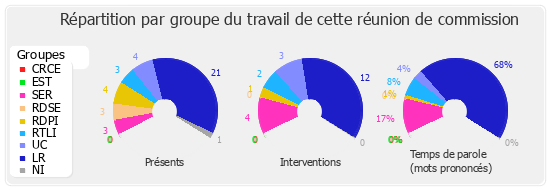Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
Réunion du 7 octobre 2015 à 9h38
Sommaire
- Loi de finances pour 2016
- Ratification du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac
- Approbation de l'accord relatif aux mesures du ressort de l'etat du port visant à prévenir contrecarrer et éliminer la pêche illicite non déclarée et non réglementée
- Approbation de l'amendement à la convention sur l'accès à l'information la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement pris par décision ii-1 adoptée dans le cadre de la deuxième réunion des parties à la convention
La réunion
La commission examine le rapport d'information de M. Robert del Picchia et Mme Josette Durrieu, co-présidents du groupe de travail sur « les relations avec la Russie : comment sortir de l'impasse ? ».

Ce groupe de travail a évolué dans sa composition et je salue le travail de Robert del Picchia, co-président, et de Gaëtan Gorce, qui a également beaucoup travaillé avec nous, ce dont je le remercie.
Le sujet qui nous était proposé concernait le thème des relations avec la Russie, et le fait de savoir comment sortir de l'impasse. Il s'agit d'un sujet particulièrement mouvant ; il est assez difficile de suivre les développements de l'actualité tout en se focalisant sur l'essentiel.
Selon notre premier constat, nous nous sommes enfermés dans une situation de blocage de façon quelque peu dommageable. La crise ukrainienne, survenue il y a un an et demi, a profondément modifié le cadre de nos relations avec la Russie. C'est toujours vrai aujourd'hui, même si la Syrie prend le dessus dans l'actualité. Les événements d'Ukraine ont une importance qu'il ne faut plus perdre de vue.
Après la Géorgie en 2008, avec l'affaire ukrainienne et l'annexion de la Crimée, c'est un État membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU qui a ouvertement violé la souveraineté et l'intégrité d'un autre État au coeur du continent européen, désavouant ainsi tous les engagements internationaux qu'il avait pris : la charte de l'ONU et l'acte final d'Helsinki qui garantissent l'inviolabilité des frontières, le traité de Minsk du 8 décembre 1991 qui organise la succession de l'URSS, le mémorandum de Budapest du 5 décembre 1994 qui garantissait à l'Ukraine l'intangibilité de ses frontières en échange de sa dénucléarisation...
Pour les pays occidentaux, cette crise a marqué un tournant stratégique : la Russie, qu'ils avaient jusqu'alors considérée comme un partenaire, ne pouvait plus l'être. Avec la crise syrienne, elle semble même constituer une menace pour la stabilité du Moyen-orient, dont elle a changé la donne diplomatique en se positionnant au centre du jeu.
La rapidité de la Russie à renverser sa stratégie lui donne l'avantage. Force est de constater qu'avec Vladimir Poutine, les États-Unis, l'Europe et la France ont parfois manqué de perspicacité et de clairvoyance, tout en faisant parfois preuve d'une certaine complaisance et en faisant des concessions, expression d'une faiblesse inopportune.
La coopération est-elle encore possible aujourd'hui ? Oui, mais peut-être pas l'alliance.
Certains ont parlé, à propos de l'Ukraine, de « surprise stratégique », dans la mesure où, préoccupés par d'autres crises dans le monde, du fait d'un moindre intérêt porté depuis plusieurs années à la Russie, ou encore du fait de situations mal analysées, acceptées puis abandonnées, qui se sont transformées en conflits gelés - Transnistrie en Moldavie, Abkhazie en Géorgie - nous n'avions pas vu venir cette crise.
De fait, le mouvement s'est amorcé inéluctablement depuis une dizaine d'années : la Russie avance ses pions ! L'objectif de sa stratégie est de conforter son espace et d'affirmer sa place sur la scène internationale.
Vladimir Poutine est l'homme qui colle aux opportunités et aux événements, et sanctuarise toute situation nouvelle, devenue irréversible. L'histoire est ainsi réécrite. Son discours de Munich, en 2007, était annonciateur de cette stratégie. La Russie s'inscrit dans une démarche de remise en cause de ce qu'elle perçoit comme un ordre mondial injuste, qui lui aurait été imposé par les pays occidentaux, et notamment les États-Unis, depuis la fin de la guerre froide.
Est-il trop tard pour inverser l'ordre des choses ? La Russie a aujourd'hui reconquis une force relative et une place évidente.
La Russie a en effet été profondément marquée par ce qu'elle a ressenti comme un triomphalisme occidental durant les années 1990, alors qu'en proie à des difficultés économiques, politiques et sociales, elle n'était plus en mesure de tenir son rang et d'imposer sa voix dans le jeu international. Les élargissements successifs de l'OTAN à l'Est, les bombardements de l'Alliance atlantique en 1999 contre la Serbie, sans autorisation du Conseil de Sécurité de l'ONU, l'expédition américaine en Irak en 2003, de nouveau sans l'aval du Conseil de sécurité, le soutien américain aux « révolutions de couleur » qui se multiplient entre 2003 et 2005 dans les pays de l'espace post-soviétique, sont pour elle des manifestations de ce qui est à ses yeux « l'hégémonie occidentale », qu'elle entend contester en faisant valoir le respect du droit international, qu'elle viole par ailleurs en avançant de faux arguments pour se justifier : Transnistrie, Géorgie, Ukraine, où elle affirme l'existence d'un coup d'État, en développant sa propagande en ce sens.
C'est largement sur ce sentiment d'avoir été mise sur la touche et traitée en vaincue de la guerre froide que la Russie de Vladimir Poutine va fonder, à partir des années 2005-2006, son retour dans le paysage stratégique, avec l'ambition d'affirmer l'indépendance et la souveraineté de la Russie.
Cette politique prend différentes formes : volonté de resserrer les liens avec l'espace post-soviétique, notamment par le lancement, en 2010, d'un projet d'intégration économique, opposition aux interventions occidentales unilatérales dans les pays souverains, en particulier en Syrie, en 2011, lancement d'une diplomatie multipolaire en direction des BRICS, avec lesquels elle entend fonder un nouvel ordre mondial, diplomatie énergétique agressive qui ne trouve, en face d'elle, qu'une absence absolue de politique énergétique en Europe - la rente énergétique étant le socle du redressement économique du pays - affichage de revendications territoriales en Arctique, développement, enfin, d'une politique d'influence et de rayonnement, un soft power russe, dont les jeux olympiques de Sotchi, en février 2014, auraient dû constituer le point d'orgue s'ils n'avaient été -logiquement- ternis par le début de la crise ukrainienne.
Il faut également évoquer la restauration des capacités militaires russes, permise par une augmentation considérable du budget alloué à la défense, qui a plus que doublé depuis 2009. Cet effort a permis une modernisation des forces, surtout de la dissuasion et des forces spéciales, l'amélioration de leur intégration et l'augmentation du niveau d'entraînement.
Soulignons que 470 milliards d'euros devaient être consacrés sur la période 2011-2020 au programme fédéral d'armement. Avec un budget de défense représentant 4,3 % du PIB, la Russie s'est ainsi hissée au troisième rang mondial derrière les États-Unis et la Chine pour les dépenses militaires.
Après le sommet de Bucarest, à l'occasion duquel les États-Unis voulaient donner à l'Ukraine et à la Géorgie une perspective d'adhésion au traité de l'Atlantique Nord, Moscou a voulu mettre un coup d'arrêt à l'expansionnisme de l'OTAN, qu'elle perçoit avant tout comme une stratégie délibérée de refoulement de la Russie le plus à l'Est possible de l'Europe.
Il importe de bien mesurer combien l'avancée de l'OTAN vers ses frontières est considérée par la Russie comme une menace directe à sa sécurité, et comme la poursuite d'une stratégie de guerre froide visant à la maintenir dans un état de faiblesse alors que, précisément, elle cherche à se relever de l'humiliation subie en réaffirmant son influence dans l'ancien espace post-soviétique.
Malgré tout, la communauté occidentale avait fait le pari de poursuivre des relations partenariales avec la Russie, symbolisées par la politique de reset lancée par Barack Obama et, en ce qui nous concerne, par le contrat de vente des BPC Mistral signé en 2011.
Ainsi, la crise ukrainienne n'est que l'un des symptômes de cette dégradation des relations. Elle manifeste la volonté de la Russie d'empêcher l'Ukraine de se rapprocher de l'Union européenne et, sans doute aussi, de l'OTAN. Aux yeux de Moscou, la situation comportait en effet un risque de ralliement de l'Ukraine à l'Alliance et posait le problème de la Crimée, qui abrite la base de Sébastopol et lui offre un accès à la Mer Noire. Les dirigeants russes n'ont pas souhaité courir un tel risque.
Leur positionnement actuel en Syrie et au Moyen-Orient modifie l'équilibre des rapports de force et fait de nouveau de la Russie une puissance centrale. Dans ces conditions géopolitiques nouvelles et évolutives, quelle coopération, quel partenariat avec la Russie ? N'oublions qu'en Syrie comme ailleurs, la solution sera politique.

Comment avons-nous pu arriver à une telle dégradation de nos relations avec la Russie? Notre constat est que nous avons échoué à ancrer la Russie dans l'Europe.
L'histoire récente avait pourtant montré plusieurs moments favorables à un rapprochement de l'Europe et de la Russie : les premières années d'après-guerre froide où la Russie met en avant le concept gorbatchévien de « Maison commune européenne », le début des années 2000, avec le lancement des « quatre espaces de coopération » entre l'UE et la Russie et le développement de leurs relations économiques, les années de la présidence de Dmitri Medvedev, enfin, durant lesquelles l'UE et la Russie tentent de passer un accord de partenariat stratégique avant d'adopter l'approche souple du « partenariat pour la modernisation ».
Malgré ces tentatives, les sujets de mésentente se sont accumulés contribuant à créer une incompréhension mutuelle entre la Russie et l'Europe : critiques européennes sur la situation des droits de l'Homme en Russie qui agacent Moscou, déception de Bruxelles vis-à-vis du durcissement du régime russe et de l'absence de modernisation économique, multiplication des contentieux dans le domaine énergétique, volonté de l'UE d'imposer à la Russie ses normes et ses standards...
Ce malentendu s'est cristallisé, de manière assez tardive, sur la politique du Partenariat oriental qui, avec le recul, s'est révélée d'une grande maladresse à l'égard de la Russie. Lancée en 2009 par des pays de la « nouvelle Europe » (Suède, Pologne, Etats baltes) et conduite par l'équipe qui avait travaillé à la dernière vague d'élargissements, cette initiative laissait la Russie à l'écart, alors même que les négociations sur un nouvel accord entre elle et l'UE s'enlisaient. La Russie l'a perçue comme une tentative d'arracher les pays du voisinage commun, notamment l'Ukraine, pièce maîtresse de sa future Union eurasiatique, à son influence, particulièrement à partir du moment où il est apparu que ces pays devaient choisir entre elle et l'UE. Faute d'arbitrage et d'évaluation préalable de ses conséquences, cette politique a reposé sur des ambiguïtés, qui ont suscité des faux espoirs et peut-être aussi des craintes injustifiées.
C'est au fond un peu le même reproche que l'on peut faire à la politique européenne vis-à-vis de la Russie : sans doute du fait de leurs divisions, les pays européens n'ont pas discuté depuis des années de ce que pourrait être la relation de l'Europe avec ce pays et envisagé la manière dont ils pouvaient inclure celle-ci dans une stratégie de développement et de sécurité.
Et la France dans tout cela ? La France a longtemps eu, c'est un fait, une relation particulière avec la Russie, reposant sur une amitié ancienne, sur l'héritage gaullo-mitterrandien et sur un certain nombre d'identités de vues concernant par exemple le multilatéralisme et le rôle du conseil de sécurité de l'ONU, l'émergence d'un monde multipolaire et la limitation de l'interventionnisme américain. Pour la France, enfin, la sécurité du continent a toujours impliqué que la Russie soit arrimée à l'Europe, c'est en ce sens par exemple qu'elle a défendu à plusieurs occasions un rapprochement OTAN-Russie. Cette relation particulière s'est cependant étiolée ces dernières années pour des raisons diverses. Côté français, ont sans doute joué la déception ressentie à l'égard du raidissement du régime russe, entraînant une dégradation de l'image de la Russie dans la presse... Côté russe, l'impression prévaut que les positions de la France se sont de plus en plus alignées sur celles des Etats-Unis et des pays européens les plus atlantistes. Enfin, il faut souligner les divergences fortes apparues sur les dossiers libyens et syriens. L'interventionnisme occidental et le soutien aux « printemps arabes » contre les régimes en place constituent en effet pour la Russie une double menace : menace par la déstabilisation qu'ils sont susceptibles de provoquer sur son front sud en favorisant la montée en puissance de l'islamisme radical, dont elle redoute le potentiel de contagion au Caucase, menace d'un changement de régime dont elle-même craint d'être la cible un jour ou l'autre.
Venons-en maintenant aux effets de la crise, dont on peut dire qu'elle a précipité la dégradation des relations entre la Russie et l'Occident
La réaction des pays occidentaux à l'annexion de la Crimée par la Russie et au soutien apporté par celle-ci aux séparatistes du Donbass a consisté à prendre plusieurs trains de sanctions dont vous trouverez le détail dans le rapport. Ces mesures, quoiqu'on en dise, étaient nécessaires. Nous ne pouvions pas ne pas réagir et nous ne pouvions réagir que de la sorte, une fois l'intervention militaire exclue.
La question de savoir si les sanctions ont eu un effet sur la crise ukrainienne est plus difficile à cerner. Elles ont en tous cas surpris la Russie, dans la mesure où elles ont démontré l'unité du camp occidental, et l'ont sans doute incitée à refreiner la déstabilisation du Donbass, comme le prouve la disparition de l'évocation de la Novorossia, terme désignant d'anciennes possessions tsaristes dans cette région, qui avait un temps laissé craindre une annexion par la Russie de ce territoire. Mais ce sont surtout les initiatives diplomatiques de l'OSCE d'abord, puis de la France et de l'Allemagne, autour des accords de Minsk, qui ont permis de mettre sur les rails une difficile et fragile sortie de crise.
Cette crise a consommé un véritable divorce entre la Russie et l'Occident qui se traduit de différentes manières :
Elle conduit d'abord la Russie à se démarquer encore plus des pays occidentaux et à revendiquer une identité propre, fondée sur la « russité », l'orthodoxie et la défense des valeurs traditionnelles face à un Occident qu'elle considère comme décadent. Cette « croisade des valeurs » va de pair avec le lancement, au moment de l'annexion de la Crimée, d'une campagne nationaliste et patriotique qui permet à Vladimir Poutine de reconquérir une popularité inespérée et contribue à développer dans la population russe un fort sentiment anti-occidental et notamment anti-américain.
Elle se traduit également par une montée des tensions militaires et des postures d'intimidation. La Russie multiplie depuis le début de cette crise les démonstrations de force : rotations militaires à la frontière ukrainienne, exercices de grande ampleur se terminant par un tir nucléaire simulé, pénétration d'avions russes (y compris de bombardiers stratégiques) dans l'espace aérien de pays européens et incursions de sous-marins. Cette pression militaire s'accompagne d'une mise en scène de la puissance militaire (comme à l'occasion notamment des cérémonies du 9 mai) et d'une rhétorique agressive en matière de nucléaire, illustrée notamment par l'annonce de l'installation de missiles intercontinentaux à capacité nucléaire, les menaces proférées contre des pays alliés susceptibles d'accueillir des missiles antimissiles américains ou encore la possibilité, prévue par la doctrine militaire russe, révisée en décembre 2014, d'employer des armes nucléaires en cas d'agression par des armes conventionnelles. On peut rattacher également à cette rhétorique les déclarations de Vladimir Poutine en mars 2015 sur le fait qu'il ait envisagé de mettre les forces nucléaires en état d'alerte lors de l'annexion de la Crimée.
En réaction et pour répondre à l'inquiétude grandissante des alliés d'Europe orientale, un renforcement des capacités militaires de l'OTAN a été décidé au sommet de Newport le 5 septembre 2014, prévoyant notamment une remontée des budgets militaires, le renforcement de sa force de réaction et une intensification des exercices.
Enfin, l'accélération du pivot asiatique de la Russie est une autre conséquence de la crise actuelle. Depuis 2014, la Russie manifeste plus ostensiblement son souhait de se tourner vers l'Asie, en premier lieu vers la Chine, pour desserrer l'étau de son isolement diplomatique et tenter de trouver des débouchés à ses hydrocarbures ainsi que les financements dont les sanctions la privent. La Russie avait, il est vrai, amorcé ce pivot depuis plusieurs années, considérant le ralentissement économique en Europe et souhaitant favoriser le développement économique de son Extrême-Orient en déclin. La crise actuelle n'en a pas moins donné un coup d'accélérateur à ce rapprochement, l'année 2014 étant marquée par une intense séquence de rencontres sino-russes et la signature d'un très grand nombre d'accords entre les deux pays, dont un gigantesque accord gazier. Soucieuse de ne pas apparaître dans une relation exclusive avec la Chine, la Russie consolide aussi ses relations avec les émergents, signant par exemple un accord douanier avec le Vietnam et prenant part, en juillet 2014, à la création de la banque de développement et de la réserve de change des BRICS, dans une démarche visant à la mise en place d'un ordre monétaire et financier alternatif à celui des accords de Bretton Woods.
Au final, un an et demi après le début de cette crise, les relations entre la Russie et l'Occident, semblent dans une phase d'éloignement voire de tensions.

Il nous faut nous interroger sur la relation que nous envisageons désormais avec la Russie.
Pour notre groupe de travail, il n'est pas possible d'accepter l'impasse que serait l'éloignement, voire la confrontation.
La première idée que nous souhaitons développer, c'est que la Russie et l'Europe partagent beaucoup d'intérêts communs. L'Europe a besoin de la Russie et réciproquement !
De par le poids important qu'elle conserve sur l'échiquier international - elle est une force nucléaire, elle a un droit de veto au Conseil de sécurité, elle entretient des relations privilégiées avec un nombre important d'États, notamment au Moyen-Orient et en Syrie - la Russie reste un interlocuteur incontournable sur bien des dossiers. Elle a, nous le savons, une capacité de blocage, comme c'est le cas dans la crise syrienne depuis 2011, mais elle sait aussi exprimer la force de sa solidarité et sa volonté d'unité dans certaines situations. Elle l'a prouvé à plusieurs reprises, à propos notamment de l'accord nucléaire avec l'Iran.
En ce qui concerne la Syrie, elle détient certainement les clés de la résolution du conflit. Comment analyser, à cet égard, l'initiative qu'elle a prise il y a quelques jours d'intervenir militairement en soutien au gouvernement de Bachar el-Assad, après avoir tenté de rallier les pays occidentaux à son projet de coalition?
La situation offrait évidemment à Vladimir Poutine une opportunité de plus de jouer la surprise. Un boulevard s'ouvrait devant lui. Lors de notre mission en Russie, nous avions compris que les Russes pouvaient potentiellement débloquer la situation en Syrie...
C'est d'abord, encore une fois, pour les Russes, une manière de revenir au centre du jeu et de sortir de l'horizon diplomatique fermé dans lequel la crise ukrainienne les cantonne - forcément ! - depuis plus d'un an. Cela s'explique aussi, bien sûr, par des préoccupations sécuritaires. La présence de Daech constitue une menace importante sur son flanc sud. N'oublions pas que 2 000 à 3 000 Russes, notamment tchétchènes, se trouvent actuellement dans les rangs de Daech et que la Russie redoute leur retour.
Je souligne que nos préoccupations se rejoignent en matière de terrorisme, domaine dans lequel notre coopération avec la Russie n'a jamais cessé.
Enfin, Vladimir Poutine veut sauver son allié syrien pour pouvoir être à la table des négociations et continuer à peser sur l'avenir de la région. Nous avons longtemps pensé, à tort, que les Russes le lâcheraient un jour. Or, ils sont assez solidaires et déterminés par rapport à certaines situations.
Vladimir Poutine peut aussi, avec la Syrie, continuer à mobiliser l'opinion publique russe. La propagande en ce sens est ample.
Interlocuteur obligé au plan international, la Russie est aussi un pays avec lequel nous partageons d'importants intérêts économiques. Elle est le troisième partenaire commercial de l'Union européenne, après les États-Unis et la Chine. À l'inverse, l'Union européenne est son premier fournisseur.
Concernant la France, la Russie est notre troisième marché d'exportation hors d'Europe. La France était, toujours en 2013, le troisième fournisseur européen de la Russie. La coopération est forte dans les domaines de la finance, de la grande distribution, de l'agroalimentaire et de l'automobile.
Force est de constater que la crise économique russe, liée pour partie aux sanctions et à la chute des prix du pétrole, met à mal nos relations économiques avec ce pays, avec lequel les échanges ont diminué de 7 % en 2014. Le manque à gagner de la France depuis l'instauration de l'embargo est estimé à 300 millions d'euros.
La Russie a elle aussi besoin de l'Europe. Son projet d'intégration régionale et son orientation vers l'Asie ne sont pas des alternatives à des relations avec l'Union européenne. Sans le pont vers l'Europe que constitue l'Ukraine, l'Union économique eurasiatique restera en effet déséquilibrée et enclavée. La crise économique qui frappe la Russie ne lui permet cependant pas d'assurer l'effet d'entraînement nécessaire à cette intégration économique.
Par ailleurs, son dirigisme entretient la méfiance de ses partenaires, et l'exemple ukrainien inquiète. Considérons également que, jaloux de leur indépendance, ces États eurasiatiques multiplient leurs relations avec des pays tiers, comme les États-Unis, la Chine, et l'Union européenne.
Le pivot asiatique, dont on parle beaucoup, dont il reste à vérifier la puissance de la dynamique qu'il a engagée, même s'il est largement affiché, ne devrait pas déboucher, à court terme, sur un grand rééquilibrage. La Chine s'est montrée solidaire de la Russie en soutenant le rouble en 2014. Est-elle pour autant prête à répondre aux importants besoins de financement dont la Russie, privée des capitaux occidentaux par les sanctions, a besoin ? Sûrement pas !
La Chine n'a pas non plus vocation à constituer immédiatement un marché alternatif au marché européen pour les hydrocarbures russes, l'Union européenne absorbant la moitié des exportations de la Russie en la matière. La Russie restera en concurrence avec l'Asie centrale pour l'approvisionnement du marché chinois en hydrocarbures. Cette relation sino-russe, économiquement, démographiquement et politiquement déséquilibrée, risque surtout de confirmer que la Russie, sur un plan politique, est dans la posture d'un « junior partner » de la Chine.
Enfin, nous estimons que la marginalisation de la Russie comporterait des risques à la fois pour la Russie, mais aussi pour la sécurité de l'Europe.
L'évolution interne de la Russie apparaît préoccupante : lancement d'une campagne nationaliste anti-occidentale, durcissement du régime, financement des médias et des partis politiques par des capitaux étrangers. Le champ politique est de plus en plus verrouillé.
De l'avis de nombreux observateurs, la Russie est, en dépit de sa politique extérieure offensive, un pays qui se ferme et qui se considère de plus en plus comme une citadelle assiégée.
Dans ce contexte, la mise au ban de la Russie ne fait que renforcer ce mouvement de repli sur soi, qui n'est pas sans risque pour le pays, et peut-être pour l'Europe.
Cette évolution n'est pas souhaitable et la dégradation du climat est inquiétante.
Certains redoutent une déstabilisation d'autres pays du voisinage, où des minorités russophones - 25 millions en Europe de l'Est - sont prises en otage par la Russie. Le discours de la Russie sur le monde russe et sa mission de protection de ses « compatriotes » lui donnent la possibilité de réactiver un certain nombre de foyers de tension : signature de traités d'alliance avec l'Abkhazie en 2014, avec l'Ossétie du Sud en mars 2015, mobilisation militaire en Transnitrie, instrumentalisation du territoire autonome de Gagaouzie en Moldavie...
Je voudrais également insister sur l'instabilité latente dans les Balkans, où la Russie conduit des manoeuvres avec la Serbie. Soyons-y attentifs : les pays Baltes et les autres territoires du voisinage ne sont pas les seuls à s'inquiéter : Kosovo et Serbie seront peut-être un jour à mettre dans la même perspective, si les initiatives russes s'étendent.
La mise en avant par la Russie du facteur nucléaire est-elle seulement une réaction défensive face au renforcement de l'OTAN ? S'agit-il pour la Russie de tester la crédibilité de l'article 5 du traité de l'OTAN ? Le survol de la Turquie par des avions russes constitue-t-il un accident ? Est-ce délibéré ou non ? Nous devons nous poser la question, le contexte étant très inflammable.
L'absence de dialogue avec la Russie comporte donc de vrais risques. C'est finalement la paix qui est en jeu, et une escalade est possible. C'est pourquoi nous prônons un dialogue renforcé.

La première recommandation que nous formulons est bien évidemment de prendre en compte le retour d'une « menace de la force » en Europe
La Russie a une conception classique des relations internationales, fondée sur l'idée de puissance et de rapports de force. Si elle ne rencontre pas de résistance, elle continuera à pousser ses pions dans un sens conforme à ses objectifs, qui sont de reconquérir son rang et sa puissance.
Ce constat doit d'abord nous inciter à faire preuve de fermeté pour être crédibles. En Ukraine, les sanctions sont le principal instrument dont nous disposons pour créer ce rapport de force car nous devons, raisonnablement, privilégier dans cette crise un règlement diplomatique et politique, qui est engagé.
Le renforcement de nos capacités militaires n'en est pas moins nécessaire. Nous nous y employons notamment avec la loi de programmation militaire et dans le cadre de l'OTAN. Mais au-delà, la stratégie européenne de défense et de sécurité, en cours de révision, doit prendre en compte la question de nos relations avec la Russie.
Notre deuxième recommandation est que la France se dote d'une stratégie globale à l'égard de la Russie, reconnaissant sa place dans l'ordre international, mais dans le respect du droit. Pour cela notre diplomatie doit s'efforcer de tester la bonne volonté russe en acceptant un dialogue approfondi sur les dossiers en cours. Il en est ainsi de la question syrienne, même si le rapide et dangereux passage à l'acte de la Russie, peu de temps après sa proposition de nouvelle coalition, rend cet exercice très difficile. Mais comme l'a rappelé notre président en séance l'autre jour lors du débat sur les BPC, nous ne pouvons laisser les Etats-Unis discuter seuls avec la Russie de l'avenir de la Syrie !
La France a pour cela une carte particulière à jouer en ce moment. D'abord, parce qu'il nous semble qu'elle a retrouvé son crédit aux yeux des Russes. Sa participation certes tardive mais décisive à la gestion de la crise en Ukraine à travers le format de Normandie et les accords de Minsk fait d'elle un interlocuteur reconnu. Ensuite, parce que du fait d'un certain refroidissement des liens entre la Russie et l'Allemagne depuis cette crise, il y a pour elle une responsabilité spécifique à jouer auprès de la Russie, notamment pour faciliter les relations de celle-ci avec l'Union européenne. Nous venons, par ailleurs, de solder l'affaire des BPC qui compliquait depuis un an nos relations bilatérales.
Enfin, outre l'héritage historique de notre relation spéciale, qu'il nous est possible de réactiver, nous pouvons nous fonder sur des points communs et des convergences de vues en matière de politique étrangère.
Cette stratégie trouverait également à s'appliquer à deux niveaux. D'abord, dans la poursuite des efforts que la France mène, au sein du « format Normandie », pour faire appliquer les accords de Minsk et obtenir le règlement de la crise en Ukraine. Ce n'est pas une chose aisée. Certes, depuis septembre dernier, la situation s'est améliorée sur le terrain et le cessez-le-feu est enfin respecté. La révision constitutionnelle ukrainienne est en cours, mais nécessite encore d'être votée en deuxième lecture à la majorité qualifiée. Il nous faut maintenir la pression sur l'application de ce volet institutionnel afin que le cessez-le-feu ne vole pas en éclats. La prolongation de la mise en oeuvre des accords vient d'être actée lors du récent sommet en format de Normandie. Aussi la France devrait-elle faire savoir dès à présent qu'elle souhaite une levée graduelle des sanctions si le cessez-le-feu est respecté et si les élections se déroulent conformément aux engagements.
D'autre part, et ce serait notre deuxième volet, la France doit prendre l'initiative d'un dialogue renouvelé avec la Russie sur les questions de sécurité et de développement économique en Europe. Ce dialogue serait l'occasion d'aborder un certain nombre de préoccupations communes et nous permettrait de renouer avec une approche pan-européenne que nous partageons de longue date avec la Russie. Ce dialogue, qui pourrait prendre la forme d'une conférence internationale sur le modèle de celle qui avait débouché en 1975 sur la signature de l'Acte final d'Helsinki, serait une façon de nous redonner une perspective politique commune, à l'heure où le dialogue Russie-UE est difficile.
Dans ce cadre pourraient être abordés avec la Russie des sujets d'intérêt commun en Europe tels que le désarmement et le rétablissement de mesures de confiance, ainsi que l'opportunité de conférer, notamment à l'Ukraine, un statut de neutralité à l'égard des organisations militaires. Cette conférence pourrait aussi se donner comme objectif d'examiner les modalités d'une réforme de l'OSCE, instance de dialogue paneuropéenne reconnue par la Russie, et qui est revenue récemment au premier plan du fait de son implication dans la gestion du conflit ukrainien.
L'Allemagne et la France auraient bien sûr un rôle moteur dans ce dialogue, mais il importe aussi d'y impliquer autant que possible la Pologne, qui peut avoir un rôle pour désamorcer les tensions entre la Russie et les pays d'Europe orientale. Une détente russo-polonaise a été possible il y a quelques années, nous espérons qu'elle puisse reprendre.
Enfin, nous souhaitons que ce dialogue, qui prendrait, soyons réalistes, plusieurs années, puisse se traduire par un accord semblable à l'Acte final d'Helsinki permettant de sceller nos engagements mutuels et de réaffirmer notre attachement commun à la paix et à un certain nombre de grands principes indispensable à notre sécurité commune.
En résumé, nous proposons - c'est ambitieux - une initiative diplomatique format « Normandie » (et si possible un jour « Weimar ») pour construire avec les Russes un « Helsinki 2 » sur la sécurité en Europe.
Enfin, il nous faut aussi mettre l'accent sur les échanges humains et la coopération scientifique, technique et culturelle.
En conclusion, au terme de nos travaux au cours desquels nous avons pu confronter nos analyses sur la question russe et prendre aussi la mesure des débats auxquels elle donne lieu chez les experts, les dirigeants politiques, les diplomates, nous convergeons pleinement sur la nécessité d'un équilibre entre fermeté et dialogue, pour nous permettre de sortir de l'impasse. La France a tous les atouts pour y parvenir, son histoire, le génie de sa diplomatie, l'indépendance de son analyse.

On ne peut aujourd'hui rien comprendre de la situation dans laquelle on se trouve avec la Russie si l'on ignore ce qui s'est passé dans les années 1990.
C'est un sentiment extrêmement fort que nous avons rencontré chez nos interlocuteurs russes, qui nous a fait comprendre ce que le pays a pu subir à la fois sur le plan économique et sur le plan diplomatique.
Sur le plan économique, cette période a correspondu à un libéralisme échevelé et à un appauvrissement du pays en parallèle.
Sur le plan diplomatique, elle a correspondu à un recul de la situation de la Russie et la perception par les Occidentaux que la dissolution de l'URSS est la conséquence d'une défaite que celle-ci aurait subie, alors que la fin de l'URSS n'est pas vécue comme telle par les Russes.
Dans les deux cas, on peut comprendre la méfiance qui s'exprime aujourd'hui en Russie à l'égard des Occidentaux. Au moment où l'Occident et les Américains ont été influents, cela s'est traduit par un affaiblissement de la position stratégique de la Russie et de sa position économique. Cela explique à mon sens une grande partie des difficultés que l'on rencontre, la Russie et ses dirigeants se plaçant aujourd'hui sur un terrain nécessairement différent de celui qui a prévalu durant cette période.
Que peut-on imaginer ? Cela a été fort bien dit par mes collègues. Nous devons, me semble-t-il, réexaminer cette situation d'un point de vue global, en considérant que la Russie constitue un partenaire incontournable, tant en matière de sécurité sur le continent que pour son développement.
La position qui a été celle de l'Union européenne, qu'on a peut-être laissée un peu trop libre de ses mouvements ces dernières années, n'était pas tenable.
La question de la sécurité du continent est trop sérieuse pour être laissée à l'Union européenne. Il était indispensable que la France et l'Allemagne s'en ressaisissent pour tenter de dégager des solutions, mais si l'on veut que ces solutions puissent prospérer, telles qu'elles ont commencé à être amorcées par les accords de Minsk et mises en oeuvre, il faut évidemment élargir cette préoccupation de dialogue à d'autres sujets.
On ne peut considérer que l'on pourrait séparer les questions, au moins dans leur approche. C'est un point de vue personnel.
La question ukrainienne et la question syrienne sont distinctes, mais la question ukrainienne a montré que la réouverture du dialogue avec la Russie, dans des conditions certes difficiles, permettait de faire avancer les choses. Il faut donc adopter la même attitude s'agissant de la question syrienne, et considérer que nous ne pouvons nous contenter d'opposer une fin de non-recevoir à la position russe. Il ne s'agit pas non plus d'y adhérer, mais la discussion doit s'ouvrir pour tenter de dégager une solution.
Vladimir Poutine nous dit aujourd'hui très clairement qu'il ne laissera pas faire en Syrie ce que nous avons fait en Libye. Il nous passe ce message de manière assez explicite, et il est prêt à jouer la provocation, voire à pratiquer une forme d'escalade. On l'a vu encore récemment avec les incidents de Turquie.
Il faut donc prendre cette situation très au sérieux, car elle peut déboucher sur une situation extrêmement grave. Il nous faut prolonger l'effort que nous avons engagé sur la question ukrainienne, dans la fermeté, à propos de la question syrienne, en essayant de voir quelles sont les options possibles.
J'espère que c'est ce qui se passe. Je veux croire que les déclarations qu'on nous fait en disant qu'il n'est pas question de discuter avec Bachar el-Assad ne servent pas à mettre de côté le dialogue inéluctable qui devrait avoir lieu par ailleurs.
Enfin, il faut indiquer que la France a pour ambition de retrouver un discours fort sur la question européenne avec l'ensemble des partenaires européens. La France devrait pouvoir avancer des propositions dans ce domaine et montrer sa disponibilité. Ce message pourrait être consolidé par des indications sur notre intention de lever les sanctions diplomatiques ou personnelles les plus humiliantes concernant le personnel politique russe dans les prochaines semaines, si la situation en Ukraine devait s'améliorer.
À un moment où les tensions peuvent s'exacerber, nous avons tout intérêt à inverser la stratégie qui a été conduite et à mettre en place les outils permettant de reconstruire le dialogue. Cela ne signifie pas que l'on aboutira à des résultats à court terme, mais c'est ainsi qu'il faut considérer le sujet, me semble-t-il.

J'aimerais que l'on fasse un point dans ce rapport sur les conflits gelés. On a en effet oublié le Nagorny Karabagh. Le Caucase Sud est totalement bloqué par la Russie, qui empêche également le groupe de Minsk de travailler, or aucune solution n'est possible sans la Russie. Faut-il continuer dans de tels schémas, qui ne mènent à rien ? Je n'ai pas non plus entendu parler de la Palestine. Le rôle de la Russie dans la région est essentiel, alors que l'on redoute une troisième intifada. Enfin, les tensions entre la Russie et la Turquie se font de plus en plus ressentir, notamment depuis l'intervention russe en Syrie. Quelle est la position des rapporteurs à propos de la Palestine, de la Turquie et au sujet d'un changement de périmètre ? J'ajoute que l'on pourrait ramener la diplomatie parlementaire au rôle qu'elle devrait avoir. C'est en effet dans ces moments de grande tension qu'elle a peut-être le plus d'utilité !

Je félicite nos rapporteurs pour ce rapport complet, précis et équilibré, tout le monde en conviendra. Tout le monde est sans doute également d'accord avec le fait qu'il faut parler avec la Russie. De quelle façon ? Cela pose deux questions essentielles. En premier lieu, la Russie est-elle aujourd'hui un partenaire ou un adversaire ? On ne parle en effet pas aux deux de la même façon. En second lieu, faut-il dialoguer à la Russie parce qu'elle est maîtresse du jeu au Moyen-Orient et faire des concessions qui permettraient d'obtenir des avantages ? La première question, je l'ai abordée lors d'une précédente séance de notre commission, lorsque nous avons parlé des Mistral, en expliquant que la Russie n'est pas aujourd'hui un partenaire mais, au mieux, un interlocuteur - Crimée, Ukraine, Géorgie, Abkhazie - je n'y reviens pas.
Depuis quelques jours, la façon dont la Russie entre en action en Syrie éclaircit les choses. Ceux qui plaidaient en faveur d'un grand marchandage consistant à sacrifier la Crimée et à mollir sur l'Ukraine comme prix à payer pour obtenir le soutien de Vladimir Poutine au Moyen-Orient se rendent compte que ce serait un marché de dupes, pour une raison simple : les objectifs de Vladimir Poutine au Moyen-Orient, à quelques exceptions près, ne sont pas les nôtres. Depuis une semaine, cette réalité s'est brutalement transformée en évidence. Nos priorités, ce sont la destruction de Daech, le confortement de nos rapports avec nos alliés majoritairement sunnites, un rapprochement prudent avec l'Iran, et une solution de paix en Ukraine. Les priorités de la Russie sont le maintien de Bachar al-Assad, d'un axe russo-syrano-irano-chiite, pour faire court, et la création de poches sécessionnistes dans les pays de l'ancienne URSS. À l'évidence, nos priorités et celles de Vladimir Poutine sont donc différentes.
La Russie est-elle maîtresse du jeu ? Beaucoup de personnes, si elles ne sont pas paniquées, sont du moins inquiètes et, estimant Daech dangereux, le problème des réfugiés étant insoluble et divisant l'Union européenne, et Vladimir Poutine semblant en bien meilleure position, demandent l'aide de ce dernier. Ce qu'on ne prend pas en compte - et je m'en étonne - c'est la position défavorable de la Russie. Premièrement, si Vladimir Poutine est intervenu en urgence en Syrie, c'est parce que, quelques semaines de plus, et le régime tombait ou risquait de tomber. Il risquait ainsi de perdre son seul allié en Méditerranée, et ses seules bases portuaires. Cette situation était bien plus catastrophique à court terme pour Vladimir Poutine que pour nous.
En second lieu, le rouble a perdu 70 % de sa valeur ; l'économie est en chute libre, et ce n'est pas parce que son appareil de propagande permet à Vladimir Poutine d'avoir 70 % d'opinions favorables dans les sondages - qu'est-ce qu'un sondage en Russie ? - qu'il faut ne pas voir la situation économique catastrophique qui s'aggrave.
Cette catastrophe économique tient plus à la chute du pétrole qu'aux sanctions ou, du moins, autant à l'une qu'à l'autre. Elle va s'aggraver, d'ici six mois à un an, par le retour de l'Iran, après l'accord sur le nucléaire, qui va permettre à ce pays d'abreuver le monde de millions de barils et de concurrencer encore plus le pétrole et le gaz russes.
Enfin, la guerre en Ukraine revient à des millions de roubles par jour, et des soldats meurent.
Dernier point : le rapprochement avec la Chine, que certains présentent comme la preuve de l'habileté diplomatique de Vladimir Poutine, est un échec retentissant, dont bénéficient uniquement les Chinois ! Je ne comprends pas qu'on ne le voie pas.
Les échanges entre la Russie et la Chine ont baissé de 30 % depuis cet accord, signé il y a un peu plus d'un an. Aucun des grands projets prévus n'a vu le jour ; ils sont au point mort et ne se réaliseront jamais. Les seuls à en tirer profit sont les Chinois, qui bénéficient de livraisons de pétrole et de gaz à prix bradé, Vladimir Poutine n'ayant d'autre solution, comme l'a dit Josette Durrieu, que de trouver en urgence des débouchés pour son pétrole.
Ma conclusion est qu'il faut parler avec Vladimir Poutine non comme avec un partenaire maître du jeu, mais comme avec un adversaire potentiel, qui est loin d'être dans une situation favorable.
Parler avec la Russie, oui, mais pas au point de renoncer d'une part à nos intérêts stratégiques, d'autre part à la solidarité avec nos alliés.
La conclusion du rapport - « fermeté et dialogue » - me convient donc tout à fait.

Au-delà des tumultes de l'heure, je voudrais poser une question qui ressortit au registre géopolitique, et qui interroge directement la nature de la relation entre la France et la Russie, que je pourrais caractériser, faute de mieux actuellement, par la phrase : « Je t'aime, moi non plus » !
Ma question s'adresse directement à nos excellents rapporteurs : selon eux, la Russie se cabre-t-elle par psychose obsidionale, du fait de la menace que représenterait l'OTAN sur ses frontières ? S'agit-il, de manière plus fondamentale, d'une politique de reconquête de son espace, pour reprendre le terme employé par Josette Durrieu, qu'Hélène Carrère d'Encausse qualifierait de « reconquête de l'empire allogène » ?
Au fond, la Russie est-elle dans une posture défensive ou offensive ?

Le rapport l'a dit, « grâce » à l'Ukraine, le Conseil européen a, pour la première fois peut-être, une politique étrangère commune. C'est le côté presque positif de cette tension avec la Russie. Dans un rapport de la commission des affaires européennes, que je suis en train de rédiger avec Simon Sutour, nous allons insister sur ce point.
Il faut également souligner l'action de la France, et notamment du Président de la République. J'étais avec lui lors de sa rencontre surprise avec Vladimir Poutine, et je considère que la France a été l'acteur majeur de la relance des accords de Minsk. Quelles que soient les analyses politiques - je suis moi-même un opposant au Président de la République - c'est l'un des points les plus positifs de son action et de celle de la France.
Troisième élément : le rapport n'insiste pas assez selon moi sur l'attitude des Américains dans cette affaire. Après la signature des accords de Minsk, le président polonais, qui a fait à cette occasion des déclarations plutôt négatives, est arrivé au Conseil européen avec Petro Porochenko pour essayer de casser le format Normandie. Par ailleurs, les Américains essayent d'avoir une action sur ce qui s'est passé en Ukraine en utilisant les pays baltes comme relais, avec l'aide du Royaume-Uni.
Ceci a également des conséquences sur l'OTAN. On peut s'interroger lorsqu'on entend les propos que tient la porte-parole de l'OTAN, Carmen Romero. Je ne suis pas sûr que ceux-ci soient dans l'esprit du rapport. C'est un élément fondamental de l'analyse, et il nous faut donc l'évaluer.
En conclusion, ce rapport est un très bon rapport. Toutefois, la décision ayant été prise de ne pas remplacer un centriste par un centriste après l'invalidation d'Aymeri de Montesquiou, je ne participerai pas au vote. Pour autant, cela ne signifie pas que je ne suis pas d'accord avec ce que contient le rapport.

Merci pour cet excellent travail. Vous avez eu tout à fait raison de rappeler les trop nombreux rendez-vous manqués, qui nous ont amenés à ce divorce. Il est cependant toujours possible de se remarier, et l'on peut donc vivre dans l'espoir.
Vous avez également fait référence au travail que l'Allemagne et la France sont capables de mener avec les accords de Minsk et les discussions dans le cadre du format Normandie. Il me semble que l'Europe occidentale, avec les pays baltes et la Pologne, est plutôt dans une logique de rapports de force avec la Russie, entraînant un durcissement des relations entre ce pays et l'Union européenne. La Russie se veut un interlocuteur sérieux, mais il semble que Bruxelles ait échoué à s'imposer, même si l'Union européenne avait perdu de sa crédibilité bien avant l'affaire ukrainienne.
Vos propositions sont assez ambitieuses. Ne pensez-vous pas que tout ce qui relève de la relation entre l'Union européenne et la Russie est l'expression de voeux pieux ? En effet, la Russie est prête à traiter de questions régionales avec Berlin ou Paris, mais pas au-delà.

Les propositions de Robert del Picchia me paraissent équilibrées et tant mieux si on peut les mettre en oeuvre.

Autrefois, Staline demandait : « Le pape, combien de divisions ? ». Quand on analyse nos rapports avec la Russie, il serait intéressant de connaître la force réelle de Vladimir Poutine.
Vladimir Poutine et la Russie actuelle, ce n'est pas l'URSS. L'URSS a perdu la course aux armements quand le président Bush a voulu lancer la course aux étoiles. Ce fut une des origines de la chute de l'URSS.
Il est vrai qu'il faut déplorer et constater que la Russie est dans une phase d'affirmation diplomatique, et qu'elle a entrepris de reconstituer son appareil militaire. Il ne faut pas pour autant craindre que la Russie cherche à mettre ses pas dans ceux de l'URSS, car ce serait surestimer les moyens d'action de Vladimir Poutine.
Ceci étant, nous avons intérêt à avoir des rapports amicaux et suivis avec la Russie. Mon propos n'est pas d'en nier l'intérêt.
S'agissant de l'Ukraine, il faut bien mesurer ce qu'a représenté la révolution de Maïdan. On trouve, en Ukraine, un peuple qui a aspiré à une certaine démocratie qu'il ne trouvait pas chez lui. Il en voulait à ses dirigeants, et il a été, semble-t-il, assez surpris de voir la vigueur avec laquelle la Russie intervenait dans l'affaire.
L'aspiration des Ukrainiens de base, pour autant que j'aie pu le ressentir dans le cadre de mes déplacements au titre du Conseil de l'Europe, était de vivre et de se développer comme le font leurs voisins polonais. Ils ne cherchaient pas à tout prix à être agressifs vis-à-vis de la Russie, avec laquelle ils conservent de nombreux contacts et à laquelle ils sont très attachés, beaucoup de familles étant mixtes.
Il est également vrai que, pour la Russie, l'Ukraine est un sujet très sensible. Nous ne devons pas chercher à arracher un lambeau de l'ancienne URSS à la Russie, ni faire du suivisme par rapport à l'OTAN ou par rapport aux demandes américaines.
Sur ce point, on doit à la fois rappeler le droit de l'Ukraine à être un pays indépendant et à vivre de façon démocratique, et le fait que l'Ukraine s'inscrit dans une histoire...

Je félicite les rapporteurs : j'ai trouvé ce texte excellent, et son analyse et ses propositions équilibrées. J'ai hâte de lire le rapport !
Il représente une certaine évolution de notre politique étrangère. C'est une évolution récente dont je me félicite : pendant longtemps, nous avons été seuls à demander que l'on renoue le dialogue, et à insister sur le fait que nous ne gagnerions jamais contre Daech sans une ouverture à la Russie et à l'Iran.
Un point que vous avez indiqué est extrêmement important : il s'agit de l'influence des États-Unis qu'il conviendrait de limiter. Nous devons rester vigilants au sein des organisations internationales, notamment de l'OTAN. Nous avons un rôle considérable à jouer si nous voulons retrouver la place qui était celle de la France en matière de politique étrangère. Au sein de l'OTAN, beaucoup d'États d'Europe de l'Est, comme les États baltes, sont extrêmement inquiets des avancées russes. Nous devons y faire attention.

Différentes questions ont été posées quant aux motivations de Vladimir Poutine en Syrie. Cherche-t-il à faire diversion par rapport à l'Ukraine ? S'agit-il d'une lutte contre l'État islamique, face à l'inefficacité des frappes occidentales ? Cherche-t-il à diviser les Occidentaux, à sauver Bachar el-Assad, ou tout simplement à sauver la base de Tartous ?
Je rejoins Jeanny Lorgeoux sur ce sujet : ne s'agit-il pas d'une question de puissance ? En s'imposant dans le jeu en Syrie, la Russie se place comme une puissance mondiale, comme au bon vieux temps de l'Union soviétique.
Avez-vous tenté d'évaluer le « soft power » russe sous cet angle ? N'est-ce pas une tentative de Vladimir Poutine d'améliorer l'image de son pays en Europe, et notamment en France ? Chacun a entendu parler d'une prochaine chaîne de télévision en français qui pourrait être mise en place sur E box, puis éventuellement sur des réseaux plus élargis.

Lors d'un exposé à l'université de la défense, un politologue nous avait brossé un tableau géopolitique et avait insisté sur ce que le cours du pétrole représentait pour l'économie et l'armée russes. Je rejoins Jacques Legendre lorsqu'il affirme que la Russie est loin d'avoir les moyens économiques de ses ambitions...
En second lieu, la forte dégradation de la relation entre les États-Unis et la Russie est une tendance lourde, et constitue un fait marquant.

Pour répondre à Nathalie Goulet : oui, le sujet de la Palestine, problème essentiel, est à nouveau banalisé ! En Turquie, la priorité de Recep Tayyip Erdogan, concerne dans l'ordre, les Kurdes, Bachar el-Assad et Daech.
Par ailleurs, Yves Pozzo di Borgo a raison de souligner que l'Union européenne a pris une initiative indépendamment de toute action américaine. C'est une bonne chose.
Hélène Conway-Mouret a attiré l'attention sur le fait que les préoccupations des pays occidentaux de l'Union européenne et de sa partie Est ne sont pas les mêmes. Les Polonais et les Baltes ont aujourd'hui peur de la Russie. On a même par moments le sentiment qu'ils sont déjà presque en guerre.
En conclusion, ce qui est en jeu, c'est la sécurité du continent européen et sa réorganisation. Les mots qui doivent se substituer aux termes de « isolement et sentiment d'humiliation », s'agissant de la Russie, qui sont fort dommageables, sont bien : « dialogue mais fermeté ».

Pour en revenir à la phrase : « Je t'aime, moi non plus » et au phénomène de psychose obsidionale, je pense que l'on est confronté aux deux. La Russie évolue entre deux attitudes, l'une offensive, l'autre défensive.
Pour ce qui est de Maïdan, l'un de nos interlocuteurs russes nous a fait sentir la grande sensibilité de la question en faisant un parallèle avec l'indépendance de la Catalogne !
Pour ce qui est de l'OTAN et des États-Unis, les Russes dénoncent la position de l'OTAN, lorsqu'elle désirait s'installer « trop » près de chez eux.
Quant à la levée des sanctions, nous sommes d'accord, pour autant que le cessez-le-feu continue à être respecté, ce qui est le cas jusqu'à présent, et que les élections ukrainiennes puissent se dérouler comme prévu en novembre.
Pour ce qui est de la Pologne, celle-ci devrait pouvoir être impliquée dans nos négociations en faveur d'un dialogue ouvert avec les Russes. On pourrait tenter d'avancer dans cette direction avec l'Allemagne. Je sais bien combien cela sera difficile mais chacun est d'accord avec le fait que la seule solution réside dans le dialogue.

Je voudrais terminer en répondant à Jeanny Lorgeoux. La Russie se cabre par rapport à l'OTAN. Est-ce une politique de reconquête de son espace ? Oui ! Est-ce offensif ? Oui, mais il existe également de leur côté le sentiment d'une démarche offensive de l'OTAN...
C'est une façon de déterminer la ligne de crête. Incontestablement, la Russie est repartie à l'offensive.
Le rapport est adopté, M. Yves Pozzo di Borgo ne participant pas au vote.
La commission examine le rapport d'information de MM. Jacques Legendre et Daniel Reiner, co-présidents du groupe de travail sur « l'Iran : le renouveau d'une puissance régionale ? »

Le 1er juillet dernier, Daniel Reiner, Michelle Demessine, Joël Guerriau et moi-même, nous avons rendu compte à la commission des premières réflexions auxquelles nous avait conduits le déplacement de notre groupe de travail, au mois de juin, en Iran. Nous avions alors achevé le cycle d'auditions que nous avons mené tout au long du premier semestre, d'une quarantaine de personnes au total : des chercheurs et des hauts fonctionnaires français, et des responsables iraniens. Depuis cette première communication, un élément nouveau - que nous avions anticipé - est survenu, qui a changé la donne pour l'Iran, et peut-être pour l'avenir du Proche et Moyen-Orient : l'accord signé à Vienne le 14 juillet 2015.
Cet accord a revêtu une dimension historique : il a marqué la fin de douze années d'une crise diplomatique visant le programme nucléaire iranien. On a pu voir dans ce résultat un succès de la diplomatie dite de « double approche » du dossier - qui a associé, au dialogue avec l'Iran, une pression croissante sur celui-ci, au moyen de sanctions (embargos commerciaux et gel d'avoirs de personnes physiques et morales). Cet accord constitue aussi un succès pour la diplomatie française, qui a témoigné sa fermeté dans les négociations, en adoptant avec constance une position clairement fondée sur le souci de la non-prolifération régionale. Les conditions que notre pays avait posées à un accord avec l'Iran ont été satisfaites : caractère durable de la limitation des capacités iraniennes de recherche et de production nucléaire ; régime rigoureux des vérifications prévues sur les sites nucléaires iraniens, y compris militaires au besoin ; enfin, automaticité du retour aux sanctions internationales en cas de violation de ses obligations par l'Iran dans l'avenir. Les bonnes nouvelles sont suffisamment rares au Proche-Orient pour que nous saluions celle-ci !
Une question-clé est donc maintenant de savoir si l'accord trouvé à Vienne va effectivement permettre à l'Iran de redevenir un acteur « normal » dans le jeu diplomatique. Il paraît encore trop tôt pour le dire avec certitude. La détermination des Iraniens à appliquer l'accord n'est pas la seule inconnue : à brève échéance, une autre donnée majeure tiendra au résultat des élections présidentielles prévues aux États-Unis en 2016, et donc à l'orientation de la politique étrangère américaine à partir de 2017 - on se souvient de l'hostilité manifestée par les Républicains américains à un accord sur le nucléaire iranien. L'accord de Vienne ne doit donc être encore envisagé, prudemment, que comme la possibilité d'un changement.
C'est bien dans cette perspective que notre groupe de travail s'est placé. Nous avons souhaité évaluer la façon dont l'Iran se trouve potentiellement à même de jouer à nouveau sa partie - il n'y a d'ailleurs jamais renoncé - au sein du concert des Nations. Il s'est donc agi pour nous de prendre la mesure de la puissance iranienne et de nous faire une idée, aussi fidèle que possible, d'un pays particulièrement complexe et qui multiplie les paradoxes.
Le groupe de travail a ainsi pu étayer ce qui est devenu sa certitude : l'Iran constitue une puissance majeure au Proche et Moyen-Orient - que cela plaise ou non ; et il est indispensable de la considérer comme telle. Néanmoins, la vocation de cette puissance n'est pas encore certaine. Quel rôle va-t-elle pouvoir et vouloir jouer dans le proche avenir ? Sous l'hypothèse de la « normalisation » autorisée par l'accord de Vienne, l'Iran acceptera-t-il de faire usage de sa capacité d'influence au bénéfice du règlement des nombreuses crises où il se trouve actuellement impliqué, en faveur de la stabilité régionale ? Au contraire, choisira-t-il de poursuivre, au gré de l'analyse qu'il fera de ses intérêts, les opérations de déstabilisation dont il est soupçonné depuis des décennies ?
On peut au moins avancer que l'Iran, suivant son propre intérêt bien compris, devrait se trouver davantage disposé à un engagement en faveur de la résolution des crises régionales qu'il ne l'était avant l'accord de Vienne... D'où l'importance des différents paramètres de sa puissance : c'est eux, finalement, qui paraissent devoir guider les futurs choix iraniens.
Nous avons ainsi analysé, d'abord, le rayonnement diplomatique de l'Iran. Cette diplomatie semble osciller entre un pôle idéologique, issu des principes de la Révolution islamique, et un pôle pragmatique, qui cherche à tirer profit des opportunités de la conjoncture internationale. Néanmoins, le régime se tient à une constante double ligne anti-États-Unis et anti-Israël.
Au niveau régional, la politique étrangère iranienne met en oeuvre une forte solidarité avec les autres communautés chiites : le prisme religieux éclaire un grand nombre de ses entreprises. Ainsi, en Irak, autre État majoritairement chiite, l'influence de l'Iran s'avère aujourd'hui déterminante. Téhéran, en particulier, prend une part substantielle, auprès des forces irakiennes, dans la résistance à Daesh, entretenant des milices chiites à cet effet - même si l'insuffisance de ces moyens a conduit le gouvernement irakien, par souci d'efficacité, à faire appel à l'appui des frappes aériennes ciblées offert par la coalition menée par les États-Unis. À Bahreïn, gouverné par une monarchie sunnite mais également peuplé d'une majorité chiite, l'Iran entretient notoirement des liens privilégiés avec cette dernière ; il est périodiquement soupçonné d'être à l'origine de diverses tentatives de déstabilisation politique - l'Arabie saoudite est intervenue, par le passé, au soutien du gouvernement. Au Yémen, l'Iran, malgré ses dénégations répétées, est fortement suspecté d'approvisionner en armes la minorité chiite des Houthis, actuellement rebellée contre le gouvernement de la majorité sunnite - que soutient la coalition dirigée par l'Arabie saoudite. Au Liban, le parti chiite Hezbollah, créé en 1982, fait figure de véritable « produit d'exportation » de la Révolution islamique ; l'Iran, par cet intermédiaire qu'il soutient puissamment, conserve une emprise forte sur le Pays du Cèdre. Alors que celui-ci se trouve aujourd'hui soumis à des conditions déstabilisatrices (vacance des institutions, afflux de réfugiés...), il pourrait représenter, dans les prochains mois, un test révélateur de la volonté de Téhéran à faire preuve, ou non, d'une attitude constructive en faveur de la stabilité du Proche-Orient. En Afghanistan, l'Iran entretient des relations privilégiées avec la minorité des Hazaras, chiites - comme avec les Tadjiks, persanophones -, à l'encontre de la communauté pachtoune, sunnite.
Mais les engagements iraniens au Proche et Moyen-Orient excèdent ce paradigme confessionnel. C'est ainsi qu'en Syrie, le soutien assuré par l'Iran au bénéfice du régime baasiste - laïc - de la famille al-Assad, elle-même alaouite mais, ce faisant, pouvant être considérée comme dissidente par rapport à l'orthodoxie chiite, paraît au fond dépourvu de motif religieux ; il est bien davantage d'ordre géopolitique. Ce soutien n'en est pas moins, jusqu'à présent, indéfectible. La plupart des experts estiment que le régime de Damas se serait effondré sans le concours d'ordre à la fois politique, militaire et financier assuré par l'Iran. Celui-ci, de la sorte, reste, dans ce dossier, au centre du jeu diplomatique... La stratégie paraît fructueuse : vous aurez noté, en septembre dernier, la déclaration commune sur la Syrie de la Haute-Représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Mme Mogherini, et du ministre iranien des affaires étrangères, M. Zarif ; et les États-Unis se sont déclarés prêts à travailler avec l'Iran, comme avec la Russie, dans la perspective du règlement du conflit syrien - à la condition que ce ne soit pas au profit de Bachar al-Assad.
Dans le même ordre d'idée, l'inimitié de l'Iran chiite et de l'Arabie saoudite wahhabite ne repose de toute évidence qu'en partie sur ces éléments confessionnels : la proximité traditionnelle de Ryad avec les États-Unis, rapportée à l'antiaméricanisme de Téhéran, représente un facteur probablement plus agissant. La concurrence s'exerce sur plusieurs théâtres extérieurs, en forme de guerre par procuration - en Irak, en Syrie, au Yémen... L'affrontement se joue également sur un plan économique, l'Arabie saoudite utilisant contre les intérêts iraniens le poids de sa production en pétrole sur les cours mondiaux. Malgré des déclarations du président iranien, M. Rohani, qui ont montré une possible voie d'apaisement avec Ryad, la situation n'a guère évolué. Le rapprochement entre les deux États que pourrait susciter, notamment, la cause commune de la lutte contre Daesh, se fait attendre.
L'opposition iranienne à Israël passe par un soutien affiché de l'Iran à la cause palestinienne. Le Hamas, essentiellement à Gaza, bénéficie ainsi de l'appui diplomatique et militaire de Téhéran, relayé par le Hezbollah libanais. Cependant le Fatah, en Cisjordanie, s'est montré ces dernières années plus réservé à l'égard de ce qu'il semble tenir pour une volonté d'ingérence.
Enfin, avec la Turquie, Téhéran semble engagé dans une forme d'alliance relative, qui fait fond sur une vieille rivalité, persistante, pour tenir le rôle de grande puissance régionale non-arabe et de nation chef de file du monde islamique. L'Iran s'est d'ailleurs longtemps défié d'un pays, membre de l'OTAN et partenaire d'Israël, qui postulait à intégrer l'Union européenne. Mais l'arrivée au pouvoir à Ankara, en 2002, du Parti de la justice et du développement (AKP), la promotion des valeurs islamiques - sunnites, certes - par le gouvernement turc, et plus récemment les distances prises par celui-ci tant avec l'Europe qu'avec Israël, ont incité au rapprochement. Ainsi, la Turquie a représenté, ces dernières années, l'un des rares soutiens reçus par l'Iran dans son projet de se doter d'un programme nucléaire civil. Il est vrai que d'importants enjeux commerciaux unissent les deux pays. Cela n'a pas empêché, notamment, que le gouvernement d'Ankara, à rebours de celui de Téhéran, prenne le parti des opposants à Bachar al-Assad en Syrie.
Au-delà de sa région, par convergence d'intérêts, l'Iran a noué d'autres partenariats stratégiques ; je me bornerai ici à mentionner le cas de la Chine et celui de la Russie. La relation est surtout économique avec la Chine, qui représente aujourd'hui le principal partenaire commercial de l'Iran. Les orientations de la diplomatie chinoise paraissent guidées, là comme ailleurs, par le pragmatisme. La Russie est le premier fournisseur d'armes de l'Iran. De fait, elle s'est conformée, un temps, aux mesures d'embargo international en la matière, elle n'a cependant pas renoncé à ce commerce : on l'a bien vu, au mois d'août dernier, avec la confirmation officielle de la livraison à l'Iran, avant la fin de l'année, de batteries de défense antiaérienne sol-air russes, de type S-300, vendues pour un montant de 800 millions de dollars.

La capacité militaire de l'Iran est en effet un autre aspect de la puissance du pays auquel notre groupe de travail s'est attaché.
L'armée régulière iranienne est toujours aujourd'hui marquée, comme le reste du pays, par la guerre Iran-Irak et ses centaines de milliers de morts. Elle compterait 350 000 hommes environ, et dispose d'un équipement assez hétérogène, de qualité plutôt moyenne : des acquisitions récentes auprès de la Russie, la Chine ou la Corée du Nord, et du matériel acquis, avant 1979, auprès des Occidentaux - dont les États-Unis et la France. L'Iran, cependant, grâce aux transferts de technologie dont il a bénéficié auprès de ses partenaires, a mis en place une industrie d'armement nationale, dont une filière balistique. Son budget annuel d'armement est évalué de 2,5 % à 3 % du PIB - ce qu'il faut notamment comparer aux dépenses militaires des États membres du Conseil de coopération du Golfe qui, cumulées, s'avèrent huit fois supérieures. La doctrine officielle est d'ailleurs strictement défensive. Et l'état des forces iraniennes disponibles paraît fort modeste : la capacité de résistance de la flotte est estimée par les experts comme extrêmement limitée au regard de la puissance de la flotte américaine basée à Bahreïn ; les 330 avions de combats des forces aériennes du pays sont en partie inutilisables, du fait de leur vétusté et du manque de pièces détachées...
Mais l'armée régulière de l'Iran se trouve doublonnée, depuis 1979, par l'organisation de Pasdarans, les « Gardiens de la Révolution islamique ». C'est une sorte d'armée parallèle. Ils disposent de leur propre équipement militaire, souvent plus performant que celui de l'armée régulière, et de leurs propres troupes - dont la force d'élite Qods, bras armé des interventions non conventionnelles de l'Iran en dehors de son territoire ; on sait qu'une partie de cette force se trouve aujourd'hui en Syrie. Ces Pasdarans, de plus, constituent une véritable organisation économique, dont les membres contrôleraient près de 40 % de l'économie de l'Iran, dans tous les secteurs. Et ils sont une force politique essentielle, dont l'emprise sur la société iranienne se révèle très concrète au quotidien.
Nous avons également cherché à analyser les aspects économiques et la société de l'Iran.
Sur l'économie, je me tiendrai à l'essentiel. Les ressources iraniennes sont importantes : le pays détient 10 % des réserves pétrolières de la planète et 18 % des réserves de gaz naturel ; sa population de près de 80 millions d'habitants fait de lui le plus gros marché intérieur du Moyen-Orient. Cette économie a connu ces dernières années un repli considérable - une contraction de 8,5 % du PIB entre 2012 et 2014. La situation est avant tout imputable aux embargos internationaux : le coût des sanctions internationales qui ont visé l'Iran est estimé aux alentours de 500 milliards de dollars. Pendant cette période, le marché iranien s'est réorienté vers ses voisins émiratis et irakiens, vers la Turquie, ainsi que vers la Chine, la Corée du sud et l'Inde. Mais le ralentissement économique du pays a tenu aussi à une inflation massive et à la chute des cours du pétrole. Les perspectives actuelles de reprise sont conditionnées à la mise en oeuvre effective du scénario tracé par l'accord de Vienne pour la levée des sanctions.
L'Iran pourrait renouer avec une activité forte : la Banque mondiale prévoit une croissance de l'ordre de 5 % du PIB dès 2016, qui devrait se prolonger pendant plusieurs années. On anticipe en effet la relance du commerce extérieur et des investissements étrangers, mais aussi la disponibilité nouvelle des quelque 100 à 150 milliards de dollars d'avoirs iraniens à l'étranger qui ont été gelés du fait des sanctions. Ce redémarrage implique toutefois que le gouvernement iranien mette en place certaines réformes structurelles. Ces réformes impliquant une diminution du contrôle de l'économie par les Pasdarans, elles risquent naturellement de rencontrer une forte opposition... Il semble néanmoins qu'un certain consensus se soit noué, pour libéraliser graduellement l'économie, au sein de la société iranienne.
Naturellement, notre groupe de travail s'est penché façon plus large sur le devenir de cette société. Notre rapport, à cet égard, se fonde principalement sur les auditions que nous avons menées à Paris, car il ne nous a pas été possible de rencontrer librement des représentants la société civile pendant notre déplacement - très encadré - en Iran. Le pays, malgré une image internationale marquée par le dossier nucléaire, ne se réduit pas à son régime politique, ni ce régime aux idées simplistes que l'on en donne parfois.
L'Iran se trouve depuis 1979 sous l'emprise d'un système de gouvernement se voulant théocratique, en grande partie à la main du Guide suprême. Toutefois, ce système présente paradoxalement des aspects démocratiques ; nos interlocuteurs iraniens se sont d'ailleurs fait fort de souligner que le président de la République était élu (Hassan Rohani, en juin 2013, l'a été avec un taux de participation remarquablement élevé de 72,7 %) et que le Parlement (Majles) était influent : il peut s'opposer à la nomination de ministres et provoquer leur destitution. Et on distingue plusieurs courants politiques.
Une vision un peu manichéenne conduit souvent à opposer, d'un côté, un courant conservateur, idéologiquement dur - proche du Guide Khamenei et des milieux sécuritaires, incarné par le Président Ahmadinejad entre 2005 et 2013 et, depuis 2012, majoritaire au Parlement - et, de l'autre côté, un mouvement réformateur-modéré que représenterait, aujourd'hui, le gouvernement Rohani. Mais la réalité paraît plus complexe. Ainsi, le Président Ahmadinejad, considéré comme ultra-conservateur, a été jusqu'à présent le seul président laïc de la République islamique. Inversement, la candidature d'Hassan Rohani a été nécessairement autorisée par le Guide, puis son élection ratifiée par celui-ci. En fait, il ne paraît pas possible aujourd'hui de gouverner, en Iran, sans l'aval du Guide : il n'y a pas d'opposition véritable.
La situation récemment observée dans le pays en matière de droits de l'Homme tend hélas à le prouver. L'arrivée au pouvoir du Président Rohani avait fait naître l'espoir d'une amélioration en ce domaine ; ces espoirs sont aujourd'hui déçus. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'Homme en Iran, M. Ahmed Shaheed, dans son rapport de mars dernier, a souligné la dégradation continue de la situation, regardant les exécutions capitales, la liberté d'expression ou la situation de certaines minorités - même si notre attention a été attirée sur le fait que les chrétiens, les juifs et les zoroastriens disposaient en Iran d'une représentation parlementaire.
J'ajoute que la condition des femmes est difficile. La Révolution islamique a maintenu certains des acquis du mouvement d'émancipation qu'avaient conduit les shahs Pahlavi - droit de vote, scolarisation, incitation à faire des études. À peine un quart des Iraniennes étaient alphabétisées en 1979, contre près de 90 % aujourd'hui, et 60 % des étudiants iraniens, toutes disciplines confondues, sont des étudiantes. Mais elles souffrent, notamment, de la tenue vestimentaire qui leur est imposée en public, de restrictions en termes d'accès à l'emploi ou de présence dans l'espace social - les manifestations sportives, entre autres -, et de l'abaissement de leur âge légal de mariage. Cet âge légal est de quinze ans depuis 2004, contre neuf ans en 1979, alors qu'il était de dix-huit ans avant la révolution.
Il est vrai que les marges de manoeuvre du gouvernement paraissent étroites, sur ces sujets, face aux résistances des milieux les plus conservateurs, tant au sein du régime que dans la société rurale. La société iranienne actuelle, néanmoins, est composée d'une classe moyenne importante et éduquée, et jeune - 55 % des habitants ont moins de 30 ans ; cette composante peut être considérée comme la promesse d'un autre avenir. Le « Mouvement Vert », issu de la protestation populaire à laquelle a donné lieu la réélection de M. Ahmadinejad à la présidence de la République, en juin 2009, avait paru incarner cette promesse. Aujourd'hui, la résignation au régime semble plus grande ; peut-être a-t-elle été favorisée par l'attente de l'issue des négociations sur le programme nucléaire. La normalisation rendue possible par l'accord de Vienne pourrait favoriser une évolution positive. À court terme, en tout cas, une nouvelle révolution, qui impliquerait de nouveaux sacrifices pour le peuple iranien, ne semble pas l'issue la plus probable : les progrès resteront sans doute lents à prendre forme. Le résultat des prochaines élections législatives iraniennes, prévues en mars 2016, devrait en constituer un bon indicateur.
Ce panorama de l'Iran dressé, notre groupe de travail s'est naturellement interrogé sur la façon dont la France doit orienter sa relation avec le pays. Les liens franco-iraniens ont une histoire longue, ponctuée de nombreux aspects positifs. L'appauvrissement récent de cette relation, notamment sur le plan des échanges culturels, a résulté de motifs d'ordre conjoncturel : le dossier nucléaire.
D'une part, dans le contexte des sanctions internationales appliquées à l'Iran depuis 2006-2007, les échanges économiques entre nos deux pays se sont considérablement restreints. Les importations françaises en provenance d'Iran ont connu une chute brutale, passant de 1,77 milliard d'euros en 2011 à 48 millions d'euros en 2013, en raison de l'arrêt des importations de pétrole iranien à la suite de l'embargo européen total décidé, en la matière, en janvier 2012. Nos exportations vers l'Iran, de même, ont fortement diminué, s'établissant à 453 millions d'euros en 2014, contre 1,66 milliard en 2011. Les difficultés commerciales ont pour partie résulté d'un problème de financement : les banques françaises, qui effectuent leurs transactions en dollar, se trouvent presque toutes exposées au dispositif de sanctions des États-Unis ; en considérant la « jurisprudence » dégagée l'occasion de l'affaire BNP-Paribas en 2014, ces banques ont souvent refusé de prendre en charge les transactions financières avec l'Iran, même dans des secteurs pourtant non ciblés par les sanctions. Sur place, en conséquence, d'autres firmes européennes, mais surtout des sociétés chinoises, coréennes et turques, se sont substituées aux françaises.
D'autre part, les relations politiques entre la France et l'Iran, dans le contexte de la négociation sur le programme nucléaire iranien, ont évidemment été tendues. On peut toutefois gager que les Iraniens savent faire la part des choses, et que la qualité de la relation franco-iranienne ne sera pas durablement affectée par l'histoire récente. Les signes de restauration de nos liens sont déjà tangibles.
Au plan politico-diplomatique, la normalisation a été amorcée, deux semaines seulement après l'accord de Vienne, par la visite officielle du ministre français des affaires étrangères à Téhéran, qui s'est bien déroulée. Le 27 septembre dernier, en marge de l'assemblée générale des Nations Unies, le Président de la République et son homologue iranien, M. Rohani, se sont entretenus. À cette occasion, deux idées fortes ont été exprimées, auxquelles souscrit notre groupe de travail : le rôle majeur de l'Iran sur la scène régionale appelle un dialogue franco-iranien nourri, et nos deux pays doivent renouer avec les projets économiques conjoints. Une visite du Président Rohani en France est désormais annoncée pour le mois de novembre prochain.
Il est en effet indispensable de rétablir un dialogue politique continu, au plus haut niveau, entre la France et l'Iran, en vue du règlement des crises en Irak, en Syrie, au Liban, en Palestine... Certes, le sens de l'implication iranienne sur la scène régionale reste sujet à caution ; le soutien actuel fourni par le régime de Téhéran à celui de Damas, entre autres, l'éloigne des options défendues par la diplomatie française. Néanmoins, compte tenu du poids du pays dans la région, il s'agit pour nous d'un interlocuteur nécessaire.
Au plan économique, dans un contexte de concurrence internationale très forte, diverses missions d'entreprises françaises se sont rendues, récemment, en Iran. En dernier lieu, au mois de septembre dernier, une délégation de près de 150 entreprises conduites par le MEDEF a accompagné la visite de Iran du ministre français de l'agriculture et du secrétaire d'État chargé, notamment, du commerce extérieur. Les discussions ont d'ores et déjà permis d'identifier les secteurs dans lesquels l'expertise française est attendue : l'industrie pétrolière - Total se trouve bien positionné ; le secteur automobile - Renault et Peugeot sont historiquement présents en Iran, et une étude réalisée par Renault estime que le marché iranien pourrait atteindre deux millions de voitures d'ici cinq ans ; l'aéronautique - vu l'âge moyen de la flotte civile iranienne, le besoin est estimé de 400 à 500 avions de ligne sur les dix prochaines années ; l'agriculture, en particulier dans le domaine de l'irrigation, et l'agro-alimentaire - des accords bilatéraux sont d'ores et déjà signés en ce domaine ; le tourisme, pour lequel le potentiel est considérable...
La reprise des investissements français en Iran suppose cependant la réouverture des canaux bancaires. Mais nos entreprises ont manifestement la possibilité de jouer l'atout que constitue, pour leur réimplantation dans le pays, la bonne image dont y jouit toujours le nôtre. Nous approuvons donc l'effort d'appui engagé par l'État en ce domaine : récente ouverture d'un bureau de Business France à Téhéran, renforcement du service économique de notre ambassade, mise en place d'une commission mixte bilatérale... Il convient bien sûr de prolonger cet effort.

Un mot encore sur notre coopération culturelle avec l'Iran, qui s'avère aujourd'hui modeste.
Il n'y a pas d'Institut français à Téhéran ; les autorités iraniennes ne l'ont pas permis. On ne trouve dans la ville qu'un « Centre de langue française ». L'activité de cet établissement est réelle, mais elle a été mise en sommeil, à la fin de l'année 2011, faute d'autorisation des autorités iraniennes ; le Centre n'a pu reprendre ses cours de langue qu'en juillet 2013. Cette activité pourrait connaître un vif essor, car la demande est croissante, mais cela supposerait l'aménagement de nouveaux locaux. Or, si l'implantation immobilière de l'établissement rend l'opération possible, celle-ci requiert des financements nouveaux. Par ailleurs, l'Institut français de recherche en Iran (IFRI), dont la mission est de promouvoir la recherche sur le « monde iranien », fonctionne au ralenti, ce qui est préjudiciable à notre faculté d'appréhension du pays.
En France, l'accueil d'étudiants iraniens est limité : ils sont au nombre de 1 800, bon an, mal an, actuellement. Un partenariat scientifique franco-iranien, de type « Hubert Curien », semble donner de bons résultats. Toutefois, les études iraniennes en France sont de moins en moins nombreuses, malgré l'activité de spécialistes de renom et d'une jeune génération talentueuse de chercheurs.
Nos capacités d'analyse de la société iranienne doivent dont être restaurées. D'une manière générale, je pense que notre politique d'influence envers l'Iran - et, à partir de l'Iran, dans la région - passe par la relance des différents pôles de notre coopération culturelle. Cette dimension est en effet partie intégrante de la vision que la France doit désormais construire de sa relation avec cette puissance régionale majeure, que notre groupe de travail appelle de ses voeux à la densité.
Il s'agit, non seulement d'offrir de nouveaux appuis au développement de nos entreprises, mais aussi de relayer nos positions au Proche et Moyen-Orient, au bénéfice en particulier de la résolution des crises, et d'y préserver nos intérêts en rééquilibrant nos alliances actuelles. En effet, la France n'a pas à prendre parti entre le monde sunnite et le monde chiite. Félicitons-nous de la qualité actuelle de la coopération politique et militaire française avec l'Égypte, l'Arabie saoudite ou les Émirats arabes unis, mais ne négligeons pas les leviers majeurs d'influence, dans la région, de la relation franco-iranienne, qui s'inscrit dans une longue histoire.
Il s'agit encore de favoriser la diffusion de notre culture et de nos valeurs. Car coopérer en faveur de la gestion des crises ou du redémarrage des investissements sur place n'implique en rien d'acquiescer aux principes défendus par la République islamique, ni de se rallier à sa vision du monde. Au contraire, l'enjeu pour la France est de faire rayonner ses valeurs, en poursuivant avec le régime de Téhéran un échange, le cas échéant, critique - que ce soit en matière de diplomatie ou sur les droits de l'Homme.
Les Présidents Hollande et Rohani sont tombés d'accord sur l'élaboration d'une « feuille de route » commune. Ce document devrait à nos yeux comporter un certain nombre de projets précis. Au plan politique, la lutte contre le terrorisme et la coopération en faveur du règlement des crises régionales doivent guider les termes de ce partenariat. C'est la mobilisation des savoir-faire et de l'excellence de notre pays qui doit permettre de déterminer les autres volets.
Pour ce qui concerne la coopération économique, la France pourrait apporter son soutien d'expertise à la restauration des circuits de financement bancaires des investissements en Iran et de l'Iran, un appui de conseil à l'amélioration par le pays de son environnement des affaires (droit, fiscalité, lutte contre la corruption), et l'accompagnement technique de la candidature iranienne, si elle se confirme, à l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Des jumelages entre chambres de commerce et d'industrie iraniennes et françaises pourraient également figurer de façon opportune dans cette collaboration, ainsi qu'un projet de coopération entre les services français et iraniens chargés du développement touristique.
Pour ce qui concerne la coopération culturelle, il conviendrait d'assurer le soutien de l'Iran au ré-essor de nos établissements culturels à Téhéran, dont j'ai indiqué la situation actuelle. Il s'agirait de faciliter, notamment, la reprise des missions de chercheurs français, et de relancer les fouilles archéologiques menées en commun dans le pays - les fouilles archéologiques ont toujours constitué un excellent vecteur diplomatique ! L'extension des capacités d'accueil de l'école française devrait également figurer dans ce programme, dans la mesure où le redémarrage économique devrait donner lieu au retour, en Iran, d'une expatriation professionnelle française. La France, de son côté, devrait s'engager à augmenter le nombre d'étudiants iraniens qu'elle accueille. Eu égard au potentiel des grands musées français, à commencer par le Louvre, et des musées iraniens - ceux de Téhéran, d'Ispahan, de Chiraz, etc. -, une coopération spécifique pourrait être mise en oeuvre avec profit, au moyen de prêts d'oeuvres et d'expositions croisées.
En résumé, la France doit saisir l'opportunité que représente le nouveau contexte créé par l'accord de Vienne - elle y a contribué -, pour reprendre pied en Iran, parler avec les Iraniens, être aux côtés de la société civile sans se rallier au régime, et rétablir ainsi une relation dont l'histoire est au moins tricentenaire. Les projets que nous proposons seront autant de leviers de notre influence. Notre pays paraît en effet avoir un rôle à jouer, auquel il doit se préparer, dans l'accompagnement des mouvements plus ou moins lents qui se trouvent aujourd'hui en gestation en Iran - ouverture de l'économie, essor d'une société plus libre ; notre groupe de travail tient d'ailleurs à marquer sa confiance dans ces évolutions.

L'Iran est un pays de paradoxes. C'est ainsi par exemple qu'au-delà de la rigidité de son régime actuel, on y découvre encore une grande civilisation millénaire.
La société iranienne s'est-elle désormais résolue à ce qu'on pourrait appeler un « obscurantisme modéré » ? Il s'agit là pour nous d'une interrogation encore sans réponse. Toutefois, des changements sont manifestement en cours. Certes, la question des droits de l'Homme apparaît encore très lourdement posée ; à cet égard, j'approuve ce qui vient d'être dit par mes collègues. Un pays ne peut pas être une démocratie s'il ne respecte pas la liberté d'expression. La condition des femmes représente une autre préoccupation forte : on perçoit l'existence d'une tension, entre celles qui supportent mal l'obligation vestimentaire qui leur est imposée et les composantes les plus religieuses de la société. Il est encore difficile d'imaginer les voies futures de possibles évolutions. Mais il faut souhaiter ces évolutions et, dans cette attente, ne pas « diaboliser » tout le pays.
D'autant que la francophilie apparaît encore comme très vive en Iran. Beaucoup de traces de notre relation avec le pays, datant d'avant la Révolution islamique, y subsistent. Dans le domaine économique, aujourd'hui, les attentes iraniennes placées dans la France sont grandes ; nous l'avons particulièrement mesuré lors de notre visite à la chambre de commerce et d'industrie d'Ispahan, à l'occasion de nos échanges avec les entrepreneurs locaux. C'est le cas, par exemple, en ce qui concerne le tourisme : notre savoir-faire en la matière est reconnu, qu'il s'agisse de politique touristique, d'hôtellerie, de communication... C'est un marché sur lequel nos entreprises ne doivent pas manquer de prendre l'avantage. D'ailleurs, j'observe que le groupe Accor, le 15 septembre dernier, a déjà conclu un contrat d'exploitation pour un hôtel Ibis et un Novotel, situés l'un et l'autre à l'aéroport de Téhéran ; il s'agit du premier groupe hôtelier international à s'implanter en Iran depuis la révolution de 1979, et du premier retour dans le pays d'une multinationale depuis l'accord de Vienne. C'est un très bon signe !

Les échanges entre la France et l'Iran ont été fortement mis à mal dans la période récente, notamment au plan de l'économie et du commerce, du fait des sanctions internationales. Ces échanges, à présent, reprennent ou sont sur le point de reprendre ; de ce point de vue, le rapport de notre groupe de travail me paraît intervenir de façon très opportune !
Différents obstacles doivent être levés, à l'initiative du gouvernement iranien, pour rendre à nouveau possible la croissance du pays. Il s'agit notamment de remédier à l'inflation et de libéraliser progressivement l'économie. Par ailleurs, les banques iraniennes doivent se réinsérer dans le cadre international et européen, en recréant le réseau de correspondants à l'étranger qu'elles ont perdu à la suite des embargos. La reprise de partenariats importants avec l'Iran sera conditionnée à l'amélioration de l'environnement des affaires. Cela ne sera sans doute pas facile, compte tenu des probables résistances sociales.
On observe déjà des avancées tangibles dans le démarrage de la reconstruction des liens bilatéraux : des délégations d'entreprises et des ministres français se rendent en Iran, le Président Rohani sera bientôt en visite officielle en France, le Président du Sénat a annoncé son propre déplacement, d'ici la fin de l'année, dans le pays... Pour ma part, je crois qu'un puissant facteur de reconsolidation tiendra au développement de partenariats régionaux, entre, d'une part, les régions et chambres de commerce et d'industrie françaises et, d'autre part, les provinces et chambres de commerce et d'industrie iraniennes. La chambre de commerce et d'industrie des Pays-de-Loire s'est déjà rapprochée de son homologue d'Ispahan, qui a reçu notre groupe de travail et où nous avons pu constater, comme l'a dit Michelle Demessine, que la coopération française est bel et bien attendue.

La restauration de la relation franco-iranienne exige des signes politiques forts. À la suite de l'attitude et des paroles du ministre des affaires étrangères français dans le cadre de la négociation sur l'accord nucléaire, il y a encore beaucoup de susceptibilités blessées en Iran ; tout n'est pas encore « digéré ». Mais je pense que le Gouvernement et le Président de la République vont prendre l'initiative dans ce domaine.
En rebond aux propos de Joël Guerriau, je souhaite indiquer que beaucoup de difficultés existent encore pour le retour des petites et moyennes entreprises (PME) françaises en Iran. Il ne faudrait pas que les grandes entreprises soient les seules à bénéficier de l'appui des services de l'État et à se trouver associées aux grandes missions organisées sur place ! Nos PME, créatrices d'emplois, qui sont prêtes à développer de nouveaux marchés dans cette région du monde, restent fortement handicapées par la paralysie du réseau bancaire liée à l'affaire BNP-Paribas.
Je crois donc qu'il faut demander au Gouvernement de prendre très vite des initiatives pour que des PME qui ne peuvent se lancer seules dans cette nouvelle aventure soit épaulées par les réseaux publics, comme la Coface, mais aussi par les banques privées, afin qu'elles puissent développer de nouvelles relations avec l'Iran.

Je voudrais féliciter les rapporteurs pour leur excellent travail. Chers collègues, vous avez eu raison de rappeler l'histoire de ce grand pays qu'est l'Iran et la relation très forte que nous avons entretenue avec lui pendant longtemps. Nous ne pouvons que nous réjouir d'une reprise des relations bilatérales dans tous les domaines, et notamment en matière commerciale.
Vous avez indiqué que l'armée iranienne ne poursuit pas de but offensif, officiellement. L'Iran ne semble toutefois pas étranger à ce qui se passe au Yémen ! Dans le cadre de l'ouverture actuelle, existe-t-il des opportunités dans le secteur de la défense ? Quelle est la position de la France vis-à-vis de l'Iran dans ce domaine particulier d'activité, qui contribue à souder notre relation, aujourd'hui, avec l'Arabie saoudite ou les Émirats ?
Par ailleurs, s'agissant du domaine culturel, avez-vous noté une volonté du ministère des affaires étrangères de soutenir la relance que vous appelez de vos voeux, notamment par le biais de nos établissements culturels à Téhéran ?

Merci à nos collègues pour leur excellent rapport et, aussi, pour nous avoir présenté, en juillet dernier, leurs conditions de voyage. C'était très intéressant.
Je pense que l'Iran est maintenant libéré du dossier nucléaire et que le bazar de Téhéran va jouer son rôle en termes économiques.
Malgré un régime actuel assez dur, on perçoit dans la société iranienne une certaine respiration. Elle tient, notamment, à la vitalité du cinéma national : certains films, que les Iraniens peuvent voir dans leur pays, laissent passer un regard critique, même sur le plan religieux.
En ce qui concerne les rapports entre sunnites et chiites, les Iraniens n'aiment guère que l'on parle d'affrontement. Ils reconnaissent des tensions, mais nous reprochent de ne pas dire que celles-ci tiennent à la « wahhabitisation » de l'islam. On en voit les ravages, même en Europe, et on ne le dénonce pas assez pour des raisons économiques.

Les Iraniens ne nous reprochent pas directement notre relation avec les pays du Golfe, mais ils estiment que les livraisons d'armes ne favorisent pas la paix au Moyen-Orient. Il est par ailleurs bien clair que les perspectives du commerce des armes entre la France et l'Iran ne sont pas aujourd'hui à l'ordre du jour ! Ils ont le sentiment de jouer un rôle positif au Proche et Moyen-Orient et considèrent qu'ils y constituent un élément de stabilité. Quand nous faisons remarquer à nos interlocuteurs que la situation n'est pas si claire, que l'implication régionale de l'Iran est armée, ils répondent que cela n'est rien à côté de ce que font l'Arabie saoudite et les autres monarchies du Golfe.
Nous appelons au rééquilibrage des alliances de la France. Nous n'avions pratiquement plus de liens avec l'Iran, avant l'accord de Vienne ; il nous faut retrouver notre relation avec ce pays. Un tel rééquilibrage ne signifie pas l'abandon des liens noués avec le monde sunnite ; c'est un renforcement de la position de la France dans la région que nous visons, en montrant qu'elle n'est pas d'un côté ou de l'autre, mais qu'elle est en faveur de la stabilité au Moyen-Orient.
Durant notre déplacement en Iran - au début du mois de juin -, nous nous sommes inscrits dans la perspective de la réussite de la négociation sur le programme nucléaire iranien. Cette issue était alors encore très peu certaine. Considérant qu'on allait parvenir à signer un accord, nous avons demandé à nos interlocuteurs de définir leur position pour favoriser la résolution des crises. Nous avons trouvé des responsables ouverts, qui traduisaient la position du gouvernement iranien.
Une précision sur les Pasdarans : ce corps des « Gardiens de la Révolution islamique » a été créé en 1979 pour encadrer idéologiquement et matériellement la révolution. Ils ont très largement participé à la guerre en Irak ; leur rôle était d'encadrer l'armée, dont le régime se méfiait à l'époque. Il s'agit aujourd'hui de 230 000 hommes environ, dont 130 000 militaires. Ils ont totalement pénétré la société civile en contrôlant une part importante de l'économie iranienne.

La société iranienne a toujours été francophile. Il nous paraît donc important de recréer, entre nos deux pays, un maximum de liens à travers un maximum de canaux. C'est la meilleure action à mener.
Le ministère des affaires étrangères exprime son intention de renforcer notre coopération culturelle avec l'Iran ; cela me paraîtrait en effet éminemment souhaitable. Mais il faudra obtenir des Iraniens qu'ils acceptent, à Téhéran, le développement des activités de nos établissements culturels. Par exemple, on ne peut pas, actuellement, créer un véritable Institut français : il faut le camoufler sous les aspects du Centre de langue française, sans quoi les autorités iraniennes ne donneraient pas leur accord. Il convient donc de leur dire que la France est prête à faire davantage, à condition qu'ils l'y autorisent, et, parallèlement, développer le nombre d'étudiants iraniens qui sont accueillis, chaque année, dans notre pays : 1 800, ce n'est pas assez !
J'insiste également sur le fait qu'il faut recréer, en France, un pôle d'études sur l'Iran qui soit véritablement digne de l'importance de cette civilisation et de ce pays, ainsi que des enjeux qui s'attachent, pour nous, à mieux les comprendre.
La commission adopte le rapport des co-présidents du groupe de travail et en autorise la publication sous la forme d'un rapport d'information.
La commission examine le rapport de M. Gilbert Roger et le texte proposé par la commission pour le projet de loi n° 696 (2014-2015) autorisant la ratification du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac.

Le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac a été adopté en novembre 2012 à Séoul. Il s'inscrit dans le prolongement de l'article 15 de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (CCLAT), qui énonçait les principales mesures à mettre en oeuvre pour lutter efficacement contre le commerce illicite des produits du tabac.
La France fait partie des premiers pays ayant signé ce protocole. Il n'entrera en vigueur qu'après le dépôt du quarantième instrument de ratification. Au 4 septembre, seuls neuf États l'avaient ratifié.
Quel est l'intérêt de ce protocole ?
L'Organisation mondiale des douanes estime qu'une cigarette sur dix fumée dans le monde pourrait être issue du commerce illicite. Dans notre pays, alors que 200 tonnes étaient saisies par la direction générale des douanes et des droits indirects en 2005, 500 tonnes l'ont été au cours du seul premier semestre 2015 ! Les trafics peuvent certes concerner des produits du tabac authentiques, fabriqués dans les usines des cigarettiers, mais détournés, ou des contrefaçons de marques légales. Mais, comme nous l'ont indiqué les représentants des douanes lors d'une audition que j'ai menée, il s'agit de plus en plus souvent de ce que l'on appelle des « illicit whites », c'est-à-dire soit des cigarettes produites par des fabricants moins connus que les majors et non autorisées en France (par exemple la marque American Legend produite par Karelia au sein de l'UE), soit des cigarettes sans aucune existence légale dont les fabricants sont inconnus. La contrebande des produits authentiques des grandes marques, qui étaient très importante au début des années 2000, à tel point qu'on a des raisons de penser qu'elle était soutenue par les industriels eux-mêmes, reste significative mais a fortement diminué depuis les accords signés par l'Union européenne avec ces grandes marques entre 2004 et 2010.
Plusieurs raisons plaident pour une intensification de la lutte contre ce phénomène.
Le commerce illicite des produits du tabac est en grande partie sous la coupe d'organisations criminelles agissant dans le monde entier et éventuellement actives dans les trafics de drogue, la traite des êtres humains ou encore le terrorisme.
En outre, au plan international, l'étude d'impact jointe au projet de loi fait état d'une estimation de 40 milliards de dollars de pertes totales de revenus fiscaux en raison du commerce illicite des produits du tabac en 2010. Dans une communication au Conseil et au Parlement européen, la Commission européenne estimait en juin 2013 que le commerce illicite de cigarettes entraîne des pertes annuelles de plus de 10 milliards d'euros au sein de l'Union européenne, résultant du non-paiement des droits de douane et des taxes.
Enfin, est-il besoin de rappeler que selon l'OMS, Le tabac tue près de 6 millions de personnes chaque année dans le monde, parmi lesquelles plus de 5 millions sont des fumeurs et plus de 600 000 des non-fumeurs exposés au tabagisme passif ?
La ratification de ce protocole serait ainsi avant tout de notre part un geste bénéfique pour l'ensemble des pays signataires en créant un effet d'entraînement afin de se rapprocher des 40 ratifications nécessaires à l'entrée en vigueur du texte au plan international.
Mais c'est aussi la situation singulière de notre pays qui doit nous inciter à ne pas relâcher nos efforts et à faire feu de tout bois pour lutter contre le tabagisme.
En effet, d'après l'eurobaromètre publié par la commission européenne en mai dernier, la France se place au quatrième rang au sein de pays de l'Union pour la prévalence de la consommation de tabac avec 32 % de fumeurs réguliers derrière la Grèce, la Bulgarie et la Croatie. Selon le même baromètre, notre pays est l'un des cinq seuls qui ait vu cette prévalence augmenter depuis 2012, et c'est celui qui a connu l'augmentation la plus forte : + 4%.
Je pense qu'il n'est pas nécessaire de rappeler en détail à quel point le tabac est un fléau de santé publique dans notre pays où 73 000 personnes meurent chaque année prématurément du fait de sa consommation selon l'INPES (institut national de prévention et d'éducation pour la santé). Il est probable qu'aux risques sanitaires bien connus du tabac légal s'ajoutent, dans le cas des contrefaçons et des cigarettes non autorisées en France, des risques supplémentaires.
En outre, la contrebande de tabac va bien entendu directement à l'encontre de la politique fiscale du tabac qui constitue un des principaux leviers de la politique de santé publique en la matière. Le renforcement de la lutte contre le commerce illicite est ainsi nécessaire pour protéger les prix pratiqués au sein du réseau des buralistes.
Pour l'ensemble de ces raisons, le Programme national de réduction du tabagisme, adopté en conseil des ministres en septembre 2014, prévoyait la ratification de ce protocole.
Quels sont les principaux axes de ce texte ?
Le premier de ces axes comporte un ensemble de mesures destinées à améliorer le contrôle de la chaîne logistique de commercialisation du tabac. Il s'agit ainsi de soumettre à une licence la fabrication des produits du tabac et de matériel de fabrication, ainsi que leur importation et exportation.
Les acteurs de la chaîne logistique auront par ailleurs une obligation de vigilance. Ils devront en particulier contrôler les ventes pour vérifier que les quantités sont proportionnées à la demande sur le marché de destination et ne servent pas en réalité à alimenter en contrebande d'autres marchés, ce qui est une pratique répandue.
Enfin, le protocole prévoit la mise en place de systèmes de suivi et de traçabilité interopérables permettant de retracer les mouvements des produits du tabac au plan international. Bien entendu, il s'agit d'une arme essentielle pour lutter contre la contrebande des cigarettes produites par les marques déposées mais pas par les marques non déclarées. Concernant cette traçabilité, certaines interrogations ont pu se faire jour sur la compatibilité entre les dispositions de l'article 8 du protocole, celles de la directive européenne du 3 avril 2014, qui comporte notamment des mesures relatives à la lutte contre le commerce illicite des produits du tabac, ses articles 15 et 16 établissant un dispositif de traçabilité et de sécurité, enfin celles de l'article 569 du code général des impôts, précédemment modifié par l'article 4 de la loi du 8 août 2014 afin d'assurer la transposition des articles susmentionnés de la directive européenne. En effet, le protocole stipule que chaque partie « instaure (...) un système de suivi et de traçabilité contrôlé par elle » et que « les obligations auxquelles une Partie est tenue ne sont pas remplies par l'industrie du tabac et ne lui sont pas déléguées » tandis que la directive impose seulement que les fabricants et importateurs « concluent un contrat de stockage de données avec un tiers indépendant », solution reprise par l'article 569 du code général des impôts. Ainsi, ce protocole de l'OMS, la directive tabac et l'article 569 du code général des impôts évoquent tous les trois la traçabilité du tabac. Pourtant, ces textes comportent une différence fondamentale et nous devons rester vigilants pour ne pas permettre au final que le contrôle de la traçabilité de la production de cigarettes soit confié aux fabricants de tabac eux-mêmes. Il est donc nécessaire d'avoir des instances et une traçabilité totalement indépendantes. Dès la ratification du protocole, le lancement d'un appel d'offres, au moins pour notre pays, devrait nous rassurer sur cette question.
Il apparaît donc que la ratification du Protocole par la France et par l'Union devra entraîner une obligation de mettre un terme à ce conflit de normes par la modification de l'article 15 de la directive et de l'article 569 du CGI, lesquels devront s'aligner sur le Protocole en vertu des règles du droit international.
Le second axe du protocole consiste en l'amélioration de la répression pénale des trafics illicites de tabac. Le protocole comporte ainsi une liste d'actes illicites liés au trafic des produits du tabac et demande à chaque Partie de prévoir les mesures nécessaires pour que ces actes soient effectivement considérés comme illicites dans leur législation et pour qu'ils fassent l'objet de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives. Le protocole met également l'accent sur l'utilisation plus fréquente de techniques spéciales d'enquête telles que les livraisons surveillées. Sur cette question de la répression, il convient de noter que notre pays dispose déjà, notamment au sein du code pénal, du code des douanes et du code général des impôts, d'une palette d'incriminations complète, avec des peines allant de un à dix ans d'emprisonnement et jusqu'à 500 000 euros d'amende ou cinq fois la valeur de l'objet de la fraude, ce qui permet la mise en oeuvre de sanctions effectives sans qu'il soit nécessaire d'envisager de nouvelles modifications législatives. En revanche, les instruments de répression sont beaucoup moins performants dans d'autres pays pour lesquels l'application du protocole impliquera une mise à niveau importante qui bénéficiera ensuite à tous.
Troisièmement, le protocole prévoit l'amélioration de la coopération internationale en matière de lutte contre le trafic illicite de tabac. Dans notre pays, la douane est déjà engagée dans de multiples actions de coopération aux niveaux européen et international. Le protocole demande à l'ensemble des Parties d'intensifier la coopération en améliorant les échanges d'information, en augmentant les capacités répressives, en collaborant au niveau administratif et judiciaire.
Clef de cette amélioration de la coopération internationale, le protocole prévoit l'instauration d'un « point focal mondial » pour l'échange d'informations dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du protocole. Ce point focal mondial sera probablement situé au Secrétariat de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac. Il comportera des bases de données comportant les informations de traçabilité et de sécurité nécessaire au suivi du commerce du tabac.
Je voudrais enfin évoquer le problème des écarts de taxation des produits du tabac entre les différents pays de l'Union européenne, qui alimente notamment le trafic transfrontalier. Dans sa communication du 6 juin 2013 relative à une stratégie globale de l'Union européenne contre le commerce illicite des produits du tabac, la Commission européenne a ainsi vivement plaidé pour une harmonisation au plan européen afin de lutter contre la contrebande qui profite de ce différentiel de prix entre les pays. Le Gouvernement plaide aussi régulièrement pour une telle harmonisation. Je pense qu'il s'agit là d'un axe de travail important pour les prochaines années.
Suivant l'avis du rapporteur, la commission a adopté le rapport ainsi que le projet de loi précité.
La commission examine le rapport de M. André Trillard et le texte proposé par la commission pour le projet de loi n° 794 (2013-2014) autorisant l'approbation de l'accord relatif aux mesures du ressort de l'Etat du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

en remplacement de M. André Trillard, rapporteur. - Monsieur le Président, Mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord relatif aux mesures du ressort de l'Etat du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. La pêche illicite, non déclarée et non réglementée, dite pêche INN, est un véritable fléau causant des pertes comprises entre 10 milliards d'USD et 23 milliards d'USD par an (entre 9 milliards d'euros et 20,5 milliards d'euros environ) à l'échelle mondiale, selon une étude de 2009, citée par la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.
Elle peut prendre diverses formes : pêche non autorisée dans les eaux sous juridiction nationale, dans des zones couvertes par des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) ou dans des zones protégées, captures d'individus trop jeunes ou d'espèces protégées, utilisation d'engins de pêche prohibés, non-déclaration des prises etc.
Elle compromet les actions entreprises en faveur d'une pêche responsable et constitue une menace pour la gestion et l'exploitation durable des ressources halieutiques, entraînant l'épuisement des stocks de poisson et la détérioration des écosystèmes. Elle a aussi pour effet d'augmenter la malnutrition, de réduire les revenus des communautés vivant de la pêche artisanale, et indirectement le développement des pays concernés. Enfin, elle se déroule le plus souvent dans des conditions de travail déplorables, voire d'esclavage et sans grande considération pour la sécurité en mer.
En mars 2007, en réponse à une demande de la communauté internationale, le Comité des pêches de la FAO a décidé l'élaboration d'un instrument international juridiquement contraignant sur la base du Plan d'action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche INN et du Dispositif type relatif aux mesures du ressort de l'Etat du port dans le contexte de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée adoptés par la FAO. Ces instruments facultatifs préconisent l'application des mesures de l'Etat du port qui sont rapidement apparues comme un outil déterminant dans la lutte contre la pêche INN.
L'accord que nous examinons aujourd'hui a fait l'objet de la Résolution 12/2009, adoptée par la Conférence des Parties, en novembre 2009. Il prévoit l'application d'une norme mondiale minimale, sur le fondement de laquelle les Parties peuvent interdire l'entrée dans leur port et l'accès aux services de celui-ci, aux navires ne battant pas leur pavillon, et se livrant à des activités de pêche INN, à l'exception des « navires d'un Etat voisin se livrant à une pêche artisanale de subsistance, à condition que l'Etat du port et l'Etat du pavillon coopèrent pour faire en sorte que les navires » ainsi que des « navires porte-conteneurs qui ne transportent pas de poisson ou s'ils en transportent, seulement du poisson qui a été débarqué auparavant », sous réserve de l'absence de suspicion. Déclinons maintenant ces mesures.
Tout d'abord, l'autorisation ou le refus d'entrée dans le port.
Les Parties désignent les ports dans lesquels les navires peuvent entrer et en communiquent la liste à la FAO qui en assure la publicité. L'autorisation d'entrée dans le port est subordonnée à la transmission préalable d'informations précises. En cas de preuves avérées de pêche INN, les Parties ont l'obligation d'interdire l'accès à leur port. À titre dérogatoire, elles peuvent laisser entrer le navire dans le seul but de l'inspecter et de prendre « d'autres mesures appropriées conformes au droit international et au moins aussi efficaces ».
Deuxièmement, le refus de l'utilisation des ports.
Une Partie a le droit de refuser l'utilisation de son port pour le débarquement, le transbordement, le conditionnement et la transformation du poisson, ainsi que l'approvisionnement en carburant, l'avitaillement, l'entretien et la mise en cale sèche par exemple, à un navire auquel elle a accordé préalablement une autorisation d'accès, si elle constate que celui-ci ne dispose pas d'autorisation valide ou si le poisson à bord a une origine illicite ou encore en cas de fortes suspicions.
En dernier lieu, les inspections et actions de suivi.
Les Parties sont tenues d'effectuer un nombre annuel d'inspections suffisant pour atteindre l'objectif de l'accord. Elles sont invitées à s'accorder sur des niveaux minimaux d'inspection, par l'intermédiaire notamment des organisations régionales de gestion des pêches ou de la FAO.
L'accord fixe le contenu minimal de la formation des inspecteurs, de la procédure d'inspection ainsi que du rapport d'inspection.
La mise en place d'un système électronique, coordonné de préférence par la FAO, permettant l'échange électronique direct d'informations et répondant à des critères précis est encouragée.
Les mesures de l'Etat du port font l'objet d'une publicité auprès du navire, de l'Etat du pavillon du navire, ainsi que dans la mesure du possible, des Etats côtiers, des organisations régionales de gestion des pêches et autres organisations internationales concernés.
Après avoir rappelé les obligations de l'Etat du pavillon à l'égard de ses navires, cet instrument accorde une considération particulière aux besoins spécifiques des Etats en développement, qui se traduit par la fourniture d'une assistance technique et financière, soit directement, soit par l'intermédiaire de la FAO, d'autres institutions spécialisées des Nations unies ou d'autres organisations ou organes internationaux appropriés. Un groupe de travail ad hoc est constitué en vue de l'élaboration de ces mécanismes de financement.
Après un examen attentif, je recommande l'adoption de ce projet de loi qui représente une avancée juridique importante et attendue dans la lutte contre la pêche INN, puisque cet accord n'est toujours pas entré en vigueur faute d'un nombre suffisant de ratifications. Je précise que son application ne posera pas de problème, dans la mesure où un règlement communautaire, d'un niveau d'exigence au moins équivalent et poursuivant le même objectif, s'applique déjà sur notre territoire depuis 2010 et que le code rural et de la pêche maritime prévoit déjà un dispositif de contrôle assorti de sanctions dans les ports.
L'examen en séance publique est fixé au mercredi 14 octobre 2015. La Conférence des Présidents a proposé son examen en procédure simplifiée.
Suivant l'avis du rapporteur, la commission adopte le rapport ainsi que le projet de loi précité.
Approbation de l'amendement à la convention sur l'accès à l'information la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement pris par décision ii-1 adoptée dans le cadre de la deuxième réunion des parties à la convention
Examen du rapport et du texte de la commission
La commission examine le rapport de M. Cédric Perrin et le texte de la commission pour le projet de loi n° 482 (2014-2015) autorisant l'approbation de l'amendement à la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, pris par décision II-1 adoptée dans le cadre de la deuxième réunion des Parties à la convention.

Monsieur le Président, Mes chers collègues, nous examinons le projet de loi autorisant l'approbation de l'amendement à la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.
Cette Convention dite « convention d'Aarhus », a été adoptée le 25 juin 1998, à Aarhus, au Danemark, sous l'égide de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies. Elle a pour objet de reconnaître à chacun le droit de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être. Elle accorde un certain nombre de droits fondamentaux aux citoyens et aux associations qui les représentent dans le domaine de l'environnement. Ces droits constituent une norme minimale contraignante pour les États qui ont choisi d'y adhérer et qui sont regroupés en trois piliers.
D'abord l'accès à l'information sur l'environnement : il prévoit que les autorités publiques mettent à la disposition, de toute personne physique ou morale qui en fait la demande, les informations relatives à l'environnement requises, et ce, dans les meilleurs délais.
Deuxièmement, la participation au processus décisionnel en matière d'environnement : il est fondé sur le Principe 10 de la « Déclaration de Rio » qui déclare que « la meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens au niveau qui convient ». Il met à la charge des États Parties une série d'obligations assurant la participation du public lorsqu'il s'agit d'autoriser certaines activités répertoriées à l'annexe 1. À titre d'exemple, on peut citer celles relevant du secteur de l'énergie, de la production et de la transformation de métaux, de l'industrie chimique, de la gestion des déchets, du traitement des eaux usées, de l'extraction de gaz et de pétrole, de la construction d'autoroutes etc...
Troisièmement, l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement : ce dernier pilier conforte les deux précédents et garantit l'application effective de la convention en accordant un droit de recours.
La dissémination volontaire dans l'environnement et la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés (OGM) ne figurait pas dans la liste des activités requérant la participation du public. C'est pourquoi, les États Parties à cette convention ont demandé l'application de la convention à la question des OGM; ce qui a abouti à l'adoption, en mai 2005, de « l'amendement OGM » à la convention, que nous examinons aujourd'hui.
Cet « amendement OGM » exige que les Parties informent et associent le public de manière « précoce et effective », avant d'autoriser ou non la dissémination volontaire dans l'environnement d'OGM et leur mise sur le marché.
L'annexe I bis décline cette exigence sous la forme d'une série d'obligations : l'obligation de mettre à la disposition du public un résumé de la notification visant à obtenir une autorisation ainsi que le rapport d'évaluation ; l'obligation de ne pas considérer comme confidentielles certaines informations, notamment la description générale de l'OGM concerné, le nom et l'adresse du demandeur de l'autorisation de dissémination volontaire, les utilisations prévues, le lieu de la dissémination, les méthodes et plans de suivi de l'OGM, les méthodes et les plans d'intervention d'urgence et enfin l'évaluation des risques pour l'environnement ; l'obligation d'assurer la transparence des procédures et l'accès du public à des informations pertinentes comme la nature des décisions qui pourraient être adoptées, l'autorité publique chargée de prendre la décision, les arrangements pris en matière de participation du public, l'autorité publique à laquelle il est possible de s'adresser pour obtenir des renseignements pertinents ou pour transmettre ses observations, ainsi que le délai prévu pour la communication d'observations ; l'obligation de permettre au public de soumettre ses observations ainsi que l'obligation de l'informer à l'issue de la procédure d'autorisation.
Je vous précise tout de suite que le droit français est déjà conforme aux stipulations de « l'amendement OGM ». Au niveau communautaire, ces exigences découlent en effet déjà de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire des OGM dans l'environnement et du règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.
Après un examen attentif, je recommande l'adoption de ce projet de loi qui n'aura aucune conséquence en droit interne et dont l'entrée en vigueur a déjà pris beaucoup de retard. À ce jour, il manque encore cinq ratifications. L'examen en séance publique est fixé au mercredi 14 octobre 2015, la Conférence des Présidents a proposé son examen en procédure simplifiée ce qui me semble pleinement justifié.

J'indique que je voterai contre.
Suivant l'avis du rapporteur, la commission adopte le rapport ainsi que le projet de loi précité.
La réunion est levée à 12 h 22.