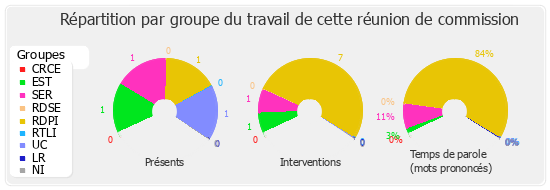Mission d'information Fonds marins
Réunion du 5 avril 2022 à 17h00
Sommaire
- Audition de mme caroline krajka sous-directrice du droit de la mer du droit fluvial et des pôles au ministère de l'europe et des affaires étrangères et de mme alexia pognonec consultante juridique (voir le dossier)
- Audition de maître virginie tassin campanella avocat à la cour experte auprès de l'union internationale pour la conservation de la nature uicn et mme anne caillaud chargée de programme outre-mer à l'uicn (voir le dossier)
La réunion
Audition de Mme Caroline Krajka sous-directrice du droit de la mer du droit fluvial et des pôles au ministère de l'europe et des affaires étrangères et de Mme Alexia Pognonec consultante juridique
Audition de Mme Caroline Krajka sous-directrice du droit de la mer du droit fluvial et des pôles au ministère de l'europe et des affaires étrangères et de Mme Alexia Pognonec consultante juridique

Nous avons le plaisir de recevoir Mme Caroline Krajka, sous-directrice du droit de la mer, du droit fluvial et des pôles au ministère de l'Europe et des affaires étrangères (MEAE), accompagnée de Mme Alexia Pognonec.
Cette sous-direction pilote la position de la France dans les instances internationales et participe à la stratégie française concernant les grands fonds marins, que nous appelons tous de nos voeux. Nous sommes d'ores et déjà engagés au sein de l'AIFM, l'Autorité internationale des fonds marins, et au sujet des aires marines protégées pour agir pour les grands fonds.
Je vous laisse nous présenter vos réponses aux questions que le rapporteur vous a adressées par écrit.
Mon propos suivra le canevas du questionnaire qui m'a été envoyé. Je suis bien évidemment à votre disposition pour répondre à d'autres questions.
La première question portait sur les politiques et la stratégie nationale concernant les grands fonds marins. Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères est porteur du projet, afin d'initier un partenariat européen dans un délai de dix-huit mois.
Sur la base des éléments qui m'ont été communiqués par la sous-direction des secteurs stratégiques de la direction de la diplomatie économique du Quai d'Orsay, je peux vous dire que, dans le domaine scientifique, la coopération internationale est ancienne et permanente. Pour ce qui concerne les potentielles exploitations, la recherche de partenariats se heurte à l'absence de financements français pour cette activité. En effet, il n'existe pas de financement européen direct dans le cadre d'Horizon 2020 sur ce sujet. Le délai de dix-huit mois ne sera donc pas respecté. Je pourrai vous communiquer des informations complémentaires, que je solliciterai, le cas échéant, auprès de mes collègues.
S'agissant des partenariats avec les pays cités par la circulaire, des contacts intéressants ont été établis avec la Norvège et l'Allemagne, voire la Belgique, mais n'ont pas été concrétisés, pour la raison que je viens d'évoquer. Les contacts scientifiques avec le Japon sont réguliers. Il existe notamment un projet d'observatoire commun en Nouvelle-Calédonie.
Ces partenariats sont essentiellement scientifiques. L'Ifremer, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, participe à l'évaluation de l'impact environnemental de la campagne de tests et de prélèvements de nodules polymétalliques menée par l'Allemagne et la Belgique dans le cadre de leur contrat d'exploration de la zone de fracture Clarion-Clipperton dans le Pacifique.
J'en viens aux contrats de l'Ifremer dans la zone internationale, et plus particulièrement au respect des règlements de l'AIFM en matière de protection de l'environnement marin. Dans l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, la France prend bien en compte les compétences liées à la Zone dans son ordre juridique interne. Si besoin est, les campagnes de l'AIFM sont financées directement par l'État.
En pratique, l'Ifremer est très présent au sein de l'AIFM. Il apporte son expertise en matière technique et environnementale à la délégation française, qui contribue à élaborer le code minier. L'Ifremer concourt ainsi à établir le cadre juridique et environnemental de l'AIFM.
Les normes internationales relatives aux grands fonds marins sont en cours d'élaboration, c'est tout l'objet des travaux actuels de l'AIFM visant à établir un code minier. Il s'agit de faire en sorte que ces normes internationales s'établissent sur des standards environnementaux élevés, tels que ceux que nous promouvons au niveau national. Dès lors que le code minier sera adopté, il conviendra de le retranscrire dans l'ordre juridique interne.
Autre question, le MEAE a-t-il été sollicité dans le cadre de la rédaction des ordonnances ? À ma connaissance, il ne l'a pas été.
Les grands principes du droit international de la mer pourraient-ils ou devraient-ils guider le régime juridique applicable aux grands fonds marins sous juridiction nationale ? La règle, c'est le respect de la partie XII de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, à savoir la convention de Montego Bay de 1982, qui prescrit une obligation générale pour les États de protéger et préserver le milieu marin. Ce principe de protection du milieu marin se retrouve à l'article 145 de cette convention. De manière générale, il convient d'appliquer le principe de précaution et le principe pollueur-payeur. En tout état de cause, la réforme du code minier devrait établir le cadre juridique s'appliquant à la recherche et à l'exploitation des granulats marins et substances de mines dans les fonds marins du domaine public, notamment pour garantir un haut niveau de protection des écosystèmes marins et en assurer une meilleure connaissance scientifique.
L'objectif est d'assurer une cohérence entre les espaces sous juridictions et les espaces internationaux, de manière à ce que les mêmes principes s'y appliquent pour l'exploration et, éventuellement, l'exploitation.
S'agissant de l'action de la diplomatie française concernant les enjeux liés aux grands fonds marins, ma sous-direction se charge de réunir les différents ministères et services concernés afin d'élaborer les instructions et positions qui seront portées au nom de la France devant l'AIFM.
La France soutient-elle officiellement l'objectif de l'AIFM d'une exploitation des grands fonds marins, lorsque des garanties environnementales suffisantes auront été définies ? La France ne soutient pas l'exploitation des grands fonds lorsque des garanties environnementales suffisantes auront été définies, mais elle conditionne l'exploitation à ces garanties. Pour autant, leur respect ne garantira pas l'obtention automatique d'un droit d'exploiter. Ce point important a été soulevé par Nauru, premier État à avoir déposé une demande d'exploitation. Outre la dimension environnementale, il existe des obstacles techniques, en raison de profondeurs importantes. Il convient également de trancher d'autres points délicats, notamment le montant des redevances à verser, le mécanisme de taxation à mettre en place, le mécanisme de compensation des États producteurs et exportateurs, le mécanisme de partage des avantages issus d'une telle exploitation. En effet, la Zone et ses ressources minérales sont consacrées « patrimoine commun de l'humanité » par la convention de Montego Bay. La France participe activement aux travaux pour préciser et réguler ces différents points.
Dans le cas où toutes les conditions environnementales, techniques et financières seraient réunies et que la France déciderait de patronner un contractant pour l'exploitation, le passage à l'exploitation ne serait pas automatique, mais resterait soumis à l'approbation de l'AIFM. Le contractant français devrait en effet soumettre une demande en ce sens, qui devrait faire l'objet d'un avis favorable de la commission juridique et technique de l'AIFM, puis d'une approbation du conseil de l'AIFM.
La demande d'exploitation de Nauru devra suivre une telle procédure, qui exclut toute automaticité.

Vous avez évoqué la réunion de synthèse qui a lieu avant chaque réunion de l'AIFM. Quels services sont représentés au sein de cette instance ? Existe-t-il des liens avec l'Union européenne, en vue d'une concertation des différents pays européens sur le sujet ?
Il s'agit d'une réunion d'instruction convoquée par la sous-direction du droit de la mer. Nous invitons le ministère de la transition écologique, dans ses différentes composantes, les différents services du Quai d'Orsay concernés, notamment la direction de la diplomatie économique, l'Ifremer, le ministère de l'outre-mer et nos experts français à l'AIFM. Nous avons en effet un expert au sein du comité juridique et technique de l'AIFM et un expert au sein du comité des finances de l'AIFM.
Le cas échéant, nous pouvons faire appel à des personnalités ad hoc.
Nous travaillons sur la base de l'ordre du jour et des textes qui sont présentés. Nous réalisons la synthèse de la position française, qui est confirmée par les personnes présentes avant transmission à notre ambassadeur, représentant permanent auprès de l'AIFM. C'est ainsi que cela se passe pour la plupart des négociations au sein d'organisations internationales.

Le ministère de la mer ou le secrétariat général à la mer sont-ils associés ?
Ils ne l'ont pas été jusqu'à présent. Toutefois, si un intérêt était exprimé en ce sens, il serait tout à fait envisageable de les convier à ces réunions d'instruction.
Quoi qu'il en soit, ils sont destinataires des instructions. Cela se fait en toute transparence.
S'agissant des liens avec l'Union européenne, il s'agit d'un point sensible au sein de l'AIFM. Nous avons des échanges avec nos partenaires européens présents au conseil de l'AIFM. L'Union européenne est partie à l'AIFM, mais pas au conseil de l'AIFM. Nos partenaires présents au conseil de l'AIFM, en toute loyauté, avec la Commission européenne et sur la base des compétences partagées en matière d'environnement, peuvent négocier et prendre des positions.
Cette participation est une demande forte de la Commission européenne. Sur le plan juridique, il s'agit de la question du respect des compétences des États membres et de l'Union européenne. À l'AIFM, l'Union européenne n'a pas de compétence exclusive.
Les États membres, dont la France, sont favorables au respect de la répartition actuelle des compétences.

On comprend bien que l'enjeu, aujourd'hui, dans le cadre de la mise en place d'une réglementation internationale, est très fortement juridique et financier. Nous aimerions creuser avec vous la question d'une redevance, puisque vous évoquez la compensation et le partage des avantages. Si vous avez des grilles de lecture plus précises à nous proposer pour nous permettre d'appréhender la logique de ce système, votre éclairage serait précieux.
En ce qui concerne les aspects scientifiques liés à l'impact environnemental, avez-vous prévu, au-delà de l'Ifremer, de vous entourer d'experts au moment où il faudra examiner les demandes ? A-t-on imaginé de pouvoir capitaliser sur les premières expériences pour affiner notre approche scientifique ?
Par ailleurs, a-t-on prévu de réunir un panel de scientifiques, une sorte de conseil scientifique, voire de veille ? L'Ifremer constituera-t-il cette base ? On a bien compris que l'on ne sait pas grand-chose, pour l'instant, de ce que l'on trouvera au fond, mais il ressort de nos auditions qu'une exploitation éventuelle ne se fera pas sans impact. Comment la France entend-elle capitaliser sur cette expérience ? Allez-vous vous appuyer sur une démarche scientifique coordonnée pour pouvoir à la fois accumuler de l'expérience, de la connaissance et enrichir les travaux de l'AIFM ?
On voit bien qu'il s'agit de déterminer un cadre juridique et financier a priori. Mais comment avancer sur le plan scientifique compte tenu de cette incertitude ?
Les organisations non gouvernementales (ONG) sont particulièrement sensibles à ce sujet, tout comme les territoires du Pacifique, que je représente au Sénat.
Je vais être très honnête avec vous : nous n'avons pas encore abordé cette question dans le détail. On explore d'abord, on étudie tous les impacts et si les conditions sont réunies, il y aura peut-être exploitation.
La question des impacts environnementaux est évidemment fondamentale. Nous n'en sommes pas encore à devoir nous entourer d'experts. Puisque vous avez évoqué l'Ifremer, une réflexion doit être menée au niveau du secrétariat général de la mer (SGMer).
L'AIFM travaille à la rédaction d'un code minier. Ses travaux ont beaucoup porté sur la dimension environnementale. C'est un point fondamental, non seulement pour la France, mais aussi pour tous les États parties et l'Autorité. Une grande partie de la session qui vient de s'écouler a été consacrée à ces questions. On avance, mais je ne peux pas vous faire d'annonces particulières. Le conseil se réunira de nouveau durant la seconde quinzaine du mois de juillet pour poursuivre ses travaux.
Je laisserai ma collègue compléter, si elle le souhaite, mais il existe une commission juridique et technique au sein de l'AIFM, composée de juristes, d'océanographes et d'experts de très haut niveau. Ils travaillent sur le projet, la réglementation et les directives. Non seulement ils étudient les demandes d'exploration, mais ils seront également amenés à se prononcer sur les plans d'exploitation. La dimension environnementale sera, bien évidemment, prise en compte pour émettre un avis, qu'il soit favorable ou défavorable.
Savons-nous sur qui nous appuyer au-delà des experts de l'Ifremer ? Pour ce qui nous concerne, nous n'y avons pas encore réfléchi, puisque les travaux se poursuivent dans le cadre de l'AIFM. Dans le cadre de France 2030 et du programme d'exploration des grands fonds marins français, la dimension environnementale est très importante également.
Le code minier est en cours d'élaboration. Michael Lodge, secrétaire général de l'AIFM, et Annick Girardin, ministre de la mer, espèrent l'avoir pour 2023. À ce stade, nous avons bon espoir que les travaux pourront se conclure à cette date.
Ce code minier est constitué par l'ensemble des règlements et procédures adoptés par l'AIFM pour encadrer la prospection, l'exploration et l'exploitation sous-marine. Les règlements qui encadrent la prospection et l'exploration des ressources minérales de la Zone ont déjà été adoptés depuis une dizaine d'années. Les travaux portent, depuis 2015-2016, sur l'élaboration du règlement qui encadrera l'exploitation ainsi que sur les normes et directives y afférentes. Je ne reviendrai pas sur les retards pris du fait de la crise sanitaire. Initialement, l'adoption du règlement était attendue en 2020. Nous espérons bien pouvoir conclure en 2023.
Les travaux se focalisent actuellement sur les parties du projet du règlement d'exploitation relatives à la protection et à la préservation de l'environnement marin, c'est-à-dire les parties IV et VI, ainsi que sur les projets de normes et directives relatives à la protection et à la préservation de l'environnement marin. Quatre d'entre eux ont été examinés en priorité au sein d'un groupe de travail dédié. Les discussions de la réunion du conseil, qui viennent de s'achever, ont également porté sur les mécanismes de taxation à mettre en place, et sur le mécanisme d'inspection, de mise en oeuvre et de conformité à envisager.
Pour ce qui est du mécanisme pollueur-payeur, le principe est prévu dans le projet de règlement d'exploitation ainsi que les moyens d'assurer sa mise en oeuvre. Concrètement, la garantie de l'application de ce principe passera par l'intermédiaire d'un fonds de compensation environnemental, qui sera abondé par des contributions imposées aux contractants. Ce fonds devra permettre le financement, l'indemnisation et la mise en oeuvre de l'ensemble des mesures nécessaires visant à prévenir, à limiter ou à réparer tout dommage causé par des activités menées dans la Zone au cas où les assurances du contractant seules ne suffiraient pas à couvrir un tel dommage.
Vous m'avez interrogée sur les propositions de la France pour assurer une prise en compte efficiente des impératifs environnementaux, et donc pour répartir équitablement les bénéfices d'une éventuelle exploitation.
Je puis vous assurer que la France contribue activement à l'élaboration de normes environnementales fortes à l'AIFM. L'élaboration de ces normes et directives qui compléteront le règlement d'exploitation est un sujet prioritaire. Chaque région susceptible d'accueillir des projets d'exploitation dans la zone de fracture Clarion-Clipperton, la dorsale médio-atlantique, le Pacifique occidental, les dorsales de l'océan Indien devra faire l'objet d'un plan régional de gestion de l'environnement (PRGE). Pour l'instant, seule la zone Clarion-Clipperton dispose d'un tel plan, mais les ateliers de travail se sont multipliés ces dernières années pour développer ces outils. Une méthodologie pour l'élaboration de ces PRGE est actuellement à l'étude : les travaux avancent de manière satisfaisante.
Toute potentielle activité d'exploitation sera ainsi soumise à la démonstration préalable qu'elle est conforme aux directives environnementales et aux exigences du PRGE de la zone concernée.
Pour ce qui est du partage des avantages issus d'une potentielle exploitation, la France promeut la création d'un fonds pour la viabilité des fonds marins, ce qui permettrait notamment la mise en place de centres de recherche régionaux, conformément aux articles 276 et 277 de la convention de Montego Bay. Ces centres régionaux seraient créés en respectant les principes du partage équitable, c'est-à-dire en priorité pour certaines régions : Afrique, etc. Les objectifs de ce fonds de viabilité des fonds marins pourraient être multiples, mais se focaliser en priorité sur la connaissance et la protection des fonds marins, ainsi que sur le développement des capacités des pays en voie de développement.
Effectivement, la France a été présentée comme l'un des membres actifs de l'AIFM par Michael Lodge. Quid de nos échanges bilatéraux entre chancelleries sur des questions relatives aux fonds marins ? Les fonds marins font partie des thèmes qui peuvent être abordés lors des dialogues diplomatiques, notamment dans la zone indopacifique. Le savoir-faire français ainsi que la réputation de responsabilité de la France en termes environnementaux lors des activités d'exploration sont des atouts. Par exemple, c'est à la suite d'un dialogue franco-japonais qu'est né le projet d'observatoire commun en Nouvelle-Calédonie. Je précise que nous avons bien évidemment des échanges bilatéraux avec les États européens qui sont actifs et présents au conseil.
Quelle est la position de la France sur ce qui a été présenté comme l'ultimatum de Nauru ? Avons-nous pu échanger avec des représentants de Nauru ou avec ceux du forum des îles du Pacifique ? Effectivement, la règle des deux ans déclenchée par Nauru est prévue par la convention de Montego Bay. Si les règles encadrant l'exploitation ne sont pas adoptées dans un délai de deux ans suivant la demande par un État partie, il est prévu d'examiner la demande de plan de travail pour l'exploitation et, le cas échéant, de l'approuver à titre provisoire dans l'attente du règlement définitif. Cela n'implique toutefois pas une approbation provisoire automatique du plan de travail. Le conseil pourrait tout à fait mettre en avant des questions de protection de l'environnement dont le cadre a déjà été adopté pour l'exploration.
La position de la France est claire : le levier enclenché par Nauru ne garantit pas le passage à l'exploitation provisoire, d'autant qu'il n'est pas certain que Nauru dépose une demande d'approbation d'un plan de travail à l'issue des deux ans. Tous les États ne partagent pas la même interprétation que nous de cette question. En revanche, tous les États s'accordent sur le fait qu'une exploitation ne devrait pas démarrer sans l'adoption de règles strictes de protection de l'environnement.
Pour répondre à la question sur les échanges avec Nauru, lors de la réunion de l'AIFM où la question a été abordée, Nauru est resté silencieux. Quoi qu'il en soit, le processus est lancé. Cela nous oblige à accélérer les travaux pour l'adoption du code minier. Pour autant, quand bien même Nauru déposerait une demande d'approbation d'un plan de travail pour une exploitation, il n'est pas garanti que ce plan soit adopté en cas de risque environnemental trop important.
Qui plus est, il s'agirait d'une approbation provisoire, en attendant que le règlement soit définitivement adopté. La demande initiale serait donc réexaminée à la lumière du futur règlement.

Pourriez-vous détailler ce statut d'approbation provisoire ? Qu'est-ce que cela sous-tend ? Qu'est-ce qui sera permis en attendant ? Quel est l'intérêt de cette autorisation provisoire pour l'État demandeur ?
Il est difficile pour moi de répondre plus précisément. C'est un mécanisme prévu par la convention, mais qui n'en détaille pas les conséquences. Celle-ci prévoit simplement qu'au bout du délai de deux ans, la commission juridique et technique ainsi que le conseil devront examiner et, le cas échéant, approuver à titre provisoire le plan de travail pour l'exploitation.

À l'inverse, un rejet pourrait-il tout autant être provisoire et la demande réétudiée une fois le règlement mis en place ?
Il me semble qu'il pourrait y avoir un rejet conditionnel, peut-être avec des orientations proposées par la commission juridique et technique indiquant quels seraient les points à faire évoluer pour que la demande d'approbation soit envisageable. J'imagine qu'un rejet serait, de fait, provisoire, puisque le contractant pourrait améliorer sa demande par la suite.
Le ministère de l'outre-mer est toujours invité à participer aux réunions d'instruction de l'AIFM et à faire valoir sa position lors des concertations. Le ministère de l'outre-mer a également été associé à la mise à jour de la stratégie nationale des grands fonds marins.
Votre avant-dernière question portait sur la géopolitique des grands fonds marins. Dans le cadre de l'AIFM, on ne peut pas vraiment parler de rapports de force dans le contexte de la Zone, dans la mesure où il n'existe pas d'intérêts immédiats susceptibles de provoquer des tensions. À ce stade, tous les États parties à l'AIFM jouent le jeu du multilatéralisme en élaborant le code minier pour les phases d'exploration et d'exploitation, et tous se conforment aux règles qui en découlent.
Comme vous le savez, les États-Unis, qui ne font pas partie de l'AIFM, participent également à l'ensemble des réunions en tant qu'observateurs. Ils ne se sont pas affranchis du cadre de l'AIFM. Il est important de le souligner, car c'est une question qui revient souvent : oui, les États-Unis jouent le jeu.
Pour ce qui est de la position de la Chine, toujours dans la Zone et dans le cadre de l'AIFM, elle joue également le jeu d'une approche multilatérale. Elle participe aux réunions et respecte les règles, mais elle poursuit également sa politique : elle a obtenu cinq contrats concernant les nodules détenus par des instituts ou des entreprises aux profils très divers, et qui couvrent toute la chaîne d'exploration et d'exploitation. C'est également le pays le plus engagé dans l'exploration et l'exploitation des fonds marins. La délégation chinoise est assez discrète lors des réunions de l'AIFM, mais elle est malgré tout active lorsqu'il s'agit d'organiser des ateliers sur des thèmes divers, ainsi qu'en matière de formation et de renforcement des capacités des autres États. De manière plus générale, la Chine n'est pas dans une logique de recherche de coopération sur le sujet des grands fonds marins, notamment en termes de développement des technologies. Elle développe sa technologie et mène ses propres explorations, voire ses essais de prototypes d'exploitation.
Vous m'avez également questionnée sur les répercussions et les impacts de la guerre en Ukraine sur les équilibres au sein de l'AIFM. Fondamentalement, il n'y en a pas eu sur les travaux proprement dits du conseil. C'était au tour des États de l'est de l'Europe de présider le conseil. En raison du contexte, nous ne souhaitions pas avoir une présidence russe et nous avons opté pour une présidence polonaise. Hormis les déclarations et condamnations des différents pays de l'agression russe, il n'y a pas eu de perturbation ou de modification des équilibres et des travaux au sein de l'AIFM, mais nous ignorons quelle sera la réaction de la délégation russe lors des prochaines élections au sein du conseil.

La Russie, jusqu'à présent, joue le jeu du fonctionnement de l'AIFM. Mais l'on sait que pour les pôles, par exemple, elle affiche des ambitions extrêmement fortes, probablement au détriment de l'environnement.

Nous le savons, les fonds marins appartiennent au patrimoine commun de l'humanité. Travaille-t-on déjà à un mécanisme de répartition des richesses issues de leur exploitation pour les pays qui ne sont pas en mesure de les exploiter ?
Par ailleurs, en application de l'article 76 la convention des Nations unies sur le droit de la mer, l'État côtier peut étendre jusqu'à 330 milles le plateau continental exploitable. La France s'est engouffrée dans cette possibilité avec le programme Extraplac, qui concerne 11 dossiers sur 3 océans, et peut aller jusqu'à 1,5 million de kilomètres carrés. Êtes-vous impliquées sur ce dossier ?
L'AIFM répond à une logique évolutive, c'est-à-dire que sa structure évolue en fonction des activités. Certains organes seront créés dans quelques années, notamment l'Entreprise, qui aura vocation à aider les pays en développement à exploiter les ressources de leur zone. Un mécanisme de taxation et de redistribution des avantages issus d'une exploitation est en gestation. Nous pourrons vous apporter des précisions par écrit par la suite.
S'agissant de la redistribution en tant que telle, il pourrait s'agir d'un mécanisme en fonction de la population du pays, mais ce serait alors une redistribution a minima. Une autre solution serait de créer des centres régionaux pour aider les États en développement à développer leurs capacités. Pour notre part, c'est ce que nous souhaitons.
Un autre problème se pose à l'égard des pays producteurs terrestres. Une exploitation sous-marine aura des effets sur les cours des métaux et des minerais et pénalisera les États disposant de ressources terrestres. Nous essayons de réfléchir à une compensation possible.
S'agissant des mécanismes financiers, plusieurs propositions sont sur la table et nous devons d'abord faire un choix franco-français. Plusieurs groupes d'États coexistent, avec des visions différentes. Nous sommes dans une phase de travail intense avec des propositions très techniques.
S'agissant d'Extraplac, nous suivons le dossier avec le secrétariat général de la mer et nous pourrons vous adresser des éléments par écrit.
Enfin, sachez que la France va proposer un candidat pour la prochaine élection à l'AIFM en juin prochain.
Audition de maître virginie tassin campanella avocat à la cour experte auprès de l'union internationale pour la conservation de la nature uicn et Mme Anne Caillaud chargée de programme outre-mer à l'uicn
Audition de maître virginie tassin campanella avocat à la cour experte auprès de l'union internationale pour la conservation de la nature uicn et Mme Anne Caillaud chargée de programme outre-mer à l'uicn

Mes chers collègues, nous poursuivons nos auditions avec Mme Tassin Campanella, experte auprès de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), et Mme Anne Caillaud, chargée de programme outre-mer à l'UICN.

Mesdames, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je vous propose de suivre le questionnaire que nous vous avons transmis, de sorte que nous ayons un fil conducteur. Nous n'en sommes néanmoins pas prisonniers...
En ce qui me concerne, vous le comprenez, je serai particulièrement intéressé par les éclairages de l'UICN sur les outre-mer.
Mesdames, messieurs les sénateurs, nous vous remercions de cette invitation.
Votre première question portait sur le moratoire international de l'UICN de septembre 2020 via la résolution 122. Cette dernière a été portée par plusieurs organisations internationales, notamment WWF International et l'UICN, mais le comité français n'en est pas à l'origine, même s'il la soutient, bien évidemment. Cette résolution demande un moratoire sur les nouveaux contrats d'exploration en zone internationale. On compte actuellement 31 contrats, qui ne sont pas concernés par le moratoire.
L'UICN a considéré que ces explorations ne présentaient pas assez de garde-fous pour la protection de l'environnement. Les premières activités datent des années 1980 et elles ont laissé des traces sévères sur les fonds marins.
Les 31 contrats en cours portent sur 1,3 million de kilomètres carrés et engagent sept pays - Chine, France, Allemagne, Inde, Japon, Corée du Sud, Russie -, ainsi que trois compagnies privées, canadienne, belge et britannique, ce qui laisse craindre un mouvement de monopolisation.
L'UICN voudrait surtout mettre au clair la distinction entre la recherche scientifique et les contrats d'exploration.
La recherche est censée se faire dans l'intérêt de l'humanité, dans un but pacifique. L'exploration, elle, intègre des considérations commerciales et ses résultats restent en principe confidentiels. Elle a pour but d'évaluer la richesse d'une zone en métaux et minerais, mais n'a pas pour vocation de protéger le milieu marin. Les contractants doivent cependant produire une étude d'impact en collectant des données environnementales.
Vous l'avez compris, avec l'exploration, l'objet est surtout commercial, et l'UICN se demande si ce mélange des genres est bien raisonnable, sachant qu'il n'y a pas de méthodologie. Les objectifs sont différents de ceux de la recherche ; les moyens et les équipes ne sont pas les mêmes.
Par ailleurs, dans le cadre de l'exploration, les données environnementales restent confidentielles jusqu'à quatre ans après la fin du contrat, délai au terme duquel le partage avec le public est possible. Vous comprenez qu'il puisse y avoir un doute sur l'utilisation de ces données.
L'Autorité internationale des fonds marins (AIFM) a tenté de mettre en place une plateforme recensant ces données, mais elle est encore très lacunaire.
Pour l'UICN, il importe de rééquilibrer le poids respectif de la recherche et de l'exploration.
La décennie des Nations unies pour les sciences océaniques au service du développement durable, menée par la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l'Unesco, traite de la connaissance des fonds marins dans le cadre de la recherche scientifique marine, et non dans une optique d'exploration et d'exploitation. Or, les données des activités d'exploration ne sont pas prises en compte.
Cette décennie devait stimuler la recherche scientifique marine. Néanmoins, celle-ci demeure embryonnaire, car, depuis le début des négociations entre les États, et même pendant la troisième conférence des Nations unies sur le droit de la mer, qui date des années 1970, le partage public des données n'a pas eu lieu. Les négociations ont été dures : aujourd'hui, le consentement des États côtiers est requis pour mener des recherches sur leur plateau continental. À chaque demande de recherche, l'État côtier, et donc la France pour ce qui nous concerne, pourra s'opposer au projet de recherche scientifique marine. Il est donc difficile d'enrichir la connaissance des ressources naturelles du milieu marin, notamment la biodiversité du plateau continental.
Dans le cadre du plateau continental étendu, la recherche marine peut, elle aussi, être bloquée si des zones spécifiques n'ont pas été délimitées, même si une définition précise de telles zones n'existe pas.
Ces blocages sont préoccupants en cas de recherches scientifiques marines portant sur des écosystèmes connectés au plateau continental où se situent également des ressources naturelles. Ainsi en est-il des cheminées noires, qui abritent des ressources minérales et biologiques importantes. La recherche scientifique peut donc être considérablement freinée par la volonté d'exploitation d'un État.
J'en arrive à l'approche de précaution, également nommé principe de précaution. Au départ, cette notion faisait partie du droit « mou », car elle figurait dans la déclaration de Rio sur l'environnement de 1992. Ce principe a été progressivement inséré dans des instruments régionaux et inclus dans les obligations de diligence requise, terme juridique qui signifie que les États doivent tout faire pour remplir leurs obligations internationales.
En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitudes scientifiques absolues ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement. Comme les données environnementales, tant en termes de quantité que de qualité, sont insuffisantes, une telle approche permet d'éviter des impacts graves ou irréversibles.
Cette analyse des risques doit concerner les espaces géographiques verticaux et horizontaux. L'UICN a toujours défendu ce principe de précaution, notamment en publiant un Guide de mise en oeuvre en 2007. Ainsi, la Nouvelle-Zélande applique ce principe en développant des indicateurs très précis pour mesurer les risques d'effets dommageables.
Pour mener des études d'impact environnementales, des informations préalables sur les fonds marins sont nécessaires. Ces études doivent mesurer les risques éventuels, proposer de les diminuer, déterminer si ces risques sont acceptables. Le principe de précaution doit donc définir des indicateurs et des cibles précis et associer les parties prenantes, notamment les communautés locales, dont la place est essentielle en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. Les activités d'exploration et d'exploitation envisagées doivent être examinées tant au niveau environnemental, social que culturel. C'est seulement à l'issue de ce processus assez lourd que l'autorisation des activités d'exploration et d'exploitation peut être envisagée.
La difficulté actuelle tient au fait que nous ne disposons que d'informations lacunaires et, souvent, confidentielles, dans la mesure où elles ont été récoltées dans le cadre de contrats d'exploration, et non à l'occasion de programmes de recherche scientifique marine. Des informations précises sont vraiment nécessaires.
Les dernières publications scientifiques et celles en cours de validation démontrent que nous n'en sommes qu'au stade de la description des écosystèmes, et non à celui de la compréhension de leur fonction. Nous ne savons toujours pas quel est le rôle des espèces, leurs liens et leurs services écologiques. Cette absence de données a déjà été dénoncée lors des recherches de gaz et de pétrole en mer du Nord. Autant les données géologiques étaient foisonnantes, autant celles concernant l'écologie et la biologie manquaient cruellement.

Merci pour cet exposé intéressant. Vous souhaitez donc des recherches scientifiques préalables avant toute exploration ou exploitation.
Tout à fait, et c'est pourquoi la résolution 122 de l'UICN, relative à la protection des écosystèmes et de la biodiversité des grands fonds marins par un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins, rappelle que les recherches scientifiques marines doivent être engagées et partagées, avant tout contrat d'exploration ou d'exploitation.

Les grands fonds marins sont encore aujourd'hui très peu connus. Les États ont-ils les moyens financiers de mener des programmes de recherche scientifique ?
Les budgets d'exploration sont bien plus élevés que ceux consacrés à la recherche. C'est une question éminemment politique.

Y a-t-il eu des recommandations pour que l'Europe se substitue aux États membres pour financer ces recherches ?
L'UICN ne s'est pas positionnée au niveau européen, mais à l'échelle l'internationale.
L'Union européenne a soutenu d'importants programmes de recherche scientifique marine dans la Zone - je vous enverrai des références précises. Ces dernières années, elle a modifié son approche vis-à-vis de l'exploration et de l'exploitation. Début 2010, l'Union européenne a approuvé le guide indopacifique élaboré par le secrétariat de la Communauté pacifique. Ce précédent a servi d'exemple à nombre de régions et d'États. Pourtant, l'exploration et l'exploitation restaient privilégiées. En 2018, dans sa résolution sur la gouvernance internationale des océans, le Parlement européen s'est prononcé en faveur d'un moratoire pour l'exploration et l'exploitation du plateau continental des États membres et de la zone internationale des fonds marins. Certains États n'étaient pas favorables à ce moratoire et, en 2020, dans le cadre de la stratégie biodiversité 2030, la Commission européenne s'est prononcée en faveur d'un moratoire sur l'exploitation des grands fonds marins dans la Zone. Le plateau continental n'était en revanche plus cité.
En 2021, le Parlement européen a rappelé l'importance de la connaissance des fonds marins et d'un moratoire sur leur exploration et leur exploitation.
Au sein de l'Union, les positions divergent : ainsi, la Belgique et l'Allemagne s'interrogent sur leur positionnement. Néanmoins, la majorité des États est plutôt favorable à biodiversité et la recherche scientifique.
J'en viens à l'exploitation. Le questionnaire envoyé par le Sénat pose la question de savoir si un moratoire international est irréaliste, compte tenu des positions de la Chine et de la Russie.
Le moratoire UICN a été adopté à 82 % des voix d'États et 95 % des voix d'ONG. La Chine a voté contre et la Russie n'a pas voté. Pour procéder à une exploitation, la majorité des membres doit lever le moratoire. La Chine et la Russie ne peuvent donc pas se précipiter dans l'exploitation des grands fonds marins, compte tenu de ce contexte diplomatique.
L'UICN souhaite des garde-fous environnementaux, notamment des études d'impact rigoureuses et transparentes, d'où de nécessaires audits indépendants qui comprennent des évaluations des risques sociaux, culturels et économiques. La France doit porter ce message, notamment en raison de ses outre-mer.
Le rôle de l'AIFM est difficile : elle encadre les activités et décline les règles en se référant à la convention du droit de la mer. Mais elle a également un rôle de potentiel opérateur, via l'Entreprise, et de distributeur des revenus d'exploitation.
Ce qui pose problème n'est pas l'existence des règles, mais leur mise en oeuvre. Des seuils, des indicateurs et une méthodologie sont nécessaires pour évaluer le caractère grave et irréversible des impacts environnementaux. Dans la pratique, il y a un déséquilibre entre la priorité de fait accordée à l'exploration et l'exploitation et la protection du milieu marin, qui vient en second. Dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer, la priorité n'est pas donnée à l'un ou à l'autre. La question est donc de les concilier de manière équilibrée et efficace.
Le moratoire adopté par l'UICN n'est pas le seul : l'Union européenne s'est également prononcée en ce sens.
Vous m'avez interrogée sur les risques d'exploitation en dehors de tout contrôle. Il a fallu neuf années pour parvenir à la rédaction de la convention des Nations unies sur le droit de la mer. La partie sur la Zone est extrêmement fournie, même si elle est loin d'être parfaite. Toutefois, le cadre juridique existe.
En outre, un accord de mise en oeuvre précise cette convention - c'est l'accord sur la partie XI. De nombreuses règles existent donc, et il n'y a en principe pas de risques d'exploitation hors de tout contrôle.
Cette convention est particulièrement importante, car elle est quasiment universelle. Elle a été ratifiée par 160 États membres, soit quasiment tous les États de la planète. Le mécanisme de responsabilité applicable aux États et aux acteurs privés qui effectuent des exploitations dans la zone a été clarifié dans un avis consultatif de la chambre des fonds marins du tribunal international du droit de la mer en 2011. Cet avis a clairement mis en avant l'obligation de diligence requise de l'État, qui est tenu de faire de son mieux pour que les contractants s'acquittent de leurs obligations, notamment les obligations environnementales. Pour cela, l'État doit adopter des lois, des règlements et des mesures administratives. Le moyen le plus simple de vérifier si l'État français a appliqué cette obligation de diligence requise, c'est d'effectuer un audit de tout ce qui a été fait dans le cadre des activités d'exploration dans la zone des fonds marins. À titre d'information, j'ajoute que très peu de règles de droit européen sont applicables aux activités en dehors de la juridiction nationale.
Cette obligation implique d'adopter une approche de précaution, d'avoir recours aux meilleures pratiques écologiques et d'effectuer des études d'impact environnementales.
Vous nous avez ensuite interrogées sur la levée du moratoire, que nous conditionnons au respect de plusieurs conditions. En quoi les discussions actuelles sur le règlement de l'AIFM ne permettent-elles pas d'apporter ces garanties ?
L'UICN a des préoccupations particulières, s'agissant notamment de la commission juridique et technique de l'Autorité internationale des fonds marins, en raison du manque de diversité dans l'expertise. Cette diversité d'expertise est prévue par la convention des Nations unies sur le droit de la mer. Il s'agit encore une fois ici d'une question de mise en oeuvre. L'UICN a ainsi constaté que, en raison de son manque d'expertise en écologie et en biologie des grands fonds marins, cette commission, qui étudie les plans de travail d'exploration et qui examinera les demandes d'exploitation, a validé un permis d'exploration de la Pologne alors que des portions très importantes des zones à explorer sont situées dans une zone marine d'importance écologique ou biologique. Par ailleurs, certains des membres de cette commission sont affiliés à des contractants de l'AIFM. Il conviendrait de régler ce problème afin d'asseoir la crédibilité de l'AIFM et d'éviter tout conflit d'intérêts.
Il existe une réelle inquiétude sur le fait que l'adoption de ces régulations suive un calendrier industriel plutôt qu'un calendrier de politique internationale. Or le droit international et la société civile ne vont pas au même rythme : le droit international est lent, car il nécessite de prendre en compte les préoccupations de tous les États. Il semble que l'adoption des régulations a été faite de manière un peu trop hâtive. Une consultation plus importante de la société civile aurait permis d'éviter ce type de problèmes.
L'enjeu, c'est un risque de perte nette pour l'humanité de services écosystémiques, d'accélération du changement climatique en cas de dommage à l'environnement marin, lequel joue un rôle dans l'absorption du CO2, de perte d'opportunités pour le développement de remèdes médicinaux. Ces enjeux sont si importants que des débats publics doivent être menés sur les questions d'exploitation.
L'UICN a par ailleurs des inquiétudes sur l'influence des acteurs privés au sein de l'AIFM, notamment sur son personnel et son secrétaire général. Il existe des suspicions de conflits d'intérêts, ces personnels étant proches de compagnies privées, notamment de DeepGreen Metals, devenue TMC. Ces compagnies exercent également une influence sur les États, notamment Nauru, qui s'est fait représenter au sein de l'AIFM par le PDG de DeepGreen... C'est une pratique un peu particulière, qui laisse craindre l'apparition de patronages de complaisance et des risques qui y sont associés.
J'en viens à la question suivante. Le moratoire adopté par l'UICN appelle à une réforme de l'AIFM : en quoi la gouvernance de cette autorité n'est-elle pas aujourd'hui suffisamment transparente ?
La résolution 122 de l'UICN soutient la réforme de l'AIFM, tout comme le Parlement européen, qui a mentionné en juin 2021 un lien apparent entre les méthodes de travail et le manque de transparence de l'Autorité internationale des fonds marins et la protection effective du milieu marin contre les effets nocifs. C'est le paragraphe 185, que je vous transmettrai.
Plusieurs propositions de réformes ont été faites, notamment la mise en place d'un système de suivi et de surveillance du respect des clauses des contrats d'exploration, une mise en oeuvre opportune et appropriée de la responsabilité des États, des entités et de l'AIFM elle-même devant la chambre des fonds marins, une possible mise en oeuvre de la responsabilité de l'AIFM en cas de fait internationalement illicite dans le cadre de la responsabilité des organisations internationales, un mécanisme qui garantisse, au sein de l'AIFM, la gestion des conflits d'intérêts et la transparence, des dispositions particulières comme la règle des deux ans, le « use it or lose it ». L'encouragement à l'exploitation après l'exploration devrait être interprété pour être sûr que l'activité n'est pas justifiée que par la seule recherche du profit.
La deuxième série des questions que vous nous avez adressées porte sur la position de la France. Comment jugeons-nous sa position officielle, notamment le fait qu'elle veuille renforcer ses activités d'exploration et de développement technologique ? Le comité français de l'UICN souhaite surtout attirer l'attention sur les implications des explorations et des exploitations au sein du plateau continental français.
La zone en dehors de la juridiction nationale n'est pas intéressante financièrement, car les bénéficies sont partagés entre tous les États parties. Ce marché est immature, les risques environnementaux dans cette zone sont très importants, les investissements considérables et la procédure relativement lourde.
Le régime du plateau continental en revanche permet à l'État côtier de déterminer sa politique environnementale. Dans ce régime, il n'y a pas d'obligation environnementale spéciale. Ce régime a été créé pour offrir de la souplesse et permettre d'accéder facilement aux ressources naturelles et de les utiliser. Les contraintes sont celles qui figurent dans la partie XII de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui parle essentiellement de pollution marine et non de perturbation du milieu marin. Le cadre juridique est donc inadapté à la protection du milieu marin sur le plateau continental de tous les États parties.
En outre, les bénéficies commerciaux de toutes les activités d'exploitation sont bien plus intéressants sur le plateau continental français que dans la Zone. Il y a donc des chances pour que les activités d'exploration et donc d'exploitation soient développées en premier sur le plateau continental. Or les risques environnementaux sont plus importants sur le plateau continental que dans la Zone.
Vous nous avez également interrogées sur la réforme du code minier français. Le comité français de l'UICN n'a pas été consulté directement sur cette réforme, mais il a soumis des propositions dans le cadre de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, lesquelles n'ont pas été adoptées. Le comité français est aussi particulièrement inquiet du projet d'ordonnance sur l'outre-mer en cours de discussion, qui permettra des autorisations d'exploitation sur le plateau continental et la zone économique exclusive (ZEE) de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Mayotte. Quoi qu'en dise le Gouvernement, on voit qu'il y a un intérêt très fort pour l'exploitation. L'UICN note, à la suite de l'adoption récente d'une stratégie ministérielle de maîtrise des fonds marins, un objectif d'exploiter durablement les ressources. Cette stratégie mentionne non pas l'action de l'État en faveur de la protection du milieu marin, mais seulement la protection des intérêts industriels et militaires. C'est un peu dommage.
Le cadre juridique français est insuffisant à plusieurs égards. Il manque un cadre clair sur la responsabilité des acteurs et des entités impliqués dans ces activités, notamment en ce qui concerne les sanctions et les dommages sur le milieu marin ou sur un écosystème unique ou rare. Une clarification du cadre juridique des installations et des engins d'exploration est également nécessaire, en particulier en ce qui concerne les véhicules autonomes. De même, il n'existe pas d'encadrement juridique des plateformes offshore, dont on ne sait pas toujours si elles sont assimilées à des navires ou pas.
Il faudrait réfléchir aussi de manière générale à un cadre fiscal applicable et renforcer le cadre environnemental. Seules les eaux et la surface de certaines aires marines sont protégées, non les fonds marins. Techniquement, des activités d'exploration sont donc possibles en dessous des aires marines protégées, par exemple dans les Terres australes.
Le plateau continental est en communication directe avec la colonne d'eau et la surface. Le plateau continental étendu coexiste avec la haute mer. Il s'agit donc de penser un cadre environnemental applicable à une zone sous juridiction et hors juridiction.
On voit très clairement la volonté de la société civile de responsabiliser tous les acteurs, notamment les États, comme le montre la proposition d'instituer la notion d'écocide.
L'UICN a toujours soutenu la proposition d'extension des aires marines protégées. Elle est particulièrement inquiète des lacunes d'encadrement de ces aires, en particulier sur les questions de représentativité et de degré de protection. Les activités d'exploration sont incompatibles avec les objectifs de protection des espèces et des habitats sensibles. Explorer ces aires protégées augmenterait la pression sur les milieux marins.
En réponse à votre question sur le jumeau numérique de l'océan, je rappelle qu'il s'agit d'une initiative européenne en cours de développement, qui ne sera pas opérationnelle avant 2024. L'utilisation de ce jumeau pour les grands fonds marins pose plusieurs difficultés. Premièrement, l'observation satellite et in situ n'est pas efficace pour les grands fonds marins. Les données ainsi collectées ne peuvent pas être utilisées. Deuxièmement, il est prévu que ces données soient en open access. Or les États membres sont réticents à ce jour à partager les données liées à la colonne d'eau. Troisièmement, pour qu'un jumeau numérique puisse être opérationnel, il faut que les données soient de bonne qualité et qu'elles soient standardisées.
J'en viens à votre dernière question : l'information et l'association des parties prenantes à la stratégie nationale de 2021 pour l'exploration et l'exploitation minière des grands fonds marins sont-elles satisfaisantes ? Cette stratégie a été développée sans consultation publique ou sollicitation de la société environnementale. Le comité français de l'UICN n'en a eu connaissance qu'une fois qu'elle a été adoptée. L'objectif prioritaire de cette stratégie est assez fragilisé. Pour l'association des parties prenantes, compte tenu des vues des industriels sur les ressources de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, il conviendrait d'associer les communautés locales et les représentants du savoir traditionnel à toutes ces questions pour discuter de l'acceptabilité de ces activités, mais aussi de leurs impacts économiques, sociaux, environnementaux et culturels.
- Présidence de M. Jean-Michel Houllegatte, président -
Mme Tassin Campanella s'exprimait également en mon nom, je n'ai rien à ajouter à ses propos à ce stade.

Merci pour ces explications très détaillées.
Vous avez évoqué les traces très sévères laissées par les campagnes d'exploration des années 1980. Avez-vous des exemples significatifs ?
Il existe des photos et des rapports scientifiques, que je peux vous envoyer.
Permettez-moi d'ajouter un point important : la France n'a pas encore publié les limites externes de son plateau continental. Cette absence de publication a des répercussions très importantes, notamment sur l'opposabilité de la juridiction de l'État français sur les ressources et la stratégie de surveillance annoncée par le ministère des armées. En outre, elle empêche l'AIFM de travailler. Enfin, elle va freiner l'application du futur accord sur la biodiversité, le Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ). La France aurait tout à gagner à publier ces limites.

Merci pour la qualité de votre intervention.
La question se pose de la raréfaction des matériaux et du devenir des gisements terrestres. Avez-vous effectué des travaux sur la disponibilité des ressources terrestres et quelle est votre position sur leur exploitation au regard des ressources maritimes ? La course aux fonds marins est-elle liée à la raréfaction des ressources terrestres ou s'agit-il simplement d'une question de souveraineté sur les ressources ? Cette course est-elle engagée indépendamment des ressources terrestres disponibles, simplement parce que l'homme souhaite toujours aller plus loin ?
Le rôle de l'UICN est de rappeler aux États et aux ONG leur responsabilité environnementale. Nous nous concentrons sur l'impact environnemental de toute l'industrie, notamment l'industrie minière, mais nous n'avons pas mené d'étude particulière sur la disponibilité des ressources terrestres ou maritimes. On voit que la demande en métaux rares explose du fait de la transition énergétique et numérique et on s'inquiète des conséquences environnementales de la course aux fonds marins, mais nous ne sommes pas spécialistes de la question des métaux.
La course aux fonds marins est engagée dans la Zone, mais aussi sur le plateau continental. On assiste à une avalanche de demandes. Tout le monde a voulu réserver sa part du gâteau pour plus tard et sécuriser ses droits. On entend toujours parler de la Zone, moins du plateau continental, alors que les risques environnementaux y sont très importants.
De nombreuses bulles d'investissement, notamment dans le secteur du pétrole et du gaz, ont été créées, sur le fondement de spéculations. Il faut donc être réaliste et consulter les experts en géologie et en géomorphologie afin de bien évaluer le potentiel connu et exploitable des ressources existantes avant de s'aventurer sur un marché aussi immature et risqué, sachant en outre qu'il n'existe que trois acteurs sur la scène internationale. Il faut avoir ce contexte en tête pour comprendre les dynamiques à l'oeuvre.

Comment vous situez-vous entre des injonctions qui peuvent paraître contradictoires ? En effet, d'une part, il s'agit de préserver stratégiquement l'accès à un certain nombre de métaux comme le cobalt, le cuivre ou le nickel que recéleraient les fonds marins, notamment ceux qui sont situés sur le plateau continental, et, d'autre part, vous avez vos propres impératifs.
Comment jugez-vous le programme Extraplac (Extension raisonnée du plateau continental) ? Je serai direct : la France pousse-t-elle le bouchon un peu trop loin ?
Tout simplement, la France n'est pas cohérente et sa position n'est pas équilibrée. Le fait qu'elle ait un appétit pour ce qui concerne les activités d'exploration et d'exploitation est une chose qui peut tout à fait être tolérée. En revanche, faire passer cet appétit pour une soif de connaissance des fonds marins, c'est autre chose ! C'est la raison pour laquelle l'UICN insiste sur la différence entre l'exploration et la connaissance scientifique.
Il y a là un problème de cohérence et d'ambition. Il convient de trouver un équilibre entre les activités d'exploration et d'exploitation et la protection du milieu marin.

Tout d'abord, si la communauté internationale, au travers de l'AIFM, décidait de progresser sur un règlement d'exploration et d'exploitation, serait-il envisageable de constituer un conseil scientifique des grands fonds marins, pour accumuler de la connaissance et éclairer les décisions prises lors de l'instruction des demandes de permis, au-delà des aspects juridiques et financiers ? Pensez-vous que cela soit souhaitable ? Ne convient-il pas de disposer d'un état zéro, pour évaluer d'éventuels impacts ? Une telle initiative a-t-elle été engagée ?
Ensuite, vous avez évoqué la question de la colonne d'eau et de ses potentialités, notamment en matière biomédicale. Il semblerait que la France, à cet égard, ne déploie pas de stratégie, y compris auprès des acteurs privés. Nous poursuivons nos recherches pour savoir si les grands laboratoires nationaux se positionnent sur ces sujets. Disposez-vous d'informations s'agissant de la connaissance scientifique de la colonne d'eau et de ses éventuelles portées biomédicales ?
Enfin, vous avez évoqué la nécessité d'associer les communautés locales. Vous ne mentionnez pas les exécutifs locaux et les gouvernements locaux. Quelles sont vos relations avec ces derniers ? Je pense notamment à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie. Lorsque vous parlez de représentation culturelle et de communauté locale, comment les identifiez-vous ? Comment l'UICN travaille-t-elle concrètement à cet égard ? Il s'agit d'un élément important, notamment au regard de ce qui s'est passé à Wallis-et-Futuna.
Sur la dernière question, qui concerne l'association des communautés locales aux questions d'exploration et d'exploitation des grands fonds marins, le comité français de l'UICN a des antennes dans les outre-mer, à Papeete, en Guadeloupe, à Mayotte et à La Réunion. Nous dialoguons avec toutes les parties prenantes à la conservation de l'environnement dans tous les territoires ultramarins. Nous n'avons pas enclenché un dialogue spécifique formel sur les grands fonds marins avec les collectivités locales.
Nous avons publié notre positionnement, et chacun peut donc le connaître. Si une volonté de dialogue se fait jour, nous répondrons bien évidemment présents.
Pour le moment, le dialogue semble se concentrer entre l'État français et les exécutifs, sans associer réellement, par le biais d'une consultation publique digne de ce nom, la population locale, qui est peu informée sur ce sujet, même s'il est de plus en plus souvent évoqué.
Les expressions que j'ai utilisées ne visaient absolument pas à exclure l'exécutif ou les gouvernements locaux. Il s'agissait uniquement de souligner l'importance de la dimension ultramarine de la France. Or, pour moi, c'est une vision plus métropolitaine et industrielle qui est développée ici.
L'association des communautés locales ou des représentants des peuples autochtones est en cours dans le cadre de la négociation de l'accord sur la biodiversité se rapportant à la convention des Nations unies sur le droit de la mer. L'idée n'est pas seulement de les tenir informés, mais aussi de les associer à la prise de décision. Nous sommes dans une phase de révolution du droit international : les gouvernements locaux, mais aussi les communautés locales et la société civile pourront participer d'une façon ou d'une autre à la prise de décision, notamment pour les aires marines protégées qui peuvent être impactées par l'exploration et l'exploitation.
En ce qui concerne les grands fonds marins et la colonne d'eau, moi non plus je ne suis pas informée de programmes d'exploration à proprement parler, en tout cas français. Pour comprendre ce qui se passe, il faudrait tout simplement se concentrer sur les ressources génétiques marines, lesquelles font l'objet des négociations actuelles sur la « biodiversité au-delà de la juridiction nationale » (BBNJ). Mais les ressources génétiques marines de la haute mer et celles de la Zone se superposent puisque la haute mer est en communication directe avec le plateau continental, lui-même partagé avec la haute mer. Bref, il y a superposition dans le même espace plutôt qu'empilement, avec des droits liés à la liberté de la haute mer, notamment en ce qui concerne les câbles et la recherche scientifique marine.
Il est tout à fait possible de créer au niveau national un conseil scientifique des fonds marins. Ce serait même approprié, notamment avec une représentation importante de l'outre-mer. Il ne doit pas s'agir uniquement d'une instance métropolitaine. En revanche, le comité juridique et technique mentionné tout à l'heure au sein de la convention des Nations unies sur le droit de la mer comprend déjà une dimension scientifique. Le problème, c'est que les États ont nommé principalement des membres juridiques et techniques, et non des scientifiques. Il y a donc une responsabilité des États de manière générale, il ne faut pas incriminer seulement l'AIFM.
La France pourrait très bien décider de nommer des biologistes et des océanographes. Elle pourrait porter ce message en demandant un rééquilibrage, conformément à ce que prévoyait initialement la Convention pour cette commission juridique et technique. En utilisant cette stratégie, nous éviterions le piège consistant à demander la création d'une instance nouvelle, car - ne nous y trompons pas - la Convention ne sera jamais amendée. Pour des questions de géopolitique, personne ne souhaite en effet la revoir de peur que certains acquis soient perdus. Il faut donc vraiment jouer avec ce qui est déjà prévu. Il pourrait s'agir d'une demande européenne, quitte à créer ensuite une sous-commission au sein de la commission juridique et technique. Quoi qu'il en soit, il importe avant tout de trouver un chemin vers des opportunités acceptables.

Je vous remercie de cette audition très intéressante et fructueuse.
La réunion est close à 19 h 30.