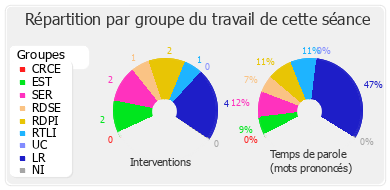Séance en hémicycle du 22 novembre 2016 à 21h30
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Claude Bérit-Débat.

La séance est reprise.

L’ordre du jour appelle la discussion, à la demande de la commission des affaires économiques, de la commission des affaires européennes et de la délégation sénatoriale à l’outre-mer, de la proposition de résolution européenne sur l’inadaptation des normes agricoles et de la politique commerciale européenne aux spécificités des régions ultrapériphériques présentée, en application de l’article 73 quinquies du règlement, par M. Michel Magras et plusieurs de ses collègues (proposition n° 65, rapport et texte de la commission n° 127, rapport pour avis n° 102).
Dans la discussion générale, la parole est à M. Éric Doligé, auteur de la proposition de résolution européenne.

Monsieur le président, madame la ministre des outre-mer, mes chers collègues, avant toute chose, je tiens à remercier le président de notre délégation à l’outre-mer, Michel Magras, de m’avoir cédé le temps de parole qui lui était dévolu en qualité de premier signataire de la proposition de résolution européenne.
La proposition de résolution que j’ai l’honneur, avec mes collègues Michel Magras, Catherine Procaccia, Jacques Gillot et Gisèle Jourda, de soumettre à l’approbation du Sénat est très directement issue des travaux de la délégation sénatoriale à l’outre-mer. Elle reprend une partie des préconisations destinées aux instances européennes du rapport de la délégation sur la nécessaire adaptation des normes agricoles outre-mer, rendu public au mois de juillet dernier. Elle comprend également un volet consacré aux effets des accords commerciaux, volet qui poursuit notre action en faveur d’un rééquilibrage des négociations européennes. Ces deux sujets, celui des normes agricoles et celui des accords de libre-échange, sont intimement liés, comme nos débats récents sur les traités commerciaux avec le Canada et avec les États-Unis le démontrent à l’envi.
Les agriculteurs et les éleveurs ultramarins sont confrontés à une hypertrophie normative ; ce ne sont pas les seuls… Si notre proposition de résolution met la focale sur la situation en outre-mer, c’est aussi, et surtout, parce que les problèmes d’inadéquation des normes à la réalité concrète y sont exacerbés et se manifestent dans toute leur absurdité. C’est également parce que les conséquences de la « mal-norme » sont particulièrement douloureuses dans des territoires ultramarins fragilisés par la crise, frappés par un chômage endémique et menacés par la concurrence des pays tiers voisins, jusque sur leurs propres marchés locaux.
Cette inadéquation des normes appelle des solutions d’acclimatation et de régulation différenciées selon les territoires. Si nous parvenons à faire bouger les lignes à l’échelon européen pour défendre les intérêts de nos outre-mer, qui sont bel et bien pour la France des intérêts nationaux, c’est l’ensemble du secteur agricole dans l’Hexagone qui bénéficiera de nouvelles souplesses et de nouvelles simplifications. C’est notre conviction.
Notre proposition de résolution européenne intervient dans un contexte très particulier, marqué à la fois par la multiplication des projets d’accords de libre-échange et par des projets de modification des règlements européens de 2007 sur la production biologique et de 2009 sur les pesticides. Nous devons profiter de cette fenêtre d’action pour faire avancer nos positions dans les cercles bruxellois. C’est pourquoi notre texte vise à dénoncer l’inadéquation du cadre réglementaire phytosanitaire et de la politique commerciale de l’Union et à demander une réorientation au service du développement endogène des RUP, les régions ultrapériphériques.
Depuis plusieurs années, les filières agricoles des outre-mer ont consenti de très importants efforts pour faire face à la concurrence internationale en modernisant leur outil de production et en revoyant leur stratégie de commercialisation. Les gains de compétitivité réalisés ne sont pas dus à une baisse quelconque des standards sociaux et environnementaux. Bien au contraire, les outre-mer se sont engagés dans une politique vertueuse de mieux-disant social et environnemental, marquée notamment par une réduction drastique de l’emploi des herbicides, fongicides et pesticides, avec d’ailleurs le soutien financier de l’Union européenne.
Ces efforts d’adaptation sont toutefois menacés d’être réduits à néant par des politiques européennes inadaptées et incohérentes entre elles. En effet, l’architecture de la réglementation phytosanitaire européenne est faite pour les conditions tempérées de l’Europe continentale, qui s’accompagnent d’une moindre pression de maladies et de ravageurs. Elle ne tient pas compte des caractéristiques de l’agriculture en milieu tropical. Les RUP restent ainsi dans l’angle mort.
Cela contribue fortement à la prégnance des usages orphelins dans les outre-mer. Ainsi, 29 % des usages phytosanitaires sur cultures tropicales dans les RUP françaises sont couverts ; la moyenne nationale française s’établit à un taux de couverture de 80 % des besoins.
Les filières de diversification sont très impactées, mais les grandes cultures de la banane et de la canne ne sont pas épargnées, car elles sont à la merci d’une perte d’homologation d’une poignée de produits absolument indispensables à la survie même des plantations. Les procédures d’homologation sont directement responsables de l’indisponibilité de solutions phytopharmaceutiques dans les RUP, alors même que celles-ci existent dans les pays tiers concurrents qui exportent leurs productions vers l’Union européenne.
Les RUP subissent la concurrence des pays tiers à l’export sur le marché européen pour leurs produits phares que sont la banane, le sucre et le rhum. Ils la subissent aussi sur leurs marchés locaux pour les produits issus des filières de diversification végétale et animale.
La porosité des outre-mer aux importations légales et illégales des pays tiers est avérée : la Guadeloupe vis-à-vis de la Dominique, notamment en exploitant les failles du contrôle à Marie-Galante, la Martinique face à Sainte-Lucie, la Guyane vis-à-vis du Suriname et du Brésil, Mayotte face aux Comores et La Réunion à l’égard de Madagascar.
Cette porosité contribue à enfermer les économies ultramarines dans un cercle vicieux. Plus la concurrence sur le marché local est rude, plus les filières de diversification végètent et ne peuvent ni résoudre le problème des usages orphelins ni s’engager dans des démarches de labellisation ou d’agriculture bio. Les économies des outre-mer restent éminemment dépendantes des grandes cultures de la banane et de la canne. Or celles-ci sont elles-mêmes fragilisées par le changement climatique – salinisation, sécheresse, épisodes violents – et surtout touchées de plein fouet par la multiplication des accords de libre-échange. L’Union européenne troque trop facilement les productions agricoles tropicales des RUP contre l’ouverture putative des marchés industriels et de services des pays tiers. La seule réponse de l’Union européenne est de prévoir des compensations financières via le POSEI, le programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité.
Cela ne fait que miner les capacités de développement endogène des RUP et accroître leur dépendance aux subventions. Les outre-mer ont besoin d’un cadre normatif adapté, propice à la mise en valeur de leur potentiel agricole. Ils ont aussi besoin d’une politique commerciale qui leur permette de lutter à armes égales avec leurs concurrents.
Aujourd’hui, seuls les outre-mer disposant de la maîtrise normative, comme la Nouvelle-Calédonie, paraissent bénéficier d’un corpus normatif et de systèmes de contrôle adaptés à leurs besoins de développement des activités agricoles.
Les membres de la délégation à l’outre-mer n’ont eu de cesse d’alerter le Gouvernement et les autorités européennes sur la nécessité de prendre en compte les spécificités des régions ultrapériphériques. Nous avons ainsi fait adopter des résolutions sur la banane, sur la politique de la pêche, sur la fiscalité du rhum et, encore cette année, sur les sucres spéciaux pour infléchir les termes de l’accord commercial avec le Vietnam. Elles n’ont pas été vaines, puisqu’elles ont contribué à arracher à la Commission européenne soit des prorogations de dispositifs de protection, soit des inflexions des équilibres négociés avec des pays tiers. Il n’en reste pas moins que la Commission européenne n’a pas encore modifié en profondeur et de manière pérenne son approche des outre-mer.
J’en veux pour preuve l’adhésion prochaine de l’Équateur à l’accord de libre-échange avec la Colombie et le Pérou conclu au mois de décembre 2012. L’Équateur est déjà le premier exportateur de bananes sur le marché européen. L’abaissement des droits de douane après son adhésion à l’accord de libre-échange provoquera inévitablement un afflux d’importations qui frappera durement nos planteurs. Ce pays traite ses bananes quarante fois par an avec une gamme de cinquante produits phytopharmaceutiques. Par comparaison, les bananiers français ne disposent que de deux produits autorisés et réalisent sept traitements par an.
C’est dans cette politique inéquitable que réside le nœud du problème. Il paraît aberrant de procéder simultanément à l’abandon des tarifs douaniers et au démantèlement des protections non tarifaires. C’est pourquoi nous estimons indispensable que les autorités communautaires garantissent la cohérence entre elles des politiques agricole, sanitaire et commerciale de l’Union européenne. Nous invitons en particulier la Commission européenne à acclimater les normes en matière d’agriculture et d’élevage aux contraintes propres des RUP en tenant compte des spécificités de la production en milieu tropical.
Il reste beaucoup à faire, en particulier à l’échelon européen, pour défendre les intérêts de nos territoires, trop facilement oubliés. L’adoption de notre proposition de résolution permettra d’associer l’ensemble du Sénat à notre action et de soutenir très directement les efforts de nos collègues parlementaires européens, non seulement français mais aussi espagnols et portugais, pour faire reconnaître les spécificités des régions ultrapériphériques.
Pour conclure, permettez-moi de revenir brièvement sur le rapport qui a donné naissance à notre proposition de résolution. Son élaboration nous a donné l’occasion de découvrir une autre facette de la richesse des outre-mer.
Nous avons appris à connaître toute une gamme de champignons, bactéries et ravageurs. Je mentionne par exemple le papillon piqueur des agrumes et le citrus greening, la lucilie bouchère, dont le nom latin signifie « mouche mangeuse d’hommes », ou encore la fourmi manioc. Nous avons aussi découvert avec intérêt combien l’inventivité de nos chercheurs était inépuisable et leur contribution irremplaçable. Ils ont mis au point en particulier des méthodes de synchronisation de la floraison des ananas par charbon enrichi à l’éthylène et des techniques de piégeage de masse du charançon de la patate douce par confusion sexuelle ; je ne vous expliquerai pas tout en détail. §Tous ces noms évocateurs vous laissent imaginer l’étendue de notre champ d’investigation.
Nous souhaitons ardemment que ces efforts et ces trésors de créativité soient récompensés. Nous entendons, par le truchement de la présente proposition de résolution européenne, faire entendre la voix des outre-mer à Bruxelles et vaincre les obstacles qui entravent le développement de leur agriculture.
Applaudissements.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je crains qu’il n’y ait quelques redites dans mon intervention – je vous prie de m’en excuser par avance –, mais le sujet l’impose.
Nos agriculteurs ultramarins veulent produire et exporter en se positionnant sur des secteurs haut de gamme. C’est un combat honorable et difficile, face à une concurrence impitoyable et alors que les acteurs ne jouent pas à armes égales.
Au début de l’année 2016, nous sommes intervenus par voie de résolution pour rappeler que l’Union européenne avait très opportunément financé la modernisation de la filière canne à sucre ultramarine et son positionnement sur les sucres roux. À l’unanimité, nous avons estimé absurde de ruiner ces efforts en ouvrant brutalement le marché des sucres spéciaux à des pays où le coût de la main-d’œuvre était dix-neuf fois moins élevé. Il s’agissait en l’occurrence du Vietnam, qui risquait de se voir offrir un boulevard pour se positionner sur ce segment.
Notre démarche a été couronnée de succès – cela vient d’être rappelé –, puisque l’accord définitif avec le Vietnam inclut une clause de contingentement strict des importations de sucres roux. Partant de 20 000 tonnes indifférenciées, on en est finalement arrivé à une limitation spécifique de 400 tonnes pour les sucres roux. Cela change tout !
Madame la ministre, je tiens à vous remercier, ainsi que l’ensemble du Gouvernement, de votre mobilisation sur ce dossier. Je vous invite à prêter une attention toute particulière au sort réservé aux productions ultramarines dans les mandats de négociation. En effet, le caractère flou du mandat confié à la Commission européenne, comme dans le cas du traité transatlantique, peut être extrêmement préjudiciable.
Ainsi que cela avait été alors annoncé, je vous présente aujourd’hui un texte plus général, même s’il répond aussi à une préoccupation immédiate concernant le secteur de la banane. La version initiale de ce texte a été cosignée par cinq membres de la délégation à l’outre-mer : Éric Doligé, que vous venez d’entendre, Jacques Gillot, Gisèle Jourda, Catherine Procaccia et moi-même. La commission des affaires européennes a pleinement souscrit à ce travail, puisqu’elle a adopté la proposition de résolution sans modification et à l’unanimité. Comme son intitulé l’indique, ce texte comporte deux volets : les normes agricoles européennes et la politique commerciale de l’Union.
Le thème des normes agricoles a été abordé par notre commission des affaires économiques au milieu de l’année 2016, mais principalement sous l’angle hexagonal. Dans son excellent rapport d’information, notre collègue Daniel Dubois constate que l’avalanche de réglementations handicape l’agriculture métropolitaine, qui est pourtant l’une des plus performantes du monde, et il invite à retrouver le chemin du bon sens avec seize propositions.
Nous sommes ici aujourd’hui pour rappeler que la situation est encore bien pire pour les outre-mer. Cela ressort du rapport d’information élaboré par la délégation sénatoriale à l’outre-mer. En 300 pages, qui rendent compte des nombreuses auditions effectuées auprès des acteurs de terrain, nous démontrons que les dispositifs phytosanitaires conçus pour l’Europe continentale s’imposent dans les régions ultrapériphériques en ignorant totalement les caractéristiques de l’agriculture en zone tropicale, tant et si bien que cette application uniforme conduit à une véritable impasse agricole.
Un seul exemple parmi tant d’autres : la fameuse fourmi manioc, présente à la Guadeloupe et en Guyane, est capable de détruire, en vingt-quatre heures seulement une culture de patates douces, d’ignames ou d’agrumes. Or aucune solution efficace ne peut être utilisée aujourd’hui sur des cultures de plein champ. En bref, la sécurité des récoltes ultramarines n’est pas garantie. Comme cela a été rappelé, 29 % des « usages phytosanitaires », c’est-à-dire les moyens de défense contre les attaques des ravageurs, sont couverts dans les départements d’outre-mer, contre 80 % en métropole. Pourtant, les produits existent, et ils sont utilisés par nos concurrents. Mais, en Europe, les procédures d’homologation sont si complexes et coûteuses que, pour les fabricants, le jeu n’en vaut pas la chandelle. Le marché ultramarin est trop étroit pour amortir le coût des formalités administratives.
Quand les produits sont autorisés, c’est leur mode ou leur fréquence d’utilisation qui fait l’objet de normes européennes inadaptées. Par exemple, l’Équateur, pays déjà mentionné, qui est le premier exportateur de bananes, traite ses cultures quarante fois par an avec une gamme de cinquante produits phytopharmaceutiques. Pendant ce temps, les bananiers français ne disposent que de deux produits autorisés et réalisent sept traitements par an.
Nous ne demandons évidemment pas à abuser des produits phytopharmaceutiques. Nous voulons simplement être traités de manière équitable face aux concurrents qui, comme nos régions ultrapériphériques, ont droit d’accès sur le marché européen.
Voilà pour vous donner un aperçu de la situation inextricable que nous connaissons face à une concurrence sans merci !
Pour réduire ces handicaps, la délégation à l’outre-mer a énoncé vingt recommandations. C’est le socle du volet « normes agricoles » de la présente proposition de résolution. J’en résume ici les trois axes.
Premièrement, adapter les normes, ainsi que les processus d’homologation pour garantir la sécurité des récoltes. Sortons du labyrinthe des procédures en dressant une liste positive de pays dont les procédures d’homologation sont équivalentes à celles de l’Union européenne.
Deuxièmement, mieux contrôler les échanges pour rééquilibrer les contraintes imposées aux producteurs.
Troisièmement, promouvoir une stratégie de labellisation des produits ultramarins pour orienter les productions vers le haut de gamme et les marchés de niche.
L’autre grand volet de la proposition de résolution porte sur les accords commerciaux et concerne plus particulièrement le secteur de la banane.
Je rappelle que, conformément aux accords de libre-échange conclus en 2012 avec l’Amérique centrale, les droits de douane sur les bananes importées dans l’Union européenne seront passés de 176 euros à 75 euros par tonne entre 2009 et 2020. Les volumes importés ont bondi, et la perte de parts de marché qui en résulte pour nos producteurs concernés met en péril l’avenir de la filière.
Sur le papier, des mécanismes de protection sont prévus en cas d’augmentation excessive des importations de bananes depuis les pays partenaires. Dans la pratique, jamais depuis 2013 la Commission européenne ne les a activés, alors que l’évolution du marché pouvait, à plusieurs reprises, le justifier.
En réponse à cette carence, la proposition de résolution suggère un déclenchement quasi automatique dès que les seuils de déclenchement prévus sont atteints. Elle demande également la prorogation de ces mécanismes de stabilisation au-delà de 2020. Il faut aussi disposer de mesures fiables des prix et des revenus pour les grandes filières exportatrices des outre-mer. La résolution appelle enfin, comme nous l’avons déjà demandé à plusieurs reprises, à la réalisation systématique d’études d’impact préalables sur les outre-mer des accords commerciaux passés par l’Union européenne.
Tous ces éléments démontrent le caractère crucial des enjeux pour nos outre-mer et l’importance des initiatives prises par le Sénat en la matière. Aussi notre commission des affaires économiques vous invite-t-elle à approuver la présente proposition de résolution, qui repose sur un objectif de rationalisation des politiques européennes actuellement contradictoires, sur le principe d’une plus grande loyauté de la concurrence internationale et sur une stratégie de montée en gamme des produits agricoles ultramarins.
Applaudissements.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nos agricultures d’outre-mer sont prises en étau : d’un côté, l’ouverture croissante des marchés européens aux productions des pays tiers ; de l’autre, l’inadaptation du cadre réglementaire sanitaire et phytosanitaire aux besoins des producteurs locaux.
Je commencerai par le cadre réglementaire.
L’agriculture de nos RUP est fortement pénalisée par rapport à la concurrence des pays tiers pour l’accès et l’utilisation des produits phytosanitaires. Ce cadre réglementaire apparaît en effet à la fois rigide et inadapté. Les normes nationales et européennes sont conçues pour une application uniforme sur la base des seuls besoins du climat européen tempéré. L’Agence européenne de sécurité des aliments reconnaît d’ailleurs elle-même que les spécificités des régions ultrapériphériques ne sont pas prises en compte dans ses travaux.
Les entreprises agrochimiques sont également peu incitées à développer une offre spécifique de produits phytosanitaires pour des marchés de faible taille. Ainsi, seulement 29 % des besoins phytosanitaires sont couverts dans les DOM, contre 80 % en métropole. Les agriculteurs des régions ultrapériphériques sont souvent démunis face aux ravageurs et aux dévastateurs tropicaux, comme la fourmi manioc, que nos deux collègues ont déjà évoquée. A contrario, leurs concurrents des pays tiers peuvent avoir recours à une palette de produits beaucoup plus large dès lors qu’ils respectent les limites maximales de résidus de pesticides.
Vous le voyez, la compétition est donc déloyale. Cela menace nos trois grandes filières exportatrices : la banane, le sucre et le rhum.
La proposition de résolution que nous examinons aujourd’hui, fruit d’un travail approfondi de notre délégation à l’outre-mer, sollicite tant notre gouvernement que la Commission européenne pour agir dans deux directions prioritaires.
En premier lieu, il faut prévoir un volet spécifique en milieu tropical – c’est vital ! –, afin d’assouplir le recours aux semences conventionnelles, à la culture sur claies et au traitement par des produits d’origine naturelle.
En second lieu, il s’agit d’obtenir une dispense d’homologation pour tous les moyens de lutte biologique, développés et validés par les instituts de recherche, afin de doter les agriculteurs de moyens de protection contre les ravageurs.
L’ouverture du marché européen à certains produits de pays tiers dont nos outre-mer sont de grands producteurs est un autre point sensible.
Ainsi, l’impact sur la filière de la banane des accords de libre-échange conclus en 2012 par l’Union européenne avec l’Amérique centrale et les pays andins est source d’inquiétudes. Ces accords prévoient une réduction substantielle des droits de douane à l’importation des bananes dans l’Union européenne. Depuis la mise en œuvre des accords avec ces pays, leurs exportations de ce produit vers l’Union européenne ont fortement augmenté et augmenteront encore avec l’arrivée de l’Équateur.
Certes, des dispositifs de protection sont prévus : une clause de sauvegarde bilatérale et un mécanisme de stabilisation. Mais, et c’est dramatique, la Commission européenne n’a jamais estimé opportun de recourir à ces outils, alors même que l’évolution du marché pouvait, à plusieurs reprises, le justifier.
La proposition de résolution européenne suggère opportunément quatre principales pistes d’action : l’activation sans délai de ces mécanismes par la Commission, donc la suspension des droits préférentiels dès que les seuils de déclenchement prévus dans les accords sont atteints ; la prorogation de ces mécanismes au-delà de la date butoir du 31 décembre 2019 ; la création d’observatoires des prix et des revenus pour les grandes filières exportatrices des régions ultrapériphériques ; la réalisation systématique par la Commission européenne d’études d’impact préalables des accords commerciaux sur les régions ultrapériphériques.
Mes chers collègues, la proposition de résolution européenne préconise des solutions de nature à rétablir un juste équilibre entre producteurs concurrents et une protection justifiée pour nos producteurs ultramarins. Votre commission des affaires européennes vous invite à l’adopter.
Applaudissements.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, cette intervention devant vous me permet de rappeler quelques vérités, quelques fondamentaux, d’exprimer les convictions qui m’animent et d’exposer les combats du gouvernement auquel j’appartiens.
J’ai eu l’occasion de développer ces éléments de contexte à Madère devant les présidents des neuf régions ultrapériphériques – les RUP – européennes quelques jours après ma prise de fonctions rue Oudinot. Il est important de les retracer aujourd'hui.
À l’instar des départements et collectivités d’outre-mer en France, les RUP souffrent, au sein d’une certaine Europe, d’un regard distinct, souvent paternaliste, parfois méprisant, toujours mal informé.
Force est de constater – hélas ! – que l’écart de richesse et de développement entre les RUP et l’Europe continentale ne s’est pas suffisamment résorbé. Il a même tendance à s’accroître de nouveau depuis les années 2008 et 2009.
Selon les dernières données d’Eurostat du mois de février dernier présentant les PIB régionaux pour l’année 2014, depuis la crise, le rattrapage de la moyenne communautaire en termes de PIB par habitant s’est interrompu en général dans les RUP. Il est donc inexact de prétendre que les RUP seraient des territoires « privilégiés », comme je l’ai entendu ici ou là.
Le niveau de vie moyen dans les DOM représente 66 % de la moyenne au sein de l’Union européenne, soit un taux inférieur à celui de la Hongrie et de la Pologne qui est de 68 %.
Le niveau de vie de La Réunion, quant à lui, est inférieur à celui de la Lituanie : 70 % de la moyenne européenne contre 75 %.
La deuxième région la plus pauvre d'Europe, c’est Mayotte, dont le niveau de vie est égal à 31 % de la moyenne de l’Union européenne.
Contrairement à certaines idées reçues, les RUP restent donc empreintes de précarité et de pauvreté, d'autant plus que les contraintes structurelles – éloignement, insularité – demeurent. Il est par conséquent plus que jamais nécessaire de maintenir un niveau optimal de dépenses publiques en faveur de ces territoires : la puissance publique doit continuer à investir pour l'avenir des outre-mer et leur cohésion sociale.
Nous demandons donc la solidarité européenne, ni plus ni moins. Cette solidarité ne saurait être assimilée à de l'assistanat. Au contraire, elle doit nous permettre de prendre nos destins en main en valorisant nos atouts. Dans cette optique, les RUP doivent être mieux connues et reconnues.
Car l'économie des RUP est avant tout structurée par leur appartenance à l’Union européenne, sous réserve des adaptations et dérogations permises par les traités à l'attention desdites collectivités, en vertu de l'article 349 du traité de Lisbonne.
Cet article, emblématique pour nous, a été fort opportunément consolidé le 15 décembre dernier par un important arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, qui réaffirme clairement la possibilité d'adaptations du droit de l'Union européenne en faveur des RUP dès lors qu'il s'agit de dispositions ou politiques spécifiques.
En effet, la Commission doit mieux prendre en compte les RUP dans ses politiques publiques. Tel est le sens que je retiens de son document du mois de juin 2012 et, surtout, de la lettre de Jean-Claude Juncker au Président de la République, le 2 septembre 2015.
La Commission, à cet égard, ne manque pas une occasion de déclarer que les RUP font l'objet de toutes ses attentions. Nous devons collectivement veiller à ce que, sur le terrain, ces paroles soient bien suivies d'effets.
Tout se passe effectivement comme si, après l'impulsion politique, le temps passant, la permanence des handicaps et la spécificité de la situation des RUP étaient oubliées, voire occultées. Or ces territoires possèdent des atouts formidables, qui ne demandent qu'à être exploités grâce à des aides et des politiques appropriées. Encore faut-il leur en donner les moyens et laisser les RUP se développer sans entraves ! Car il existe, s'agissant des outre-mer, une suspicion permanente et tatillonne, particulièrement stigmatisante, qui limite leur développement.
Deux points, à cet égard, m'interpellent tout particulièrement.
Je voudrais d’abord évoquer, en quelques mots, le dossier du règlement général d’exemption par catégorie, le RGEC.
Pour qu'il reste adapté aux caractéristiques des RUP, le présent texte ne doit pas devenir un instrument de plafonnement des aides au fonctionnement dans nos régions. Il doit au contraire demeurer un mécanisme de soutien pour nos économies. L'image de l'Union européenne en dépend. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé – et obtenu – certaines adaptations dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler les « lettres de confort ».
Preuve du pragmatisme de la Commission, l'existence de ces lettres de confort démontre également, mesdames, messieurs les sénateurs, la nécessité absolue d'une adaptation réelle et profonde du droit communautaire aux réalités économiques ultramarines. Sinon, le système ne fonctionne tout simplement pas.
Certes, depuis près de deux ans, le dossier avance. À l'issue d'intenses débats techniques et après l'intervention personnelle du Président de la République au mois de septembre dernier, le gouvernement français a obtenu l'enclenchement d'une révision rétroactive du RGEC pour les RUP.
Un texte rénové devrait être publié d'ici à mars 2017 et le prochain forum des RUP. Nous travaillons avec pugnacité pour aboutir d'ici là. Nous œuvrons, avec le soutien des socio-professionnels des DOM, la Fédération des entreprises des départements d’outre-mer, la FEDOM, et l’association EURODOM, pour que des solutions pragmatiques soient trouvées dans le cadre des traités actuels.
Concrètement, nous souhaitons d’abord que l'octroi de mer soit sorti du périmètre de calcul des taux maximaux d'aides ; ensuite, que la notion de surcoûts soit mieux reconnue ; enfin, que le mode de contrôle des aides par entreprise soit neutralisé.
Nous avons bon espoir de trouver une issue favorable dans les semaines à venir. Je m'en entretiendrai lundi prochain avec la commissaire à la concurrence, Margrethe Vestager.
Deuxième point que je veux évoquer devant vous : la prise en compte des RUP dans la négociation des accords commerciaux de libre-échange.
Pour nous, c'est clair : il faut défendre les intérêts des Européens, et non pas une idéologie, fût-elle prétendument vertueuse, car favorable au libre-échange. Il nous appartient d'être vigilants dans la défense des intérêts des RUP, car, il faut bien le reconnaître, il peut être tentant, dans les grandes tractations internationales, de sacrifier nos économies insulaires et les acteurs locaux, qui pèsent si peu en comparaison des grandes entreprises implantées au cœur du continent.
Oui, ces régions fragiles subissent la concurrence d'États tiers non soumis aux mêmes réglementations sociales, fiscales ou environnementales. On le constate lors des négociations agricoles, les concurrents des pays tiers étant singulièrement avantagés par un moindre niveau d'exigences environnementales.
Les socio-professionnels comprennent donc d'autant moins que les intérêts des RUP soient délibérément oubliés, voire sacrifiés, au nom d'un libre-échange de plus en plus perçu, par nos compatriotes, comme dogmatique. Nous l’avons vu récemment avec l'affaire de l'accord avec le Vietnam qui imposait initialement aux RUP les conséquences d'une politique commerciale communautaire trop souvent synonyme de concessions unilatérales.
Il faut le rappeler d'emblée, les acteurs économiques ultramarins ont la volonté de se conformer aux règles communautaires. Mais celles-ci ne sauraient relever du dogme. Elles doivent prendre en compte les réalités locales, notamment sociales, démographiques et – c'est l'occasion d'en parler plus en détail ce soir – agricoles.
La proposition de résolution qu’il est proposé à la Haute Assemblée d’adopter vise à provoquer une prise de conscience, aux échelons national et européen, des périls qui menacent l'agriculture des régions ultrapériphériques.
L'enjeu économique et social est de première importance pour les outre-mer, qui, tout le monde le sait, connaissent un niveau de chômage et de pauvreté dramatiquement élevé, qu'aucun département de l'Hexagone ne supporterait. Je l'ai rappelé à l'Assemblée nationale le mois dernier, et j’aurai l’occasion de le souligner devant vous en janvier prochain, lorsque je présenterai le projet de loi de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer.
L’agriculture représente ainsi, dans les cinq DOM, une valeur ajoutée évaluée à 844 millions d'euros en 2013, soit environ 2, 4 % de la valeur ajoutée totale, contre 1, 7 % dans l'Hexagone. Cette proportion atteint même 3, 1 % en Martinique, soit presque deux fois plus qu'en métropole.
La filière canne-rhum représente près de 40 000 emplois dans les DOM, dont 22 000 directs. La filière banane joue également un rôle économique fondamental – 37 000 emplois en dépendent, directement ou indirectement – et garantit la viabilité de la desserte maritime.
Les trois grandes filières exportatrices – celles de la banane, de la canne à sucre et du rhum – ont réalisé d'importants efforts en matière de qualité et de respect des normes environnementales, dans l'objectif d'assurer une montée en gamme, devant être reconnue à sa juste valeur par les consommateurs européens.
Parallèlement, l'Union européenne a très opportunément financé la modernisation de la filière sucrière ultramarine et son positionnement sur les sucres haut de gamme. Il faut en effet reconnaître l'indéniable engagement consenti par l'Union européenne au profit des RUP. Sur la période 2014-2020, sont ainsi prévus 859 millions d'euros au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural, ou FEADER, soit 7, 5 % du total dévolu à la France entière, alors que les RUP représentent 3, 2 % de la population nationale.
C'est un effort important, alors que l’argent public est rare. J'en profite pour rappeler que ces fonds doivent être programmés, engagés et consommés le plus rapidement possible ; c'est pour moi une impérieuse priorité.
Il serait donc absurde, voire criminel, de compromettre tous ces efforts de long terme par rigidité normative ou par l’ouverture brutale du marché européen à des pays où le coût de la main-d'œuvre est entre quinze et vingt fois moins élevé que dans nos outre-mer.
Avant d’entrer plus en détail dans les sujets soulevés et d’évoquer les propositions que vous formulez dans le présent texte, mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite également vous faire part du fait que les autorités françaises préparent un document officiel, qui sera transmis à l’échelon européen pour contribuer à l'élaboration d'une nouvelle communication de la Commission européenne relative aux RUP, courant 2017.
Cette contribution officielle de la France comprend un volet relatif à l'agriculture et à la forêt, sur lequel je travaille avec le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Vos travaux permettront, sans aucun doute, d'enrichir ce document.
J’en viens au volet de la proposition de résolution consacré aux normes agricoles.
Le constat de la délégation sénatoriale à l’outre-mer est très clair, et je le partage : les normes nationales et européennes sont imbriquées et conçues pour une application uniforme, sur la base d'un climat tempéré. L'agriculture des régions ultramarines se situe donc dans ce que vous avez très justement appelé un « angle mort réglementaire ».
Dans ces conditions, il n'est guère surprenant de constater l'indisponibilité de nombreux usages phytosanitaires. On estime aujourd'hui que seulement 29 % des besoins phytosanitaires sont couverts en moyenne pour toutes les cultures d'outre-mer, contre 80 % en métropole.
Les cultures secondaires sont les plus pénalisées. Celle des ananas, en particulier, a accusé au cours des dernières années une chute de production très importante, car un seul produit phytosanitaire est autorisé pour la protéger.
Des dérogations sont possibles, mais dans un cadre très limité. C’est d'autant plus vrai que, la délégation l’a souligné, les interprétations françaises des normes européennes peuvent être maximalistes, si on les compare aux pratiques au sein des autres États membres de l'Union européenne.
Sur ce point comme sur d'autres, si la vigilance et le principe de précaution s'imposent, il faut sortir du complexe du bon élève. Il s'agit donc d'inviter la Commission européenne à acclimater les normes européennes agricoles au milieu tropical.
Le ministère de l'agriculture prend de plus en plus largement en compte les régions ultrapériphériques. J’en profite d’ailleurs pour saluer l'action de Stéphane Le Foll.
Ainsi, le ministère peut délivrer des autorisations de mise sur le marché en urgence, en cas de crise phytosanitaire. Ses services suivent attentivement les besoins des filières agricoles ultramarines, notamment ceux des grandes cultures exportatrices.
À cela s'ajoutent les activités des instituts de recherche nationaux : l'Institut national de la recherche agronomique, l’INRA, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, le CIRAD, et l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture, l’IRSTEA. Ces trois organismes publics dépensent en moyenne 60 millions d’euros par an dans les outre-mer.
Le travail de ces différentes institutions témoigne donc d'une volonté de remédier aux contraintes normatives pesant sur les agriculteurs ultramarins. Pour moi, il est important que cet effort public soit maintenu, voire amplifié, durant les prochaines années.
Parallèlement, je souhaite saluer les efforts entrepris et les importants progrès enregistrés en matière environnementale, au regard de la qualité des produits, par les producteurs agricoles ultramarins.
J'en veux pour preuve, à la suite à la mise en œuvre des plans successifs « Banane durable », la production de la banane française dans les Antilles, qui a considérablement diminué son recours aux produits phytosanitaires : moins 85 % en dix ans, avec un usage dix fois moins important que dans certains pays voisins.
Pour les espèces cultivées en outre-mer et soumises à la réglementation européenne, la demande de dérogation à cette réglementation que vous formulez ne nous paraît pas forcément constituer la priorité pour parvenir à la diffusion de variétés résistantes aux ravageurs. L'enjeu est avant tout de résoudre la difficulté à identifier les variétés résistantes et leurs mécanismes de résistance, ainsi que de créer des variétés intégrant ces résistances. Il s'agit donc plutôt d'une problématique de recherche.
À cet égard, il conviendrait de demander à la Commission européenne un soutien adapté en faveur des organismes de recherche que j’ai mentionnés tout à l'heure, et de pouvoir développer davantage de démarches partenariales.
Dans le même objectif, je vous annonce ce soir que le ministère de l'agriculture va très prochainement publier une nouvelle version du plan « Semences et plants pour une agriculture durable ». L’une des actions de ce plan porte spécifiquement sur les territoires ultramarins : elle prévoit de définir des objectifs de sélection des variétés pour les principales espèces tropicales cultivées dans les outre-mer.
J'en arrive au développement de l'agriculture biologique dans les outre-mer. Vous avez souhaité donner une place centrale, dans votre proposition de résolution, à la question de l'équivalence des normes biologiques entre les RUP soumises à la réglementation européenne et les pays tiers qui exportent vers les RUP, les normes applicables entraînant une concurrence sur les mêmes produits agricoles tropicaux.
Il ne sera pas possible d'évoquer ce soir tous les aspects de ces problèmes, très techniques. J'aborderai seulement un point clé.
Afin de clarifier davantage encore les règles qui s'appliquent dans les pays tiers, dans le nouveau projet de règlement bio en cours de révision, la Commission européenne a proposé, ce que la France soutient fortement, de remplacer le régime d'équivalence délivrée aux organismes certificateurs par un régime de conformité. Cela constituera un gage de confiance pour le consommateur et garantira des conditions de concurrence équitables pour les producteurs européens. Le Conseil et le Parlement européen appuient cette proposition. Vous le constatez, nous avançons dans la bonne direction.
Sur l'ensemble de ce dossier, l'approche défendue par les autorités françaises est de réussir à maintenir un standard européen exigeant. C’est tout aussi essentiel en métropole que dans les RUP, au regard de l'importance de ce marché pour l'Europe dans son ensemble, à l’échelle mondiale.
Ce qu'il faut que l'on parvienne à faire, c'est imposer nos critères aux autres pays, sur les produits tropicaux comme sur les autres. Pour cela, l'un des leviers à activer plus fermement, au-delà du renforcement de la réglementation européenne et de l'assurance de la bonne tenue des contrôles douaniers, c’est la recherche permanente d'une meilleure valorisation des productions tropicales françaises.
La qualité de nos productions, au plan environnemental, sanitaire et social, par rapport notamment à celle de certains de nos voisins, doit nous rendre fiers. Des instruments existent dans la réglementation européenne, comme le logo RUP, pour mettre en avant la qualité des produits européens. Il convient de renforcer de tels mécanismes.
De la même manière, pour ce qui est de la consommation locale, le renforcement de l'usage de la mention valorisante « produit pays » s’impose. Une véritable politique alimentaire en faveur de la qualité et des produits locaux doit être conduite, en particulier à destination des jeunes générations et de la restauration collective. Il faut diffuser, défendre et valoriser nos saveurs d'outre-mer.
J’en viens à la question des accords commerciaux.
En matière de commerce, la situation, vous l’avez souligné et je l’ai moi-même rappelé dans mes propos introductifs, est préoccupante et déséquilibrée.
Ainsi, en 2015, les bananes de Guadeloupe et de Martinique ne représentaient que 4, 5 % de l'approvisionnement de l'Union européenne. Pour ce qui concerne le sucre, en 2014, la part de marché des DOM français s'élevait à 2, 5 %. Celle-ci, s’agissant du rhum, atteignait certes 24 % du marché européen, mais elle était en diminution de moitié par rapport au niveau de 1986, année où elle s’établissait à 51 %.
Or, nous le savons, les régions ultrapériphériques ne sauraient concurrencer les pays tiers sur le terrain des coûts salariaux et de la protection sociale. Personne de sensé, heureusement, n'envisage un nivellement par le bas ; ce serait absurde et mortifère.
Le maintien et le développement des parts de marché des producteurs ultramarins reposent donc exclusivement sur une stratégie de montée en gamme.
Juridiquement, des mécanismes de protection sont prévus sous deux formes : la clause de sauvegarde spécifique et le mécanisme de stabilisation. Mais vous l’avez dit, monsieur le rapporteur, jamais, depuis 2013, la Commission européenne n'a activé ces dispositifs.
Je tiens à souligner devant vous, mesdames, messieurs les sénateurs, que la position de la France est constante : la politique commerciale européenne doit répondre, Mme la rapporteur l’a rappelé, aux exigences d'ambition, d'équilibre et de bénéfice mutuel.
Le Gouvernement, par la voix de Matthias Fekl, porte ce message depuis 2015 et l’a encore fait récemment, s'agissant du projet de traité transatlantique.
Le Premier ministre, Manuel Valls, l’a également souligné avec force, il faut que l'Europe, en matière de négociations commerciales, sorte de l'innocence. Nos intérêts économiques et nos emplois doivent prévaloir sur les théories, les postures et les dogmes.
Le Gouvernement a pleine conscience des enjeux pour les régions, notamment pour les RUP et leurs filières. Il est attentif, à l’échelon européen, à la prise en compte des territoires ultramarins dans les négociations.
Vous avez eu notamment l'occasion de débattre de la place des sucres spéciaux dans l'accord entre l'Union européenne et le Vietnam conclu en 2015. L'accord commercial a fait l’objet d’évolutions pour être pleinement satisfaisant.
C'est pourquoi la France insiste pour que les études d'impact que présente la Commission soient désormais aussi solides et rigoureuses que possible avant tout accord, et prennent dûment en compte les sensibilités agricoles des États membres de l'Union européenne, ce qu'elle s'est engagée à faire.
La France est ainsi active à l’échelon européen pour que des solutions concrètes soient trouvées afin d’améliorer le suivi du marché de la banane et de rendre les dispositions de sauvegarde plus opérationnelles.
S'agissant du mécanisme de stabilisation et de la clause de sauvegarde, les dispositions permettant leur déclenchement sont trop contraignantes et les délais incompressibles d'analyse du marché limitent l'efficacité des dispositifs et la capacité de la partie européenne à réagir rapidement.
Quant aux bases de données permettant le suivi du marché de la banane, les autorités françaises souhaitent, sur ce point aussi, proposer des évolutions. L'amélioration de l'outil statistique outre-mer est d'ailleurs l’un des objectifs importants contenus dans les dispositions du projet de loi de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer.
Il est également nécessaire de ne pas s'arrêter à de simples études de prix ou de marché. Ce qui fait la stabilité du marché européen, c'est aussi et surtout la situation économique et sociale réelle de ses producteurs. Celle-ci doit être évaluée dans chaque région et dans les territoires ultramarins évidemment, par le biais d’une étude sur l'évolution de l'emploi et de la prise en compte des différences en termes de structures, de capacités de production et d'exportation.
Enfin, je veux conclure mon propos en vous remerciant, monsieur le président de la délégation sénatoriale à l’outre-mer, de votre engagement au service des outre-mer et de vos travaux. Ils nous permettent d'enrichir tant notre réflexion que notre action et de mener des politiques publiques toujours plus pertinentes pour les outre-mer.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous le constatez, ce gouvernement est déterminé à défendre les intérêts des RUP au sein de l'Union européenne.
Les spécificités des outre-mer doivent être pleinement prises en compte afin de soutenir l'activité économique et l'emploi – surtout l’emploi – au sein de ces territoires.
Nos régions sont riches de leur agriculture, de la qualité de leur production et de leur savoir-faire : nous pouvons en être fiers.
Les outre-mer disposent de formidables atouts. Donnons-leur toutes les chances d'en tirer pleinement avantage !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe CRC, du groupe écologiste et du RDSE.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’examen de la proposition de résolution européenne qui nous est soumise aujourd'hui permet de rappeler clairement que le secteur agricole constitue un pilier essentiel de l'économie des outre-mer et un levier clé du développement économique de ceux-ci.
Ces territoires combinent un fort potentiel naturel et de grandes fragilités structurelles. L'essor de leur agriculture est bridé par des contraintes de tous ordres : éloignement et insularité qui renchérissent les intrants, étroitesse des marchés intérieurs, virulence et récurrence des aléas climatiques. En particulier, le fait de devoir faire appel à l'expertise de l'Hexagone pour procéder aux analyses et aux diagnostics phytosanitaires et vétérinaires peut poser des problèmes de délais et de coûts.
Au-delà de ces difficultés structurelles, il est important de souligner à quel point les régions ultrapériphériques, aussi éloignées soient-elles du continent européen, font partie intégrante de l'Union européenne et contribuent au dynamisme, à la prospérité et au rayonnement de cette dernière sur l’ensemble du globe. Néanmoins, il faut sans cesse le rappeler aux institutions européennes, qui ont tendance à uniformiser les normes pour l'ensemble de l'Union européenne et à les résumer aux contraintes continentales, sans prendre en compte les spécificités des RUP.
Il convient de mentionner que les régions ultrapériphériques représentent pour l'Europe un véritable gisement. Avec leurs 4, 3 millions d'habitants, elles occupent une immense partie du territoire maritime européen, qu’elles hissent au premier rang mondial. À cela s'ajoutent 80 % de la biodiversité européenne, une économie non délocalisable, avec des produits agricoles uniques, des destinations touristiques paradisiaques et des sites industriels de pointe, comme ceux qui concernent l'aérospatial.
Pour autant, il ne faut pas oublier que les RUP doivent faire face à des contraintes liées à leur localisation, leur géographie, leur éloignement. Nous devons en tenir compte.
Nous en sommes tous conscients dans cet hémicycle, et ce depuis longtemps. Grâce à vous tous, mes chers collègues, notre nation mène une politique spécifique envers ses outre-mer. Mais il est fondamental que l'Union européenne en ait également pleinement conscience.
Juridiquement, la prise en compte de cette spécificité existe bien, grâce à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Mais dans les faits, on ne peut que regretter sa faible invocation.
Or les territoires ultramarins doivent surmonter des difficultés intrinsèques, notamment en matière de développement économique. Ainsi, la politique européenne doit permettre de réduire les écarts avec les territoires continentaux. On peut citer, par exemple, les problèmes liés au coût des transports, des personnes et des marchandises qui renchérissent grandement le coût de la vie et diminuent la compétitivité de ces territoires.
Il est donc impératif que les institutions européennes adaptent les règlements européens aux régions ultrapériphériques. Inversement, contraindre celles-ci à adopter des règlements européens inappropriés à leur situation accroît leurs difficultés.
Nous devons par conséquent continuer à défendre des programmes spécifiques, sectoriels en faveur de certaines filières, comme celles des technologies de l'information et de la communication, des transports ou des énergies renouvelables. Nous voulons que ces régions soient des territoires d'avenir, avec des projets pilotes et expérimentaux.
Les institutions européennes ont l'obligation de prendre en compte les spécificités des RUP.
L'Union européenne veut créer un partenariat clair avec les RUP qui s'articule autour de cinq grands piliers : améliorer l'accessibilité, accroître la compétitivité, renforcer l'intégration régionale, soutenir la dimension sociale du développement et s’adapter au changement climatique, qui affecte tout particulièrement ces territoires.
Avec cette proposition de résolution européenne, le Sénat estime nécessaire de garantir la cohérence des politiques agricole, sanitaire et commerciale de l'Union européenne, et invite la Commission européenne à adapter les normes européennes réglementant l'agriculture et l'élevage aux contraintes propres des RUP en tenant compte des spécificités des productions en milieu tropical.
En guise d’illustration, j'aimerais apporter un témoignage sur la situation en Guyane, où j'ai eu la chance de me rendre en mission, situation qui illustre parfaitement les difficultés ressenties par les agriculteurs exploitants et les éleveurs.
Pour développer l'agriculture et l'élevage, des terres actuellement couvertes de forêts doivent d’abord être déforestées. Cette première étape est déjà complexe à cause de la géographie et du relief accidenté. Ensuite, les exploitants doivent ensemencer la terre en herbe. Pour cela, ils doivent utiliser des semences uniquement produites au Brésil et capables de s'adapter à la terre et à l'humidité.
Néanmoins, les exigences européennes imposent des contraintes communautaires sur ces semences, que les agriculteurs guyanais, en conséquence, ne peuvent pas acheter directement au Brésil. Les semences doivent être transportées en Europe avant de repartir vers la Guyane… Notez la logique ! D’autant que, au terme de ce transport, le coût des produits phytosanitaires peut être quatre fois plus élevé qu’au Brésil ou au Surinam voisin. On voit bien les travers qui se produisent en termes de compétitivité…
Je ferai maintenant une remarque rapide concernant les questions sanitaires. Lorsqu’un animal est malade en Guyane, certains prélèvements sanguins ne peuvent être analysés que dans des pays fort éloignés. Le temps d’acheminer les prélèvements et d’en obtenir les résultats, un élevage complet peut être perdu.
Au final, ces exemples, loin d’être anecdotiques, reflètent la complexité, mais surtout l’incohérence de certaines décisions communautaires applicables dans les RUP. Cette situation a des effets directs sur le développement économique de ces dernières.
Les politiques européennes doivent non seulement prendre en compte les contraintes effectives et la diversité des régions, mais aussi assurer une meilleure cohérence dans leur mise en œuvre.
C’est un sujet malheureusement récurrent, puisque, en 2011, en 2012 et en 2014, nous avons déjà adopté des résolutions allant dans le même sens. J’avais d’ailleurs eu le plaisir, au nom de la délégation à l’outre-mer, d’être le rapporteur de deux d’entre elles qui relevaient l’incohérence de la politique commerciale.
Le positionnement du Sénat doit permettre au Gouvernement de défendre des problématiques françaises. Pour cela, la présente proposition de résolution européenne est très claire dans les objectifs poursuivis : acclimater les normes européennes agricoles aux RUP ; autoriser pour les RUP la culture locale de variétés végétales résistantes aux ravageurs tropicaux – nous notons et approuvons votre souhait, madame la ministre, d’encourager davantage la recherche et d’inventer une solution par ce moyen ; autoriser la certification de l’agriculture biologique par un système participatif de garantie, ou SPG ; inciter la Commission européenne à prolonger au-delà de 2019 les mécanismes de stabilisation prévus dans les accords sur la banane.
La délégation sénatoriale à l’outre-mer a souhaité traduire les recommandations de son rapport d’information sur les normes sanitaires et phytosanitaires applicables à l’agriculture dans les outre-mer dans cette proposition de résolution européenne.
Avant de conclure, je souhaite remercier les auteurs et les rapporteurs de ce texte. Notre assemblée doit être celle de tous les territoires français. Notre rôle est donc de comprendre les spécificités de ceux-ci et d’adopter les mesures au plus près de leur réalité.
Le groupe UDI-UC votera par conséquent sans réserve en faveur de cette proposition de résolution.
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et du groupe socialiste et républicain.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je veux tout d’abord vous dire mon plaisir de participer à ce débat en tant que représentant du groupe écologiste, mais aussi en tant que Breton. Nous sommes au moins deux dans cet hémicycle !

M. Joël Labbé. Vous êtes, vous, mon cher collègue, à la périphérie de la Bretagne…
Sourires.

Cela étant, je ne sais qui a trouvé cette dénomination « région ultrapériphérique », « RUP »… Je vous ai écoutée avec attention, madame la ministre : vous avez parlé à plusieurs reprises de « l’outre-mer » ; cette expression est bien plus jolie ! Réfléchissons-y ensemble, car comment qualifiera-t-on demain les populations de ces territoires ? Nous devons y prendre garde.
Quoi qu’il en soit, nous examinons une fois de plus un texte visant à alléger les normes agricoles.
Qu’il faille par certains aspects aménager les normes européennes aux spécificités tropicales des régions éloignées, cela semble être de bon sens.
On peut même voir une ouverture intéressante dans le fait d’utiliser des semences non inscrites au catalogue officiel, ce qui permettrait de mettre en culture des semences plus adaptées aux terroirs et aux climats spécifiques de ces régions, ainsi que des semences anciennes dont, malheureusement, le patrimoine est trop peu exploité.
Vous avez évoqué la recherche, madame la ministre ; dans ce domaine, il y a des travaux de recherche fondamentale à mener !
Toutefois, il ne faudrait pas que cela rende possible la mise en culture de variétés issues des nouvelles techniques d’édition du génome, en dehors de tout contrôle, les risques étant encore mal évalués et la dangerosité de ces produits étant équivalente, voire supérieure, à celle des OGM.
Concernant l’allégement du cahier des charges de l’agriculture bio, nous ne pouvons pas cautionner certains éléments de ce texte. En effet, comme l’a rappelé récemment M. le ministre de l’agriculture lors de son audition au Sénat, le lien au sol est essentiel dans notre agriculture. Nous ne pouvons donc avaliser une agriculture qui renierait ce lien, et ce d’autant moins pour l’agriculture bio.
Qu’il faille soutenir le développement des filières bio, y compris dans les outre-mer, c’est une évidence. Elles connaissent d’ailleurs, comme partout dans nos territoires, une forte progression depuis quelques années.
Les gros producteurs en monoculture font pression pour alléger le cahier des charges de l’agriculture bio, mais cela conduirait à une dévalorisation généralisée de la filière et des labels bio français et européens. Il faut, au contraire, soutenir les véritables démarches de transition, qui mêlent la polyculture élevage, les productions biologiques maraîchères et vivrières, ainsi que l’arboriculture.
Le texte que nous examinons contient de très bonnes mesures. Il est ainsi demandé à la Commission européenne de supprimer les tolérances à l’importation pour les denrées traitées par une substance active interdite dans l’Union européenne. Il est recommandé, par ailleurs, à la Commission « d’établir une liste noire pour interdire les importations de produits de la pêche et de légumes-racines depuis les pays qui ont traité massivement par le passé leur production avec des substances polluantes rémanentes dans le sol et l’eau » ; ce dernier point laisse songeur lorsque l’on connaît l’ampleur de la pollution au chlordécone aux Antilles.
On ne peut décemment interdire les importations sous prétexte de pollution diffuse et permettre à nos exploitations durablement polluées d’être certifiées bio !
La proposition de résolution évoque également les homologations de produits phytosanitaires. Il y a là, madame la ministre, un enjeu important.
La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt avait enregistré dans son article 50 un principe d’homologation simplifié pour les produits dits « de biocontrôle ».
À ce jour, la situation est au point mort. J’ai rencontré personnellement trois responsables de PME industrielles du secteur dont l’activité et les perspectives de croissance et d’emploi, sans compter la dynamique à l’international, sont bloquées, car le décret en Conseil d’État qui devait intervenir n’est toujours pas paru – ou, plus exactement, les décrets parus se révèlent inopérants.
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES, ne connaît pas de procédure simplifiée, c’est regrettable. Elle ne s’avoue pas davantage en mesure d’élargir la liste des préparations naturelles peu préoccupantes, les PNPP. À peine une centaine d’entre elles a été autorisée par décret sur une liste de près de 700 substances naturelles que nous avons soumise à l’Agence. Or leur usage permettrait de réduire drastiquement les problématiques rencontrées, y compris dans nos régions ultrapériphériques, sans avoir recours à des produits phytopharmaceutiques dont la dangerosité pour les populations et l’environnement est avérée.
Mes chers collègues, ne faisons pas l’erreur de croire que c’est en abaissant les exigences de qualité du label bio ou en autorisant des produits chimiques interdits par ailleurs que nous allons aider l’agriculture de nos régions tropicales. Nous le ferons, au contraire, en libérant les solutions innovantes et propres qui sont déjà à notre portée et qui n’attendent que leur autorisation par l’ANSES. Là encore, madame la ministre, des travaux de recherche spécifiques aux territoires d’outre-mer doivent être menés. Il convient également d’accompagner tous les agriculteurs qui le souhaitent vers une véritable transition agricole. Ne nous trompons pas de combat !
Pour marquer l’ensemble de ces réserves, le groupe écologiste a le grand regret de s’abstenir sur ce texte.

Je tiens d’abord à remercier la délégation à l’outre-mer, à l’origine de cette proposition de résolution, qui fait suite à son rapport du mois de juillet 2016. Ce texte constitue une nette avancée dans le domaine de la production agricole des régions d’outre-mer. Mais tout n’est pas réglé, loin de là.
En effet, comme l’a très souvent souligné Paul Vergès, la question principale pour les productions agricoles d’outre-mer, mais aussi pour les autres productions industrielles, reste la mise en place des accords de partenariat économique, les APE, qui remplacent les accords de Lomé et de Cotonou. Il s’agit de créer des zones de libre-échange entre les anciens pays colonisés d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et les pays européens qui les ont colonisés.
À ce titre, ces accords sont une menace considérable pour les productions ultramarines. En effet, à ce jour, personne n’est capable de définir clairement ce qu’ils contiennent.
En outre, les outre-mer n’ont jamais été entendus. C’est la France qui a défendu, ou tenté de défendre, les intérêts ultramarins. Cette stratégie de défense, s’il s’agit bien de cela, ne repose sur aucune analyse chiffrée. Ainsi, il n’y a jamais eu, préalablement à la ratification de ces textes, une quelconque étude d’impact sur les conséquences pour les économies ultramarines des accords envisagés.
Comme le TAFTA, ou Transatlantic Free Trade A greement, et les autres documents de libéralisation des échanges, les APE sont victimes d’une opacité totale. Comment peut-on se satisfaire de réponses à l’emporte-pièce, telles que celles du Gouvernement ?
Je citerai un exemple. À Paul Vergès, qui voulait savoir quelles productions agricoles pourraient être importées sur le sol réunionnais au titre des APE, le ministère des affaires européennes a répondu, en des termes surréalistes : « Certaines lignes tarifaires correspondant à des produits sensibles ne seront pas libéralisées immédiatement. » Quelles sont ces lignes, quels sont ces produits ? Aucune réponse n’a été donnée à cet égard.
Comment, dès lors, le monde agricole ultramarin peut-il se préparer à l’arrivée de productions provenant des pays de leur zone géographique ? Comment peut-il définir une stratégie de développement ou de diversification ?
C’est dans ce contexte d’incertitude, de flou et d’impréparation totale que je plaide pour la mise en place de clauses de sauvegarde automatiques, voire d’un moratoire avant l’application des APE dans les outre-mer. Cela suppose une présence ultramarine aux côtés de la France dans la délégation européenne qui négocie ces accords.
La commission du commerce international du Parlement européen commence à prendre la mesure du danger de ces APE sur les économies d’outre-mer. J’en veux pour preuve l’amendement qui a été adopté pour protéger les producteurs de bananes des Antilles. En effet, la production de ces derniers était menacée par la signature d’un accord de libre-échange entre l’Union européenne, d’une part, le Pérou, la Colombie et l’Équateur, d’autre part.
Dans l’attente d’une ratification officielle tant par la Commission européenne que par le Conseil européen, le vote de cet amendement ouvre la voie à la protection d’autres productions. Je pense notamment à la canne à sucre.Je suis désolée, mes chers collègues, je n’avais pas prévu qu’il serait si difficile pour moi de prendre aujourd’hui la place de Paul Vergès…
La canne à sucre est un secteur clé de l’économie réunionnaise. Mais cette filière aura-t-elle encore un avenir après 2017 ? Au mois de septembre prochain interviendra la fin des quotas sucriers et du prix garanti. Comment les producteurs réunionnais et antillais pourront-ils aborder cette échéance ? À La Réunion, 18 000 emplois sont en jeu. Le Gouvernement a mis en place des structures pour aider les betteraviers à traverser cette étape, mais il a purement et simplement oublié les producteurs de canne.
La filière canne à sucre-rhum-bagasse de La Réunion va-t-elle connaître le sort du géranium et du vétiver, secteurs qui avaient subi un gros choc social et économique ? Pour la canne, les conséquences seront infiniment plus grandes.
Il est donc indispensable que, du côté du Gouvernement, l’on se saisisse de toutes les opportunités pour préserver les intérêts agricoles des outre-mer. Nous n’avons pas le sentiment que tel soit le cas.
Ainsi, nous ne pouvons qu’être inquiets lorsqu’un membre du Gouvernement déclare, au Sénat, le 21 juin dernier : « Nos départements et régions d’outre-mer se situent en effet à proximité de ces pays et peuvent donc exporter une partie importante de leur production vers ces territoires. »
Le Sénat, lui, est pleinement conscient des enjeux. Il a adopté, au mois de janvier dernier, la proposition de résolution visant à une meilleure prise en compte des RUP dans la politique commerciale de l’Union européenne, spécifiquement les incidences de la libéralisation du marché du sucre.
Pour en revenir à la proposition de résolution qui nous est aujourd’hui présentée, il est bien évident qu’il est impératif d’adapter les normes européennes à nos situations spécifiques.
Rappelons que les RUP françaises souffrent de handicaps structurels et conjoncturels considérables. À cet égard, citons la question du prix de revient des productions agricoles : celui des productions des pays avoisinant nos outre-mer est extrêmement bas, étant donné le niveau de salaire qui y est appliqué.
En outre, les pays voisins des RUP ne sont pas soumis aux règles phytosanitaires européennes. Et parfois ils utilisent des produits interdits sur le sol européen. Néanmoins, au nom de la sacro-sainte libéralisation des échanges, l’Europe tolère l’importation de produits comportant des substances, que, par ailleurs, elle interdit.
Relevons aussi la question de la recherche et des moyens de celle-ci appliquée à ces « petits marchés » que sont les outre-mer. Au nom du profit, les recherches spécifiques ne sont pas financées. Les agriculteurs font donc face à une absence d’alternative.
Pour terminer, je tiens à souligner l’intérêt de la création d’observatoires des prix et des revenus pour les grandes filières exportatrices des RUP que sont celles de la banane et de la canne. Il s’agit de disposer de mesures fiables, publiques et transparentes des effets des importations en provenance des pays tiers, mesures qui, je le souligne, ne peuvent être effectuées en remplacement de l’étude d’impact que nous demandons sur la mise en place des APE.
J’adhère aussi à cette idée d’un meilleur contrôle des importations et des certifications des produits des pays tiers.
Cette proposition de résolution répond donc à des problématiques particulières et soulève de véritables questions de fond. Le groupe CRC la votera.
Applaudissements. – M. Joël Labbé et quelques sénateurs du groupe Les Républicains se lèvent et applaudissent également .

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les régions ultrapériphériques françaises font, bien entendu, partie intégrante de la Nation. Mais eu égard à leur éclatement géographique, à l’exiguïté de leur territoire, à la faiblesse de leur marché d’exportation, à leur grande dépendance vis-à-vis de la France et de l’Europe en matière d’importation et à la fragilité de leurs économies en raison de phénomènes climatiques, ces régions doivent trouver des applications différenciées de la réglementation française et européenne pour mieux tenir compte de ces spécificités.
Je le sais, mes chers collègues, plusieurs régions de la France hexagonale connaissent certaines de ces difficultés, mais, à la différence de nos régions, elles ne les cumulent pas.
La délégation sénatoriale à l’outre-mer, sous l’égide de son excellent président, Michel Magras, s’est donc tout naturellement saisie de cette épineuse question des normes applicables en outre-mer et consacre le premier volet de son document y afférent à l’application des normes sanitaires et phytosanitaires.
La présente proposition de résolution fait donc suite au rapport d’information de la délégation adopté le 7 juillet dernier et intitulé Agricultures des out re-mer : p as d’avenir sans acclimatation du cadre normatif.
Les auteurs de ce rapport de qualité, Catherine Procaccia, Jacques Gillot et Éric Doligé, ainsi que Gisèle Jourda et Michel Magras ont souligné l’importance en termes d’enjeux socio-économiques de la production agricole dans les collectivités d’outre-mer que « l’éloignement de l’Hexagone et l’étroitesse des surfaces disponibles exposent au double défi de la réduction de la dépendance alimentaire et de l’identification de ressources de développement endogène. »
La production agricole de ces régions est menacée par la concurrence intense de pays tiers, liés à l’Union européenne par des accords commerciaux de libre-échange, ainsi que par l’application de normes sanitaires et phytosanitaires européennes et françaises bien souvent inadaptées aux besoins des producteurs locaux, les produits n’ayant pas été éprouvés en milieux tropicaux.
Aussi, le rapport évalue l’application de la réglementation européenne et française, dresse les défauts de procédures d’homologation et dénonce les lacunes des systèmes de contrôles des importations de productions agricoles de pays tiers. Il apparaît clairement à la lecture de ce document que les politiques en matière agricole peuvent se révéler particulièrement préjudiciables à nos régions en raison des contradictions intrinsèques qu’elles comportent et des distorsions de concurrence que celles-ci induisent.
La concurrence est d’autant plus déloyale quand les partenaires commerciaux de l’Union européenne n’appliquent pas les mêmes normes sociales, environnementales ou en matière de sécurité sanitaire. Les coûts de production sont moindres et les produits très probablement de moins bonne qualité, conséquence d’une rémanence plus longue des pesticides et autres produits chimiques.
L’usage déséquilibré des produits phytosanitaires par ces pays nuit à nos régions ultramarines, dont les producteurs se sont engagés dans une démarche volontariste, afin de réduire l’utilisation des produits chimiques, surtout après le désastre du chlordécone.
L’objet de la présente proposition de résolution est donc d’inciter à une prise de conscience des autorités françaises et européennes de la nécessité d’intégrer les spécificités des régions ultrapériphériques françaises, tout en augmentant le niveau d’exigence à l’égard des pays partenaires de l’Union européenne ; sans quoi, comme le souligne le rapport de Gisèle Jourda, la dynamique de montée en gamme entreprise par les producteurs de nos régions ultrapériphériques pourrait être réduite à néant.
Or il apparaît aujourd’hui que le maintien et le développement des parts de marché des producteurs ultramarins reposent particulièrement sur cette stratégie qualitative.
De même, la proposition de résolution prévoit que les accords de libre-échange entre l’Union européenne et les pays tiers et les instruments de défense de nos marchés doivent être reconsidérés.
D’une part, les critères et les procédures de déclenchement de la clause de sauvegarde spécifique doivent être revus, de manière que l’Union européenne puisse suspendre le droit de douane préférentiel prévu par les accords de libre-échange en cas de besoin. D’autre part, les mécanismes de stabilisation doivent être révisés, car, s’ils existent, ils sont inadaptés et n’ont jamais été actionnés, malgré l’importation massive de produits similaires qui perturbent effectivement le marché.
Dès lors, le groupe du RDSE soutient pleinement la proposition de résolution présentée par la délégation à l’outre-mer et se positionne clairement en faveur de la défense d’une agriculture ultramarine de qualité.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et de l'UDI-UC.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, politique commerciale européenne et normes agricoles applicables à nos régions ultrapériphériques, voilà deux sujets de préoccupation lourds pour les territoires ultramarins dont les économies restent largement structurées autour de deux grandes filières héritées d’un autre âge, la banane et la canne.
Ces sujets reviennent dans notre hémicycle de façon récurrente, car le Sénat reste indéfectiblement attentif au sort de nos territoires, et je salue encore une fois l’initiative du président Gérard Larcher d’avoir engagé, en 2009, la création d’une mission d’information sur la situation des départements d’outre-mer, laquelle a conduit à la mise en place en 2011, par le président Jean-Pierre Bel, de notre délégation.
Selon une expression chère à Aimé Césaire, la délégation agit comme « éveilleur de conscience », vis-à-vis tant des gouvernements successifs que des instances européennes, notamment la Commission.
La délégation remet d’ailleurs inlassablement sur le métier la question des accords commerciaux conclus par l’Union européenne, mais aussi celle de la nécessaire prise en compte des spécificités des régions ultrapériphériques, prenant ainsi le relais des préconisations 35 et 54 du rapport d’information de 2009.
Permettez-moi de rappeler les termes de cette dernière préconisation qui, malheureusement, n’a guère été suivie d’effet à ce jour : « Tenir compte davantage des spécificités des régions ultrapériphériques dans le cadre des accords de partenariat économique avec les pays ACP et mettre en place un mécanisme spécifique et régulier d’évaluation de ces accords au regard de leur impact sur l’économie des DOM. »
Dans le prolongement de ce rapport fondateur, Éric Doligé et moi-même avions déposé, voilà cinq ans déjà, une proposition de résolution européenne pour dénoncer l’indifférence de la Commission européenne aux répercussions, sur les agricultures ultramarines, des accords commerciaux conclus avec les pays producteurs concurrents, sans véritables garde-fous, au nom du dogme du libre-échange.
Or les effets collatéraux de ces accords menacent gravement les centres vitaux de l’économie de nos outre-mer, exposés à la concurrence de pays qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes sociales, salariales ou sanitaires. L’effet est même tangible sur les marchés locaux, inondés par une concurrence déloyale à bas coûts !
Parallèlement à cette vigilance qu’elle n’a cessé d’exercer sur les effets en outre-mer des politiques de l’Union européenne, avec quatre autres propositions de résolution relatives à la défense, respectivement de la banane, du secteur de la pêche en 2012, du rhum des DOM en 2013 et, dernièrement, des sucres spéciaux, la délégation à l’outre-mer a engagé une réflexion globale sur les normes sanitaires et phytosanitaires applicables aux agricultures ultramarines.
Ses recommandations ont été consignées dans l’excellent rapport d’information d’Éric Doligé, Jacques Gillot et Catherine Procaccia ; certaines d’entre elles seront reprises dans le rapport prochainement publié d’Odette Herviaux, qui s’est vue confier par le Premier ministre une mission sur la simplification des normes agricoles. Elle recommande, à juste titre, dans ce document que des représentants des outre-mer siègent dans le comité de rénovation des normes en agriculture, installé au mois de mars dernier.
Est également proposée la possibilité pour les RUP d’autoriser une culture locale d’une variété végétale résistante aux ravageurs tropicaux, sans que celle-ci soit nécessairement inscrite au catalogue européen des variétés.
Est enfin soulignée la nécessité de requalifier les importations de produits bio provenant de pays tiers, car cette qualification est trompeuse pour le consommateur, dès lors que ces produits bio venus de l’extérieur ne répondent pas au même degré d’exigence que ceux qui sont fabriqués sur le territoire européen.
La proposition de résolution européenne dont nous discutons aujourd’hui a le mérite de souligner la complémentarité des problématiques posées par la politique commerciale de l’Union, d’une part, et l’inadéquation des contraintes phytosanitaires qui pèsent sur les agricultures ultramarines, d’autre part.
Les procédures en vigueur et le spectre normatif en matière agricole ignorent en effet la dimension tropicale et la petite taille de nos marchés. C’est la double peine, et ce alors même que les agricultures de nos outre-mer sont vertueuses et pourraient être des ambassadrices des valeurs sociales et environnementales de l’Union européenne dans les différents océans. J’en veux pour preuve le retour de la biodiversité dans nos bananeraies, notamment en Guadeloupe et à la Martinique.
La communication de la Commission européenne du 20 juin 2012 définissant la stratégie de l’Union à l’égard des RUP laissait miroiter une embellie pour la prise en compte effective des contraintes spécifiques et de la diversité de ces régions, ainsi qu’une meilleure cohérence entre elles des politiques européennes.
Or force est de constater que l’objectif n’est pas encore atteint, et même que la Commission européenne rechigne à actionner les mécanismes de stabilisation des marchés qu’elle a pourtant acceptés. Il ne faut cesser de le répéter, elle campe sur son interprétation restrictive de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou TFUE, malgré les évolutions jurisprudentielles favorables de la Cour de justice de Luxembourg qui, en 2015, ont étendu au droit dérivé la faculté de déroger ou d’adapter consentie par cet article. Vous l’avez dit, madame la ministre, mais il faut remettre encore l’ouvrage sur le métier. Pour faire entrer un clou dans un mur, il faut donner plusieurs coups !
Mes chers collègues, la France enrichit l’Europe de sa diversité territoriale et humaine ; elle doit continuer à défendre ses particularités et à affirmer ses modèles de qualité. Battons-nous inlassablement pour défendre cette juste cause, qui est également la clé du développement de nos économies ultramarines !
Pour toutes ces raisons, avec le groupe socialiste et républicain, je vous appelle à voter des deux mains la proposition de résolution qui nous est soumise.
Applaudissements.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la présente proposition de résolution européenne est issue des travaux que nous avons effectués et qui ont déjà été rappelés. Nous avons découvert tant d’aberrations que nous ne pouvions pas ne rien faire. Nous voulons faire vivre nos préconisations, qui sont précises et concrètes : le dépôt d’un texte destiné à interpeller les autorités européennes nous est apparu comme une suite logique.
Pour simplifier les normes agricoles outre-mer, les efforts doivent être menés à l’échelon à la fois national et européen. En France, le ministère de l’agriculture et l’ANSES commencent à prendre conscience des spécificités ultramarines. C’est une véritable avancée, si l’on considère le rapport que j’ai rendu en 2009 sur le chlordécone aux Antilles.
L’extrême fragilité des filières ultramarines, confrontées à de nombreux usages orphelins, n’a pas été encore complètement prise en compte. Le ministère de l’agriculture a créé un comité des usages orphelins outre-mer et a rénové le catalogue des usages agricoles pour faire toute leur place aux cultures tropicales. L’ANSES s’est dotée d’un référent outre-mer qui dialogue avec les filières en amont de la procédure d’homologation. Ce sont des évolutions intéressantes, mais encore insuffisantes pour remplir l’objectif d’une couverture à hauteur de 49 % en 2017 des besoins phytosanitaires, objectif que les autorités françaises se sont elles-mêmes fixé.
Il faut donc aller plus loin. Il est temps d’adapter aux spécificités des outre-mer les limites maximales de résidus, les LMR. Il est clair que les prescriptions associées aux autorisations de mise sur le marché, ou AMM, des produits phytosanitaires doivent être différenciées selon le climat, quoi qu’en pense Joël Labbé. Les conditions d’utilisation, comme la dose, le nombre d’applications, les cadences et les délais des traitements avant récolte, ne peuvent plus être définies de façon uniforme en outre-mer comme en Europe, car ce sont toujours les producteurs des DOM qui en pâtissent.
Pour réduire les usages orphelins et accélérer le déploiement d’une couverture phytosanitaire adaptée outre-mer, nous préconisons d’obliger les firmes pétitionnaires à joindre à tout dossier d’AMM des analyses portant sur l’utilisation du produit sur cultures tropicales. En contrepartie, les firmes bénéficieraient simultanément de l’AMM et de l’extension de celle-ci pour l’usage tropical. Cela réduirait immanquablement les délais et les coûts au bénéfice des producteurs ultramarins.
Actuellement, la plupart des produits phytopharmaceutiques utilisés ne sont pas homologués directement, notamment pour la banane, la canne à sucre, l’ananas. Ils le sont pour les grandes cultures de l’Hexagone, comme celles du blé, du maïs, de la tomate, et suivent ensuite une deuxième procédure d’extension d’autorisation pour usage mineur sur une culture tropicale. Nous souhaitons au contraire fusionner les procédures et forcer les firmes à fournir des données sur les cultures tropicales qui permettront de mieux calibrer les AMM et les conditions d’utilisation. Si nous y parvenons, ce sera une petite révolution !
Il nous paraît également essentiel d’assurer un traitement spécifique des substances indispensables à la survie des cultures. La France doit rester vigilante sur de nombreux dossiers. En particulier, elle doit veiller au maintien d’une couverture en herbicide pour la canne. À l’échelon européen, le Royaume-Uni était désigné comme État membre rapporteur pour étudier l’Asulox, dont l’AMM doit encore être renouvelée. Après le Brexit, personne ne peut nous dire si cette procédure se conclura.
Le ministre de l’agriculture devrait aussi prendre garde à ajuster les autorisations de traitement en urgence. On nous a cité, à moult reprises, l’exemple d’un fongicide autorisé en urgence pendant cent vingt jours pour protéger les plants de melon. Le seul problème est que la période fixée correspondait à la récolte du melon des Charentes, mais pas à celle du melon de Guadeloupe. Les maraîchers guadeloupéens en ont fait les frais.
Par ailleurs, certaines interprétations françaises des normes européennes sont maximalistes. Je vous remercie, madame la ministre, de l’avoir reconnu ! Ainsi, des préparations comme les biostimulants, qui sont à la frontière entre les fertilisants et les produits phytosanitaires, ne sont pas évaluées de la même manière partout. En France, si le biostimulant a un effet sur les mécanismes de défense de la plante contre un bioagresseur, il doit suivre la procédure d’AMM des pesticides. En revanche, l’Espagne et l’Allemagne évaluent ces produits comme de simples fertilisants et les font bénéficier d’une procédure d’autorisation beaucoup plus souple.
Force est de constater que les principaux blocages pénalisant les agricultures ultramarines se situent à l’échelon européen. Nos territoires d’outre-mer demeurent largement invisibles pour les autorités communautaires, qui ne les prennent en considération ni dans l’élaboration des normes phytosanitaires ni dans l’évaluation des risques.
En particulier, l’Autorité européenne de sécurité alimentaire, l’EFSA, a clairement admis devant nous que les spécificités de l’agriculture des RUP n’étaient pas prises en compte dans ses travaux. En d’autres termes, les RUP restent délibérément hors du champ d’investigation de l’Agence, qui n’est donc pas en mesure d’infléchir ses avis.
Par exemple, le potentiel de contamination des eaux souterraines par une substance active est évalué par l’EFSA en considérant neuf lieux représentatifs des grandes zones de productions agricoles en Europe. Le site de Châteaudun est retenu pour la France, continentale comme ultramarine. Les conditions spécifiques des sols et des climats en milieu tropical ne sont pas considérées malgré d’énormes différences qui jouent sur la diffusion des polluants. Difficile, il faut l’avouer, d’extrapoler quelque chose de la culture du blé dans la Beauce pour définir des normes applicables aux Antilles, en Guyane ou à La Réunion…
De même, les évaluations d’exposition des consommateurs aux résidus de pesticides sont basées sur les régimes alimentaires inclus dans un modèle appelé PRIMo, qui prend en considération vingt-deux régimes européens. Aucun régime ultramarin n’en fait partie. Les spécificités alimentaires des populations caribéennes ou de l’océan Indien sont totalement ignorées. Mais c’est en matière d’encadrement des moyens de lutte biologique que les normes européennes apparaissent les plus pénalisantes. Cela ne peut manquer de surprendre, alors que leur faible nocivité en fait une alternative de choix aux traitements chimiques.
Nos instituts de recherche, comme l’Institut national de la recherche agronomique, l’INRA, et le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, le CIRAD, y travaillent activement et sont déjà fortement implantés outre-mer. Mais, comble du paradoxe, ce sont les pays tiers avec lesquels nous menons des coopérations qui sont en mesure d’exploiter ces techniques !
La question des normes applicables aux phéromones est particulièrement importante. Certaines phéromones pourraient être utilisées pour compenser les usages orphelins sur les cultures fruitières et légumières des DOM. Mais les phéromones sont considérées comme des substances actives au plan européen. Elles sont soumises à la procédure du règlement « pesticides » de 2009 et doivent obtenir une AMM, comme n’importe quel produit phytopharmaceutique. Malgré leur efficacité, les méthodes de l’INRA pour lutter contre le charançon de la patate douce, par exemple, ne peuvent pas légalement être utilisées par les producteurs en l’absence d’AMM, même si cette phéromone n’est pas en contact avec la culture et n’est pas dispersée dans l’environnement.
Malheureusement, la longueur et le coût de la procédure d’homologation sont trop élevés pour intéresser une firme. Nos instituts de recherche français n’ont ni les moyens financiers ni la vocation de s’y substituer, si bien que les résultats de la recherche restent lettre morte dans les territoires pour lesquels ils ont été mis au point.
Le problème est identique pour l’emploi de substances naturelles. Des produits de traitement à base d’extraits d’huiles essentielles, autorisés en Floride ou en Californie, ont été développés par l’INRA et le CIRAD, notamment pour lutter contre le citrus greening, qui décime les agrumes. Ces travaux valorisent des traditions locales, issues d’un savoir-faire ancien. Mais la réglementation est telle que l’EFSA évalue ces substances naturelles comme s’il s’agissait de produits chimiques.
Nous préconisons en réponse une mesure forte pour dynamiser la lutte biologique : il faut dispenser d’homologation tous les moyens de biocontrôle, phéromones et extraits de plantes, dès lors qu’ils sont développés et validés par les instituts de recherche nationaux, comme l’INRA et le CIRAD. Pour réduire les usages orphelins et rétablir en même temps la balance entre les outre-mer et les pays tiers, je demande, comme mes collègues, à la Commission européenne d’établir une liste positive de pays dont les procédures d’homologation sont équivalentes à celles de l’Union. À partir de cette liste, les autorités françaises pourront autoriser directement l’usage en outre-mer d’un produit déjà homologué dans l’un des pays de la liste.
Par ailleurs, nous devons faire cesser les importations de pays tiers où les conditions de production sont laxistes. En l’état du droit européen, les denrées des pays tiers, dès lors qu’elles respectent les limites maximales de résidus de pesticides, sont acceptées sur les marchés européens, même si elles ont été traitées par des substances interdites pour les producteurs européens.
Nos propositions sont fortes et ambitieuses, mais à la hauteur des problèmes auxquels est confrontée l’agriculture de nos outre-mer.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste et républicain.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je me contenterai de faire une rapide synthèse, car l’essentiel a été dit. Dans les interventions précédentes, ont été exposées la philosophie et la stratégie qui sous-tendent cette proposition de résolution.
Il ne fait plus aucun doute aujourd’hui que les agriculteurs ultramarins pâtissent de politiques européennes très favorables aux pays tiers. Il suffit pour s’en convaincre de constater d’une part, la multiplication d’accords de libre-échange qui mettent en péril les grandes filières exportatrices et, d’autre part, le faible degré d’exigence des normes imposées aux produits agricoles importés depuis ces pays.
Pour rétablir une concurrence saine et loyale, le cadre normatif de commercialisation dans l’Union européenne doit être plus strict que le seul respect des limites maximales de résidus. C’est pourquoi nous demandons à la Commission européenne d’assurer la cohérence des normes de production et des normes de mise sur le marché pour résorber le handicap des RUP, tout en améliorant la protection du consommateur européen.
Il est en outre indispensable de développer l’information de ce dernier sur deux points : les conditions de travail dans les pays tiers et le différentiel de qualité environnementale entre leurs productions et celles des RUP.
Qui peut savoir que les bananes vendues comme biologiques en provenance de la République dominicaine sont traitées avec des substances qui sont interdites aux planteurs conventionnels des Antilles ? Pour l’instant, l’Union européenne accepte l’étiquetage biologique de productions agricoles importées de pays tiers qui ne respectent pas son propre cahier des charges défini par un règlement de 2007 sur l’agriculture biologique.
Pour assurer la transparence de l’information apportée aux consommateurs et rétablir l’équilibre entre les RUP et leurs concurrents, nous préconisons l’interdiction de l’étiquetage biologique pour les produits importés de pays tiers lorsque ne sont pas respectées les mêmes normes que celles qui sont appliquées aux producteurs biologiques européens.
Les producteurs ultramarins sont engagés dans une stratégie de montée en gamme et de certification. C’est à la fois une démarche ambitieuse et leur seule perspective de survie face à la concurrence de plus en plus féroce des pays à bas prix.
En particulier, les perspectives de développement du bio sont bridées par une réglementation européenne qui n’est pas adaptée au contexte tropical des RUP. C’est pourquoi, dans la refonte en cours du règlement de 2007, il faut prévoir un volet spécifique pour la culture biologique en milieu tropical. Cela offrirait l’opportunité d’assouplir le recours aux semences conventionnelles, d’autoriser la culture sur claies, de raccourcir le délai de conversion et de permettre le traitement post-récolte par des produits d’origine naturelle. D’ailleurs, ces produits sont utilisés dans l’agriculture traditionnelle et dans les jardins créoles. Leur fabrication et leur utilisation à plus grande échelle pourraient ouvrir de nouvelles perspectives de développement industriel en matière de chimie verte dans nos territoires.
Nous préconisons plus spécifiquement d’autoriser la certification de l’agriculture biologique par un système participatif de garantie, comme en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ce qui rendra facultatif le recours à un organisme certificateur pour les exploitants des RUP et allégera les coûts et les délais. Aujourd’hui, en effet, ces organismes payants ne sont pas présents dans les territoires ultramarins, ce qui renchérit et rallonge les procédures, et finalement décourage les agriculteurs ultramarins.
La proposition de résolution européenne que nous soumettons aujourd’hui à l’approbation du Sénat répond à un véritable projet politique : nous devons arrêter de penser seulement les outre-mer au travers du prisme des fonds structurels. Il faut dépasser la logique des subventions et compensations pour pousser le développement endogène de nos territoires. Sans une acclimatation des normes européennes, nous n’y parviendrons pas !
Madame la ministre, lorsque nous avons présenté cette proposition de résolution devant la délégation, nous avions conclu en soulignant la nécessité d’avoir un accompagnement fort et une politique engagée du Gouvernement. À vous entendre, j’ai compris que vous étiez une combattante, décidée à faire de l’agriculture des RUP un élément de développement à la hauteur des problèmes que rencontrent aujourd’hui les outre-mer. Continuez cette politique ; avec nous à vos côtés, le combat devrait pouvoir être gagné !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du groupe Les Républicains.

La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
Le Sénat
Vu l’article 88-4 de la Constitution,
Vu les articles 206, 207 et 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (grande chambre) du 15 décembre 2016 – Parlement européen et Commission européenne contre Conseil de l’Union européenne, soutenu par le Royaume d’Espagne, la République française et la République portugaise (Affaires jointes C-132/14 à C-136/14),
Vu le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 396/2005 du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil,
Vu le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91,
Vu le règlement (CE) n° 669/2009 du 24 juillet 2009 de la Commission portant modalités d’exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE,
Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil,
Vu le règlement (UE) n° 283/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives,
Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, présentée le 24 mars 2014,
Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 19/2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, et le règlement (UE) n° 20/2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, présentée le 26 mai 2015,
Vu le projet de rapport n° 2015/0112(COD) du 18 juillet 2016 de Mme Marielle de Sarnez au nom de la Commission du commerce international du Parlement européen sur la proposition de règlement précédente,
Vu la communication « Les régions ultrapériphériques de l’Union européenne : vers un partenariat pour une croissance intelligente, durable et inclusive » présentée par la Commission européenne le 20 juin 2012,
Vu le document d’orientation du 4 mars 2016 destiné à harmoniser les études de dissipation des pesticides chimiques en milieu terrestre au champ, mis au point par l’Agence européenne de sécurité des aliments, par l’Agence américaine de protection de l’environnement et par l’Agence Santé Canada,
Vu la réponse du 23 février 2015 apportée par M. Phil Hogan au nom de la Commission européenne à la question écrite E-011032-14 du 18 décembre 2014 de M. Younous Omarjee, posée en application de l’article 130 du Règlement du Parlement européen, sur les conséquences de la suppression des quotas sucriers sur le marché du sucre de l’Union européenne,
Vu la réponse du 17 mai 2016 apportée par M. Vytenis Andrukaitis au nom de la Commission européenne à la question écrite E-001040-16 de Mme Mireille d’Ornano du 3 février 2016, posée en application de l’article 130 du Règlement du Parlement européen, sur la révision du règlement sur les pesticides de 2009,
Vu la réponse du 3 juin 2016 apportée par Mme Corina Creţu au nom de la Commission européenne à la question écrite E-003154-16 du 20 avril 2016 de Mme Cláudia Monteiro De Aguiar, MM. Gabriel Mato, Younous Omarjee, Louis-Joseph Manscour et Maurice Ponga, Mme Sofia Ribeiro, M. Ricardo Serrão Santos, Mme Liliana Rodrigues et M. Juan Fernando López Aguilar posée en application de l’article 130 du Règlement du Parlement européen, sur la fermeture de l’unité spéciale de la Commission pour les régions ultrapériphériques,
Vu la réponse du 23 juin 2016 apportée par M. Phil Hogan au nom de la Commission européenne à la question écrite P-003927-16 du 11 mai 2016 de M. Louis-Joseph Manscour, posée en application de l’article 130 du Règlement du Parlement européen, sur la filière canne-sucre des RUP face aux négociations commerciales,
Vu la résolution du Sénat n° 105 (2010-2011) du 3 mai 2011 tendant à obtenir compensation des effets, sur l’agriculture des départements d’outre-mer, des accords commerciaux conclus par l’Union européenne,
Vu la résolution du Sénat n° 68 (2015-2016) du 26 janvier 2016 relative aux effets des accords commerciaux conclus par l’Union européenne sur les économies sucrières et la filière de la canne des régions ultrapériphériques,
Considérant que les régions ultrapériphériques (RUP) constituent un atout pour l’Union européenne et qu’il est dans son intérêt de soutenir ces territoires « dans l’exploitation de toutes les possibilités de croissance intelligente, durable et inclusive sur la base de leurs atouts et de leur potentiel endogène », conformément aux orientations de la Commission européenne dans sa communication de 2012 exposant sa stratégie pluriannuelle pour les RUP,
Considérant que l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) permet l’édiction de mesures spécifiques aux RUP afin de prendre en compte leurs contraintes propres, notamment « leur éloignement, l’insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits »,
Considérant que les filières agricoles des RUP jouent un rôle économique et social vital dans ces territoires et constituent, au sein de leur environnement régional, des modèles porteurs des valeurs de l’Union européenne en matière sociale et environnementale,
Considérant que les normes et les procédures applicables à l’agriculture des RUP françaises en matière sanitaire et phytosanitaire trouvent leur origine pour l’essentiel dans des règlements européens d’application directe qui y imposent les mêmes dispositifs et les mêmes procédures qu’en Europe continentale, sans aucune prise en compte des caractéristiques de l’agriculture en contexte tropical,
Considérant que l’application uniforme de la réglementation conçue pour des latitudes tempérées, sans forte pression de maladies et de ravageurs, conduit à une impasse qui menace directement la survie des filières agricoles des RUP,
Considérant que les filières agricoles ultramarines souffrent de la prégnance des usages phytosanitaires orphelins, de la fragilité de la couverture phytopharmaceutique menacée par des retraits soudains d’homologation de substances actives, de l’absence de réponse contre des ravageurs dévastateurs comme la fourmi manioc, d’un encadrement inadapté des conditions d’utilisation des produits phytosanitaires en climat tropical et de dérogations difficiles à mettre en œuvre,
Considérant que les agriculteurs des RUP subissent de surcroît les effets d’une politique commerciale de l’Union européenne très favorable aux pays tiers, tant en termes de conclusion d’accords de libre-échange qui mettent en péril les grandes filières exportatrices comme la banane, le sucre et le rhum, qu’au regard du faible degré d’exigence des normes alimentaires imposées aux denrées importées depuis ces pays,
Considérant que, face à la concurrence des pays tiers dont la compétitivité-coût est insurpassable, du fait de niveaux de salaire et de conditions de travail nettement moins élevés et onéreux que dans les RUP, la préservation des barrières tarifaires et non-tarifaires est indispensable pour protéger les marchés des RUP,
Considérant que les clauses de sauvegarde et les mécanismes de stabilisation inscrits dans les accords de libre-échange ont fait la preuve qu’ils étaient actuellement inopérants, en particulier lors de l’application des accords sur la banane avec la Colombie et le Pérou et avec les pays d’Amérique Centrale, dans la mesure où la Commission européenne a décidé de ne pas déclencher ces dispositifs malgré des dépassements répétés des quotas d’importation,
Considérant que l’adhésion de l’Équateur à l’accord avec la Colombie et le Pérou ne peut manquer de porter préjudice aux producteurs de banane des RUP, alors que l’Équateur est déjà le premier exportateur de bananes vers l’Union européenne et qu’il bénéficiera désormais du même démantèlement tarifaire massif qui a déjà permis au Pérou de tripler ses exportations,
Considérant que les outre-mer doivent tenter de résister sur leurs marchés traditionnels à l’export, comme sur leurs marchés locaux, en endossant un handicap normatif dont l’Union européenne exonère les pays tiers,
Considérant que les denrées des pays tiers, dès lors qu’elles respectent les limites maximales de résidus (LMR) de pesticides, même si elles ont été traitées par des substances interdites pour les producteurs de l’Union européenne, sont acceptées sur les marchés européens, où elles concurrencent sévèrement les productions des RUP,
Considérant que, pour rétablir une concurrence saine et loyale, les normes de commercialisation dans l’Union européenne doivent exiger des conditions de production excédant le seul respect des LMR,
Considérant que les contrôles des importations de denrées alimentaires dans les RUP, même selon les modalités renforcées prévues par les règlements européens, sont insuffisants et régulièrement contournés, ce qui aboutit à la commercialisation frauduleuse de produits ne respectant pas les LMR sur les marchés ultramarins,
Considérant que les producteurs ultramarins sont engagés dans une stratégie de montée en gamme et de certification qui ne pourra porter ses fruits tant que certaines productions des pays tiers bénéficient parallèlement de labels de qualité européens sans pour autant respecter pleinement les exigences communautaires,
Considérant que les perspectives de développement de la production biologique, qui constitue une voie d’avenir possible pour les agricultures ultramarines, sont bridées par une réglementation européenne défavorable et par le cumul des normes sur l’agriculture biologique et sur les produits phytosanitaires, qui avantage à nouveau les pays tiers par rapport aux RUP,
Considérant que la réglementation européenne sur l’agriculture biologique n’a jamais été élaborée en tenant compte du contexte tropical des RUP, alors que leurs concurrents comme la République dominicaine et le Brésil ont défini des règles d’agriculture biologique adaptées au climat tropical et que la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, grâce à leur statut d’autonomie, ont su également élaborer une norme d’agriculture biologique en harmonie avec leur environnement régional océanien,
Considérant que certaines productions biologiques des pays tiers, moins vertueuses du point de vue environnemental et de la santé des agriculteurs que leurs homologues conventionnelles des RUP, envahissent le marché européen en profitant d’un étiquetage biologique qui entretient une confusion trompeuse pour le consommateur européen,
Estime nécessaire de garantir la cohérence des politiques agricole, sanitaire et commerciale de l’Union européenne, conformément à l’article 207 du TFUE, aux termes duquel « il appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de l’Union »,
Invite la Commission européenne à acclimater les normes européennes réglementant l’agriculture et l’élevage aux contraintes propres des RUP en tenant compte des spécificités des productions en milieu tropical,
Préconise de procéder à la révision du règlement sur les pesticides de 2009 pour dispenser d’homologation les phéromones et les extraits végétaux, et en général tous les moyens de lutte biologique, développés et validés par les instituts de recherche implantés dans les RUP, afin de doter les agriculteurs de moyens de protection contre les ravageurs, efficaces et conformes à la mutation agroécologique,
Recommande à la Commission européenne d’établir une liste positive de pays dont les procédures d’homologation de produits phytopharmaceutiques sont équivalentes à celles de l’Union européenne afin de permettre aux autorités françaises d’autoriser directement un produit homologué dans un des pays de la liste pour la même culture et le même usage,
Propose d’autoriser pour les RUP, à titre dérogatoire, la culture locale de variétés végétales résistantes aux ravageurs tropicaux mais non-inscrites au catalogue européen des variétés,
Demande à l’Agence européenne de sécurité des aliments de compléter les référentiels pédoclimatiques et d’habitudes alimentaires qu’elle utilise afin de prendre en compte les caractéristiques propres des RUP au moment de l’évaluation des risques,
Recommande, à l’occasion de la refonte du règlement sur la production biologique de 2007, de prévoir un volet spécifique pour la culture biologique en milieu tropical afin d’assouplir le recours aux semences conventionnelles, d’autoriser la culture sur claies, de raccourcir le délai de conversion et de permettre le traitement post-récolte par des produits d’origine naturelle,
Préconise d’autoriser la certification de l’agriculture biologique par un système participatif de garantie (SPG), comme en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, en rendant facultatif le recours à un organisme certificateur pour les exploitations implantées dans les RUP,
Invite la Commission européenne à assurer la cohérence des normes de production et des normes de mise sur le marché pour résorber le handicap normatif des RUP tout en veillant à la protection du consommateur européen,
Demande à la Commission européenne de supprimer les tolérances à l’importation pour les denrées traitées par une substance active interdite dans l’Union européenne,
Recommande à la Commission européenne d’établir une liste noire pour interdire les importations de produits de la pêche et de légumes-racines depuis les pays qui ont traité massivement par le passé leur production avec des substances polluantes rémanentes dans le sol et l’eau,
Préconise l’interdiction de l’étiquetage biologique pour les produits importés de pays tiers lorsqu’ils ne respectent pas les mêmes normes que les producteurs biologiques européens,
Demande à la Commission européenne d’activer les mécanismes de stabilisation inscrits dans les accords commerciaux et, ainsi, de suspendre les droits préférentiels octroyés aux pays tiers, dès que les importations en provenance de ces derniers dépassent les seuils de déclenchement fixés dans l’accord,
Incite la Commission européenne à prolonger au-delà de 2019 les mécanismes de stabilisation prévus dans les accords sur la banane avec les pays d’Amérique latine afin d’assurer aux producteurs ultramarins une visibilité et une protection pérenne,
Souhaite la création d’observatoires des prix et des revenus pour les grandes filières exportatrices des RUP, la banane et la canne, afin de disposer de mesures fiables, publiques et transparentes des effets des importations en provenance des pays tiers avec la périodicité pertinente et ainsi d’alerter rapidement la Commission européenne et les États membres en cas de perturbation grave du marché européen et des marchés locaux, pour déclencher sans délai les clauses de sauvegarde et les mécanismes de stabilisation,
Appelle la Commission européenne à évaluer systématiquement les effets sur les RUP des accords commerciaux qu’il lui revient de négocier en menant des études d’impact préalables et recommande au Gouvernement d’exercer la plus grande vigilance sur la définition du mandat de négociation et sur le suivi de l’application des accords commerciaux, dont les Parlements nationaux doivent être tenus précisément informés,
Juge nécessaire de développer l’information du consommateur sur les conditions de travail pour les producteurs des pays tiers et sur le différentiel de qualité environnementale avec les RUP.

Avant de mettre aux voix, dans le texte de la commission, l’ensemble de la proposition de résolution européenne, je donne la parole à M. Maurice Antiste, pour explication de vote.

Je tiens à féliciter tout d’abord les auteurs de la proposition de résolution européenne et les rapporteurs pour la qualité de leur travail sur cette question, eux qui ont ciblé les lacunes de la politique européenne vis-à-vis de nos territoires et l’incompréhension des États membres face à nos spécificités.
Je rappelle par ailleurs que le Conseil économique, social et environnemental, en 2014, plaidait déjà pour une « Europe ultramarine » au travers d’une résolution qui n’a malheureusement pas trouvé écho auprès de nos partenaires, alors même qu’elle comportait des dispositions à caractère programmatique qui me semblent aller dans le bon sens, puisqu’elle portait sur des enjeux déterminants pour l’avenir du secteur agricole dans chacune des collectivités ultramarines.
Aujourd’hui, la situation est identique, alors que l’outre-mer présente un terrain exceptionnel de dynamisme agricole, en raison des atouts et des avantages comparatifs naturels propres aux collectivités ultramarines. Nos collectivités connaissent également des difficultés structurelles importantes, qui appellent encore et toujours une action déterminée de la part des pouvoirs publics. Or les différents instruments financiers européens dédiés aux outre-mer ne permettent pas aux territoires ultramarins de s’inscrire véritablement dans les objectifs que s’est fixés l’Union européenne dans le cadre de la stratégie UE 2020.
J’ajoute que la politique européenne menée actuellement va à l’encontre de nos intérêts, puisque nous subissons de plein fouet une absence d’harmonisation des normes européennes applicables aux produits et services entre les RUP et les pays tiers situés dans leur environnement géographique. Cela crée de facto des distorsions importantes de concurrence qui se font croissantes dans le cadre d’accords commerciaux mis en œuvre par l’Union.
Je vise en l’occurrence les conséquences désastreuses des accords de libre-échange signés entre l’Union européenne et des pays tiers, tels que le Vietnam, qui se serait vu accorder un contingent de 20 000 tonnes de sucre, alors même que la filière canne-sucre-rhum-bagasse est un pilier fondamental de la vie économique de nos départements d’outre-mer.
Ainsi, les accords bilatéraux à venir, qui tendent à abaisser les barrières douanières pour le sucre, sont une menace très sérieuse pour nos planteurs, qui doivent respecter des normes environnementales et sociales beaucoup plus strictes que celles de leurs concurrents.
De la même manière, je me suis opposé à un amendement dans cette enceinte, la semaine dernière, relatif à une surtaxation des rhums ultramarins et j’évoquai les difficultés rencontrées par nos producteurs soumis à un quota de 120 000 hectolitres d’alcool pur depuis 2011, que la Commission européenne refuse de rehausser de 20 % malgré les requêtes déposées. Cela conduira à terme le circuit de la grande distribution, qui est le circuit principal de vente du rhum des DOM, à se tourner vers les rhums des pays tiers pour répondre à la hausse de la demande du marché.
Ces deux exemples constituent un tout petit aperçu de l’énorme fossé qui existe entre la réalité de nos territoires, au travers de la survivance de nos productions agricoles, et la perception qu’a l’Union européenne des marchés sur lesquels elle dicte ses règles.
C’est pourquoi je voterai cette proposition de résolution, qui constituera – je l’espère ! – les prémices d’une nouvelle politique européenne plus à l’écoute de nos véritables besoins.

Je tiens à remercier mes collègues à l’origine de cette proposition de résolution européenne sur l’inadaptation des normes agricoles et de la politique commerciale européenne aux spécificités des régions ultrapériphériques. Ce texte, de grande qualité, dresse un bilan juste quant à la situation de l’agriculture des régions ultrapériphériques et en tire les conclusions notamment en termes de réglementations phytosanitaires.
Ces conclusions rejoignent celles du rapport d’information que Jérôme Bignon et moi-même avons eu l’honneur de rédiger sur les solutions territoriales en outre-mer au changement climatique. Nous avions présenté six thématiques majeures, notamment la définition de modèles agricoles robustes et résilients.
Au lendemain de la COP 22, qui se veut la conférence de l’action, nous devons donner toute la visibilité nécessaire aux capacités d’innovation de nos territoires. Certains d’entre eux, qui se caractérisent par leur nature archipélagique, à l’image de la Guadeloupe, sont aux avant-postes de la vulnérabilité climatique. Ils sont également à l’avant-garde, en particulier en matière de définition de stratégies d’adaptation et de conception de projets innovants en favorisant le développement local, pour tendre vers l’autosuffisance alimentaire en 2050.
De nombreuses initiatives ont vu le jour, s’inscrivant dans un mouvement structurel de transformation des modèles de production et de consommation.
S’agissant des questions relatives à l’amélioration de l’étiquetage et à l’information du consommateur, deux exemples montrent que le consommateur est parfois induit en erreur par la labellisation ou l’étiquetage. Ainsi, 80 % de la banane bio écoulée en Europe provient de la République dominicaine ; elle bénéficie d’une aura positive grâce à ce label, alors qu’elle est traitée avec du Banole, qu’elle est donc moins respectueuse de l’environnement et soumise à davantage de traitements que la banane conventionnelle des Antilles.
Permettez-moi, mes chers collègues, de citer un seul exemple : celui du jardin créole. C’est un jardin de subsistance à partir duquel il est possible de tirer tous les aliments nécessaires à la vie humaine : glucides, lipides, protéines, vitamines et oligoéléments. Il permet de moins dépendre de l’élevage pour la production de protéines, ce qui signifie à la fois produire plus de protéines par surfaces mobilisées et consommer moins d’intrants.
C’est un paradoxe que 80 % de l’alimentation des Guadeloupéens, mais d’autres également, soit importée, alors qu’il existe une grande diversité de cultures qui peuvent s’épanouir sur le sol du territoire considéré. Si l’autosuffisance alimentaire et l’autarcie sont utopiques, il demeure une marge de progression importante. Il convient donc de ne pas laisser perdre le savoir associé à la culture du jardin créole et d’en poursuivre la transmission.
Pour toutes ces raisons, je voterai en faveur de cette proposition de résolution.

Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l’ensemble de la proposition de résolution européenne sur l’inadaptation des normes agricoles et de la politique commerciale européenne aux spécificités des régions ultrapériphériques.
La proposition de résolution européenne est adoptée.

En application de l’article 73 quinquies, alinéa 7, du règlement, la résolution que le Sénat vient d’adopter sera transmise au Gouvernement et à l’Assemblée nationale.
La parole est à M. le rapporteur.

Je veux d’abord dire à Gélita Hoarau que nous comprenons tous son émotion. Il n’est sans doute pas facile de succéder à cette tribune à un homme politique comme Paul Vergès, dont nous connaissons la grandeur des engagements, non seulement pour La Réunion et la France, mais bien au-delà.
J’aimerais maintenant rassurer mes amis écologistes. L’agriculture ultramarine se veut une agriculture d’excellence. Elle le prouve chaque jour. Notre démarche consiste à demander non pas le développement d’une agriculture au rabais, mais simplement une adaptation des normes aux réalités de nos territoires. L’Europe ne doit pas autoriser l’entrée sur son marché de produits agricoles en provenance de pays qui ne respectent pas les mêmes règles.
Je vous remercie, mes chers collègues, de vos propos. Je suis fier d’avoir demandé au président du Sénat d’autoriser ce débat en séance. Nous avons constaté que cette discussion était nécessaire. Dorénavant, il s’agit non plus d’une proposition de résolution, mais bien d’une résolution du Sénat, que le président du Sénat vous transmettra, madame la ministre.
Mais, au-delà de ce débat sur ce texte, vous nous avez présenté, madame la ministre, votre conception de l’engagement au service des outre-mer, en particulier dans le domaine de l’agriculture, et nous vous en remercions.
Le Sénat n’en restera pas là, si vous y souscrivez, mes chers collègues. En accord avec la commission des affaires européennes, nous espérons défendre cette résolution à l’échelon de l’Union européenne, sans porter atteinte aux missions et aux fonctions des parlementaires européens, mais, au contraire, en les accompagnant. L’Europe est une grosse machine, mais nous finirons par la faire bouger si nous en avons l’ambition, ce qui est mon cas !

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, mercredi 23 novembre 2016 :
De quatorze heures trente à dix-huit heures trente :
Ordre du jour réservé au groupe du RDSE

Débat sur l’avenir du transport ferroviaire en France.
Débat sur le thème « Sauvegarde et valorisation de la filière élevage ».
De dix-huit heures trente à vingt heures et de vingt et une heures trente à minuit :
Ordre du jour réservé au groupe socialiste et républicain

Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à l’action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional (n° 497, 2015-2016) ;
Rapport de M. Mathieu Darnaud, fait au nom de la commission des lois (n° 51, 2016-2017) ;
Texte de la commission (n° 52, 2016-2017).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures trente.