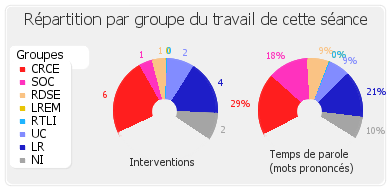Séance en hémicycle du 2 février 2017 à 10h30
Sommaire
La séance
La séance est ouverte à dix heures trente-cinq.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

L’ordre du jour appelle le débat, organisé à la demande du groupe écologiste, sur le thème : violences sexuelles, aider les victimes à parler.
La parole est à Mme Esther Benbassa, oratrice du groupe auteur de la demande.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, chaque année, en France, 62 000 femmes et 2 700 hommes âgés de 20 à 69 ans sont victimes d’au moins un viol ou une tentative de viol. On estime que, au cours des douze derniers mois, 553 000 femmes et 185 000 hommes ont été victimes d’autres agressions sexuelles. Parmi ces victimes, 11 % des femmes et 7 % des hommes ont déclaré des attouchements du sexe, 95 % des femmes des attouchements des seins ou des fesses, des baisers imposés par la force ou du pelotage, et 93 % des hommes du pelotage. Entre 20 et 34 ans, les agressions sexuelles touchent une femme sur vingt, soit cinq fois plus qu’entre 50 et 69 ans.
La famille et l’entourage proche constituent un espace privilégié de victimation. Ainsi, 5 % des femmes y ont subi au moins une agression depuis leur enfance et 1, 6 % au moins un viol ou une tentative de viol. Ces violences se produisent avant les 15 ans de la victime.
C’est également au sein de cet espace que les hommes sont le plus victimes de viols ou de tentatives de viol. Dans neuf cas sur dix, ces violences commencent au même âge que pour les femmes.
Les femmes subissent viols et agressions sexuelles dans de bien plus grandes proportions que les hommes. Pour elles, les violences dans le cadre des relations conjugales s’ajoutent aux violences subies au sein de la famille dès l’enfance et l’adolescence, ainsi qu’aux agressions tout au long de la vie, au travail ou dans l’espace public.
Cela étant dit, les violences sexuelles ne sont nullement une « affaire de femmes ». À cet égard, je regrette que seules des femmes se soient inscrites pour prendre la parole dans le présent débat et que les hommes ne soient guère nombreux dans l’hémicycle. C’est dommage !

Certes, depuis vingt-cinq ans, un travail considérable a été accompli par les associations féministes et de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. Depuis 2011, des plans gouvernementaux triennaux de lutte contre les violences faites aux femmes ont été lancés, ainsi que, en 2013, une mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains, la MIPROF.
Sur le terrain, pourtant, ces initiatives n’ont pas bouleversé la donne. La loi du silence, le déni, l’impunité des agresseurs, l’abandon des victimes perdurent.
Dans un livre paru en 2010, Mourir de dire – La Honte, Boris Cyrulnik explique pourquoi ces victimes restent dans le silence :
« Si vous voulez savoir pourquoi je n’ai rien dit, il vous suffira de chercher ce qui m’a forcé à me taire. […] Si je vous dis ce qui m’est arrivé, vous n’allez pas me croire, vous allez rire, vous allez prendre le parti de mon agresseur, vous allez me poser des questions obscènes ou, pire même, vous aurez pitié de moi. […] Il m’aura suffi de dire pour me sentir mal sous votre regard. […] Le honteux fait secret pour ne pas gêner ceux qu’il aime, pour ne pas être méprisé et pour se protéger lui-même en préservant son image. »
Notre société continue de méconnaître la réalité des violences sexuelles, leur fréquence, la gravité de leur impact et de les reléguer dans la catégorie des faits divers. Cette méconnaissance participe à la non-reconnaissance des victimes et à leur abandon sans protection ni soin.
Ce système, organisant le déni et la mise en cause des victimes elles-mêmes, qui auraient provoqué le viol ou l’agression sexuelle par leur comportement, a un nom : la « culture du viol ».
Une société dans laquelle une part importante de la population estime que forcer sa conjointe ou sa partenaire à avoir un rapport sexuel alors qu’elle le refuse et ne se laisse pas faire n’est pas un viol, que forcer une personne à faire une fellation alors qu’elle le refuse et ne se laisse pas faire n’est pas un viol, ou encore qu’à l’origine d’un viol il y a souvent un « malentendu », est une société dans laquelle les victimes de violences sexuelles révélant ce qu’elles ont subi courent le risque d’être mises en cause et maltraitées. Comment attendre d’elles qu’elles parlent ?
Or céder, faut-il le rappeler, n’est pas consentir. Maintes contraintes physiques, morales ou économiques peuvent permettre à une personne d’imposer des actes ou des comportements sexuels à une autre qui ne les veut pas, mais les subira sans mot dire ni s’opposer.
La vision stéréotypée des violences sexuelles, parasitée par la « culture du viol », n’est pas seulement le fait des hommes : elle est aussi partagée par de nombreuses femmes. Pour en venir à bout, l’imprescriptibilité des crimes et délits sexuels ne suffira pas ; il y faudra une lutte de tous les instants.
Le premier objectif doit être d’encourager les victimes à parler, pour les aider à sortir plus tôt de leur traumatisme.
Pour 72 % des Français et des Françaises, les victimes de viol ne sont pas bien soignées, et 83 % des victimes de violences sexuelles déclarent n’avoir reçu aucune protection, tandis que 78 % d’entre elles n’ont pu bénéficier d’une prise en charge en urgence et un tiers n’a pu rencontrer de psychiatre ou de psychothérapeute dûment formé. Plus de deux Français sur trois jugent impossible de se remettre d’un viol.
L’urgence est, clairement, de lancer des campagnes à destination du grand public afin de l’informer qu’il est possible, par une prise en charge adaptée, de guérir des conséquences psychotraumatiques engendrées par les violences sexuelles. Elle est de lancer des campagnes visant à améliorer, au sein de la population, la connaissance de la loi, des droits des victimes et des chiffres des violences sexuelles, ainsi qu’à déconstruire les représentations fausses qui portent préjudice aux victimes.
Priorité doit être donnée à l’amélioration, par des campagnes d’affichage et d’information et des actions spécifiques, de la prévention dans les sphères les plus touchées par ces violences : la famille et le couple, mais aussi les institutions, les lieux publics, dont les transports en commun, et l’internet.
Il est tout aussi impératif de mieux former les professionnels susceptibles d’être en contact avec les victimes : médecins, policiers, juges, enseignants, éducateurs.
L’efficacité de la prévention passera aussi par un renforcement de l’éducation à l’égalité entre femmes et hommes. Elle exige que l’on donne aux médias les outils nécessaires pour qu’ils cessent de participer à la diffusion de représentations sexistes, de stéréotypes et d’idées fausses concernant les violences sexuelles.
On sait qu’une proportion élevée d’enfants et de jeunes adolescents subissent des violences sexuelles. Ils devraient être prévenus des dangers qu’ils courent, apprendre comment et par qui ils peuvent en être protégés. Il ne faut jamais se lasser de répéter que leur protection passe avant celle de l’agresseur, avant celle, aussi, des intérêts et de la réputation de la famille, des institutions ou de la société, quand les mis en cause sont des personnalités publiques connues. Il paraît indispensable, à cet égard, d’inclure un volet relatif à la prévention des violences sexuelles dans la formation initiale des directeurs d’école, en l’inscrivant dans un projet éducatif plus global de promotion de la santé, élaboré avec les différents acteurs concernés au sein de l’école, en accordant une plus grande place à la parole de l’enfant et en établissant de bonnes relations avec les familles. Dans le même esprit, l’accompagnement des enseignants dans la mise en œuvre de la prévention passe par une réflexion sur le choix des pratiques pédagogiques.
Malgré les efforts déjà déployés, le chemin est encore long. Nous sommes loin d’avoir rompu avec la « culture du viol ». Il ne s’agit pas seulement d’un travail institutionnel, mais aussi d’une démarche à conduire avec chaque victime, pour libérer sa parole de souffrance avant qu’elle ne se laisse envahir par elle, parfois pour des décennies.
Il revient à chacun, là où il vit et là où il œuvre, et à la société tout entière, au nom de la solidarité, de s’investir dans ce combat, pour rendre définitivement inacceptables les violences sexuelles et aider celles et ceux qui les subissent à sortir de leur silence, pour pouvoir se reconstruire. C’est aussi à sa capacité de mener pareil combat qu’une société démocratique comme la nôtre est jugée.
Applaudissements.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, force est de constater, comme vient de le faire Esther Benbassa, que les intervenants dans ce débat sont exclusivement des femmes, comme si le sujet ne concernait pas les hommes…
Au début du mois de janvier, l’académie des Césars annonçait en grande pompe sur Twitter que le réalisateur franco-polonais Roman Polanski, 83 ans, présiderait la quarante-deuxième cérémonie des Césars, le 24 février prochain. L’industrie du spectacle, qui n’aime rien tant que les anniversaires, choisissait Roman Polanski quarante ans exactement après qu’il eut été accusé de viol sur une jeune fille de 13 ans, ce qui l’avait poussé à fuir les États-Unis peu après s’être déclaré coupable de « rapports sexuels illégaux ».
Depuis, sous la pression des associations féministes, le réalisateur, dont personne ici ne nie le talent, a décidé de renoncer. Rappelons que Frédéric Mitterrand, en 2009, alors qu’il était ministre de la culture, avait eu ces mots terribles : « Si le monde de la culture ne soutenait pas Roman Polanski, ça voudrait dire qu’il n’y a plus de culture dans notre pays. » Si le monde de la culture absout des agresseurs sans nuance ni scrupule, au prétexte qu’ils débordent de talent, comment la société peut-elle espérer que les victimes, confrontées à de telles amnisties, libèrent leur parole ?
Car c’est un fait malheureusement avéré : très souvent, les victimes ne portent pas plainte parce qu’elles éprouvent un sentiment de honte ou de culpabilité, et elles s’enferment malgré elles dans cet état, parfois aussi pour épargner leurs proches. Elles craignent d’être tenues pour responsables de ce qui leur est arrivé, qu’on les soupçonne d’avoir été consentantes. C’est la funeste « culture du viol », en raison de laquelle, pendant longtemps, les questions de la pédophilie, du viol ou des agressions sexuelles ont été peu abordées, pour ne pas dire taboues.
Dans cette « culture », si peu éclairée, les victimes sont souvent mises en cause à la place de leur agresseur.
Publiée en mars 2016 – voilà donc moins d’un an, j’insiste sur ce point –, une enquête de l’IPSOS portant sur les représentations du viol et des violences sexuelles chez les Français donne des résultats effarants : 40 % des personnes interrogées estiment que la responsabilité du violeur est atténuée si la victime a eu une attitude provocante en public ; pis, 27 % portent la même appréciation si la victime portait une tenue sexy ; enfin, quatre sur dix pensent que l’on peut faire fuir le violeur si l’on se défend vraiment… Ces chiffres donnent la mesure du travail de pédagogie et d’accompagnement restant à accomplir.
Selon le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, en moyenne annuelle sur la période 2010-2015, 84 000 femmes âgées de 18 à 75 ans et 14 000 hommes déclarent avoir été victimes de viol ou tentative de viol. Mais, parmi ces personnes, 12 % seulement déposent plainte et seule une plainte sur dix aboutira à une condamnation. Ces données alarmantes font dire à la présidente du Collectif féministe contre le viol que, « dans le viol, la parole est le premier tabou ».
À ce titre, l’accueil des victimes est le premier enjeu. Si, dès ses premiers mots, une victime a le sentiment qu’elle n’est pas crue, que l’accueil manque de confidentialité et n’est pas bienveillant, elle renonce à porter plainte.
Pour remédier à cette situation, les policiers et gendarmes qui le souhaitent peuvent, depuis le début des années 2000, bénéficier d’une formation relative à l’accueil et à l’audition des femmes victimes de violences sexuelles.
Plus récemment, la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a instauré une obligation de formation pour tous les professionnels – depuis les personnels médicaux jusqu’aux magistrats et aux policiers – en contact avec des femmes victimes de violences.
L’intervention de ces professionnels est en effet capitale pour les victimes, et c’est aussi grâce à eux que de nombreuses femmes parviennent à aller au bout du processus et à se reconstruire.
La présidente du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, Danielle Bousquet, rappelle d’ailleurs que, en la matière, si des progrès indiscutables ont été faits, « il faut […] aller plus loin, en s’inspirant de l’expérience de la cellule d’accueil d’urgence des victimes d’agressions du CHU de Bordeaux : les victimes peuvent y accéder en direct, c'est-à-dire sans dépôt de plainte préalable. Du coup, parce qu’elles sont mieux accompagnées, elles portent davantage plainte –jusqu’à trois fois plus. »
Un tel accompagnement se pratique déjà au Québec, via la prise en charge des victimes, souvent dans un cadre hospitalier, au sein de ce que l’on appelle des « centres désignés ». Ces structures, accessibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, offrent aux personnes victimes d’agressions sexuelles différents services d’aide médicale et psychologique, assurés par une équipe d’intervenants sociaux, de médecins et d’infirmières. La victime y rencontre sans délai une équipe de professionnels formés pour la soutenir dans ses démarches. Ce dispositif est complété par les centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, dont la mission est de venir en aide aux victimes d’agressions sexuelles, particulièrement en les accompagnant durant tout le processus judiciaire si elles décident de déposer une plainte.
On le voit, la France gagnerait à s’inspirer de l’exemple du Québec, lequel a institutionnalisé l’ensemble du processus de prise en charge et d’accompagnement des démarches judiciaires, afin de sécuriser les victimes et, ainsi, de libérer leur parole.
Beaucoup reste à faire, et je remercie le groupe écologiste du Sénat d’avoir pris l’initiative de ce débat.
Applaudissements.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens moi aussi à remercier le groupe écologiste d’avoir demandé l’inscription à notre ordre du jour de ce débat, dont l’intitulé même – « aider les victimes à parler » – est assez effrayant, en ce qu’il révèle la difficulté, voire l’impossibilité, pour les victimes, de sortir du silence, et l’existence, dans notre société, d’une forme de tolérance à l’égard des violences sexuelles que rien ne saurait justifier.
Les chiffres qui expriment l’ampleur du phénomène des violences sexuelles ont été rappelés. D’après l’Institut national d’études démographiques, chaque année, quelque 580 000 femmes et 197 000 hommes sont victimes de violences sexuelles. C’est énorme, d’autant que les enquêtes de l’INED ne portent que sur les personnes âgées de 20 à 69 ans, alors que, malheureusement, beaucoup d’enfants subissent aussi de telles violences.
Ajoutons que seulement 10 % des victimes des actes les plus graves portent plainte, les autres n’osant pas le faire parce qu’elles ont honte d’évoquer des faits commis le plus souvent au sein de la famille ou par des membres de l’entourage. On sait en outre – c’est aujourd'hui une réalité médicale pleinement avérée – que les victimes, en particulier les enfants, sont fréquemment atteintes d’amnésie post-traumatique. Leur cerveau occulte par tous les moyens une violence d’autant plus traumatisante qu’elle est généralement le fait de proches, de personnes en qui elles ont confiance. Cette amnésie post-traumatique peut n’être levée que bien tardivement, hors délai de prescription pénale. Je reviendrai bien entendu sur ce dernier point.
La négation collective de l’ampleur des violences sexuelles tient enfin au fait que les viols sont beaucoup trop souvent requalifiés en attouchements.
Or les victimes sont blessées, dans leur chair et dans leur esprit, non seulement par l’agression subie, mais aussi par le déni de leurs proches et de l’ensemble de la société.
À ce propos, comme Mireille Jouve, je suis choquée que, au nom de la liberté de création, on se permette de mettre en avant des personnalités du monde de la culture ayant commis des violences sexuelles. Outre Roman Polanski, on pourrait citer Gabriel Matzneff, primé pour des ouvrages qui relatent de tels actes en leur conférant un caractère presque romantique, voire poétique…

Nous sommes donc bien face à une tolérance collective à l’égard des violences sexuelles.
Le constat étant posé, comment agir ? Je voudrais évoquer plusieurs pistes juridiques.
Tout d’abord, depuis la loi du 5 novembre 2015, les professionnels de santé ont la possibilité, et non l’obligation, de signaler les cas de violences sexuelles. Ils hésitent à le faire, faute de garanties en termes de confidentialité et de protection. Il faut absolument rouvrir le débat juridique en reconsidérant les dispositions du code pénal en cause.
Ensuite, j’évoquerai l’un de mes sujets de prédilection, sur lequel je me suis engagée dès 2013 au côté de Muguette Dini, à savoir l’allongement des délais de prescription. En effet, en matière de violences sexuelles, les délais de prescription ne sont pas du tout en adéquation avec la réalité médicale, notamment l’amnésie post-traumatique. À cet égard, il est profondément regrettable que le texte de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale, qui comporte de bonnes dispositions, à l’instar du doublement des délais de prescription pour les crimes et délits, et dont l’adoption devrait intervenir le 7 février prochain, ne fasse plus aucune distinction, en matière de violences sexuelles, selon que les victimes sont mineures ou majeures, comme si ce point n’avait finalement guère d’importance ! J’espère que nous aurons l’occasion de rouvrir ce débat.
Par ailleurs, il faut se donner les moyens d’entendre les victimes et de les prendre en charge. Des progrès substantiels ont été réalisés dans ce domaine, notamment au sein des commissariats, pour mieux recueillir les témoignages des victimes. Toutefois, nous aimerions que Mme la ministre nous apporte des éléments d’information sur le rôle des brigades de prévention de la délinquance juvénile, qui, apparemment, depuis la circulaire du 20 avril 2016, n’interviennent plus lors des auditions d’enfants victimes de violences sexuelles.
Enfin, la prise en charge des victimes, comme l’ont dit les deux oratrices précédentes, est quasi inexistante aujourd’hui. Au mieux, les conséquences physiques immédiates de l’agression sont traitées ; ses effets psychologiques sont rarement pris en considération, en tous cas jamais dans la durée. Or la violence sexuelle est comparable à une forme d’affection de longue durée nécessitant un traitement global du corps et de l’esprit sur le long terme, qui n’existe pas aujourd’hui.
Il en va de même pour les auteurs de violences sexuelles, qui ont eux aussi besoin d’être accompagnés et traités pour ne pas récidiver. Aujourd’hui, une telle prise en charge n’existe pas. Or elle est absolument nécessaire si l’on veut éviter ce phénomène presque épidémique de récidive des auteurs de violences sexuelles, qui sont parfois d’ailleurs d’anciennes victimes.
La violence sexuelle n’est pas une fatalité ni une simple déviance acceptable, fût-ce au sein du couple. Ce n’est pas une question de parité ou d’égalité entre femmes et hommes ; c’est une question de société d’une urgence absolue, surtout au regard de la progression des rapports sexuels non consentis entre mineurs et de la diffusion croissante d’images mettant en scène de tels rapports, phénomène qui me donne à penser que le plus dur est encore devant nous.
Applaudissements.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à remercier chaleureusement Esther Benbassa d’avoir pris l’initiative de ce débat et le groupe écologiste d’en avoir demandé l’inscription à l’ordre du jour.
Je regrette que nos travées soient quelque peu clairsemées. On y dénombre ce matin trois fois plus de femmes que d’hommes : c’est le Sénat à l’envers ! Visiblement, ce sujet ne touche pas certains de nos collègues…
J’ai choisi d’axer mon intervention sur la protection des mineurs victimes de violences sexuelles.
Les violences sexuelles constituent encore un tabou, absolu dans le cas des mineurs. La honte, la peur de voir sa parole contestée et le sentiment qu’il est impossible de mettre en cause l’auteur des faits prennent souvent le dessus, d’autant que ce dernier est souvent un proche. En outre, la situation post-traumatique ajoute un stress très intense à celui né de l’agression : des troubles de la mémoire et un sentiment de culpabilité empêchent souvent les victimes de sortir du silence et de révéler les faits.
Rappelons que la parole est particulièrement difficile, sachant que 80 % des victimes ont été agressées par des proches, des membres de la famille ou des amis. On oublie trop souvent que l’on compte aussi des hommes parmi les victimes.
Cependant, victimes et professionnels sont unanimes : il faut parler pour espérer surmonter le traumatisme. La parole est le premier jalon d’une libération.
S’il faut libérer la parole des victimes, il faut également libérer celle d’éventuels témoins : personnels éducatifs, voisins, proches, amis, personnels médicaux… Nombreux sont ceux qui ont des soupçons et s’interrogent mais hésitent à parler, faute d’être protégés ou de peur d’« aggraver les choses » ou d’« accuser à tort ».
Dans cette perspective, il convient de rappeler que tout signalement sera suivi d’une enquête menée par des professionnels, qui permettra de déterminer si la personne est bien victime de violences à caractère sexuel. En réalité, les personnels de terrain savent souvent identifier les situations, comprendre les rapports de force et deviner les problèmes. Ce sont eux, et seulement eux, qui seront à même de définir si la personne a été ou non victime d’agression sexuelle.
Pour que les agressions sexuelles ne soient plus aussi fréquentes qu’elles le sont aujourd’hui, il est indispensable d’entendre les victimes et de renforcer la prévention. La formation des professionnels, quels qu’ils soient, est perfectible. Dans le domaine éducatif, des modules de formation au sein des écoles supérieures du professorat et de l’éducation sont prévus par les textes : pourriez-vous nous rassurer, madame la ministre, quant à leur effectivité ? Dans les domaines médical, judiciaire et social, un certain nombre d’acteurs devraient être mieux protégés. À cet égard, Mme Jouanno a souligné les limites des textes que nous avons votés en 2015. Il pourrait être utile d’y revenir.
Comment combattre le sentiment de peur éprouvé par certains médecins et professionnels de santé placés dans une position extrêmement délicate, qui peuvent ne pas se sentir soutenus ? Comment limiter leurs craintes de s’exposer à des poursuites judiciaires ? Comment faire en sorte que les victimes ne redoutent pas d’être attaquées en diffamation lorsqu’elles révèlent des faits avérés ?
L’interdisciplinarité et le travail d’équipe doivent être érigés en priorité.
Enfin, j’évoquerai une question taboue : celle de l’amélioration des procédures de recrutement des professionnels en contact avec les enfants. Si des progrès ont été accomplis au sein de l’éducation nationale, des problèmes subsistent en ce qui concerne les associations. Celles-ci doivent pouvoir s’assurer de la bienveillance des bénévoles sans pour autant les effrayer. Quant aux communes, qui doivent désormais organiser les activités périscolaires et périéducatives, elles ont de ce fait la responsabilité délicate de recruter les animateurs. Je ne suis pas sûre que l’on demande à beaucoup d’entre eux de fournir un extrait de casier judiciaire… J’ai tendance à penser que, sur ce plan, un important chantier est devant nous.

Peut-être ne prend-on pas suffisamment de précautions en recrutant des bénévoles sortis de nulle part ou des retraités que personne ne connaît. Sans jeter le soupçon sur tout le monde, il faut maintenant prévoir des garanties en la matière.
Au mois de décembre 2016, Psychologie Magazine a lancé un appel – « Il est urgent d’agir pour protéger les mineurs des violences sexuelles » – en faveur de la levée de l’omerta et de l’affirmation d’une volonté politique plus forte, plus structurée de protéger les enfants contre les violences sexuelles, qui a recueilli plus de 23 000 signatures. Cet élan en faveur de la protection des enfants a touché d’éminents spécialistes, mais aussi de nombreux citoyens, artistes et sportifs. Tous considèrent qu’il reste beaucoup à faire.
S’agissant des délais de prescription en matière de crimes sexuels contre les mineurs, on ne peut que se réjouir, madame la ministre, que vous ayez confié une mission sur ce thème à Flavie Flament et au magistrat Jacques Calmettes.
À titre personnel, je ne suis pas favorable à l’imprescriptibilité, qui je pense devoir être réservée aux crimes contre l’humanité. Cependant, entre l’imprescriptibilité et la situation actuelle, il y a une marge pour la discussion !
Vous présenterez le mois prochain, madame la ministre, le premier plan de lutte contre les violences faites aux enfants. Nous sommes très satisfaits que vous vous soyez saisie du sujet ; c’est tout à votre honneur, car agir dans ce domaine apporte sans doute davantage de désagrément que de reconnaissance. Le groupe écologiste compte sur vous !
Pour les victimes, « rebondir » est possible, mais les associations qui les prennent en charge doivent avoir les moyens de conforter leur résilience. Il faut aussi consentir un effort pour la formation de tous les professionnels.
Applaudissements.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ces derniers mois ont été marqués par le retentissement médiatique du livre témoignage de Flavie Flament, La Consolation, qui dénonce un viol dont l’auteur présumé est un photographe de renom. Après ces révélations, l’animatrice a dû faire face à des accusations de diffamation. Une partie de l’opinion l’a même accusée d’être responsable de la mort de l’auteur présumé du viol.
Cet enchaînement de faits révèle, en raison de la notoriété des protagonistes, ce que vivent dans l’ombre des milliers, voire des millions, de victimes de violences sexuelles : l’horreur du drame et ses conséquences tout au long de la vie, la difficulté, voire l’impossibilité, d’en parler, d’être crue, le déchaînement de violences, de ruptures auquel de nombreuses victimes ont à faire face lorsque leur parole se libère. C’est la preuve, s’il en était besoin, que notre société n’entend pas ces victimes, pour plusieurs raisons.
Le huis clos dans lequel se déroulent ces abus et ces crimes muselle la parole des victimes. La violence physique et psychologique, la peur rendent le crime presque parfait, car l’enjeu pour l’auteur des faits, en plus d’abuser sexuellement sa victime, est d’empêcher la parole de celle-ci. Une double peine est ainsi infligée aux victimes. Comme nous le disent si justement les associations, c’est le seul crime dont la victime porte la honte. C’est insupportable !
Je tiens à saluer à mon tour l’initiative de mes collègues du groupe écologiste. L’enjeu est fort. La parole est le point de départ de la reconstruction des victimes et le point d’arrêt des criminels. Encore faut-il que la société accepte de regarder, d’écouter cette réalité et de mettre en œuvre les moyens d’accompagner cette parole, de la rendre audible. Au-delà de la révélation, il s’agit de proposer des lieux de réparation.
Commençons par regarder les choses en face : les violences sexuelles, qu’elles s’exercent sur des enfants ou sur des adultes, sont un phénomène d’ampleur dans notre pays. Selon l’enquête réalisée en 2006 par l’INSERM et l’INED, 16 % des femmes et 5 % des hommes déclarent avoir subi des viols ou des tentatives de viols au cours de leur vie. On estime que seulement 10 % des viols font l’objet d’une plainte.
Le Conseil de l’Europe estime qu’un enfant sur cinq est confronté à la violence sexuelle sous toutes ses formes : viols, abus sexuels, pornographie, sollicitation des enfants par le biais d’internet, prostitution et corruption. Selon le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, à l’âge de 20 ans, une Française sur dix déclare avoir été agressée sexuellement au cours de sa vie, dans le cercle familial pour la très grande majorité d’entre elles. Ces chiffres sont effrayants.
Ce matin, nous parlons d’un type de violences bien spécifique, les violences sexuelles, mais je souhaite insister sur le fait que ces violences s’inscrivent dans un contexte social très permissif. Les auteurs se sentent tout-puissants, ce qui décourage les victimes de parler.
On peut évoquer un continuum des violences au niveau individuel et au niveau collectif.
Au niveau individuel, toutes les violences subies dans l’enfance meurtrissent, abîment profondément. Les violences sexuelles sont encore plus destructrices. La victime risque, plus que toute autre personne, d’être surexposée à d’autres violences à l’école, et plus tard au sein du couple ou au travail. Elle risque aussi de développer des comportements à risque contre elle-même ou contre les autres. Si la victime n’est pas prise en charge, elle peut souffrir de ce continuum de violences tout au long de sa vie.
Nous retrouvons ce continuum au niveau sociétal, car même si les garçons et les hommes sont aussi victimes de violences, sexuelles notamment, celles-ci s’inscrivent toujours dans un contexte de domination sexué. Les auteurs sont très majoritairement des hommes, et les victimes sont majoritairement des femmes et des enfants.
Toutes les formes de violences se conjuguent et se renforcent : mépris, insultes, harcèlement, violences sexuelles, violences conjugales, prostitution, inégalités salariales, remise en cause de l’IVG, inégalités politiques, etc. Ces violences révèlent que les femmes, les enfants subissent encore une forte inégalité et une stigmatisation dans notre société.
On peut aussi évoquer un continuum chez les auteurs de violences. Violaine Guérin, endocrinologue et gynécologue médicale, présidente de l’association Stop aux violences sexuelles, indique, en s’appuyant sur les travaux de la psychanalyste Alice Miller, que « la violence est racine de la violence ». Elle avance même que 80 % des agresseurs auraient eux-mêmes subi des abus dans leur enfance.
Il y a donc urgence à traiter ce fait social, de santé publique que sont les violences sexuelles, en agissant au niveau individuel et au niveau collectif.
La politique conduite ces dernières années en matière d’égalité entre les femmes et les hommes a permis de mettre en évidence, de mesurer les inégalités et de rechercher des moyens d’atteindre l’égalité réelle. Malgré des avancées, il reste beaucoup à faire. Nous devons centrer nos efforts sur les droits des enfants et opter pour une éducation bienveillante. Il faut informer davantage les mineurs sur leurs droits.
À cet instant, que l’on me permette de déplorer que certains de nos collègues sénateurs aient saisi le Conseil constitutionnel de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté, adoptée à la fin du mois de décembre dernier. Son article 222, que les deux chambres avaient enfin fini par adopter, disposait que l’autorité parentale s’exerce à l’exclusion de « tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux violences corporelles ». Cette censure, pour une question de forme, permet à certains parents de continuer à user d’un archaïque « droit de correction » sur leurs enfants. C’est bien regrettable !
Au niveau individuel, il s’agit de créer un climat de confiance propice à la libération de la parole de la victime, de croire celle-ci et de l’accompagner.
Comme nous l’apprennent de nombreux témoignages, il est tout d’abord difficile de faire émerger ces événements à la conscience : la victime les enfouit pour survivre. On parle d’amnésie traumatique. Ce travail personnel peut prendre de nombreuses années, voire ne jamais se faire. La victime doit affronter la honte et l’emprise, mécanismes spécifiques aux agressions sexuelles.
Ensuite, la question est « en parler ou non ». En effet, pour les personnes victimes de violences sexuelles, le fait même d’en parler constitue une expérience redoutable. En parlant, en déposant plainte, elles vont revivre les épisodes douloureux. Elles prennent le risque de se retrouver face à leur agresseur, d’être exclues de leur famille, accusées de mensonge, menacées de mort. Pour tenir, il faut impérativement être accompagné.
Cet accompagnement pourrait être assuré au sein de centres de crise et de soin spécifiques et pluridisciplinaires pour les enfants et les adultes victimes de violences sexuelles, comme le propose la psychiatre Muriel Salmona : des lieux de soins, mais aussi des lieux ressources pour les intervenants professionnels et bénévoles.
Dans les cas où les faits ne sont pas prescrits, c’est alors « parole contre parole ». La victime s’expose à une nouvelle charge de violence de la part de l’agresseur. En l’absence de preuves, comme c’est très souvent le cas pour ces faits, le dossier est classé sans suite. La victime n’a pas obtenu la reconnaissance attendue. Parfois, lorsque les faits sont prescrits, le dépôt de plainte permet la découverte de nouvelles victimes, pour lesquelles les faits peuvent être poursuivis.
Il me paraît essentiel d’évoquer à mon tour la question des délais de prescription. Je sais que cette vision est, pour l’instant, loin d’être partagée, y compris au sein de ma famille politique ; pourtant, je ne désespère pas que les délais de prescription puissent être allongés et que l’on atteigne un jour l’imprescriptibilité pour ces faits. En effet, la victime qui parle après que les délais de prescription sont écoulés se retrouve dans une situation d’insécurité juridique. En témoignant, elle risque d’être poursuivie pour diffamation ; c’est inique !
Devant un fait social d’une telle ampleur, il faut prendre les moyens d’aider les victimes à se réparer.
Tout d’abord, il est essentiel de former les professionnels et les bénévoles à la réalité des violences sexuelles, à leur ampleur, à leurs mécanismes de destruction et à la reconstruction de la personne, que ce soit dans le champ médical, dans l’éducation ou dans le monde du travail.
Par ailleurs, nous devons poursuivre les travaux engagés ici sur l’initiative de notre collègue Colette Giudicelli en instaurant une obligation de signalement pour le personnel médico-social qui repère des violences sexuelles chez un patient. Aujourd’hui, une vision conservatrice demeure au sein des ordres médicaux, qui, sous couvert de respect du secret professionnel, s’opposent à l’obligation de signaler.
Si, à l’automne 2015, nous avions réussi à faire en sorte que le signalement ne puisse se retourner contre le soignant, nous devons aller plus loin, en assurant la confidentialité des informations transmises. En effet, dans certaines situations, le signalement profite à la défense du mis en cause, par exemple quand celui-ci est détenteur de l’autorité parentale et peut donc consulter les dossiers relatifs à la victime
La réponse judiciaire doit également évoluer. Les classements sans suite sont trop nombreux. Il faut former les personnels de la police, de la gendarmerie et de la justice à ces réalités, en vue tant du traitement de la plainte spécifique de chaque victime que de la prévention. En effet, la connaissance d’un prédateur sexuel peut permettre de l’empêcher de nuire à nouveau, et d’enrayer ainsi le cycle infernal des violences.
Pour conclure, mes chers collègues, je me réjouis que ce débat ait lieu. Il nous honore. Ces dernières semaines, en effet, nous avons pu entendre dire que députés et sénateurs se désintéressaient de la question des violences sexuelles. Il n’en est rien. Nous continuons le combat en faveur des victimes. Nous voulons une société plus juste, plus respectueuse de chaque être humain.
Continuons à dénoncer toutes ces formes de violences. Je pense notamment à un phénomène récent, celui des « viols à distance », sur commande et par internet, qui se répandent dans les réseaux pédophiles.
Continuons aussi à dénoncer toutes les inégalités et injustices desquelles se nourrissent toutes ces violences. Rien n’est inéluctable, et l’intervention de la loi en la matière est déterminante pour signifier quelle société nous voulons construire.
La mobilisation de l’opinion publique, les prises de position de personnalités du monde du spectacle, aux côtés de la comédienne Andréa Bescond, en faveur de l’imprescriptibilité, nous interpellent et nous servent d’aiguillon. Soyons attentifs à la souffrance des victimes et à l’attente forte de plus de bienveillance que notre société exprime ; je veux croire avec vous qu’il n’y a pas de fatalité de la souffrance !
Applaudissements.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd’hui, sur l’initiative d’Esther Benbassa, pour aborder le délicat sujet des violences sexuelles et de la nécessité d’aider les victimes à en parler.
Je voudrais remercier le groupe écologiste de nous permettre d’avoir ce débat difficile mais ô combien utile.
En effet, même s’il est difficile d’avoir des chiffres fiables et représentatifs, une femme sur cinq et un homme sur quatorze interrogés dans le cadre de consultations médicales déclarent avoir déjà subi des violences sexuelles.
En se fondant sur les seuls dépôts de plainte, on peut estimer que près de 260 000 personnes seraient chaque année victimes de viols ou tentatives, dont plus de 125 000 filles et 32 000 garçons de moins de 18 ans, selon l’Observatoire national des violences faites aux femmes. Dans 81 % des cas, les victimes sont des mineurs. Dans 94 % des situations, les agresseurs sont des proches de la victime. Au moins 68 % des victimes ont subi un viol, et 40 % rapportent une situation d’inceste. Tandis que nous débattons, une, voire plusieurs personnes, seront agressées sexuellement dans notre pays.
Huit victimes sur dix déclarent que les faits se sont déroulés lorsqu’elles étaient encore mineures. Une sur deux avait moins de 11 ans, une sur cinq moins de 6 ans. Dans 96 % des cas, l’agresseur est un homme. Un enfant victime sur deux est agressé par un membre de sa famille. Dans un cas sur quatre, l’agresseur est lui-même mineur. Je rappelle que, à l’âge adulte, un viol sur deux serait un viol conjugal. Seulement 18 % des viols de personnes majeures seraient le fait d’un inconnu.
Ces agressions sont lourdes de conséquences pour les victimes, dont elles affectent la santé mentale et physique. Un rapport a montré qu’il en est ainsi dans 96 % des cas lorsque l’agression a été subie dans l’enfance. Ce rapport dresse une longue liste des pathologies somatiques associées aux violences sexuelles. En touchant à l’âme des victimes, les agresseurs font aussi des ravages dans leur corps. Plusieurs études scientifiques ont montré qu’avoir subi de tels faits serait un facteur de risque, parfois plusieurs décennies après, de développer des maladies cardiovasculaires, pulmonaires, endocrines, auto-immunes, neurologiques, des problèmes de sommeil et de douleurs chroniques, voire des atteintes épigénétiques pouvant être transmises à la descendance des victimes.
Les conséquences sont encore plus graves quand l’agression était incestueuse : plus la victime est jeune au moment des faits, plus l’agresseur est proche d’elle, plus il a d’autorité sur elle, et plus l’impact sur sa qualité de vie et le risque qu’elle tente de se suicider sont importants, nous disent les professionnels.
L’abus reste un secret absolu très longtemps, parfois toute une vie. En gardant le silence, la victime se fait, malgré elle, l’alliée de l’abuseur, puisque la seule chose que celui-ci redoute, c’est d’être dénoncé. Le fait de devenir ainsi, bien involontairement, son alliée, renforce le mépris que la victime a d’elle-même et son sentiment de culpabilité.
Pourtant, une personne sexuellement abusée n’est jamais coupable ni responsable. Mais parler est pour elle très difficile, et peu de victimes portent plainte. Il est de la responsabilité des pouvoirs publics d’aider à améliorer la prise en charge et l’accompagnement des victimes.
Seules 4 % des victimes agressées dans l’enfance disent avoir été prises en charge par l’aide sociale à l’enfance, tandis que 70 % de ceux qui ont porté plainte pour des faits commis alors qu’ils étaient mineurs n’auraient jamais été protégés et que 70 % de l’ensemble des victimes se sont senties insuffisamment ou pas du tout reconnues comme telles.
C’est pourquoi la prise en charge médicale doit être améliorée, afin qu’elle soit plus rapide et mieux adaptée à l’état de stress post-traumatique des victimes.
Ces enseignements figurent au programme des épreuves classantes nationales d’accès à l’internat, mais de nombreux étudiants interrogés semblent l’ignorer. En effet, alors que 30 % d’entre eux ont été confrontés aux violences sexuelles lors de leurs stages en hôpital, moins d’un sur cinq indique avoir déjà reçu un cours ou une formation sur ce sujet, à l’issue de la réforme menée en 2012-2013. À ce jour, ces troubles restent mal diagnostiqués par les médecins. Ils sont souvent mis sur le compte de troubles de la personnalité, d’une dépression, voire d’une psychose.
Selon l’Organisation mondiale de la santé, l’OMS, avoir subi des violences sexuelles est le facteur de risque principal d’en subir à nouveau… C’est pourquoi il faut libérer la parole. Un important travail d’information est d’ores et déjà mené auprès des personnes sexuellement violentées, notamment par les associations, qui sont très présentes et dont je tiens à souligner l’extraordinaire travail.
Idéalement, il faudrait réussir à créer, dans chaque ville moyenne, une consultation spécialisée en psycho-traumatismes associée à un réseau de professionnels formés et informés. Beaucoup de médecins généralistes hésitent à interroger leurs patients lorsqu’ils ont un doute. Or beaucoup de victimes ont envie d’être devinées et disent que, si on leur avait demandé si elles avaient subi des violences sexuelles, elles en auraient parlé beaucoup plus tôt.

Je suis convaincue que, pour combattre ce fléau, il ne faut pas opposer ceux qui sont chargés du sujet et ceux qui ne le seraient pas. Il y a urgence à sensibiliser tous les professionnels qui sont en contact avec les enfants, notamment dans les structures d’accueil des jeunes enfants.
Face à cette problématique, le personnel doit être en éveil. Il doit être familiarisé à sa détection. Il doit bénéficier d’une formation adaptée et d’une protection lui garantissant qu’il ne sera pas poursuivi ou stigmatisé s’il dénonce des violences sexuelles. Chacun doit prendre conscience que ne pas agir relève de la non-assistance à personne en danger.
Dans le même esprit, des campagnes de sensibilisation doivent être organisées au sein de l’éducation nationale et les personnels, y compris les enseignants, doivent être en éveil sur ce sujet.
Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons endiguer ce fléau et aider les victimes à parler !
Applaudissements.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à remercier Esther Benbassa d’avoir pris l’initiative de ce débat.
Le sujet est grave et complexe : il touche à l’humain, à son intimité, à ses souffrances les plus terribles. Ce débat doit être consensuel. Il nous faut agir ensemble contre ce fléau qui frappe aussi bien des femmes et des hommes que des enfants. Nous devons faire front dans l’intérêt de nos concitoyens.
Dans notre pays, une femme sur cinq et un homme sur quatorze déclarent avoir subi des violences sexuelles. Dans 94 % des cas, les agresseurs sont des proches, parfois même des membres de la famille, hélas !

Très peu de victimes portent plainte, par honte, par crainte, par pudeur, par peur de détruire la cellule familiale.
À la lumière de ces chiffres alarmants, on comprend très bien quel est l’enjeu majeur de la lutte contre les violences sexuelles : comment faciliter et accompagner la parole des victimes ? Comment l’encourager ?
Si le Parlement renforce les protections à l’endroit des victimes de violences sexuelles en matière de prescription, nous devons également nous pencher sur les dispositifs nécessaires à la libération de la parole. L’impunité et le silence ne doivent jamais être la règle.
Notre pays doit nécessairement renforcer tous les dispositifs de prévention au bénéfice des personnes les plus exposées, expliquer où se situent les limites de l’acceptable, diffuser un message de tolérance zéro à l’égard des actes odieux et encourager la parole. Sortir du silence permettra aux victimes de mieux se reconstruire.
L’accompagnement des victimes et de leurs familles doit être renforcé pour éviter tout enfermement et, surtout, toute culpabilisation.
La justice doit avoir les moyens de remplir pleinement son rôle et de sanctionner, au nom de la société, ces actes odieux.
Il faut commencer par faire de la pédagogie en milieu scolaire, et ce dès le cours préparatoire. C’est un bon moyen de prévenir l’installation d’un silence souvent dévastateur.
Les violences sexuelles sont traumatisantes. Certaines et certains n’en parlent que difficilement, seulement avec l’aide d’un thérapeute. D’autres n’y arrivent jamais.
Les violences sexuelles sont celles qui, potentiellement, affectent le plus fortement le psychisme. Plus l’agression touche le corps, plus elle vise l’intimité, plus elle est humiliante, plus elle est dévastatrice pour la victime.
La force physique, quant à elle, n’est pas nécessairement employée dans les violences sexuelles : c’est la raison pour laquelle il n’en résulte pas toujours des traumatismes physiques.
Les atteintes à la santé génésique, à la santé mentale et au bien-être social comptent parmi les conséquences les plus courantes de la violence sexuelle.
Une étude française portant sur des adolescentes conclut également à l’existence d’un lien entre le fait d’avoir été violée et l’apparition de troubles du sommeil, de symptômes de dépression, de plaintes somatiques, la consommation importante de tabac et certains troubles du comportement courant, comme le fait d’avoir une attitude agressive. Ces manifestations sont propres à chaque victime et varient avec le temps.
C’est pourquoi la victime doit être aidée et accompagnée de façon très personnalisée. Il me paraît essentiel que nous débattions de l’importance des approches individuelles.
Les soins et le soutien psychologique, par l’intermédiaire de conseils, d’une thérapie et de groupes de soutien, se révèlent utiles après des agressions sexuelles, surtout lorsque le processus de rétablissement est compliqué.
Certains faits montrent qu’un programme de courte durée, alliant thérapies cognitive et comportementale, suivi peu après l’agression peut contribuer à une atténuation plus rapide du traumatisme psychologique subi. En effet, les victimes de violences sexuelles se sentent souvent responsables de ce qui leur arrive, et il est démontré qu’il est important, pour leur rétablissement, de traiter ce sujet en psychothérapie.
Pour faire face à ce fléau dramatique, des actions concrètes doivent être mises en place. Nous devons en être les garants.
Les questions relatives à la violence sexuelle doivent être en partie traitées lors de la formation de tout le personnel des services de santé, y compris les psychiatres et les conseillers sociopsychologiques. À mon sens, les travailleurs de la santé seraient ainsi mieux sensibilisés à ce problème. Mieux informés, ils seraient mieux à même de détecter les cas de violences sexuelles et de les signaler.
Les campagnes de prévention sont également essentielles. Nous avons tous ici en tête des campagnes violentes et très réalistes sur la sécurité routière. Dans d’autres pays, la télévision est utilisée efficacement pour alerter le grand public sur les violences sexuelles.
À mes yeux, il est nécessaire d’accorder davantage d’attention à la prévention primaire de la violence sexuelle. Celle-ci est d’ailleurs beaucoup trop souvent négligée au profit des services aux victimes. Nous pourrions renforcer la prévention primaire par le biais de programmes diffusés dans les écoles, en mettant l’accent sur les violences sexuelles dans le cadre de la promotion de l’égalité des sexes.
Il faut également améliorer la formation des policiers et des gendarmes, qui sont souvent les premiers interlocuteurs de la victime souhaitant dénoncer son agresseur.
Si l’on n’a pas reçu une formation adaptée, il est difficile d’adopter le bon comportement pour ne pas brusquer ou inquiéter une victime déjà très fragilisée. Nos policiers et nos gendarmes se dévouent pour protéger nos concitoyens. Leur apporter ce type de formation va directement dans le sens de l’amélioration du service rendu à la population.
La violence sexuelle est un problème de santé publique courant et grave, qui affecte des milliers de personnes chaque année en France. Elle est dictée par de nombreux facteurs qui agissent dans différents contextes économiques, sociaux et culturels. L’inégalité des sexes est au cœur de la violence sexuelle dirigée contre les femmes, mais il ne faut pas non plus négliger la violence sexuelle dirigée contre les hommes : elle existe elle aussi, et est sûrement encore moins dénoncée.
Mes chers collègues, notre débat prouve que, sur ce sujet si grave, la représentation nationale est totalement mobilisée. Elle ne recule pas et refuse de céder du terrain à la criminalité sexuelle. Nous devons nous engager ensemble, et fermement, pour mettre fin aux violences sexuelles et faire baisser les chiffres effrayants qui ont été cités.
Applaudissements.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à onze heures quarante, est reprise à onze heures quarante-trois.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens moi aussi à remercier le groupe écologiste, notamment Esther Benbassa, d’avoir pris l’initiative de ce débat.
Le sujet est difficile et grave. S’il nous faut, bien entendu, l’aborder avec beaucoup d’humanité, c’est aussi en tant que législateur que nous devons l’appréhender, pour améliorer la prise en charge des victimes, pour mettre fin à ces violences.
Nous devons donc étudier les obstacles sociaux et juridiques qui font qu’aujourd’hui, dans notre société, les victimes, adultes comme enfants, ont tant de mal à dénoncer leurs harceleurs et leurs agresseurs.
Quelques langues se sont déliées récemment pour rompre avec la loi du silence et du tabou. Je pense notamment aux collaboratrices parlementaires et élues ayant fait l’objet de harcèlement sexuel ou d’agressions sexuelles. Je songe aussi à l’animatrice Flavie Flament, qui a témoigné du viol dont elle a été victime. Toutefois, au regard de la réalité, rares encore, trop rares sont les victimes qui dénoncent leurs agresseurs, osent parler.
Permettez-moi de faire un « focus » sur le viol, forme la plus extrême de ces violences, en reprenant les chiffres des ministères de l’intérieur et de la justice.
En France, chaque année, 84 000 femmes majeures déclarent avoir été victimes de viol ou de tentative de viol. Moins de 10 % de ces femmes déposent plainte, et seule une plainte sur dix aboutit à une condamnation. Au total, 51 % des femmes victimes de viol ou de tentative de viol ne font aucune démarche, ni auprès des forces de police ou de la gendarmerie, ni auprès de médecins, psychiatres et psychologues, ni auprès des services sociaux, associations ou numéros d’appel.
Ce sont là des chiffres, hélas ! relativement constants, qui ne diminuent pas au fil des années, malgré les politiques publiques déployées jusqu’à présent, notamment par vous, madame la ministre. Ce débat est donc bienvenu pour nous permettre de réfléchir ensemble aux mesures urgentes qu’il faut prendre, par le législateur comme par l’État.
On ne peut analyser ces violences qui gangrènent notre société sans insister sur le caractère « genré » de ce fléau : la très grande majorité des victimes sont des femmes. Malgré les luttes menées par les féministes et les progressistes, le patriarcat est un système de domination qui continue d’imposer sa loi.
Je tiens à dénoncer un premier obstacle qui empêche les femmes victimes de harcèlement sexuel ou d’agression sexuelle de parler, ou d’ailleurs de toute forme de violence : la honte, la culpabilité de ne pas avoir réagi et de devoir affronter incompréhension et jugement réprobateur.
L’expertise en matière de mémoire traumatique de Muriel Salmona, psychiatre et psychotraumatologue, peut nous être utile. Les victimes de violences sexuelles, majeures ou mineures, sont en état de sidération, ce qui empêche toute action. Je pense bien sûr ici au cas de Jacqueline Sauvage, dans lequel cette dimension n’a été que trop peu prise en compte.
Les travaux de Muriel Salmona démontrent également que les violences sexuelles accroissent fortement les risques de détresse psychologique et d’apparition de symptômes liés à un état de stress post-traumatique.
Avec la torture et les situations de massacre, les violences sexuelles font partie des violences les plus traumatisantes. Muriel Salmona préconise la mise en place d’un plan Marshall en santé publique pour former les professionnels de la santé et créer des centres de soins pluridisciplinaires de prise en charge des victimes de violences sexuelles. Je soutiens totalement cette demande.
Il faut en finir avec la présomption de responsabilité des victimes, …

… avec le fameux « elle l’a bien cherché », « elle n’a pas vraiment dit non », qui pèse systématiquement sur les femmes. Il faut inverser la culpabilité et mettre un terme à cette forme de tolérance sociale des agressions sexuelles. Pour reprendre le slogan de l’association Osez le féminisme !, « la honte doit changer de camp ».
Le second obstacle est le traitement que la justice réserve aux violences faites aux femmes, et singulièrement aux violences sexuelles.
Comment ne pas dénoncer la longueur des procédures judiciaires ? Comment ne pas s’indigner que la parole des femmes soit remise en cause et que les faits soient le plus souvent minimisés ? Comment ne pas constater la défaillance du service public de la justice ?
Une femme ne peut pas se reconstruire si la justice n’a pas condamné son agresseur, si la justice ne lui a pas reconnu le statut de victime.
Un travail remarquable et édifiant a été accompli par l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, notamment par Marilyn Baldeck, que la délégation sénatoriale aux droits des femmes a reçue.
C’est un véritable parcours de la combattante qu’une femme victime de harcèlement ou d’agression sexuelle a à affronter. Le documentaire d’Olivier Pighetti, Harcèlemen t sexuel : le fléau silencieux, en donne un aperçu très émouvant, mais aussi révoltant.
Je tiens à souligner que les harceleurs et agresseurs se retrouvent dans tous les milieux sociaux professionnels, en zone urbaine comme en zone rurale.

Bien sûr, il faut encore améliorer et amplifier le travail mené auprès des agresseurs, dans un souci de prévention.
Madame la ministre, au-delà des campagnes de sensibilisation menées par des associations telles que le Collectif féministe contre le viol, qui a créé un numéro vert d’aide aux victimes, pourquoi ne pas lancer, à l’exemple de la campagne de lutte contre le harcèlement dans les transports, qui a rencontré un fort écho, une grande campagne nationale, à la fois pour rappeler que le viol est un crime et pour aider les victimes à porter plainte, à se reconstruire ?
Je souhaiterais que vous puissiez dresser un premier bilan de la mise en place de référents « violences sexuelles » dans les services d’urgences des hôpitaux et nous préciser ce qu’entend faire le Gouvernement pour améliorer l’accueil, la protection et l’accompagnement des victimes par les unités médico-judiciaires.
La formation des personnels de la police, de la justice et de la santé, ainsi que des travailleurs sociaux, me paraît devoir être l’un des axes essentiels. Certes, un article de la loi du 4 août 2014 porte sur cette question, mais peut-être présente-t-il un caractère trop général et manque-t-il un « focus » spécifique sur le viol et les agressions sexuelles.
Tout cela plaide, une nouvelle fois, en faveur de l’élaboration d’une loi-cadre pour les femmes, comme le demande avec force le Collectif national pour les droits des femmes, et pour la création d’observatoires départementaux des violences faites aux femmes, à l’instar du dispositif qui a été mis en place en Seine-Saint-Denis, notamment, sous l’impulsion d’Ernestine Ronai.
De même, il serait utile que le Gouvernement suive un certain nombre de recommandations issues de l’avis rendu public en octobre dernier par la commission « violences de genre » du Haut Conseil à l’égalité des femmes et des hommes, dont je suis membre.
En premier lieu, il faut assurer une prise en charge à 100 % des soins visant à traiter les conséquences psychotraumatiques des violences sexuelles.
En deuxième lieu, il faut renforcer les dispositifs des articles 222-22 et suivants du code pénal, portant sur la définition des agressions sexuelles, du viol et des éléments constitutifs permettant de qualifier ces actes.
En troisième lieu, comme l’ont souligné plusieurs de mes collègues, il paraît nécessaire de revoir les délais de prescription en matière pénale. À titre personnel, je plaide pour un réel allongement des délais de prescription, voire pour l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs.
Enfin, exigeons collectivement que l’on cesse de correctionnaliser les viols sous prétexte, prétendument, de désengorger les cours d’assises et d’éviter les délais trop longs. Le viol n’est pas un délit et ne doit donc pas être requalifié en agression sexuelle : c’est un crime, qui doit être jugé en cour d’assises.

Tout cela exige bien entendu que des moyens soient accordés à la justice, au ministère des droits des femmes et aux associations de terrain. À cet égard, je ne peux que regretter la baisse des dépenses publiques intervenue au cours de ce quinquennat.
Mes chers collègues, en juillet 2014, la France a ratifié la convention dite d’Istanbul, dont les dispositions sont plus favorables aux femmes que celles du droit français. Il me semble urgent de les transposer dans notre droit.
Le silence, la peur, la honte, le tabou ne doivent plus régner. Mais, on l’a vu tout au long de ce débat, pour les victimes, parler ne relève pas d’une simple injonction. Il faut absolument passer à la vitesse supérieure, notamment en matière de politiques publiques. L’État doit se donner les moyens de débarrasser la société des violences sexuelles et, plus largement, de toutes les violences faites aux femmes. C’est la condition à remplir pour conquérir l’égalité entre les femmes et les hommes. « Là où il y a une volonté, il y a un chemin », disait Lénine !
Sourires et applaudissements sur la plupart des travées.
Monsieur le président, madame la présidente de la délégation aux droits des femmes, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je remercie Mme Benbassa et le groupe écologiste d’avoir pris l’initiative de ce débat et je salue la qualité des propos tenus par l’ensemble des intervenantes.
Ce débat me donne l’occasion de vous exposer, le plus précisément possible, les actions que le Gouvernement a engagées pour lutter contre les violences sexuelles, quelle qu’en soit la nature, et pour mieux rendre justice aux victimes, les protéger et les soigner, quels que soient leur âge ou leur sexe.
Je ne reviendrai pas sur les chiffres, car ils ont déjà été donnés à plusieurs reprises, sinon pour souligner la persistance d’une forme d’impunité pour les agresseurs. En effet, seules 10 % des victimes de viol portent plainte. De plus, lorsque des procédures judiciaires sont engagées, de nombreuses plaintes sont classées sans suite ou aboutissent à des non-lieux, quand des viols ne sont pas déqualifiés en agressions sexuelles. Au total, seulement 1 % des viols font l’objet d’une condamnation.
J’insisterai également sur l’importance des violences sexuelles commises sur des mineurs. Plus de la moitié des femmes victimes de viol ou de tentative de viol ont été agressées avant 18 ans, dont 40 % avant 15 ans ; pour ce qui concerne les hommes, les trois quarts des victimes étaient mineures au moment des faits et près des deux tiers avaient moins de 15 ans. En 2015, la moitié des victimes de violences sexuelles enregistrées par la police et la gendarmerie avaient moins de 15 ans.
À ce jour, nous ne disposons d’aucune évaluation précise du nombre d’enfants victimes de violences sexuelles en France. En 2010, le Conseil de l’Europe avançait qu’un enfant sur cinq sur notre continent était victime de ces violences entendues au sens large : viols, tentatives de viol, agressions sexuelles, exposition à la pornographie, exploitation sexuelle et prostitution.
Ces chiffres l’attestent, nous avons affaire à un phénomène de masse, certainement toujours sous-estimé pour ce qui concerne les plus jeunes. La loi du silence et le règne du déni contribuent à en minorer encore l’ampleur, voire à le rendre invisible. L’absence de données fiables sur les violences sexuelles commises sur des hommes majeurs, qu’elles relèvent d’agressions homophobes ou qu’elles s’exercent en milieu carcéral, illustre bien la réalité de cette omerta.
Mme Corinne Bouchoux acquiesce.
Cette chape de plomb nous confronte à un double écueil : la difficulté pour les victimes de dénoncer leurs agresseurs ; la difficulté pour les professionnels de détecter ce type de violences, donc d’apporter les réponses adaptées en termes médico-judiciaires.
La réalité et la gravité des conséquences des violences sexuelles sur la santé physique et mentale des victimes sont aujourd’hui mieux connues. Sans aide ni protection, les victimes sont condamnées à survivre avec des symptômes post-traumatiques. Tout au long de leur vie, elles présenteront des troubles physiques et psychologiques, qui les amèneront parfois à adopter des conduites à risques.
Libérer et recueillir la parole des victimes est donc un préalable à une prise en charge efficace. Là est l’enjeu majeur.
Les sentiments de honte, de culpabilité, d’humiliation que ressentent toutes les victimes de violences sexuelles et qui sont entretenus par l’adhésion majoritaire de la société aux fausses représentations sur le viol font évidemment obstacle à la révélation et à la dénonciation. « C’est pas si grave », « elle était consentante », « elle l’a bien cherché »… À chaque fois que l’on évoque le viol d’une femme, les premières questions sont : où se trouvait-elle ? Comment était-elle habillée ? Comment cela a-t-il pu lui arriver ? De tels propos reflètent la « culture du viol ».
Mme Laurence Rossignol, ministre. À cet égard, dans l’expression « se faire violer », la forme pronominale réfléchie implique une participation de la victime à la commission du viol.
Mme Corinne Bouchoux acquiesce.
Il est d’autant plus difficile de libérer la parole que, contrairement aux idées reçues, les viols et les agressions sexuelles se produisent majoritairement au sein du couple ou de la famille, au domicile de la victime, à son travail ou dans les institutions qu’elle fréquente. Cela a été rappelé, dans 90 % des cas, les violences sexuelles sont commises par une personne connue de la victime : le conjoint ou l’ex-conjoint pour près de 50 % des viols perpétrés sur des femmes adultes, un membre de la famille pour plus de la moitié des viols sur mineur.
Pour les jeunes victimes, parler et être crues est un véritable défi. Outre la difficulté de reconnaître une agression sexuelle, de mettre des mots sur des actes insensés, d’identifier un interlocuteur ou une interlocutrice à qui s’ouvrir, le poids du tabou de la violence sexuelle dans la sphère familiale pèse très lourdement sur la parole de ces enfants.
Comme l’écrit de manière poignante Laurent Boyer dans Tous les f rères font comme ça, livre où il révèle l’inceste dont il a été victime entre 6 et 9 ans : « D’abord, c’est la peur de ne pas être cru qui nous fait nous taire. Ensuite c’est la crainte de faire mal à cette famille que l’on risque de faire voler en éclats. Et enfin c’est la honte de n’avoir finalement rien osé dire. Cette même honte qui nous fait nous sentir coupables, monstrueux et sales. »
Comment dire l’indicible ? Comment penser l’impensable ? Il est urgent de donner à toutes les victimes, et tout particulièrement aux plus jeunes d’entre elles, les moyens de signaler les violences qu’elles ont subies, et aux professionnels les outils pour recueillir leur parole de manière appropriée et respectueuse.
Les quatrième et cinquième plans interministériels de lutte contre les violences faites aux femmes ont permis d’avancer.
À cet égard, madame Cohen, je précise que le budget consacré aux droits des femmes n’a pas subi de baisse au cours du quinquennat : il a même augmenté de 50 % et connaîtra encore une hausse de 8 % cette année.
Cela étant, je vous le concède, plus on libère la parole, plus les associations sont sollicitées et plus leur volume d’activité augmente.
Les subventions n’ont pas été réduites, au contraire, mais le volume d’activité des associations, qui sont les premiers recours des victimes, s’est accru.
Il s’agit de permettre aux professionnels de mieux repérer les violences. Travailleurs sociaux, personnels soignants, magistrats, fonctionnaires de police, gendarmes ou responsables associatifs : tous, dans leurs fonctions respectives, sont des maillons essentiels d’une même chaîne. La cohérence et l’articulation de leurs interventions sont essentielles pour garantir aux victimes une prise en charge optimale.
Il est donc impératif que toutes et tous disposent des mêmes repères et puissent s’approprier des outils communs. Quels que soient le professionnalisme, l’investissement et l’empathie dont chacun fait preuve, nul n’est à l’abri des préjugés, des interrogations ou des maladresses face à un phénomène qui doit être appréhendé dans toute sa complexité pour être traité de manière efficace.
Poser les bonnes questions aux victimes, offrir un cadre d’écoute qui les aide à trouver les mots, leur rappeler qu’elles ne sont en rien responsables ou coupables de ce qu’elles ont subi : c’est le préalable indispensable pour libérer leur parole. Voilà pourquoi nous avons fait de la formation des professionnels une priorité du quatrième plan de lutte contre les violences faites aux femmes, qui a couvert la période 2013-2016. Cette priorité donnée à la formation s’est traduite par la création de plusieurs outils, élaborés par la mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences, la MIPROF. Plus de 300 000 professionnels ont ainsi bénéficié d’actions de formation depuis 2014.
Concrètement, des fiches réflexes sur l’audition des victimes de violences sexuelles sont désormais à la disposition des forces de police et de gendarmerie ; plus de 500 urgentistes référents « violences », spécifiquement formés, ont été désignés dans les hôpitaux ; la MIPROF a réalisé un kit de formation et un kit de constatation en urgence disponible dans les centres hospitaliers ; les magistrats peuvent suivre un stage de trois jours en formation continue à l’École nationale de la magistrature ; des modèles de certificats médicaux, élaborés en lien avec le conseil de l’Ordre des médecins, ont été mis en ligne sur le site internet de la MIPROF, ces certificats médicaux constituant des éléments de preuve obligatoires pour engager une action judiciaire ou permettre aux femmes de bénéficier d’une ordonnance de protection et, le cas échéant, d’un téléphone « grave danger ».
Cette dynamique vertueuse est poursuivie et amplifiée au travers du cinquième plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes, que j’ai présenté au mois de novembre dernier.
Ces actions de formation ont ainsi été étendues à d’autres métiers, dans le cadre d’une coopération renforcée entre l’ensemble des actrices et des acteurs des champs social, judiciaire, de l’éducation, de la santé et de la sécurité, en particulier les sapeurs-pompiers.
La loi du 14 mars 2016 a également contribué à accroître nos moyens en matière de protection de l’enfance et de détection des violences faites aux enfants. Le large champ de compétence de mon ministère, qui recouvre l’enfance, les droits des femmes et les familles, permet de mettre au service de la lutte contre les violences faites aux enfants l’expertise développée en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. J’y vois une illustration supplémentaire, s’il en était besoin, de la pertinence de la titulature de mon ministère.
Dans cette optique, je me suis attachée à faire travailler ensemble les professionnels qui avaient construit les politiques de prévention et de formation en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, afin que nous puissions nous appuyer sur leur savoir pour mieux prévenir et combattre les maltraitances faites aux enfants. C’est ainsi que nous avancerons.
La loi du 14 mars 2016 avait déjà posé un cadre favorable à un meilleur repérage des violences sexuelles, ainsi qu’à une meilleure prise en charge des mineurs victimes. J’évoquerai deux mesures emblématiques : l’obligation pour les départements de désigner un médecin référent pour la protection de l’enfance ; le développement des unités d’accueil médico-judiciaires pédiatriques, ou unités AMJP, qui permettent à la police, à la justice, aux médecins et aux travailleurs sociaux de travailler ensemble dans le cadre des procédures d’enquête et constituent un lieu dédié, adapté et non anxiogène pour recueillir la parole de l’enfant et apporter les premiers soins nécessaires.
Chantal Jouanno m’a interrogée sur l’instruction du 20 avril 2016, qui a recentré le rôle des brigades de prévention de la délinquance juvénile sur la prévention de la radicalisation et du passage à l’acte terroriste. J’ai moi-même interrogé le ministère de l’intérieur, qui m’a précisé que cette circulaire n’empêche pas les gendarmes spécialement formés de continuer à intervenir dans les unités AMJP en tant que personnalités qualifiées, par le biais d’une réquisition, en appui à un officier de police judiciaire. Sur les 1 774 militaires de la gendarmerie formés à l’audition de mineurs victimes, 3, 7 % travaillent aujourd’hui au sein des quarante-trois brigades de prévention de la délinquance juvénile, les BPDJ. La formation au recueil de la parole continuera à être développée et le déploiement des unités AMJP se poursuivra. Cela fait partie de la feuille de route pour la période 2016–2019.
Dans le prolongement de cette démarche, et forte de l’expérience acquise avec les quatre premiers plans de lutte contre les violences faites aux femmes, je présenterai le 1er mars prochain le premier plan de lutte contre les violences faites aux enfants, élaboré dans le cadre d’une démarche pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle et englobant le repérage, la formation et l’accompagnement, y compris judiciaire.
Vous comprendrez que je ne dévoile pas aujourd’hui les principales mesures de ce plan, qui vise à rendre visibles les mécanismes des violences et à améliorer leur compréhension, à sensibiliser et à prévenir, par la promotion du soutien à la parentalité et de l’éducation bienveillante, à améliorer le repérage et le recueil de la parole, notamment en cas de violences sexuelles, à mieux accompagner les victimes, notamment par une meilleure prise en charge des psychotraumas.
Concernant la promotion de l’éducation bienveillante, je déplore, à la suite de Michelle Meunier, que certains sénateurs aient jugé bon de saisir le Conseil constitutionnel en vue d’obtenir la censure, pour des raisons de procédure, de l’article de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté issu de l’adoption d’un amendement tendant à poser pour principe que l’autorité parentale doit s’exercer sans recourir aux punitions corporelles. C’est là un mauvais coup porté à la prévention de la maltraitance des enfants.
On ne peut pas arguer, à mon sens, que corriger des enfants, utiliser la force physique à leur encontre, relèverait d’une quelconque liberté éducative.
Nous savons que la parole de l’enfant se libère dès lors que celui-ci connaît ses droits. L’enfant a des droits, à commencer par celui de ne pas être frappé ! Les enfants sont les seuls êtres vivants que l’on puisse encore légalement frapper dans notre pays – dès lors, je le concède, qu’il s’agit de ses propres enfants. Quand quelqu’un frappe son chien dans la rue, il n’est pas rare qu’un tiers intervienne pour défendre l’animal. Quand un parent frappe son enfant, en revanche, une telle intervention est très mal vécue, au nom de la liberté éducative.
Lorsque des associations se rendent dans les écoles pour expliquer aux élèves ce que sont les droits de l’enfant, il est très fréquent que, à l’issue de leur intervention, des enfants leur demandent si ce qu’ils vivent chez eux est normal, si les adultes ont le droit de se comporter avec eux comme ils le font. Je regrette d’autant plus la censure de l’article que j’évoquais à l’instant que son dispositif revêtait une grande importance en vue de la libération de la parole de l’enfant. Il est profondément hypocrite de prétendre vouloir lutter contre les violences faites aux enfants, y compris sexuelles, tout en prônant le maintien du droit de correction, donc de la domination des parents sur les enfants.
L’amélioration de la prise en charge des victimes est un élément fondamental.
L’enquête nationale réalisée l’an dernier par l’IPSOS pour l’association Mémoire traumatique et victimologie révélait que 78 % des victimes de viols ou de tentatives de viol n’avaient pas reçu de soins d’urgence et qu’une sur trois n’avait pu bénéficier d’une prise en charge psychologique adaptée.
Il s’agit là d’un enjeu majeur de santé publique, et il est impératif que nous puissions progresser rapidement. J’ai donc souhaité que le cinquième plan de lutte contre les violences faites aux femmes, présenté en novembre dernier, comporte un volet spécifique pour renforcer l’accès aux droits et aux soins des jeunes filles et des femmes victimes de violences sexuelles.
Fin 2016, le Gouvernement a engagé une large réflexion sur la prise en charge des traumatismes graves des adultes, des adolescents et des enfants victimes d’attentats. Les connaissances qui résulteront de ce travail de recherche-action seront mobilisables et transposables aux cas de violences sexuelles, en vue d’améliorer l’accompagnement des victimes, quel que soit leur âge.
L’objectif est que chaque victime, où qu’elle réside, puisse bénéficier d’une prise en charge psychologique adaptée à la spécificité des psychotraumas, grâce à un maillage territorial renforcé des unités de soin.
Conformément aux recommandations formulées par le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes dans son « avis pour une juste condamnation sociétale et judiciaire du viol et des agressions sexuelles », nous nous attachons également à simplifier le parcours judiciaire des victimes, selon les trois objectifs suivants : faciliter le dépôt de plainte, faciliter le recueil de preuves de violences en l’absence de plainte, avancer sur la question de l’allongement des délais de prescription pour les infractions de viol et d’agression sexuelle, notamment sur les mineurs.
Je m’arrêterai un instant sur ce point. Vous le savez, les amendements à la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale, présentée par les députés Alain Tourret et Georges Fenech, ont été systématiquement rejetés. Comme l’actualité nous l’a récemment rappelé, ce projet de réforme n’épuise pas toutes les difficultés posées par les délais de prescription.
Les professionnels, tant de la justice que de la psychiatrie, sont divisés sur la question de l’allongement des délais de prescription en matière de viol sur mineurs. C’est pourquoi j’ai confié à Flavie Flament et à Georges Calmettes, magistrat honoraire, une « mission de consensus » qui associe spécialistes et victimes, celles-ci étant elles aussi, à mes yeux, des experts, du fait de leur vécu. L’objectif est que partisans et opposants à l’allongement des délais de prescription se parlent, croisent leurs regards. Cette mission me rendra ses conclusions au mois de mars. J’ai conscience que le calendrier électoral ne me permettra guère d’aller plus loin, mais au moins laisserai-je à mes successeurs une base de travail qui, je l’espère, leur permettra d’avancer sur ce sujet. Dans cette perspective, je garderai pour moi mon avis personnel sur la question de l’allongement des délais de prescription.
Les dispositifs d’écoute et de prise en charge ne trouveront leur pleine efficacité que s’ils sont accompagnés d’actions de prévention et de sensibilisation, l’enjeu étant de faire reculer la tolérance sociale à l’égard du viol et l’omerta sur violences sexuelles au sein de la famille et des institutions que fréquentent les enfants.
L’enquête de l’IPSOS de mars 2016 sur les représentations du viol et des violences sexuelles révélait que 40 % des Français estiment que « la responsabilité du violeur est atténuée si la victime a eu une attitude provocante en public ». Il nous reste donc un travail important de déconstruction à mener… La même proportion de nos concitoyens soutient l’idée que l’on peut « faire fuir le violeur si l’on se défend vraiment », ce qui reflète une ignorance totale de ce qu’est l’état de sidération.
Déresponsabilisation de l’agresseur, mise en cause des victimes, méconnaissance de la réalité des viols… Ce sont aussi toutes ces fausses représentations des violences sexuelles qui empêchent les victimes de parler et de demander justice. Tous ces mythes, ancrés dans la « culture du viol », doivent être déconstruits. C’est une exigence, et une urgence !
Dans la majorité des cas, le viol ou l’agression sexuelle sur un mineur est commis par un membre de la famille ou par un proche. Il importe de sensibiliser les parents à l’idée que les personnes auxquelles ils confient leurs enfants ne sont pas forcément toutes bienveillantes. De même, les éducateurs et les médecins doivent être conscients du fait que la famille est, pour les enfants, le premier lieu d’exposition aux violences.
Une campagne de communication à destination du grand public a été lancée le 25 novembre dernier pour faire connaître le numéro 3919. Nous poursuivons, en lien avec le ministère de l’éducation nationale, la mise en œuvre d’outils spécifiques, dont les dispositifs d’éducation à la sexualité et de sensibilisation à l’égalité entre les filles et les garçons. Une fois encore, on ne peut pas prétendre vouloir lutter contre les violences sexuelles faites aux enfants et refuser, dans le même temps, que l’éducation nationale se mêle d’éducation à la sexualité. Celle-ci passe par la verbalisation de ce qu’est le respect du corps et du consentement. C’est une question de cohérence : l’éducation à la sexualité à l’école et la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants sont des sujets connexes.
Enfin, la mobilisation « Sexisme, pas notre genre ! », qui vise à mettre en lumière la dimension systémique du sexisme, de la misogynie et de la domination exercée par les hommes sur les femmes et sur les enfants, est aussi, à mes yeux, un outil pour lutter contre les violences sexuelles et libérer la parole des victimes.
Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, j’aurai grand plaisir à vous accueillir au ministère, en mars, pour la présentation du premier plan de lutte contre les violences faites aux enfants.
Applaudisse ments .

Nous en avons terminé avec le débat, organisé à la demande du groupe écologiste, sur le thème : violences sexuelles, aider les victimes à parler.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 7 février 2017, à quatorze heures trente et le soir :
1. Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle (n° 316, 2016-2017) ;
Rapport de M. Daniel Gremillet, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 344, 2016-2017) ;
Texte de la commission (n° 345, 2016-2017).
2. Deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale, portant réforme de la prescription en matière pénale (n° 295, 2016-2017) ;
Rapport de M. François-Noël Buffet, fait au nom de la commission des lois (n° 347, 2016-2017) ;
Texte de la commission (n° 348, 2016-2017).
3. Nouvelle lecture du projet de loi relatif au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain (n° 315, 2016-2017) ;
Rapport de M. Mathieu Darnaud, fait au nom de la commission des lois (n° 349, 2016-2017) ;
Résultat des travaux de la commission (n° 350, 2016-2017).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à douze heures quinze.