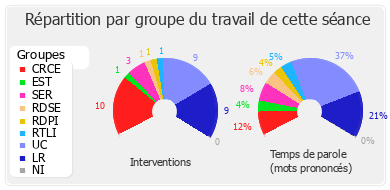Séance en hémicycle du 4 novembre 2020 à 21h30
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Pierre Laurent.

La séance est reprise.

L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal (projet n° 15, texte de la commission n° 92, rapport n° 91).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, madame la rapporteure, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, le texte aujourd’hui soumis à votre approbation est l’aboutissement d’un long travail, dont l’impulsion a été donnée par le Président de la République lors de son discours prononcé à Ouagadougou en novembre 2017 : il y avait exprimé sa volonté de réunir les conditions nécessaires à des restitutions d’œuvres relevant du patrimoine africain, dans le cadre du renouvellement et de l’approfondissement du partenariat entre la France et les pays du continent africain.
C’est un texte important, qui ouvre une nouvelle page dans nos relations culturelles avec le continent africain.
Il n’est pas question ici de repentance ou de réparation. C’est l’avenir qui nous intéresse, et il passe par la refondation du lien culturel qui unit la France à l’Afrique.
S’il est inédit par son ampleur et sa symbolique, le projet de restitution des vingt-six œuvres issues du « Trésor de Béhanzin » à la République du Bénin, ainsi que du sabre attribué à El Hadj Omar Tall et de son fourreau à la République du Sénégal, s’inscrit néanmoins dans le prolongement d’une politique de coopération culturelle déjà engagée avec ces deux pays.
Ce projet de loi s’inscrit également dans un contexte de réflexion sur le rôle et les missions des musées en Europe et dans le monde. Le rapport de Felwine Sarr et Bénédicte Savoy remis au Président de la République en 2018 a été l’occasion de passionnants échanges sur l’histoire des collections, notamment originaires du continent africain, et sur la nécessité de mieux en expliquer la provenance au grand public.
Les œuvres et les objets que nous souhaitons restituer au Bénin et au Sénégal sont exceptionnels à tous égards. Témoins d’un passé glorieux et tourmenté, leurs qualités esthétiques attestent le génie de leurs créateurs et leur valeur symbolique n’a cessé de s’accroître au cours du temps. Ils sont devenus de véritables « lieux de mémoire », au sens que l’historien Pierre Nora donne à cette expression, dépositaires d’une partie de l’identité des peuples sénégalais et béninois.
Le sabre attribué à El Hadj Omar Tall ainsi que son fourreau renvoient, dans l’imaginaire collectif, à la formidable épopée de la fondation et de l’extension de l’empire toucouleur, sous la conduite de ce chef militaire et religieux d’exception, qui a fini par se heurter aux forces françaises. Données au musée de l’Armée il y a plus d’un siècle par le général Louis Archinard, ces deux pièces sont actuellement exposées au musée des civilisations noires de Dakar dans le cadre d’une convention de prêt de longue durée.
Les œuvres du trésor des rois d’Abomey, quant à elles, constituaient la manifestation insigne de la continuité et de la grandeur de cette dynastie pluriséculaire, avant que le général Dodds ne s’en empare, par la force, en 1892. Ces vingt-six pièces sont les derniers témoins de l’esprit de résistance du roi Béhanzin, qui a préféré incendier son palais et les regalia inestimables qu’il contenait plutôt que de les abandonner aux mains des troupes françaises victorieuses.
La perte de ce trésor royal est progressivement devenue, pour le peuple béninois, le symbole d’une indépendance perdue. Conservées par différents musées français puis, à partir de sa création en 1999, par le musée du quai Branly-Jacques Chirac, ces œuvres ont suscité une émotion considérable lorsqu’elles ont été présentées sur le sol béninois, en 2006, dans le cadre d’une exposition temporaire. La République du Bénin a, en 2016, demandé à la République française de lui restituer les vingt-six œuvres du trésor royal d’Abomey.
En restituant ces objets d’exception au Bénin comme au Sénégal, nous donnerons à la jeunesse africaine accès à des éléments majeurs de son propre patrimoine et de son identité, conformément au souhait exprimé par le Président de la République.
Je souhaite à présent vous préciser le sens, la portée et les conséquences du texte qui vous est soumis.
Tout d’abord, il convient de rappeler que cette restitution de biens culturels par un État à un autre État n’a en soi rien d’inédit. Ce qui l’est davantage, c’est – je viens de le souligner – la qualité et la dimension symbolique des œuvres concernées pour le patrimoine africain comme pour le patrimoine mondial. Parmi les restitutions récentes consenties par la France figurent notamment celle, en 1981, d’une statue d’Amon-Min volée à l’Égypte, en application du jugement d’un tribunal français, celle de vingt et une têtes maories à la Nouvelle-Zélande, par le biais de la loi votée en 2010 sur l’initiative de la sénatrice Catherine Morin-Desailly, ou encore celle de trente-deux plaques d’or à la Chine, en application de la convention de l’Unesco (Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture) pour la lutte contre le trafic illicite des biens culturels de 1970, ratifiée par la France en 1997.
Ces différents cas de figure illustrent la diversité des voies offertes par le droit français pour procéder à des restitutions.
Dans le cas présent, en l’absence de recours judiciaire du Bénin et du Sénégal, le législateur peut apporter une réponse aux demandes de ces deux pays sans craindre les effets d’une jurisprudence que la décision du juge aurait nécessairement fait naître.
Sans portée générale, ce projet de loi ne vaut que pour le cas spécifique de l’ensemble des objets qu’il énumère expressément. Il n’institue aucun « droit général à la restitution », en fonction de critères abstraits qui seraient définis a priori.
La voie législative s’impose à nous, par ailleurs, dans la mesure où la restitution des objets au Bénin et au Sénégal implique de déroger au principe d’inaliénabilité des collections publiques, inscrit dans le code du patrimoine.
Mais si ce projet de loi tend à contrevenir ponctuellement à ce principe, il ne le remet nullement en cause, pas plus que ne l’ont fait les lois précédentes du même type, comme celle de 2010.
L’adoption de l’amendement de la députée Constance Le Grip lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale permet d’ailleurs de lever toute incertitude à cet égard, en inscrivant dans le texte la référence à ce principe et en désignant explicitement ces restitutions comme des dérogations.
À l’inverse, l’amendement adopté par la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, ajoutant au projet de loi un article 3 instaurant un « Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour d’œuvres d’art extra-occidentales » me semble nous éloigner, au profit d’un dispositif-cadre, de cette logique « d’espèce », cette appréciation au cas par cas que le Gouvernement privilégie pour les raisons que je viens d’évoquer. C’est pourquoi j’en proposerai la suppression.
Au-delà des points juridiques, ces restitutions soulèvent des questions purement politiques, au sens le plus noble du mot, sur lesquelles je voudrais apporter un éclairage.
Le présent projet de loi n’est en aucun cas une remise en cause ou une critique du rôle joué par les institutions françaises qui ont assuré la conservation de ces œuvres depuis de nombreuses années, à savoir le musée du quai Branly-Jacques Chirac et le musée de l’Armée – tout au contraire. Ces deux établissements ont permis non seulement la conservation, mais aussi l’étude approfondie de ces œuvres, sans laquelle nous ne pourrions prendre la pleine mesure de leur valeur historique, symbolique et esthétique. Elles en ont également assuré la présentation au public, tant en France qu’à l’étranger, en particulier dans leurs pays d’origine, aujourd’hui concernés par ces restitutions, sous la forme de prêts. Nous devons leur en être reconnaissants.
Accepter ces restitutions, ce n’est pas davantage remettre en cause le modèle universaliste de nos musées, que nous devons plus que jamais défendre. Le contexte actuel, dans notre pays comme à l’étranger, nous rappelle de la façon la plus tragique à quelles extrémités monstrueuses les crispations identitaires et le mépris de la culture de l’autre peuvent conduire. La mission de la France, aujourd’hui plus encore qu’hier, est de favoriser, notamment grâce à la circulation des œuvres, le dialogue des cultures et l’échange des perceptions.
Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je veux vous le dire ce soir avec gravité : la fonction première de la culture est d’exprimer et d’explorer ce que notre condition humaine a d’universel. Cette conviction, qui est au fondement de notre ministère français de la culture, peut paraître aujourd’hui, hélas, de moins en moins partagée. Ce projet de loi est aussi une façon de rappeler que nous n’y renoncerons jamais.
C’est au nom d’une telle conviction, d’un tel idéal, que la France n’accepte de restituer des œuvres à d’autres États que si ces États s’engagent à ce que ces œuvres gardent leur vocation patrimoniale, c’est-à-dire continuent à être conservées et présentées au public dans des lieux consacrés à cette fonction. Dans le cas du Bénin et du Sénégal, ces garanties ont été données.
La France accompagne les initiatives de ces deux pays en faveur du patrimoine, bien au-delà des seules restitutions. Tel est le sens du programme de travail commun élaboré avec le Bénin ainsi que du partenariat culturel renforcé avec le Sénégal, qui visent tous deux à inscrire ces restitutions dans le cadre plus large d’une véritable coopération ambitieuse.
Nous soutenons ainsi des projets de développement de musées et des actions de formation, qui permettront de partager l’expertise des professionnels français du patrimoine et de mettre en place de véritables filières professionnelles dans ce domaine. Le patrimoine d’exception ainsi rendu sera de la sorte accessible, sur le long terme, au plus grand nombre, dans un cadre à la hauteur de sa valeur.
Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, le projet de loi qui vous est soumis n’est pas un acte de repentance – je le disais – ni une condamnation du modèle culturel français. C’est un acte d’amitié et de confiance envers le Bénin et le Sénégal, pays auxquels nous lient une longue histoire commune et des projets communs d’avenir.
Ce projet de loi permettra aux Béninois et aux Sénégalais de renouer plus directement avec leur passé et d’accéder à des éléments constitutifs de leur histoire, comme nos propres collections nous permettent de le faire. Ces objets symboliques leur permettront de penser un présent et de bâtir un futur qui leur soient propres, tout en faisant l’objet d’un partage avec les autres, avec tous ceux qui visiteront ces nouveaux musées.
C’est, pour la France, un honneur et une fierté de pouvoir jouer un rôle actif en la matière, et de contribuer à ce que notre histoire commune, riche sans jamais avoir été simple, ne cesse de nous nourrir les uns les autres et de nous amener à nous dépasser.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi que sur des travées des groupes SER et CRCE.

Monsieur le président, madame la ministre, mes très chers collègues, comment ne pas être sensible à la démarche qui anime le Bénin et le Sénégal, visant à contribuer au désir de la jeunesse africaine de connaître et de s’approprier son histoire ? Comment ne pas être favorable à l’objectif de renforcer notre dialogue avec l’Afrique, ce continent ami, par le biais d’une coopération culturelle et patrimoniale accrue ?
Ce n’est en tout cas pas le Sénat qui pourrait contester ces deux points, lui qui a été à l’initiative tant des deux seules lois de restitution que notre pays ait jamais adoptées que de la consécration législative des droits culturels.
À la différence d’autres demandes, qui portent aujourd’hui sans discernement sur l’ensemble des biens conservés dans nos collections et originaires d’un pays d’un pays donné, quelles que soient leur importance ou la manière dont nos musées les ont acquis, les revendications du Bénin et du Sénégal portent sur des objets précis et limités en nombre, des biens qui revêtent pour eux une portée culturelle, symbolique et spirituelle, au-delà de la simple valeur artistique et historique qu’ils ont aussi en France.
La demande de leur retour est motivée par le besoin de ces pays de recouvrer une part de leur identité culturelle. Elle s’inscrit dans un vaste projet politique, muséal et touristique visant à faciliter l’accès de leurs populations à leur patrimoine. À cet égard – cet élément était pour nous essentiel –, des garanties ont été données quant aux modalités de conservation et de présentation au public de ces biens au cas où nous acceptions leur cession.
Le problème soulevé par ce projet de loi ne tient donc pas à sa démarche. Celle-ci est fondée d’un point de vue éthique et diplomatique ; elle témoigne de la volonté de la France de renouer avec l’esprit des Lumières et, non pas de se repentir, mais de se réapproprier conjointement, dans un cas avec le Bénin, dans l’autre avec le Sénégal, une part importante de notre histoire commune, cette réappropriation devant servir de base à une coopération culturelle renouvelée. Notre pays ne peut en sortir que grandi.
Ce qui est en cause, c’est la méthode qui préside à la politique menée en matière de restitution depuis le discours de Ouagadougou, dont ce projet de loi est l’un des volets.
Certains pourront trouver ce sujet anodin, mais il y va de collections nationales, c’est-à-dire de biens qui appartiennent au patrimoine de la Nation et qui, à ce titre, sont protégés par le principe d’inaliénabilité, au même titre que le reste du domaine public. C’est ce qui rend indispensable l’autorisation de la représentation nationale pour faire sortir des biens des collections publiques.
Notre pays a certes déjà, par le passé, adopté deux lois de restitution, mais le projet de loi dont nous débattons aujourd’hui s’en distingue à la fois par la forme, puisqu’il s’agit d’une initiative gouvernementale et non parlementaire, et par le fond, dans la mesure où ce texte concerne le retour d’œuvres et d’objets, et non de restes humains, ces deux types de biens culturels ne pouvant pas être traités de la même manière.
Là où la loi de 2010 de restitution des têtes maories avait été précédée d’un vaste symposium international consacré à la question des restes humains dans les musées, organisé au musée du quai Branly en février 2008 à la demande de la ministre de la culture de l’époque, Christine Albanel, aucune initiative similaire, réunissant scientifiques, universitaires, juristes, parlementaires et décideurs, n’a cette fois-ci été prise pour permettre à tous de s’exprimer publiquement et faciliter la recherche d’un consensus. Je veux le rappeler ici : le fait que Felwine Sarr et Bénédicte Savoy n’aient que faiblement associé les scientifiques à leurs travaux pèse pour beaucoup dans les critiques dont leur rapport fait l’objet.
Il est vrai que les conservateurs des musées concernés ont été consultés pour préparer ce projet de loi ; mais ont-ils pu être véritablement entendus, sachant que le Président de la République avait déjà annoncé publiquement le retour de ces objets ?
Le problème, dans cette affaire, est que la décision politique a précédé et prévalu sur toute autre forme de débat, historique, juridique, scientifique, philosophique, au mépris du principe d’inaliénabilité des collections, pourtant instauré pour empêcher le « fait du prince ».
Ainsi le débat au Parlement est-il faussé et s’apparente-t-il davantage au vote d’un projet de loi de ratification, dans la mesure où l’État a déjà engagé sa parole et où le sabre a déjà été, il y a un an, officiellement remis au Sénégal – je le regrette. J’en veux pour preuve, aussi, le manque de considération que m’a témoigné il y a quelques jours un membre de votre cabinet, madame la ministre, balayant d’un revers de main mes propositions d’amendement au motif que la question avait déjà été débattue et décidée à l’Assemblée nationale. J’ignorais que le Parlement était devenu monocaméral !
Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.

Faut-il rappeler combien le Sénat a été loué pour la sagesse et la créativité de ses apports à l’occasion des discussions parlementaires sur le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, dite LCAP, et sur le projet de loi « Notre-Dame », qui ont permis de contrebalancer les excès que comportaient les projets initiaux ?
C’est la même ambition qui a, une fois encore, animé notre commission. Le texte que nous avons adopté la semaine dernière n’a nullement remis en cause le principe du retour des objets. Aucun amendement n’avait même été déposé en ce sens.
En revanche, nous jugeons indispensable de garantir, dans le futur, un surcroît de méthode, celle-ci ayant partiellement fait défaut cette fois-ci.
Nous sentons tous que l’enjeu de ce projet de loi va bien au-delà de son simple objet. Certains seront déçus qu’il n’ait pas été l’occasion de poser un cadre général ; d’autres, au contraire, craignent l’effet d’entraînement qu’il pourrait avoir. Ces points de vue contradictoires révèlent toute la complexité du sujet. Ils démontrent aussi combien nous sommes conscients de l’ampleur que sont appelées à prendre les questions de restitution dans les années à venir, eu égard aux revendications toujours plus nombreuses que l’on observe dans le cadre de l’Unesco ou d’autres enceintes internationales.
En même temps, nos débats en commission ont révélé notre profond attachement au principe d’inaliénabilité des collections, véritable « colonne vertébrale » de nos musées. D’où la nécessité de définir une procédure qui permette à la fois de préserver ce principe et d’engager un nécessaire travail approfondi de connaissance des œuvres de nos collections, propre à les mettre en lumière dans toute la vérité de leur histoire. Il s’agit de combler le retard accumulé par notre pays en la matière et de lui permettre de sortir de son isolement.
La position défensive adoptée aujourd’hui par la France au niveau international lui est en effet de plus en plus préjudiciable – j’ai reçu de nombreux témoignages en ce sens de l’Unesco. Notre pays a trop à perdre à esquiver plus longtemps un débat que le Sénat l’avait pourtant invité à engager dès 2002, à l’occasion de l’examen de la loi Musées de et de la loi de restitution de la dépouille mortelle de la « Vénus hottentote », puis en 2010, lors de la discussion de la loi de restitution des têtes maories. Désormais, c’est le concept même de musée universel qui est contesté, sa mise en œuvre ayant échoué à donner des gages suffisants tant de réciprocité que de partage.
À nos yeux, la création d’un conseil national de réflexion sur le sujet permettrait de répondre à ce double enjeu.
Consulté sur les demandes de restitution présentées par des États étrangers avant qu’une réponse officielle y soit apportée, il permettrait, premièrement, de garantir qu’un temps soit réservé à l’examen scientifique des demandes, avant toute intervention politique et diplomatique. Le conseil agirait comme une protection face au risque que les intérêts politiques et activistes prennent le dessus sur toute autre forme de considération.
Cet outil protégerait du même coup les autorités politiques des pressions dont elles peuvent faire l’objet – on le comprend –, lesdites autorités ne prenant leur décision, désormais, qu’une fois cet éclairage scientifique recueilli.
Madame la ministre, nous ne pensons pas, bien au contraire, que le conseil soit incompatible avec un traitement au cas par cas des demandes : même si les membres du conseil ne seront pas toujours experts des biens qu’ils auront à examiner, ils auront tout loisir d’entendre des spécialistes avant de rendre leur avis, comme le font les commissions parlementaires. Un tel conseil pourrait en revanche garantir la formation progressive d’une doctrine scientifique en matière de restitution, susceptible de mettre un frein aux demandes tous azimuts. Sa mission ne pourra ainsi se résumer à observer s’il existe un intérêt public attaché à la conservation d’un bien dans les collections ; il s’agira plutôt de mettre en balance cet intérêt public avec l’intérêt scientifique, éthique et politique que présenterait le retour du bien dans son pays d’origine.
Le second intérêt de la création de ce conseil serait d’inciter le ministère de la culture, celui de la recherche et les scientifiques à engager vraiment, cette fois, une réflexion en matière de gestion éthique des collections et de permettre aux autorités françaises de reprendre la main sur le débat relatif aux restitutions. Il est indispensable de clarifier la position française, tant celle-ci est aujourd’hui brouillée par le rapport Sarr-Savoy, qui constitue à ce stade le seul document de référence que brandissent les États étrangers.
Je regrette que nous ayons perdu dix ans, car toutes ces missions auraient pu être menées à bien par la Commission scientifique nationale des collections (CSNC) si l’intention exprimée à l’unanimité par le législateur en 2010 avait été fidèlement et correctement traduite. Le Gouvernement a fait le choix de supprimer cette commission, en se gardant bien d’expliquer les raisons à l’origine de ses dysfonctionnements. Dont acte ; nous en tirons les leçons, et aussi le bilan – car bilan il y a ; nous aurons l’occasion d’en reparler –, en proposant la création de ce conseil national – le mot « conseil » est essentiel – spécifiquement consacré aux questions de restitution et de réflexion sur les collections.
Vous le voyez, madame la ministre : le Sénat attache beaucoup d’importance à ces questions de circulation et de retour des œuvres lorsque cela apparaît justifié. Il est soucieux, pour autant, de l’authenticité et de la rigueur de la démarche afférente.
C’est la raison pour laquelle notre commission est attachée à la création de cet outil garantissant une pérennité de la réflexion bien au-delà des gouvernements qui passent et des ministres qui changent. Enfin, cela permet d’engager enfin la réflexion vers l’avenir, ainsi que de l’élargir à d’autres continents. C’est l’auteure de la loi de restitution de têtes maories qui vous le dit : quoique nous soyons intimement liés au continent africain, nous avons bien d’autres liens et contacts à travers le monde avec nos anciennes colonies.
Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées des groupes SER, RDPI et Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.

« Objets inanimés, avez-vous donc une âme / Qui s’attache à notre âme et l’oblige d’aimer ? » Ces vers de Lamartine illustrent parfaitement la charge affective pesant, pour des individus ou tout un peuple, sur certains objets.
Qu’est-ce qui arrache un objet à sa banalité pour le hisser au rang d’œuvre d’art ou de bien culturel ? Ce peut être sa dimension esthétique, sa matière, son origine, son secret de fabrication ou simplement son parcours historique l’ayant fait passer dans les mains de telle ou telle personne illustre.
Nous ne pouvons nier l’apport culturel de l’art africain dans l’élaboration de notre propre culture. Il a permis en retour de repérer, et parfois de sauver de la destruction, du vol ou du trafic, certains biens africains, leur conférant ainsi une dimension culturelle qu’ils n’auraient pas eue.
Ce retour participe au rayonnement universel de la culture française. Ce projet de loi concrétise un engagement fort du Président de la République formulé au Burkina Faso en novembre 2017 devant les étudiants de l’université de Ouagadougou : restituer à l’Afrique des biens culturels appartenant à son patrimoine.
Cette démarche s’inscrit plus largement dans le cadre d’une refondation des relations avec nos homologues africains. La coopération culturelle en est un des piliers majeurs. Il s’agit de permettre aux peuples africains d’avoir accès, chez eux, aux œuvres issues de leurs propres cultures et de leur civilisation, alors que 90 % de leur patrimoine se situe aujourd’hui hors du continent africain, essentiellement dans les musées européens.
Cette nouvelle impulsion démontre la volonté de la France d’établir une amitié renouvelée avec ses partenaires africains. Ce projet de loi vise, en outre, à mettre le droit français en conformité avec une politique de restitution réfléchie dans cette perspective. Il entend également autoriser une dérogation limitée au principe général d’inaliénabilité applicable aux collections publiques françaises, afin de laisser sortir ces objets des collections nationales dans le cadre d’un transfert de propriété.
Cette démarche mérite d’être éclairée par un conseil national de réflexion sur la circulation et le retour d’œuvres d’art extra-européennes.
Les précédents notables ont participé à l’affermissement de nos relations bilatérales, à l’instar des restitutions de la dépouille mortelle de la Vénus hottentote à l’Afrique du Sud en 2002 ou du transfert des têtes maories à la Nouvelle-Zélande en 2010.
Pour autant, ce projet ne vise pas à remettre en question ce principe d’inaliénabilité, ni même la vocation universaliste des musées français. Il ne s’agit pas de vider nos collections ; ces restitutions sont limitées à certaines œuvres et doivent le rester. Elles répondent à des demandes précises des pays, et s’effectuent avec des garanties de bonne conservation. En effet, le Sénégal et le Bénin bénéficient d’ores et déjà d’une solide expertise et d’une volonté forte de valoriser leurs collections.
De plus, ces retours sont porteurs d’un message fort à destination de nos homologues africains. Il ne s’agit pas seulement d’un acte de diplomatie culturelle. Ce geste doit permettre de tourner la page de la Françafrique et participer à la construction d’un nouvel imaginaire, loin des souvenirs de nos conflits et de nos traumatismes.
En effet, nous restituons des objets soustraits à leurs pays d’origine sous la colonisation en l’absence de cadre juridique légal. Il est nécessaire de prendre conscience des enjeux mémoriels et d’accéder aux demandes légitimes des peuples africains de reconnexion avec leur patrimoine.
Car ces œuvres sont empreintes d’une forte charge symbolique, spirituelle et historique. Vingt-six œuvres du trésor royal d’Abomey, conservées par le musée du quai Branly-Jacques Chirac à la suite de leur don aux collections nationales par le général Alfred Dodds, seront restituées au Bénin. Elles constitueront les pièces maîtresses du futur complexe muséal d’Abomey, conçu en étroite collaboration avec l’Agence française de développement (AFD), qui viendra renforcer le développement touristique local.
Le sabre dit d’El Hadj Omar Tall, conservé par le musée de l’armée à la suite d’un don du général Louis Archinard, sera restitué au Sénégal. Actuellement prêté au musée des civilisations noires de Dakar, il en constitue déjà une des œuvres majeures.
Enfin, il s’agit d’un acte de confiance à destination de la jeunesse africaine, alors que 70 % de la population a moins de 30 ans. La France sera au rendez-vous pour aider le continent à relever les défis contemporains. Elle l’aidera ainsi à se réapproprier son histoire et à mettre fin à une forme de captation patrimoniale.
Les retours de biens culturels doivent ainsi s’intégrer dans une coopération patrimoniale et muséale étendue. Celle-ci pourrait passer par le déploiement de l’expertise de l’Agence France-Museums dans les pays africains ou le renforcement de la formation de leurs conservateurs et de leurs restaurateurs d’œuvres d’art.
Ce travail devra trouver un équilibre entre l’exigence de préservation du patrimoine présent dans les musées français et une circulation renforcée des œuvres par l’intermédiaire de restitutions, de retours ou de prêts, car les biens culturels universels n’ont pas de frontières puisqu’il s’agit du patrimoine commun de l’humanité.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le 9 thermidor de l’an VI de la République, sur le Champ de Mars à Paris, s’ébranla le long convoi des œuvres d’art spoliées par Napoléon lors de sa campagne d’Italie. Dans l’un des nombreux charriots se trouvaient les chevaux de cuivre de la basilique Saint-Marc de Venise. Ces statues auraient été fondues au IVe siècle avant notre ère, dans une île grecque du Dodécanèse, puis installées sur la spina de l’hippodrome de Constantinople et, enfin, disposées, en 1204, par les Vénitiens, sur la porte principale de la basilique Saint-Marc.
Après leur transport à Paris, Napoléon les plaça au sommet de l’arc de triomphe du Carrousel, mais elles furent rendues à Venise par l’Autriche après la chute de l’Empire. Avec elles, les chars transportaient aussi plus de cinq cents tableaux de maîtres. La moitié d’entre eux fut restituée, mais l’autre resta en France pour constituer le cœur des collections du Louvre.
Ainsi va la vie des œuvres, qui passent de main en main et de pays en pays au gré du pouvoir des princes, de la fortune de la guerre et des alliances des États.

Celles qui font l’objet du présent projet de loi auraient pu s’inscrire dans cette histoire tumultueuse, mais les circonstances particulières de la conquête militaire de l’Afrique de l’Ouest font de cette restitution une péripétie supplémentaire de notre relation complexe avec notre histoire coloniale.
Par ailleurs, le choix de ces biens culturels, les formes de l’instruction des demandes par les services du ministère de la culture et du musée de l’Armée, les conditions de leur transport et de leur présentation au Bénin et au Sénégal posent de nombreuses questions. Enfin, nous ne comprenons pas comment ces dossiers ont pu, au plus haut niveau, être gérés dans l’ignorance presque totale de l’expérience acquise lors de la restitution des têtes maories et des initiatives fortes défendues par notre collègue la sénatrice Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture du Sénat.
Le 25 septembre 2007, à cette même tribune, à l’occasion du débat sur les accords passés entre la France et les Émirats arabes unis relatifs au musée universel d’Abou Dabi, Mme Rama Yade, alors secrétaire d’État chargée des affaires étrangères et des droits de l’homme, avait déclaré :…

… « Dans ce contexte de mondialisation, le Louvre Abou Dabi constitue un formidable vecteur de rayonnement de l’universalité de la culture et un défi que la France, au nom de la diversité culturelle et du rapprochement des civilisations, se devait de relever. »
Dans ce cadre, les musées français ont apporté leur expertise en matière de conception du bâtiment, de gestion des collections et prêté trois cents œuvres. La réussite actuelle de cette institution doit beaucoup à cet investissement majeur et à la qualité du partenariat entre les deux pays. Il est vrai que cet échange a été accompagné par une généreuse participation des Émirats arabes unis de presque un milliard d’euros. L’humanisme n’a pas de prix !
Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.

Le 28 novembre 2017, devant les étudiants de l’université de Ouagadougou, le Président de la République, Emmanuel Macron, avait rappelé que, pour lui, « les crimes de la colonisation européenne sont incontestables et font partie de notre histoire ».
M. François Bonhomme s ’ exclame.

Partant de ce constat, il concluait à la nécessité de renouveler le dialogue franco-africain pas la construction d’un projet commun. Il considérait, à raison, que la culture devait en constituer un chapitre essentiel et souhaitait que les restitutions du patrimoine africain s’organisassent rapidement dans ce cadre.
Sourires.

La forme juridique adaptée de ce partenariat aurait dû être, à l’imitation des accords pour le Louvre d’Abou Dabi, un traité international. Le Conseil d’État, dans son avis, a considéré que, dans le cadre de l’article 53 de la Constitution, le transfert de propriété aurait pu être organisé par un accord international.
Ce traité aurait eu l’avantage de préciser les engagements de la France, au titre de l’aide au développement, pour le financement du transport des œuvres, la construction des installations qui vont les accueillir et l’instauration des échanges indispensables entre les institutions patrimoniales des pays. Il aurait pu aussi organiser le prêt aux musées africains d’œuvres symboliques du patrimoine français.
Défendre l’universalité de l’art exige de notre pays des actions volontaires afin de faciliter la circulation des œuvres par un double processus de reconnaissance. Aimé Césaire disait : « Il y a deux manières de se perdre : par ségrégation murée dans le particulier ou par dilution dans l’“universel”. Ma conception de l’universel est celle d’un universel riche de tout le particulier, riche de tous les particuliers, approfondissement et coexistence de tous les particuliers. »
Je regrette vivement que les présentes restitutions n’aient pas porté cette double ambition.
Applaudissements sur les travées des groupes CRCE et SER, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.

La parole est à Mme Claudine Lepage. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en tant que sénatrice des Français établis hors de France j’ai eu souvent l’occasion et la chance de me rendre en Afrique, notamment au Bénin et au Sénégal. La question de la restitution des biens culturels y a régulièrement été évoquée par mes interlocuteurs, notamment par Marie-Cécile Zinsou, qui a d’ailleurs été entendue dans le cadre de nos travaux préparatoires.
Si ces restitutions font suite à la volonté du Président de la République d’œuvrer au retour du patrimoine africain en Afrique et à son discours prononcé à Ouagadougou en 2017, elles trouvent également leur origine dans la volonté des États africains de voir revenir sur leur sol les biens culturels dont ils ont été dépossédés pendant la colonisation.
Cette demande est fortement appuyée par la société civile africaine et par de nombreuses associations. Ce projet de loi, au-delà du discours du Président de la République, est la réponse à une demande ancienne et forte dont je regrette qu’elle n’ait pas été entendue plus tôt.
Précisons d’emblée que cette demande ne concerne pas tous les biens culturels issus du patrimoine africain présents sur notre territoire, notamment au quai Branly, mais uniquement ceux provenant de prises de guerre.
Il s’agit plus précisément de vingt-six objets béninois, issus du palais des rois d’Abomey, qui ont été saisis en 1892 par le général Dodds, commandant des armées coloniales françaises, dans le cadre de la guerre du Dahomey, et du sabre attribué à El Hadj Omar Tall, qui aurait été confisqué par le général Archinard après la prise de Bandiagara en 1893.
Cette demande limitée n’est donc pas de nature à remettre en cause le caractère inaliénable des collections auquel nous sommes tous attachés.
L’Afrique est un continent jeune – on considère que 19 ans y est aujourd’hui l’âge médian –, qui connaîtra, dans les décennies à venir, une croissance démographique spectaculaire.
Ces restitutions peuvent jouer un rôle majeur pour permettre à cette jeunesse de retisser le lien avec son histoire et de renforcer son identité. Pour que ces futures générations construisent leur avenir, il est vital qu’elles puissent accéder à leur histoire et s’inspirer des générations précédentes. Car, comme le disait justement Aimé Césaire, « un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir ».
Au-delà de l’aspect historique, n’oublions pas les enjeux de mémoire qui se jouent également ici et qui sont vitaux dans la construction et l’avenir de nos sociétés. Dans les discussions que j’ai pu avoir lors de mes déplacements en Afrique, il était souvent question de fierté ou de dignité retrouvée lorsqu’était évoqué le retour de biens culturels sur le sol africain.
Ces restitutions sont également rendues nécessaire par le fait que les collaborations, dépôts ou prêts entre musées, bien que précieux, ne sont aujourd’hui pas toujours suffisants, car ils ne répondent plus aux demandes de la société africaine. Il en était ainsi, en 2006, lors de l’exposition de la fondation Zinsou, à Cotonou, consacrée au roi Béhanzin et organisée à la demande du musée du quai Branly. Cette exposition avait attiré 275 000 personnes en trois mois, et nombre de Béninois n’avaient pas compris pourquoi les objets de leur patrimoine devaient retourner en France à la fin de l’exposition.
Outre son aspect éthique, à mes yeux, la restitution à ces pays de biens culturels – revêtant parfois une dimension spirituelle – dont ils ont été dépossédés contribuera à refonder notre relation et notre partenariat avec eux. Le retour des vingt-six pièces du trésor de Béhanzin, provenant du pillage du Palais d’Abomey en 1892, et du sabre d’El Hadj Omar Tall offre ainsi la possibilité d’ouvrir un nouveau chapitre de notre diplomatie culturelle avec l’Afrique. À l’inverse, une fin de non-recevoir aurait des conséquences désastreuses et nuirait fortement aux relations franco-africaines.
Les inquiétudes que l’on peut entendre concernant la conservation et la présentation au public de ces biens seront, je n’en doute pas, levées grâce au renforcement de la coopération culturelle franco-béninoise, à la coopération muséale, à la formation de conservateurs de musée, à l’échange d’experts et à un programme de travail commun. Il convient de tout entreprendre pour que ces biens continuent, à l’avenir, d’être présentés au public dans des lieux adaptés.
Un dernier point peu évoqué dans nos travaux est la nécessaire pédagogie que nous devons mener, notamment auprès de nos compatriotes, pour leur expliquer pourquoi ces objets qui étaient jusqu’à présent exposés dans nos musées sont restitués à des pays africains. Je crains que, sans explication et sans démarche historique accompagnant ces restitutions, ces dernières puissent être mal comprises par notre population fortement attachée à l’histoire et aux enjeux qu’elle peut représenter.
En conclusion, ce projet de loi, qui est un geste fort et symbolique, mais de portée limitée sur le plan législatif, pose naturellement la question de l’après. N’en doutons pas, mes chers collègues, d’autres États africains souhaiteront à l’avenir récupérer des biens culturels appartenant à leur histoire.
Cette démarche s’inscrit dans un mouvement global qui affecte l’histoire et la mémoire. M. Emmanuel Kasarherou, président du musée du quai Branly-Jacques Chirac, l’indiquait justement devant notre commission : « La question des restitutions a mis au premier plan celle des provenances, un questionnement prégnant dans notre siècle, mais qui ne l’était pas dans le précédent : la façon dont les objets sont passés de main en main n’intéressait guère, c’est désormais une préoccupation importante. »
Quel procédé législatif devrons-nous adopter à l’avenir ? Devrons-nous, chaque fois, passer par un dispositif dérogatoire au droit commun ou, à l’inverse, disposerons-nous d’une loi-cadre qui permettrait, peut-être, une procédure plus claire et plus lisible et dans laquelle pourrait être indiqué que seuls des objets acquis par la violence et la contrainte peuvent être concernés par une éventuelle restitution.
Applaudissements sur les travées du groupe SER et sur des travées du groupe RDPI.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, permettez-moi tout d’abord d’avoir une pensée amicale pour notre ancien collègue Alain Schmitz qui s’était impliqué, avec l’intelligence fine qu’on lui connaît, dans cette complexe question des restitutions.
Permettez-moi également de saluer la qualité des apports et des travaux de Catherine Morin-Desailly, notre rapporteure depuis plusieurs années, qui s’est forgée sur ce sujet sensible, un point de vue que je partage pleinement.
Avec raison, elle appelle depuis longtemps à fixer une méthode là où prévaut, jusqu’à ce jour, une approche trop strictement politique répondant aux seules exigences des relations diplomatiques du moment. Sur un dossier de cette nature, il aurait été bien utile que Catherine Morin-Desailly soit davantage entendue et que le Gouvernement esquisse une méthode fondée sur quelques principes.
Le premier d’entre eux serait d’appréhender la question en se départant d’une approche exclusivement morale, fondée sur une vision du bien et du mal dont on sait qu’elle est variable avec le temps et les peuples.
Ainsi, la restitution de vingt-six objets au Bénin que prévoit ce projet de loi peut, bien entendu, être saluée comme le retour du trésor d’Abomey dans l’ancien royaume du roi Béhanzin. Mais il aurait également pu être vu comme le retour des symboles de l’oppression de l’ethnie fon sur ses esclaves yorubas, après la chute et le pillage de Kétou en 1886. Je ne suis pas certain que les descendants des Yorubas soient si heureux que cela de les voir réinstaller dans le palais de leurs anciens maîtres. « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. »
Le deuxième principe serait de recueillir, avant toute décision politique, l’avis des experts, qu’ils soient conservateurs, archéologues, historiens ou ethnologues. Cela aurait évité, dans l’affaire qui nous préoccupe, d’attribuer à un sabre une valeur et une symbolique qu’il n’a peut-être pas et à celui qui est censé l’avoir porté, une aura qu’il ne mérite certainement pas. Les travaux de Francis Simonis ou Bertrand Goy sur le sabre d’El Hadj Omar Tall n’ont-ils pas montré que la légende de ce sabre fut surtout forgée par le général Louis Archinard pour glorifier son expédition ?
Le troisième principe consisterait à trouver le juste équilibre avant toute décision entre ce qui est moral aujourd’hui, ce qui était légal hier et ce qui répond à l’impératif permanent de contextualisation historique. En ce qui concerne la légalité, il y a matière à discussion puisqu’une grande partie des collections venues d’Afrique, exposées aujourd’hui dans nos musées, répond parfaitement à la légalité de l’époque. Comme chacun sait, la pratique des butins de guerre n’a été déclarée illégale qu’en 1899 par la convention de La Haye. Elle était jusqu’alors le fait des vainqueurs, et l’empire toucouleur y eut recours tout autant que les autres.
Soyons clairs : je souscris à la nécessité de renforcer la circulation des œuvres et l’accessibilité du patrimoine sur sa terre d’origine. Pour autant, j’en appelle à la définition d’une méthode devant répondre à quelques questions. Comment éclairer le politique, sur lequel repose aujourd’hui le processus de restitution, afin d’éviter qu’il ne s’apparente au fait du prince ? Comment faire en sorte que le ministère de la culture et les conservateurs jouent pleinement leur rôle dans ce processus pour éviter que des atteintes fondamentales ne puissent être portées aux principes mêmes qui sont au cœur de notre politique muséale ?
C’est important, car aujourd’hui ce sont les propositions du rapport Sarr-Savoy qui font foi pour nos interlocuteurs. C’est sur ses inventaires, en dépit de leurs inexactitudes, qu’ils s’appuient pour formuler leurs requêtes.
Si le dernier mot doit revenir au politique, cela ne doit être qu’en vertu d’une décision éclairée par des avis étayés et non pour répondre à je ne sais quelle tyrannie de l’instant, aux seules raisons d’une diplomatie du soft power ou pour donner des gages à telle ou telle approche mémorielle, pour ne pas dire communautaire.
Ce serait jeter par-dessus bord les principes multiséculaires forgés précisément pour que le patrimoine de la Nation ne soit jamais soumis aux humeurs du prince de l’instant. Tenons donc compte de ce sage précepte scellé sous le règne de Charles IX, sur l’initiative du chancelier Michel de L’Hospital.
Il est certes difficile d’élaborer une loi-cadre posant des critères précis qui ne soient ni trop larges, au risque d’être contraires à la Constitution, ni trop rigides, au risque d’empêcher des restitutions qui paraîtraient opportunes. Des solutions permettant de protéger l’inaliénabilité des collections publiques et la vision universaliste de nos musées, tout en ne fermant pas la porte à un dialogue des cultures, doivent pourtant être trouvées au plus vite, car le risque est grand que nous ne soyons de plus en plus fréquemment bousculés par des demandes de plus en plus nombreuses.
Or votre projet de loi n’esquisse aucune doctrine en matière de transferts de biens culturels, de circulation des collections et de leur monstration au public.

Nous avons pourtant besoin d’une méthode et il nous faut l’inventer.
Oui, ce projet de loi aurait gagné à fixer une doctrine et sa méthode. Il se limite à l’exécution d’une décision présidentielle. Il n’en provoque pas moins un réel et profond malaise à plusieurs égards.
Tout d’abord, j’évoquerai la manière de procéder des auteurs du rapport Sarr-Savoy, qui n’ont pas jugé bon d’auditionner la présidente de la commission de la culture du Sénat, alors qu’ils ont pris le temps de rencontrer son homologue de l’Assemblée nationale. Permettez-moi donc de douter de la qualité de leur démarche, très certainement militante et assurément peu scientifique.
Deuxième cause de malaise, le sabre El Hadj Omar Tall est déjà au Sénégal, où il é été remis en grande pompe par l’ancien Premier ministre au président Macky Sall.
Ce malaise est renforcé par la mise en extinction de la Commission scientifique nationale des collections, chère à Philippe Richert et à Catherine Morin-Desailly. Notre pays avait pourtant là l’outil pour s’emparer du sujet et y réfléchir de manière scientifique. Hélas, rien n’a été fait pour faciliter le travail de cette commission. C’est ce qui nous conduit aujourd’hui à nous retrouver dans une position défensive.
Le malaise nous gagne encore davantage quand vous nous dites que le caractère inaliénable des collections est maintenu. Mais, madame la ministre, cette loi d’exception étant fondée, sinon sur le fait du prince, du moins sur la raison d’État, elle en appellera d’autres au rythme des demandes qui vont se multiplier !
La loi n’est pas encore votée que le président du Bénin, Patrice Talon, se dit « insatisfait ». Déjà cinq pays africains frappent à la porte et demandent le retour de 13 000 objets.

Qu’en sera-t-il demain des demandes venues d’Asie et pourquoi pas d’Amérique latine et d’Océanie ?

Cette crainte est d’autant plus fondée que le chef de l’État, dans son discours de Ouagadougou, déclarait : « Le meilleur hommage que je peux rendre non seulement à ces artistes, mais à ces Africains ou ces Européens qui se sont battus pour sauvegarder ces œuvres, c’est de tout faire pour qu’elles reviennent. »
Votre projet de loi sera donc suivi d’autres, et comporte un risque sérieux d’atteinte à la cohérence des collections de nos musées, constituées au fil des siècles, et par là même à leur vision universaliste, fondée sur la mise en valeur du génie humain, d’où qu’il vienne.
Oui, madame la ministre, je crois primordial d’ancrer à nouveau le caractère inaliénable de nos collections comme principe fondateur de l’universalité de nos musées, sauf à ouvrir la porte à un engrenage dont on ne sait où il s’arrêtera. Après tout, le retrait de la collection Dodds, général africain de l’armée française, n’est-il pas déjà une damnatio memoriae ?
Dernière cause de malaise, l’utilisation du terme « restitution » laisse germer l’idée qu’il s’agit d’un retour de biens possédés indûment et, par là même, que la France s’est rendue coupable par la possession de ces œuvres. Or ce sont des artistes français, épris d’art moderne et sensibles au génie humain, qui, voilà un peu plus d’un siècle – presque un siècle et demi –, érigèrent ces objets, jusque-là objets cultuels ou de la vie quotidienne, en œuvres d’art pour ensuite les muséifier pour partie en Europe, mais aussi en Afrique.
Je vous encourage donc, mes chers collègues, à adopter l’amendement que j’ai déposé avec Bruno Retailleau pour changer l’intitulé de cette proposition de loi en l’expurgeant du mot « restitution », qui sous-entend que notre pays aurait à expier je ne sais quelle faute morale.
Mes chers collègues, j’entends bien la demande des pays africains, je ne la conteste pas. Mais je suis profondément mal à l’aise quant à la manière dont le Gouvernement entend y répondre, en cédant à une vision moralisatrice de notre histoire et en sacrifiant les principes qui participent de la grandeur de notre pays, au premier chef ceux de l’universalisme, fondateur même de notre conception de la citoyenneté.
J’aurais tellement préféré que nous restions fidèles à l’héritage du président Jacques Chirac. Il était l’artisan infatigable d’une politique culturelle moins ethnocentrée, le fondateur du musée du quai Branly, dont la raison d’être, comme cela est inscrit dans sa charte, est le dialogue des cultures. Et s’il a offert le sceau du dey d’Alger au peuple algérien, c’est en le faisant acquérir par la France lors d’une vente aux enchères, et non en le faisant disparaître de nos collections nationales. Il est bien dommage que la France ne se soit pas dotée, dans son sillage, d’une vraie politique d’échanges et de circulation et d’une solide réflexion sur le sujet.
Ce défaut de réflexion anticipée peut surprendre, tant la prégnance de la question est une évidence. Catherine Morin-Desailly nous a proposé, en commission, un amendement tendant à instaurer un conseil destiné à statuer sur les restitutions, une ébauche de régulation allant dans le bon sens. Elle esquisse une méthode, un cadre, une vision appelés par notre groupe.
C’est la raison pour laquelle nous suivrons les préconisations de la rapporteure. Le groupe Les Républicains soutiendra ce projet de loi parce qu’il a été amendé en commission et que, désormais, il fixe pour l’avenir des procédures indispensables à la protection de nos collections et à l’universalité de nos musées.
Nous voterons donc le texte issu de la commission, mais resterons très vigilants quant à la suite de la procédure parlementaire. Il y va de l’avenir de nos collections, de la préservation de notre patrimoine, de l’intégrité de notre histoire !
C’est aussi, madame la ministre, pour que nous restions fidèles à votre prestigieux prédécesseur, André Malraux qui, justement, nous rappelait : « L’œuvre surgit dans son temps et de son temps, mais elle devient œuvre d’art par ce qui lui échappe. »

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le Président de la République a annoncé voilà trois ans, lors de son discours à l’université de Ouagadougou, vouloir restituer de façon temporaire ou définitive les œuvres d’art africain des collections publiques françaises aux pays africains dont sont issues ces œuvres.
Dans cette perspective, il a confié à deux chercheurs, Felwine Sarr et Bénédicte Savoy, le soin de réaliser un rapport sur la restitution du patrimoine africain.
Ce rapport se présente comme un plaidoyer en faveur d’une restitution massive, au nom de la repentance politique, du patrimoine africain présent dans les collections publiques françaises. Sont visées les œuvres acquises « en l’absence de consentement des populations locales », par « la violence ou la ruse ou dans des conditions iniques ». Le rapport prévoit également la restitution des pièces saisies lors de conquêtes militaires, collectées lors de missions scientifiques ou par des agents de l’administration coloniale, ainsi que le retour des œuvres issues du trafic illégal après 1960.
La France détient près de 90 000 œuvres d’art africain dans ses collections publiques, dont les deux tiers au sein des collections du musée du quai Branly. La remise du rapport au Président de la République, le 23 novembre 2018, a été l’occasion pour ce dernier d’annoncer la restitution de vingt-six œuvres conservées actuellement au musée du quai Branly – statues de l’homme requin ou du roi Ghézo notamment – et réclamées depuis 2016 par la République du Bénin. Il s’agit du trésor de Béhanzin saisi comme butin de guerre en 1892, lors de la prise du palais d’Abomey par les troupes du général Dodds.
De la même façon, le 17 novembre 2019, Édouard Philippe s’est engagé à restituer au Sénégal le sabre d’El Hadj Omar, fondateur de l’empire toucouleur et guide spirituel de la plus grande confrérie soufie du Sénégal, tiré des collections du musée de l’Armée, mais déjà confié au musée de Dakar pour une durée de cinq ans.
Si le texte présenté replace sur le devant de la scène la difficile question de la restitution des œuvres d’art africain, de nombreux conservateurs dénoncent la position manichéenne des auteurs du rapport susmentionné, arguant que « les musées ne doivent pas être otages de l’histoire douloureuse du colonialisme ». Ils s’alarment du préjudice pour les collections publiques, vitrine de l’art africain en Europe.
Les risques liés à de mauvaises conditions de conservation sont bien réels, tout comme les risques de vol et de malversation dans des sociétés marquées par une forte corruption et une faible implication des autorités publiques dans les politiques patrimoniales.
L’artiste Romuald Hazoumè dénonçait en 2016 une « culture béninoise à l’abandon », le délabrement des musées de son pays, les nombreux vols subis. Il qualifiait la restitution du trésor royal de fausse bonne idée, dans la mesure où le pays n’aurait pas les moyens ni la volonté de protéger et valoriser ces œuvres.
À l’image du grand sabre sacré, volé en 2001 au sein même du palais royal d’Abomey, les vols, incendies et l’absence de qualification du personnel rendent les conditions d’accueil des œuvres actuellement conservées au musée du quai Branly difficiles. Le financement d’une autre structure, le musée de l’épopée des amazones et des rois du Dahomey, par un prêt de 12 millions d’euros de l’AFD devrait permettre de remédier à ce problème.
Pour autant, la dimension symbolique de réparation mémorielle et de réappropriation patrimoniale que revêtent ces restitutions est indéniable, sans oublier leur dimension économique d’attractivité touristique. Il apparaît légitime de favoriser l’accès au patrimoine historique et culturel de la jeunesse africaine, source d’inspiration pour la création et de compréhension de son héritage culturel.
Soutenant ce projet de loi, le groupe Les Indépendants considère aussi que de nouvelles formes de partenariat sont à imaginer. De nombreuses combinaisons sont possibles en matière d’engagements mutuels sur la formation des conservateurs, ou encore sur la valorisation et la protection d’œuvres d’art qui, bien qu’issues d’un pays, d’une région, d’un peuple, représentent une richesse culturelle au rayonnement plus vaste, à la résonance internationale, qui appartient à l’humanité dans son ensemble.
Les musées du monde entier témoignent de l’universalité de l’art, dont le propre est bien de dépasser les langues, les civilisations, les frontières, et de rapprocher les peuples.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons aujourd’hui est fondé sur un principe de justice, celui de rendre à deux pays, le Bénin et le Sénégal, des biens culturels appartenant pleinement à leur histoire.
Le trésor de Béhanzin, nommé d’après Béhanzin Ier, dernier roi du Dahomey, présente le dernier ensemble de pièces régaliennes de l’empire désormais disparu. Saisi en 1892 et rapporté en France par le général Alfred Amédée Dodds, ce trésor est un symbole important pour le Bénin, un vestige ultime d’une aire d’indépendance et de prospérité.
Le sabre d’Omar Seydou Tall, dit El Hadj Omar, est nommé d’après le nom de son propriétaire. Chef spirituel soufi, érudit musulman et fondateur de l’empire toucouleur, ce dernier régna sur des territoires situés aujourd’hui au Sénégal, en Guinée et au Mali, vers les années 1850. Saisi en avril 1893 par les troupes du colonel Louis Archinard, cet objet représente, lui aussi, l’un des vestiges du pouvoir en place avant l’établissement de l’Afrique occidentale française.
Ces deux objets sont donc des prises de guerre, des biens acquis dans la violence d’une époque de conquêtes coloniales qu’il nous faut aujourd’hui regarder avec lucidité.
Les demandes de restitution du Bénin et du Sénégal sont donc tout à fait légitimes, et c’est en se fondant sur cette légitimité que le Gouvernement nous propose ce projet de loi.
Celui-ci fait également écho à un engagement du Président de la République, pris le 28 novembre 2017 devant les étudiants de l’université de Ouagadougou, et qui a suscité de grands espoirs au sein de la jeunesse africaine.
Affirmons-le ici sans détour, notre groupe est favorable à ces restitutions, qui sont des témoignages de l’humanisme devant animer notre politique de coopération culturelle. En revanche, nous estimons qu’il faut sortir aujourd’hui de la logique de ces lois d’exception, obligeant le législateur à examiner chaque restitution dans un texte spécifique.
Cette législation au cas par cas s’explique, bien entendu, par le principe d’inaliénabilité, lequel affirme que les biens appartenant aux collections publiques françaises ne peuvent être vendus ou cédés, mais elle freine cette amorce de politique de coopération culturelle volontariste.
Les écologistes sont évidemment attachés au caractère inaliénable des collections publiques, qui garantit l’unité du patrimoine culturel au bénéfice de toute la Nation. C’est dans le respect de ce principe que nous souhaitons travailler à une évolution du cadre législatif.
D’où, mes chers collègues, l’amendement que nous souhaitions soumettre à votre vote, visant à confier au conseil national de réflexion créé par notre commission la tâche de réfléchir à un dispositif législatif durable pour sortir de cette politique d’exception permanente, dont personne ne peut se satisfaire. Malheureusement, cet amendement ne sera pas examiné, ayant été déclaré irrecevable.
Nous estimons toutefois que nous ne pourrons nous affranchir de cette réflexion essentielle. En effet, le Bénin et le Sénégal ne seront pas les seuls pays à avoir des demandes légitimes. Mali, Cameroun, Nigeria, Éthiopie, Tchad : plusieurs pays ont déjà fait des demandes, portant parfois sur des milliers d’objets ou de biens.
Avec une politique de coopération culturelle enrichie d’un cadre législatif pérenne, nous pourrons durablement regarder notre passé en face, avec honnêteté, et renforcer nos liens avec de nombreux pays. Il s’agit non pas de repentance, mais simplement de justice !
Nous sommes conscients de toutes les questions soulevées et, comme vous l’indiquiez ce matin, madame la rapporteure, nous sommes encore très loin d’y répondre. Mais, de nouveau, mes chers collègues, nous ne pouvons faire l’économie d’un cadre pérenne permettant de sortir de ces lois d’exception, qui contournent de façon hypocrite notre principe d’inaliénabilité des œuvres.
Madame la ministre, mes chers collègues, le groupe écologiste votera ce projet de loi, qui va dans le bon sens, tout en appelant à une réflexion plus globale sur l’évolution de notre législation, pour plus d’efficacité et de justice dans notre politique de coopération culturelle.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ce projet de loi prévoit le retour au Bénin, leur terre d’origine, de vingt-six objets du palais de Béhanzin conservés au musée du quai Branly et la restitution au Sénégal d’un sabre et de son fourreau attribués à El Hadj Omar Tall, chef toucouleur.
Il fait suite à une demande expresse de ces deux États.
Il ne met pas fin au caractère inaliénable de nos collections publiques. Il témoigne d’une exigence de vérité, d’un souhait commun d’apaiser des conflits de mémoire, d’une confiance en un partenariat équilibré.
Il faut se réjouir de cette coopération !
Ce projet de loi concrétise un engagement fort du Président de la République, prononcé en novembre 2017 devant les étudiants de l’université de Ouagadougou.
Plus de la moitié de la population africaine a aujourd’hui moins de 25 ans. Dans mon département d’outre-mer, entre côtes africaines et Madagascar, la croissance de la démographie est sept fois plus forte que la moyenne nationale et les moins de 18 ans sont majoritaires. C’est une grande chance, mais aussi un lourd défi, pour Mayotte comme pour l’Afrique. Et nous savons l’importance, pour la construction harmonieuse de tous ces jeunes, de la connaissance de leur propre histoire.
Peu de jeunes Sénégalais ou Béninois ont les moyens de voyager, de venir en France pour voir ces objets. Les restitutions – nous aurons le débat sur la question de savoir s’il faut maintenir ce terme ou lui préférer ceux de « retours » ou « transferts » – leur permettront d’accéder chez eux à des œuvres de leur culture, de leur civilisation et de se les approprier.
Ces œuvres ont une forte portée symbolique. Apportées en France lors de l’expansion coloniale comme des objets de curiosité exotique, elles avaient d’abord, pour la plupart, une fonction spirituelle. Témoins d’un passé prospère, elles participent à un sentiment de fierté, de confiance en soi de populations trop souvent dépouillées de leur histoire.
Il est donc important qu’elles soient exposées à tous – le Bénin et le Sénégal s’y sont engagés – et présentent des garanties de bonne conservation, dans le cadre d’une coopération repensée. La réalisation concrète du nouveau musée d’Abomey s’inscrira dans cette vision.
Ces biens, revenus à leur terre originelle, ne seront certes plus notre propriété, mais ils resteront toujours porteurs d’universel, parce qu’issus du génie humain.
Nous restons vraiment, avec ce texte, dans le domaine de l’exception. C’est pourquoi la création d’un comité chargé d’émettre un avis sur les restitutions, décidée par notre commission, ne me semble pas opportune. Nos musées nationaux resteront, avec leurs collections, des vecteurs de connaissance de l’autre et d’histoire partagée. Prêts et expositions temporaires doivent se multiplier afin de profiter au plus grand nombre.
Certes, on peut croire que des demandes de restitution, limitées jusqu’à présent, se feront plus nombreuses et pourront sembler tout aussi légitimes.
Mais ce sera à la France de décider, au cas par cas, en fonction d’ailleurs des terres de conflits, hélas propices aux destructions et aux pillages. Les équipes de scientifiques spécialistes des œuvres demandées éclaireront le choix du Gouvernement et il nous reviendra, à nous, parlementaires, la décision de l’approuver, ou non, au cas par cas.
Le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants votera ce projet de loi.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi qui nous réunit ce jour vise à sortir des collections nationales vingt-sept biens culturels, afin d’ouvrir la voie à leur restitution à deux pays africains, le Bénin et le Sénégal.
Il concerne, en son article 1er, le trésor de Béhanzin, vingt-six œuvres conservées au musée du quai Branly-Jacques Chirac et revendiquées par la République du Bénin depuis septembre 2016 et, en son article 2, le sabre, attribué à El Hadj Omar Tall, inscrit à l’inventaire des collections du musée de l’Armée, officiellement réclamé par le Sénégal depuis juillet 2019 et exposé au musée des civilisations noires de Dakar depuis son inauguration en décembre 2018, dans le cadre d’une convention de dépôt entre la France et le Sénégal.
L’ensemble de ces œuvres constitue des prises de guerre. Les vingt-six objets béninois, issus du palais des rois d’Abomey, ont été emportés en 1892 par le général Dodds, commandant des armées coloniales françaises, dans le cadre de la guerre du Dahomey qui l’opposait au roi Béhanzin. Le sabre attribué à El Hadj Omar Tall aurait, quant à lui, été confisqué à Ahmadou Tall, son fils, par le général Archinard après la prise de Bandiagara en 1893.
Ce texte est une nouvelle étape au sein d’une réflexion de plus grande ampleur : d’une part, celle du Président de la République, Emmanuel Macron, relative au patrimoine africain présent en France et, d’autre part, celle qui est liée à l’universalisme culturel, voulant que les œuvres culturelles appartiennent, au-delà des frontières des pays d’origine ou d’accueil, au patrimoine de l’humanité.
Lors de la remise du rapport Savoy-Sarr en novembre 2018, le Président de la République a annoncé cette nouvelle étape, qui nous réunit aujourd’hui : la restitution au Bénin des vingt-six œuvres ayant appartenu aux rois d’Abomey et le sabre attribué à El Hadj Omar Tall au Sénégal.
Le retour de ces objets tend à atteindre un double objectif : le premier est de permettre à la jeunesse, mais aussi à l’ensemble de la population africaine d’avoir accès en Afrique à son propre patrimoine ; le second est de consolider le partenariat, ici dans sa dimension culturelle, entre la France et le continent africain – il s’agit donc d’un objectif diplomatique et de coopération.
Le groupe Union Centriste est favorable à ces motifs, mais cet accord de fond ne doit pas occulter les réserves sur la forme et la méthode que nous souhaitons émettre.
La première réserve est liée au fait que notre intervention ici, en tant que législateurs, est aujourd’hui moins démocratiquement souhaitée que juridiquement requise.
Les objets concernés sont des prises de guerre, non des biens volés. Ils n’entrent donc pas dans le champ d’application de la convention de l’Unesco de 1970. Dès lors, c’est le droit français qui s’applique.
Dans ce cadre, un principe prévaut : celui de l’inaliénabilité des collections publiques, consacré par la loi et s’opposant à ce que la propriété d’un bien conservé dans les collections publiques puisse être transférée. Le législateur doit donc intervenir pour poser des exceptions : c’est la raison de ce texte.
Le principe de la restitution des œuvres béninoises a été acté par le Président de la République en novembre 2018. Le sabre, lui, a d’ores et déjà été restitué au Sénégal, le prêt n’étant qu’une sorte d’étape transitoire « en attendant » que le Parlement français ne valide la décision gouvernementale.
Ainsi, ce projet de loi entérine une décision présidentielle, alors même que le principe législatif d’inaliénabilité est inscrit dans la loi pour éviter dans ce domaine le « fait du prince », même si, ici, je le souligne, les raisons sont tout à fait acceptables.
On demande au Parlement de consacrer en droit ce qui est d’ores et déjà acté en fait. Ce n’est pas cela le rôle du Parlement !
La deuxième réserve que le groupe Union Centriste souhaite émettre s’inscrit dans une réflexion plus générale, qui aurait dû et doit être engagée à propos de ce patrimoine.
Lors de l’examen en 2009 de la proposition de loi, déposée par ma collègue Catherine Morin-Desailly, visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections, le ministre de la culture de l’époque, Frédéric Mitterrand, s’était exprimé en ces termes au sujet de l’initiative parlementaire : « Elle marque surtout l’ouverture, trop longtemps retardée à mes yeux, d’un véritable débat de fond sur le recours au déclassement, en donnant aux collectivités publiques les moyens de disposer en la matière d’une doctrine définie en parfaite concertation. » Tout est dit !
Plus d’une décennie et deux mandatures présidentielles plus tard, d’aucuns pourront constater que ce véritable débat de fond sur la nécessité d’établir une doctrine a malheureusement peu avancé. Je dis « malheureusement », parce que, citant de nouveau le ministre en 2009, « la question qui nous est posée à l’occasion de l’examen de la présente proposition de loi est de celles qui attisent la controverse, les prises de position morales ». Cela aurait effectivement mérité que les gouvernements s’en saisissent alors.
C’est précisément pour éviter controverses et procès que la Commission scientifique nationale des collections a été créée en 2010. Elle devait permettre à la France d’engager une réflexion prospective.
Faute pour le ministère d’avoir donné à cet organe les moyens de réussir, la France se trouve désormais dans une démarche sujette à la critique, défensive et casuistique. Coup de grâce, la loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) l’a tout simplement supprimé.
En l’absence de doctrine et de critères au sujet du retour des œuvres, nous sommes en effet contraints de n’avancer que par lois spécifiques portant exception au principe d’inaliénabilité. Eu égard aux dizaines de milliers d’œuvres qui sont et seront réclamées par les États, et dans une démarche proactive que commande la restitution de biens mal acquis, nous ne pouvons raisonnablement pas considérer que les lois d’exception itératives soient satisfaisantes.
Madame la rapporteure a donc justement, et nous l’en remercions, présenté à la commission un amendement visant à créer un Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour d’œuvres d’art extra-occidentales.
Il aura pour objectif d’apporter aux pouvoirs publics un éclairage scientifique dans leur prise de décision en la matière ; d’encourager notre pays et, en particulier, le monde muséal à approfondir sa réflexion sur ces questions qui ont vocation à rebondir dans les années à venir, afin de ne pas prendre les décisions au fur et à mesure, et d’anticiper ; de contenir dans le futur le risque de décisions conjoncturelles, aussi versatiles que l’actualité et l’opinion de l’instant ou les orientations politiques du moment.
Enfin, ce conseil est tout à fait indispensable pour poser une doctrine en matière de retour et contenir ce risque de « fait du prince », non seulement par principe, mais aussi pour les conséquences que cela emporte pour les œuvres. On ne restitue ni ne conserve a priori : il doit y avoir une décision objective, qui s’appuie sur une argumentation posée et construite.
L’enjeu du débat autour des restitutions consiste à concilier ce qui était légal autrefois avec ce qui est moral aujourd’hui, pour reprendre les mots de ma collègue Catherine Morin-Desailly.
Prendre du recul, exprimer la ou les vérités, voilà les raisons pour lesquelles il faut que le conseil proposé par la rapporteure soit mis en place, avec les moyens de fonctionner. Son travail permettra de concilier la portée universaliste de nos musées avec les exigences tout à fait légitimes des pays africains, comme c’est ici le cas. Nos histoires sont mêlées et communes, chargées d’un héritage parfois lourd, mais rien n’est manichéen, et le danger serait de résumer ce parcours de l’humanité à un simplisme caricatural.
Ces œuvres ont une charge morale forte et symbolique, mais elles sont le témoin de la complexité de la construction de notre monde et de la place majeure qu’occupe la culture dans la construction de l’humanité. La culture de l’autre est un bien commun, notre bien commun. La culture de l’autre a changé notre culture.
Le groupe Union Centriste votera donc en faveur du texte, avec une vigilance accrue quant aux efforts réalisés par le Gouvernement pour qu’une doctrine sur la question des restitutions soit discutée et établie. Il y va autant de la qualité de nos relations avec un continent ami que de notre éthique artistique, culturelle et scientifique. À celle-ci, en particulier, nous devons vraiment cette réflexion.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je veux d’abord vous féliciter et féliciter tous les intervenants pour la qualité et la profondeur du travail réalisé. Je pense tout particulièrement au vôtre, madame la rapporteure, sur ce sujet qui vous mobilise déjà depuis de longues années et sur lequel vous faites autorité.
La première question qui a été soulevée est celle de l’importance des travaux scientifiques sur ces sujets.
Ceux qui ont été menés ont été approfondis et continuent de l’être, avec, notamment, une journée d’étude sur les collections extra-occidentales, un séminaire de recherche « Parcours d’objets » organisé par la Direction générale des patrimoines et l’Institut national d’histoire de l’art, le renforcement des équipes au musée du quai Branly-Jacques Chirac grâce à des bourses de recherche spécifiques et un poste de recherche.
Je partage d’ailleurs l’avis exprimé sur plusieurs de ces travées quant aux inexactitudes ou, du moins, au parti pris dont témoigne parfois le rapport de Sarr-Savoy. Celui-ci ne pouvait être qu’un élément de réflexion ! Il n’est pas question de le mépriser ou de le rejeter ; il s’agit bien de lui donner sa juste place.
Ainsi, s’ils constituent un élément important de la réflexion, ces travaux n’ont pas suffisamment associé les spécialistes des musées et les historiens. Ils ont souvent minimisé la question de la provenance des œuvres ou adopté un parti pris sur celle-ci : par définition, dans le rapport, les œuvres sont systématiquement des œuvres volées ou indûment acquises, alors que la réalité est en fait beaucoup plus complexe et exige que l’on juge au cas par cas.
Ce parti pris est, de toute évidence, gravement dommageable dans une approche, qui, comme je viens de le rappeler, doit être scientifique.
Madame la rapporteure, il n’y avait nul mépris ni arrogance dans l’avis donné par le membre de mon cabinet. On a simplement porté à votre connaissance que l’Assemblée nationale avait voté ce projet de loi à l’unanimité, tous groupes confondus. Le débat est ouvert entre le Sénat et l’Assemblée nationale, sur ce texte comme sur beaucoup d’autres, et il se poursuivra en commission mixte paritaire : il ne faut pas surinterpréter cette considération purement factuelle.
Finalement, notre discussion prouve que, dans le conseil national de réflexion, chacun voit un peu ce qu’il veut. Pour certains, une telle instance pourrait limiter les procédures de restitution. D’autres, au contraire, y voient curieusement un outil méthodologique permettant de les faciliter. Cette différence conceptuelle montre bien la fragilité de la procédure.
Pour notre part, à travers ce projet de loi, nous établissons clairement notre doctrine : les œuvres détenues par les musées français sont inaliénables. Aucune procédure générale ne peut conduire à la restitution ou au don des œuvres. Il ne peut pas y avoir de doctrine plus claire et plus affirmée ! Toute autre procédure viendrait la battre en brèche et serait l’amorce de démarches extrêmement dangereuses.
MM. Bruno Retailleau et Max Brisson s ’ exclament.
Je remercie les orateurs qui ont inscrit les deux restitutions dont il s’agit dans une perspective d’avenir et de développement. Bernard Fialaire l’a dit très justement et plusieurs d’entre vous ont placé cette coopération dans ce cadre extrêmement fécond.
Bien entendu, je n’éprouve pas pour autant les craintes que semblent traduire certains propos, mettant en doute les capacités des peuples africains à assurer la conservation de ces œuvres. Les chercheurs français, les présidents et directeurs d’institutions muséales mettent à disposition leur expertise, qui est remarquable, dans un esprit de coopération ; mais, dans ce domaine, il faut se garder de toute approche méprisante ou arrogante.
Monsieur Ouzoulias, chacun connaît ici vos grandes qualités scientifiques et vos travaux ; vous êtes historien et archéologue, spécialiste des Gaules romaines. Vous avez dit une chose très importante : il faut que ces échanges soient à double sens. C’est une perspective dans laquelle nous pourrions tous nous retrouver.
On ne peut pas se contenter de la restitution d’œuvres. Notre horizon doit être plus large : peut-être les œuvres restituées reviendront-elles au musée du quai Branly pour une exposition temporaire ; peut-être organisera-t-on une exposition Matisse au Bénin ou une exposition Picasso au musée de Dakar. C’est vers cette logique qu’il faut aller. Une démarche à sens unique se révélerait, finalement, néocolonialiste. Elle serait dès lors parfaitement condamnable. À l’opposé, il faut défendre une vision universaliste de l’art : sur ce point, je vous rejoins tout à fait.
Madame Lepage, vous avez beaucoup insisté sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur : la jeunesse africaine exprime sa fierté, elle a besoin de dignité et veut se reconnaître dans son histoire, qui a été souvent méprisée. Le grand historien africain Joseph Ki-Zerbo déplorait que l’on ait souvent une vision anhistorique de l’Afrique. Évidemment, cette jeunesse doit pouvoir se retrouver dans son passé.
Néanmoins, on ne peut pas partir du principe que toute restitution suppose le pillage, donc la violence, notion juridiquement très difficile à établir : dans un contexte de colonisation, à quel moment commence la violence ? À quel moment achète-t-on les œuvres indûment ? À quel moment les paie-t-on à leur véritable valeur, quand le rapport de force est si déséquilibré ? Cette notion est éminemment contestable. Une méthodologie ne saurait en aucun cas se fonder sur elle.
Monsieur Brisson, vous avez évoqué la mémoire de Jacques Chirac : vous pensez si j’y souscris !
Vous avez également cité André Malraux. Dieu sait si je m’y réfère ; mais les pillages du temple d’Angkor et des autres temples cambodgiens ne sont tout de même pas les épisodes les plus glorieux de sa vie…
Mme Roselyne Bachelot, ministre. Dans un tel débat, mieux vaut donc éviter d’évoquer sa mémoire ! Je vous le dis en toute amitié.
Sourires.
Monsieur Decool – j’y insiste –, nous avons développé les capacités des musées africains et la coopération permettra d’assurer une parfaite conservation des œuvres.
Monsieur Dossus, vous nous invitez à sortir des lois d’exception ; mais, pour ma part, je m’y refuse ! C’est le sens même du texte que je vous propose. En définitive, tous les orateurs estiment qu’il faut traiter les dossiers au cas par cas, finement, en se penchant sur les origines des œuvres, en étudiant la manière dont elles ont été acquises. Pourquoi se ligoter par telle ou telle procédure ? Il faut s’en tenir à des dispositifs législatifs d’exception.
Monsieur Hassani, vous avez parfaitement décrit la manière dont nous voulons procéder : je vous remercie de votre propos, empreint d’une grande humanité.
Enfin, madame de La Provôté, je ne peux que vous le répéter : oui, nous avons une doctrine. Je la rappelle une fois de plus : ces sujets extrêmement délicats ne peuvent être jugés qu’au cas par cas, au terme d’un travail scientifique approfondi, fondé sur des recherches historiques minutieuses. Les œuvres sont inaliénables, mais la France est un pays de générosité qui examinera ces coopérations dans un esprit d’ouverture. Je remercie le Sénat de l’avoir compris !
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.

La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
Par dérogation au principe d’inaliénabilité des collections publiques françaises inscrit à l’article L. 451-5 du code du patrimoine, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les vingt-six œuvres provenant d’Abomey conservées dans les collections nationales placées sous la garde du musée du quai Branly-Jacques Chirac, dont la liste figure en annexe à la présente loi, cessent de faire partie de ces collections. L’autorité administrative dispose, à compter de la même date, d’un délai d’un an au plus pour transférer ces œuvres à la République du Bénin.
Annexe 1 à l’article 1er
1. Numéro d’inventaire du musée du quai Branly-Jacques Chirac : 71.1893.45.1 – Statue anthropomorphe du roi Ghézo ;
2. Numéro d’inventaire du musée du quai Branly-Jacques Chirac : 71.1893.45.2 – Statue anthropomorphe du roi Glèlè ;
3. Numéro d’inventaire du musée du quai Branly-Jacques Chirac : 71.1893.45.3 – Statue anthropomorphe du roi Béhanzin ;
4. Numéro d’inventaire du musée du quai Branly-Jacques Chirac : 71.1893.45.4 – Porte du palais royal d’Abomey ;
5. Numéro d’inventaire du musée du quai Branly-Jacques Chirac : 71.1893.45.5 – Porte du palais royal d’Abomey ;
6. Numéro d’inventaire du musée du quai Branly-Jacques Chirac : 71.1893.45.6 – Porte du palais royal d’Abomey ;
7. Numéro d’inventaire du musée du quai Branly-Jacques Chirac : 71.1893.45.7 – Porte du palais royal d’Abomey ;
8. Numéro d’inventaire du musée du quai Branly-Jacques Chirac : 71.1893.45.8 – Siège royal ;
9. Numéro d’inventaire du musée du quai Branly-Jacques Chirac : 71.1895.16.1 – Récade (insigne d’autorité) réservée aux soldats masculins du bataillon blu, composé uniquement d’étrangers ;
10. Numéro d’inventaire du musée du quai Branly-Jacques Chirac : 71.1895.16.2 – Calebasses royales grattées et gravées d’Abomey, prise de guerre dans les palais royaux ;
11. Numéro d’inventaire du musée du quai Branly-Jacques Chirac : 71.1895.16.3 – Autel portatif aseñ hotagati ;
12. Numéro d’inventaire du musée du quai Branly-Jacques Chirac : 71.1895.16.4 – Autel portatif aseñ royal ante mortem du roi Béhanzin ;
13. Numéro d’inventaire du musée du quai Branly-Jacques Chirac : 71.1895.16.5 – Autel portatif aseñ du palais royal incomplet ;
14. Numéro d’inventaire du musée du quai Branly-Jacques Chirac : 71.1895.16.6 – Autel portatif aseñ du palais royal incomplet ;
15. Numéro d’inventaire du musée du quai Branly-Jacques Chirac : 71.1895.16.7 – Trône du roi Glèlè ;
16. Numéro d’inventaire du musée du quai Branly-Jacques Chirac : 71.1895.16.8 – Trône du roi Ghézo (longtemps dit « Trône du roi Béhanzin ») ;
17. Numéro d’inventaire du musée du quai Branly-Jacques Chirac : 71.1895.16.9 – Autel portatif aseñ hotagati à la panthère, ancêtre des familles royales de Porto-Novo, d’Allada et d’Abomey ;
18. Numéro d’inventaire du musée du quai Branly-Jacques Chirac : 71.1895.16.10 – Fuseau ;
19. Numéro d’inventaire du musée du quai Branly-Jacques Chirac : 71.1895.16.11 – Métier à tisser ;
20. Numéro d’inventaire du musée du quai Branly-Jacques Chirac : 71.1895.16.12 – Pantalon de soldat ;
21. Numéro d’inventaire du musée du quai Branly-Jacques Chirac : 71.1895.16.13 – Siège tripode kataklè sur lequel le roi posait ses pieds ;
22. Numéro d’inventaire du musée du quai Branly-Jacques Chirac : 71.1895.16.14 – Tunique ;
23. Numéro d’inventaire du musée du quai Branly-Jacques Chirac : 71.1895.16.15 – Récade (insigne d’autorité) réservée aux soldats masculins du bataillon blu, composé uniquement d’étrangers ;
24. Numéro d’inventaire du musée du quai Branly-Jacques Chirac : 71.1895.16.16 – Récade réservée aux soldats masculins du bataillon blu, composé uniquement d’étrangers ;
25. Numéro d’inventaire du musée du quai Branly-Jacques Chirac : 71.1895.16.17 – Autel portatif aseñ du palais royal incomplet ;
26. Numéro d’inventaire du musée du quai Branly-Jacques Chirac : 71.1895.16.18 – Sac en cuir.

L’amendement n° 3 n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’ensemble constitué de l’article 1er et de l’annexe 1.
L ’ article 1 er et l ’ annexe 1 sont adoptés.
Par dérogation au principe d’inaliénabilité des collections publiques françaises inscrit à l’article L. 451-5 du code du patrimoine, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le sabre avec fourreau dit d’El Hadj Omar Tall conservé dans les collections nationales placées sous la garde du musée de l’Armée, dont la référence figure en annexe à la présente loi, cesse de faire partie de ces collections. L’autorité administrative dispose, à compter de la même date, d’un délai d’un an au plus pour transférer ce bien à la République du Sénégal.
Annexe 2 à l’article 2
Numéro d’inventaire du musée de l’Armée : 6995/Cd 526 – Sabre avec fourreau dit d’El Hadj Omar Tall.

L’amendement n° 4 n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’ensemble constitué de l’article 2 et de l’annexe 2.
L ’ article 2 et l ’ annexe 2 sont adoptés.
Le titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour d’œuvres d’art extra-occidentales
« Art. L. 117 -1. – Le Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour d’œuvres d’art extra-occidentales a pour missions :
« 1° De donner son avis, avant toute réponse officielle de la part des autorités françaises, sur les réclamations de biens culturels présentées par des États étrangers qui ne relèvent pas du chapitre II du présent titre. Il est saisi à cette fin par le ministère des affaires étrangères dès la réception d’une telle réclamation. Son avis est rendu public ;
« 2° De fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils en matière de circulation et de retour des œuvres d’art extra-occidentales. Il peut être consulté à cette fin par les ministres intéressés, ainsi que par les présidents des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Il peut consulter toute personne susceptible de l’éclairer dans l’accomplissement de ses missions.
« Art. L. 117 -2. – Le Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour d’œuvres d’art extra-occidentales comprend un nombre maximal de douze membres, dont au moins :
« 1° Trois représentants des personnels mentionnés à l’article L. 442-8 ;
« 2° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’histoire ;
« 3° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’histoire de l’art ;
« 4° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’ethnologie ;
« 5° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière de droit du patrimoine culturel.
« Ses membres sont nommés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche.
« Art. L. 117 -3. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre. »

Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 5 est présenté par M. Masson.
L’amendement n° 7 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
L’amendement n° 5 n’est pas soutenu.
La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 7.
Cet amendement tend à supprimer l’article 3, ajouté par le Sénat, qui crée un conseil national de réflexion sur la circulation et le retour d’œuvres d’art extra-occidentales.
Bien entendu, toute proposition de restitution doit faire l’objet d’un travail scientifique. Sur ce point, nous sommes parfaitement d’accord. D’ailleurs, en répondant aux orateurs et en vous répondant, madame la rapporteure, j’ai dit à quel point nous y avons veillé : ce projet de loi garantit la mise en œuvre des recherches historiques et des études d’impact. Une telle commission pourrait mener un travail intéressant, mais l’expertise scientifique est déjà parfaitement convoquée.
Surtout, je pense au danger que représenterait cette commission : elle vous imposerait inévitablement une position dogmatique. Ce faisant, elle contreviendrait au principe revendiqué par tous les orateurs, à une exception près, à savoir l’inaliénabilité. Ces œuvres font partie du patrimoine.
Mesdames, messieurs les sénateurs, pour ce qui concerne la restitution des œuvres, ce conseil élaborerait une doctrine ou des procédures dont on ne pourrait s’échapper. Cette méthode me paraît receler des dangers majeurs : elle contrevient au principe que vous avez vous-mêmes retenu !

Madame la ministre, je me doutais que le Gouvernement proposerait la suppression de cet article important, introduit par la commission et voté à l’unanimité, tous groupes confondus.
Les membres de la commission se sont bien entendus quant à l’objet de ce conseil.
Tout d’abord, les mots ont leur importance : il s’agit, non pas d’une commission ou d’un comité – ces termes renvoient à des instances très formalisées, édictant des avis prescriptifs –, mais d’un conseil.
Vous avez évoqué la démarche scientifique engagée conjointement par vous-même, à la suite de votre prédécesseur, et par la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation – sur ce sujet, je suis néanmoins sans nouvelles de sa part… Les nombreux musées en dehors de Paris, dont nous n’avons pas parlé, sont en effet sous cette double tutelle.
J’ai bien compris qu’un travail scientifique avait été accompli pour procéder à la restitution de ces objets et que vous comptiez le prolonger. D’ailleurs, pour avoir également eu des échanges avec des représentants du ministère des affaires étrangères, j’ai cru comprendre que, sur cette question, un travail interministériel se dessinait pour l’avenir.
Mais, pour notre part, nous souhaitons une instance pérenne, qui survive aux gouvernements, aux changements de ministres, au renouvellement des assemblées parlementaires, et qui puisse enfin s’inscrire dans la durée.
Je travaille sur ces questions depuis dix ans et je ne le sais que trop : faute d’impulsion politique, les volontés s’étiolent au sein des ministères, qui plus est quand ces derniers ne disposent pas des moyens nécessaires. J’en veux pour preuve divers témoignages : le ministère de la culture n’avance pas très vite pour la restitution des biens spoliés – j’y insiste, faute de moyens –, alors que le sujet fait consensus.
Qu’il s’agisse du Parlement ou du Gouvernement, le politique doit donc disposer d’un tel conseil, qui sera un outil d’aide à la réflexion : chaque fois qu’une demande est émise, il doit être éclairé par les bonnes expertises. Les spécialistes de la question doivent s’exprimer, dans une variété d’approches : outre les directions des musées, il faut entendre les historiens de l’art, les anthropologues ou encore les juristes.
À ce titre, je vous renvoie à l’excellent rapport de Michel Van Praët et du groupe de travail sur la problématique des restes humains dans les collections publiques, réuni au sein de la Commission scientifique nationale des collections.
Il ne s’agit en aucun cas de privilégier une approche dogmatique, mais de mener une réflexion très approfondie, fondée sur un faisceau d’appréciations, pour apporter une réponse simple à chaque demande de restitution d’œuvres patrimonialisées. On évitera ainsi les réponses tous azimuts, ne concernant pas véritablement ce qui doit être considéré comme pouvant et devant revenir au pays d’origine.
En créant cet outil, nous voulons tout simplement permettre un travail de fond en continu. Je le répète, je l’ai vécu – je connais la qualité du travail mené par les représentants de l’institution muséale, et ils me pardonneront de le souligner : il y a eu beaucoup de résistances pour s’engager dans cette voie. On s’est souvent voilé la face. Or le vaste mouvement de restitution est là, devant nous, dans tous les pays européens qui ont un passé colonial.
Il faut regarder les choses en face et faire un travail de fond tranquillement, sereinement, pour éclairer le politique tout en respectant le principe d’inaliénabilité. Il faut étudier ces questions au cas par cas. Étant donné leur place dans l’histoire et dans la culture des pays, certains objets très symboliques doivent peut-être faire l’objet d’une loi d’exception.
Il me semble donc que nous sommes complètement d’accord quant au but à atteindre ; mais, pour notre part, nous retenons une autre méthode. Il s’agit notamment de se prémunir contre la tentation du fait du prince.
Pour la signature d’un contrat avec une filiale d’Alstom, François Mitterrand était allé en Corée du Sud au début des années 1980. À cette occasion, il avait rendu l’un des 297 manuscrits coréens détenus par la Bibliothèque nationale de France : vous imaginez le tollé que cette restitution a provoqué à l’époque.
Par la suite, Nicolas Sarkozy s’est vu reprocher de semblables faits du prince. Aujourd’hui, c’est au tour d’Emmanuel Macron : de telles critiques peuvent donc toucher tous les Présidents de la République. En ce sens, l’éclairage pérenne du conseil national de réflexion serait extrêmement utile !
La commission est défavorable à cet amendement.

En effet, une telle instance existait déjà par le passé !
Ce conseil est essentiel pour permettre un débat contradictoire, transparent et public – ce sont là trois critères fondamentaux pour apporter un éclairage sur ces œuvres – en garantissant une distanciation historique et en assurant l’information du Parlement.
Nous venons de voter l’article 2 ; néanmoins, nous aurions pu palabrer sur le choix du sabre. Pour ce qui concerne l’origine de cet objet, l’étude d’impact et l’exposé des motifs se contredisent. Il apparaît que ce sabre n’a jamais appartenu à Omar Tall : il a été offert par Faidherbe à son fils avant d’être repris par un autre général. Sa lame est française – modèle Montmorency, 1820, fabriqué en Haute-Alsace –, il a été donné par un général français et repris par un général français !
Est-ce vraiment ce qu’aurait choisi le Sénégal ? Je n’en suis pas sûr. D’ailleurs, quand on reprend le rapport Sarr-Savoy, on s’aperçoit que la demande vient non de la République du Sénégal, mais de la famille d’Omar Tall. Or le même rapport précise que les restitutions doivent relever de relations d’État à État. Il s’agit d’une clause forte, qui, manifestement, n’a pas été respectée en l’occurrence.
Un débat contradictoire et public, fondé sur des pièces, est donc bel et bien nécessaire, faute de quoi l’on en arrive à de telles décisions. Nous avons voté cet article à l’unanimité. Je ne le regrette pas. Mais on sent que l’on nous a un peu forcé la main : si le Sénégal avait pu choisir, il aurait sans doute préféré la bibliothèque d’Omar Tall, que les armées françaises ont également prise à Ségou. Ses 518 volumes, aujourd’hui conservés à la Bibliothèque nationale de France, sont extrêmement importants pour toute la tradition soufie de la confrérie Tijaniyya, dont Oumar Tall était le représentant !

Finalement, en la matière, deux constances se font face.
D’un côté, le Sénat déplore la suppression, par le projet de loi ASAP, de la Commission scientifique nationale des collections : nous en avons débattu dans cet hémicycle et, avec de nombreux membres de la commission de la culture, Catherine Morin-Desailly a regretté que l’on ait tout fait pour empêcher le fonctionnement de la CSNC, notamment en la privant de moyens.
De l’autre, quel que soit le ministre en poste, le ministère de la culture ne souhaite pas que cette commission fonctionne.
Madame la ministre, nous sommes là au cœur de nos divergences. Personnellement, je ne sais pas comment l’on mobilise des expertises sans une méthode, sans un cadre, sans un minimum de rigueur. En procédant au cas par cas, on n’échappe pas au fait du prince. Ce que Pierre Ouzoulias a dit au sujet du sabre l’illustre parfaitement : un peu d’expertise aurait certainement permis d’aborder la question autrement.
Sans le cadre commun que nous vous proposons avec constance, vous ne pourrez pas éviter le fait du prince. Catherine Morin-Desailly l’a rappelé à juste titre : tous les chefs d’État, tous les présidents, tous les princes de l’instant peuvent avoir cette tentation. Le chancelier de L’Hospital nous observe. §Depuis l’édit de Moulins, le patrimoine national n’est plus à la disposition du prince : il s’agit là d’un principe fondateur de notre nation.
Il faut s’opposer au fait du prince : nous nous y opposons avec force et avec constance !

Madame la ministre, notre groupe va effectivement voter contre l’amendement du Gouvernement.
Nous avons retenu le dispositif proposé par Catherine Morin-Desailly, et pour cause : c’est le seul que nous ayons trouvé pour entraver un tant soit peu l’action du prince. Nous ne voulons pas, à l’avenir, être placés de nouveau dans la situation de contrainte où nous nous trouvons aujourd’hui.
Le présent texte – je le relève à mon tour – est un projet de loi de ratification, voire de régularisation. On demande au Parlement d’entériner juridiquement ce qui a été promis, voire, pour le fameux sabre, ce qui a déjà été accompli dans les faits.
Bien entendu, nous tous ici sommes attachés au caractère inaliénable des œuvres : il s’agit du patrimoine de la Nation !
À cet égard, nos positions sont aux antipodes l’une de l’autre. Vous estimez qu’il faut recourir à des projets de loi d’exception : très bien ! D’ailleurs, nous reviendrons sur ce point en débattant de l’intitulé du texte. Vous ajoutez qu’il faut juger au cas par cas. Mais, de notre côté, nous voulons une procédure encadrant l’action du prince.
Avec ce texte d’exception, vous ouvrez un champ infini de précédents. Max Brisson l’a dit : le président du Bénin a déjà déclaré que cette démarche était insuffisante. Déjà, cinq ou six autres pays africains demandent la restitution d’au moins 13 000 objets. Où va-t-on s’arrêter ?
L’an dernier, le Parlement belge a voté une résolution tendant à engager un dialogue avec la France au sujet des quelque 200 œuvres – sculptures et peintures, notamment de l’école de Rubens – saisies comme prises de guerre lors de la Révolution et de la période napoléonienne. Y a-t-il de bons et de mauvais tributs de guerre ?
Nous voulons poser un cadre : souffrez simplement que nous cherchions une procédure nous protégeant, pour l’avenir, contre la prolifération des lois d’exception. Notre patrimoine appartient au peuple français et il faut garantir son caractère inaliénable.
En commission, la proposition de Catherine Morin-Desailly a rallié une très large majorité, bien au-delà de nos appartenances partisanes respectives !
Ce débat est très intéressant ! Pour Mme la rapporteure, le conseil national de réflexion a vocation à donner un avis scientifique éclairé. D’ailleurs, il serait composé presque exclusivement de personnalités qualifiées se prononçant sur la provenance et la qualité des œuvres.
Or, pour vous, monsieur Retailleau, le rôle de ce conseil est d’empêcher le fait du prince…
Ces deux visions sont parfaitement contradictoires.
Soit c’est une démarche scientifique d’analyse des œuvres ; soit c’est une procédure qui, comme vous le souhaitez, contraint le pouvoir exécutif…
Je ne porte pas de jugement de valeur : vous avez bien dit que ce conseil doit empêcher le fait du prince ! On voit bien toute l’ambiguïté de cette démarche.
Pour notre part – je l’ai dit –, nous réaffirmons le caractère inaliénable des biens détenus par les musées français. Il faut suivre, projet de loi après projet de loi, une procédure dérogatoire – je n’aime pas le terme « loi d’exception ». Dès lors, chaque sujet est examiné de manière spécifique, suivant une procédure scientifique parfaitement définie.
Monsieur Ouzoulias, en l’occurrence, nous n’avons pas eu besoin de ce conseil pour obtenir une parfaite description des œuvres : le travail scientifique a été fait. La provenance du sabre d’El Hadj Omar Tall a été parfaitement établie. Toute son histoire a été décrite. De même, on connaît en détail le pillage du palais d’Abomey, auquel le roi Béhanzin avait mis le feu. Sur le plan scientifique, tout le monde a été parfaitement éclairé.
Enfin, cette affaire présente un aspect diplomatique, qui est au moins aussi important. Or les diplomates seraient complètement absents de ce conseil scientifique, alors qu’une telle démarche ne peut pas les laisser de côté.
Mesdames, messieurs les sénateurs, nous sommes donc bien en pleine ambiguïté !

Madame la ministre, nous avons un désaccord, d’ailleurs pas tant sur le fond de vos propos que, plus globalement, sur la manière d’aborder ces questions.
Je ne parlerai pas du fait du prince – la formule peut être quelque peu blessante. Je dirai plutôt que deux logiques coexistent au sein de l’État et peuvent entrer en confrontation.
D’un côté, il y a votre logique, celle de l’administration de la culture : une logique patrimoniale que nous partageons non seulement au sein de notre commission, mais, assez largement, au Sénat. De l’autre, il y a la logique diplomatique dont vous avez parlé : une logique qui parfois interfère et entre en opposition – qui joue, en tout cas, un jeu différent.
Nous savons bien que ces restitutions, celles dont nous parlons comme les autres, antérieures ou à venir, donnent lieu, à un moment donné, à une confrontation au sein de l’État entre ces deux logiques. L’intérêt de ce conseil est précisément de participer à l’élaboration d’une décision interministérielle, qui équilibre les deux logiques et permette la prise en compte de chaque dimension.
Nul n’ignore la dimension diplomatique de ces restitutions ;…

… nul n’ignore non plus qu’elle est particulièrement importante pour la France dans le cadre de son dialogue avec l’Afrique. Reste que le choix des œuvres doit obéir aussi à une logique culturelle et patrimoniale.
Vous avez fait remarquer, à juste titre, que nous n’avions pas intégré dans le conseil un représentant du Quai d’Orsay. S’il ne s’agit que de cela, nous pouvons très probablement le faire. Au reste, l’approche interministérielle que nous souhaitons promouvoir à travers ce conseil en sera renforcée.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Je suis saisi de trois amendements et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L’amendement n° 2 est présenté par MM. Ouzoulias et Bacchi, Mme Brulin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 8 est présenté par M. Dossus, Mme de Marco, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Alinéas 3, 4 et 8
Remplacer les mots :
d’œuvres d’art extra-occidentales
par les mots :
de biens culturels extra-européens
II. - Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
œuvres d’art extra-occidentales
par les mots :
biens culturels extra-européens
La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour présenter l’amendement n° 2.

Cet amendement, très simple, vise à clarifier deux termes : d’une part, il s’agit d’introduire la notion de biens culturels, reconnue par le droit du patrimoine en France ; d’autre part, de lever l’ambiguïté associée au qualificatif « occidental » – la Nouvelle-Zélande peut être considérée comme un pays occidental – en privilégiant une acception géographique limitée.

Le sous-amendement n° 10, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Alinéa 5, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et ne portent pas sur des restes humains
II. – Compléter cet amendement par deux alinéas ainsi rédigés :
et compléter cette phrase par les mots :
, hors restes humains
La parole est à Mme la rapporteure.

Les amendements identiques n° 2 et 8 et l’amendement n° 6, très proches sur le fond, vont dans le sens des discussions constructives que nous avons menées en commission autour du rôle et du périmètre de cette nouvelle instance. Je remercie chacune et chacun d’avoir bien contribué à éclairer et à approfondir le débat jusqu’à ce soir.
La commission a jugé tout à fait approprié d’élargir le périmètre du conseil national à l’ensemble des cas extra-européens, plutôt qu’extra-occidentaux, afin de lui permettre de se prononcer sur les demandes qui pourraient émaner d’autres pays eux aussi précédemment colonisés : je pense à l’Amérique du Nord, à l’Australie ou encore à la Nouvelle-Zélande – je suis bien placée pour le dire.
En revanche, pour ne pas alourdir excessivement l’appellation du conseil, il nous semble préférable de faire référence à la notion de biens extra-européens, prévue par les amendements identiques n° 2 et 8, plutôt qu’à celle de biens originaires d’un État non membre de l’Union européenne, prévue par l’amendement n° 6, que Mme Lepage présentera dans quelques instants.
Élargir le périmètre du conseil national à l’ensemble des biens culturels présente l’avantage de lui donner compétence pour les demandes relatives à des objets, au-delà des œuvres d’art – je le concède volontiers ; en revanche, cela présente l’inconvénient d’élargir son périmètre à la question des restes humains, alors qu’un travail de fond a déjà été mené en la matière, aboutissant à un consensus scientifique. De là mon sous-amendement n° 10, tendant à exclure les restes humains du champ de compétence du conseil national.
La commission est favorable aux amendements identiques n° 2 et 8, sous réserve de l’adoption du sous-amendement.

L’amendement n° 6, présenté par Mme Lepage, MM. Antiste, Assouline, Lozach et Magner, Mmes Monier et S. Robert, M. Stanzione, Mme Van Heghe et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 3, 4 et 8
Remplacer les mots :
d’œuvres d’art extra-occidentales
par les mots :
de biens culturels originaires d’un État non membre de l’Union européenne
II. – Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
œuvres d’art extra-occidentales
par les mots :
biens culturels originaires d’un État non membre de l’Union européenne
La parole est à Mme Claudine Lepage.

Cet amendement vise aussi à remplacer la notion « d’œuvres d’art » par celle de « biens culturels », pour les raisons qui ont été expliquées. Je conçois, madame la rapporteure, que l’expression « biens culturels originaires d’un État non membre de l’Union européenne » soit un peu lourde dans le titre du conseil… Je me rallie à votre avis et aux amendements identiques.
Les deux amendements identiques et le sous-amendement visent des modifications terminologiques qui n’apportent pas véritablement de différences conceptuelles, maintenant que vous avez entériné la création de ce conseil.
La notion de « biens culturels », plus large que celle d’« œuvres d’art » est, en effet, inscrite dans le code du patrimoine.
S’agissant du remplacement du terme « extra-occidental » par « extra-européen », mon ministère, s’appuyant sur l’avis des spécialistes des musées concernés, conserve une préférence pour la première formule, comme le montrent les journées professionnelles et les séminaires de recherche qu’il organise, avec des musées nationaux ou l’Institut national d’histoire de l’art, dont les intitulés mentionnent bien : collections extra-occidentales ou art extra-occidental.
Vous ayant livré ces réflexions, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
Le sous-amendement est adopté.
Les amendements sont adoptés.
L ’ article 3 est adopté.

L’amendement n° 1 rectifié ter, présenté par MM. Brisson, Retailleau, Bonne et Cuypers, Mmes Bourrat, Berthet, Drexler, Bonfanti-Dossat et M. Mercier, M. Bazin, Mmes Goy-Chavent, Micouleau, Dumas et Deromedi, M. Lefèvre, Mme Chain-Larché, MM. Savin, J.M. Boyer, Mouiller, Duplomb, Vogel et Rapin, Mme de Cidrac, M. Courtial, Mmes Gruny et Eustache-Brinio, MM. Genet, Cardoux et Hugonet, Mme Deroche, M. Calvet, Mme Imbert, M. Piednoir, Mmes Di Folco et L. Darcos, MM. Regnard et Savary, Mme Joseph, M. Karoutchi, Mme Belrhiti, MM. de Legge et Bascher, Mme Lavarde, MM. Sido, Longuet, J.B. Blanc, Milon, Anglars, Belin et Sautarel, Mmes Schalck et Ventalon, MM. C. Vial et Mandelli, Mme Lherbier, MM. B. Fournier et Chevrollier, Mme Lopez et MM. Bonhomme, Laménie, Segouin, Gremillet, Bouchet et Husson, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet intitulé :
Projet de loi d’exception portant sur le transfert de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal
La parole est à M. Max Brisson.

Nombre de sénateurs du groupe Les Républicains tiennent à modifier l’intitulé du projet de loi.
Comme je l’ai souligné dans la discussion générale, la Haute Assemblée doit rappeler avec force le caractère inaliénable des collections nationales. C’est la raison pour laquelle les auteurs de l’amendement proposent de qualifier ce texte de projet de loi d’exception.
Par ailleurs, le terme restitution continue de poser problème de notre point de vue. En effet, si le verbe latin restituere signifie « remettre à sa place, replacer, rendre », il n’en demeure pas moins que, en français, restituer désigne bien le fait de rendre une chose que l’on possède indûment – après le Gaffiot, je me réfère au Larousse –, ce qui véhicule incontestablement l’idée d’une faute à réparer.
Voilà pourquoi nous proposons d’employer le mot, plus neutre, de « transfert », qui exclut que la France porte une quelconque culpabilité.
Comme je sais que Mme la rapporteure s’apprête à nous suggérer deux rectifications, j’annonce que nous sommes tout à fait disposés à y faire droit…
MM. Bruno Retailleau et Jean-Raymond Hugonet applaudissent.

Cet amendement vise à apporter une double modification à l’intitulé du projet de loi.
D’une part, il est proposé de le qualifier de projet de loi d’exception.
En l’absence de cadre général pour les restitutions, ce type de texte est, de toute façon, un texte d’exception : la règle applicable à nos collections reste l’inaliénabilité. C’est la raison pour laquelle nous sommes saisis de ce projet de loi. Au reste, grâce à la députée Constance Le Grip, les articles 1er et 2 prévoient déjà clairement que la sortie des biens revendiqués par le Bénin et le Sénégal est dérogatoire au principe d’inaliénabilité des collections.
Dans ces conditions, je ne crois pas utile de faire référence à l’exception dans l’intitulé du projet de loi.
D’autre part, les auteurs de l’amendement entendent substituer à la notion de restitution celle de transfert.
L’intitulé actuel s’inscrit dans la droite ligne des textes antérieurs : loi de 2002 relative à la restitution par la France de la dépouille mortelle de Saartjie Baartman à l’Afrique du Sud et loi de 2010 visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections. J’y vois donc une forme de continuité. Toutefois, je conçois que la question des restes humains et celle des objets soient tout à fait différentes. Par ailleurs, il est exact que le verbe « restituer » comporte, dans sa définition précise, l’idée d’une propriété illégitime.
Je ne suis pas enthousiasmée par le mot « transfert », même si je l’ai fait introduire aux articles 1er et 2, par souci de précision par rapport au verbe « remettre ». En effet, c’est un terme assez technocratique et peu signifiant ; surtout, il risque de ne pas parler aux populations concernées, nos amis béninois et sénégalais.
Nous pourrions tomber d’accord sur la notion de retour : ce serait une bonne façon de marquer que ces objets reviennent dans leur pays d’origine, sans que soit contestée leur propriété juridique, reconnue par le droit français comme par le droit international.
Les questions de terminologie sont d’autant plus intéressantes qu’on peut en débattre à l’infini – ce qui, nuitamment, a toujours un certain charme…
Quelque amour que j’éprouve pour le grec, je ne convoquerai pas les langues anciennes ; je ne suis d’ailleurs pas sûre que le mot « restitution » ait une grande importance. Comme je l’ai souligné deux fois dans la discussion générale, après l’avoir fait dans les débats parlementaires précédents, il s’agit d’être clair sur l’objectif du texte, sans que celui-ci constitue un acte de repentance.
Avis défavorable sur l’amendement.

Monsieur Brisson, acceptez-vous la demande de rectification de Mme la rapporteure ?

Madame la rapporteure, je vous remercie d’avoir compris le sens de notre amendement, d’en avoir précisé l’esprit est d’avoir confirmé que le mot « restitution » comporte bien une charge morale.
Je rappelle qu’un examen attentif de ce qui était légal dans le contexte de l’époque disqualifie ce terme, sauf à appréhender le passé selon non pas une démarche historique fondée, mais une stricte et exclusive vision mémorielle moralisatrice.
Je consens à retirer la référence à l’exception.
Quant au terme « retour », compris comme un retour des objets sur leurs terres d’origine, il me paraît plus acceptable que « restitution ». Le mot « transfert », qui avait notre préférence, a été introduit, sur votre initiative, aux articles 1er et 2, pour remplacer à juste titre le verbe « remettre » : nous aurions pu l’employer une troisième fois, mais j’entends vos arguments, madame la rapporteure, et je respecte votre belle expertise sur ces questions.
Monsieur le président, j’accepte donc de rectifier notre amendement dans le sens demandé.

Il s’agit donc de l’amendement n° 1 rectifié quater, ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet intitulé :
Projet de loi relatif au retour de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal
La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

Monsieur Brisson, vous m’avez privé de ma declamatio : vous saviez que j’allais répondre au Larousse par le Gaffiot !
Il est seulement dommage que vous n’ayez pas lu la définition du Gaffiot jusqu’au bout… Car vous auriez appris que restituo est employé par Cicéron pour rapporter que le Sénat de la République romaine avait replacé à son emplacement d’origine la statue de Minerve emportée par la tempête. Or, en droit latin, une statue possède un caractère inaliénable, qui la distingue d’une marchandise.
C’est très exactement ce qui se passe avec les statues d’Abomey : ce sont d’abord des œuvres religieuses. D’ailleurs, dans le document signé le 18 novembre 1892 au palais d’Abomey, le colonel Dodds déclare au nom de la France : « Rien ne sera changé dans les coutumes et les institutions du pays, dont les mœurs seront respectées. »
Manifestement, il y a eu, quelque part, un manquement à la parole donnée. C’est pourquoi je préfère le verbe « restituer ».

Je n’entrerai pas dans cette joute entre personnes très cultivées… Je remercie simplement Max Brisson d’avoir rectifié son amendement, parce que, dans sa rédaction initiale, nous n’aurions pas pu le voter. Ne serait-ce que parce que ce projet de loi, s’il est certes dérogatoire, n’est pas un texte d’exception.
Notre collègue rejette le terme « restitution », qui, dans son esprit, s’accompagne d’une forme de repentance, ce qu’il refuse absolument. Je l’admets, mais il ne s’agit pas de nier l’histoire telle qu’elle s’est passée, seulement de reconnaître une juste part de responsabilité. Il convient non pas de regarder l’histoire d’hier avec les yeux d’aujourd’hui, mais de légiférer pour aujourd’hui et demain.
Puisque le terme « retour » met tout le monde d’accord, et la notion d’exception ayant été supprimée, je souscris tout à fait à l’amendement rectifié.

Pas tout à fait tout le monde, puisque M. Ouzoulias préfère « restitution »…
La parole est à M. François Bonhomme, pour explication de vote.

Je ne crois pas que ce débat soit accessoire, même nuitamment… Le terme « restitution » est lourd de sous-entendus : il emporte même la notion de spoliation, avec tout ce que cela véhicule en termes d’idéologie de la repentance.
Dans la discussion générale, madame la ministre, vous avez pris des précautions infinies pour expliquer que ce texte n’est pas un acte de repentance. Précisément : cet amendement nous offre l’occasion, en parlant de transfert ou de retour – je ne sais pas s’il s’agit de termes technocratiques –, de neutraliser l’idéologie de la repentance dont le terme initial est porteur !
L ’ amendement est adopté.

Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

Quand les frontières se ferment, il faut que les œuvres de l’esprit continuent de voyager pour donner du sens à notre humanité commune. L’universalisme que nous invoquons depuis le début de cette discussion nous oblige à rendre accessibles ces biens culturels à l’ensemble des pays qui nous les demandent, et pas seulement à ceux qui ont les moyens financiers de les accueillir.
Ce devoir est d’autant plus impérieux quand il s’agit de les offrir à la contemplation des sociétés qui les ont réalisés et que nous en avons privées.
Je regrette vivement que ce débat ait été enfermé dans les limites juridiques étroites d’un texte consistant en des transferts de propriété. Il eût été utile de nous interroger sur la validité, presque morale, d’un acte de propriété sur des œuvres qui n’ont cessé de passer de main en main et de traverser les frontières et les époques.
Pour reprendre l’exemple des chevaux de Saint-Marc, que valent les droits de leurs derniers propriétaires, alors qu’ils témoignent aussi du génie grec, de la capacité de la Renaissance constantinienne à fonder un nouvel empire sur les bases de l’Antiquité finissante et, finalement, du lien jeté entre l’Orient et l’Occident par la République de Venise ?
Les œuvres qui nous intéressent ce soir ont été juridiquement incorporées dans les collections nationales françaises, ce qui justifie notre débat sur ce texte. Néanmoins, elles participent surtout de l’expression du génie humain. À ce titre, la France n’en est que l’ultime dépositaire : ce statut lui donne sans doute des droits, mais lui confère aussi des devoirs envers celles et ceux qui n’y ont pas accès, en particulier les populations auxquelles nous les avons arrachées.
Si notre pays continue de défendre l’universalisme du patrimoine mondial et des musées, il ne peut continuer à opposer cette conception aux légitimes demandes de partage. Nous devons abandonner cette position strictement défensive et nous engager dans une politique qui favorise les échanges et la circulation de toutes les œuvres !

Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble du projet de loi.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 16 :
Nombre de votants343Nombre de suffrages exprimés343Pour l’adoption343Le Sénat a adopté.
Applaudissements.

Je remercie l’ensemble des orateurs pour leur contribution à ce débat riche et complexe.
Six mois après le vote à l’unanimité, ici même, du projet de loi de restitution des têtes maories, puis son adoption définitive par l’Assemblée nationale, une très belle cérémonie s’est tenue au musée du quai Branly, en présence du ministre de la culture de l’époque, Frédéric Mitterrand, et de l’ensemble des parties prenantes, pour solenniser ce geste extrêmement fort et symbolique de restitution des têtes maories à la Nouvelle-Zélande.
Un an plus tard, mes chers collègues, c’est le groupe d’amitié France-Nouvelle-Zélande du Sénat qui, à l’invitation du gouvernement néo-zélandais, a accompagné le retour des vingt et une têtes maories en terre maorie. Loin d’être la fin d’une aventure, ce déplacement a marqué le début d’un nouveau dialogue et d’une nouvelle coopération, aujourd’hui intenses et qui, bien au-delà de la diplomatie, ont considérablement renforcé les liens d’amitié entre les institutions des deux pays.
Avec le Sénégal et le Bénin, nous avons un travail formidable de coopération et de partage à mener, à partir des textes que nous avons votés. Tout commence ce soir !
Applaudissements.
Je me réjouis que ce projet de loi, annoncé par le président Emmanuel Macron dans son discours de Ouagadougou et destiné à renforcer nos liens de coopération avec les pays africains, spécialement le Sénégal et le Bénin, ait été voté à l’unanimité.
Ce texte compliqué a donné lieu à un débat riche sur la proposition d’un conseil. Mais le cœur du projet de loi, c’est la volonté politique forte d’entamer une nouvelle ère de coopération en rendant aux pays africains – en leur retournant, si vous préférez… – le sabre d’El Hadj Omar Tall et les vingt-six objets issus du sac du palais d’Abomey.
C’est pour moi une grande satisfaction que ce texte, qui a suscité bien des interrogations, ait été voté à l’unanimité par le Sénat, après l’avoir été par l’Assemblée nationale !
Applaudissements.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, jeudi 5 novembre 2020 :
À neuf heures trente :
Quarante-deux questions orales.
À dix-neuf heures :
Sous réserve de sa transmission, nouvelle lecture du projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (procédure accélérée ; texte A.N. n° 3495), discussion générale.
Le soir :
Sous réserve de sa transmission, nouvelle lecture du projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (procédure accélérée ; texte A.N. n° 3495), discussion des articles.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à minuit.
La liste des candidats désignés par la commission de la culture, de l ’ éducation et de la communication pour faire partie de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l ’ enseignement supérieur a été publiée conformément à l ’ article 8 quater du règlement.
Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai d ’ une heure prévu par l ’ article 8 quater du règlement, cette liste est ratifiée. Les représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire sont :
Titulaires : M. Laurent Lafon, Mme Laure Darcos, MM. Stéphane Piednoir, Jean-François Rapin, Mmes Marie-Pierre Monier, Sylvie Robert et M. Julien Bargeton ;
Suppléants : MM. Max Brisson, Olivier Paccaud, Jean-Raymond Hugonet, Jean Hingray, Mme Claudine Lepage, MM. Bernard Fialaire et Pierre Ouzoulias.