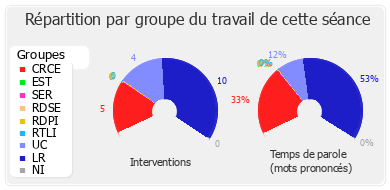Séance en hémicycle du 27 mars 2008 à 9h30
Sommaire
La séance
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
Ordre du jour prioritaire

L'ordre du jour appelle la discussion de la question orale avec débat n° 12 de M. Gérard Dériot à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la politique de lutte contre l'obésité.
Cette question est ainsi libellée :
« M. Gérard Dériot demande à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, de bien vouloir l'informer de l'état d'avancement de la politique de lutte contre l'obésité. Il souhaite notamment faire le point sur les résultats du programme national nutrition santé 2001-2005, ainsi que sur les mesures mises en oeuvre et à venir dans le cadre du second programme national nutrition santé 2006-2010 et les moyens qui y sont consacrés.
« Par ailleurs, il lui demande une appréciation de l'efficacité du dispositif prévu à l'article 29 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, en ce qui concerne les modalités de levée de la taxe sur les publicités en faveur des produits gras et sucrés et l'estimation de son rendement pour l'institut national de prévention et d'éducation à la santé, mais aussi l'évaluation des effets, sur la population, des messages de prévention diffusés dans le cadre de ces publicités.
« Il s'interroge enfin sur l'évolution prévisible de l'obésité en France au cours des prochaines décennies, notamment chez les enfants et les populations précaires. »
La parole est à M. Gérard Dériot, auteur de la question.

Le 27 février dernier, vous avez présenté, madame la ministre, votre plan « Santé des jeunes ». Parmi les mesures proposées figure en bonne place la lutte contre les troubles de l'alimentation. On pense, bien sûr, à l'anorexie, mais les pratiques alimentaires pouvant entraîner l'obésité sont également visées.
Notre commission des affaires sociales y est évidemment très sensible. Après avoir travaillé activement à l'adoption des premières mesures législatives « anti-obésité » dans la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, elle a poursuivi sa réflexion sur ce sujet difficile dans le cadre de l'OPEPS, l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé, en confiant à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, une étude consacrée aux facteurs déterminants de l'obésité et aux moyens de la prévenir. Ce travail a fait l'objet, en 2005, d'un rapport que j'ai eu l'honneur de présenter ; vous comprendrez ainsi combien la question de l'obésité me préoccupe.
Aujourd'hui, il ne fait de doute pour personne que l'obésité, qualifiée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, de « première maladie non infectieuse de l'histoire », constitue un risque sanitaire majeur dans les pays développés. Tous ont pris conscience de l'ampleur du problème et mis progressivement en place des mesures de prévention. C'est le cas du programme national nutrition-santé, dont le deuxième opus couvre la période 2006-2010, sans pour autant endiguer à ce jour la progression de la maladie.
Cette situation justifie votre présence aujourd'hui, madame la ministre. Quels moyens prévoyez-vous de mettre en oeuvre et de renforcer pour protéger nos enfants et nos adolescents de ce danger, qui menace, à court terme, leur développement physique et psychologique et, à long terme, leur santé ?
Permettez-moi de rappeler quelques chiffres et données scientifiques sur la réalité de l'obésité infantile dans notre pays.
La surcharge pondérale est mesurée par des seuils de référence de l'indice de masse corporelle, l'IMC. Lorsque l'IMC est supérieur à 25, on parle de surpoids ; lorsqu'il dépasse le seuil de 30, on parle alors d'obésité.
Sur ces bases, les enquêtes les plus récentes indiquent que 10 % des enfants âgés de six ans présentent une surcharge pondérale modérée et 4 % une obésité. En 1980, seulement 5 % de cette classe d'âge était en surpoids.
Si, à six ans, les filles semblent plus sujettes à l'obésité que les garçons, l'écart a tendance à s'atténuer à l'adolescence. À quinze ans, on estime à 12, 4 % la prévalence du surpoids et à 3, 3 % celle de l'obésité, sachant que les jeunes concernés présentaient déjà, pour la moitié d'entre eux, un problème de poids à l'âge de six ans.
Ce constat démontre, s'il en était besoin, la nécessité de prévenir les risques d'obésité dès le plus jeune âge. II ne faudrait pas que la France se rapproche du triste record des États-Unis, qui comptent près de 30 % d'enfants en surpoids.
Quels sont les déterminants de l'obésité ?
À l'origine de la maladie, il existe, bien sûr, un déséquilibre entre l'apport alimentaire et la dépense énergétique. Pourtant, tous les individus ne réagissent pas à ce déséquilibre de manière identique. De fait, la prévalence de la surcharge pondérale dépend aussi de certains facteurs environnementaux, qui sont d'abord d'ordre économique et social.
On observe ainsi une proportion d'enfants et d'adolescents obèses plus importante dans les zones d'éducation prioritaires. Plus généralement, la catégorie socioprofessionnelle des parents constitue un critère essentiel : l'obésité est dix fois plus fréquente chez un enfant d'ouvrier non qualifié que chez un enfant de cadre supérieur. Ce constat appelle plusieurs explications.
Il existe d'abord un « effet revenu » évident, que le rapport de l'OPEPS avait bien analysé, dans le choix de l'alimentation.
Ainsi, au fil des ans, le prix des aliments est devenu inversement proportionnel à leur densité calorique et à leurs qualités nutritionnelles : en cinquante ans, le prix des produits gras a diminué de près de la moitié, tandis que celui des fruits et légumes a augmenté d'un tiers.
Ce critère économique est amplifié par les inégalités d'éducation, qui expliquent certaines habitudes alimentaires et la méconnaissance de l'apport nutritionnel des différents aliments.
Enfin, on connaît aussi l'effet de la sédentarisation des modes de vie, toutes catégories sociales confondues, qui contribue encore à déséquilibrer la relation entre l'apport et la dépense énergétiques.
Vous l'aurez compris, mes chers collègues, les déterminants de l'obésité infantile sont multiples et leurs interactions complexes. Une politique ambitieuse de prévention de cette maladie doit, pour être efficace, agir sur l'ensemble de ces facteurs. Ma première série de questions portera donc, madame la ministre, sur les différentes facettes de la prévention de l'obésité.
D'abord, comment peut-on intervenir sur la composition, sur le prix et sur les modalités de distribution des aliments ?
Le surpoids résulte notamment de la qualité nutritionnelle des produits consommés. Or, la composition des aliments préparés fait apparaître une proportion de sucre, de sel et de graisses bien supérieure aux besoins quotidiens du corps humain, et l'on sait que les modes de vie actuels incitent de plus en plus à consommer des plats tout préparés. À cette richesse calorique des aliments s'ajoute le fait qu'on a tendance à accroître la taille des portions, ce qui conduit le consommateur à manger plus et moins bien.
Or, ce double aspect « composition des produits alimentaires » et « taille des portions » dépend entièrement des industriels de l'agroalimentaire. Ne conviendrait-il pas de négocier avec eux une charte de qualité, dont le respect serait, par exemple, récompensé par un label « nutrition-santé », pour qu'ils s'engagent à agir sur ces deux déterminants de l'obésité ?
Par ailleurs, je le disais tout à l'heure, il existe un « effet revenu », qui influence les choix alimentaires en raison du prix proportionnellement plus élevé des fruits et des légumes que celui des produits gras et sucrés. Il n'est pas illogique de penser que la réduction de cet écart permettrait de rééquilibrer la consommation au profit des aliments plus diététiques.
Deux solutions sont alors envisageables, sans être exclusives l'une de l'autre d'ailleurs : d'une part, subventionner les fruits et les légumes afin de rendre leur prix moins prohibitif, et telle est précisément l'option que nous avions retenue dans le cadre de l'OPEPS ; d'autre part, taxer plus fortement les produits caloriques à faible valeur nutritionnelle, cette possibilité ayant été prônée par notre commission qui s'est prononcée en faveur d'une fat tax sur les boissons sucrées lors de la discussion du dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Or je constate, pour le déplorer, que, au final, pas une seule de ces deux mesures n'a encore vu le jour, en dépit de nos recommandations. Quelles sont donc vos propositions pour rendre les fruits et les légumes économiquement plus abordables et/ou pour renchérir le coût des aliments gras et sucrés ? Par diminution du prix des fruits et légumes, j'entends bien évidemment une diminution au niveau de la distribution et non pas au niveau de la production, car les producteurs eux-mêmes rencontrent déjà des difficultés pour survivre avec les prix qui leur sont imposés.
Le troisième aspect lié à cette question est celui des modalités de distribution des produits caloriques, car il est vraisemblable que l'accès facile à ces produits ne soit pas dénué d'effets sur la prévalence de l'obésité.
À cet égard, j'ai appris avec satisfaction qu'une certaine chaîne de grandes surfaces s'engageait désormais à retirer les sucreries susceptibles d'attirer les enfants de leurs présentoirs de caisse, afin de ne pas inciter à leur consommation. Est-il envisageable, comme vous l'aviez suggéré, madame la ministre, d'étendre, le cas échéant, de manière contraignante, cette initiative à l'ensemble de la grande distribution ?
Je citerai un autre exemple en milieu scolaire. La limitation de la disponibilité des produits gras et sucrés a été inscrite dans l'article 30 de la loi du 9 août 2004, qui a interdit les distributeurs automatiques dans les écoles.
Nous n'avons pas oublié que, à l'époque, le Sénat s'était prononcé contre cette mesure d'interdiction, estimant qu'il convenait plutôt, dans un souci nutritionnel, mais aussi pédagogique, de conserver ces équipements, tout en contrôlant leur contenu. Ainsi, les élèves auraient facilement eu accès à des fruits ou à de l'eau minérale sans être incités à se fournir en dehors de l'établissement scolaire. Telle est encore ma position personnelle aujourd'hui. Quelle est la vôtre, madame la ministre, si vous disposez d'un premier bilan de ce dispositif ?
La restauration en milieu scolaire pose également le problème des cantines. Comment concilier une offre nutritionnelle équilibrée et un coût abordable, y compris pour les familles les plus modestes, sans peser trop lourdement sur les finances des collectivités territoriales ? Dans ce domaine, il faudra s'inspirer du programme EPODE, « Ensemble prévenons l'obésité des enfants », lancé par un certain nombre de collectivités, notamment de communes, et qui commence à porter ses fruits, si je puis dire, et l'accompagner.
J'aborderai ensuite la question qui me semble essentielle pour la prévention de l'obésité, l'information et l'éducation en matière d'alimentation.
L'article 29 de la loi du 9 août 2004 prévoit, à cet égard, que les messages publicitaires promouvant des boissons et des aliments sucrés ou caloriques doivent être assortis d'une information sanitaire d'éducation diététique. C'est aujourd'hui le cas de 85 % de ces publicités, la majorité des industriels ayant préféré cette solution au paiement d'une taxe.

Or, on constate que cette obligation est contournée à bien des égards. D'abord, je l'ai vérifié personnellement, ces publicités qui entrecoupent les émissions destinées aux jeunes sont diffusées avec un volume sonore nettement supérieur à celui des autres programmes, tandis que le message de prévention sanitaire consiste souvent en un bandeau écrit en petits caractères sur l'écran ...

... et s'adresse d'ailleurs à des jeunes qui savent à peine lire. Il n'informe donc personne !

En effet !
En outre, ces messages de prévention sont généralement peu lisibles et difficilement compréhensibles par les plus jeunes. Pour la plupart, ils en tirent même la conséquence que la consommation de ces éléments médiocres sur le plan diététique serait positive pour leur santé. Le produit est forcément bon puisqu'ils l'ont vu à la télévision !
Ce fâcheux paradoxe fait aujourd'hui douter de l'efficacité du dispositif. Avez-vous établi un premier bilan de cette mesure ? Comment comptez-vous améliorer la perception de cette information par les enfants et leurs parents ?
De même, la lisibilité de l'information nutritionnelle doit être améliorée sur l'étiquetage des produits. Aux États-Unis, la loi a rendu obligatoire l'indication claire de leur contenu.
Est-il envisagé de mettre en place, en France, une nomenclature intelligible du contenu des aliments qui informerait le consommateur avant l'achat ? Nous avions préconisé une telle mesure dans le rapport fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé, OPEPS.
La prévention de l'obésité infantile suppose, enfin, de favoriser l'activité physique. Je sais qu'il s'agit là du domaine d'intervention de votre collègue Bernard Laporte, mais je ne doute pas qu'en tant que ministre de tutelle vous pourrez me répondre sur ce point.
La pratique sportive est aujourd'hui devenue un luxe pour de nombreuses familles, malgré les aides proposées par la plupart des communes, et même des départements.

Personnellement, j'ai mis en place de telles aides dans le mien. À côté des traditionnels clubs de sports, il me semble donc utile de développer des équipements sportifs accessibles à tous, en milieu urbain comme en zone rurale.
L'aménagement de pistes cyclables constitue également un moyen de favoriser les modes de déplacements actifs. Quelle est votre opinion sur ce sujet ? Comment inciter les communes à engager ce type d'investissements très coûteux ?
En améliorant la qualité des aliments, en renforçant l'information sur cette qualité, en limitant le coût des fruits et légumes, en augmentant le prix des produits gras et sucrés, en favorisant la pratique d'une activité physique, la prévention constitue évidemment le meilleur instrument de lutte contre l'obésité infantile.
Cela étant, certains enfants resteront ou deviendront obèses. Pour ceux-là, la prise en charge des maladies associées au surpoids doit être améliorée grâce, notamment, à un dépistage plus rapide. C'est à cet aspect que s'attache ma deuxième série de questions.
Les enfants obèses présentent une fréquence élevée d'anomalies infracliniques concernant notamment la pression artérielle. Ils sont exposés à des complications précoces, telles que des troubles orthopédiques, endocriniens ou des diabètes de type 2.
Enfin, les études épidémiologiques s'accordent pour associer l'obésité infantile à une augmentation du risque de mortalité prématurée à l'âge adulte.
Il convient par conséquent de développer le dépistage précoce de l'obésité infantile et des maladies qu'elle provoque. À cet égard, une formation non seulement des médecins et des infirmières de l'éducation nationale, qui réalisent le bilan de santé préalable à l'entrée en primaire, mais aussi des pédiatres sur les facteurs et les conséquences sanitaires du surpoids ne devrait-elle pas être envisagée ?
La qualité de ce dépistage dépend, en amont, du niveau de connaissance sur les déterminants génétiques, physiologiques et environnementaux de la maladie. Les équipes de chercheurs français se situent aujourd'hui parmi les meilleures du monde en matière de recherche fondamentale sur l'obésité.
Cette position doit être confortée par la mise en place de programmes de recherche interdisciplinaires. Le ministère de la santé a-t-il prévu de s'investir dans ce type de projets, via notamment l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM, dont il assure la cotutelle aux côtés du ministère de la recherche ?
Le dépistage et la prise en charge de l'obésité de l'enfant ne doivent pas faire oublier les conséquences psychologiques et sociales de cette maladie. Les enfants et les adolescents en surpoids sont aujourd'hui encore souvent victimes de railleries pouvant aller, dans certains cas, jusqu'au harcèlement, voire la discrimination. Les campagnes d'information sur l'obésité ne devraient-elles pas, selon vous, prendre en compte cette dimension pour rappeler le respect auquel chacun a droit ?
Après les nombreuses interrogations que m'inspirent la prévention et la prise en charge de l'obésité infantile, je souhaiterais enfin vous interroger, madame la ministre, sur les moyens humains et financiers que vous estimez nécessaires à la mise en oeuvre de cette politique.
Pour le pilotage des mesures que vous prendrez, quelle instance est la plus à même d'engager, de conduire et de contrôler le dispositif ? S'agit-il du ministère de la santé - même si de nombreuses dispositions ne dépendront vraisemblablement pas de lui -, d'un haut comité ad hoc - comme certain le propose -, d'une instance interministérielle placée auprès du Premier ministre, sur le modèle de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, MILDT, solution en faveur de laquelle s'était prononcé l'OPEPS ?
Par ailleurs, dans un contexte de régionalisation de la politique de santé et de l'offre de soins, quel pourrait être le rôle des futures agences régionales de santé en matière de lutte contre l'obésité infantile ?
Enfin, quel est le coût estimé des mesures que vous prendrez pour lutter contre l'obésité ? Comment seront-elles financées ?
Telles sont, madame la ministre, les nombreuses questions que posent, à mon sens, la définition et la mise en oeuvre d'une politique ambitieuse de lutte contre l'obésité infantile et sur lesquelles nous attendons des réponses.
Je suis convaincu, pour ma part, de votre détermination à mobiliser l'ensemble des acteurs - élus, industriels, professionnels de santé et enseignants - en faveur de cette cause, dont il me semble que vous avez pris la juste mesure. Je vous souhaite de réussir dans cette entreprise. Il en va, vous l'aurez compris, de la santé de notre jeunesse.
Applaudissements

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaite simplement attirer votre attention sur un aspect du sujet qui nous retient ce matin.
En outre, l'excellente intervention de notre collègue Gérard Dériot, dont je salue ici la grande compétence sur ce problème de l'obésité comme sur tant d'autres sujets, vient de faire un point très précis et extrêmement complet sur l'ensemble de la question.

Lors de l'examen du dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale, la commission des affaires sociales, vous vous en souvenez, a souhaité engager un débat sur l'instauration d'une taxe nutritionnelle dans notre pays.
L'analyse faite notamment par le président de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale, la MECSS, M. Alain Vasselle, est partie d'un double constat : d'une part, la nécessité de lutter plus activement contre l'obésité, qui reste en progression dans notre pays, en particulier par un renforcement des moyens destinés à modifier les comportements alimentaires ; d'autre part, l'obligation de trouver et de diversifier les ressources nécessaires au rééquilibrage des comptes de la sécurité sociale.
Pour répondre à cette double préoccupation, la mise en place d'une taxe nutritionnelle est une solution qui mérite d'être examinée sérieusement. Elle pourrait prendre plusieurs formes.
La première est la taxation de certaines catégories de produits avec l'application d'un taux ou d'un montant par unité de produit, par exemple 1 % du prix de vente hors taxe des confiseries ou un centime par canette de boisson sucrée.
La deuxième est la taxation des composants jugés mauvais sur le plan nutritionnel - graisses, sel, sucre - et qui entrent dans la composition des produits alimentaires.
La troisième est l'augmentation du taux de la TVA applicable à certains produits, par exemple les barres chocolatées, les sodas, les chips ou les confiseries.
La commission des affaires sociales a, pour l'instant, retenu la première option. Il ne nous a pas paru opportun de proposer, à ce stade, une augmentation de la TVA. Par ailleurs, la taxation des seuls composants est extrêmement complexe à mettre au point ; elle n'a d'ailleurs encore jamais été mise en oeuvre, y compris dans les pays, principalement anglo-saxons, qui disposent d'une « fat tax ».
La commission a donc suggéré - et le Sénat a adopté cet amendement à l'occasion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 - que l'on taxe simplement les boissons sucrées, à l'exception des jus de fruits et des eaux minérales aromatisées, en appliquant un taux de 1 % au prix de vente hors taxe de ces produits. Le choix des boissons sucrées visait à éviter de toucher des produits de première nécessité, tout en ciblant la taxe sur des produits réellement néfastes sur le plan nutritionnel.
Quels sont les principaux arguments qui militent en faveur d'une telle taxe ?
Premièrement, elle permettrait de donner un signe à nos concitoyens, de susciter une prise de conscience sur les conséquences sanitaires des choix alimentaires. Le monde de la médecine, de même que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, se prononcent aujourd'hui sans équivoque sur la nécessité de donner cette alerte.
Deuxièmement, elle pourrait contribuer à financer le coût en augmentation rapide des problèmes de santé liés à l'obésité et aux mauvais comportements alimentaires.
Au passage, je souligne que ces mauvais comportements ne sont pas seulement à l'origine des problèmes d'obésité et des pathologies liées au surpoids. Ils provoquent aussi de nombreuses maladies, notamment certains cancers, comme le montrent de façon très claire de récentes études. Il y a donc un enjeu réel et majeur de santé publique à faire évoluer certaines habitudes alimentaires.
Quels sont les principaux arguments avancés contre la taxe ?
D'abord, elle serait une atteinte à la liberté et à la vie privée, une intrusion du Gouvernement dans des choix nutritionnels qui sont éminemment personnels, argument toujours avancé dans les pays anglo-saxons. Mais ne taxe-t-on pas déjà le tabac ou l'alcool pour des raisons précisément liées à la santé de la population ?
Ensuite, la taxe aurait un impact disproportionné sur les populations pauvres ou à faible revenu. Or on observe que ce sont aussi celles qui souffrent le plus des problèmes de santé liés à cette mauvaise alimentation et qu'il convient donc de les accompagner sur un meilleur chemin nutritionnel. C'est à ce titre d'ailleurs que Martin Hirsch, en charge au Gouvernement des solidarités actives, a plusieurs fois insisté sur l'utilité de créer une telle taxe.
Enfin, on souligne souvent la difficulté du choix des aliments taxables. Par exemple, se pose dans notre pays le problème des fromages qui présentent un taux élevé de matière grasse. Cet argument existe bien sûr, mais il ne paraît pas insurmontable.
Sourires

Bien sûr ! Le Camembert et d'autres !
Il est possible de mettre en place des taxes simples et claires, comme l'ont fait plusieurs États américains sur les sodas et les boissons sucrées ou les produits de grignotage, solution que la commission des affaires sociales a d'ailleurs retenue.
Le principe de la taxe étant dès lors acquis, je voudrais vous démontrer pourquoi il faut en affecter le produit, comme nous le proposons, au financement de l'assurance maladie.
La première raison est évidente : les mauvais régimes alimentaires et le manque d'exercice sont responsables de nombreux problèmes de santé : diabète, problèmes cardiaques, cancer, opérations du genou et de la hanche. Le coût de l'obésité est donc réel pour l'assurance maladie, sans parler des indemnités journalières ou même des allocations invalidité qui doivent parfois être versées.
Une étude de la CNAM démontre que, par rapport au reste de la population, les personnes obèses dépensent en moyenne 27 % de plus en soins de ville et 39 % en pharmacie. La Commission européenne estime que les dépenses liées à l'obésité coûtent chaque année entre 75 milliards et 130 milliards d'euros à l'Europe des Quinze.
Seconde raison, dans le contexte actuel des finances sociales, le rendement d'une telle taxe ne serait pas négligeable. Même fixée à un taux modique, une taxe sur les aliments diététiquement contestables peut produire des recettes importantes.
Plusieurs États américains ont mis en place de telles taxes, à des taux faibles, essentiellement sur les sodas et les boissons sucrées. Elles rapportent en général plusieurs centaines de millions de dollars par an aux budgets des États concernés. En France, on pourrait sans difficulté concevoir la mise en place d'une taxe qui rapporterait entre 500 millions et un milliard d'euros par an.
Certes, dans la plupart des pays où une telle taxe a été instituée, son produit a été affecté au budget général, l'idée étant toutefois affirmée que ces sommes supplémentaires doivent permettre de financer des programmes de promotion de la santé, notamment à l'école, ou de subventionner des aliments tels que les fruits et légumes ou la pratique d'activités sportives et de mise en forme.
En France, il nous semble que ce serait une erreur d'affecter ces sommes au budget de l'État, car il ne prend pas en charge les dépenses supplémentaires liées aux problèmes nutritionnels.
On a mis en place un système spécifique pour le financement de campagnes nutritionnelles menées par l'INPES, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, à partir d'un prélèvement sur les publicités télévisées. Comme cela vient d'être dit, ce mécanisme ne fonctionne pas aujourd'hui de façon optimale et devra donc être revu.
Néanmoins, c'est bien à l'assurance maladie qu'il faudra affecter le produit d'une éventuelle fat tax, car c'est elle qui supporte l'essentiel des coûts dus aux problèmes nutritionnels et d'obésité. De la même façon, les droits sur le tabac ou l'alcool sont désormais, en très large partie, affectés à la sécurité sociale.
C'est d'ailleurs pour la même raison que la commission des affaires sociales suggère aussi, dans un autre ordre d'idées, qu'une partie de la future fiscalité écologique soit affectée à la sécurité sociale.
Pour répondre à notre demande de l'automne dernier, le Gouvernement a confié une mission sur l'opportunité de mettre en place une taxe nutritionnelle aux inspections générales des finances et des affaires sociales, qui doivent remettre leurs conclusions avant le 1er juin prochain. Nous vous remercions, madame la ministre, d'avoir lancé cette réflexion en lien avec votre collègue Éric Woerth, ministre des comptes publics. Nous attendons beaucoup de ces travaux et espérons qu'ils pourront trouver une conclusion dans la prochaine loi de financement de la sécurité sociale.
Sur un sujet de santé publique qui concerne nombre de nos compatriotes, il est important que nous puissions avancer en utilisant tous les moyens qui sont à notre disposition.
Applaudissements

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je me réjouis du débat que nous avons aujourd'hui sur un sujet qui, pendant trop longtemps, a été ignoré des pouvoirs publics. Depuis le vote de la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004, la lutte contre l'obésité est enfin devenue une priorité.
Vous me permettrez, avant d'en venir à mon propos, de rendre hommage à l'action déterminée et déterminante de l'un de nos anciens collègues, Gilbert Chabroux, qui, dans cet hémicycle, a beaucoup oeuvré pour faire adopter plusieurs amendements importants en la matière.

Mes chers collègues, vous le savez tous, la progression de l'obésité dans notre pays est attestée depuis plusieurs années par une série d'études épidémiologiques concordantes. Sa fréquence est en forte augmentation, puisqu'elle est passée en cinq ans de 8 % à 11 % chez les adultes et de 2 % à 4 % chez les enfants et les adolescents. Aujourd'hui 1, 5 million de nos jeunes souffrent d'obésité. Sans catastrophisme aucun, on peut dire qu'avec un taux de croissance annuelle de 5, 7 % l'obésité pourrait bien être le fléau sanitaire du xxie siècle.
Si la France est, avec les Pays-Bas et la Suède, l'un des pays de l'Union européenne où la prévalence de l'obésité infantile est la moins importante, il nous faut tout de même amplifier notre effort, afin de faire face à un problème majeur de santé publique, qui concerne la santé d'un Français sur cinq. Si nous ne faisons rien, les équilibres de nos organismes de protection sociale seront singulièrement et durablement mis à mal et nos capacités de développement social et économique seront altérées.
Nous devons faire face à cette transformation de nos modes de vie, qui a débuté il y a de nombreuses années et dont nous voyons à peine aujourd'hui les premières conséquences. Le défi est d'importance, il faut répondre avec vigueur, tout en sachant que la lutte contre l'obésité devra s'inscrire dans la durée.
Comme le souligne le rapport de notre collègue Gérard Dériot, rédigé à la fin de l'année 2005 au nom de l'OPEPS, l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé, « les déterminants de l'obésité sont multiples et leur interaction complexe ». Aux facteurs biologiques ou génétiques de chaque individu se mêlent des déterminants socio-économiques liés à l'environnement, mais aussi au contexte culturel, sociétal, politique et législatif, qui se retrouvent dans le système alimentaire et les normes sociales. À cet égard, je tiens à dire mon accord total avec les propos que vient de tenir M. Gérard Dériot.
Ainsi, la variété des facteurs d'explication de l'obésité rend impossible une réponse simple et unique. Il n'y a pas une solution miracle pour lutter contre l'obésité, mais bien un ensemble de réponses et d'axes d'actions. C'est le sens du programme national nutrition-santé, le PNNS, mis en place dans notre pays depuis l'an 2000, qui privilégie une approche pluridisciplinaire concernant le diagnostic, le traitement, la prise en charge et la prévention de l'obésité. Il nous faut poursuivre dans cette voie.
Il n'en reste pas moins que l'alimentation tient un rôle prépondérant dans le développement de l'obésité. Si l'on veut donc offrir à chacun, notamment aux enfants, des conditions favorables à l'équilibre alimentaire, il est indispensable de mettre en place une véritable politique nutritionnelle.
Parmi les réponses apportées dans ce domaine, la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004 a permis plusieurs avancées, en ce qui concerne tant la présence de distributeurs automatiques dans l'enceinte des établissements scolaires - je suis en désaccord avec Gérard Dériot sur ce point, mais ce n'est pas fondamental -, que la taxation des « premix » ou, encore, les messages d'information à caractère sanitaire dans les publicités.
On peut aussi se féliciter de l'entrée en vigueur de l'étiquetage nutritionnel des aliments. Encore faut-il savoir lire ces étiquettes, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, j'oserai même dire du plus grand nombre d'entre nous. Il faudrait sans doute rendre cet étiquetage plus accessible et plus lisible. Plusieurs pistes sont à étudier, notamment celle d'un pictogramme, idée défendue par Mme Payet, ou d'un étiquetage de couleur en fonction de la concentration du produit alimentaire en sucres, en sel et en matières grasses.
Le programme national nutrition-santé avait, dès 2001, fixé des objectifs chiffrés relatifs à la nutrition et à l'alimentation des Français. Les principaux d'entre eux avaient été intégrés dans la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Parmi ces objectifs figurait la question de l'obésité : il s'agissait de diminuer de 20 % la prévalence du surpoids et de l'obésité chez l'adulte et de stabiliser l'augmentation de la prévalence du surpoids et de l'obésité chez les enfants.
L'étude nationale nutrition-santé, l'ENNS, qui s'est déroulée de février 2006 à février 2007, a permis de montrer les premiers effets positifs de la politique mise en place depuis 2000, ainsi que les efforts qui restent à faire. Incontestablement, l'état nutritionnel des Français s'améliore lentement.
Parmi les avancées, on note déjà la stabilité de la prévalence du surpoids et de l'obésité chez les enfants. Les données nationales et régionales semblent démontrer que l'on s'approche de cet objectif avec, au niveau national, 3, 5 % pour l'obésité et 14, 3 % pour le surpoids.
On constate également la progression de la consommation moyenne de fruits par les adultes - celle-ci ne diminue pas chez les enfants - et la stabilisation de la consommation de légumes.
Par ailleurs, la consommation de sel a diminué de plus de 5 % depuis 1999 et l'activité physique a augmenté.
Il s'agit d'avancées, sans doute encore insuffisantes, mais qu'il faut noter. C'est un encouragement à continuer dans cette voie : il est très difficile de changer les habitudes alimentaires et nous devons poursuivre nos efforts sur tous les champs, par une politique nutritionnelle de plus en plus volontariste.
Un bon comportement alimentaire doit être adopté dès le début de la vie. En 2005, Gérard Dériot s'interrogeait notamment sur les conséquences respectives de l'allaitement et de l'alimentation par lait industriel sur le poids et la morphologie des nourrissons et proposait de renforcer la recherche dans ce domaine. A-t-on avancé sur ce sujet ?
La question la plus préoccupante aujourd'hui est celle des personnes défavorisées, dont la situation se dégrade, d'après les données présentées dans l'ENNS. Il s'agit probablement du plus grand défi de ces prochaines années. Or les problèmes de pouvoir d'achat que connaissent aujourd'hui de plus en plus de ménages français compliquent la situation, en particulier lorsque la hausse des prix concerne les céréales, le lait, les fruits et les légumes, autant de produits essentiels à une alimentation équilibrée.
Parmi les mesures que vous avez annoncées, madame la ministre, le 4 février dernier, celle qui a le plus retenu mon attention concerne les publicités diffusées au cours des programmes télévisés destinés aux enfants. La surreprésentation des produits déséquilibrés nutritionnellement dans les publicités télévisées à destination des enfants, notamment au moment des programmes qui leur sont spécifiquement destinés, doit être très contrôlée. On ne peut nier que ces publicités ont une influence directe sur le comportement alimentaire des plus jeunes.
Je dois avouer que, si j'adhère parfaitement à l'objectif que vous avez annoncé, je suis plus circonspect concernant le moyen d'y parvenir. Vous apporterez certainement des réponses à cette interrogation.
Comme l'a montré l'évaluation que vous avez fait faire sur l'impact des messages sanitaires accompagnant les publicités de l'industrie agro-alimentaire, l'influence de la publicité sur les enfants est indéniable. Ainsi, 47 % des 8-14 ans disent que les publicités qu'ils regardent leur donnent envie de manger ou de boire ; 62 % d'entre eux demandent à leurs parents d'acheter les produits dont ils ont vu la publicité à la télévision - Gérard Dériot y a fait allusion tout à l'heure -, et, peut-être encore plus grave, 91 % d'entre eux obtiennent ce qu'ils ont demandé !

Il faut donc responsabiliser les parents.
L'évaluation réalisée par l'INPES montre aussi que, si, globalement, les messages sont bien reconnus et acceptés, il y a aussi des problèmes de confusion entre le message sanitaire et le produit promu. C'est la faiblesse du dispositif que nous avons adopté en 2004. À la différence du message simple et unique concernant les boissons alcoolisées - « à consommer avec modération » -, la multiplicité de messages qui ne sont pas toujours bien adaptés aux produits auxquels ils sont adossés amoindrit les effets positifs du dispositif.
Pour un public aussi spécifique que celui des enfants, il est nécessaire, selon moi, de franchir un palier supplémentaire, en réduisant, peut-être même en interdisant, la publicité pendant les programmes qui leur sont destinés. Comment voulez-vous que les jeunes enfants assimilent le message sanitaire qui défile en petits caractères tout en bas de l'écran, alors que la publicité met en scène le produit avec une musique enjouée et des personnages de dessin animé ou de super héros ?
Très honnêtement, madame la ministre, j'avoue que j'ai des doutes sur les capacités et la volonté d'autorégulation des professionnels sur cette question. Qu'a donné la réunion de concertation ?
Je note au passage que je ne suis pas le seul à avoir des doutes, si j'en crois la proposition de loi récemment déposée par plus de cent députés UMP et dont l'objet est bien de proscrire « la diffusion de messages publicitaires ou radiodiffusés relatifs à des boissons ou à des produits alimentaires à forte teneur en sucre ou en matières grasses avant, pendant et après les émissions, qualifiées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur la base d'analyses média métriques, de ? programmes où une partie importante du public est constituée d'enfants et d'adolescents ? ». Pour ma part, je n'en demande pas plus, et ce depuis longtemps !
Parallèlement, les sénateurs présents dans cet hémicycle savent qu'un autre sujet me préoccupe tout autant. Il s'agit du niveau sonore de ces publicités. Je suis déjà intervenu à plusieurs reprises sur ce point à l'occasion de l'examen de plusieurs textes, y compris auprès du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, mais pour l'instant sans réel écho. J'insiste sur ce problème, parce qu'il est, selon moi, important, surtout pour les jeunes enfants. Qui n'a jamais vu ses enfants ou ses petits-enfants accourir devant la télévision, attirés par une publicité dont la musique se met soudainement à retentir ?
Une étude du CSA datant de 2003 révélait que le niveau sonore des écrans publicitaires télévisés dépasse le niveau moyen des programmes dans plus de 50 % des cas. Le CSA avait engagé une concertation avec l'ensemble des chaînes, mais il semble bien que rien n'ait vraiment changé. Chacun de nous, en tant que téléspectateur, peut le constater chaque fois qu'il allume son écran de télévision.
C'est la raison pour laquelle, madame la ministre, je souhaite pour que vous saisissiez votre collègue ministre de la culture et de la communication, afin de trouver une réponse adaptée à ce problème.
Je suis également parfaitement d'accord pour retirer des caisses les confiseries et autres sucreries. Je le répète, si les professionnels ne sont pas capables de s'autoréguler, il faudra les y obliger.
Vos propositions sur la restauration scolaire me semblent également importantes. En la matière, les collectivités locales sont, me semble-t-il, des partenaires indispensables. Certains de mes collègues, notamment Mme Brigitte Bout, s'intéressent plus précisément au programme EPODE. Il faut encore le développer et faire en sorte que toutes les collectivités locales le mettent en oeuvre.
A contrario, madame la ministre, vous avez oublié un aspect sur lequel il serait temps de se pencher sérieusement. Je veux parler de la taxe nutritionnelle, qui est loin de faire consensus. Il n'est évidemment pas très populaire de parler de taxe nouvelle ! Au lieu d'en rejeter l'idée a priori, ce que vous n'avez d'ailleurs pas fait, puisque vous disiez « taxer, pourquoi pas, mais pourquoi faire ? », il était nécessaire de lancer, comme vous l'avez fait, une étude de faisabilité pour en apprécier réellement les avantages et les inconvénients.
Je constate d'ailleurs que l'idée fait son chemin, que ce soit au Gouvernement - je n'ai pas oublié non plus, monsieur le président de la commission, la proposition de Martin Hirsch, Haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, du mois de juin 2007 - ou au sein de la majorité - je pense à l'amendement qu'avait fait adopter ici même notre collègue Alain Vasselle lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. J'avais d'ailleurs moi-même fait une proposition en ce sens à cette même occasion.
Il me semble que l'instauration d'une telle taxe, même d'un montant faible, pourrait avoir un impact positif sur la santé et les comportements individuels ; il ne peut s'agir de taxer tous les aliments qui contiennent du sucre ou du sel, ce serait impossible. Il faut laisser un peu tranquille le camembert, monsieur le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Le camembert Président ! Pas de publicité, mon cher collègue !
Sourires

M. Jean-Pierre Godefroy. Ce qui nous importe pour l'instant, et nos collègues normands le savent bien, c'est de continuer à avoir du camembert au lait cru, parce que c'est le meilleur !
Nouveaux sourires.

Il y a beaucoup de calcium dans le camembert, comme dans les autres fromages !

Il s'agit bien de taxer les aliments les plus déséquilibrés nutritionnellement. C'est pour cette raison que je proposais de faire intervenir l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'AFSSA, dont les compétences en matière d'alimentation humaine et de nutrition permettent d'établir une liste précise des catégories d'aliments visés par une telle taxe. Je rejoins l'essentiel des propos tenus en la matière par le président de la commission, Nicolas About.

J'en suis persuadé, madame la ministre, dans notre société, il y a place pour une industrie agroalimentaire et une grande distribution plus responsables et plus soucieuses de la santé de ses consommateurs.
L'évolution de la réglementation peut les y aider, car il devient de plus en plus difficile d'admettre que les produits les moins chers ne soient pas parmi les meilleurs si l'on se place du point de vue de l'hygiène alimentaire. Cela nous ramène au problème du pouvoir d'achat et à la pénalisation pour leur santé des plus démunis de nos concitoyens.
Avant de conclure mon propos, permettez-moi de dire un mot d'une autre proposition de loi, déposée à l'Assemblée nationale par mon collègue Jean-Marie Le Guen.
Comme lui, je crois qu'il nous faut aller au-delà des mesures que vous avez annoncées, madame la ministre - et qui sont bonnes, je le répète -, en faisant adopter par le Parlement une loi qui symbolise la mobilisation de la nation contre ce fléau, une loi qui fixe les objectifs et les principes de ce combat, une loi qui clarifie les responsabilités de chacun, une loi qui ne se contente pas d'énoncer de grands principes, mais s'appuie sur les moyens budgétaires rendant possible la mise en oeuvre de la politique que nous appelons tous de nos voeux.
J'aimerais que vous preniez en considération les propositions formulées dans ce texte, notamment en ce qui concerne l'information et l'éducation nutritionnelles, la promotion d'une offre alimentaire équilibrée dans les écoles, mais aussi dans les entreprises, dont on oublie de parler, et la prise en charge de l'obésité reconnue comme affection de longue durée, ou ALD, dans certains cas.
Nous sommes tous convaincus, je le sais, qu'il est urgent de mobiliser nos énergies pour éviter le pire, comme ce qui se passe aux États-Unis par exemple. Sur un sujet aussi essentiel, nous pouvons certainement, tous ensemble, trouver une voie commune.
Applaudissements

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, au nom du groupe UMP, je tiens à saluer l'initiative de notre collègue Gérard Dériot, qui nous permet de relancer le débat sur un enjeu majeur de santé publique.
Ainsi que cela vient d'être souligné, l'obésité est devenue un problème de santé publique considérable. Comme l'indique le professeur Arnaud Basdevant, chef du service nutrition à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, c'est « une maladie de la modernité, une maladie de la transition urbaine, de la transition sociale et de la transition économique, qui touche les populations les plus vulnérables ». C'est la raison pour laquelle aucun pays n'est épargné. Cette maladie atteint soit, comme aux États-Unis et en Europe du Nord, les couches de la population les plus défavorisées, soit, au contraire, dans les pays émergents, les populations qui accèdent à plus de prospérité après avoir connu la pauvreté.
Après les collègues qui m'ont précédée à cette tribune, je dénonce, à mon tour, le fait que l'obésité progresse rapidement dans notre pays et affecte de plus en plus de jeunes : aujourd'hui, un enfant sur six est en surpoids, contre un sur vingt dans les années quatre-vingt.
Cette progression régulière pourrait avoir des conséquences catastrophiques sur la santé de nos concitoyens : les risques de complications cardiovasculaires sont multipliés par trois et de diabète par neuf. En tant que médecin, le président de la commission, Nicolas About, l'a expliqué mieux que je ne le ferais.
L'obésité prend un caractère particulièrement dramatique lorsqu'elle touche les enfants. Non seulement ils sont atteints des mêmes maladies que les adultes, mais l'on sait aujourd'hui que, si l'obésité apparaît avant la puberté, son risque de persistance à l'âge adulte est très élevé.
Des mesures ont déjà été prises. En France, la prise de conscience des menaces que fait peser l'obésité n'est pas nouvelle : dès 2001, notre pays s'est doté d'un programme national nutrition-santé, qui a établi des recommandations nutritionnelles diffusées par le biais de campagnes de communication. Sa mise en place représentait un premier pas dans l'affirmation d'une volonté politique pour combattre ce fléau.
Mes collègues l'ont dit, une deuxième étape décisive a été franchie grâce à la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004.
À cette occasion, le Parlement a pris les premières mesures législatives de lutte contre l'obésité : l'une rendant obligatoire la mention d'une information à caractère sanitaire sur les publicités pour les produits alimentaires, l'autre visant à interdire les distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires dans les établissements scolaires, où ils faisaient des ravages.
Je tiens à rendre hommage au travail mené par notre collègue Gérard Dériot au sein de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé, qui a permis d'approfondir la réflexion engagée lors de nos débats sur la loi de 2004 et qui représente une excellente base pour l'élaboration de nouvelles mesures.
Devant l'ampleur de la maladie et de sa progression, notamment chez les enfants, nous devons aller plus loin. Compte tenu de la vulnérabilité des enfants et de l'influence de la publicité sur leur comportement alimentaire - tous les intervenants l'ont souligné -, il est indispensable que les émissions télévisées qui leur sont destinées ne comportent plus aucune publicité les incitant à consommer des produits sucrés ou salés. Le maintien de ces publicités avec des messages de mise en garde serait une mauvaise solution, puisque, dans la plupart des cas, les enfants ne comprennent pas la teneur de ces avertissements.
Les causes de l'obésité sont multiples. Mais, si les facteurs génétiques et héréditaires comptent, c'est avant tout notre mode de vie contemporain qui est en cause : la sédentarisation croissante des individus et la consommation massive d'aliments trop sucrés ou trop salés, facilement accessibles et relativement peu coûteux, sont les vrais responsables de l'ampleur prise par cette nouvelle épidémie.
À ces considérations, valables dans de nombreux pays, s'ajoute, dans le nôtre, un facteur aggravant spécifique : la disparition progressive des traditionnels repas conviviaux, pris à des heures déterminées, au profit d'une alimentation segmentée, constituée d'une nourriture industrielle et immédiatement consommable.
En outre, l'obésité n'est pas uniquement un problème de santé publique : elle entraîne également une souffrance sociale et humaine qu'il nous faut absolument prendre en compte si nous ne voulons pas que des générations entières d'enfants et d'adultes soient mises à l'index dans notre société.
L'enfant obèse a plus de mal qu'un autre à s'intégrer dans un groupe, à pratiquer certains sports, à s'identifier à des modèles de réussite ; l'adulte obèse souffre de nombreux handicaps ; il voit sa mobilité réduite, rencontre plus de difficultés pour trouver un emploi et participer à des activités, souffre de discriminations.
Dans cette perspective, le deuxième programme national nutrition-santé, lancé en septembre 2006, a mis en place une politique globale, qui se décline en deux volets principaux :
Le premier concerne la prévention. Il s'agit de sensibiliser les citoyens à une bonne alimentation et de les inciter à exercer une plus grande activité physique quotidienne, mais aussi de parvenir à l'amélioration nutritionnelle des produits alimentaires.
Le second volet est axé sur le dépistage précoce et la prise en charge des troubles nutritionnels. À ce titre, je tiens à saluer l'action de l'Association française de pédiatrie ambulatoire, qui, lors de la Quatrième journée nationale de dépistage de l'obésité chez l'enfant, le 12 janvier dernier, a mobilisé trois cents pédiatres dans soixante villes de France pour des consultations gratuites afin d'informer et d'alerter les familles sur le problème de l'obésité infantile.
Notre rapporteur, Gérard Dériot, a présenté une brillante et parfaite synthèse des causes de l'obésité et des remèdes à y apporter.
Aussi, comme chaque fois qu'il est question d'enfants, il nous faut insister sur le rôle primordial de l'éducation au sein de la famille et à l'école. C'est là où l'enfant peut acquérir les bonnes habitudes, à la fois de nutrition - avec des repas à heure fixe, la diversité des produits, légumes et fruits à consommer - et d'hygiène de vie, en intégrant la pratique de la marche et du sport entre les séquences de télévision et de jeux vidéo, qui font trop souvent la joie des enfants et préservent la tranquillité des parents ! Ne l'oublions pas, nutrition rime avec éducation.
Applaudissements

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en 2000 déjà, l'Organisation mondiale de la santé reconnaissait à l'obésité la qualification d'épidémie.
C'est dire les risques qui y sont liés. Nous les connaissons, il s'agit de la diminution de l'espérance de vie et de l'accroissement des risques cardiovasculaires. À cet égard, nous savons qu'un obèse a dix fois plus de risques qu'une personne de poids normal d'être traité pour les trois facteurs suivants - le diabète, l'hypertension, les anomalies des graisses du sang.
Les risques ne se limitent pas à l'aspect médical, puisque l'obésité a également des conséquences au regard de la société, avec l'exclusion et les discriminations à l'emploi, mais aussi avec le coût que fait peser cette épidémie sur notre système de santé.
Or, sous les apparences d'un débat d'ordre médical et même de santé publique compte tenu de l'ampleur du phénomène, la question de l'obésité soulève des interrogations allant au-delà des seules normes médicales.
Nous pourrions paraphraser un célèbre adage : nous ne sommes pas seulement ce que nous mangeons, mais ce que nous mangeons reflète la société dans laquelle nous vivons.
Parler de l'obésité, c'est introduire une réflexion sur les habitudes alimentaires en elles-mêmes certes, mais également sur la nature des produits entrant dans notre alimentation, sur nos rythmes de vie, le partage de notre temps entre vie professionnelle et vie privée.
C'est également aborder les évolutions de notre société : l'implication du travail à temps partiel et à horaires décalés.
C'est aussi évoquer les crises que nous rencontrons et qui se répercutent à tous les niveaux. Je pense, par exemple, à la précarisation, qui empiète sur les temps nécessaires au repos, à la préparation ou à l'éclatement des temps de repas.
Je l'indiquais préalablement, l'obésité et une bonne part des déséquilibres alimentaires trouvent à la fois leurs conséquences et leurs sources dans les évolutions de notre société, ses déséquilibres et ses crises.
Selon l'étude ObEpi de 2006 réalisée en collaboration avec l'INSERM, la fréquence de l'obésité « reste inversement proportionnelle aux revenus ». Ainsi, les revenus mensuels des personnes atteintes d'obésité représentent moins de 900 euros pour 19 % d'entre elles, se situent entre 1 200 et 2 900 euros pour 18 % d'entre elles, et s'élèvent à près de 5 000 euros pour seulement 5 % d'entre elles. Les chiffres sont clairs !
Une autre statistique qui montre que l'obésité progresse plus vite chez les femmes que chez les hommes vient confirmer ces chiffres. Dès lors, comment ne pas établir un lien entre ces données et le récent rapport du Conseil économique et social, qui confirme ce que nous dénoncions : les femmes sont en plus grande précarité que les hommes, puisqu'elles sont plus souvent soumises aux temps partiels imposés et aux conditions de travail les plus difficiles.
Autant dire, madame la ministre, que la précarisation accroît les risques d'obésité, sachant que la même étude témoigne de la progression constante et croissante des formes les plus graves d'obésité dans les foyers à faibles ressources financières.
Il faut donc agir et ce, à tous les niveaux, tant en France qu'à l'échelon européen.
La France présidera l'Union européenne à partir du mois de juillet prochain. Les pâles propositions du plan santé- jeunesse m'inquiètent quant à la capacité de notre pays d'être une force de propositions sur ce sujet.
Alors que, dans son Livre vert sur l'obésité, la Commission européenne faisait le constat de la nécessité de coordonner les politiques de luttes contre l'obésité, l'on regrettera tous, dans cette enceinte, que de ce Livre vert il ne reste rien, ou si peu, si ce n'est le témoignage de la force des lobbies et des groupes industriels.
Bien entendu, la priorité doit être donnée à la lutte contre l'obésité infantile. Encore une fois, il s'agit bien d'une question sociale et il nous faut faire le choix entre deux modèles de sociétés.
On ne peut ignorer, madame la ministre, que, depuis des années, votre majorité ne cesse de diminuer le nombre de poste de personnels parascolaires dans les établissements. Tous les moyens auront été bons : diminution budgétaire, transferts de personnels non compensés aux collectivités territoriales entre autres, moins d'adultes encadrant les cantines, moins de personnels techniques, ouvriers et de service, ou TOS. Espaces de fabrication à l'origine, les cantines se sont de plus en plus souvent muées en lieux de transformation, où l'on se contente de réchauffer et de distribuer les repas.
Quant aux médecins scolaires et aux nutritionnistes, ils manquent cruellement. On sait pourtant que le système scolaire pourrait être le lieu opportun pour un plan de grande envergure concernant l'éducation des plus jeunes à une alimentation saine et équilibrée. Combien de jeunes, inscrits dans nos établissements, ne font qu'un seul repas dans la journée, celui qui est distribué dans les écoles, collèges et lycées ?
C'est donc à l'école, au sens large, qu'il faut intervenir. Mais, pour ce faire, encore faut-il disposer de moyens humains et financiers, lesquels ne peuvent reposer sur la seule capacité des collectivités locales et territoriales.
La conception gouvernementale de la décentralisation a conduit à de grandes aggravations des disparités entre les régions et les départements. Les collèges et les lycées ne sont pas épargnés.
L'étude de l'ObEpi précise encore que l'obésité se mesure également sur le plan territorial. Le nord de la France, par exemple, connaît une expansion plus grande et plus rapide de l'obésité que le sud de notre pays. Et cela n'est pas du seul fait du « régime crétois » et des vertus de l'huile d'olive, même si ces dernières sont certaines.
Sourires

C'est aussi l'une des conséquences d'une économie marquée par une précarisation plus grande.
La réponse que nous devons envisager, que le Gouvernement doit élaborer, madame la ministre, doit prendre en compte cette réalité. Or, là encore, la question des produits utilisés par la ménagère pour composer le repas nous amène à nous interroger, au-delà de la simple question alimentaire. Les études des associations et de la presse le prouvent, ce sont les prix des hard-discounters et des produits vendus sous le nom des enseignes de la grande distribution qui ont le plus augmenté. Ce sont donc les produits les moins chers, ceux qui sont achetés par les familles les plus pauvres, qui ont connu une hausse plus importante, conduisant certaines des familles les plus nécessiteuses à opérer de nouveaux choix, à faire de nouveaux sacrifices.
Cela peut apparaître comme une anecdote, mais dans combien de familles le repas du soir se limite-t-il à des tartines et à un chocolat chaud, quand il n'est pas tout simplement sacrifié, faute de ressources suffisantes ? Voilà une conséquence supplémentaire de la baisse continue du pouvoir d'achat des Français !
Je regrette d'ailleurs, avec mes collègues du groupe CRC, que le Gouvernement s'entête à refuser une diminution de 1 % de la TVA sur les produits de première nécessité.
Avant de conclure, madame la ministre, je voudrais vous interroger sur votre plan « Santé des jeunes ».
Un premier plan avait été mis en place sous l'ancien gouvernement. Je regrette sincèrement qu'un réel bilan n'en ait pas été réalisé, notamment quant à la participation des industriels de l'agroalimentaire. En effet, ceux-ci, ne l'oublions pas, occupaient dans le précédent plan une place importante. Voilà donc un curieux paradoxe lorsque l'on connaît les intérêts financiers que représente le marché des jeunes et des adolescents ! Une preuve récente en est la levée de bouclier qu'a suscitée, auprès d'un grand groupe industriel, la décision d'une grande enseigne de la distribution de supprimer la vente des produits chocolatés aux caisses de ses magasins. On peut encore citer la récente et grande campagne publicitaire de l'industrie du sucre dénonçant l'anti-campagne dont elle serait victime.
Or, madame la ministre, si, à la lecture de votre plan, il semble que vous fassiez cesser cette curieuse association, rien ne paraît concret. Il nous semble pourtant évident, à moi-même et à mes collègues du groupe CRC, que l'école doit concentrer tous nos efforts. Nous avons besoin d'un grand plan d'éducation populaire à l'équilibre alimentaire, dont l'école, au sens large, doit être un acteur incontournable. C'est la seule garantie d'une action coordonnée sur le plan national si, bien entendu, le Gouvernement décidait de se donner les moyens et l'ambition de traiter l'extension de cette pandémie.
Madame la ministre, vous parlez d'améliorer la qualité des cantines scolaires sans jamais évoquer les moyens financiers. Vous ne dites pas un mot, par exemple, sur la formation, le rôle et le nombre des nutritionnistes ! Comment, dès lors, faire en sorte que les parents soient correctement informés sur les qualités nutritionnelles des repas distribués ? Je me permettrai de formuler une proposition à cet égard : pourquoi ne pas envisager de transformer la « semaine du goût » en une « semaine du goût et de l'équilibre alimentaire » au cours de laquelle les élèves, associés aux professionnels de santé, participeraient à l'élaboration et à la réalisation des repas ? Des expériences intéressantes en la matière ont eu lieu, notamment à l'étranger.
À cette semaine pourraient également être associés les agriculteurs locaux, puisqu'une chose est certaine : un repas équilibré et sain, ce sont de bons produits et de bonnes pratiques culinaires.
Votre plan ne dit pas un mot sur la mise à disposition, tout au long de la journée, de boissons sucrées et de barres chocolatées par le biais des distributeurs. On sait combien cette consommation est néfaste. Mais on sait également que ces distributeurs participent au financement des fonds d'action sociale des établissements scolaires, lesquels contribuent à exonérer certaines familles les plus modestes des frais de restauration ou permettent aux élèves les moins riches de participer à des séjours linguistiques.
Si la suppression ou le remplacement de ces distributeurs s'avère utile, il faut nous interroger sur la manière de compenser les pertes que l'une et l'autre occasionneront.
Votre plan évoque une possible association des collectivités territoriales. Mais de quelle association s'agit-il ? Envisagez-vous, sans le dire réellement, que ce seront les communes, les départements et les régions qui devront demain financer ces améliorations ?
Votre plan viserait aussi à améliorer la formation des professionnels afin de « faire évoluer les programmes de formation initiale ». Pourtant, là encore, il n'y a rien de concret. De quelle formation s'agit-il ? Par quelle structure sera-t-elle organisée ? Par qui sera-t-elle financée et pour quel montant ? Votre plan ne dit rien !
Vous dites encore vouloir favoriser la pratique d'activités sportives sur les plans scolaire et universitaire. Mais, là encore, on peut légitimement s'interroger. Cette proposition n'est-elle pas contradictoire avec les déclarations du ministre de l'éducation nationale, qui dit vouloir recentrer l'école sur ses fondamentaux ?
Le sport, c'est fondamental !

C'est aussi méconnaître la réalité de milliers d'étudiants qui enchaînent cours et petits boulots, leur priorité étant non la pratique du sport universitaire mais le moyen de gagner de quoi payer leur loyer, leurs frais d'inscription et leur nourriture.
D'une manière plus générale, à l'exception de la pratique sportive à l'école, votre plan se caractérise, concernant la lutte contre l'obésité, par une absence quasi totale de financement. La partie dédiée à la lutte contre l'obésité est d'ailleurs la seule à ne pas contenir un volet financement.
Votre plan, sur ce sujet, madame la ministre, ne risque-t-il donc pas de se limiter à un simple appel aux bonnes volontés ? On sait ce qu'il en sera pour les industriels. Une fois de plus, vous vous tournerez vers les collectivités territoriales, déjà très lourdement affectées par des transferts de compétences non compensés et par de nouvelles charges, pour financer votre plan qui, pourtant, relève de la politique nationale en matière de santé.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Mme Nathalie Goulet. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, pardonnez à l'avance les éléments redondants de mon intervention, mais les derniers orateurs ne peuvent guère échapper à cet écueil. Néanmoins, mieux vaut se répéter que se contredire !
Sourires

Madame le ministre, je suis déjà intervenue sur ce sujet, d'une part, lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale, d'autre part, lors de l'examen des crédits de la mission « Santé ». Je vous redis mon attachement aux politiques de prévention, notamment à celles qui sont liées à l'éducation en matière alimentaire.
Je regrette d'ailleurs que le ministre en charge des sports n'ait pas pu prendre part à nos travaux.
Il n'est que secrétaire d'État, et j'ai pleine compétence sur le dossier des sports !

L'obésité est une pandémie ; c'est aussi un facteur aggravant d'autres maladies. Avec 12, 4 % d'adultes obèses, auxquels s'ajoutent 29, 2 % de personnes en surpoids, ce sont au total 41 % des Français adultes qui sont en surcharge pondérale
Ce fléau n'épargne pas les plus jeunes, qui sont 1, 5 million à souffrir d'obésité.
Au-delà de l'image corporelle, l'obésité a des conséquences graves sur la santé : élévation des graisses dans le sang entraînant de nombreux problèmes cardiovasculaires, insuffisance respiratoire, diabète, etc.
Les pathologies liées à l'obésité entraînent des coûts considérables pour les individus et pour la collectivité. La Caisse nationale d'assurance maladie a calculé - M. About l'a déjà indiqué - que, par rapport au reste de la population, les personnes obèses dépensent en moyenne 27 % de plus en soins de ville et 39 % de plus en pharmacie.
M. le président de la commission des affaires sociales acquiesce.

D'après l'OCDE, « analogues à ceux d'un vieillissement de vingt ans », les problèmes de santé chroniques associés à l'obésité sont « très supérieurs aux effets estimés du tabagisme ou de la consommation excessive d'alcool », et l'augmentation des dépenses de santé liées à l'obésité sera donc, dans l'avenir, supérieure à la progression des dépenses de santé liées au tabagisme.
Il est d'autant plus nécessaire d'agir rapidement que l'obésité connaît une progression en France comparable à celle qui était observée sur le continent nord-américain voilà trente ans.
Néanmoins, je demeure quelque peu perplexe quant aux effets de la loi. La comparaison avec les pratiques de nos voisins est intéressante pour éviter que la législation ne se limite à suppléer des parents démissionnaires.
Au Royaume-Uni, la Food standards agency a élaboré un programme d'étiquetage des produits au moyen d'un feu tricolore. C'est une manière pour les enfants les plus jeunes de reconnaître les produits qui seront pour eux les meilleurs.
Cette question de l'étiquetage, dont nous avions parlé également avec Mme Kosciusko-Morizet lors de la discussion du projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés, pourrait constituer un vrai sujet pour la présidence française de l'Union européenne, même si, je le sais bien, madame le ministre, cette liste s'allonge de jour en jour. Il n'en demeure pas moins qu'un tel étiquetage au niveau européen, similaire à celui qui existe pour les machines à laver et facilement identifiable par les jeunes enfants, qui sont évidemment les premiers touchés, serait probablement intéressant.
Au Danemark, les communes disposent d'importantes compétences en matière de santé, et les autorités sanitaires considèrent qu'elles constituent le cadre idéal pour les actions dans ce domaine. Des crédits spécifiques leur sont accordés dans la lutte contre l'obésité. En novembre 2004, les principaux partis politiques danois ont conclu un accord sur la répartition de ces crédits spécifiques ; pour 2008, 15 millions d'euros ont été alloués au financement d'initiatives municipales.
Les communes, comme les intercommunalités, sont au coeur de l'action ; elles peuvent non seulement déterminer les endroits et les pratiques, mais également assurer le suivi. En l'espèce, le travail à l'échelle locale est aussi important que les grandes opérations nationales, dont on ne perçoit parfois pas immédiatement les résultats sur le terrain.
On pourrait très bien imaginer ce type de démarches, qui, sans être une compétence nouvelle dévolue aux intercommunalités, constituerait pour elles une option.
De nombreuses communes et structures intercommunales du département de l'Orne ont, en la matière, pris de nombreuses initiatives, notamment la mise en place de cantines « bio ». Ces initiatives locales servent la politique nationale et contribuent à sa réussite.
En Espagne, la Confédération espagnole des boulangers s'est engagée à réduire progressivement le taux de sel dans ses produits, lequel passerait de 2, 2 % à 1, 8 %.
Au Canada, dans les zones défavorisées, des programmes de nutrition ont été mis en place, financés grâce à des fonds privés et publics. Le cofinancement peut représenter une solution.
Ces programmes permettent de fournir des suppléments de nourriture au moment du goûter et du petit-déjeuner et, dans une moindre mesure, du déjeuner. Ils s'adressent à tous les élèves d'un établissement, sans tenir compte de leur situation socio-économique.
Ils sont parfois associés à la promotion d'une nourriture saine, mais les problèmes de financement - nous risquons nous aussi d'y être confrontés - empêchent souvent de fournir des aliments variés et de bonne qualité.
Dans la plupart des provinces du Canada, la taxe sur la vente au détail s'applique aux boissons gazeuses, aux jus de fruits, aux bonbons et aux en-cas - chips, bretzels, pop-corn, cacahuètes, etc. -, alors qu'elle ne pèse pas sur d'autres denrées. Le produit de cette taxe est affecté au financement de programmes de lutte contre l'obésité.
Aux États-Unis, exemple de ce qu'il ne faut pas faire, certains États ne se sont pas limités à l'adoption de mesures strictement pédagogiques. Ainsi, l'Arkansas a adopté en 2003 une loi obligeant les écoles à adresser aux parents un courrier mentionnant l'indice de masse corporelle de leurs enfants et des explications relatives aux répercussions possibles sur leur santé, ainsi que des informations concernant le régime alimentaire et l'activité physique.
Les États de l'Illinois et de la Californie, quant à eux, ont adopté des dispositions prévoyant le dépistage du diabète de type II dans les écoles.
Je n'ose pas mettre en avant l'Orne comme département pilote, puisque celui-ci ne dispose que de sept médecins scolaires pour 53000 élèves. L'idée que les médecins scolaires puissent éventuellement procéder au dépistage de l'obésité pourrait être une piste, mais le problème du suivi se posera alors.
Madame le ministre, les efforts que vous faites pour lutter contre l'obésité infantile sont extrêmement importants, et nous ne pouvons que soutenir toutes ces mesures, tant à l'échelon local qu'à l'échelon national.
Là encore, les parents ont un rôle majeur à jouer, même si les mesures que nous avons envisagées tout à l'heure, s'agissant notamment de la publicité, doivent être examinées attentivement.
Madame le ministre, vous avez une vraie croisade à mener ! M. Laporte et ses amis sportifs - nos amis sportifs ! -pourraient être des vecteurs importants auprès des enfants dans les écoles. En effet, la promotion du sport est essentielle pour tout ce qu'elle véhicule ; c'est aussi facile que la vente de portables, mais sûrement beaucoup plus efficace !
Nous sommes tous très attachés à la politique que vous mettez en place, et nous vous soutiendrons donc dans votre action.
Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées de l'UMP.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, notre collègue Gérard Dériot a eu raison de poser cette question orale avec débat. La nécessité de prendre des mesures pour remédier à cette équation entre la malnutrition, l'obésité et les conséquences sur la santé a suscité une quasi-unanimité des intervenants dans cet hémicycle.
Nous sommes tous d'accord sur le principe suivant : mieux vaut prévenir que guérir, comme l'a excellemment dit Janine Rozier dans son intervention.
Notre collègue Jean-Pierre Godefroy a affirmé tout à l'heure que 91 % des parents cédaient aux demandes de leurs enfants réclamant l'achat de tel ou tel produit dont ils ont vu la publicité à la télévision.
Madame la ministre, pourrait-on envisager d'intégrer dans les programmes scolaires des cours de nutrition et de gestion d'un budget familial ?
Je suis agriculteur de profession, et j'ai constaté sur le terrain que la formation reçue par de jeunes agriculteurs dans un lycée agricole a une incidence extraordinaire sur la conduite des exploitations agricoles. Connaissant l'influence des enfants sur leurs parents, je me dis que l'apprentissage de la nutrition par les jeunes aura des conséquences sur les choix de leurs parents concernant l'alimentation et la gestion du budget familial. Mieux vaut préparer soi-même un plat de carottes râpées, plutôt que d'en acheter une barquette !
Madame la ministre, serait-il possible de suggérer à M. le ministre de l'éducation nationale que, dans le cadre du parcours scolaire, au collège ou au lycée, des cours soient dispensés aux jeunes, afin de permettre à ces derniers de mieux appréhender ces problèmes ? Les conséquences pour les familles sont en effet beaucoup plus importantes qu'on ne le pense.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
Monsieur Dériot, comme vous l'avez fort justement souligné, l'obésité représente aujourd'hui en France un enjeu majeur de santé publique.
J'irai plus loin : l'obésité et le surpoids constituent désormais un enjeu majeur pour notre cohésion sociale et notre solidarité nationale.
Il est loin le temps où nos peintres académiques figuraient, dans les chairs abondantes de leurs modèles, le triomphe d'une bourgeoisie prospère et rayonnante !
Sourires
Notre réalité, aujourd'hui, la voici : en France, lorsque vous faites partie des plus pauvres, la probabilité que vous soyez obèse ou en surpoids est supérieure à 30 %. En revanche, cette proportion décroît nettement dans les milieux les plus favorisés. L'obésité et le surpoids sont devenus des marqueurs sociaux.
Si l'obésité et le surpoids dépendent de facteurs multiples, les habitudes alimentaires jouent un rôle déterminant dans la prévention des risques que comportent ces maladies.
Nous devons nous mettre en ordre de bataille. Il serait faux d'affirmer aujourd'hui que les Français sont égaux dans le choix de leur alimentation.
En tant que ministre de l'égalité et de la qualité des soins, j'appelle tous les acteurs du monde de la santé, la société civile et le secteur agro-alimentaire à faire preuve de responsabilité et de solidarité. Nous devons donner aux Français les moyens de reprendre la maîtrise de leur poids et donc de leur santé.
Le temps n'est plus aux manoeuvres en solitaire, aux initiatives isolées. Il nous faut travailler et agir ensemble, parce que le drame sanitaire auquel nous devons nous mesurer dépasse de loin les intérêts particuliers. Il engage notre solidarité nationale.
En 2001, le programme national nutrition santé, ou PNNS, avait fixé un certain nombre d'objectifs chiffrés relatifs à la nutrition et à l'alimentation des Français.
L'objectif était de diminuer de 20 % la prévalence du surpoids et de l'obésité chez l'adulte, et d'empêcher que le surpoids et l'obésité n'augmentent chez les enfants.
Avant d'évoquer les nouvelles étapes dans ce combat contre l'obésité, je me dois de dresser avec vous le bilan du premier PNNS.
Coordonné par mon ministère, le PNNS engage la participation active des ministères de l'éducation nationale - cela a été évoqué à de nombreuses reprises dans ce débat -, de l'agriculture, de la consommation et des affaires sociales.
Les résultats sont là : des progrès sensibles ont été réalisés. À cet égard, je répondrai à M. Bret et à Mme Goulet que le programme français national nutrition santé est un modèle pour nombre de pays, en particulier les États européens, qui puisent dans notre démarche des leçons importantes pour mettre en oeuvre leur politique de santé publique.
Du point de vue de la nutrition, l'objectif était de faire reculer le nombre de petits consommateurs de fruits et légumes. Alors que les Français mangeant moins de 3, 5 portions de fruits et légumes par jour représentaient 60 % de la population, l'objectif était, en 2001, de faire passer cette proportion à 45 %. Les résultats dépassent ces espérances, puisque désormais seuls 35 % des Français consomment trop peu de fruits et de légumes.
L'objectif de consommation moyenne de sel de 8 grammes par jour est presque atteint. En dix ans, la consommation excessive de sel a reculé : elle ne touche plus que 10, 5 % des hommes et 1, 7 % des femmes.
Par ailleurs, l'activité physique chez les femmes et les hommes a progressé : près des deux tiers des Français parviennent aujourd'hui à exercer au moins trente minutes d'activité physique par jour.
Sur d'autres points, en revanche, les avancées sont insuffisantes.
Ainsi, la consommation de féculents, pourtant recommandée, demeure insuffisante. Celle du pain a même tendance à diminuer.
À l'inverse, la consommation de produits riches en sucres rapides ne baisse pas. Elle est encore excessive chez un trop grand nombre d'enfants.
La consommation moyenne de fibres n'est que de 16 grammes par jour pour un objectif de 25 grammes par jour. Quant aux lipides, et notamment les acides gras saturés, ils restent beaucoup trop présents dans l'alimentation de nos compatriotes.
Les habitudes alimentaires des jeunes, en particulier, sont très perfectibles : ainsi, un jeune sur six affirme ne pas se nourrir de façon équilibrée, et, parmi eux, un étudiant sur trois se plaint d'une alimentation déréglée.
Les chiffres de la prévalence du surpoids et de l'obésité ne sont pas bons. Un certain nombre d'entre vous l'ont rappelé, et je ne me lasserai pas de le redire. Près de 32, 4 % des adultes français sont en surpoids et 16, 9 % sont obèses.
Les enfants paient un lourd tribut à cette épidémie : 14, 3 % des enfants de trois à dix-sept ans sont en surpoids et 3, 5 % sont obèses.
Ce drame sanitaire masque une injustice sociale. En effet, l'écart se creuse désormais entre les enfants de cadres et les enfants d'employés ou d'ouvriers. Or 80 % des enfants qui sont obèses à dix ans le resteront à l'âge adulte. Une fois n'est pas coutume, je suis d'accord avec le diagnostic qu'a rappelé M. Robert Bret !
Vous connaissez bien les conséquences de l'obésité ou du surpoids sur la santé : des risques accrus de diabète, de maladies cardio-vasculaires, voire de cancers. Être en surpoids, être obèse, c'est s'exposer à vivre moins bien, et moins longtemps.
Devant cette injustice sanitaire, nous devons nous mobiliser, et entrer dans une démarche volontaire, cohérente et coordonnée.
Les premières évaluations du PNNS mettent en lumière l'implication croissante des partenaires institutionnels, sous l'égide du ministère de la santé.
Les collectivités territoriales se mobilisent devant ces enjeux. Plus de cent vingt d'entre elles ont aujourd'hui signé la charte des « villes actives du PNNS ». Les conseils généraux sont appelés depuis le début de l'année à signer eux aussi une charte « départements actifs du PNNS ». Permettez-moi de saluer ici le conseil général de la Moselle, qui vient d'être le premier à signer cette charte.
Les messages que nous avons à faire passer autour des questions de santé et de nutrition sont nombreux, et les canaux par lesquels nous pouvons les diffuser sont complémentaires.
Aujourd'hui, nous devons viser la communication la plus cohérente et la plus large possible, afin que nos concitoyens puissent prendre la mesure de ce qui se joue pour eux autour de leur alimentation.
L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, l'INPES, a diffusé près de 25 millions de guides nutrition du PNNS.
Près de 500 000 outils destinés au dépistage du surpoids et de l'obésité chez les adultes et les enfants ont été distribués aux professionnels de santé.
Des campagnes nationales ont été menées pour inciter à la pratique d'une activité physique quotidienne, la limitation de la consommation de produits gras et sucrés et la promotion de la consommation de fruits et légumes. Leur impact, évalué par l'INPES, a dépassé les espérances. Une véritable prise de conscience a eu lieu.
Aujourd'hui, les pouvoirs publics ne sont plus seuls à agir, et je m'en réjouis. Je suis particulièrement satisfaite de pouvoir désormais compter sur le soutien de nombreux industriels, des distributeurs et des médias, qui s'engagent en faveur de cette action.
Nous proposons aujourd'hui des chartes d'engagements volontaires de progrès nutritionnel aux entreprises du secteur alimentaire. Une première charte vient d'être signée. D'autres entreprises mettent en avant des initiatives neuves. En signant ces chartes, l'État et ses partenaires privés s'engagent à faire respecter des critères de qualités rigoureux et objectifs. L'observation de Gérard Dériot concernant la taille des portions est intéressante. Les professionnels devraient en tenir compte dans leurs évaluations.
C'est dans cet esprit de transparence, et afin d'assurer un suivi permanent de la qualité nutritionnelle des aliments, que je viens de mettre en place, avec les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, un Observatoire de la qualité de l'alimentation, ou OQALI.
Cet observatoire aura pour mission d'évaluer le rapport qualité-prix des aliments en tenant compte de la valeur nutritionnelle de ces derniers. Ce nouvel outil permettra aux Français de mieux gérer leur alimentation.
Aujourd'hui, nous l'avons tous dit, en particulier Gérard Dériot et Janine Rozier, ce sont les enfants qui retiennent d'abord notre attention.
Vous avez évoqué le dépistage précoce à l'école de l'obésité et du surpoids.
Dans le cadre du PNNS, tous les professionnels de médecine scolaire et de protection maternelle et infantile, ou PMI, ont reçu des outils pratiques pour assurer le dépistage du risque d'obésité chez le jeune enfant, qu'ils pratiquent désormais systématiquement.
Nous devons à présent nous interroger, au sein du comité de pilotage du programme national nutrition santé, sur les suites à donner à cette consultation.
Que faire une fois le diagnostic établi à l'école ou en PMI ? Comment permettre au médecin traitant d'intervenir, et dans quel cadre ? Comment, en un mot, tisser un véritable réseau de santé, intégrant d'autres professionnels, qu'ils soient spécialistes de l'activité physique ou de la diététique par exemple, pour mieux tenir compte des données familiales et sociales affectant les comportements alimentaires ?
La Haute autorité de santé a été saisie pour formuler des recommandations afin d'améliorer les pratiques professionnelles et de mettre en place une prise en charge de qualité.
Pour nos enfants, l'essentiel se joue à l'école. Nous entendons à cet égard agir sur deux leviers : d'une part, en interdisant la promotion commerciale, ouverte ou déguisée, de certains produits alimentaires ; d'autre part, en améliorant la qualité des repas scolaires.
Monsieur Revet, comme vous l'avez rappelé avec raison, sur ces sujets, ce sont bien souvent les enfants qui éduquent les parents. Ce fut le cas pour le geste écologique, ...
... il en sera sans doute de même pour le geste nutritionnel.
Nous sommes en train de développer, en partenariat avec les services de l'éducation nationale, des outils qui permettront d'assurer la formation que vous appelez de vos voeux à juste titre.
Lors d'une conférence de presse, en février dernier, j'ai annoncé plusieurs mesures importantes et attendues pour prévenir la surcharge pondérale et pour promouvoir la santé nutritionnelle chez les enfants. Ces mesures ont d'ailleurs été saluées par l'ensemble des collectifs associatifs qui se mobilisent sur ces questions.
Un texte réglementaire encadrant la qualité nutritionnelle des repas servis à la cantine sera publié pour la rentrée 2008. Il reprendra les recommandations du groupe d'étude des marchés de restauration collective et de nutrition de 2007.
Mes services travaillent en concertation avec les ministères de l'agriculture et de la pêche, de l'éducation nationale, de l'intérieur et des collectivités territoriales concernées.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche s'est engagé à rendre plus abordable la consommation des fruits et des légumes.
Au demeurant, limiter la question de l'accès à une nutrition équilibrée à de simples considérations financières serait extraordinairement réducteur. On ne peut qu'être frappé que des enfants se voient proposer au goûter des confiseries ou des pâtisseries très élaborées alors que le meilleur goûter, c'est une tranche de pain, qu'ils se voient proposer des sodas très riches et très sucrées alors que la boisson d'accompagnement, c'est bien évidemment l'eau et, ajouterai-je, l'eau du robinet, qui, dans 90 % de nos communes est d'excellente qualité. On ne peut qu'être frappé aussi de l'achat de produits laitiers extrêmement élaborés alors que des produits plus simples offrent la même valeur nutritive pour un prix beaucoup plus abordable.
Avec l'appui des collectivités territoriales volontaires, le ministère de l'agriculture et de la pêche apportera donc son soutien financier à la distribution gratuite des fruits dans plus de mille écoles, dans des zones urbaines et rurales défavorisées, dès la rentrée 2008. À terme, cette distribution sera généralisée grâce à un financement communautaire.
Le ministère de l'agriculture expérimente par ailleurs l'implantation de distributeurs de fruits dans les lycées agricoles. Si les résultats se montrent à la hauteur des promesses, cette expérience pourra être généralisée.
Je vous rappelle à cet égard, monsieur Bret, que les distributeurs de confiseries et de produits élaborés sont d'ores et déjà interdits en milieux scolaire. Il n'est peut-être pas inutile de le répéter du haut de cette tribune à l'intention des responsables d'établissement qui ne respecteraient pas la réglementation.
Les messages sanitaires figurant dans les publicités pour les aliments et les boissons sucrées, salées ou à base d'édulcorants de synthèse sont désormais connus de tous.
Le législateur avait prévu, dans la loi du 9 aout 2004, que ces publicités contiendraient une information de santé, faute de quoi l'annonceur ou le promoteur s'acquitterait d'une contribution financière versée à l'Institut national pour la prévention et l'éducation à la santé, l'INPES.
Le dispositif est en place depuis un an. L'INPES a pu établir un premier bilan. Ce bilan est globalement positif, sous réserves des quelques bémols que vous avez évoqués.
Les quatre messages sanitaires sont désormais connus par une très large majorité de Français. À une écrasante majorité, nos concitoyens trouvent ces messages clairs et efficaces. Plus de 20 % des personnes interrogées auraient ainsi modifié leurs habitudes de consommation et plus d'un tiers des enfants ont retenu le message.
La quasi-totalité des annonceurs concernés a choisi d'inscrire ces messages dans leurs publicités, ce qui était le but visé par la loi. Le montant de la taxe qui sera versée à l'INPES, pour la première fois cette année, a été estimé entre 900 000 et 3 millions d'euros.
Cependant, monsieur Dériot, comme vous-même et d'autres orateurs l'avez souligné à juste titre, il faut aller plus loin. Nous ne pouvons nous contenter de ces premiers résultats, si encourageants soient-ils. C'est pourquoi je souhaite que nous adoptions deux mesures supplémentaires.
La première, évoquée par M. Jean-Pierre Godefroy, est la suppression de la publicité mettant en avant certains aliments et boissons dans les programmes destinés aux enfants.
Comment, en effet, pouvons-nous croire que de jeunes enfants sont libres d'interpréter ces messages ? Comment des enfants auraient-ils les moyens de faire la part entre ce qui est bon pour eux et ce qui est bon pour les annonceurs ?
C'est un point sur lequel presque tous les Français s'accordent : plus de 60 % des enfants demandent à leurs parents d'acheter ce qu'ils ont vu à la télévision. Et plus de 90 % de leurs parents admettent ne pas savoir le leur refuser.
J'ai ouvert la concertation sur cette question en mars dernier. Aujourd'hui, j'en appelle, une fois encore, à la responsabilité et à la solidarité des annonceurs.
Nous connaissons les contraintes des industries agro-alimentaires et celles des médias. Mais je sais aussi, je le répète, que leur image à long terme ne bénéficiera pas de ce qui pourrait être interprété comme un manque de fair-play, pire comme un manque de responsabilité à l'égard de nos enfants.
La concertation, ouverte à tous les partenaires, a commencé début mars. Le groupe de travail s'est réuni à trois reprises ce mois-ci afin de parvenir à un cadre d'engagements volontaires.
Je privilégierai le dialogue avec tous les acteurs économiques de ce secteur. Toutefois, monsieur Godefroy, je tiens à rappeler avec une grande fermeté que la période du dialogue est limitée et qu'elle ne saurait constituer un alibi à l'inaction. Si nous ne parvenons pas à trouver ensemble un compromis, le Parlement s'en chargera !
Comme vous l'avez rappelé, monsieur Dériot, une proposition de loi déposée par plus de cent soixante-dix députés est prête à être soumise au vote.
Par ailleurs, c'est la seconde mesure, nous déciderons la suppression des rayons de confiseries et de sucreries aux caisses des magasins. Un grand distributeur a anticipé cette disposition. Là encore, je souhaite que nous puissions travailler sur la base d'un engagement volontaire.
Songeons à ce que cela signifie d'être démuni, à ce que cela signifie de devoir faire attention à son budget ! Lorsque vous êtes obligé de dire très souvent « non » à votre enfant, il faut beaucoup de courage pour ne pas lui céder quand il vous demande un tout petit rien au supermarché, une friandise qui lui fera plaisir.
En lui achetant ces sucreries, non seulement vous rassurez votre enfant sur votre volonté de le satisfaire, mais vous vous rassurez aussi sur votre capacité à être une mère, un père aimants. Vous croyez, de bonne foi, agir en bon parent.
Réfléchissons à l'organisation de nos supermarchés ! Pour nombre d'entre nous, faire ses courses représente moins une satisfaction qu'une multitude de petites frustrations.
Lorsqu'on passe d'un rayon à l'autre pour remplir son chariot, on consent à toute une série de renoncements, on compare les prix, on repose les produits dont l'achat ne serait pas raisonnable. Cette expérience de la frustration, tout le monde, adultes et enfants, l'éprouve, même sans en avoir conscience.
À la caisse, ces tensions accumulées retombent. Et c'est là, dans ce temps d'attente vide et lassé, que l'on se tourne machinalement vers des confiseries inutiles, sans autre envie que d'effacer le goût de frustration laissé par un long parcours entre les rayons.
M. Jean-Pierre Godefroy applaudit.
C'est pourquoi je souhaite que nous nous asseyions ensemble autour de la table de négociation.
J'ai regretté l'absence de certains acteurs économiques lors des concertations qui ont eu lieu. Je tiens à répéter encore une fois qu'ils resteront les bienvenus jusqu'au bout, jusqu'à ce que, avec eux ou sans eux, nous prenions des décisions.
Mme Nathalie Goulet a évoqué l'étiquetage nutritionnel des aliments.
Un projet de directive européenne, qui devrait être publiée d'ici à la fin de 2009, doit rendre la mention de cet étiquetage obligatoire, ainsi que le ministère de la santé le demande depuis plusieurs années. Vous le constatez, nous avançons.
Vous avez également souligné, madame - et je ne me lasserai pas de répéter que je suis la ministre de la santé, des sports, de la jeunesse et de la vie associative -, que la prévention de l'obésité infantile passe par la valorisation de l'activité physique. Le PNNS prend en compte l'activité physique au même titre que la nutrition.
D'ailleurs, en dessinant ce nouveau périmètre ministériel et en réunissant la santé, la jeunesse et les sports sous une seule autorité, le Président de la République a témoigné de sa volonté d'agir sur ces deux aspects en même temps et dans un même mouvement.
Les initiatives locales en faveur de l'activité physique et sportive sont essentielles. La promotion du sport à l'école est une priorité : le Centre national pour le développement du sport, le CNDS, participe d'ores et déjà au financement de programmes de développement du sport, en particulier pour les jeunes des quartiers populaires.
Mon ministère travaille par ailleurs avec les services de l'éducation nationale pour augmenter le nombre d'heures d'activités sportives, avec l'appui du CNDS, dont les crédits ont été augmentés, vous vous en souvenez, lors de la discussion du projet de budget pour 2008.
Plus de cent trente villes actives du PNNS ont signé une charte pour promouvoir la bonne nutrition sur leur territoire. Nombre d'entre elles réalisent des actions en faveur de l'activité physique. Les villes actives du PNNS sont actuellement en train de se regrouper en réseau afin de dialoguer, de mettre en commun des idées, des talents et des initiatives pour élaborer des projets concrets en direction des habitants.
Je tiens à vous apporter quelques précisions sur le fonctionnement du PNNS.
Son budget pour 2008 est fixé à 15, 3 millions d'euros.
Le PNNS est un programme de santé publique. Son comité de pilotage, qui se réunit chaque mois sous l'égide de mon ministère, est composé d'une quarantaine de représentants : ministères, agences, assurance maladie, Haute autorité de santé, collectivités territoriales, acteurs économiques majeurs, experts des domaines de la santé et des sciences sociales.
Ce comité met en avant les orientations stratégiques définies par le Comité national de santé publique et évalue leur impact. Ses travaux sont publiés chaque année sous la forme d'un bilan transmis au Comité national de santé publique par le président du comité, le professeur Serge Hercberg, à qui je souhaite rendre hommage pour son engagement de tous les instants.
Dans le domaine de la santé, les inégalités territoriales recoupent bien souvent les inégalités sociales.
Dans la loi de financement de la sécurité sociale de 2008, j'ai donné des outils pour mener des politiques de santé publique adaptées en ouvrant pour les médecins la voie à d'autres formes de rémunération. Il est bien évident que le paiement à l'acte ne permet pas de rémunérer des politiques de santé publique.
Je souhaite maintenant aller plus loin. La création des agences régionales de santé m'en offrira la possibilité. Ce sera le cas notamment dans la région Nord-Pas-de-Calais, où la prévalence de l'obésité infantile constitue un marqueur social territorial. Ainsi, les agences régionales de santé seront les outils qui nous permettront de mener des politiques de santé publique adaptées et de mobiliser l'ensemble des acteurs.
Ces agences seront un atout pour le PNNS. Elles nous permettront de décliner localement les actions de lutte contre l'obésité, au plus près des particularités territoriales, en fédérant l'ensemble des acteurs locaux.
Monsieur About, vous avez consacré l'essentiel de votre intervention à la taxe nutritionnelle. Il n'est un secret pour personne que je suis un défenseur de cette taxe nutritionnelle, mais d'une taxe nutritionnelle « intelligente ».
Comme vous l'avez souligné, il devra s'agir d'une taxe nutritionnelle dédiée, avec un fléchage de la fiscalité écologique en direction de l'assurance maladie.
Cette taxe devra être intégrée à un plan de santé publique de lutte contre l'obésité, et les raisons de sa création devront être expliquées aux Français.
Nous sommes engagés dans une réflexion globale sur le financement de notre système de santé et de l'assurance maladie. Des décisions vont être prises. Elles trouveront sans doute une concrétisation lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 et s'inscriront dans les éléments structurants de santé publique qui feront l'objet du grand projet de loi de modernisation de l'organisation de la santé dont nous discuterons à l'automne. Il est inutile de préciser que les arbitrages sur ce sujet seront rendus au cours de l'année !
Mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à remercier Gérard Dériot d'avoir pris l'initiative de ce débat ainsi qu'à tous ceux d'entre vous qui sont intervenus, donnant lieu à une discussion large et très intéressante.
Nombre de propositions ont été formulées ce matin.
Les maladies dues au surpoids touchent en priorité les plus faibles, les plus démunis d'entre nous, et j'appelle chacun d'entre nous à une véritable éthique de la responsabilité. Je tiens à réitérer devant vous, mesdames, messieurs les sénateurs, l'engagement sans faille qui sera celui du Gouvernement dans cette lutte qui se déploie sur tant de fronts.
Applaudissements sur l'ensemble des travées

Assurément, madame la ministre, le sujet n'est pas clos et nous aurons sans doute l'occasion de l'aborder de nouveau à de nombreuses reprises, car il est crucial : il concerne notre jeunesse, il concerne toute la société et son avenir.
La parole est à M. Gérard Dériot.

Au nom de l'ensemble de mes collègues, je voudrais, madame la ministre, vous remercier d'avoir pris le temps de venir nous exposer l'état d'avancement des travaux sur ce sujet extrêmement important qu'est l'obésité, qui, vous avez pu le constater, rassemble tout le monde.
Nous avons bien pris acte de votre engagement personnel, engagement dont vous avez déjà donné des preuves par votre action. Au demeurant, en la matière, tout repose d'abord sur la prévention et celle-ci ne pourra être efficace que dans la durée. Nous souhaitons donc que vous restiez extrêmement vigilante et que des moyens suffisants soient affectés à cette prévention pour qu'elle puisse non seulement se poursuivre, mais encore aller plus loin.
Sachez, madame la ministre, que nous serons à vos côtés pour vous aider dans votre tâche.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

En application de l'article 83 du règlement, je constate que le débat est clos.

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, nous allons donc examiner, en seconde lecture, le projet de loi relatif à la nationalité des équipages de navires.
Ce projet a été adopté en première lecture le 18 septembre 2007 par votre assemblée, puis, le 30 janvier dernier, par l'Assemblée nationale.
Vous vous en souvenez, ce projet de loi ouvre à tout ressortissant communautaire les fonctions de capitaine et de suppléant des navires immatriculés au premier registre ou au registre international français, le RIF. Il s'inscrit, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer à la Haute Assemblée, dans une démarche de modernisation du secteur de la marine marchande et d'adaptation aux enjeux de la mondialisation, dont il a été amplement question ces jours-ci dans le cadre de la réforme des ports que mène actuellement le Gouvernement et qui fera l'objet d'un projet de loi avant la fin de la présente session.
Il s'agit en premier lieu d'adapter notre droit aux évolutions du droit communautaire.
La Cour de justice des Communautés européennes, vous le savez, a condamné la France la semaine dernière - et le fait que le présent projet de loi soit en cours d'examen par le Parlement n'a pu l'empêcher - pour manquement aux obligations définies à l'article 39 du traité de la Communauté européenne : la législation française ne peut plus désormais exiger que le capitaine et l'officier suppléant soient de nationalité française.
De surcroît, notre pays assurera à partir du 1er juillet prochain la présidence de l'Union européenne. Parmi les objectifs qu'il s'est fixés pour cette occasion, nombreux sont ceux qui concernent la politique des transports, la politique de la mer et la politique de sécurité maritime.
Il était donc impératif, avant cette échéance et compte tenu de la condamnation par la Cour de justice, de mettre notre législation en conformité avec le droit communautaire.
Au-delà de ces aspects juridiques, la modernisation concerne aussi nos ports et notre pavillon ainsi que notre système de formation, sujet que j'avais longuement évoqué en septembre dernier.
Dans un environnement complètement mondialisé et concurrentiel, l'emploi, la formation et la qualification des marins français constituent des enjeux majeurs pour nos armements, dont le développement est freiné par une pénurie de main-d'oeuvre.
Comme je vous l'avais indiqué à l'automne, j'ai souhaité qu'une réflexion de fond soit conduite sur notre système d'enseignement supérieur maritime.
J'ai présidé, le 31 janvier dernier, une table ronde sur l'avenir de l'enseignement maritime qui réunissait l'ensemble des acteurs intéressés : armateurs, élèves, enseignants, administrations. Sur la base des conclusions qui ont été tirées, je fixerai prochainement une feuille de route - je vais dans l'immédiat vous en donner quelques éléments - puisqu'il est très important pour notre pavillon de former des marins.
Une première décision concrète a déjà été prise : il s'agit de l'ouverture, au mois de septembre prochain, de deux classes supplémentaires d'élèves-officiers. Une classe expérimentale d'officiers chefs de quart passerelle sera créée à l'école de la marine marchande de Marseille, en partenariat avec Armateurs de France ; une seconde classe, en filière académique, sera ouverte à l'école du Havre. Cette première mesure permettra d'ores et déjà de prévoir un accroissement de près de 30 % du nombre des officiers.
Au-delà de cette décision, nous travaillons sur cinq points.
En premier lieu, les opérateurs du transport maritime, les armateurs doivent participer activement à la définition des politiques publiques touchant à l'enseignement maritime supérieur. Nous prévoyons donc la création d'un observatoire de l'emploi maritime et la mise en place d'une commission consultative participative.
Je souhaite aussi prendre l'attache du président d'Armateurs de France pour que soit conclu un contrat d'études prospectives pour la navigation au commerce. Il s'agira de faire un état des lieux précis des besoins des armateurs en termes quantitatifs - combien de marins à former - et qualitatifs - quelles qualifications sont nécessaires pour armer les navires sous pavillon français - et de définir les échéances.
En deuxième lieu, nous devons agir, parallèlement, pour rendre ces métiers plus attractifs - nombre d'entre vous s'étaient exprimés sur ce problème. Je pense en particulier que la délivrance du titre d'ingénieur pourrait être un facteur d'attractivité déterminant pour le recrutement d'élèves-officiers. Aussi, une équipe-projet sera constituée par le directeur des affaires maritimes afin d'étudier cette réforme du diplôme.
La cinquième année de la formation académique doit également être réformée dans cette perspective afin qu'elle prenne mieux en compte les fonctions « manageriales » que les futurs officiers exerceront à bord des navires. Là encore, nous formulerons des propositions.
En troisième lieu, les intervenants de la table ronde se sont longuement exprimés sur le nombre et le statut des écoles de la marine marchande. Ils ont marqué leur préférence pour un établissement à direction unique, implanté sur plusieurs sites et doté d'un statut d'établissement public national.
Nous étudions ces propositions. Quel que soit le statut que nous retiendrons, il devra permettre une certaine souplesse d'organisation, une plus grande autonomie financière et une ouverture accrue des établissements d'enseignement supérieur et des collectivités territoriales à l'égard des armements.
Cette école, destinée à former des officiers de la marine marchande, devra également s'ouvrir aux autres domaines maritimes et paramaritimes : la visibilité et la notoriété de notre formation en sortiront renforcées.
En quatrième lieu, un effort financier sera évidemment nécessaire pour permettre la modernisation des locaux et des outils de formation. Dès cette année, les subventions aux écoles seront augmentées de plus de 10 %. Par ailleurs, des moyens financiers supplémentaires seront mis en oeuvre dans le cadre de la préparation budgétaire pluriannuelle.
En cinquième et dernier lieu, les participants à la table ronde ont souhaité une simplification de l'organisation des filières de formation : nous la mettrons en oeuvre.
Je connais, mesdames, messieurs les sénateurs, votre attachement à la formation maritime et aux écoles de la marine marchande. Les aspects que je viens d'évoquer - et qui, je pense, étaient de nature à retenir votre attention - constituent, me semble-t-il, un ensemble cohérent.
J'aurai prochainement l'occasion de vous le présenter dans sa totalité afin que vous en ayez une vue globale.
J'en reviens maintenant au projet de loi qui est aujourd'hui soumis à votre examen. L'Assemblée nationale en a peu modifié le contenu, rien ne remettant en cause son équilibre général.
Il est notamment prévu d'organiser une vérification approfondie des compétences juridiques et linguistiques des candidats. Il s'agit là d'un élément essentiel du dispositif auquel vous avez été attentifs.
J'aurai l'occasion, si M. le rapporteur le souhaite, de détailler le dispositif réglementaire qui doit nous permettre d'assurer un contrôle efficace et rigoureux des connaissances des capitaines communautaires appelés à embarquer sur les navires français.
Je remercie la Haute Assemblée de l'intérêt qu'elle a témoignée pour le projet de loi - qui n'est pas seulement un texte technique mais qui, au contraire, aura d'importantes conséquences en matière politique, en matière d'échanges extérieurs - et de l'éclairage qu'elle a apporté au Gouvernement. Je remercie particulièrement le rapporteur, M. Charles Revet, de la grande qualité de ses travaux.
Le texte du projet de loi me semble désormais être équilibré et correspondre à toutes les attentes qui s'étaient exprimées lors de l'examen en première lecture par le Sénat.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui en deuxième lecture le projet de loi relatif à la nationalité des équipages de navires, adopté par l'Assemblée nationale le 30 janvier dernier.
Je ne reviendrai pas sur le contexte ni sur le contenu de ce projet de loi, que M. le ministre a déjà présentés.
Il est clair que le contexte a évolué depuis l'examen de ce texte au Sénat en première lecture, en septembre dernier, puisque, M. le secrétaire d'État vient de le rappeler, la France a été condamnée le 11 mars dernier par la Cour de justice des Communautés européennes. Celle-ci a en effet jugé que le fait de réserver aux Français les postes de capitaine et de son suppléant à bord des navires battant pavillon français était contraire à l'article 39 du traité d'Amsterdam, qui fixe le principe de libre circulation des personnes au sein de la Communauté européenne. Dans ces conditions, il apparaît désormais urgent d'adopter ce projet de loi, ne serait-ce que pour éviter à la France d'être condamnée à payer une astreinte.
S'agissant du contenu, l'Assemblée nationale a validé pour une grande partie le texte tel qu'il avait été modifié par le Sénat.
Ainsi, afin d'assurer le respect des conditions de sécurité, nous avions estimé indispensable d'exiger des futurs capitaines, outre une maîtrise minimale de la langue française, des connaissances juridiques solides, puisque les capitaines disposent de pouvoirs importants en matière civile et pénale. Ce point a été conservé par les députés, et je m'en félicite.
Nous avions également souhaité pérenniser les obligations des armateurs en matière d'embarquement d'élèves-officiers afin de soutenir une filière nationale de formation maritime. Cette disposition a, elle aussi, été maintenue.
La principale modification, adoptée sur l'initiative du Gouvernement, concerne les modalités de vérification du niveau de maîtrise de la langue et du droit français par les candidats au poste de capitaine.
Estimant qu'il existait un risque de censure au niveau communautaire, le Gouvernement a remplacé la notion de « diplôme », adoptée au Sénat, par celle de « vérification ». D'après le projet de décret qui m'a été communiqué, cette vérification devrait être confiée à une commission composée de professionnels chargée d'évaluer le niveau des candidats.
Je regrette que, pour des raisons de droit communautaire, la notion de diplôme n'ait pu être conservée, et je souhaiterais, monsieur le secrétaire d'État, comme vous venez de l'évoquer, que vous puissiez vous engager sur deux points du décret qui me paraissent très importants.
D'une part, je souhaite que la commission qui jugera du niveau des capitaines européens leur délivre une attestation de capacité. D'autre part, cette commission doit impérativement être composée de capitaines en exercice, qui connaissent les réalités du métier, et de représentants des professeurs ou des directeurs d'écoles de la marine marchande. Pouvez-vous, monsieur le secrétaire d'État, nous donner confirmation sur ces deux points ?
La commission des affaires économiques avait insisté en première lecture sur la nécessité d'accompagner l'adoption de ce projet de loi de mesures fortes pour relancer la filière maritime française. Force est en effet de constater que la France, grande puissance maritime historique, n'occupe pas aujourd'hui le rang qui devrait être le sien. Placé dans les années soixante au quatrième rang mondial, le pavillon français n'occupe plus que la vingt-neuvième place.
L'emploi maritime est marqué par une crise de vocations et la France connaît une grave pénurie de capitaines, puisqu'on l'évalue à environ 600 officiers. Or, l'existence d'un nombre suffisant d'officiers navigants est une condition impérative du maintien de la sécurité maritime à bord de nos côtes et au-delà. En effet, après une carrière maritime, les personnels navigants deviennent fréquemment experts maritimes, pilotes maritimes et hauturiers et inspecteurs des affaires maritimes. C'est pourquoi le maintien de cette filière est indissociable de l'existence d'un savoir-faire français, gage d'une exigence particulière en matière de sécurité maritime.
Monsieur le secrétaire d'État, vous vous étiez engagé en première lecture à organiser rapidement sur cette question une rencontre de tous les acteurs concernés. Celle-ci a eu lieu le 31 janvier dernier et a réuni environ 250 représentants et personnalités du monde maritime. Les discussions se sont déroulées autour des thèmes suivants : le contenu de la formation maritime et l'organisation des études, l'amélioration de l'attractivité des métiers maritimes et le statut des écoles de la marine marchande.
À l'issue de cette table ronde, il apparaît impératif de prendre rapidement des mesures fortes pour améliorer l'attractivité du métier et des formations. Vous nous avez d'ailleurs donné à l'instant des informations sur les premières mesures que vous avez décidées, ce dont je vous remercie.
Il faut en effet augmenter substantiellement les moyens des écoles de la marine marchande et les réorganiser. L'État doit conserver, selon moi, la maîtrise de l'enseignement maritime supérieur et il faut réfléchir à une simplification des implantations des écoles, qui sont actuellement au nombre de quatre. Il faut également renforcer les partenariats avec les armements et envisager que les élèves puissent passer un contrat avec l'école, par lequel ils s'engagent à rester dans la marine pendant un certain nombre d'années.
Enfin, il faut améliorer les débouchés offerts aux élèves à la sortie des écoles, en leur permettant, par exemple, d'avoir une équivalence de diplôme d'ingénieur. Vous venez également de l'évoquer voilà quelques instants.
Sur tous ces points, monsieur le secrétaire d'État, j'espère que nous pourrons avancer rapidement dans les semaines à venir.
Enfin, vous aviez annoncé, lors du débat en première lecture, le lancement d'une mission de médiation sur la question du registre international français, dont l'intersyndicale nationale des marins et officiers de la marine marchande a obtenu le classement en pavillon de complaisance. Pouvez-vous nous indiquer où en est cette mission, qui a été confiée au président du Conseil supérieur de la marine marchande ? Il est, effet, particulièrement important que nous progressions sur ce point si nous voulons relancer la flotte de commerce française.
Sous réserve de ces observations, la commission vous propose, mes chers collègues, d'adopter le présent projet de loi.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

« Le travail des hommes en mer, bien que la technologie puisse beaucoup en atténuer la pénibilité et la dangerosité garde une spécificité liée au milieu. Il demeure chargé de nombreuses et fortes contraintes très souvent mal acceptées par l'individu moderne et considérées comme pénalisantes au regard d'une vie sociale normale et intégrée [...] Il semblerait donc que le manque de vocations en France, mais aussi dans d'autres nations développées traditionnellement maritimes, puisse s'étendre peu à peu aux pays émergents où les contraintes du métier deviennent insupportables pour les nouvelles générations à bon niveau de formation par rapport aux offres faites dans d'autres domaines de l'économie ».
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, ce constat du groupe d'études du Conseil supérieur de la marine marchande a été fait il y a maintenant un an dans le rapport intitulé : Développement de l'emploi dans les activités maritimes, de la filière portuaire et dans les secteurs connexes.
Il pose clairement, monsieur le secrétaire d'État, la question du manque d'attractivité des professions de la mer. Or le Gouvernement, en refusant de s'atteler à ce problème, renonce de facto à la mise en oeuvre de solutions efficaces et pérennes.
En effet, depuis cette date, que propose le Gouvernement ? L'adoption d'un texte de loi qui, d'une part, revient sur la réserve de nationalité du capitaine et de son second, entrant ainsi en contradiction avec le principe de l'exercice de prérogatives de puissance publique par les nationaux, et, d'autre part, pose le problème élémentaire d'une garantie minimale des règles de sécurité sur les navires.
Monsieur le secrétaire d'État, le Gouvernement se trompe de combat. Les artifices juridiques ne masqueront pas longtemps l'incapacité de la majorité gouvernementale à répondre à la crise du secteur maritime.
Vous ne résoudrez pas les déficits de personnels qualifiés tant que les conditions de travail et les rémunérations ne seront pas revalorisées. Les revendications lors de la grève, il y a quelques semaines, des officiers de la Seafrance ont été très claires à cet égard.
Face au mécontentement grandissant, le 31 janvier dernier, la tenue de tables rondes sur le contenu de la formation maritime, le devenir des écoles de la marine marchande ou l'attractivité des métiers maritimes, ont débouché sur des pistes intéressantes.
Vous nous avez annoncé, il y a un instant, l'ouverture de nouvelles classes susceptibles d'augmenter de 39 % la capacité de formation : c'est positif. Mais d'autres mesures - si toutefois elles sont prises - n'auront d'effet que sur le long terme, monsieur le secrétaire d'État. La découverte par le ministère des transports de la nécessité de renforcer les moyens des écoles et de la formation me semble hélas ! bien tardive.
Bref, ces mesures nécessaires dans un climat dégradé ne seront pas suffisantes pour donner envie aux jeunes, à court terme, d'engager des carrières dans le secteur maritime.
En ce qui concerne le projet de loi, je dispose de très peu de temps pour envisager en détail les difficultés et les dangers auxquels il nous expose.
Au demeurant, la concision de mon intervention ne sera guère regrettable dans la mesure où nos collègues de la majorité ont défendu il y a quelque temps, dans cet hémicycle, un certain nombre d'arguments en faveur du maintien de l'exigence de nationalité française pour le capitaine et son second sur les navires battant pavillon français. Je citerai parmi d'autres notre collègue Henri de Richemont, rapporteur de la proposition de loi relative à la création du registre international français.
Sur la question de l'exercice des prérogatives de puissance publique, il justifiait la réserve de nationalité de la manière suivante : « Le capitaine et son substitué sont en effet investis de prérogatives de puissance publique : le code civil et le code disciplinaire et pénal de la marine marchande leur confèrent tantôt l'exercice de fonctions d'officier d'état civil tantôt de véritables pouvoirs de police qui les font directement participer au service public de la justice. »
Aujourd'hui, le fait de vider artificiellement les compétences susvisées du capitaine suffirait à écarter l'obstacle légal tiré de l'existence de l'exercice de prérogatives de puissance publique ? Non, car si sur le papier les incompatibilités semblent levées, dans la pratique les problèmes demeurent.
Même si la probabilité que le capitaine soit amené à faire usage de ses pouvoirs en matière civile est faible, elle n'est pas nulle. C'est pourquoi, contrairement à la position adoptée par la Cour de cassation et conformément à la position retenue par les juridictions du fond, nous restons persuadés que le droit communautaire tolère cette réserve de nationalité et qu'il appartient au législateur d'en tirer les conséquences
Monsieur le rapporteur, vous citez dans votre rapport un extrait de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 11 mars dernier. Vous soulignez, pour nous convaincre - ou peut-être vous convaincre vous-même
M. le secrétaire d'État et M. le rapporteur sourient

Je voudrais, pour ma part, souligner un autre passage.
La Cour de justice des Communautés européennes pour condamner la France déclare qu'« en maintenant dans sa législation l'exigence de la nationalité française pour l'accès aux emplois de capitaine et d'officier (second de navire) à bord de tous les bateaux battant pavillon français » - j'insiste sur ce « tous » - « la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 39 CE ».
Il ressort de ce dernier considérant que la législation française aurait pu prévoir des solutions différentes en fonction de la durée et des distances du déplacement en mer.
Or le projet de loi ne s'embarrasse pas du détail.
En effet, des navires armés au long cours et au cabotage international, pour lesquels M. le rapporteur avait noté que le capitaine est amené, ne serait-ce qu'en matière disciplinaire, à exercer réellement ses prérogatives de puissance publique, ne font pas l'objet d'une exception.
Imaginez la situation d'un capitaine de nationalité étrangère au large de Singapour qui devra entrer en contact avec les autorités françaises pour pouvoir exercer ses prérogatives d'officier de police judiciaire. En admettant que cet officier parle français, sera-t-il en mesure de comprendre les instructions juridiques transmises par l'autorité compétente et sera-t-il en mesure de joindre rapidement cette autorité ? Je ne le pense pas.
Pour avoir les informations, il appellera probablement sa compagnie, qui les trouvera et les lui communiquera dans un délai plus ou moins long. Ainsi, par la multiplication des interlocuteurs, votre texte rendra impossibles les réactions d'urgence.
Les débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale ont été l'occasion de révéler, me semble-t-il, l'artifice du système proposé. Le débat est clair de ce point de vue.
Face aux difficultés pratiques, avec le renvoi aux autorités publiques à terre, certaines compétences qui relèvent de la procédure pénale ont été rendues au capitaine ; je pense aux cas de crime ou de délit flagrant.
Enfin, nous estimons que la multiplication des langues parlées sur un navire présente l'inconvénient de ralentir la réaction de l'équipage face aux dangers potentiels, avec tous les risques que cela peut engendrer.
Bref, sans remettre en cause les qualifications des officiers étrangers, nous voterons contre ce texte, qui n'apporte pas de remède à la pénurie d'officiers, qui pose des problèmes pratiques en ce qui concerne l'exercice des prérogatives de puissance publique, enfin qui risque d'engendrer des dangers en ce qui concerne la sécurité des bâtiments.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, j'ai été tenté, à l'occasion de cette deuxième lecture du projet de loi relatif à la nationalité des équipages de navires, de vous proposer - pas de vous infliger - une seconde écoute de mon intervention prononcée le 18 septembre 2007, lors de la première lecture.
M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. C'eût été un plaisir, monsieur le sénateur !
Sourires

J'avais de bonnes raisons pour cela : la qualité de mon intervention, ...
Nouveaux sourires.

... la rémanence de la situation de la marine marchande française, qui demeure très préoccupante, enfin, le caractère marginal des modifications apportées par l'Assemblée nationale le 30 janvier 2008 aux trois articles qui sont de nouveau soumis à notre examen.
Marginales, ces modifications n'en sont pas pour autant insignifiantes, comme celle qui revient, aux articles 1er et 2, sur l'obligation de présenter un diplôme attestant d'une maîtrise de la langue française et de la possession de connaissances juridiques, permettant notamment d'exercer les prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi. Comme M. le rapporteur, je regrette cette modification.
Si le Sénat avait introduit l'obligation d'un diplôme, c'était précisément pour se prémunir contre un laxisme que la vérification du niveau des connaissances proposée par l'Assemblée nationale est loin d'écarter.
Il appartiendra au décret d'application d'y remédier, en donnant à la commission nationale chargée de la vérification des connaissances la composition - le rapporteur a eu raison d'insister sur ce point -, les moyens et les instructions garantissant le respect des intentions du législateur et, singulièrement, des sénateurs.
Comme le rapporteur, nous pensons que les modifications apportées à l'article 4 du projet de loi consolident le dispositif initial : nous les approuvons. Cependant, ne sous-estimons pas les difficultés d'application de la procédure prévue ! Notre collègue Robert Bret vient, à juste titre, d'y insister.
Écoutons le président de l'Association française des capitaines de navires, l'AFCAN : « Certes, le capitaine européen, confronté à un grave problème de personnes, fera pour le mieux, comme d'habitude. Les risques ne sont ni réduits, ni exceptionnels et exigent le plus souvent une réaction rapide. » Il évoque quelques situations, dressant une liste non exhaustive : émeute à bord d'un car-ferry, cas de folie avec agression, décès, recueil de boat people, attaque de pirates. Ce sont, hélas, des réalités qu'il faut aujourd'hui prendre en compte sur un nombre important de côtes, notamment lointaines.
« Mais le capitaine européen, continue-t-il, qui n'aura aucune obligation de parler le français, ni de connaître un minimum de droit français, devra en ce cas commencer par joindre un juge d'instruction, même au milieu de la nuit, pour demander en termes français clairs et juridiquement précis l'autorisation de lever le petit doigt. Le capitaine européen pourra seulement prendre ensuite les décisions urgentes nécessaires pour préserver au mieux le navire, avec son équipage, et surtout les passagers lorsqu'il en a. »
« Même en respectant le code international ISPS, des erreurs graves de procédure au regard du droit français sont assurément à redouter et la justice aura bien du mal à les gérer. Si les prérogatives du capitaine étaient jusqu'à présent aussi étendues, ce n'était certainement pas pour satisfaire son ego, mais bien pour servir les intérêts de la République. » Le président de cette association annonce donc des problèmes pour les juges et l'État. Voilà pour le texte qui nous est soumis.
Sur le fond, les mêmes problèmes demeurent, monsieur le secrétaire d'État, et nous posons toujours les mêmes questions pour faire face à la pénurie de capitaines et défendre la filière française.
Nous avons pris connaissance avec intérêt du long développement consacré par notre rapporteur aux tables rondes du 31 janvier 2008 qui ont réuni, autour de la question de la formation, les personnalités du monde maritime. Elles ont permis d'identifier quelques solutions pour accroître le recrutement, solutions auxquelles vous-même, monsieur le secrétaire d'État, avez fait allusion à l'instant : l'expérimentation de la filière monovalente, l'augmentation dès cette année des places offertes au concours de recrutement de la filière polyvalente, la nécessité d'améliorer, au besoin, le statut des écoles ainsi que, probablement, l'ensemble de leur organisation, enfin, le renforcement des partenariats avec les armateurs, mais aussi avec les collectivités territoriales.
Monsieur le secrétaire d'État, vous avez affirmé votre volonté de vous appuyer sur les conclusions de ces tables rondes : nous vous en donnons acte. Alors, n'oubliez pas le coup de projecteur qu'elles ont porté sur la lancinante question des moyens ! Les subventions aux écoles, nous dit Charles Revet, seraient portées en 2008 à 2 millions d'euros, représentant 10 % d'augmentation. C'est bien, mais le rapport rappelle que le coût d'un seul simulateur - équipement désormais indispensable - dépasse 1 million d'euros et que la remise aux normes des écoles - je pense, en particulier, à l'immobilier - nécessiterait, à elle seule, 5 millions d'euros par an sur trois ans. C'est dire que nous sommes loin du compte ! Je connais les contraintes budgétaires de l'État, il n'empêche qu'entre l'intention affichée et les réalités budgétaires, même améliorées, subsiste un écart considérable.
Nous sommes aussi loin du compte pour ce qui est du statut social des capitaines et, plus généralement, des marins. Un statut social négocié entre armateurs et syndicats constituerait, dans un cadre européen, la seule véritable défense, mieux, la contre-attaque pour sauver notre marine marchande.
Le 18 septembre 2007, lors de notre première lecture, je dénonçais l'autisme des autorités françaises par rapport à la réalité européenne qui nous valait de traiter de la question de la nationalité des équipages sur injonction de la Commission européenne et, aujourd'hui, après condamnation de la France par la justice européenne, alors que cette question aurait pu être traitée bien avant et dans un autre cadre, par exemple, lors de la discussion de la loi de 2005. Nous étions en effet déjà très informés de l'obligation dans laquelle nous nous trouvions.
Je vous disais alors ma conviction que « la condition première pour garantir la pérennité de la filière française [était] de rendre espoir et confiance en l'avenir à la flotte marchande, en garantissant et en protégeant par un authentique registre européen, entre autres, ses conditions d'emploi, de sécurité, de rémunération, de formation, y compris la responsabilité des capitaines ». Je redis la même chose aujourd'hui.
Je poursuivais ainsi : « Je ne mésestime pas la difficulté de convaincre de cette nécessité certains de nos partenaires, qui croient avoir déjà résolu leurs propres problèmes. » Certains y ont consacré peut-être plus d'efforts, de soins et de moyens que nous. « Toutefois, puisque, après tout, c'est la direction que nous devons prendre, la France ne pourrait-elle pas, lorsqu'elle exercera la présidence de l'Union européenne, profiter de l'occasion pour réinscrire cette question à l'ordre du jour de l'agenda européen ? » Telle était la question que je vous avais posée en septembre, vous aviez alors « acquiescé », selon le compte rendu des débats, monsieur le secrétaire d'État.
L'agenda de la présidence française n'a pas manqué depuis d'être précisé. Cette question figure-t-elle à l'ordre du jour ? Pourquoi ne pas faire ainsi la preuve que l'Europe serait sortie de l'ornière, comme l'adoption du traité de Lisbonne le laisserait entendre - en tout cas, c'est ainsi qu'on l'a présenté...
Enfin, monsieur le secrétaire d'État, je veux reprendre à mon compte la proposition que vous adressait à l'Assemblée nationale, le 30 janvier 2008, M. Jean Gaubert, qui fut longtemps mon suppléant et qui, aujourd'hui, représente la deuxième circonscription des Côtes-d'Armor. Ayant rappelé que vous aviez porté une loi d'orientation agricole, il vous demandait : à quand une loi d'orientation sur la mer ?
À quand de vraies orientations, un vrai cap, de vrais moyens, pour éviter de continuer à désespérer nos marins et nos territoires maritimes, y compris le département dont vous venez d'être élu président du conseil général ? Sinon, tous nos navires pourront reprendre le triste refrain de Michel Sardou : « Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber ! »
Sourires

Monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, le groupe socialiste s'était abstenu en première lecture. L'économie du texte n'a pas profondément changé, le contexte maritime non plus, même si l'actualité récente a été marquée par quelques naufrages qui sont venus endeuiller le secteur de la pêche. Les violentes tempêtes des dernières semaines ont à nouveau mis en évidence l'extraordinaire actualité de la question de la sécurité, celle des marins comme celle des riverains. Le groupe socialiste s'abstiendra de nouveau.

Monsieur le secrétaire d'État, en attendant les précisions que vous allez nous apporter dans quelques instants, je voudrais d'ores et déjà répondre à mes collègues Robert Bret et Charles Josselin sur un point précis qu'ils ont évoqué tous les deux, à savoir les conditions de recrutement des officiers européens.
Comme eux, comme nombre de nos collègues et comme M. le secrétaire d'État, je souhaite développer le pavillon français et maintenir un maximum d'officiers français. Mais nous nous heurtons à deux obstacles : le premier, c'est la condamnation de la France, qui s'impose à nous et nous fait courir des risques financiers ; le second, c'est le manque d'effectifs.
Dès lors, soit nous gardons les mêmes exigences et le pavillon français risque de perdre encore en importance et de descendre plus bas que la 29e place, soit nous prenons les mesures nécessaires au maintien du pavillon français et accentuons l'effort d'information et de recrutement pour que, dans les années à venir, plus d'officiers français sortent de nos écoles.
Comme vient de l'indiquer Charles Josselin, j'avais proposé que le niveau des connaissances linguistiques et juridiques soit sanctionné par un diplôme. J'ai compris que cette solution risquait de poser un problème juridique et de faire l'objet d'un recours. C'est pourquoi, dans l'esprit de ce que souhaitait M. le secrétaire d'État, j'ai proposé que soit délivrée une « attestation de capacité », chaque mot, chaque terme ayant sa valeur.
J'ai compris vos craintes, monsieur Bret, quand vous avez évoqué les difficultés que pourrait rencontrer un capitaine étranger commandant un navire situé à Singapour pour converser en cas de difficultés. Mais, mon cher collègue, l'attestation de capacité doit garantir de très bonnes connaissances linguistiques chez l'intéressé, c'est-à-dire la faculté de s'exprimer et de dialoguer en français, comme de très bonnes connaissances juridiques, puisque le capitaine exerce des prérogatives au nom de l'État !
C'est pourquoi j'ai demandé que la commission qui délivrera l'attestation comprenne deux officiers français en exercice et, au titre de l'administration, deux directeurs ou enseignants d'école de la marine marchande qui ont tous une connaissance parfaite de la situation. Nous avons donc pris un maximum de précautions pour que les risques évoqués ne se réalisent pas.
Cela étant, nous sommes engagés dans une démarche progressive. Il nous faut donc mettre en place un système de formation qui soit suffisamment attractif, il nous faut accorder à nos écoles les moyens de se développer - nous y travaillerons avec vous, monsieur le secrétaire d'État - afin que de nombreux jeunes s'engagent dans cette voie et que de nouveaux officiers assurent la pérennité du pavillon français.
M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Monsieur Josselin, l'idée du registre européen n'est pas oubliée. La présidence française de l'Union européenne débutera le 1er juillet 2008. Deux conseils des ministres des transports se réuniront pendant cette période, l'un à Bruxelles, l'autre à Luxembourg. M. le Premier ministre m'a donné l'autorisation de tenir un conseil des ministres informel - comme cela se fait toujours lors des présidences - à La Rochelle, donc dans une région atlantique, les 1er et 2 septembre - il faudra en effet laisser le temps à l'université d'été du parti socialiste de libérer les hôtels.
Sourires
À cette occasion, nous aborderons la réflexion sur le registre européen et sur la politique de sécurité maritime, à laquelle je sais que tous les sénateurs sont très attachés. Vous avez eu raison, monsieur Josselin, de rappeler les récents accidents liés aux tempêtes et à un certain nombre d'autres événements. Les problèmes maritimes seront donc au coeur de la présidence française.
Je me suis rendu récemment à Lisbonne aux côtés de M. le Premier ministre pour évoquer cette politique maritime avec l'ex-présidence portugaise. Je suis donc tout à fait prêt à ouvrir la réflexion sur le registre européen.
J'en viens aux deux points que M. le rapporteur a évoqués.
S'agissant du RIF, j'ai confié une mission de conciliation et de médiation à M. Bernard Scemama, président du Conseil supérieur de la marine marchande, qui a pris connaissance des positions syndicales des marins et des officiers ainsi que de celles des armateurs. Personne aujourd'hui ne comprend que le RIF, classé par le mémorandum de Paris parmi les tout premiers pavillons en termes de sécurité, soit encore considéré comme pavillon de complaisance.
Cette situation n'est pas acceptable, à l'heure où nous allons lancer un plan de modernisation de notre enseignement maritime et où nous sommes en train d'engager la réforme et la relance des ports. J'ai récemment évoqué cette question avec le président d'Armateurs de France, M. Riblier. J'ai demandé qu'un dialogue s'instaure entre Armateurs de France et les syndicats, car il n'en existait pas jusqu'à présent, pour que l'on puisse trouver un terrain d'entente. Je ne désespère pas que l'on y parvienne dans les semaines à venir.
Quant à l'élaboration du décret d'application qui sera pris à la suite de l'adoption du présent texte par le Parlement, je tiens beaucoup à ce que les rapporteurs des deux assemblées et les commissions concernées aient connaissance des projets de décret.
Je crois que c'est là une bonne méthode de travail. Cela permet aux rapporteurs et aux commissions de donner leur avis.
Pour l'heure, le projet de décret prévoit la création d'une commission nationale chargée de se prononcer sur le niveau des connaissances juridiques et de maîtrise de la langue française des candidats aux fonctions de capitaine ou de suppléant ressortissants de l'un des États visés.
Conformément à vos souhaits, monsieur le rapporteur, cette commission sera présidée par l'inspecteur général de l'enseignement maritime, qui sera désigné par mes soins, et comptera parmi ses membres deux représentants de l'enseignement supérieur maritime, ainsi que deux capitaines en activité, qui pourront voir quelle peut être la réactivité du candidat dans des situations pratiques du type de celles que M. Bret évoquait tout à l'heure. Ces capitaines seront choisis sur une liste qui sera réactualisée chaque année.
La commission comportera donc des personnes capables d'apprécier les compétences des candidats. Elle délivrera, comme vous le souhaitez, monsieur le rapporteur, une attestation de capacité aux candidats agréés.
Cette attestation permettra aux intéressés d'exercer les fonctions de capitaine ou de suppléant.
Concernant les modalités de vérification des connaissances juridiques et linguistiques, tout sera précisé dans le décret. Les candidats subiront une épreuve écrite et un entretien oral avec les membres de la commission, portant sur des thèmes tels que la tenue des documents de bord ou, comme le souhaitait M. Bret, l'exercice des prérogatives de puissance publique des capitaines.
Le projet de décret sera présenté aux instances consultatives, notamment le Conseil supérieur de la marine marchande, et au Conseil d'État. Le décret pourra être pris dans des délais extrêmement brefs si le projet de loi est adopté rapidement par les deux assemblées.

M. Charles Revet, rapporteur. Je remercie M. le secrétaire d'État de toutes les précisions qu'il vient de nous apporter. Elles devraient, à mon sens, tous nous sécuriser s'il en était encore besoin, et peut-être même inciter notre collègue Charles Josselin, qui a pratiquement réponse à toutes ses questions, à se prononcer avec nous en faveur de l'adoption de ce projet de loi !
Sourires

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.
CHAPITRE IER
Dispositions relatives au critère de nationalité des équipages de navires
Le second alinéa de l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« À bord des navires battant pavillon français, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. L'accès à ces fonctions est subordonné à la possession de qualifications professionnelles et à la vérification d'un niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques permettant la tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi. Un décret en Conseil d'État, pris après avis des organisations représentatives d'armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées, précise les conditions d'application de cette dernière disposition.
« Les membres de l'équipage sont ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse dans une proportion minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la mer pris, après avis des organisations représentatives d'armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées, en fonction des caractéristiques techniques des navires, de leur mode d'exploitation et de la situation de l'emploi. »
L'article 1 er est adopté.
I. - L'article 5 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « doivent être ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « sont ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« À bord des navires immatriculés au registre international français, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance, qui peut être l'officier en chef mécanicien, garants de la sécurité du navire, de son équipage et de la protection de l'environnement ainsi que de la sûreté, sont ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. L'accès à ces fonctions est subordonné à la possession de qualifications professionnelles et à la vérification d'un niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques permettant la tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi. Un décret en Conseil d'État, pris après avis des organisations représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application de cette dernière disposition. »
II. - Non modifié....................................................... » -
Adopté.
CHAPITRE II
Dispositions relatives aux prérogatives du capitaine en matière pénale et de sécurité du navire
Les articles 28 à 30 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande sont remplacés par cinq articles 28 à 30-2 ainsi rédigés :
« Art. 28 et 29. - Non modifiés
« Art. 30. - Lorsque le capitaine a connaissance d'un crime, délit ou tentative de crime ou de délit commis à bord du navire, il effectue, afin d'en conserver les preuves et d'en rechercher les auteurs, tous les actes utiles ou exerce les pouvoirs mentionnés aux articles 54, 60, 61, 62 et au premier alinéa de l'article 75 du code de procédure pénale. Les articles 55, 56, 59, 66, et les trois premiers alinéas de l'article 76 du code de procédure pénale sont applicables. Les pouvoirs d'enquête de flagrance visés au présent article s'appliquent aux crimes flagrants et aux délits flagrants lorsque la loi prévoit une peine d'emprisonnement. Les constatations et les diligences du capitaine sont inscrites au livre de discipline. Celui-ci en informe sans délai l'autorité administrative en indiquant la position du navire ainsi que le lieu, la date et l'heure prévus de la prochaine escale. L'autorité administrative en informe sans délai le procureur de la République compétent au titre de l'article 37 qui peut ordonner le déroutement du navire.
« Lorsque la personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit fait l'objet d'une mesure de consignation, le capitaine la conduit dès que possible devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
« Lorsque le capitaine constate une contravention commise à bord, il l'inscrit sur le livre de discipline.
« Art. 30-1 et 30-2. - Non modifiés.................................... » -
Adopté.

Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jacques Gautier, pour explication de vote.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le groupe UMP se range entièrement à l'avis du rapporteur, M. Charles Revet, qui nous suggère d'adopter conforme le présent texte, dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.
Nous le disions déjà lors de la première lecture, en septembre dernier : l'adoption de ce projet de loi est indispensable afin de mettre notre droit national en conformité avec les dernières évolutions de la jurisprudence communautaire. Cela est encore plus vrai aujourd'hui qu'au mois de septembre puisque, on l'a redit ce matin, l'État français a été condamné le 11 mars dernier par la Cour de justice des Communautés européennes. Il nous faut donc adopter ce texte et souhaiter que la promulgation de la loi intervienne le plus rapidement possible. Vous nous avez rassurés sur ce dernier point, monsieur le secrétaire d'État.
Je rappellerai que ce texte a notamment pour objet d'ouvrir aux ressortissants communautaires l'accès aux fonctions de capitaine ou de suppléant à bord des navires battant pavillon français. Plusieurs autres pays européens ont déjà pris des mesures analogues.
Même si, comme l'ensemble de mes collègues ici présents, je regrette la suppression du mot « diplôme » dans le texte, les modifications apportées par l'Assemblée nationale me paraissent équilibrées. Je veux parler de la vérification de la pratique de la langue française et du niveau des connaissances juridiques des candidats, dont les modalités seront détaillées dans un décret. Vous l'avez bien compris, monsieur le secrétaire d'État, les professionnels de la marine marchande et les sénateurs attendent beaucoup de ce dernier, s'agissant en particulier de la représentativité de la commission ad hoc. Cela étant, là aussi, monsieur le secrétaire d'État, votre intervention nous a rassurés, et nous attendons la parution de ce décret avec sérénité.
Bien sûr, le volet relatif aux précisions sur le pouvoir du capitaine en cas de crime ou de flagrant délit commis à bord nous amène à nous interroger. Nous attendons aussi beaucoup du décret sur ce point.
Cependant, monsieur le secrétaire d'État, comme nous le disions déjà lors de la première lecture, au-delà de ce texte, la question clé demeure l'attractivité de la profession et la compétitivité du registre français, sujet sur lequel notre collègue Henri de Richemont a beaucoup travaillé.
C'est pourquoi je tiens à saluer ici la détermination de la commission des affaires économiques et à vous remercier, monsieur le secrétaire d'État, d'avoir organisé, en ce début d'année, une série de tables rondes avec les élus et les professionnels afin d'envisager les moyens de réformer et de dynamiser cette filière. Nous espérons que, dans cette perspective, les mesures concrètes dont vous avez déjà fait état pourront être très rapidement mises en place.
C'est dans cette attente que le groupe UMP votera en faveur de l'adoption de ce projet de loi.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

J'ai été sensible aux propos du rapporteur m'invitant à voter moi aussi ce projet de loi. Cela étant, je voudrais dire que c'est au moins autant pour ce qu'il ne contient pas que pour ce qu'il contient que nous avons fait le choix de nous abstenir.
Quoi qu'il en soit, nous resterons attentifs aux orientations que M. le secrétaire d'État et le Gouvernement voudront bien donner à la politique française en matière de transport maritime et, plus généralement, à la filière maritime. Pour l'instant, je l'ai dit tout à l'heure, le compte n'y est pas, et nous maintenons donc notre abstention.

Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Le projet de loi est adopté définitivement.

Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures dix, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Christian Poncelet.