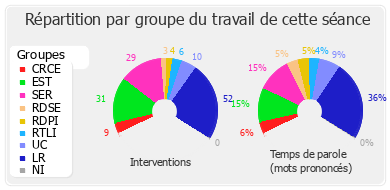Séance en hémicycle du 16 mai 2023 à 14h30
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à douze heures trente-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.

La séance est reprise.

L’ordre du jour appelle la discussion, à la demande du groupe Les Républicains, de la proposition de loi visant à réduire les inégalités territoriales pour les ouvertures de casinos, présentée par Mme Catherine Deroche, M. Stéphane Piednoir, M. Claude Nougein et plusieurs de leurs collègues (proposition n° 363, texte de la commission n° 585, rapport n° 584).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme Catherine Deroche, auteure de la proposition de loi.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la proposition de loi que Stéphane Piednoir, Claude Nougein et moi-même vous présentons reprend en partie un texte déposé en avril 2019 par les quatre sénateurs de Maine-et-Loire, sollicités alors par le maire de Saumur.
Ce texte étendait la possibilité d’installation d’un casino aux communes comptant dans leur périmètre un ou plusieurs éléments du patrimoine matériel ou immatériel propriété de l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE).
La proposition de loi déposée cette année a été travaillée avec les députées des circonscriptions des communes de Saumur et Arnac-Pompadour – je salue Laetitia Saint-Paul, députée de Maine-et-Loire, présente dans nos tribunes. J’y associe les premiers cosignataires, Emmanuel Capus et Daniel Chasseing.
L’ouverture d’un casino est une source importante d’emplois et contribue de façon déterminante au développement touristique et culturel, ce qui rejaillit nécessairement sur l’ensemble des autres activités de la commune où il est implanté, participant ainsi à son animation et à l’attractivité du territoire concerné. Par ailleurs, les casinos sont souvent parmi les premiers contributeurs du budget des communes qui les accueillent.
Les jeux d’argent et de hasard, dont les casinos font partie, sont régis par un principe de prohibition, qui connaît toutefois des dérogations limitatives et encadrées.
En effet, les textes en vigueur, votés avant l’existence des jeux en ligne, limitent l’ouverture des casinos aux stations thermales, balnéaires ou climatiques ; aux villes principales d’agglomérations de plus de 500 000 habitants ayant des activités touristiques et culturelles particulières, participant pour plus de 40 % au fonctionnement d’un centre dramatique national ou d’une scène nationale, d’un orchestre national et d’un théâtre d’opéra ; aux communes dans lesquelles un casino était régulièrement exploité avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme ; enfin, aux communes ou stations classées de tourisme de plus de 15 000 habitants du département de la Guyane.
Cette liste a l’avantage de poser des limites à une activité qui se doit – nous souscrivons à cet objectif – d’être strictement encadrée.
Ce faisant, elle a aussi pour effet de concentrer les casinos dans certaines zones géographiques, notamment les bords de mer ou les départements les plus urbanisés, en privant d’autres zones, moins dynamiques, de cette activité pourtant susceptible de les aider à développer une économie locale. La législation actuelle sur l’implantation des casinos est donc à l’origine d’inégalités territoriales peu justifiées.
Les départements ruraux du centre de la France ont notamment pour attrait touristique les activités équestres, qui, de par leur lien avec le monde du jeu et des paris, pourraient constituer le support du développement d’infrastructures touristiques, telles que des casinos.
Ainsi, en autorisant les villes ayant développé une activité importante en lien avec l’équitation à ouvrir des casinos, il serait possible de pallier l’inégale répartition de ces établissements sur le territoire.
Pour cette raison, notre proposition de loi vise à autoriser la création de casinos dans les communes « sites historiques du Cadre noir et des haras nationaux » qui ont organisé, pendant au moins cinq années avant le 1er janvier 2023, dix événements hippiques de rayonnement national ou international. À ce jour, seules deux communes, Arnac-Pompadour et Saumur, entrent dans ce cadre.
L’IFCE est l’opérateur public au service de la filière équine française qui assure la gestion du Cadre noir de Saumur, mais aussi d’une vingtaine de haras nationaux partout en France. Il est dépositaire d’un patrimoine matériel et immatériel équestre unique, qu’il lui appartient de porter et valoriser, seul ou en partenariat. Ses actions se déploient sur tout le territoire sous les marques patrimoniales haras nationaux et Cadre noir, dont Saumur et Arnac-Pompadour sont les sièges sociaux et administratifs.
Il est à noter qu’il ne reste que deux sites « haras national » en France avec participation de l’État : Arnac-Pompadour et Saumur. De plus, les missions régaliennes ayant évolué, l’État se désengagera progressivement de ces deux sites. Les autres haras nationaux, au nombre d’une vingtaine, ont été cédés ou donnés.
Reste Uzès, encore haras national, qui n’accueille plus de compétitions et n’est plus utilisé que pour des formations. Par ailleurs, ce site n’est pas historique, puisqu’il a été construit en 1962.
Conditionner l’ouverture d’un casino à l’existence d’un patrimoine équestre participerait ainsi au développement de cette filière touristique importante, tout en assurant un soutien à la relance de l’ensemble de la filière cheval.
La commission, partageant l’objectif des auteurs de la proposition de loi, a souhaité améliorer le dispositif proposé, d’une part, en s’assurant que les communes visées satisfont aux critères pertinents qui justifient l’ouverture d’un casino sur leur territoire et, d’autre part, en permettant aux communes dotées des infrastructures équestres similaires à celles de Saumur et d’Arnac-Pompadour d’accueillir le cas échéant un casino.
Mes collègues coauteurs s’exprimeront dans la discussion générale. Je vous remercie, d’ores et déjà, du soutien apporté à ce texte.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et INDEP.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le texte proposé par Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales, et par ses collègues a une ambition simple. Son article unique vise à répondre aux attentes anciennes et légitimes des maires de territoires ruraux qui souhaitent accueillir un casino.
Il s’agit plus précisément des communes de Saumur et d’Arnac-Pompadour, qui disposent d’équipements équestres ancestraux, nécessitant que des financements soient trouvés rapidement pour assurer leur pérennité.
En effet, depuis plus de dix ans, l’État se désengage progressivement de la filière équestre, laissant bien souvent les collectivités territoriales bien seules pour entretenir et financer les activités et les infrastructures de cette filière. Or ces équipements et les événements équins font partie intégrante du patrimoine de ces territoires. Ils sont de véritables atouts permettant d’attirer touristes et visiteurs.
Vous le savez, l’ouverture d’un casino municipal est par principe prohibée. Depuis près de deux siècles, l’État encadre de manière très stricte les jeux d’argent et de hasard. Cette interdiction est justifiée par les motifs d’intérêt général tenant à la prévention des « risques d’atteinte à l’ordre public et à l’ordre social, notamment en matière de protection de la santé et des mineurs ».
L’exploitation des casinos fait partie des exceptions anciennes au principe de prohibition, mais son étendue a peu évolué au cours des dernières années.
Actuellement, les seules catégories de communes pouvant accueillir un casino, de manière dérogatoire, figurent sur la liste limitative prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure. Il s’agit principalement des communes classées stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme, ou des villes principales d’agglomérations de plus de 500 000 habitants dotées d’établissements culturels spécifiques.
Par ailleurs, une particularité existe depuis plus d’un siècle pour la Ville de Paris, puisqu’il est interdit d’exploiter un casino à moins de 100 kilomètres de son territoire, exception faite de la commune d’Enghien-les-Bains. Toutefois, depuis le 1er janvier 2018, la capitale expérimente l’exploitation de sept clubs de jeux ; cette expérimentation prendra fin le 31 décembre 2024.
Enfin, l’ouverture d’un casino municipal nécessite une double autorisation, à la fois municipale et ministérielle.
L’autorisation du ministère de l’intérieur fait suite notamment à une enquête administrative. Les services de ce ministère contrôlent et régulent de manière très rigoureuse cette branche des jeux d’argent et de hasard. À ce jour, il existe 203 casinos, et leur nombre n’a que peu évolué au cours des dernières années.
Mes chers collègues, à l’issue de cette courte présentation du cadre juridique applicable aux casinos, je souhaite vous exposer la position de la commission des lois, dont les membres se sont prononcés favorablement sur la proposition de loi visant à introduire une sixième hypothèse de dérogation à l’interdiction d’exploitation de casinos.
La commission a notamment été sensible au fait que les territoires ruraux ne disposent pas des mêmes atouts que les communes du littoral – c’est une évidence – et qu’ils pourraient utilement bénéficier de l’ouverture de casinos pour accroître leur attrait touristique et leurs ressources financières.
En outre, les communes qui ont une activité équestre importante sont déjà en lien avec l’univers du jeu et des paris, de sorte que l’ouverture d’un casino viendrait compléter une offre touristique liée aux jeux d’argent et de hasard déjà existant.
Au surplus, les maires de Saumur et d’Arnac-Pompadour ont mis en avant la nécessité de l’arrivée d’un casino dans leur commune pour financer l’activité équestre présente sur leur territoire ou à proximité.
C’est pourquoi l’intention qui sous-tend la proposition de loi de la présidente Deroche et de ses collègues a emporté la complète adhésion de notre commission, laquelle a néanmoins souhaité améliorer le caractère opérationnel du dispositif, en ciblant mieux les communes susceptibles d’en bénéficier.
En premier lieu, la commission des lois a jugé pertinent de permettre aux communes disposant d’une infrastructure équestre pluriséculaire d’accueillir un casino sur leur territoire. Elle a décidé d’étendre, de manière restrictive, le champ de la proposition de loi aux communes qui accueillent soit le site historique du Cadre noir, soit un haras national.
Cette extension demeure très limitée, dans la mesure où, selon les informations transmises par l’IFCE, seules huit communes pourraient éventuellement justifier de la présence d’un haras dit « national ».
En deuxième lieu, la commission a maintenu l’exigence d’activités équestres régulières et anciennes au sein de la commune : cette dernière doit pouvoir justifier de l’organisation d’au moins dix événements équestres par an entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2023.
En troisième lieu, afin de conserver un lien étroit entre la commune, les activités hippiques et les paris sportifs qui y sont associés, la commission a introduit une troisième condition : la présence du siège d’une société de courses hippiques dans la commune.
En résumé, le texte voté en commission permet aux communes d’accueillir un casino si elles répondent aux trois conditions cumulatives suivantes : disposer d’un haras national ou du site historique du Cadre noir ; avoir organisé au moins dix événements équestres à caractère national ou international par an au cours des cinq dernières années ; être le siège d’une société de courses hippiques au 1er janvier 2023.
À l’aune de ces trois critères, le texte qui est soumis à votre appréciation offre la possibilité d’ouvrir de nouveaux casinos, mais de manière extrêmement réduite. En effet, la commission a souhaité s’inscrire dans la philosophie du législateur, en restreignant au maximum la création d’établissements de jeux d’argent et de hasard.
De plus, la commission a tenu compte de la nécessité urgente de répondre aux difficultés de financement des activités et infrastructures équestres des communes de Saumur et d’Arnac-Pompadour. Il s’agit de régler une situation particulière.
Par ailleurs, le texte issu des travaux de la commission assure une égalité de traitement avec les communes disposant d’infrastructures similaires, sans déséquilibrer la filière des casinos sur l’ensemble du territoire.
Néanmoins, j’y insiste, il apparaît nécessaire d’envisager une réflexion plus globale sur les critères d’installation d’un casino dans une commune. À cet égard, la fin de l’expérimentation relative aux clubs de jeux parisiens, prévue le 31 décembre 2024, sera l’occasion pour le Gouvernement de clarifier et de remettre à plat, par un véhicule législatif plus adapté, les règles régissant l’installation des casinos en France.
Pour conclure, ayant régulièrement échangé avec les auteurs de la proposition de loi, …

M. François Bonhomme, rapporteur. … je les remercie chaleureusement de leur disponibilité et de la qualité de nos discussions, qui ont visé à formuler des pistes de solution équilibrées et consensuelles, dans l’intérêt de nos communes.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et INDEP.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, avec plus de 200 établissements sur son territoire, la France concentre 40 % des casinos de l’Union européenne. Elle jouit ainsi d’une offre ludique considérable, qui constitue un véritable atout pour l’attractivité de nos territoires.
Pour les 196 communes accueillant un casino, au-delà des revenus fiscaux directs perçus, cette exploitation participe au développement de l’économie locale et à l’attractivité du territoire, en créant des emplois en son sein, mais aussi dans son environnement direct.
Toutefois, compte tenu de leurs critères d’implantation, l’offre de casinos est inégalement répartie sur le territoire national. Elle se concentre majoritairement sur les bords de mer ou dans les départements les plus urbanisés. D’autres zones, moins dynamiques, sont quant à elles non couvertes – c’est le cas de 38 départements français.
Ces critères d’implantation sont le fruit de près de deux siècles d’encadrement strict, mais nécessaire, des jeux d’argent et de hasard par l’État.
Actuellement, conformément au code de la sécurité intérieure, peuvent accueillir un casino de manière dérogatoire les communes classées stations balnéaires, thermales, climatiques ou de tourisme ou les villes principales d’agglomération de plus de 500 000 habitants qui sont dotées d’établissements culturels spécifiques.
La multiplication de démarches émanant aussi bien d’élus locaux que de parlementaires témoigne d’une volonté, sur le terrain, de faire évoluer les conditions d’implantation de ces établissements.
Pour autant, il est essentiel de penser cette évolution avec prudence et sagesse. Le cadre juridique d’implantation des casinos doit ainsi être réformé pour maîtriser l’évolution du nombre de ces établissements.
Compte tenu des enjeux de sécurité et de santé publique liés à leurs activités, les casinos font l’objet d’une grande vigilance de la part des services du ministère de l’intérieur et des outre-mer. C’est dans cette perspective que la direction des libertés publiques et des affaires juridiques procède aux interdictions administratives de jeux ou agrée les employés des casinos.
De même, le service central des courses et jeux (SCCJ) de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) réalise des audits périodiques des établissements pour veiller au respect de la réglementation, mène des enquêtes administratives sur les employés et mobilise un réseau de correspondants territoriaux.
Préserver la capacité du ministère de l’intérieur et des outre-mer d’assurer, à moyens constants, ces missions, est fondamental pour la sécurité de tous.
Par ailleurs, nous devons penser cette évolution avec précaution et discernement pour ne pas fragiliser le réseau de casinos existant, en garantissant une aire de chalandise suffisante pour ces établissements. Si une remise à plat des critères d’implantation des casinos devait avoir lieu, elle mériterait une large concertation avec les acteurs de ce secteur économique singulier.
Afin d’étendre le maillage actuel de l’implantation des casinos en France et de permettre à des communes rurales d’en bénéficier, cette proposition de loi étend la possibilité d’installation des casinos à un nouveau cas de figure.
Il est en effet proposé d’autoriser l’implantation d’un casino aux communes sur le territoire desquelles sont implantés, au 1er janvier 2023, le siège d’une société de courses hippiques, ainsi que le site historique du Cadre noir ou un haras national où ont été organisés au moins dix événements équestres au rayonnement national ou international par an entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2023.
Trois communes qui, à l’heure actuelle, ne sont pas dotées d’un casino deviendraient éligibles : Arnac-Pompadour, Saumur et Segré-en-Anjou Bleu. La rédaction issue de l’examen du texte en commission étend ainsi l’autorisation d’implantation d’un casino à un nombre limité de communes.
Si elle ne constitue pas une fin en soi, cette proposition de loi permet de faire évoluer les conditions d’implantation de nos casinos et d’aller vers des zones blanches, répondant en cela à une attente forte des territoires concernés.
Pour ces raisons, le Gouvernement s’en remettra à la sagesse du Sénat quant à l’adoption de ce texte, dont nous souhaitons que la rédaction soit retravaillée au cours de la navette parlementaire, afin de prévoir le cumul d’un critère tiré de l’activité hippique et d’un critère lié au classement touristique de la commune. Cette nouvelle rédaction s’inscrirait dans la logique de la rédaction actuelle de l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, qui exige la vérification d’un critère d’attractivité touristique constaté par un label.
Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le risque que des ajouts dans la loi au gré de la promotion d’intérêts particuliers n’aboutissent à un inventaire à la Prévert de critères dépourvus de cohérence.
Si un casino est un atout pour l’attractivité d’un territoire et pour le développement local, son implantation ne peut guère faire l’économie des moyens de vigilance accrue que ces établissements mobilisent face aux enjeux de sécurité et de santé publique intrinsèquement liés à leurs activités.
Pour finir, je remercie les parlementaires qui se sont saisis de cet enjeu, qui touche au cœur de nos territoires et aux loisirs de nos concitoyens.
Mme Françoise Gatel applaudit.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, les casinos représentent une manne d’un peu plus d’un milliard d’euros au 31 octobre 2021, en diminution par rapport aux années précédentes.
De son côté, la filière équine suscite, selon l’Observatoire économique et social du cheval de l’Institut français du cheval et de l’équitation, brasse plus de 11 milliards d’euros de flux financiers par an.
L’idée d’utiliser ces filières pour soutenir les collectivités locales et le patrimoine n’est pas nouvelle, comme en témoigne la récente expérience du loto du patrimoine, organisée par le célèbre Stéphane Bern.
Les collectivités territoriales souffrent d’un manque de moyens pour financer les infrastructures existantes. Aussi nos collègues auteurs de cette proposition de loi ont-ils, de manière parfaitement logique et cohérente, opéré un rapprochement entre les deux activités, pour combler un désert ludique et profiter des revenus des jeux.
Comme l’ont souligné les orateurs précédents, le texte que nous examinons peut sembler simple et guidé par une certaine logique : il s’agit d’aider au financement de l’entretien des infrastructures du Cadre noir de Saumur.
Pour ce faire, la proposition de loi comprend un article unique introduisant une sixième hypothèse de dérogation au principe d’interdiction générale des jeux d’argent et de hasard, qui serait fondée sur l’existence d’infrastructures et d’activités équestres au sein de la commune. Le texte instaure donc un double critère.
La commission est revenue sur la condition cumulative tenant à l’existence du site historique du Cadre noir et d’un haras national sur le territoire d’une même commune, de manière à étendre le champ de la proposition de loi aux communes qui accueillent ou l’un, ou l’autre.
Par ailleurs, si les communes d’Arnac-Pompadour et de Saumur organisent annuellement de nombreux événements équestres, les événements dits « hippiques » ont lieu dans les hippodromes se trouvant sur le territoire de communes voisines. La commission a donc retenu le terme « équestre », qui renvoie à l’ensemble des activités relatives au monde du cheval et de l’équitation.
La commission a souhaité maintenir un lien étroit entre la commune, les activités hippiques ou équestres et les paris sportifs, en retenant comme critère d’implantation la présence dans la commune du siège d’une société de courses hippiques.
Avec ce texte, je suis saisie d’une double allégresse : mon département, l’Orne, comprend à la fois un haras national – le haras national du Pin –, propriété du département depuis la promulgation de la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite loi 3DS, et un casino – celui de Bagnoles de l’Orne Normandie. Me voilà donc absolument comblée !
Toutefois, la rédaction issue des travaux de la commission fragilise le texte. En effet, alors que celui-ci était assez cohérent lorsqu’il s’agissait d’implanter un casino unique à Saumur, l’extension de son champ à d’autres communes le dessert, car aucune négociation ne s’est tenue avec les autorités compétentes – j’y reviendrai.
Au sujet des auditions non publiées, le rapport indique : « Il ressort des auditions des syndicats de casinos, de l’Association nationale des élus des territoires touristiques et des services du ministère de l’intérieur, menées par M. le rapporteur, qu’il apparaît nécessaire d’envisager aujourd’hui une réflexion plus globale sur les critères permettant l’installation d’un casino dans une commune. » C’est exactement ce qu’a dit Mme la secrétaire d’État. À cet égard, la fin de l’expérimentation relative aux clubs de jeux parisiens devra donner lieu à une évaluation globale.
Par ailleurs, la facilité qui consiste à fusionner l’hippisme et l’équestre, c’est-à-dire ce qui relève des courses – donc du jeu – et ce qui relève des concours hippiques – donc du sport – n’est, selon les spécialistes, pas judicieuse. La complexité de la situation appelle une réflexion plus globale.
Malgré ses mérites, le texte qui nous est proposé est un texte de circonstance, qui devra être retravaillé. Mais son examen lance clairement un débat qui méritera d’être approfondi avec l’ensemble des acteurs de la filière cheval.
Les voies de financement de la filière provenant des paris en ligne et des courses hippiques sont déjà bien identifiées et fléchées. L’extension, dans la version de la commission, du champ de la proposition de loi complexifie le sujet et appelle d’autres réflexions, qui sont d’ailleurs engagées entre les autorités de tutelle et les syndicats d’opérateurs. Voilà ce à quoi nous devons parvenir : qu’il y ait un débat global sur le sujet, pour trouver un bon équilibre.
Un texte de circonstance peut déséquilibrer l’ensemble de la filière, comme en témoigne l’ouverture du casino de Saint-Gervais-les-Bains, qui a affaibli ceux de Megève et de Chamonix.
Il est vrai que les territoires ruraux doivent pouvoir se doter de casinos et qu’il faut opérer un rééquilibrage entre les territoires. Cette proposition de loi a le mérite d’évoquer ce sujet. Néanmoins, j’estime que sa rédaction doit être retravaillée.
Aussi, le groupe Union Centriste s’abstiendra sur cette proposition de loi.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, l’implantation des casinos pourrait sembler un sujet anecdotique ou secondaire, voire, au regard des préoccupations quotidiennes de nos concitoyens, marginal. Chacun, dans cet hémicycle, conviendra que l’actualité appelle peut-être d’autres priorités.
Toutefois, j’ai la conviction que nous aurions tort de nous désintéresser de cette proposition de loi. En effet, mon département, la Gironde, comptant six casinos, je mesure l’impact positif de la présence de ces établissements sur nos territoires.
Pour prendre l’exemple particulier du casino de Bordeaux, qui a ouvert il y a une vingtaine d’années, celui-ci représente un gain significatif pour la ville, puisqu’elle prélève directement une somme sur le produit des jeux de l’établissement, qui alimente notamment les lignes budgétaires consacrées aux politiques sociales.
Aussi, sans entrer encore dans les aspects juridiques, la question de l’implantation des casinos de jeu présente un intérêt économique certain pour les communes concernées. Notre pays compte un peu plus de 200 casinos, qui emploient plusieurs dizaines de milliers de personnes et contribuent au développement économique des espaces touristiques où ils sont implantés.
De ce point de vue, chacun s’accordera sur l’opportunité de cette proposition de loi. Pour ma part, je partage néanmoins certaines remarques que j’ai déjà pu entendre au sujet de ce texte : l’implantation d’un casino ne saurait être une solution pérenne pour répondre aux difficultés financières que rencontrent nos collectivités dans leur ensemble.
Il s’agit d’un problème global, qui mérite une réponse généralisée à l’ensemble des collectivités. Nous devons nous y pencher à l’occasion de l’examen du projet de loi, mais aussi lorsque nous cherchons des solutions pour dynamiser les politiques économiques de nos collectivités.
Par ailleurs, je suis plus circonspecte sur la dimension juridique du texte, notamment lorsque je lis la rédaction de l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, qui fixe une liste de dérogations permettant l’ouverture de nouveaux casinos.
Actuellement, les communes déclarées villes d’eau, stations thermales ou balnéaires, ainsi que les villes principales d’agglomérations de plus de 500 000 habitants ayant des activités touristiques et culturelles particulières peuvent accueillir de tels établissements.
Cette proposition de loi vise à ajouter une nouvelle catégorie, très singulièrement liée aux événements hippiques. Si je veux bien admettre le lien existant entre le monde des paris et celui des jeux, nous comprenons surtout que cela permettrait d’inclure les communes d’Arnac-Pompadour et de Saumur, ainsi que, par l’assouplissement des critères en commission, une dizaine d’autres communes. Je puis d’ailleurs vous proposer d’autres communes girondines à ajouter si besoin !
Plutôt que d’élargir le dispositif d’autorisation par des critères si spécifiques qu’ils ne viseraient qu’une ou deux communes déjà bien identifiées, peut-être vaudrait-il mieux le repenser dans sa globalité, de sorte qu’il soit moins contraignant d’un point de vue législatif.
En outre, sans tomber dans une forme de moralisme excessif, je refuse de faire comme si le phénomène de la dépendance aux jeux n’avait rien de préoccupant. Une proposition de loi qui élargit les possibilités d’implantation des casinos ne peut s’affranchir de toute réflexion sur la promotion et le développement d’établissements de jeux de hasard et d’argent, en particulier à une époque où les paris sportifs en ligne posent de grandes difficultés, notamment parmi les jeunes générations.
Le législateur se doit de faire preuve de vigilance pour ne pas donner le sentiment qu’il accompagne favorablement ce développement inquiétant, au moment même où les casinos français ont connu, depuis le début de l’année, des baisses de fréquentation significatives par rapport à 2019, et même s’ils sont nombreux, à l’instar du casino de Bordeaux, à prendre en charge les addictions. Il est toujours bon de le répéter, et nous devons en faire une ligne de conduite.
Même si la situation semble s’arranger en 2023, la pandémie de la covid-19 a bouleversé les habitudes : de plus en plus de joueurs préfèrent désormais les jeux d’argent en ligne, malgré l’interdiction des jeux de hasard sur internet. Cela mériterait une étude d’impact approfondie, ce que ne permet pas la présente proposition de loi – c’est fort dommage !
Cela dit, le groupe RDSE reste, dans son ensemble, favorable à cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées des groupes RDSE, RDPI et INDEP, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.

La parole est à M. Claude Nougein. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et INDEP. – M. Jean-Claude Requier applaudit également.)

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nos territoires ruraux sont trop souvent abandonnés, alors qu’ils sont si dynamiques et innovants !
Plus que jamais, notre espace rural mérite que nous fassions preuve d’une véritable ambition. Il est de plus en plus perçu par les Français comme une richesse, comme un facteur d’équilibre social et comme un lieu d’épanouissement. Mais, malgré cette image positive, la vérité du monde rural reste mal connue et mal comprise.
Les besoins en infrastructures et en services publics sont souvent ignorés. De plus, de récentes lois comme la loi Climat et résilience, qui fixe un objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) des sols, vont accentuer la désertification rurale et le désengagement de l’État, ce dernier sonnant aujourd’hui comme une alerte dans l’esprit des élus qui défendent leur territoire.
La filière équine représente parfois une composante importante du développement des territoires ruraux, en cela qu’elle est créatrice d’emplois et génératrice d’activités sportives, sociales et culturelles. Elle crée du lien social, elle favorise le développement rural et elle est une alliée du développement durable.
De plus, le cheval est un acteur majeur de la culture française : l’Unesco a inscrit l’équitation de tradition française au patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2011. En Corrèze, nous avons la chance, avec le haras national d’Arnac-Pompadour, de compter un site historique, véritable emblème du territoire et de la filière équestre, laquelle se délite.
La commune d’Arnac-Pompadour abrite toujours le siège administratif de l’Institut français du cheval et de l’équitation, l’IFCE. Or, devant une gestion toujours plus complexe, l’État souhaite se désengager de cette filière et se concentrer sur ses missions régaliennes, ce qui est peut-être normal, d’ailleurs.
Comment compenser ce désengagement ? Comment sauver cette filière équestre connue et reconnue ? Bien sûr, les territoires ruraux ont l’innovation chevillée au corps. Bien sûr, leurs élus font toujours preuve d’imagination et d’innovation pour faire vivre leurs territoires.
L’attrait touristique des départements ruraux du centre de la France repose notamment sur les activités équestres, qui, de par leur lien avec le monde du jeu et des paris, pourraient constituer un support du développement de nouvelles infrastructures telles que des casinos.
Ainsi, autoriser les villes ayant développé une activité importante en lien avec l’équitation à ouvrir des casinos pourrait viser un double objectif : remédier à l’inégale répartition de ces établissements sur le territoire et sauver la filière cheval.
La législation en vigueur profite essentiellement à des communes littorales et à des stations thermales, auxquelles nous donnons un certain monopole, alors qu’elles disposent déjà de nombreux atouts touristiques, à l’inverse de nos territoires ruraux, qui sont bien plus enclavés.
En outre, l’ouverture d’un casino dans une commune est une source importante d’emplois. Ces établissements contribuent ainsi de façon déterminante aux développements touristiques et culturels, ce qui rejaillit nécessairement sur l’ensemble des autres activités de la commune où ils sont implantés. Ils participent à l’animation et à l’attractivité des territoires concernés et comptent souvent, à la faveur de la redistribution fiscale, parmi les premiers contributeurs du budget des communes.
Aussi, mes chers collègues, cette proposition de loi va au-delà de la simple autorisation d’ouverture d’un casino. Il s’agit de maintenir en vie toute une filière de l’économie locale de communes qui comportent à la fois un stade équestre et un établissement de l’Institut français du cheval et de l’équitation, mais aussi qui ont développé une attractivité particulière et récurrente liée à l’organisation d’événements équestres de rayonnement national ou international.
Par exemple, dans la commune d’Arnac-Pompadour, plus de 160 journées équestres seront maintenues – ce n’est pas rien, c’est même la vie de ce territoire ! Seules quelques communes, dont Arnac-Pompadour et Saumur, entrent dans le cadre du dispositif. Ces communes sont des sites historiques du Cadre noir ou des haras nationaux.
Il n’y a aucun casino dans ces territoires, ni même alentour. En effet, il n’y en a pas à moins de 100 kilomètres d’Arnac-Pompadour, et je pense qu’il en va de même pour Saumur. Il s’agirait d’installer des établissements petits, mais viables, dont les taxes permettraient de sauver la filière équestre. L’économie locale et l’attractivité de tout un territoire en dépendent.
Ces ouvertures de casinos assureraient des retombées économiques aux communes dotées d’une activité équestre pluriséculaire et permettraient d’accroître leur attrait touristique et leurs ressources financières.
Mes chers collègues, vous l’aurez compris, il s’agit de défendre non pas la multiplication des casinos, mais la survie de la filière équestre dans ces villes historiques du cheval !
Aussi, le groupe Les Républicains se prononcera en faveur de cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et INDEP. – M. Alain Duffourg applaudit également.
M. Daniel Chasseing applaudit.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, les communes d’Arnac-Pompadour et de Saumur, dans mon département du Maine-et-Loire, sont deux hauts lieux de l’équitation. Leur nom est associé à une longue tradition d’élevage et d’activités équestres. Leur réputation dépasse largement nos frontières.
Saumur est le site historique du célèbre Cadre noir. Il participe, avec ses écuyers et ses chevaux, au rayonnement international de l’art équestre à la française.

Son patrimoine, ses compétitions et ses infrastructures équestres constituent la clé de voûte de l’attractivité de la commune. Ils irriguent l’ensemble des secteurs d’activité locaux.
Le désengagement progressif du ministère de l’agriculture risque de compromettre la poursuite des activités équestres sportives à Saumur, à Arnac-Pompadour et dans les territoires ruraux avoisinants.
Ce texte introduit donc, tout simplement, une dérogation à la loi, afin de permettre l’ouverture d’un casino à Saumur et à Arnac-Pompadour. Il s’agit d’une demande de longue date des élus locaux et des parlementaires du territoire, dont je salue la mobilisation. À ce propos, je salue le maire d’Arnac-Pompadour et la députée de la circonscription de Saumur, Laetitia Saint-Paul, qui sont présents dans la tribune. Ces deux communes sont historiquement et intimement liées au monde équestre.
Par cette proposition de loi, soutenue par l’ensemble des sénateurs des départements concernés, cosignée par Daniel Chasseing et moi-même et amendée par M. le rapporteur, il s’agit de remédier au déséquilibre dans l’implantation des casinos à l’échelle du territoire national.
En France, les casinos sont concentrés, principalement, sur le littoral. Les territoires ruraux du centre du pays sont, à de rares exceptions près, totalement laissés de côté. Quand on sait à quel point ces établissements sont un atout pour leur territoire, on ne peut que le déplorer.
Comme l’a souligné Claude Nougein, l’implantation d’un casino contribue de manière déterminante au développement touristique et culturel local. Son exploitation est une source importante d’emplois à l’année et – vous l’avez reconnu, madame la secrétaire d’État – d’activité économique pour le territoire concerné.
Aussi l’implantation d’un casino dans ces deux communes serait-elle une excellente chose, d’autant plus que, pour ce qui concerne Saumur, le casino le plus proche se trouve à 106 kilomètres – il s’agit du petit casino de La Roche-Posay. Je rassure donc Nathalie Goulet : il n’y aura pas de grande concurrence avec d’autres casinos.
Ainsi, la majorité des membres du groupe Les Indépendant votera, comme Daniel Chasseing et moi-même, qui en sommes cosignataires, cette proposition de loi.
J’ajouterai un dernier argument : il s’agit peut-être de la dernière proposition de loi déposée par notre collègue Catherine Deroche. C’est donc l’occasion de manifester, par notre vote positif, notre reconnaissance pour son travail, à propos de cette proposition de loi, mais aussi tout au long de ses trois mandats.
Vifs applaudissements sur les travées des groupes INDEP, UC et Les Républicains. – Mme Nathalie Delattre applaudit également.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, notre ordre du jour, à l’approche des élections sénatoriales, nous réserve, parfois, des surprises.
Cette proposition de loi comprend un article unique introduisant une sixième dérogation au principe d’interdiction générale des jeux d’argent et de hasard, qui reposerait sur l’existence d’une infrastructure et d’une activité équestre au sein d’une commune.
Une telle dérogation profiterait essentiellement à deux communes, dont l’une est située dans le département d’élection des auteurs de la proposition de loi… Outre l’opportunité de voter une telle loi six mois avant les élections sénatoriales, qui concerneront ce département, ce texte nous semble problématique sur plusieurs points.
Tout d’abord, la finalité de cette proposition de loi, par l’ajout de deux nouvelles conditions, est de permettre à deux villes d’implanter des casinos sur leur territoire. Nous le savons tous, et les auteurs de la proposition de loi le soulignent avec justesse, en raison des critères d’installation, l’implantation des casinos est très inégale sur notre territoire, avec de lourdes conséquences, car la présence d’un casino crée des emplois directs ou indirects et a des retombées touristiques positives.
Au-delà de l’argument de la création d’emplois, les communes où se trouve installé un casino bénéficient d’une manne financière certaine : ces presque 200 communes perçoivent en moyenne 1, 4 million d’euros chaque année au titre d’une taxe sur les produits des jeux. Ces ressources représentent jusqu’à 30 % du budget des villes concernées. La Gironde comptant six casinos, ces derniers représentent une manne financière non négligeable pour le département.
Nous entendons les besoins de la filière équine, et singulièrement, bien entendu, les difficultés que rencontrent les communes de Saumur et d’Arnac-Pompadour pour financer leurs activités et infrastructures équestres. Nous entendons aussi la petite musique issue des travaux de la commission, M. le rapporteur trouvant « nécessaire d’envisager une réflexion plus globale sur les critères permettant l’installation d’un casino dans une commune ».
Toutefois, nous ne pensons simplement pas que la solution envisagée pour remédier à ce problème, à savoir installer de nouveaux casinos, soit la bonne. Cet objectif de création d’emplois et cet espoir de revenus supplémentaires pour les communes et pour favoriser la filière équine ne sauraient cacher les problématiques liées aux casinos.
Notre groupe considère que la restriction d’implantation des casinos se justifie par des considérations de santé publique.
Les jeux d’argent et de hasard, donc les casinos, sont, comme l’a rappelé le rapporteur, régis par un principe de prohibition. Leur interdiction se justifie par des motifs d’intérêt général. Ainsi, l’article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure dispose qu’ils « font l’objet d’un encadrement strict aux fins de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public et à l’ordre social, notamment en matière de protection de la santé et des mineurs ».
L’addiction aux jeux d’argent peut avoir des conséquences financières, psychologiques et familiales dramatiques pour les victimes. Selon le sociologue spécialisé Jean-Pierre Martignoni-Hutin, 48 000 personnes sont interdites de jeu en France, sans tenir compte de celles qui sont inscrites dans des dispositifs de régulation du jeu.
Selon SOS Joueurs, 79 % des victimes d’addiction au jeu sont endettées. Aussi, de grâce, évitons d’ouvrir une brèche pour la multiplication de ces établissements de jeu d’argent.
À nos yeux, ce texte ne présente que l’une des solutions envisageables pour la respiration financière des communes. Nous le répétons souvent, les baisses de la dotation globale de fonctionnement (DGF), la mainmise du préfet sur de trop nombreux financements, les restrictions de levier fiscal propre et la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) asphyxient les collectivités locales.
C’est bien là le cœur du problème de nos territoires : leurs capacités d’actions sont limitées. Or ce problème ne peut et ne doit être résolu qu’au travers de mesures structurelles, pérennes et adaptées à chaque territoire.
Nous souscrivons à l’ambition de redonner aux collectivités territoriales les moyens d’une plus grande autonomie financière, celle-ci étant mise à mal depuis plusieurs années. Au reste, plusieurs groupes du Sénat y travaillent. Le véritable enjeu réside là, et non dans l’ouverture des portes de nouveaux casinos de jeu.
Ce texte facilitant les installations de casinos ne constitue en rien une solution. Nous ne le voterons pas.
Applaudissements sur les travées des groupes RDPI et INDEP.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous débattons aujourd’hui d’une proposition de loi importante pour réduire les inégalités territoriales en matière d’ouverture de casinos.
Ce texte vise à permettre leur installation dans les terres de cheval, qui attirent chaque année un public nombreux pour des événements équestres ou des courses hippiques. Ces dernières sont d’ailleurs déjà une forme de jeu d’argent. Dès lors, l’arrivée du casino ne fait pas de différence morale majeure. Par ailleurs, passion du jeu et cheval sont liés : l’une offre la chance d’un instant, l’autre incarne la force et la beauté en mouvement.
Mme Catherine Deroche approuve.

Permettez-moi de souligner l’importance économique du secteur des casinos en France.
Actuellement, notre pays compte 196 casinos, qui jouent un rôle majeur pour notre économie, dans 190 communes d’implantation privilégiées. Dans ces communes, la contribution financière du casino représente en moyenne près de 10 % du budget communal – jusqu’à 80 % pour certaines.
De plus, la filière française des casinos représente 50 000 emplois, notamment 18 200 emplois directs. Ces établissements sont donc des acteurs essentiels de l’animation locale et contribuent au dynamisme des régions où ils opèrent.
Ma région, la Normandie, pays de cheval, est un exemple concret de la richesse que peuvent apporter les activités équestres.

Les centres équestres normands, notamment le célèbre haras national du Pin dans l’Orne qu’a mentionné ma collègue précédemment et tout près duquel se trouve le casino de Bagnoles-de-l’Orne, attirent des passionnés de chevaux du monde entier. Ils offrent une multitude d’activités, allant des compétitions équestres à la vente de chevaux en passant par les concours de dressage et de saut d’obstacles.
La législation actuelle limite l’ouverture des casinos aux stations balnéaires, thermales et climatiques, ainsi qu’aux grandes agglomérations de plus de 500 000 habitants proposant des activités touristiques et culturelles spécifiques. Cette concentration des casinos dans certaines régions a pour conséquence de créer des inégalités territoriales d’ordre économique.
Lors de son examen en commission des lois, la proposition de loi a été modifiée pour garantir son opérationnalité. Un amendement a été adopté pour permettre aux communes de Saumur et d’Arnac-Pompadour d’accueillir un casino sur leur territoire. Ces villes se distinguent par leurs activités équestres prestigieuses, telles que le concours national d’Arnac-Pompadour et la compétition « Saumur complet », qui attirent des milliers de spectateurs chaque année.
Bien sûr, les jeux d’argent sont aussi un enjeu de santé publique qu’il faut considérer avec sérieux. L’ordonnance du mois d’octobre 2019 réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard montre l’engagement du Gouvernement envers la protection des citoyens, la transparence et l’intégrité dans le domaine des jeux d’argent et de hasard. En effet, elle a créé l’Autorité nationale des jeux (ANJ), dotée de pouvoirs renforcés, encadré la privatisation de la Française des jeux (FDJ) et préservé le contrôle rigoureux sur ces activités.
Le titre II du livre III du code de la sécurité intérieure prévoit déjà le dispositif par lequel les communes peuvent demander l’ouverture d’un casino. Il comporte une possibilité d’appel de la décision préfectorale et celle d’octroyer des dérogations. Tout en étant d’accord sur le principe, on peut donc interroger le véhicule législatif choisi.
Ouvrir des casinos seulement dans les stations thermales, c’est la double peine pour les autres départements touristiques, qui méritent aussi leur part de frissons et de jackpots.
Ces territoires méritent leur tour de roulette ; ouvrons-leur les portes de la chance ! §Cette ouverture permettrait de développer davantage ces infrastructures touristiques et contribuerait à l’épanouissement économique local.
De plus, ce texte n’est pas dépourvu de garanties. Les communes éligibles devront avoir organisé au moins dix événements hippiques de rayonnement national ou international pendant une période d’au moins cinq années avant le 1er janvier 2023. L’amendement adopté en commission tend à préciser que les communes doivent disposer soit du site historique du Cadre noir, soit d’un haras national, et doivent être le siège d’une société de courses hippiques au 1er janvier 2023.
Cette proposition de loi offre une occasion unique de dynamiser Saumur et Arnac-Pompadour, en permettant à ces deux communes d’ouvrir des casinos. Cela aurait un impact positif sur l’emploi, en créant de nouvelles occasions pour les habitants de ces régions. Les casinos sont connus pour offrir une variété de postes, allant des croupiers aux serveurs, en passant par les agents de sécurité et les responsables marketing.
Ainsi, l’ouverture de casinos dans ces villes permettra de stimuler l’économie locale et l’emploi et sera l’occasion d’offrir aux habitants de ces territoires des événements culturels à thèmes, dîners-spectacles et animations, au sein de lieux uniques. Bien souvent, des offres financières spécifiques sont d’ailleurs négociées pour les locaux.
Cela aura également un impact positif sur les commerces locaux, tels que les hôtels, les restaurants, les magasins et les attractions touristiques. Les retombées économiques seront significatives, créant ainsi un cercle vertueux de développement, de prospérité et d’attractivité.
Les autres pistes d’extension des dérogations pour l’ouverture de casinos, explorées par les amendements de mes collègues Franck Menonville pour les plans d’eau et Else Joseph pour les départements frontaliers, méritent également d’être discutées ici.
En conclusion, cette proposition de loi offre l’occasion de réduire les inégalités territoriales et d’adresser un message quant à notre engagement en faveur de l’équité des territoires. Pour autant, elle peut être perçue comme un effort trop sectoriel, trop spécifique à un petit nombre de villes, sans que la nécessité d’en passer par une loi soit établie.
Les membres du groupe RDPI voteront donc chacun en toute liberté sur ce texte.
Sourires.
Applaudissements sur les travées du groupe INDEP, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

M. Joël Bigot. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui une proposition de loi très spécifique, pour permettre aux communes de Saumur, en Maine-et-Loire, et d’Arnac-Pompadour – cela ne s’invente pas !
Sourires.

Ce texte vient répondre utilement à une demande ancienne des élus locaux, notamment du Saumurois.
En 2019, lors de l’examen de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte, j’ai défendu avec mes collègues de Maine-et-Loire, Catherine Deroche et Stéphane Piednoir, un amendement visant le même objectif : permettre l’ouverture de casinos dans les villes accueillant l’Institut français du cheval et de l’équitation.
Nous voulions ainsi préserver le patrimoine équestre et l’attrait touristique de ces communes en leur apportant des moyens financiers aptes à garantir la pérennité de la filière Cheval en France. Cet amendement n’a malheureusement pas pu être discuté pour des raisons d’irrecevabilité.
Cette proposition de loi s’inscrit dans la continuité de ce travail transpartisan. Elle est conforme à l’objectif d’attractivité du territoire. Nous espérons donc l’adoption de ce texte consensuel qui, au regard des déclarations du Président de la République, devrait recueillir l’assentiment du Gouvernement.
En effet, interpellé sur le sujet par le maire de Saumur en 2019 lors du grand débat national post-« gilets jaunes », le Président de la République avait promis, comme à son habitude, que la commune recevrait l’autorisation avant la fin de son premier quinquennat ; il indiquait même ne pas comprendre les freins juridiques à la réalisation d’un tel projet. Depuis lors, certains élus disposent même d’un engagement écrit de la présidence favorable à cette implantation…
Les modifications actées par la commission la semaine dernière précisent et améliorent la proposition de loi initialement déposée. La nouvelle rédaction permet en l’occurrence de lever les difficultés posées par les conditions cumulatives d’existence du Cadre noir et d’un haras national sur le territoire d’une même commune, alors que ce n’est pas le cas tant pour Saumur que pour Arnac-Pompadour.
L’ajout d’un critère pour la commune bénéficiaire, à savoir accueillir le siège d’une société de courses hippiques au 1er janvier 2023, mais également avoir organisé annuellement au moins dix événements équestres au cours des cinq dernières années, me paraît suffisamment restrictif pour encadrer le dispositif proposé.
Ainsi, la version actuelle permet de clarifier et rend opérationnelle la volonté des auteurs de la proposition de loi, à laquelle je souscris. Elle devrait également inspirer nos députés impliqués sur ce sujet pour qu’ils concourent à l’adoption finale de ce texte au plus tôt.
Les retombées attendues en termes d’attractivité sont très importantes pour le Maine-et-Loire, notamment la ville de Saumur. De l’aveu même du maire, la commune escompte entre 200 000 et 300 000 visiteurs supplémentaires par an. L’activité pourrait créer entre 60 et 100 emplois selon la taille de l’établissement, et les recettes fiscales, de l’ordre de 1 à 2 millions d’euros par an, ne sont pas négligeables, d’autant que s’y ajoutera un soutien à l’activité équestre.
Ce texte permettra de toute évidence d’apporter des solutions à nos territoires qui n’entraient pas dans les critères actuels de la loi.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, je salue cette initiative de notre assemblée, qui arrive à point nommé.

Les élus du Maine-et-Loire et d’ailleurs peuvent se rendre compte en actes que la chambre des territoires demeure toujours attentive à leurs enjeux locaux. Le Sénat est dans son rôle lorsqu’il rappelle à l’exécutif ses promesses.
Je souhaite enfin utiliser cette tribune pour enjoindre à nos députés de se saisir de ce travail, afin qu’aboutisse rapidement ce dossier qui n’a que trop duré. Tous les feux sont au vert, mes chers collègues : tâchez d’en assurer un dénouement heureux.
Je me prononcerai donc en faveur de cette proposition de loi, à l’instar d’un certain nombre de mes collègues, même si tous ne la voteront pas.
Applaudissements sur les travées des groupes SER et INDEP, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la proposition de loi sur laquelle nous nous apprêtons à débattre se présente comme un outil pour réduire les inégalités territoriales via l’ouverture de casinos.
Je vous l’avoue, mes chers collègues, nous n’avons pas la même définition de la lutte contre les inégalités, puisque votre proposition de loi ne concerne que deux communes, dans un pays qui en compte plus de 35 000…

En changeant un seul mot, monsieur le rapporteur, je le reconnais, vous avez élargi à treize communes cette proposition de loi. Toutefois, vous en conviendrez, cela reste encore très faible.
Je parle bien évidemment des communes qui peuvent accueillir les différents événements équestres, mais nous pourrions nous interroger très sérieusement sur celles qui accueillent des événements importants et qui ne peuvent bénéficier d’une autorisation pour ouvrir un casino.
Comme je l’ai indiqué en commission, il faudrait mener une réflexion d’ensemble sur les règles d’implantation des casinos §et cesser de parler d’inégalités territoriales entre communes alors que la ville de Saumur reçoit une dotation globale de fonctionnement à hauteur de 7 millions d’euros pour 26 000 habitants.
Par ailleurs, on ne peut utiliser l’ouverture d’un casino pour pallier la perte de moyens financiers des collectivités, laquelle est une réalité. Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2023, le Sénat a voté l’indexation de la DGF sur l’inflation, une disposition qui a été retirée dans le cadre du recours au 49.3 – c’est fort regrettable.
Chaque année, il y a moins de ressources directes pour les collectivités. Il faut que l’État, qui se désengage depuis des années, soit responsable face aux besoins de toutes les communes. Ce n’est pas une délégation de service public via les casinos qui permettra toujours à des budgets de résister.
Que fait-on quand certaines collectivités dépendent essentiellement de cette ressource ? Le rapport de la Cour des comptes souligne les limites de ce montage, et nous ne pouvons prendre de décision sans tenir compte de la crise sanitaire que nous avons traversée ou de la crise de l’énergie que nous vivons actuellement.
En effet, dans son rapport, la Cour des comptes note la dépendance forte de certaines collectivités à cette ressource, surtout en période de crise. En faisant reposer le financement de charges récurrentes et pérennes sur les recettes en provenance du casino, elles ne peuvent résister aux retournements de la conjoncture économique.
Ce risque a été visible à deux reprises : pendant et après le confinement, avec les restrictions sanitaires. Certaines recettes ont chuté de 20 %, 30 %, voire 50 %. Le prélèvement sur le produit des jeux représente près de 30 % des recettes réelles de fonctionnement. Je laisse aux plus mathématiciens d’entre nous le soin de calculer les ratios.
Vous défendez le fait que l’ouverture de casinos permettra de répondre à des enjeux liés à l’emploi, à l’économie locale, au tourisme. Mais certaines communes ont témoigné de l’effet limité de telles installations. De la même manière, certaines communes qui ne comptent pas de casinos ont malgré tout de l’emploi, une économie locale florissante et un développement touristique important.
Nous pourrions également regretter l’absence d’une loi d’envergure qui viserait à repenser véritablement l’installation et les règles d’ouverture des casinos pour l’ensemble des communes de notre pays, qui prendrait en compte les problématiques liées à l’addiction aux jeux, notamment ses conséquences sur la vie des gens, et qui envisagerait, dans le cadre d’une politique publique, une politique de prévention en la matière en partenariat avec les responsables et les gérants de casinos – un certain nombre d’entre eux, je le sais, y sont très attentifs.
Sans surprise, mes chers collègues, vous l’aurez compris, sans réelle réflexion ni échanges sur l’implantation des casinos, nous ne pouvons être favorables à cette proposition de loi. Œuvrons à être utiles à nos collectivités à l’occasion du prochain débat budgétaire et à donner les moyens nécessaires et indispensables à nos communes, pour qu’elles puissent bâtir sereinement leur budget dès l’an prochain.
Mme Monique de Marco applaudit.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la France compte actuellement près de 200 casinos, répartis dans 63 départements ; 38 départements français en sont donc totalement dépourvus. Rappelons que ces établissements sont également des complexes de loisirs intégrant des spectacles, des animations culturelles et artistiques, de la restauration, etc.
Lancée par Napoléon en 1804 afin de lutter contre la clandestinité des jeux d’argent, l’implantation de casinos dans notre pays est régie par une loi de 1906, qui souhaitait la réserver aux villes thermales ou balnéaires. Par conséquent, l’implantation des casinos est très hétérogène sur le territoire, avec une très forte présence le long du littoral, dans les grandes stations touristiques et dans les villes d’eau, en lien étroit avec le tourisme, donc, mais sous une forme restrictive.
Partant de ce constat, Catherine Deroche, Claude Nougein et moi-même avons d’abord souhaité, grâce à la proposition de loi que nous soumettons à votre examen aujourd’hui, élargir le champ des possibles en la matière et rectifier ce que l’on peut considérer aujourd’hui comme une inégalité territoriale, tout en restant fidèles à cette caractéristique touristique.
Tous ceux qui connaissent le beau département du Maine-et-Loire le savent, la ville de Saumur remplit parfaitement ce premier critère, elle qui se trouve au cœur du parc régional Anjou-Touraine et qui est posée sur ce fleuve royal qu’est la Loire. Parmi ses nombreux atouts, nous pouvons citer son château, ses troglodytes, ses caves et même son marathon, qui s’est tenu dimanche dernier.
Nous sommes convaincus qu’il faut renforcer l’attractivité de cette belle ville, que l’on dit souvent endormie. Il ne fait aucun doute que l’implantation d’un casino contribuerait à la fois au renforcement de son rayonnement touristique et à son développement économique.
Il ne faut pas oublier que les casinos sont des établissements créateurs d’emploi, souvent le principal employeur de la localité dans laquelle ils sont implantés. Cela représente environ 15 000 emplois directs, que ce soit pour l’activité de jeux ou pour la restauration-hôtellerie, l’animation, l’accueil, la sécurité, auxquels s’ajoutent 30 000 emplois indirects. L’implantation d’un casino à Saumur, sujet régulièrement mis sur la table depuis plusieurs décennies, entraînera la création d’une centaine d’emplois.
Enfin, les retombées financières potentielles se mesurent aussi sur le budget des collectivités locales concernées, à hauteur de 30 % à Deauville, par exemple. Soutenir ce projet donnerait incontestablement des marges de manœuvre intéressantes aux élus pour lancer des initiatives créatrices de valeur.
Il est évidemment une autre dimension, tout aussi essentielle, la filière équine. L’école de cavalerie et ses nombreux manèges font partie des véritables fiertés et de l’histoire de cette sous-préfecture du Maine-et-Loire.
Saumur, ville du cheval s’il en est, accueille le siège social de l’Institut français du cheval et de l’équitation, l’IFCE, institut public au service de la filière équine qui assure la gestion du Cadre noir de Saumur et des haras nationaux, dépositaire d’un patrimoine matériel et immatériel unique qu’il lui appartient d’entretenir et de valoriser.
Or cet établissement souffre depuis quelques années d’un désengagement financier de l’État, fragilisant l’ensemble de la filière. Particulièrement sensibles au soutien qu’il convient de lui apporter, c’est en étroite collaboration avec l’IFCE que nous avons souhaité écrire cette modification de l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, qui régit l’implantation des casinos dans notre pays.
Toutefois, comme toute modification dérogatoire d’un texte de loi existant, il convient d’être mesuré. C’est dans cet esprit d’équilibre que nous avons limité cette nouvelle dérogation aux communes accueillant des sites historiques de haras nationaux ou du Cadre noir.
Pour le dire clairement, cela ne concernerait que quelques villes, en particulier Saumur et Arnac-Pompadour, y compris avec la nouvelle rédaction issue des travaux de la commission, sous la conduite de son rapporteur François Bonhomme, dont je salue l’excellent travail.
Je conclus cette intervention par la question de l’accès aux jeux d’argent. Dans l’absolu, on peut considérer que toute mesure de facilitation pourrait inciter un public plus nombreux à céder à la tentation, voire à tomber dans les affres de l’addiction, dont on connaît les dangers potentiels. Ce serait à mon sens tenir un discours d’un autre temps, en faisant abstraction des changements radicaux de pratiques que l’on observe depuis une dizaine d’années.
Rien de plus facile aujourd’hui, y compris pour des foyers aux revenus modestes, que d’acheter un jeu à gratter ou de s’inscrire sur une plateforme de jeux en ligne. Le buraliste connaît bien ses clients et sait les mettre en garde contre des dépenses excessives. De même, le croupier d’un casino a l’expérience nécessaire pour repérer le joueur qui s’enflamme et dont la banqueroute pourrait nuire à l’établissement lui-même.
Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, je vous remercie du soutien que vous pourrez apporter à cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et INDEP.
Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, Saumur et Pompadour ont des activités équestres mondialement connues.
Pompadour bénéficie de la réputation de son haras et de l’ancienneté de ses activités équestres. On les doit notamment à la famille de Pompadour, à l’origine de la construction du château de style flamboyant et de ses écuries. Cette dynastie s’achève en 1728. Louis XV achète le château et l’offre à sa célèbre favorite, qui va devenir ainsi la marquise de Pompadour. Il décide d’y créer un haras, inspiré par la qualité des pâturages limousins.
À la Révolution, le haras devient bien national. Il est vendu, puis réquisitionné par Napoléon Bonaparte pour être un bien public.
Sous Napoléon III, le sénateur Brunet empêche la privatisation du château. La République conserve le haras pour la guerre, mais aussi pour l’activité équestre.
Ensuite, le domaine accueille progressivement le siège de plusieurs grandes organisations équestres : le Sire, ou système d’information relatif aux équidés, l’établissement public administratif Les haras nationaux, enfin, l’IFCE depuis 2010.
Mes chers collègues, voilà un résumé de l’histoire prestigieuse de Pompadour et de son haras. L’activité d’élevage y est très importante – sélection, reproduction ; on y trouve aussi des activités sportives – jumping, hippodrome –, qui ont des retombées économiques très importantes pour la commune et ce territoire rural.
Le vote de ce texte donnerait la possibilité aux communes de Saumur et de Pompadour d’avoir un casino.
Pour Pompadour, le nom, l’histoire de ce lieu, son haras national, mais aussi l’absence d’un casino dans un rayon de cent kilomètres sont des données en faveur du projet. De plus, les retombées financières permettront de maintenir les 160 journées par an d’activités sportives équestres nationales et internationales, si importantes pour l’économie et le tourisme dans ce territoire, comme cela a été rappelé.
Je vous invite donc à voter cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe INDEP, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la France compte plus de 200 casinos. L’objectif initial de cette proposition était d’offrir aux communes d’Arnac-Pompadour en Corrèze et de Saumur dans le Maine-et-Loire la possibilité d’ouvrir chacune leur propre casino, objectif légitime et recevable.
Au regard du droit positif en vigueur, cette faculté leur était malheureusement interdite. En effet, les conditions permettant l’ouverture de tels établissements sont prévues de manière particulièrement stricte par l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure.
Sont pour l’heure autorisées à accueillir un casino en leur sein les communes ayant un statut de station de tourisme, balnéaire, thermale ou climatique ou les communes-centres des grandes métropoles dotées d’équipements culturels particuliers.
Il s’agit là d’un choix pour le moins arbitraire, qui entraîne une surconcentration de ces établissements sur les littoraux et, dans une moindre mesure, dans les communes thermales, laissant de nombreux territoires français écartés de la possibilité de se doter de ce type d’établissement.
La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui a donc pour objectif d’élargir ce champ. Dans sa rédaction initiale, elle permettait en effet d’ouvrir cette possibilité aux seules communes dotées de « sites historiques du Cadre noir et des haras nationaux [ayant] organisé, au moins pendant cinq années […] au moins dix événements hippiques au rayonnement national ou international par an ».
Jugeant que ces critères cumulatifs rendraient ce texte difficilement opérationnel, M. le rapporteur a préféré en changer la rédaction de l’article unique. Cette modification de la législation en vigueur devrait permettre l’ouverture à terme d’une douzaine de casinos supplémentaires.
Si le texte originel pouvait faire sens, dans la mesure où les activités hippiques et équestres alimentent grandement le monde des paris, donc des jeux d’argent, dont les casinos tirent leurs recettes, cette nouvelle rédaction soulève des interrogations et nous inquiète.
Si l’ouverture de deux nouveaux casinos n’est pas de nature à bouleverser les équilibres territoriaux en la matière, qu’en est-il de l’ouverture potentielle de treize nouveaux établissements ?
Nous ne nions aucunement que ces nouveaux casinos constitueraient des sources nouvelles d’attractivité économique et touristique pour les communes qui les accueilleront. Pour autant, nous ne pouvons adhérer à cette libéralisation excessive, et ce pour au moins deux raisons.
D’une part, il est à craindre que l’ouverture d’une douzaine de nouveaux casinos ne vienne bouleverser cette activité et ne mette encore plus en difficulté cette filière, déjà fragilisée par l’essor des jeux de hasard et des paris en ligne.
D’autre part, la fréquentation des casinos et la pratique des jeux de hasard et de paris en ligne sont source d’excès, de dépendance et d’endettement pour certains de nos concitoyens.
Ainsi, au cours des cinq dernières années, les dépenses de jeux des Français ont augmenté de 12, 5 %. Par ailleurs, 1, 6 % de nos concitoyens s’adonneraient à une pratique excessive en la matière, soit plusieurs centaines de milliers de personnes, particulièrement au sein des milieux sociaux défavorisés, populaires et paupérisés.
Nous partageons donc les réserves et la prudence qui ont été exprimées tant par notre collègue Nathalie Goulet que par Mme la secrétaire d’État. Pour autant, une fois n’est pas coutume, les sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain disposeront d’une liberté de vote, liée aux enjeux locaux et territoriaux, ainsi que Joël Bigot l’a exposé tout à l’heure. Pompadour et Saumur, oui ! En revanche, l’ouverture d’un casino dans une douzaine de nouvelles communes n’est pas forcément raisonnable.
Par conséquent, dans sa majorité, le groupe SER s’abstiendra.
Applaudissements sur les travées du groupe SER. – Mme Nathalie Goulet applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, faire plus avec moins, c’est ce casse-tête récurrent que les élus locaux doivent résoudre au quotidien. C’est donc naturellement que les communes cherchent de nouvelles sources de revenus.
Les casinos, en tant que jeux d’argent et de hasard, sont régis par une règle de prohibition. Ce principe salutaire, que cette proposition de loi ne remet nullement en cause, vise à prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public et à l’ordre social, notamment en matière de protection de la santé et des mineurs.
Si l’on peut comprendre que les dérogations à la prohibition de principe d’implantation des casinos concernent des villes ayant une culture du tourisme, on peut néanmoins s’interroger sur les inégalités territoriales résultant de cette logique. En effet, cette dernière a finalement contribué à rendre encore plus attractives des communes ayant déjà de forts atouts touristiques.
L’objectif de ce texte est donc de lutter contre les inégalités territoriales, sans pour autant supprimer l’interdiction de principe des casinos ni transformer les villes françaises en autant de mini-Las Vegas.
Sourires.

L’extension prévue est limitée aux communes ayant un lien particulier et important avec l’activité hippique. En effet, ces communes ont déjà une relation étroite avec l’industrie du jeu, du fait des paris hippiques qui y ont lieu. Un casino compléterait une offre existante et permettrait à la commune de dégager une nouvelle manne financière.
Cependant, je m’interroge sur le caractère trop restrictif de cette définition. En effet, cette nouvelle occasion ne semble concerner que deux communes en France : Arnac-Pompadour et Saumur.
Ainsi, elle exclut des communes de premier plan en matière hippique, qui méritent tout autant de se voir accorder l’ouverture d’un casino sur leur territoire. Je pense évidemment en particulier au sud de l’Oise, caractérisé par ses nombreux haras, ou à des communes hippiques de premier plan, comme la cité impériale de Compiègne ou encore Chantilly – capitale du cheval, n’en déplaise à Fontainebleau !
Sourires.

C’est en effet à Chantilly que se trouve le plus grand centre d’entraînement de chevaux de course d’Europe et qu’ont lieu 197 courses hippiques par an, dont, je le rappelle, les prestigieux prix du Jockey Club et de Diane. La ville compte également un musée vivant du cheval qui attire chaque année 200 000 visiteurs. Au total, 2 000 personnes y vivent de la filière hippique.
Pourquoi l’activité pluriséculaire de Chantilly dans le domaine du cheval serait-elle donc considérée comme moins importante que celles de Saumur et d’Arnac-Pompadour ?
Cette proposition de loi, dont les objectifs sont louables, aura des effets positifs, mais je regrette son caractère trop restreint. J’avais envisagé d’amender le texte, mais cela aurait sans doute remis en cause l’équilibre fragile qui a été trouvé. Je lance donc un appel, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, en faveur d’une ouverture plus large, qui bénéficierait également à cette terre de chevaux qu’est l’Oise.

La discussion générale est close.
Nous passons à l’examen du texte de la commission.
L’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Des communes sur le territoire desquelles sont implantés, au 1er janvier 2023, le siège d’une société de courses hippiques ainsi que le site historique du Cadre noir ou un haras national où ont été organisés au moins dix événements équestres au rayonnement national ou international par an entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2023. »

L’amendement n° 1 rectifié, présenté par M. Menonville, Mme Paoli-Gagin et MM. Wattebled, Decool et A. Marc, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Des communes riveraines des étangs salés et des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares. »
La parole est à M. Franck Menonville.

Cet amendement tend à offrir la possibilité aux communes riveraines d’un étang salé ou d’un lac d’une superficie supérieure à 1 000 hectares, soit les communes soumises à la loi Littoral, d’implanter un casino.
Actuellement, seules certaines villes, communes ou stations balnéaires, thermales ou climatiques peuvent en accueillir un. Or l’ouverture d’un tel établissement contribue au développement économique d’un territoire et à son animation touristique.
Les lacs soumis à la loi Littoral accueillent des bases de loisirs qui proposent des activités nautiques et de plein air, des hébergements et de la restauration. L’ouverture d’un casino permettrait de compléter l’offre touristique proposée.

Cet amendement tend à rendre possible l’ouverture d’un casino dans les communes riveraines d’étangs salés, sans que cette notion soit précisée, ou de plans d’eau dont la superficie est supérieure à 1 000 hectares.
Je rappelle que la proposition de loi vise à trouver de nouvelles sources de financement pour les activités et infrastructures équestres et qu’elle repose sur le fait qu’il existe un lien entre les jeux d’argent et de hasard et les courses hippiques, ce qui n’est pas le cas des communes visées dans l’amendement.
Comme l’ont indiqué plusieurs intervenants, nous attendons la fin de l’expérimentation relative aux clubs de jeux à Paris en 2024 pour remettre à plat le dispositif d’autorisation des jeux. Nous pensons donc qu’il est plus opportun d’attendre ce rendez-vous.
C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
Cet amendement tend à ouvrir la possibilité aux communes riveraines d’un étang salé ou d’un lac d’une superficie supérieure à 1 000 hectares d’implanter un casino.
Or de nombreuses communes étant riveraines d’un étang salé ou d’un plan d’eau, elles pourraient toutes, si cet amendement était adopté, ouvrir un casino, ce qui n’apparaît pas opportun.
En outre, aucun mécanisme de régulation de l’implantation des casinos qui relèveraient de ces nouveaux critères n’est prévu.
D’une manière générale, en réponse à un certain nombre de demandes qui ont été formulées, notamment par le sénateur Courtial, nous vous proposons de travailler avec les services de l’État au cours de la navette parlementaire pour étudier les critères qui permettraient, le cas échéant, d’étendre à d’autres communes le droit d’ouvrir un casino, mais dans un cadre correct.
En attendant, le Gouvernement vous prie de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 2 rectifié ter, présenté par Mme Joseph, M. Laménie, Mme Gruny, M. Anglars, Mme Borchio Fontimp, MM. Pellevat, Bascher et Klinger, Mme Belrhiti, MM. Darnaud et Belin, Mmes Berthet et Dumont, M. Meurant, Mme Ventalon, MM. Cadec, Charon et Moga, Mme Lassarade, M. Folliot, Mme Muller-Bronn, MM. Cambon, Lefèvre et Genet, Mme Di Folco, M. Détraigne, Mme Micouleau, MM. C. Vial, Calvet et Levi, Mmes Imbert et Eustache-Brinio, MM. Chatillon et Mandelli et Mme Bellurot, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Des communes, à raison d’une par département frontalier, où aucun casino n’est autorisé à la date de la demande d’une commune classée commune touristique, membre d’une intercommunalité à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants. »
La parole est à Mme Else Joseph.

L’implantation de casinos peut contribuer au développement de nos territoires, dans le respect de notre législation et selon des critères objectifs adaptés au caractère exceptionnel de cette activité.
Cet amendement vise à étendre l’autorisation d’ouvrir un casino aux territoires qui en sont encore privés. Il tend à prévoir l’ouverture d’un casino dans chaque département frontalier qui en serait dépourvu, mais dans une ville classée commune touristique et membre d’une intercommunalité à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants.
S’il était adopté, cet amendement permettrait un rééquilibrage salutaire de l’implantation des casinos en inscrivant dans la législation spécifique le souci de l’aménagement du territoire, qui reste absent des dispositifs actuels.
Selon mon collègue Marc Laménie et moi-même, qui représentons les Ardennes, cette mesure présente un intérêt pour tous nos territoires frontaliers. Son adoption permettrait d’éviter des fuites fiscales importantes vers la Belgique ou le Luxembourg et de récupérer cette assiette. L’administration centrale aurait d’ailleurs réalisé un rapport sur ce sujet.
Un avis défavorable serait incompréhensible, d’autant que le Gouvernement s’était engagé en ce sens lors de la signature du pacte Ardennes, le 15 mars 2019.
En outre, l’adoption de cet amendement ne susciterait pas de dépenses publiques, bien au contraire. L’implantation d’un casino constituerait un atout touristique certain et serait d’un intérêt stratégique, notamment pour tous les départements frontaliers du nord-est, en incitant à la consommation en France, en Belgique et non pas au Luxembourg.

Je comprends parfaitement l’intention de notre collègue, qui pose trois conditions cumulatives : les communes éligibles doivent être situées dans un département frontalier, être classées communes, non pas historiques, mais touristiques – cette notion est prévue par le législateur – et appartenir à une intercommunalité de plus de 100 000 habitants.
Il faut toutefois veiller à ne pas bouleverser l’implantation actuelle des casinos en France et attendre en 2024 la fin de l’expérimentation prévue dans la loi de 2017 relative au statut de Paris. Il sera alors sans doute possible de remettre à plat la question des zones transfrontalières et de mettre en œuvre une implantation plus équilibrée des casinos sur notre territoire.
La commission émet donc un avis défavorable.
Cet amendement vise à répondre à la situation particulière des départements frontaliers, dont les habitants, en l’absence d’offre de jeux en France, vont jouer dans les casinos étrangers.
Il tend à limiter le nombre de casinos qui pourraient être ouverts en fixant trois conditions : chaque département frontalier ne pourrait compter qu’un seul casino, ce dernier ne pourrait être ouvert que dans une commune classée, laquelle devrait être membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants.
En ce qui concerne cet amendement, le Gouvernement s’en remettra donc à la sagesse de la Haute Assemblée.

Je me suis exprimée durant la discussion générale et, je l’ai dit, notre groupe est momentanément assez hostile à l’extension du droit d’ouvrir un casino, en attendant une étude plus poussée sur le sujet.
Je voterai évidemment contre cet amendement, qui tend à permettre l’ouverture d’un casino à la frontière luxembourgeoise, au moment même où l’on travaille par ailleurs sur la fraude fiscale… On a déjà tellement de problèmes de blanchiment, on ne va pas en plus installer une lessiveuse à la frontière !
Sourires.

Je remercie le Gouvernement de s’en remettre à la sagesse de notre assemblée sur cet amendement et j’encourage évidemment mes collègues à le voter.
Je rappelle que, à la suite de la demande formulée par le ministre de l’intérieur en 2019, une réflexion est en cours sur une possible évolution des critères relatifs à l’implantation des casinos. Ce travail, me dit-on, a abouti. Il permettrait de donner une base législative à ces demandes d’ouverture de casinos. La ville de Sedan et celle de Saumur seraient citées dans ce rapport.
Cette proposition de loi est l’occasion de revenir sur la carte des casinos en France, qui résulte de textes assez anciens, lesquels privilégiaient à l’époque des communes touristiques et thermales.

Je soutiendrai naturellement cet amendement, qu’a très bien présenté ma collègue des Ardennes, Else Joseph. Je remercie d’ailleurs tous ses cosignataires.
Je respecte l’intervention de notre collègue Nathalie Goulet, mais je rappelle que, si le Luxembourg n’est pas très loin des Ardennes, notre frontière la plus proche est avec la Belgique.
Historiquement, les casinos ont été implantés dans des stations thermales. Or les Ardennes en comptent de nombreuses. Soutenue par notre collègue député Jean-Luc Warsmann, l’implantation de casinos était prévue dans des secteurs frontaliers dans le cadre du pacte Ardennes signé il y a quelques années par des représentants des collectivités territoriales et le Gouvernement.
La Belgique est à deux pas. Nous aimons beaucoup nos amis belges, mais il serait dommage que des fuites d’argent aient lieu des Ardennes vers la Belgique ! La ville de Sedan a des arguments forts. Un casino concourt réellement à l’attractivité, donc à l’aménagement du territoire.
Je soutiendrai cet amendement et je salue ceux de nos collègues qui feront de même. Je remercie également Mme la secrétaire d’État de s’en remettre à la sagesse de notre assemblée sur cet amendement.
L ’ amendement est adopté.

Avant de mettre aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’article unique constituant l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Je tiens simplement à dire à Catherine Deroche et aux auteurs de la proposition de loi que notre opposition est liée non pas à la proposition de loi initiale, mais à son extension.
Les amendements qui ont été déposés en séance et les discussions qui ont eu lieu montrent qu’un véritable débat est nécessaire. Des négociations avec les opérateurs sont déjà en cours au sein du ministère de l’intérieur. Je pense qu’il est extrêmement important de les poursuivre.
J’espère que nous pourrons continuer de débattre tranquillement de ce texte au cours de la navette parlementaire, comme l’a suggéré Mme la secrétaire d’État, en nous appuyant sur les études d’impact. Des évolutions sont probablement nécessaires.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous nous abstiendrons favorablement sur ce texte.
Sourires.

Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’article unique constituant l’ensemble de la proposition de loi visant à réduire les inégalités territoriales pour les ouvertures de casinos.
La proposition de loi est adoptée.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures cinq.

L’ordre du jour appelle la discussion, à la demande de la commission des affaires économiques, de la proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France, présentée par MM. Laurent Duplomb, Pierre Louault, Serge Mérillou et plusieurs de leurs collègues (proposition n° 349, texte de la commission n° 590, rapport n° 589).
Dans la discussion générale, la parole est à M. Laurent Duplomb, auteur de la proposition de loi.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, après six ans d’un travail scrupuleux et objectif, dans la pure tradition du Sénat, je peux l’affirmer : oui, la France agricole décline !
Si nous continuons ainsi, je pense que nous pourrions, dans un avenir proche, perdre non seulement notre souveraineté alimentaire, mais aussi notre sécurité alimentaire. D’ailleurs, la pandémie de la covid-19 et la guerre en Ukraine nous ont fait toucher du doigt cette réalité, pourtant improbable il y a encore peu de temps.
La proposition de loi que j’ai rédigée avec mes collègues Pierre Louault et Serge Mérillou – je les en remercie – a pour objectif d’enrayer ce déclin et de mettre fin à cette naïveté coupable, bien française, qui consiste à empêcher de plus en plus la production chez nous, tout en fermant les yeux sur l’ouverture de plus en plus grande de nos portes aux importations.
Nous ne pouvons plus continuer à nier les évidences : à force d’interdire, à force de stigmatiser, à force de ne pas regarder la réalité en face, notre pays achète de plus en plus ! Et la France devient, de fait, de plus en plus dépendante des autres : 71 % des fruits sont importés, comme 85 % du coulis de tomate et 56 % de la viande de mouton.
La débâcle de notre agriculture s’explique par les mêmes raisons que celles qui ont conduit à ruiner notre industrie ou le secteur de l’électricité. Les mêmes causes produisent les mêmes effets !
Le choix de l’État, conditionné par une minorité qui terrorise la majorité, nous mène vers une stratégie malthusienne fondée sur le « tout montée en gamme ». Mais au moment où la pression sur le pouvoir d’achat est maximale, cette stratégie se révèle une erreur fatale, car elle oblige à déclasser plus de 40 % du lait bio, tandis que les produits d’entrée et de moyenne gamme sont importés !
Notre pays doit se repositionner rapidement comme une grande puissance agricole en donnant la priorité à la souveraineté alimentaire, ce qui implique d’augmenter la production, de répondre aux besoins du marché de masse et de s’opposer frontalement à la logique décroissante du projet Farm to Fork, qui planifie la dépendance et la famine.
Notre proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France peut y contribuer au travers de ses 26 articles.
Je remercie les 174 sénateurs qui ont cosigné cette proposition de loi et je leur dis, de cette tribune : n’ayez pas peur ! N’ayez pas peur, car, vous qui êtes élus de toutes les campagnes de France, vous la constatez, cette lente agonie qui s’accélère.
N’ayez pas peur de redonner de l’espoir à nos paysans, car vous les connaissez mieux que quiconque et vous mesurez leur désarroi face à toutes les injonctions contradictoires auxquelles ils sont soumis.
N’ayez pas peur, enfin, de ces messages de chantage et d’intimidation sous couvert d’écologisme, car la majorité d’entre nous pensent qu’il vaut mieux produire en France, plutôt que d’importer de l’autre bout du monde.
Mes chers collègues, comme l’a dit Clemenceau, « Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire ; quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire. » Aussi, soyons fiers de notre agriculture et votons cette proposition de loi !
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC. – M. Franck Menonville applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, aujourd’hui, nous faisons face à une réalité : l’agriculture française est de moins en moins compétitive, et les jeunes ne veulent plus devenir agriculteurs. Dans un certain nombre de branches professionnelles, on travaille 70 heures par semaine pour gagner la moitié du Smic. Il est urgent de prévoir un certain nombre de moyens, afin que l’agriculture française redevienne compétitive.
Nous avons laissé notre industrie s’effondrer, tout comme notre production nucléaire. Les conséquences pour notre souveraineté sont graves. Allons-nous à présent regarder notre agriculture disparaître ? Allons-nous assister sans réagir, jour après jour, à la dégradation de notre souveraineté industrielle et alimentaire ?
C’est pour éviter cela que nous avons décidé de proposer cette loi d’urgence agricole, qui a été enrichie par les travaux de notre rapporteur Sophie Primas lors de son examen en commission.
Les mesures qui y figurent sont fortes, mais alors qu’un fruit et un légume sur deux consommés en France sont importés, comme la moitié des poulets, et que les éleveurs laitiers doivent travailler 70 heures par semaine pour gagner la moitié d’un Smic, nous avons besoin de mesures fortes.
Ces mesures sont fortes, mais elles n’en sont pas moins empreintes de bon sens ! Réduction des normes, baisse des charges, sécurisation de l’accès à l’eau, levée des freins à l’innovation : voilà ce dont nos agriculteurs ont besoin.
Ces mesures ne sont pas non plus anti-écologiques, comme on peut parfois l’entendre dire dans cet hémicycle : est-ce une régression que de permettre l’épandage de pesticides très ponctuellement sur des zones ultra-ciblées plutôt que d’arroser tout un champ ?
Je conclurai en évoquant une disposition du texte qui me tient à cœur, la création d’un livret Agri. Cette idée n’est pas nouvelle au Sénat et, comme bien souvent, elle fait son chemin.
Ce livret permettra aux agriculteurs d’obtenir des prêts, à l’heure où les taux d’intérêt remontent, et donc d’investir pour leur adaptation et leur résilience face au changement climatique. Quant aux Français, ils pourront placer leur argent disponible sur un nouveau livret réglementé et ainsi témoigner de leur attachement à leur agriculture.
Le Gouvernement annonce un plan de relance pour l’industrie prévoyant une réduction de moitié des délais administratifs. Cette mesure doit être étendue à l’ensemble du secteur agricole, qui n’en peut plus, lui non plus, de la surréglementation. Le moral des agriculteurs est au plus bas. Les jeunes ne veulent plus exercer ce métier. Or on ne forme pas un agriculteur en quelques mois.
Cette proposition de loi va permettre d’accompagner les agriculteurs dans ce changement.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC. – M. Franck Menonville applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, répondre à l’urgence, répondre à la crise, donner aux agriculteurs français les moyens de nous nourrir : tel est l’objectif premier de cette proposition de loi, un texte qui fait parler, un texte critiqué. Et pour cause, il traite de sujets majeurs, et pas seulement de l’agriculture.
Ce texte porte également sur notre relation à l’alimentation, à notre souveraineté alimentaire. Il nous conduit à nous interroger sur nos différents modèles agricoles, sur leur adaptation au changement climatique ou encore sur notre modèle de société, notamment sur la relation entre urbains et ruraux. Il est difficile, voire impossible, de trouver un consensus quand on aborde ces questions.
Le texte que nous examinons aujourd’hui est d’ailleurs un texte de compromis, qui s’appuie sur les constats sans appel que, avec mes collègues Laurent Duplomb et Pierre Louault, j’ai dressés dans le rapport que nous avons publié en septembre dernier.
Pour reprendre une célèbre expression, la ferme France brûle. Notre modèle agricole décline, notre marché est submergé par des importations de denrées qui ne sont pas conformes à nos exigences environnementales, sanitaires et sociales. Notre agriculture recule, nos agriculteurs ne parviennent plus à écouler leur production, à gagner leur vie tout simplement.
Ce texte, j’en conviens, est loin d’être parfait. J’ai d’ailleurs toujours fait part à mes collègues de mes réticences quant au volet relatif aux pesticides, notamment l’article 13. Ce texte vise cependant à stopper l’hémorragie, à contenir l’incendie, à trouver des solutions concrètes pour sortir la ferme France de la crise dans laquelle elle s’est engouffrée il y a plus de vingt ans.
La détresse des agriculteurs, leurs difficultés, je les connais, car j’y ai consacré une grande partie de ma vie professionnelle.
Mon département, la Dordogne, est un territoire rural et le rapport de la commission, tout comme cette proposition de loi, y ont été bien reçus. Les agriculteurs et nos concitoyens, notamment les plus modestes, comptent sur nous.
Ils n’achètent pas tous bio, ou alors moins qu’auparavant. Ce n’est pas une question de dogmatisme, c’est tout simplement qu’ils n’en ont pas les moyens. Difficile de consommer 100 % bio ou sous signe officiel de qualité quand on n’a qu’un Smic pour trois enfants… Alors, on se contente de produits importés, moins chers, mais de bien moindre qualité.
Être de gauche, c’est combattre les inégalités. Or la première d’entre elles, c’est le contenu de l’assiette. J’en suis convaincu, donner à nos agriculteurs les moyens de nourrir tous les Français, avec nos normes de qualité supérieure à celles de nos voisins, est un moyen concret de lutter contre ces inégalités et d’aller vers cette agriculture durable et relocalisée que j’appelle sincèrement de mes vœux. Poursuivre la stratégie actuelle d’importations massives, c’est contribuer à l’érosion progressive de notre souveraineté alimentaire.
Enfin, parce qu’il ne se limite pas aux questions de pesticides, ce texte parle de compétitivité, ainsi que d’innovation et d’adaptation au changement climatique. Nous souhaitons donner aux exploitations les moyens d’investir dans cette adaptation au changement et dans l’évolution des pratiques.
Je me réjouis donc qu’un diagnostic carbone figure dans cette proposition de loi. Il s’agit d’une première pierre pour le développement de ce dispositif, outil essentiel dans la transition des exploitations agricoles et point de départ utile pour la démarche de labellisation bas-carbone.
Ce texte est issu d’une initiative transpartisane. Il a le mérite de mettre les questions d’agriculture, notamment de souveraineté alimentaire, au cœur de nos débats, à l’aube de la grande loi agricole annoncée par le Gouvernement.
M. Pierre Louault, Mmes Nadia Sollogoub et Sophie Primas applaudissent.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la compétitivité agricole est, pour les auteurs de cette proposition de loi, un sujet majeur.
C’est d’abord un impératif pour protéger notre modèle agricole français si singulier et si éloigné des modèles industriels décriés, pour lui permettre de perdurer en faisant émerger des générations de jeunes agriculteurs motivés, grâce à la double perspective d’une juste reconnaissance de leur importance et d’une juste rémunération.
La compétitivité, c’est aussi le corollaire de l’investissement, donc de la modernisation continue de notre agriculture : hier, de sa mécanisation, pour sortir les agriculteurs de la pénibilité, aujourd’hui, pour permettre l’adaptation aux conséquences du changement climatique et aux attentes sanitaires, environnementales et alimentaires de la société.
Enfin, la compétitivité est une obligation ardente si nous, Français, souhaitons rester durablement maîtres de notre alimentation, en quantité et en qualité.
Je tiens à le dire une fois encore : la compétitivité n’est pas l’ennemie d’une agriculture durable – pas plus que la durabilité ne peut s’opposer à la compétitivité.

Le temps de ces oppositions doit cesser, et je sais, monsieur le ministre, que, sur ce point, nous nous rejoignons.
Pourquoi présenter aujourd’hui un texte sur la compétitivité ?
Depuis les États généraux de l’alimentation et les lois pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dites Égalim, la politique du Gouvernement en la matière repose sur deux piliers.
D’une part, une exigence environnementale sans équivalent dans aucun autre pays européen, se traduisant par une explosion en chaîne des normes, donc des charges pesant sur les agriculteurs. D’autre part, un encouragement à la montée en gamme pour accroître les revenus, qui se traduit en réalité par une fuite en avant, comme l’a parfaitement décrit le rapport sur la compétitivité de la ferme France.
Cependant, à l’heure où les Français font face à une grave crise du pouvoir d’achat et à une forte inflation, encourager uniquement à toujours plus de montée en gamme, avec toujours plus de normes et de charges liées, c’est pousser les Français les plus modestes à acheter des produits étrangers, qui pour certains ne sont produits ni dans les normes françaises, ni même dans les normes européennes.
Nous observons aujourd’hui ce que nous avons toujours redouté au Sénat : une alimentation à deux vitesses. Il y a en effet une alimentation française, normée, labellisée, mais réservée à la part la plus aisée de la population, et une alimentation d’entrée de gamme, d’importation, pour ceux qui ont des fins de mois difficiles.
En définitive, mes chers collègues, à force de ne plus jamais parler de compétitivité, on ne s’occupe ni de la fin de mois des Français, ni de la fin du monde, ni de la faim dans le monde !

Aujourd’hui, cette proposition de loi transpartisane, faisant suite au rapport sur la compétitivité de la ferme France, entend définir les caractéristiques essentielles de l’agriculture de demain : compétitive, durable, sobre en intrants et attractive pour les jeunes arrivants.
Stockage et partage de l’eau, incitation à l’innovation, baisse des charges, lutte contre les surtranspositions, formation continue des agriculteurs, adaptation au changement climatique… Ses 26 articles, enrichis en commission, abordent des sujets fondamentaux pour l’avenir de notre agriculture.
L’enjeu de ce texte, c’est la place de notre agriculture en Europe et dans le monde, sa résilience et son rôle face au changement climatique, sa capacité à renouveler ses exploitants.
Mes chers collègues, je vous présente aujourd’hui un texte cosigné par plus de la moitié de cet hémicycle, amélioré en commission et qui, je l’espère, saura susciter un débat sans caricature ni opposition stérile entre deux types d’agriculture supposés irréconciliables.
Les auditions ont d’ailleurs souligné à quel point le monde agricole, dans sa très grande majorité, ses filières comme ses organisations représentatives, souhaitait voir assumée la thématique de la compétitivité. Ce thème, nous le déclinons en trois axes.
Le premier axe porte sur la lutte contre les distorsions de concurrence, véritable fléau pour la compétitivité de notre agriculture. Les surtranspositions sont vécues douloureusement par nos agriculteurs quand ils doivent se plier à des exigences toujours plus grandes qui n’existent pas ailleurs, notamment chez nos principaux concurrents européens.
La commission a ainsi enrichi les prérogatives du haut-commissaire à la compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires instauré par ce texte pour faire office de guichet unique des problématiques des filières. Il pourra être saisi et rendre des avis publics au sujet des normes et des surtranspositions. Loin de se substituer à vous, monsieur le ministre, il sera votre meilleur allié !
À propos de surtranspositions, je souhaiterais m’attarder sur le très commenté article 13, relatif à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). Changeons-nous les missions de l’Anses ? À l’issue du passage en commission, la réponse est non. Remettons-nous en cause le travail ou l’impartialité de l’Anses ? Non plus.
Nous donnons simplement au ministre de l’agriculture ce qu’il semble réclamer depuis quelque temps, c’est-à-dire la possibilité de faire réaliser, sur des cas particuliers, une balance bénéfices-risques de la décision, et de suspendre temporairement une décision d’interdiction de l’Anses lorsque celle-ci n’est pas synchronisée avec les autres États membres, lorsqu’il n’existe pas de solution de substitution ou lorsqu’il y a des risques avérés pour la pérennité des productions agricoles ou d’outils agroalimentaires, qui mettraient en péril notre souveraineté alimentaire.
C’est pour vous, monsieur le ministre, le meilleur moyen de pousser la recherche fondamentale et appliquée sur les productions en péril tout en incitant l’Union européenne à prendre des décisions communes à tous les agriculteurs européens, afin d’assurer l’équité concurrentielle et la sécurité sanitaire en Europe. À cet égard, je pense que la commission a trouvé un juste équilibre.
Le deuxième grand axe de la proposition de loi de nos collègues est de modérer les charges de nos agriculteurs, pour que leur revenu ne soit plus la variable d’ajustement de la compétitivité : déduction pour épargne de précaution, pérennisation du dispositif « travailleurs occasionnels-demandeurs d’emploi » (TO-DE), exclusion des entreprises à production saisonnière du bonus-malus sont autant de sujets importants que nous aborderons dans la discussion, puisque la commission les a rendus budgétairement abordables.
Enfin, le troisième et dernier grand axe de cette proposition de loi consiste à encourager le renouvellement des pratiques et l’innovation, afin d’accompagner l’agriculture dans sa nécessaire adaptation.
Deux dispositifs encouragent et accompagnent l’investissement : un crédit d’impôt d’une durée de trois ans vise à soutenir les investissements dans les secteurs les plus intensifs en main-d’œuvre ; la création d’un livret Agri aura la double vertu de resserrer les liens entre les Français et leur agriculture et d’orienter l’épargne vers les investissements agricoles, y compris l’acquisition du foncier pour les jeunes agriculteurs.
Par ailleurs, trois dispositions concernant l’usage de l’eau ont été adoptées et améliorées par la commission. Nous aurons sans doute l’occasion d’aborder cette problématique d’actualité, qui concerne un facteur majeur de compétitivité.
Enfin, je souhaite évoquer l’autorisation de l’usage de drones pour la pulvérisation aérienne de précision.
Il ne s’agit évidemment pas d’autoriser la pulvérisation tous azimuts par des avions ou des hélicoptères : c’est une mesure nécessaire si l’on veut encourager et accompagner l’innovation, accomplir de réels progrès dans la baisse des intrants et susciter des vocations parmi les plus jeunes. L’article 8 ressort donc de son passage en commission sous la forme d’une expérimentation limitée aux terrains agricoles en pente et à l’agriculture de précision. Nous sommes loin des caricatures qui ont été faites !
Je le répète, c’est par la recherche, l’investissement et l’accès à l’innovation de tous les agriculteurs que nous assurerons la résilience de notre agriculture et l’attractivité de ses métiers.
Je n’ai pu être exhaustive, tant les 26 articles ouvrent des champs diversifiés. Je suis certaine que notre discussion en séance sera riche, si elle sait éviter les effets de manche.
Pour conclure, je tiens à redire avec force que notre agriculture n’attira pas les jeunes arrivants si elle demeure enserrée dans un carcan de normes toujours plus nombreuses et complexes les unes que les autres ; si l’on étouffe la production et l’innovation par l’application irraisonnée d’un principe de précaution devenu principe d’inaction ; si l’on continue à pointer du doigt une profession qui pourtant change, évolue, innove, et dont les pratiques, répétons-le, sont déjà parmi les plus vertueuses du monde ; enfin, et c’est peut-être le plus important, si l’on ne permet pas une juste rémunération des agriculteurs.
Les agriculteurs ont une noble mission : nourrir nos concitoyens et une partie de la planète, afin d’assurer les grands équilibres géopolitiques, en étant totalement acteurs, mais aussi bénéficiaires, de la lutte contre le changement climatique. Il est nécessaire et vital pour la Nation de les soutenir, de considérer toutes leurs missions et de les rémunérer dignement.
Monsieur le ministre, soyez assuré que ces thématiques continueront d’être portées par le Sénat à l’occasion des prochaines échéances agricoles.
Bravo ! et applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et INDEP.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, une lente et inquiétante érosion de notre souveraineté agricole et alimentaire : tel est, en substance, le constat du rapport de la mission d’information sur la compétitivité de la ferme France de septembre 2022, qui a inspiré la proposition de loi dont nous allons débattre. Et il serait sans doute plus juste de parler de rapports, au pluriel, car cette proposition de loi est aussi l’aboutissement d’un travail lancé en 2019, avec un premier rapport d’information de Laurent Duplomb.
Avant d’en venir aux constats et aux mesures proposées, je souhaite saluer la qualité du travail mené par le Sénat, depuis le constat éclairant posé par la mission d’information jusqu’à cette proposition de loi cosignée par plus de 170 parlementaires issus de cinq groupes politiques différents. Je souhaite également saluer le travail de votre rapporteur, ainsi que de la commission et de ses services, et la qualité des échanges que nous avons eus en vue de l’examen de ce texte.
C’est un débat utile que nous allons mener, alors que la concertation sur le projet de loi d’orientation et d’avenir agricoles (PLOA), que j’ai lancée en décembre dernier et qui a eu lieu dans tous les territoires dont vous êtes élus, s’achèvera prochainement.
Je souhaiterais tout d’abord évoquer les constats qui ont nourri cette proposition de loi, pour vous dire que je puis naturellement en partager une partie.
Sans doute n’aurons-nous pas tout à fait la même appréciation sur ce que le Président de la République et le Gouvernement ont essayé de mettre en œuvre depuis 2017 pour répondre aux difficultés de notre agriculture, notamment en matière de compétitivité, et donner à cette dernière de nouvelles perspectives.
Je pense notamment aux allègements de cotisations patronales, à la création d’un fonds de portage du foncier, dont le prix en France est un élément d’attractivité, au soutien à la modernisation de notre outil de production avec France Relance ou France 2030, ou à des réformes plus structurelles, comme les lois Égalim, le Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement climatique et la réforme de l’assurance-récolte.
Je pense aussi à la question des clauses miroirs et de la réciprocité des normes qui, pour la première fois, a été mise à l’agenda européen – même si nous devons aller plus loin et avancer vers une généralisation. Cette question est au cœur de la bataille que nous devons mener pour garantir à nos producteurs équité et loyauté par rapport à nos concurrents étrangers.
De même, je ne présenterais pas la stratégie du Gouvernement comme fondée uniquement sur la montée en gamme. D’ailleurs, la montée en gamme est une politique déjà ancienne et constante, et je ne vous ferai pas l’offense de rappeler quand furent créées les indications géographiques protégées (IGP) et les appellations d’origine contrôlée (AOC)… Elle a soutenu certains des produits qui se vendent le plus aujourd’hui. L’enjeu est plutôt de trouver un équilibre entre la montée en gamme et la nécessité de satisfaire les besoins de toute la population, mais vous ne dites pas autre chose, je crois.
Cela fait soixante ans que nous développons les signes officiels de qualité. Combien ont été créés ces cinq ou six dernières années ? Beaucoup moins sans doute qu’au cours des cinq ou six dernières décennies.
Dans le discours que le Président de la République a prononcé à Rungis, il me semble que la qualité était plutôt présentée comme un élément permettant de créer une rémunération supplémentaire. Assumons collectivement d’avoir porté ces signes de qualité, car nous pouvons en être fiers. On le voit bien, pour les fromages par exemple, les installations sont plus nombreuses là où il y a un label de qualité, comme le Comté. Ces labels sont donc un atout pour notre pays, notamment pour nos exportations.
Au-delà de ces divergences, il me semble, comme à vous, que la perte de notre souveraineté alimentaire, que les auteurs du rapport font remonter à la fin des années 1990, est un fait majeur. Nous pouvons en tirer quelques enseignements pour relever les défis auxquels notre agriculture fait face.
Tout d’abord, nous devons comprendre que ce qui a été défait pendant des années ne pourra se reconstruire du jour au lendemain. Il faut donc poser les enjeux et avancer les solutions avec humilité, en assumant aussi la complexité des sujets et en refusant de tomber dans les caricatures – je sais que cette proposition de loi a pu en faire l’objet. Veillons à ne pas caricaturer les positions des uns et des autres, comme l’a bien dit Mme le rapporteur, car nous défendons tous la compétitivité de notre agriculture.
Le second élément est naturellement la question du changement climatique, qui se pose aujourd’hui avec une urgence inédite et qui va forcément constituer un impératif pour penser la façon de rebâtir notre souveraineté alimentaire.
La souveraineté alimentaire sera durable et résiliente ou elle ne sera pas. En effet, notre agriculture ne pourra pas produire en quantité et en qualité suffisante sans une adaptation des systèmes de production pour préserver l’accès aux moyens de production que sont les sols, la biodiversité et les ressources naturelles comme l’eau. La souveraineté alimentaire ne s’oppose pas à la transition écologique, bien au contraire. Nous devons le dire aux agriculteurs.
Cela ne signifie pas que l’on doit pudiquement fermer les yeux sur des problématiques comme celles de la compétitivité ou de la compétitivité-prix de l’agriculture. Au contraire, ces questions existent. Elles sont au cœur de cette proposition de loi et des défis que nous devons relever pour l’avenir de notre agriculture. Elles sont également présentes dans les concertations en cours sur le PLOA, auxquelles j’ai pu assister ou que l’on m’a relatées.
La compétitivité, ce n’est pas un gros mot ! Dire que, depuis trop longtemps, nous croyons en France qu’une norme ou une interdiction produit une solution, ce n’est pas remettre en cause notre ambition environnementale et sociale.
Dire que nous ne pouvons pas agir seuls, avant tous les autres partenaires et concurrents européens, comme si nous étions sur une île, c’est au contraire considérer qu’il y a un lien indissociable entre souveraineté alimentaire, changement climatique et sécurité alimentaire.
Dire que nous avons besoin de transitions, ce n’est pas en rabattre sur les objectifs : c’est se donner une perspective et des moyens pour les atteindre.
Si nous sommes sans cesse en train de produire de nouvelles normes et de nouvelles contraintes pour notre agriculture, dans une sorte de course folle, c’est l’existence même des outils de production agricoles et agroalimentaires dans nos territoires qui sera remise en question, et même, celle de nos agricultrices et agriculteurs. Les auteurs du rapport le disent clairement.
C’est la question de notre capacité à assurer l’accès à une alimentation en quantité et en qualité suffisante, notamment aux plus modestes, qui sera posée.
C’est l’importation, dans nos assiettes, de produits ne respectant pas nos standards environnementaux qui deviendra la norme.
C’est notre vocation exportatrice, qui peut être aussi un élément de stabilité géopolitique, qui sera remise en cause, alors même que la guerre en Ukraine démontre l’importance de la sécurité et de la souveraineté alimentaires.
Tout cela se tient, et la question est celle du chemin à emprunter. Mais il ne peut s’agir en aucun cas d’opposer impératif productif et impératif climatique.
C’est dans cette perspective que se déroule d’ailleurs la concertation sur le PLOA. Nous devons tous, à mon sens, être attentifs à préserver l’esprit des concertations en cours.
Tout d’abord, j’ai voulu qu’elles se fondent sur des constats factuels, et non pas autour d’objets politiques prédéfinis. Je crois que c’est aussi pour cela que les acteurs qui y participent saluent, à ce stade, un exercice plutôt réussi.
J’ai voulu que l’on assure le respect de la diversité des avis, des pratiques, des solutions et des modèles, que les acteurs puissent se projeter à l’horizon 2040 et que nous assumions, ensemble, les objectifs européens et français en matière climatique, environnementale et sociale, tout en assurant notre souveraineté alimentaire.
Telle est sans doute, à ce stade, la réussite principale de cette concertation : faire en sorte que les agriculteurs puissent reparler de ce qu’ils font – c’est un élément important de la reconnaissance que nous leur devons –, mais aussi mettre autour de la table des personnes issues d’horizons différents, pour penser ensemble un chemin.
Comme vous le savez, la concertation se déploie à des échelons différents, et je salue l’implication des régions et des chambres d’agriculture dans ce travail : cette concertation a une dimension nationale, avec les trois groupes de travail, ainsi qu’une dimension régionale, dans les territoires, car les solutions seront très largement différentes selon les contraintes locales. Elle se tient également auprès des jeunes, dans les établissements de l’enseignement agricole, avec une consultation dédiée, ainsi qu’auprès du grand public.
Ce sont des éléments de méthodes précieux, sur lesquels je voulais insister, et je sais que l’initiative du Sénat ne s’inscrit aucunement dans une forme de remise en cause de la concertation en cours, mais plutôt dans la volonté d’ouvrir, avec exigence – comme souvent ici –, un certain nombre de débats sur l’avenir de notre agriculture et notre souveraineté alimentaire.
Le PLOA a sans doute vocation à élargir encore le spectre des sujets dont nous aurons à débattre. Je pense notamment à un certain nombre d’enjeux que nous devons interroger ou réinterroger pour mieux armer notre agriculture face aux grands défis de demain, comme le réchauffement climatique ou le problème foncier.
Comment pouvons-nous massifier les transitions systémiques des exploitations et nous préparer à opérer des transitions de rupture dans des territoires qui en auront besoin ?
Comment imaginer un nouveau cadre de financement de l’agriculture pour couvrir les besoins sans précédent de capitaux liés à la reprise d’au moins un tiers des fermes françaises ? Le texte aborde cette question.
Comment répondre aux besoins d’investissements dans l’appareil productif et la recherche et le développement pour faire face aux transitions ?
Comment améliorer l’attractivité des formations et des métiers, y compris pour celles et ceux qui ne sont pas issus du monde agricole, et permettre une meilleure compréhension par la société et une meilleure connaissance des métiers, des contraintes et des exigences du secteur ?
Comment faciliter, accélérer et systématiser la mobilisation des connaissances produites par la recherche, le développement et l’innovation agricoles français, pour accélérer la diffusion de la connaissance et rendre opérationnelles les solutions et innovations face à l’accélération des situations d’impasses et des impacts à venir du changement climatique ?
Enfin – c’est l’un des sujets également soulevés par cette proposition de loi – comment préserver un cadre équitable et soutenable de financement de la transition de l’agriculture et limiter toute concurrence déloyale en matière environnementale, climatique et sociale ?
Dans ce contexte, au-delà même de la question de la compétitivité, à laquelle elle ne saurait être réduite, cette proposition de loi ouvre des champs de travail utiles et nécessaires, soit parce qu’ils mettent à l’agenda des sujets importants, soit parce qu’ils entrent en résonnance avec l’action que le Gouvernement mène quotidiennement au service de notre agriculture, de nos agriculteurs et de nos agricultrices, soit enfin parce qu’ils font écho à l’ambition que nous portons avec le PLOA.
Comme l’a dit le sénateur Duplomb, n’ayez pas peur !
Sourires.
J’aime bien cette expression. N’ayons pas peur de parler de compétitivité agricole ! N’ayons pas peur de trouver des consensus, même si cela peut paraître révolutionnaire aujourd’hui. Notamment sur ce sujet, n’ayons pas peur de sortir des caricatures, d’affronter les grands défis, en particulier celui de la transition et du climat, et de les rappeler aux agriculteurs.
Enfin, n’ayons pas peur de ce débat qui, pour moi, est très utile, car nous le devons aux agriculteurs. Je tenais à vous en remercier, mesdames, messieurs les sénateurs, avant que nous n’entamions l’examen des articles.
Applaudissements sur les travées des groupes RDPI et RDSE, ainsi que sur des travées des groupes UC et Les Républicains. – M. Serge Mérillou applaudit également.

Je suis saisi, par MM. Salmon, Labbé, Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, d’une motion n° 10.
Cette motion est ainsi rédigée :
En application de l’article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France (n° 590, 2022-2023).
La parole est à M. Daniel Salmon.
Applaudissements sur les travées du groupe GEST.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous le savez, le groupe GEST est viscéralement attaché au débat démocratique. Pourtant, nous avons déposé une question préalable pour rejeter ce texte.
En effet, nous devons prendre conscience de la gravité de cette proposition de loi, qu’il s’agisse de son calendrier de discussion ou du fond des articles qu’elle comporte, composés essentiellement de régressions sociales et environnementales majeures.
Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.

Tout d’abord, sur la forme, la discussion de ce texte intervient alors qu’une concertation est en cours sur ces mêmes questions pour construire un PLOA.
Alors que les syndicats, les associations et les élus des territoires s’impliquent depuis des mois pour faire remonter des propositions, alors que ces travaux sont en train de s’achever, le Sénat estime, en discutant ce texte, qu’il n’est ni utile ni pertinent de patienter quelques semaines pour s’appuyer sur leur contribution.
Dans un contexte où la démocratie est fragilisée et où les citoyens et la société civile se sentent peu écoutés et en décalage avec les instances politiques, il convient pour nous de réfléchir au message envoyé par notre assemblée si elle choisit de rejeter cette motion et de discuter ce texte.

La concertation organisée sur le PLOA est déjà, pour nous, largement insuffisante. La participation des citoyens a été organisée avec des mois de retard, en toute discrétion et via un questionnaire accessible durant quinze jours seulement. Le manque de pluralisme des débats a également été dénoncé.
Toutefois, la qualité et la crédibilité des dispositifs de participation semblent importer peu pour les auteurs de ce texte, pour qui l’essentiel paraît être de verrouiller encore davantage le débat en organisant un premier round avec le Gouvernement pour faire valoir une vision bien particulière de l’agriculture.
Murmures sur les travées du groupe Les Républicains.

Certes, le Sénat et les parlementaires ont toute légitimité pour formuler des propositions dans le cadre des concertations sur l’orientation de notre agriculture. Mais les propositions portées par ce texte figuraient déjà dans un rapport sénatorial, qui semblait bien suffisant pour contribuer aux travaux en cours.
Il est tout aussi problématique que ce texte, présenté comme étant à vocation agricole, propose des modifications substantielles de notre droit du travail, en organisant le cumul de revenus d’activité et du RSA, ainsi que l’orientation active des demandeurs d’emploi vers des secteurs en tension, sans réflexion sur leur parcours ou sur les conditions de travail dans ces secteurs.
Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.

Ces réformes structurantes sont proposées à la veille de discussions sur la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Là encore, nous sommes dans un contretemps démocratique, qui dénote un mépris du dialogue avec la société civile et les partenaires sociaux, et ce dans un contexte extrêmement tendu.
Par cette question préalable, nous proposons de respecter le temps de la démocratie et de la concertation. Notre modèle agricole et notre modèle social sont au cœur de questions majeures pour nos sociétés. Nous pensons qu’ils méritent bien mieux que les quelques heures de débat qui nous sont proposées ce soir.
Au-delà même de ces questions de forme, le fond de cette proposition de loi nous apparaît particulièrement dangereux.
Tout d’abord, nous estimons que ce n’est pas le rôle du Parlement que d’alimenter de fausses informations sur les supposées surtranspositions du droit français.
Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.

Rappelons que, si l’Anses a retiré l’autorisation d’utiliser du S-métolachlore, c’est en application directe d’un règlement européen : ni plus, ni moins.
Rappelons aussi que ses conclusions rejoignent celles de l’autorité européenne de sécurité des aliments (European Food Safety Authority), qui fait état de préoccupations critiques pour cet herbicide, dont l’autorisation de mise sur le marché au niveau européen expire le 31 juillet 2023.
Rappelons enfin qu’un rapport du Gouvernement sur le sujet, paru l’année dernière, estimait que les surtranspositions étaient particulièrement peu nombreuses et que, lorsqu’elles existaient, elles correspondaient à un choix politique assumé.
Murmures sur les travées du groupe Les Républicains.

Doit-on inscrire dans notre droit un renoncement à faire de la France un pionnier en termes de progrès environnemental, social et sanitaire ? Cela nous paraît aller contre le sens de l’Histoire. Alors que les sécheresses et les preuves des impacts des pesticides, ainsi que la pollution de notre ressource en eau, devraient nous pousser à accélérer la transition, on voudrait, par ce texte, nous contraindre à la ralentir.
Pis, on nous propose même de faire marche arrière et de revenir sur les trop rares avancées de ces dernières années. Abandonnée, la séparation des activités de conseil et de vente pour les pesticides, qui visait à garantir aux agriculteurs un conseil indépendant ! Exit, la loi de 2014, qui favorise, en renforçant le rôle de l’Anses, l’indépendance de la décision sur les autorisations de pesticides !
Pire encore, on nous propose même de remettre en cause le droit européen de protection de l’environnement et de faire primer les intérêts économiques de court terme.
Ainsi, sur les pesticides, vous proposez de contraindre les retraits de produits dangereux au regard d’une balance bénéfices-risques entre, d’un côté, la santé et l’environnement et, de l’autre, les distorsions de concurrence.
Cette proposition fait preuve d’un cynisme sans nom §à tel point que l’association Phyto-Victimes, représentant les professionnels malades du fait des pesticides, nous interpellait voilà quelques jours dans un communiqué de presse, avec cette question : « Notre santé a-t-elle un prix ? ».
En plus d’être cynique, cette mesure est une attaque en règle contre le droit européen. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient tout juste de le rappeler : le règlement relatif à l’autorisation des pesticides prévoit que l’objectif de protection de la santé humaine et de l’environnement devrait primer l’objectif de croissance des rendements.
Reconnaissons que vous n’êtes pas les seuls à promouvoir ces attaques, aussi dangereuses soient-elles. Nous avons tous en tête les déclarations visant à regretter l’élimination de certaines molécules, comme si leur interdiction ne procédait pas d’études scientifiques prouvant leur dangerosité. Tant pour les néonicotinoïdes que pour la phosphine ou le glyphosate, il ne s’agit pas de créer de la norme pour la norme ; il s’agit de lutter contre une pollution généralisée et d’enrayer l’effondrement de la biodiversité.
Nous voulons poser une question : le mot d’ordre de la compétitivité-prix porté par les majorités sénatoriale et gouvernementale bénéficie-t-il réellement aux agriculteurs ? C’est là un enjeu crucial de notre débat.
En agitant les chiffons rouges de la surtransposition des normes européennes, des cotisations sociales trop élevées, des normes environnementales trop contraignantes, on oublie de poser dans le débat public les vrais sujets qui menacent notre agriculture.
Ces sujets, vous les connaissez tous. Ce sont la promotion du libre-échange et de la dérégulation des marchés européens, la promotion d’une PAC inégalitaire et inefficace, et celle d’une répartition de la valeur inéquitable dans les négociations commerciales.
Le Ceta (Comprehensive Economic and Trade Agreement), conclu en 2016, n’a toujours pas été soumis au vote du Sénat, dans un déni de démocratie que nous n’oublions pas. De même, de nombreuses inquiétudes persistent, que nous partageons, quant à l’impact de l’accord avec le Mercosur sur les marchés agricoles.
C’est en agissant pour une sortie de l’agriculture du libre-échange, pour la régulation des marchés au niveau européen, pour une PAC juste, qui accompagne les transitions, que nous garantirons un revenu décent à de nombreux agriculteurs.
Nous voulons en effet construire une véritable compétitivité pour notre agriculture. Or la compétitivité-prix, placée au cœur de ce texte, est extrêmement réductrice. Elle néglige tout un pan de coûts qui sont assumés, in fine, par qui ? Par la collectivité, bien sûr !
Que devient l’analyse de la compétitivité de notre agriculture si l’on y inclut les coûts cachés des pesticides, des nitrates et des engrais azotés ? Que devient l’analyse de notre balance commerciale si l’on y inclut les coûts de l’importation massive d’intrants et les subventions publiques visant en définitive à soutenir l’exportation de denrées alimentaires ?
La compétitivité de notre agriculture inclut l’ensemble de ces dimensions, à la fois économiques, sociales, environnementales et sanitaires. Elle prend en compte les emplois générés, la qualité de l’alimentation, la vie des territoires, la réponse aux attentes des consommateurs.
Oui, il nous faut maintenir et développer une production locale, diversifiée, à même de nourrir notre population et d’exporter pour équilibrer notre balance commerciale. Oui, l’augmentation des importations est une véritable problématique.
Mais la solution n’est pas de se lancer dans une course au moins-disant social et environnemental. Elle réside dans l’accompagnement de la relocalisation de l’alimentation et dans la transition vers des pratiques agronomiques permettant de se passer d’intrants, dont les coûts explosent, et de limiter la consommation d’eau et d’énergie, à l’heure où l’efficacité et la sobriété sont des nécessités.
De telles solutions sont pourtant les grandes absentes de ce texte, qui mise sur le renforcement de nos dépendances à la mécanisation, à la robotique, à l’irrigation massive, aux pesticides, le tout à grand renfort de dépenses publiques et d’exonérations de cotisations sociales.
L’agroécologie, notamment l’agriculture biologique, fonctionne déjà sur le terrain. Elle permet de cultiver l’autonomie et la résilience et de produire des excédents.
Certes, il nous faudra garantir l’accès de toutes et tous à cette alimentation locale et de qualité. Nous ne pouvons pas oublier qu’un nombre croissant de nos concitoyens souffrent de précarité alimentaire. Cependant, à nos yeux, la réponse se situe dans une politique ambitieuse de justice sociale pour l’accès à une alimentation de qualité.
À l’heure où les inégalités explosent, cette ambition, plus que jamais nécessaire, est systématiquement négligée par les politiques publiques. Nous devons agir, collectivement, pour construire une véritable sécurité sociale de l’alimentation, comme le soulignait notre collègue Mélanie Vogel dans son rapport sur la sécurité sociale écologique.
Chers collègues, nous vous proposons donc, par le vote de cette motion, de respecter le temps du débat démocratique. Nous vous demandons de refuser un texte qui, en s’appuyant sur un diagnostic erroné, en attaquant le droit européen et en propageant de fausses informations, nous propose une série de régressions sociales et environnementales qui ne seront bénéfiques ni pour nos concitoyens ni pour nos agriculteurs.
Applaudissements sur les travées du groupe GEST, ainsi que sur des travées du groupe SER.

Y a-t-il un orateur contre la motion ?…
Quel est l’avis de la commission ?

Cher collègue, permettez-moi de vous répondre sur plusieurs points.
Tout d’abord, si un pacte et une loi d’orientation et d’avenir agricoles sont bien à l’étude en ce moment, cela n’empêche en rien le Sénat de poursuivre ses travaux. Nous verrons le moment venu ce que le Gouvernement nous proposera comme avenir pour notre agriculture, mais je crois sincèrement qu’il est de l’intérêt du Sénat d’affirmer dès maintenant sa position sur un certain nombre de sujets fondamentaux pour nos agriculteurs : l’excès de normes – nous en avons parlé –, l’excès de taxes ou encore le défi du changement climatique.
Je crois que nous n’avons pas été élus seulement pour attendre que le Gouvernement nous transmette des projets de loi, mais bien pour faire entendre la voix du Sénat. C’est ce que nous faisons ici cet après-midi.
Dès lors, nous sommes légitimes pour débattre d’une proposition de loi qui – vous l’avez d’ailleurs rappelé, cher collègue – est le fruit d’un travail de longue haleine ; ce n’est pas un effet d’opportunité.
Vous citez l’article 7 de la Charte de l’environnement, qui dispose : « Toute personne a le droit […] de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. » C’est ce qui se fait dans le cadre des discussions actuelles. Cependant, cet article n’entend pas, je crois, déposséder le Parlement de ses prérogatives. Il ne me semble pas qu’il y ait une antinomie ici.
Ensuite, vous expliquez que la proposition de loi remet en cause la protection de l’environnement et de la santé. Est-ce remettre en cause la protection de l’environnement que de proposer un diagnostic carbone des exploitations ? Est-ce remettre en cause la protection de l’environnement et de la santé que de proposer une expérimentation de l’utilisation des drones précisément pour diminuer les quantités de pesticides utilisés et protéger les applicateurs de leurs effets indésirables ?
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et INDEP.

Si vous le permettez, je citerai à mon tour la Charte de l’environnement. Son article 6 énonce que les politiques publiques doivent concilier la « protection de l’environnement » avec le « développement économique ». Il me semble que c’est exactement ce que nous faisons. Son article 9 dispose, quant à lui, que la recherche et l’innovation doivent « apporter leur concours » à la préservation de l’environnement. C’est exactement ce que fait cette proposition de loi.
Enfin, vous évoquez la sincérité du débat. Je pense que le débat est sincère. Nous jouons, de part et d’autre, cartes sur table. Nous allons discuter des amendements. Le ministre s’exprimera, la commission s’exprimera, les groupes politiques s’exprimeront, et notre assemblée votera. Il me semble donc qu’il s’agit d’un débat sincère entre nous !
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe UC.
M. Marc Fesneau, ministre. Monsieur le sénateur Salmon, tout d’abord, je m’inquiète un peu, car vous vous faites, à travers cette motion, le gardien vigilant de l’agenda gouvernemental. Vous vous érigez en effet en défenseur du travail gouvernemental. Je le prends comme un moment de grâce, même si je ne suis pas sûr que cela dure. D’ailleurs, la suite de votre propos m’a prouvé que cela ne pouvait pas durer !
Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.
Mais vous avez raison de saluer la façon dont la concertation a été menée pour faire en sorte que nous ayons, avec les professionnels, les collectivités et les responsables agricoles un dialogue qui me paraît fructueux.
Ensuite, vous remettez en cause – de manière un peu paradoxale, mais on peut être à contre-emploi – le fait que nous ayons ouvert un questionnaire. Je vous indique qu’il y a eu 40 000 réponses. Je n’ai d’ailleurs pas prétendu qu’il s’agissait d’un dispositif de participation citoyenne. Même si j’ai été ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne, je n’ai jamais prétendu qu’il s’agissait en l’occurrence d’un exercice de participation citoyenne. J’avais simplement besoin, à travers ce questionnaire, dans un dialogue direct, de sentir un certain nombre de choses, sans prétendre que cela avait une vocation académique. Cela n’empêche pas d’ailleurs que nous travaillons aussi avec les jeunes sur cette question.
Vous avez mille fois raison de dire que la définition de la politique agricole constitue une décision structurante pour notre société. C’est d’ailleurs là-dessus que nous travaillons. Pour autant, cela doit-il empêcher le Sénat de se saisir d’un certain nombre de sujets ? Je ne le crois pas.
Par définition, une loi d’orientation a vocation à embrasser un champ plus large que celui de la compétitivité, qui est le fil rouge de la présente proposition de loi. La mention dans le texte d’une urgence sur un horizon de cinq ans n’est pas incompatible avec la volonté qui est la nôtre de nous projeter sur une période de trente ans ou quarante ans.
En outre, et je tenais à le souligner, il n’y a pas, d’un côté, les défenseurs de l’environnement et de la santé et, de l’autre, les défenseurs de je ne sais quels intérêts. Nous sommes tous défenseurs de l’intérêt général. Il y a sur toutes ces travées, ministre de l’agriculture compris, des gens qui pensent à l’intérêt général ! §Ils ont, eux aussi, des familles, des amis, des préoccupations et des inquiétudes concernant l’environnement. Ne nous drapons pas dans des postures, les uns contre les autres. Dans ce genre de débat, je trouve que cela est, au fond, à la fois caricatural et assez désagréable. Nous aussi, nous défendons à la fois l’agriculture et la nécessité des transitions. C’est en tout cas ce que j’essaie de faire et ce que je crois que vous essayez tous de faire.
On est toujours pris en contradiction avec soi-même. Je vais vous donner un exemple. Vous avez été de ceux qui ont demandé de remettre en cause l’avis de l’Anses sur la grippe aviaire. Vous disiez qu’il n’était pas normal d’imposer ainsi des mesures de confinement beaucoup trop lourdes – alors que c’était la demande de l’Anses – et vous demandiez, dans une logique économique, en lien avec un certain nombre de gens et de syndicats, la sortie du confinement pour les élevages dits autarciques. Cela ne vous posait pas de problèmes ! Ce n’était pas une question !
Il était normal que vous vous interrogiez ainsi sur les difficultés que cette mesure contre la grippe aviaire pouvait entraîner d’un point de vue économique. Mais quand une telle question est soulevée par vous, dans ce sens, elle ne vous pose pas de difficultés. Or je pense que nous parlons ici du même sujet.
Personne ne remet en cause les prérogatives de l’Anses, pas plus ici qu’ailleurs. En revanche, tout le monde peut se dire, comme l’a très bien dit Mme la rapporteure, qu’un équilibre est à trouver, sur certains sujets, entre la dimension économique et les nécessités et contingences environnementales et de santé publique. Or c’est ce que vous nous aviez demandé, par exemple, sur la grippe aviaire.
La phosphine est un sujet que je connais bien pour en avoir débattu publiquement. Nous nous trouvons tout de même dans une situation où des personnes, de l’autre côté de la Méditerranée, attendent nos céréales pour se nourrir. Ce ne sont pas de petits sujets, monsieur Salmon !
M. Daniel Salmon proteste.
Il ne suffit pas de claquer des doigts et de dire qu’il faut interdire ces produits, sans se soucier de ce qui arrive à des populations qui sont soumises à une contrainte de sécurité alimentaire et qui réclament. Donner des leçons me paraît un peu risqué
Mme le rapporteur acquiesce.
Par ailleurs, et au risque de me mettre à dos l’ensemble du Sénat, je voudrais aussi évoquer les accords de libre-échange. Voilà vingt-cinq ans que l’on se félicitait de voir que la France exportait, sur tous les registres. Il ne faut pas avoir peur de l’exportation, l’important est d’être compétitif.
Vous parlez d’accords qui n’existent même pas encore, comme celui avec le Mercosur. Or la compétition ne se noue pas avec des pays extérieurs à l’Union européenne. La perte de compétitivité française date de vingt-cinq ans ou trente ans, et elle s’est faite par rapport à nos voisins européens, par exemple sur les fruits et légumes ou sur la viande bovine.
N’allons donc pas chercher des boucs émissaires à l’extérieur de l’Union européenne ou désigner les accords de libre-échange comme la cause de tous nos maux.
Je souhaite mentionner deux éléments complémentaires. Je ne pense pas vous apprendre grand-chose, mais je crois que l’agriculture biologique aussi aura besoin d’eau.
Caricaturer les agricultures en pensant qu’aucun maraîcher bio n’a manqué d’eau en 2022, …
Nous aurons besoin d’eau. Ne caricaturons pas l’accès à l’eau et le besoin en eau, parce que nous avons envie de voir évoluer l’agriculture. Le maraîcher a besoin d’eau. Nous avons donc besoin de nous poser tranquillement la question de l’accès à l’eau.
Et l’interdiction ne produit pas la solution. Je l’ai vécu de façon un peu compliquée – lorsque vous êtes ministre, vous n’aimez pas avoir à affronter ce type de situation – s’agissant des néonicotinoïdes. J’ai entendu des gens, y compris parmi vos amis politiques, dire sur tous les plateaux de télévision qu’ils avaient une solution. Résultat des courses : j’espère que l’épisode de jaunisse ne viendra pas totalement mettre à mal la filière betterave.
Ce n’est pas parce que l’on ânonne qu’il existe des solutions qu’il en existe vraiment. Ce n’est pas parce que l’on pose une interdiction qu’il y a des solutions.
Nous avons besoin de nous mettre dans la transition, car, le jour où nous n’aurons plus de betterave ni de sucre en France, savons-nous où nous irons les chercher ? Dans l’accord avec le Mercosur, sur lequel vous tapez tant. Ce n’est pas très cohérent. Or nous avons besoin, collectivement, de cohérence.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi que sur des travées d u groupe Les Républicains.

Moi non plus, mais je vous trouve bien vif après seulement dix minutes de débat. Les rôles sont distribués, et le débat va être intéressant.
En cohérence avec le propos que j’ai tenu en commission, et avec celui que je vais tenir tout à l’heure dans le cadre de la discussion générale, nous voterons cette motion tendant à opposer la question préalable. §Nous partageons pleinement les remarques de notre collègue Daniel Salmon. Cette proposition de loi, qui réécrit allégrement notre politique agricole, ne respecte pas, à notre sens, la concertation effectuée dans le cadre de la loi d’orientation et d’avenir agricoles.
De nombreuses mesures du texte auront des conséquences importantes, que ce soit sur les pratiques agricoles, le droit du travail ou l’environnement. Elles auraient mérité, au minimum, une concertation plus large et une association des autres commissions sénatoriales ; je pense notamment à la commission des affaires sociales et à la commission des finances.
Soulignons également les nombreuses incompatibilités du texte avec le droit européen, pourtant souvent brandi – là aussi, nous sommes dans la caricature – comme argument par la majorité sénatoriale pour défaire les textes de l’opposition, qui sont parfaitement listés dans l’exposé des motifs de cette motion tendant à opposer la question préalable.
La présente proposition de loi va donc à contresens, à notre avis, autant dans sa forme que sur le fond. C’est pourquoi cette motion tendant à opposer la question préalable nous paraît pleinement justifiée, et nous la soutiendrons.
Applaudissements sur les travées d u groupe GEST.

Je mets aux voix la motion n° 10, tendant à opposer la question préalable.
Je rappelle que l’adoption de cette motion entraînerait le rejet de la proposition de loi.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 283 :
Le Sénat n’a pas adopté.

M. le président. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Jean-Claude Requier.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE. – MM. Franck Menonville et Pierre Louault applaudissent également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j’interviens ici en lieu et place de mon collègue Henri Cabanel qui a été victime d’un accident de tracteur et ne peut donc pas être présent. L’agriculture est un métier nécessaire, utile, mais aussi dangereux. Nous lui souhaitons un bon rétablissement. J’espère qu’il sera là mardi prochain pour les explications de vote et le vote sur l’ensemble.
Notre modèle agricole arrive à bout de souffle. Ce constat aussi simple que préoccupant doit nous pousser à rechercher et explorer les solutions les plus à même d’inverser la courbe de son déclin, quelles que soient nos convictions.
Nous devons penser l’agriculture de demain autrement qu’à travers le prisme de la critique stérile. Il nous faut réfléchir aux enjeux que sont l’orientation, la transmission, l’installation, la modernisation et la dynamisation de la ferme France, dans un contexte inflationniste et alors que les transitions écologique et climatique bousculent les pratiques agricoles et celles des consommateurs.
Rappelons que la France, aujourd’hui cinquième exportateur mondial, était sur la deuxième marche du podium jusqu’en 2006. Son excédent commercial, en retrait, n’est plus tiré que par l’effet prix de ses exportations, vins et spiritueux en tête, et non par les volumes. Nous étions autrefois le grenier de l’Europe ; nous sommes aujourd’hui réduits à en être, tout au plus, la cave.
Si nos politiques publiques successives se sont démarquées par la défense d’un modèle conciliant performances économique et écologique, elles se sont traduites par la production de produits haut de gamme, peu rémunérateurs pour les agriculteurs, à destination d’une clientèle de niche à fort pouvoir d’achat. Et les consommateurs les plus modestes ont été contraints de se tourner vers des denrées importées, produites dans des conditions environnementales et sociales non satisfaisantes ou peu transparentes.
Je rappelle que lorsqu’un Français dépense 100 euros en alimentation, seulement 6, 90 euros vont dans la poche du producteur. Le partage de la valeur devrait être essentiel et dicter nos actions dans les relations commerciales entre le monde agricole, les industries agroalimentaires et la grande distribution. Or, ces dix dernières années, nous avons emprunté le chemin inverse et détruit cette valeur sous couvert de la recherche du prix le plus bas. À ce jeu-là, je rappelle que ce ne sont ni les producteurs ni les consommateurs qui ressortent gagnants, mais les intermédiaires.
Alors que nous faisons face au défi du renouvellement des générations, notre modèle agricole n’attirera pas plus de jeunes et nouveaux exploitants si nous continuons de ne pas rémunérer les professionnels du secteur à leur juste valeur, d’étouffer l’innovation et de nous enfermer dans un carcan de normes soumis notamment à de multiples surtranspositions.
Néanmoins, il est fondamental que nous avancions selon un triptyque indissociable unissant l’économie, la santé et l’environnement, aucun de ces éléments ne pouvant être sacrifié au profit de l’un ou de l’autre.
Si la compétitivité de la ferme France est handicapée par des normes élevées, en matière environnementale et sanitaire notamment, il ne faut pas, au nom d’une productivité renouvelée, abandonner nos acquis, qui font du modèle agricole français le plus vertueux du monde. Pour autant, tout est une question d’équilibre.
À cet égard, soyons attentifs aux accords de libre-échange fragilisant notre agriculture. Je rappelle que le groupe RDSE a présenté au Sénat une proposition de résolution dénonçant l’accord de libre-échange avec le Mercosur, qui contenait les germes d’une déstabilisation du marché européen de viande bovine et, par ricochet, d’une fragilisation des territoires ruraux.
En attendant, aujourd’hui encore, nous devons trouver des rustines, car la grande loi d’orientation agricole n’est pas encore au rendez-vous, monsieur le ministre.
Le texte d’aujourd’hui a le mérite d’enrichir le débat sur le choc de compétitivité en faveur de la ferme France. Le groupe RDSE souhaiterait améliorer certaines des dispositions envisagées.
Nous aimerions notamment que la proposition de loi contienne des mesures traitant d’une transition globale et systématique des exploitations agricoles, dans laquelle l’atténuation et l’adaptation au changement climatique seront le fil conducteur des nouvelles démarches agricoles.
En ce sens, nous proposerons, en premier lieu, la réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité de l’exploitation agricole et d’un plan de transformation de cette dernière et, en deuxième lieu, la réalisation d’un diagnostic de réduction de l’impact carbone et de performance agronomique des sols incluant les réductions d’émissions de gaz à effet de serre telles que définies dans le cadre du label bas-carbone. Nous souhaitons également que les paiements pour services environnementaux se démocratisent au sein des exploitations agricoles afin de faire de la restauration et du maintien des écosystèmes une source supplémentaire de revenus, et non pas une contrainte supplémentaire.
Je rappelle que le groupe RDSE s’est toujours positionné dans le débat pour une agriculture durable, innovante et rémunératrice, car soucieuse d’une meilleure reconnaissance de ses exploitants.
Dans cette perspective, le groupe sera attentif à l’examen de chacun des articles du texte, mais émet préalablement un avis globalement favorable sur cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE. – M. Daniel Chasseing applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d’abord saluer Laurent Duplomb, Pierre Louault et Serge Mérillou, qui nous permettent tous les trois d’apporter notre pierre à cette discussion tellement ambitieuse qu’est une loi d’orientation, quand nous savons que l’agriculture française fonctionne encore globalement sur les fondements de lois d’orientation des années 1960.
Mon propos n’est pas de dire que ces lois ne sont plus d’actualité. Il est de dire que le monde a changé et qu’il y a des attentes nouvelles auxquelles il est essentiel d’apporter une contribution. La présente proposition de loi y participe. Je voudrais remercier notre rapporteur de son travail, qui vient compléter celui des trois dépositaires et autres cosignataires du texte.
Je voudrais prendre quelques exemples concrets. Je commencerai par l’article 2, dont l’objet est, tout simplement, de donner des perspectives, tous les cinq ans. C’est ce dont souffre la France depuis de nombreuses années : le manque de feuilles de route et de perspectives. Monsieur le ministre, je partage votre propos : une loi d’orientation s’inscrit dans le long terme, et nécessite d’introduire des rendez-vous, filière par filière. Fixer ainsi des rendez-vous tous les cinq ans sur la compétitivité et le positionnement de la ferme France est essentiel.
L’autre exemple que je voudrais prendre est celui de l’article 4. Je le dis d’autant plus que j’avais été rapporteur en 2015 de la proposition de loi de Jean-Claude Lenoir en faveur de la compétitivité de l’agriculture et de la filière agroalimentaire. Nous avions déjà, en 2015, ici, au Sénat, évoqué l’idée d’un livret d’épargne populaire.
L’agriculture n’est pas seulement l’affaire des paysans. L’article 4 de la proposition de loi a pour objet d’appliquer à l’agriculture ce que nous sommes en train de réussir à faire pour la forêt. Des reboisements s’effectuent en effet à la faveur de moyens mobilisés par des particuliers, conjointement aux collectivités et à l’État. Là, c’est la même chose ! L’idée est de faire participer les Françaises et les Français aux choix stratégiques de leur alimentation. Cela me paraît très important : rendre les Françaises et les Français acteurs de la politique agroalimentaire de notre pays.
L’article 6 marque un rendez-vous important, monsieur le ministre. Nous avons réformé récemment le principe des calamités agricoles auquel nous avons substitué un dispositif assurantiel. Or le secteur assurantiel accorde une place plus importante que par le passé à la contribution des agriculteurs à la gestion du risque.
Si l’on veut réussir le dossier des calamités agricoles, si l’on veut réussir à bien suivre les aléas qui font qu’en agriculture les années ne se ressemblent pas, il est absolument stratégique de modifier le plafond de la déduction pour l’épargne de précaution. C’est une nécessité si l’on veut réussir la démarche que vous avez lancée et à laquelle le Sénat a contribué concernant la réforme de la gestion des risques.
L’article 10 nous fait vraiment plaisir, car nous avions déjà évoqué la question de l’information des consommateurs en 2015. Monsieur le ministre, la France interdit aux paysans français de faire des cultures d’organismes génétiquement modifiés (OGM). L’Europe l’interdit également. Or, tous les jours, les consommateurs français et européens mangent des OGM. Une honnêteté et une transparence de l’étiquetage sont nécessaires pour l’information des consommateurs. L’article 10 du texte repositionne notre responsabilité par rapport à la production et à la consommation.
J’en viens aux articles 19 et 20, que j’avais évoqués en commission. Je suis choqué par les propos qui ont été tenus tout à l’heure. L’agriculture peut au contraire être une forme de solution pour celles et ceux qui sont au bord du marché de l’emploi. Nous en avons besoin. Ces personnes peuvent retrouver des perspectives, l’étincelle dans le cœur qui leur donne envie de se relancer dans la vie professionnelle.

Nous savons tous que les fils et filles d’agriculteurs ne sont pas capables de reprendre l’ensemble des fermes qui se libèrent. Nous avons plus que jamais besoin d’ouvrir le monde agricole. Si nous voulons réussir notre indépendance alimentaire, nous avons plus que jamais besoin de permettre à des femmes et des hommes de se lancer dans l’agriculture : soit par le biais du salariat, soit – pourquoi pas, monsieur le ministre ? – par le biais de la transmission et de l’installation des jeunes. J’avais défendu cette idée lorsque je faisais partie des Jeunes agriculteurs.
Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains soutient cette proposition de loi et votera en sa faveur. Nous avons besoin de fixer un cap, et de donner envie. Notre avis sur ce texte est donc favorable.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et INDEP.
Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme l’a dit Christiane Lambert, ancienne présidente de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), lors du dernier salon de l’agriculture, notre agriculture dévisse.
En effet, depuis dix ans, notre balance commerciale ne cesse de se dégrader. Nous sommes l’un des seuls grands pays agricoles à voir ses parts de marché reculer depuis 2000. Nos capacités productives s’effritent. Certaines filières s’affaiblissent dangereusement.
Notre solde commercial a chuté, passant de 12 milliards d’euros en 2011 à 8 milliards d’euros en 2021. En matière d’exportations, nous sommes passés en vingt ans de la deuxième place à la cinquième place, alors que nos importations explosent : nous importons 2, 2 fois plus qu’en 2000. Près de 50 % de ce que nous consommons aujourd’hui est issu des importations, principalement intra-européennes.
La compétitivité de notre agriculture décline dangereusement. Il était urgent de réagir ; c’est toute l’ambition de ce texte, que notre groupe soutient pleinement.
Cette proposition de loi vise à réduire les contraintes qui pèsent sur notre agriculture et nos agriculteurs, à encourager l’innovation et à accompagner les transitions.
En effet, depuis vingt ans, nous privilégions les injonctions sociétales et environnementales sans intégrer la dimension de la compétitivité et de la performance. C’est une erreur de vouloir opposer investissement, innovation, santé publique et performance. Il faut, au contraire, combiner ces objectifs.
Cette proposition de loi est dense et technique. Je veux à cet égard saluer le travail de ses auteurs et de notre rapporteure Sophie Primas, qui a su l’enrichir et la compléter.
Je voudrais maintenant m’attarder sur plusieurs mécanismes du texte.
L’article 13 complète les missions de l’Anses, qui sera chargée d’établir, dans ses avis, une balance des bénéfices et des risques. Or, de fait, cette agence n’a, à ce stade, ni les moyens ni les compétences nécessaires pour exercer cette nouvelle mission. C’est pourquoi, comme Mme la rapporteure, j’ai déposé en commission un amendement tendant à octroyer au ministre de l’agriculture un droit de veto en la matière, amendement qui a été adopté. Cela permettra de suspendre une décision de l’Anses si la souveraineté alimentaire est en péril ou si aucune solution alternative n’est possible. Nous devons tirer les leçons de nos erreurs et éviter de répéter des précédents qui ont lourdement fragilisé des filières entières.
L’article 9 est un autre des points majeurs du texte. Le stockage du carbone est un enjeu essentiel. L’agriculture que nous bâtissons doit être porteuse de solutions permettant de lutter contre le réchauffement climatique ; le stockage du carbone en est une.
L’article 12 vise, quant à lui, à lutter contre les surtranspositions de normes européennes, en fixant un principe de non-surtransposition. Le Conseil d’État sera chargé d’identifier dans ses avis les surtranspositions, qui sont souvent source de distorsions de concurrence et fragilisent nos filières. Elles contribuent également à réduire l’attrait du métier et à exaspérer nos agriculteurs, qui croulent sous les injonctions contradictoires et sous des directives mal comprises et souvent déconnectées des réalités quotidiennes de leur métier. Il faut absolument redonner du sens !
Enfin, l’investissement est crucial. À ce titre, deux dispositifs sont proposés : le crédit d’impôt et le livret Agri. Il est impératif de soutenir l’investissement dans nos outils de transformation et, plus généralement, dans le secteur agroalimentaire pour restaurer notre force exportatrice et maintenir notre puissance agricole.
Nous devons à tout prix allier performance, innovation et durabilité des produits. Aucun de ces objectifs n’est à sacrifier ; il faut au contraire les combiner. Telle doit être l’agriculture d’aujourd’hui et de demain. La productivité n’est pas incompatible avec les objectifs environnementaux !
Faute de temps, je ne pourrai pas m’attarder sur la séparation du conseil et de la vente, séparation sur laquelle le texte revient. C’est une mesure que j’ai toujours jugée contre-productive et source de complexité et de désorganisation. Il est préférable, à mon sens, de renforcer l’exigence et la qualité du conseil pour nos agriculteurs.
Pour conclure, monsieur le ministre, je formule le vœu que ce travail transpartisan, qui vient à point nommé, devienne un élément constitutif de votre futur projet de loi d’orientation et d’avenir agricoles, dont nous soutenons l’initiative.
Laurent Duplomb l’a bien dit : n’ayons pas peur !
Applaudissements sur les travées du groupe INDEP, ainsi que sur des travées des groupes UC et Les Républicains.

M. le président. Mes chers collègues, je suis heureux de saluer la présence, dans notre tribune d’honneur, d’une délégation de l’Assemblée de la République portugaise, conduite par son président, M. Augusto Santos Silva, et composée de membres du groupe d’amitié Portugal-France, présidé par Mme Emilia Cerqueira.
Mmes et MM. les sénateurs, ainsi que M. le ministre se lèvent.

La délégation, qui vient de s’entretenir avec le président du Sénat, est accompagnée par notre collègue Louis-Jean de Nicolaÿ, président du groupe d’amitié France-Portugal du Sénat.
La mission de nos homologues portugais porte en particulier sur nos relations économiques, culturelles et scientifiques. Elle fait suite à l’accueil, à Lisbonne, la semaine dernière, d’une délégation du groupe d’amitié France-Portugal.
La France et le Portugal, qui entretiennent des relations historiques étroites et denses, se sont encore rapprochés au sein de l’Union européenne.
Quelques mois après la clôture de la saison culturelle portugaise en France, et un an avant la commémoration du cinquantenaire de la Révolution des œillets, qui a rétabli la démocratie au Portugal, nous espérons que votre visite a pu contribuer à consolider encore nos liens parlementaires.
En votre nom à tous, mes chers collègues, permettez-moi d’adresser un salut solennel et amical à la délégation conduite par le président de l’Assemblée de la République du Portugal !
Mmes et MM. les sénateurs, ainsi que M. le ministre applaudissent longuement.

Nous reprenons la discussion de la proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France, présentée par MM. Laurent Duplomb, Pierre Louault, Serge Mérillou et plusieurs de leurs collègues.

M. le président. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Joël Labbé.
Applaudissements sur les travées du groupe GEST. – M. Joël Bigot applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voilà donc amenés, quelques mois avant les débats sur le projet de loi d’orientation et d’avenir agricoles, à discuter d’une pré-loi d’orientation, ou de la version qu’en a rédigée la majorité sénatoriale.
C’est bien de cela qu’il s’agit : le texte qui nous est soumis exprime des orientations claires pour notre agriculture. Pour notre part, nous ne pensons pas que ces orientations freineront la chute du nombre de paysans, limiteront l’endettement des agriculteurs ou empêcheront l’effondrement de la biodiversité, la pollution de l’eau et l’épuisement des sols. C’est à nos yeux une fuite en avant !
Je voudrais insister à cette tribune sur quelques reculs majeurs contenus dans le texte.
Son article 1er subordonne l’ensemble des politiques publiques agricoles à la compétitivité-prix, sacrifiant de fait les enjeux sociaux, environnementaux et sanitaires.
À l’article 8, on autorise largement l’épandage de pesticides par drone, sans prendre en compte les risques de dérives relevés par l’Anses.

Nous dénonçons les reculs sur les trop rares avancées de la loi Égalim. Nous voterons donc contre l’article 11, qui revient en arrière sur la qualité alimentaire en restauration collective. Il avait été décidé dans cette loi qu’y seraient proposés au moins 20 % de produits bio et 50 % de produits durables et locaux. Aujourd’hui, on est pourtant loin du compte. On se devrait donc, dans un tel texte – il le faudra bien en tout cas dans le prochain projet de loi d’orientation, qui doit être un projet d’avenir –, de soutenir cette approche avec force, ce qui suppose de donner des moyens aux territoires.
Nous sommes aussi particulièrement atterrés par l’article 12, qui subordonne la possibilité de mieux protéger l’environnement et la santé à l’absence de distorsion de concurrence européenne.
Nous dénonçons également l’article 13, qui soumet les retraits de pesticides jugés dangereux à une balance bénéfices-risques axée sur l’économie et remet en cause le rôle et l’indépendance de l’Anses, …

… indépendance reconnue depuis 2014.
Encore une fois, il s’agit d’acter, non sans cynisme, la supériorité des intérêts économiques de court terme, et de compliquer, voire d’entraver tout progrès dans la protection de nos concitoyens et de l’environnement.

Les mesures sur l’eau sont tout aussi problématiques, notamment l’article 15, qui promeut le stockage et l’irrigation sans aucune réflexion sur leur encadrement à l’heure du réchauffement climatique.
Nous avons aussi à redire sur le volet social du texte, que nous jugeons plutôt antisocial. Rappelons que les cotisations sont non pas des charges, mais des outils de protection sociale !
Nous serons particulièrement attentifs, sur tous ces points, à la position que prendra le Gouvernement. Nous souhaitons que le processus de concertation en cours ne soit pas entravé.
Dans quelque temps, ce type de débat me manquera. À chaque fois, j’ai voulu dire tout ce qui me tenait à cœur, non pas avec des bannières ou quoi que ce soit d’autre, mais avec des convictions !

Oui, comme vous, mon cher collègue. Alors, allons-y !
Le rapport publié en 2013 par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) sur les effets des pesticides sur la santé humaine m’avait frappé. Qu’en est-il sorti ? On a reconnu la maladie de Parkinson et le cancer de la prostate comme maladies professionnelles chez les agriculteurs.
Le rapport de la Cour des comptes sur le soutien à l’agriculture biologique a, quant à lui, relevé que celle-ci est très insuffisamment aidée. Enfin, le rapport de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae), Agriculture européenne sans pesticides chimiques en 2050, montre que des politiques cohérentes et articulées permettraient de sortir de l’usage de ces molécules chimiques.
Ce matin encore, un article du journal Le Monde nous alertait, sans rien inventer, sur la chute des populations d’oiseaux : elle atteint 60 % en quarante ans sur le continent européen. C’est dire s’il y a vraiment des soucis !
À l’occasion de ce qui est très probablement – je suis prudent ! – ma dernière intervention dans une discussion générale, je dois vous exprimer mon dépit et mes regrets sur tous ces sujets.
Monsieur le ministre, vous avez argué tout à l’heure que l’agriculture biologique utilise, elle aussi, de l’eau… Encore heureux ! Mais c’est une question de quantité. L’agriculture biologique n’est pas industrielle ; j’insiste sur ce point. Je tiens à la défendre comme une véritable agriculture d’avenir. Or, dans ce texte, il n’y a pas un mot, pas une seule pensée pour l’agriculture biologique ! §On nous dira qu’il faut arrêter d’opposer les agriculteurs…

Mais heureusement qu’il y a encore des gens qui la défendent ! (Applaudissements sur les travées du groupe GEST, ainsi que sur des travées du groupe SER. – M. Fabien Gay applaudit également.)
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui est largement issue des recommandations du rapport d’information de la commission des affaires économiques sur la compétitivité de la ferme France.
Les discussions que nous avons eues autour des conclusions de ce rapport nous ont permis de cheminer et de convenir, en commission, qu’il ne fallait ni opposer des modèles les uns aux autres ni condamner en bloc la stratégie de montée en gamme.
Si la compétitivité de notre modèle agricole ne peut pas reposer uniquement sur le haut de gamme, ne miser que sur les volumes sans tenir compte des externalités négatives que cette approche comporte ferait passer notre agriculture à côté des grands enjeux qui s’imposent non seulement à elle, mais aussi à toutes celles de la planète.
En plus d’assurer la souveraineté alimentaire, notre agriculture doit répondre à une exigence croissante de qualité et s’orienter vers des pratiques plus durables, respectueuses de l’environnement et du climat.
Face à la concurrence internationale croissante, de nombreux producteurs français ont ainsi fait le choix du bio ou d’une activité sous signe de qualité, synonyme de valeur ajoutée, de prix plus rémunérateurs et de conquêtes de nouveaux marchés.
La France fait ainsi, en Europe, figure de leader en matière de bio. Lorsque nous réussissons, soyons-en fiers, persévérons et maximisons notre avantage comparatif !
Les évolutions des pratiques et des exigences sociétales sont partagées par de jeunes agriculteurs, déjà installés ou en devenir, qui souhaitent être acteurs de la transition. Leur réussite sera la nôtre, car, d’ici à dix ans, un tiers des agriculteurs seront en âge de partir à la retraite.
Le renouvellement des générations est donc une priorité ; c’est même le principal défi de notre agriculture, car sans agriculteurs, il n’y aura pas de ferme France.
Le dérèglement climatique et les évolutions démographiques nous imposent d’évoluer en profondeur, de nous adapter et d’anticiper.
C’est pourquoi, depuis six ans, nous sommes aux côtés du Gouvernement pour que les transitions nécessaires s’engagent rapidement, de manière pragmatique et efficace. Les concertations nationales et locales pour le pacte et la loi d’orientation et d’avenir agricoles préfigurent un débat riche pour notre agriculture et une loi structurante pour son avenir.
Aujourd’hui, c’est de la compétitivité de notre agriculture que nous débattons : lutter contre la concurrence déloyale, rééquilibrer la fiscalité agricole, favoriser l’innovation et les investissements… Tout cela, nous y souscrivons.
Cependant, en examinant le texte qui nous est soumis, nous notons que, si nous partageons de tels objectifs, nous avons en revanche des réserves sur certaines mesures qui semblent parfois en contradiction avec ceux-ci.
Ainsi, alors que la bureaucratie et la surabondance des normes sont des freins à la compétitivité de notre agriculture, la mise en place d’un haut-commissaire à la compétitivité et d’un plan quinquennal de compétitivité peut étonner.
Il faut toutefois reconnaître et saluer la qualité du travail fourni par Mme la rapporteure, car certaines modifications apportées au texte en commission constituent des évolutions positives.
Je tiens en particulier à insister sur celles apportées à l’article 8, ainsi que sur l’expérimentation de la pulvérisation par aéronefs téléguidés. Tout en tenant compte des observations de l’Anses, on lève ainsi les freins à l’innovation qui entravaient le développement de toute une filière. Le recours à des drones permettra en effet de réduire significativement l’utilisation de produits phytosanitaires.
Le groupe RDPI a cependant déposé deux amendements visant à supprimer des mesures qui feront, sans aucun doute, l’objet de nouvelles discussions lors de l’examen du projet de loi d’orientation et d’avenir agricoles : d’une part, à l’article 15, la présomption d’intérêt général majeur des ouvrages visant à prélever et stocker l’eau à des fins agricoles ; d’autre part, à l’article 18, l’abrogation de deux avancées significatives de la loi Égalim : la séparation de la vente et du conseil et l’interdiction des remises, rabais et ristournes sur les produits phytopharmaceutiques.
L’article 15 porte sur un sujet sensible qui fait débat dans l’ensemble de la société. La solution préconisée, en plus de susciter des crispations, affaiblirait la concertation locale que l’article 16 vise pourtant à renforcer au sein des projets territoriaux de gestion de l’eau (PTGE).
Le revirement opéré à l’article 18, quant à lui, nécessiterait que l’on prenne le temps d’en évaluer l’impact en termes de recours aux produits phytopharmaceutiques.
Enfin, les mesures proposées de maîtrise des charges sociales et des charges de production, si elles nous paraissent pertinentes, semblent davantage relever du projet de loi sur le travail que nous examinerons cet été ou du projet de loi de finances.
Mes chers collègues, le chemin parcouru depuis la parution du rapport d’information qui a inspiré ce texte semble préfigurer de potentiels consensus sur le projet de loi d’orientation agricole ; il est important de le souligner sans masquer les désaccords qui subsistent.
Pour ces raisons, et sous réserve des débats que nous aurons sur ce texte, les membres du groupe RDPI auront pleine liberté de vote.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – Mme le rapporteur applaudit également.
M. Joël Bigot applaudit.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous y voilà : alors que les concertations sur le projet de loi d’orientation et d’avenir agricoles viennent à peine de se conclure, la majorité sénatoriale nous propose, avec ce texte, un premier round pour définir notre future politique agricole.
Nous commençons à être habitués à ce jeu politique entre la droite sénatoriale et le Gouvernement, un jeu où les propositions de loi sénatoriales servent à influencer les futurs projets de loi, avec un terrain d’entente : toujours plus à droite, toujours plus libéral !
Mme Nicole Bonnefoy applaudit.

Nous aurions pu espérer que l’agriculture, qui est au cœur de l’histoire de notre pays, échappe à ces nouveaux calculs politiques et à cette volonté incontrôlée de tout déréglementer, de tout déconstruire dans des logiques purement économiques.
La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui s’inscrit pourtant dans cette trajectoire.
Vous l’aurez compris par cette courte introduction, mes chers collègues, mon groupe s’opposera avec vigueur à la très grande majorité des dispositions du texte.
Avant de revenir de manière plus détaillée sur les principaux aspects qui justifient notre opposition, je souhaite aborder le débat idéologique, voire philosophique, qui sous-tend le rapport qui a inspiré ce texte, débat qui justifie notre opposition. Je veux parler de la fameuse opposition entre modèles agricoles, mon cher collègue Laurent Duplomb…

Nous ne pouvons pas nier qu’il existe – cette proposition de loi le prouve une nouvelle fois – deux visions de l’agriculture, avec leurs spécificités et leurs valeurs.
Toutefois, mes chers collègues – je pense que mon expérience, ayant exercé le métier d’agriculteur, me permet de le dire –, les différences entre ces deux visions ne peuvent pas se résumer à la simple opposition entre un « bon modèle », fondé sur la raison, qui servirait à nourrir les hommes, et un « modèle de l’utopie » défendu par les écologistes, bobos et autres décroissants… Non, mes chers collègues, ces deux modèles ont une même vocation : nourrir les hommes ! Et tous deux, s’ils sont adaptés à leur territoire, peuvent être compétitifs et pérennes.
Mais la principale différence entre ces deux visions est que le modèle de l’agroécologie et de l’agriculture biologique a élargi son approche, en essayant d’aboutir à un système qui respecte autant le producteur que l’environnement.
Et je pense très sincèrement, monsieur le ministre, que c’est le rôle des pouvoirs publics et du législateur d’apporter un soutien de long terme à un modèle qui tente d’allier santé humaine et préservation de l’environnement.
Mme Nicole Bonnefoy applaudit.

Pour en revenir à la question de la compétitivité, France Stratégie, institution autonome placée auprès de la Première ministre, a publié en 2020 une étude sur la rentabilité des exploitations agricoles en fonction de leur modèle.
Après de nombreuses études de terrain, les deux auteurs de ce rapport en sont venus à la conclusion suivante : « Les exploitations agroécologiques présentent en général des résultats économiques à moyen terme supérieurs à ceux d’exploitations conventionnelles. »
Mes chers collègues, il me semble donc totalement aberrant de considérer que l’agriculture française souffrirait actuellement des choix faits en 2014, lors de l’ouverture à ce nouveau modèle.
Pour revenir sur les divergences de fond, je souhaiterais à présent aborder l’ensemble des articles fiscaux de cette proposition de loi.
En effet, pour les auteurs du texte, la question de la compétitivité semble se résumer à deux termes : crédit d’impôt et exonération.
Au sein de mon groupe, comme nous l’exprimons lors de l’examen de chaque projet de loi de finances, nous croyons à un impôt qui soit juste et redistributeur, portant uniquement sur les personnes qui peuvent le payer.
Toutefois, nous n’avons pas de difficulté à aborder la potentielle question du « trop d’impôt », de celui qui peut mettre en difficulté des concitoyens ou des entreprises.
Cela dit, il me semble quand même qu’il y a un problème dans les dispositions fiscales que vous proposez : elles ne semblent conçues que pour les plus favorisés, pour ceux qui réalisent déjà des bénéfices importants, et elles n’aideront aucunement les agriculteurs en difficulté.

Il me semble, sauf erreur de ma part, que proposer une augmentation du plafond pluriannuel de la déduction pour épargne de précaution (DEP), pour le fixer à 200 000 euros, avec une déduction maximale par exercice amenée à près de 60 000 euros, c’est surtout proposer une disposition pour les exploitants agricoles qui ont la chance de faire des bénéfices et de pouvoir mettre des sommes importantes de côté.
À cela, on peut ajouter le crédit d’impôt pour la mécanisation figurant à l’article 5, que Mme la rapporteure a heureusement plafonné à 20 000 euros – nous avons déposé un amendement tendant à descendre encore ce plafond, mais il a reçu de la commission un avis défavorable ; c’est dommage ! –, la création d’une déduction fiscale pour favoriser la contractualisation, à l’article 7 ou encore l’augmentation des seuils d’exonération de l’impôt sur le revenu agricole prévue à l’article 24.
Alors que nous devrions réfléchir à des aides pour les agriculteurs les plus en difficulté, cette volonté de permettre aux plus favorisés de contourner l’impôt est inquiétante pour notre pacte républicain.
Je souhaite faire part de mon profond étonnement quant à la teneur de l’ensemble des articles qui réécrivent allégrement le droit du travail.
Alors que ce texte est centré sur la question agricole, ses auteurs ont choisi d’introduire la notion de « secteurs prioritaires en tension » au sein des missions de Pôle emploi, ou encore de créer une exonération inédite, au sein du dispositif dit de bonus-malus, pour les contrats courts.
Monsieur le ministre, il serait peut-être pertinent que votre collègue Olivier Dussopt, ministre du travail, soit présent à vos côtés pour nous présenter la position du Gouvernement sur l’ensemble de ces points, d’autant que les mesures proposées sont loin d’être anodines et mériteraient a minima une étude d’impact.
Il me semble quand même important de rappeler que ce secteur bénéficie déjà d’un dispositif particulier, que je soutiens dans chaque projet de loi de finances, à savoir le dispositif travailleurs occasionnels-demandeurs d’emploi, qui offre une exonération de cotisations aux employeurs du secteur agricole.

En cohérence avec nos positions antérieures, nous soutiendrons cette pérennisation.
C’est la raison pour laquelle, au sein de mon groupe, nous sommes profondément surpris par la philosophie des articles 19 et 20 : l’idée latente d’envoyer les personnes éloignées de l’emploi « aux champs » relève d’une vision bien particulière du travail !
C’est d’autant plus étrange que ces propositions ignorent les conditions de travail déjà difficiles rencontrées par de nombreux saisonniers, mais aussi les difficultés qu’ont les exploitants agricoles à offrir des locaux adaptés pour recevoir convenablement une telle main-d’œuvre.
Pour ces raisons, nous nous opposerons à l’ensemble des articles qui reviennent sur les droits des travailleurs.
Enfin, et il s’agit certainement du point le plus inquiétant de cette proposition de loi, de nombreux articles prévoient des retours en arrière inconcevables sur les enjeux environnementaux.
Alors même que le président du Sénat vient de mettre en demeure l’un des principaux lobbies des pesticides, Phyteis, pour avoir fourni des informations erronées aux parlementaires, vous faites le choix, mes chers collègues, de rouvrir la porte à un certain nombre de pratiques et de revenir sur des acquis pourtant difficilement obtenus.
Avec la réautorisation de l’épandage aérien des produits phytopharmaceutiques, …

… on revient de manière incompréhensible sur les conclusions du rapport d’information Pesticides : vers le risque zéro, rédigé par notre collègue Nicole Bonnefoy et adopté à l’unanimité !
La réautorisation des promotions sur les pesticides et la suppression de la séparation du conseil et de la vente pour ces mêmes produits représentent également un retour en arrière sur une disposition acquise ici même, avec difficulté, lors de l’examen de la loi Égalim.
Je rappelle simplement qu’en 2018 les rapporteurs de ce texte, Anne-Catherine Loisier et notre ancien collègue Michel Raison, avaient défendu le maintien de la séparation du conseil et de la vente prévu dans le texte gouvernemental. Cinq ans plus tard seulement, vous faites le choix de les déjuger et de revenir sur ce maigre acquis.

L’article 13 de cette proposition de loi est certainement le plus problématique.
Alors que l’Anses est une agence d’expertise scientifique et indépendante, vous choisissez de lui donner un rôle politique, en incluant dans ses missions la réalisation d’« une balance détaillée des bénéfices et des risques sanitaires, environnementaux et économiques de la décision envisagée ».
Et de surcroît, madame la rapporteure, vous avez décidé de donner au ministre de l’agriculture la possibilité de suspendre certaines décisions de l’Anses, et même de prendre une décision relative à une autorisation de mise sur le marché.

M. Jean-Claude Tissot. Très sincèrement, mes chers collègues, comment pouvez-vous avoir une telle vision de cette agence indépendante, indispensable pour évaluer scientifiquement un produit phytosanitaire ? Comment pouvez-vous, en tant que parlementaires, souhaiter concentrer autant de pouvoirs dans les mains du ministre ?
Mme Nicole Bonnefoy applaudit. – Protestations au banc des commissions.

J’aurais aussi pu évoquer les délais de grâce pour les pesticides interdits, mais nous aurons l’occasion d’y revenir au cours des débats.
Enfin, concernant l’eau, la majorité sénatoriale fait le choix de jeter de l’huile sur le feu, en créant un motif d’intérêt général majeur dont absolument personne n’est capable de nous donner de définition précise, et en réduisant les contentieux, dans une triste vision du rôle joué par la justice.
Mes chers collègues, vous l’aurez compris, au sein du groupe socialiste du Sénat, nous nous opposerons fermement à cette proposition de loi, …

… et nous proposerons logiquement la suppression d’une grande partie de ses articles.
Ce premier round est donc particulièrement peu engageant. Mais nous saurons défendre un autre modèle agricole, compétitif, pérenne et respectueux de l’agriculteur, du consommateur et de l’environnement !
Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST. – M. Pascal Savoldelli applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE. – M. Joël Bigot applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, s’il y a bien une conviction que notre groupe partage avec les auteurs de ce texte, c’est celle que notre modèle agricole doit être transformé en profondeur. Pour le reste, nous ne partageons ni la vision de l’agriculture développée dans cette proposition de loi ni les solutions qui y sont mises en avant. Ce sont donc bien deux visions qui s’opposent.
Aborder le sujet de l’agriculture, c’est se plonger dans un système complexe, placé au cœur de l’économie mondialisée, et qui mêle plusieurs questions essentielles : celle, d’abord, des ressources naturelles, de l’eau, de l’air, de la Terre, qui nous nourrit et dont nous devons prendre soin, car nous n’en avons qu’une ; celle, également centrale, du travail et de la rémunération des femmes et des hommes qui nous permettent de nous nourrir et qui éprouvent chaque jour les conséquences d’un changement climatique qui s’accélère ; celle, enfin, du droit à une alimentation saine et de qualité pour toutes et tous.
L’enjeu est de taille. Nous sommes désormais forcés de constater qu’une alimentation à deux vitesses s’est mise en place dans notre pays, propulsée par une inflation alimentaire sans précédent et par les échecs de décennies entières passées à favoriser les traités de libre-échange plutôt qu’à encourager et à accompagner une agriculture locale, bio et paysanne.
Les phénomènes d’agrandissement et de spécialisation, qui entraînent des accaparements fonciers et qui conduisent à une disparition des paysans, sont ignorés et passés sous silence.
La compétitivité par les prix reste le prisme de réflexion, mandat après mandat, gouvernement après gouvernement, sans reconnaître les spécificités de l’agriculture ni l’absolue nécessité d’une exception agricole.
Les traités de libre-échange restent la logique de la politique agricole française, sans cesse guidée par le moins-disant social et environnemental, sans parler de la PAC, dont il faut revoir les priorités et les critères.
Ces raisonnements nous conduisent sur une pente dangereuse, celle du renoncement, mais aussi, parfois, du dénigrement de l’administration et des agents publics, en particulier de l’Anses, dont vous nous avez dit, monsieur le ministre, qu’elle n’avait pas « vocation à décider de tout, tout le temps, en dehors du champ européen et sans jamais penser aux conséquences pour nos filières ».
Vous avez raison, monsieur le ministre : on peut parfois concilier intérêts économiques et intérêts sociaux ; mais, souvent, privilégier les intérêts économiques de court terme va à l’encontre de la défense de l’intérêt général, de la santé et de l’environnement.
Non, nous n’avons pas le temps de faire une pause environnementale de cinq ans, n’en déplaise au Président de la République, ni sur la qualité de l’air, ni sur la qualité des sols, ni sur la qualité de l’eau.
Sur ce dernier point, nous allons d’aberration en aberration. Nous le voyons bien sur la question des retenues d’eau : déclarer systématiquement, sans distinction, qu’elles relèvent de l’intérêt public majeur reviendrait à autoriser toutes les mégabassines !
L’eau doit être considérée comme un bien commun, et sa gestion doit reposer sur le triptyque : préservation, partage, juste répartition. Parce qu’elle est une ressource indispensable à la vie, la réalisation de tels ouvrages doit se faire à partir de critères de faisabilité, de pertinence scientifique et d’objectifs d’utilité publique.
Les projets de territoires pour la gestion de l’eau ont vocation non pas à donner blanc-seing à toutes les mégabassines, mais bien à interroger l’ensemble des possibilités sur un territoire pour optimiser, répartir et préserver la ressource en eau.
Dernier point, et non des moindres, la question de l’emploi et du travail agricole.
Le milieu perd des actifs et peine à renouveler les départs à la retraite. C’est toute une politique de l’emploi qu’il faut revoir pour lutter contre des conditions de travail dégradées et contre des dispositifs fiscaux qui encouragent le recours aux contrats courts et saisonniers.
Plutôt que de précariser le travail agricole, il faut renforcer son attractivité et garantir des conditions de travail dignes aux hommes et aux femmes qui nous permettent de nous nourrir, en France et partout dans le monde.
C’est tout un système mondial qu’il faut repenser : un système dans lequel des multinationales toujours plus avides de profit épuisent les terres des pays en voie de développement, exploitent les populations locales, condamnent la biodiversité et, avec elle, toute l’humanité ; un système dans lequel le capitalisme règne en maître sur des marchés mondiaux ; un système dans lequel les agricultures vivrières et les petites structures n’ont pas leur place…
Aux traités de libre-échange et à la compétition mondiale, il faut opposer les coopérations entre pays, inverser les logiques à l’œuvre dans ce capitalisme dévastateur pour l’humain et pour la planète.
La rémunération du travail paysan, la réduction du réchauffement climatique, l’accès à une alimentation de qualité pour toutes et tous, la préservation de la biodiversité sont les seules conditions, incompatibles avec les lois du profit, d’une sécurité alimentaire française et mondiale.
(Applaudissements sur les travées des groupes CRCE et GEST, ainsi que sur des travées groupe SER.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à l’heure où le commerce international de produits agroalimentaires n’a jamais été aussi dynamique, la France est l’un des seuls grands pays agricoles dont les parts de marché reculent.

Elle est ainsi passée du deuxième au cinquième rang des exportateurs mondiaux en vingt ans. Les deux tiers de ses pertes de marché s’expliquent par son manque de compétitivité.
La France décroche en raison de plusieurs facteurs : la hausse des charges, liée au coût de la main-d’œuvre, aux surtranspositions, à une fiscalité trop lourde ; une productivité en berne, du fait de moindres investissements dans l’agroalimentaire et de l’effet de taille d’exploitation, la ferme France reposant historiquement sur un modèle familial, à la différence de bon nombre de nos concurrents ; enfin, l’agribashing, qui vitupère un modèle agricole comptant pourtant parmi les plus vertueux au monde en matière environnementale.
Face à ces constats, notre responsabilité politique est dès lors d’adapter notre modèle agricole et nos politiques publiques nationales, afin de concilier compétitivité, innovation, transition environnementale et attractivité, mots d’ordre réalistes qui doivent désormais guider notre action à court, moyen et long terme.
La proposition de loi issue de l’initiative transpartisane de nos collègues Laurent Duplomb, Pierre Louault et Serge Mérillou, que je salue, présente de premiers éléments de réponse déterminants pour l’avenir de la ferme France et offre aussi des perspectives aux générations d’agriculteurs qui vont s’engager.
Ce texte comporte plusieurs mesures stratégiques aux yeux du groupe Union Centriste : facilitation du financement des investissements agricoles grâce au livret Agri ; soutien aux filières ayant recours aux TO-DE en raison de leurs spécificités ; augmentation des seuils d’exonération de l’impôt sur les revenus agricoles afin de redonner des marges de manœuvre aux agriculteurs ; fin de mesures discriminatoires comme les surtranspositions ou la non-application des clauses miroir.
Le travail en commission et l’investissement de la rapporteure Sophie Primas ont permis d’enrichir le texte, afin de mieux protéger notre agriculture des distorsions de concurrence au sein de l’Union européenne et avec le reste du monde, de modérer les charges pour que le revenu des agriculteurs ne soit plus la variable d’ajustement de la compétitivité et que nos atouts relevant de la compétitivité hors prix soient mieux pris en compte et, enfin, de faciliter l’innovation agricole, clef de la transition énergétique et écologique.
En commission, nous avons clarifié le rôle du haut-commissaire à la compétitivité, chargé de coordonner, planifier et structurer les politiques agricoles. Nous avons également validé l’usage des drones, afin de permettre une pulvérisation aérienne de précision des produits phytosanitaires et approfondi le sujet décisif des clauses miroir, tant attendues. Il nous a enfin paru déterminant de redonner la main au politique en permettant au ministre de l’agriculture de suspendre temporairement une décision de l’Anses de retrait de mise sur le marché de produits phytosanitaires dans des conditions déterminées.
Avec plusieurs de mes collègues centristes, nous présenterons des amendements visant à mettre un terme à la concurrence déloyale qui sévit dans le commerce des miels, à soutenir l’emploi de saisonniers dans les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers, à accélérer la prise du décret d’application de la loi Égalim 2 visant à rendre obligatoire l’indication du pays d’origine ou le lieu de provenance des viandes utilisées en ingrédients, à mieux valoriser le stockage de carbone dans les sols agricoles ou encore à renforcer les fonds propres des coopératives.
Alors que le projet de loi d’orientation et d’avenir agricoles sera présenté à l’automne prochain au Parlement, le Sénat prend date avec ces propositions, qui engagent notre modèle pour les quinze années à venir. Nous souhaitons non pas opposer, mais concilier pour assumer les défis sociétaux de décarbonation et de gestion de l’eau qui sont devant nous.
La survie et la prospérité de nos entreprises agricoles dépendront de notre capacité à concevoir des modèles multifonctionnels qui servent les trois piliers – économie, environnement, société – du développement durable.
Avec ma collègue Nadia Sollogoub, qui complétera mes propos, nous saluons les avancées présentes dans le texte et confirmons qu’une grande majorité des membres du groupe centriste voteront en sa faveur de cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi qu ’ au banc des commissions . – M. Yves Bouloux applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons une proposition de loi qui, je le souhaite vivement, fera date pour la compétitivité de notre agriculture et notre souveraineté alimentaire. Je tiens d’ailleurs à saluer ici le travail de ses trois auteurs : Laurent Duplomb, Pierre Louault et Serge Mérillou.
Issue d’un excellent rapport d’information sur la compétitivité de la ferme France, adopté au mois de septembre 2022 par la commission des affaires économiques, cette proposition de loi transpartisane vise à inverser le déclin de notre puissance agricole.
Le Sénat alerte le Gouvernement à ce sujet depuis plusieurs années. La situation est véritablement alarmante : la France importe plus de produits alimentaires qu’elle n’en exporte, et la concurrence européenne et internationale lui a fait perdre des parts de marché très importantes.
Comme le pointent très justement nos collègues, nous nous sommes repliés sur une production de denrées haut de gamme qui fait, certes, la fierté de la France, mais qui n’est pas suffisamment rémunératrice pour nos agriculteurs. Beaucoup de nos concitoyens, notamment les plus modestes, se trouvent ainsi contraints de consommer des produits importés, sans même évoquer la restauration hors domicile. Ce n’est plus concevable.
Nous connaissons les causes de cette perte dramatique de compétitivité : surréglementation, charges excessives, productivité faible, coût de la main-d’œuvre, fiscalité trop lourde, manque d’investissements, prix élevés… Ce à quoi s’ajoutent aujourd’hui la crise des prix de l’énergie et l’inflation.
Or la pandémie de covid-19 et la guerre en Ukraine ne nous ont que trop bien rappelé l’importance géostratégique de la souveraineté alimentaire. Il est grand temps de réagir et de rendre du souffle à l’agriculture française dans son ensemble, notamment par des investissements d’avenir et des innovations en matière de transition des pratiques agricoles. C’est l’esprit de cette proposition de loi.
Le texte, composé de vingt-six articles, a plusieurs objectifs : assouplir le cadre normatif, lutter contre les surtranspositions, améliorer le cadre fiscal pour susciter l’investissement, encourager l’innovation pour la productivité et accompagner l’agriculture dans sa transition écologique. Mme la rapporteure Sophie Primas, dont je salue également le travail, y a ajouté des dispositions visant à alléger les charges pesant sur les agriculteurs et à préserver davantage l’agriculture française des distorsions de concurrence européenne et internationale.
La ligne d’horizon de ce texte reste le triptyque que nous défendons ardemment au Sénat : bien manger, prix abordables pour le consommateur français, juste rémunération des agriculteurs.
Parmi les mesures phares, la création d’un haut-commissaire à la compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires françaises auprès du ministre de l’agriculture et la mise en œuvre d’un plan quinquennal vont permettre de définir de véritables objectifs agricoles avec de vrais responsables.
La rapporteure a également introduit une disposition permettant au ministre de l’agriculture de suspendre de nouveau une décision technique du directeur général de l’Anses.
Par ailleurs, le fonds de soutien à la compétitivité des filières agricoles en difficulté et l’augmentation des plafonds de la déduction pour épargne de précaution viendront soulager les producteurs, notamment les éleveurs en difficulté.
Enfin, dans la mesure où l’accompagnement de nos agriculteurs face au dérèglement climatique est crucial – je pense notamment au défi du partage de l’eau –, au risque de perdre encore en compétitivité, ce texte rend possible la réalisation d’un diagnostic carbone et de performance agronomique des sols pour les structures agricoles, cofinancé par l’État.
Le rôle de l’agriculture dans notre transition écologique est – faut-il le rappeler ? – décisif. À ce titre, il est nécessaire de donner à nos agriculteurs les moyens d’agir encore plus pour la préservation de la biodiversité, notamment de notre bocage.
En somme, au travers cette proposition de loi, il s’agit d’être cohérent : si nous voulons défendre notre puissance agricole et retrouver notre souveraineté alimentaire, il faut nous en donner les moyens. Ne soyons pas naïfs, sans compétitivité nouvelle, nous ne parviendrons ni à rendre leur pleine attractivité et une rémunération juste aux métiers agricoles ni à enrayer l’érosion du potentiel de production que nous constatons dans nos territoires. En Mayenne, par exemple, entre 2010 et 2020, nous avons perdu plus de 1 000 fermes. Dans le même temps, le nombre de chefs d’exploitation a diminué de 17 %.
Ne perdons pas de temps et saisissons l’occasion que nous offre cette proposition de loi ambitieuse pour construire une agriculture française forte, dynamique et durable.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous débattons aujourd’hui de la compétitivité de la ferme France, quelques heures à peine après le sommet Choose France organisé à Versailles par le président Macron.
La terre de France, nos agriculteurs l’ont choisie ; ils la travaillent tous les jours. À l’instar des autres entrepreneurs auxquels s’adresse le chef de l’État, ils font chaque jour de la production et du négoce. Comme les autres chefs d’entreprise, ils font face à des obligations de rentabilité, à des problématiques de cours nationaux et internationaux, à des soucis de recrutement, à des galères administratives. Ce sont des businessmen farmers. Mais leurs clients, nationaux et internationaux, les consommateurs de leurs produits, eux, choisissent de moins en moins la France…
Très conscients de cette forme de décroissance, nos collègues Laurent Duplomb, Pierre Louault et Serge Mérillou, à la suite de leur rapport d’information, nous proposent un texte aux mesures concrètes, opérationnelles, inspirées des difficultés identifiées dans les exploitations.
Les politiques publiques doivent d’urgence se décider à donner un cap à une reconquête stratégique nationale. N’attendons pas de devoir un jour réagricoliser la France, comme nous devons aujourd’hui essayer de la réindustrialiser. Espérons ne pas avoir à pleurer notre agriculture perdue comme nous pleurons notre industrie perdue.
Créer un haut-commissariat à la compétitivité agricole, lui donner des outils, du pouvoir et des moyens est un signe fort, à condition que ce ne soit pas un « machin » de plus ou une coquille vide.
Oui, la compétitivité agricole doit être surveillée avec la plus grande attention. Il ne faut pas se contenter de la constater a posteriori, ou plutôt d’en constater l’absence, à l’aune des disparitions d’exploitations ou des décapitalisations de cheptel.
Oui, nous devons éradiquer la surtransposition des normes, qui entravent, là comme ailleurs, le fonctionnement des entreprises. Ce qui est particulièrement grave en l’espèce, c’est que l’on demande à l’agriculture de s’adapter aux changements de l’environnement tout en l’enfermant dans un carcan rigide et chaque jour plus contraignant.
Depuis l’apparition de la vie sur terre, l’agriculture n’a cessé d’évoluer selon les besoins des hommes et le contexte naturel. Elle a suivi l’évolution du monde, poursuivant constamment sa mission nourricière. Si elle ne l’avait pas fait, l’homme aurait disparu.
En France, cependant, pour des raisons qui ne sont pas les bonnes, on enchaîne l’agriculture, on la ligote dans des injonctions contradictoires, prenant le risque insensé de l’affaiblir gravement.
Nous devons lui rendre la liberté d’évoluer, accorder plus de moyens à son soutien plutôt qu’à son contrôle et encourager massivement l’innovation, comme le prévoit cette proposition de loi.
Ce n’est pas le champ qui fait la moisson ; c’est le labour, dit justement un proverbe espagnol. Sanctuariser des parcelles agricoles n’est pas une fin en soi s’il n’y a pas de bras pour les exploiter. Il n’est pas inutile de rappeler ce prérequis face aux risques d’excès du « zéro artificialisation nette ».
La folie administrative, les surtranspositions malvenues, quoique pétries de bonnes intentions, mais aussi les distorsions de concurrence par rapport aux autres pays producteurs sont autant de vers qui rongent la ferme France.
Il faut, avec bon sens et de toute urgence, éradiquer les inepties, décréter un vrai plan de relance d’une production agricole compétitive et concurrentielle. La fiscalité est un vieil outil, qui sait souvent être efficace ; utilisons-la à bon escient.
La transmission des exploitations et le renouvellement des générations sont aussi des enjeux essentiels. De manière générale, une entreprise déficitaire ne trouve pas de repreneur : l’enjeu de prospérité et compétitivité en est donc d’autant plus vital.
Nous déplorons aussi qu’il soit aujourd’hui beaucoup plus facile de s’agrandir que de reprendre une exploitation. C’est une dérive dont nous risquons de faire très vite les frais.
Enfin, je souhaite vous faire partager ma réflexion sur la non-valorisation des apports de l’agriculture à notre société. Celle-ci doit s’adapter aux évolutions climatiques ; elle est chargée de notre souveraineté alimentaire ; elle s’inscrit désormais comme un producteur d’énergie ; c’est l’acteur essentiel de la décarbonation ; elle est dépositaire des enjeux de biodiversité… Il est temps de comprendre que l’on ne peut pas avoir tout pour rien !
Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j’interviens en lieu et place de Jean Pierre Vogel, président de la section Cheval du groupe d’études Élevage, qui ne peut pas être présent parmi nous.
Je m’attarderai assez peu sur l’économie générale de cette proposition de loi, qui a très largement été exposée. Nous connaissons tous la situation de nos agriculteurs, perclus de charges et de normes, qui sont une forme particulière de charges. Notre agriculture se trouve aujourd’hui dans un environnement juridique si contraint qu’elle a perdu en compétitivité.
Qui connaît la démographie agricole sait combien il était urgent de provoquer un choc de compétitivité pour notre agriculture, qui brille par son excellence unanimement reconnue. J’en remercie les trois auteurs de cette proposition de loi.
Je souhaiterais plus particulièrement évoquer l’article 25 de ce texte, qui vise à appliquer un taux de TVA intermédiaire de 10 % à la filière équine. Nous nous félicitons de cette mesure, qui émane de la section Cheval et de son président. Il s’agit d’un élément technique dont Mme Primas et M. Duplomb ont parfaitement saisi l’importance.
Rappelons que, entre 2004 et 2012, la filière équine a bénéficié d’un taux de TVA de 5, 5 % particulièrement favorable à son développement. En 2012, la CJUE, s’appuyant sur une directive européenne, a imposé de porter ce taux à 20 %, ce qui a été extrêmement préjudiciable à la filière.
Tous les gouvernements successifs se sont engagés à revenir sur cette mesure, qui nuit à la compétitivité de notre filière équine, si le cadre européen évoluait. Or cet engagement peut désormais être tenu, ledit cadre européen ayant été modifié sous la présidence française de l’Union européenne.
Monsieur le ministre, allez-vous répondre à cette attente importante de la filière équine en maintenant le taux de TVA de 10 % retenu dans cette proposition de loi ?
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe UC.
Je voudrais tout d’abord remercier M. Requier de son engagement continu sur les sujets agricoles ; j’ai bien noté les points qu’il a soulevés.
Monsieur Gremillet, nous avons franchi une première étape en stabilisant le dispositif de l’épargne de précaution sur trois ans dans le projet de loi de finances pour 2023. Il s’agit d’un sujet important de compétitivité, mais il faut aussi travailler à la définition de cette notion et de ses objectifs. Prolonger par principe un dispositif qui a montré son intérêt ne suffit pas.
Monsieur Menonville, cela fait au moins vingt-trois ans que nous perdons en compétitivité. Nous devons assumer collectivement ce qui a été réalisé sous plusieurs septennats et quinquennats : le principe de précaution a été introduit dans la Constitution sous la présidence de Jacques Chirac, et le Grenelle de l’environnement s’est tenu sous celle de Nicolas Sarkozy.
Soit on décide de s’inscrire en rupture totale avec le passé, soit on assume collectivement le cadre qui a été construit. Notre pays est le seul à avoir inscrit le principe de précaution dans sa Constitution : assumons collectivement ce cadre et essayons d’avancer sans nécessairement remettre en cause une œuvre commune, qui peut présenter des défauts, mais qui correspond aussi à notre tempérament particulier.
Monsieur Labbé, ne caricaturons pas sur la question des drones. Les auteurs de la proposition de loi ne veulent pas épandre davantage : c’est tout l’inverse ! Nous nous engageons sur la voie de la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires, ce que nous souhaitons tous, me semble-t-il. Le drone peut, certes, avoir d’autres usages, mais il peut aussi se révéler très intéressant pour l’agriculture, notamment pour sécuriser le travail des agriculteurs sur des terrains escarpés.
Par ailleurs, monsieur Labbé, une tomate bio et une tomate conventionnelle ont besoin de la même quantité d’eau ; idem pour le maïs. Bien sûr, nous devons réfléchir aux façons de mieux utiliser l’eau et de mieux la stocker dans les sols. Mais, de grâce, essayons de ne pas tomber dans la caricature : oui, l’agriculture a besoin d’eau, mais évitons tout propos excessif. Nous sommes l’un des pays utilisant le moins d’eau et comptant le moins de surfaces irriguées ; nous en comptons moins, par exemple, que les Pays-Bas.
Madame Schillinger, vous avez évoqué des sujets qui peuvent faire l’objet de réserves. Nous aurons l’occasion d’y revenir lors de l’examen des amendements. Je vous remercie de vos propos.
Monsieur Tissot, je récuse l’idée d’un jeu politique. Nous ne nous faisons pas la courte échelle. Ce serait faire grief à Mme Primas, à M. Duplomb et à moi-même que de laisser croire que nous serions capables de nous influencer les uns les autres : nous sommes des esprits suffisamment libres et indépendants pour vivre nos vies séparément ; parfois, nos points de vue convergent, parfois, non, mais toujours dans la liberté du débat démocratique.
Certains des sujets de ce texte proviennent des concertations. Il faut savoir les entendre, quand bien même vous ne seriez pas d’accord. Les sujets concernant l’eau, par exemple, sont remontés des concertations. Il faut essayer de dépassionner le sujet et d’avancer concrètement.
Monsieur Gay, vous connaissez les grands auteurs, et je ne puis que vous remercier de m’avoir cité… « Pas tout, pas tout le temps » : voilà ce que j’ai dit sur les avis de l’Anses. Je ne retire rien, comme je l’ai rappelé au sénateur Salmon, qui m’a parfois demandé de revenir sur des avis de l’Anses. Il ne s’agit pas de propos révolutionnaires, même si je commence à m’interroger compte tenu des reproches qui me sont adressés ! Toujours est-il qu’il n’est nullement question d’en rabattre sur les questions de santé !
Par ailleurs, viser la neutralité carbone en 2050, c’est tout sauf faire une pause ! En revanche, changer les règles en permanence ne permet pas de bien organiser les filières.
Madame Loisier, vous avez raison d’insister sur le financement agricole et sur l’importance des innovations. Je crois beaucoup à ce dernier sujet.
Monsieur Chevrollier, la situation alarmante que vous décrivez est juste et nous la partageons tous. Vous avez évoqué un triptyque ; j’y ajouterais un quatrième élément : la transition écologique. Il ne s’agit pas de produire davantage de normes. À la vérité, si nous n’agissons pas, l’érosion du potentiel de production des sols se poursuivra. Il faut y réfléchir de manière apaisée.
Madame Jourda, j’ai compris vos préoccupations. Nous reparlerons dans la discussion des articles de ce sujet spécifique, mais la volonté du Gouvernement est d’avancer,
Madame Sollogoub, je partage vos remarques sur la fiscalité. Toutefois, certaines entreprises qui ne sont pas déficitaires ne sont pas non plus reprises : certains sujets vont au-delà de la rentabilité. La question de la mise à disposition des terres se pose.
Penchons-nous sur les sujets ouverts et évitons les caricatures. Je voudrais plus particulièrement m’adresser à M. Labbé, dont je doute qu’il s’agisse de la dernière intervention lors d’une discussion générale ; nous ne sommes qu’au mois de mai !
Sourires.
Pour ma part, j’essaie toujours, dans le débat public, d’écouter mes contradicteurs, considérant qu’il y a peut-être des choses dont il faut tenir compte. Je ne vous fais pas grief, monsieur Labbé, de penser ce que vous pensez, car je ne crois pas que votre seule motivation soit d’être en désaccord avec le Gouvernement. Souffrez que l’inverse soit vrai, et que je puisse défendre des positions avec lesquelles vous pouvez ne pas être d’accord, mais qu’il ne faut pas refuser d’écouter par principe.
Essayez donc d’écouter notre position sur la productivité ! Vous me trouverez toujours sur le chemin d’une agriculture française souveraine. Vous me trouverez aussi toujours sur le chemin du refus des démagogies, d’où qu’elles viennent. Et il y en a partout ! Certains vous disent « y’a qu’à, faut qu’on » et qu’il faut donner des injonctions aux agriculteurs quand d’autres préconisent de les laisser faire et de continuer comme avant. Vous ne me trouverez sur aucun de ces deux chemins.
En effet, selon moi, ce serait une erreur de dire aux agriculteurs que les contraintes climatiques ne sont pas puissantes. Ce serait une erreur de ne pas dire aux agriculteurs que nous avons intérêt à décarboner notre agriculture. Quatre degrés de plus, c’est le drame absolu pour nos agriculteurs. Nous avons donc besoin de penser des systèmes plus résilients. J’essaie de trouver un équilibre sur chaque point du texte, afin de faire en sorte que nous ne tombions ni d’un côté ni de l’autre. Et ce n’est pas du « en même temps » !
Je ne me satisferais pas d’une situation ne nous permettant pas d’exercer nos prérogatives de souveraineté. Je ne me satisfais pas que plus de 50 % des fruits et légumes consommés en France ne viennent pas de France. Nous avons besoin de regagner en compétitivité et en souveraineté, en posant la question de l’accès à l’eau.
Dire aux agriculteurs que rien ne changera, c’est une autre position démagogique à laquelle je me refuse. Tenir de tels propos, c’est confortable quand on s’exprime à la tribune. Mais cela conduit à la disparition de la souveraineté agricole française. Si nous ne répondons pas à la question de la résilience du système, nous perdrons en souveraineté.
J’étais voilà peu dans les Pyrénées-Orientales. Je dois pouvoir répondre à la contrainte sans dire aux agriculteurs qu’il suffit de changer de modèle. Nous devrons accompagner des gens qui font de la vigne, de l’arboriculture, de l’élevage et un peu de maraîchage, loin des caricatures de l’agriculture que vous qualifiez parfois d’« industrielle » ! La résilience, ce n’est pas la disparition de l’agriculture. Il s’agit de savoir comment nous continuons à exercer nos prérogatives de souveraineté sous les contraintes climatiques.
Il faut décrire les contraintes et trouver les solutions. Nous le devons aux agriculteurs, il convient d’avoir un débat apaisé sur ces questions. Nous n’avons aucun intérêt à ce que la société se dresse contre les agriculteurs ou à ce que les agriculteurs soient dressés contre une partie de la société. Nous avons besoin de construire un tel débat. J’écoute en effet le témoignage de nombreux agriculteurs qui, tous les jours, ont le sentiment de ne pas être compris, qu’il s’agisse de leurs contraintes ou de leurs pratiques. Nous avons donc besoin de décrire les pratiques agricoles sans les caricaturer. Nous rendrions un service non seulement aux agriculteurs et à l’agriculture, mais aussi aux transitions que nous serons amenés à mettre en œuvre.
Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, INDEP, RDSE, UC et Les Républicains.

La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
TITRE Ier
FAIRE DE LA COMPÉTITIVITÉ DE LA FERME FRANCE UN OBJECTIF POLITIQUE PRIORITAIRE

Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 70 rectifié quinquies est présenté par Mmes Noël, Pluchet et Bonfanti-Dossat, M. Joyandet, Mmes Thomas, Muller-Bronn et Berthet, MM. Bacci, Belin, Sido et D. Laurent, Mme Belrhiti, M. Bouloux, Mme Garriaud-Maylam, MM. Meurant et Bouchet, Mme Micouleau, M. Somon, Mmes Malet, Bellurot et Joseph, M. B. Fournier, Mme Imbert et MM. Klinger et Gremillet.
L’amendement n° 79 rectifié est présenté par MM. Menonville et Chasseing, Mme Loisier, MM. Kern et A. Marc, Mmes Guidez et Férat, MM. Decool, Médevielle, Hingray et Maurey, Mmes N. Delattre et Gacquerre, MM. Verzelen, P. Martin et Wattebled, Mme Perrot, M. Chauvet, Mme Saint-Pé, M. Marseille, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Moga, Folliot, Longeot, Duffourg et Malhuret.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – La souveraineté alimentaire est un intérêt fondamental de la Nation au sens de l’article 410-1 du code pénal. »
La parole est à M. Daniel Laurent, pour présenter l’amendement n° 70 rectifié quinquies.

L’article 1er vise à intégrer la souveraineté alimentaire à la liste des intérêts fondamentaux de la Nation, au même titre que son indépendance, l’intégrité de son territoire, sa sécurité, la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger, et de l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique, économique et de son patrimoine culturel.
À la lumière de la crise liée au covid-19, qui a révélé la vulnérabilité de nos approvisionnements dans de nombreux domaines, il est apparu, avec une évidence renouvelée dans l’opinion publique et dans l’action des pouvoirs publics que la souveraineté alimentaire figurait bien au nombre des intérêts fondamentaux de la Nation.
Pour autant, à ce jour, la notion de souveraineté alimentaire n’est consacrée dans aucun code ni aucune loi.
Par cet amendement, nous proposons de corriger cette anomalie, en donnant enfin toute sa portée symbolique à ce principe, qui recouvre la capacité de production agricole et le taux d’auto-approvisionnement alimentaire, mais diffère de l’autosuffisance alimentaire, qui ne serait ni possible ni souhaitable.
Cet amendement permet de resituer la recherche de compétitivité, érigée en priorité par la présente proposition de loi, comme un moyen parmi d’autres d’atteindre la souveraineté alimentaire, objectif consensuel partagé sur toutes les travées du Sénat.

La parole est à M. Franck Menonville, pour présenter l’amendement n° 79 rectifié.

Cet amendement vient d’être admirablement défendu. J’ajoute simplement que, depuis la crise sanitaire, la notion de souveraineté alimentaire a pris tout son sens.

Ces deux amendements symboliques me paraissent donner le ton en matière d’agriculture et d’alimentation, dans ce que devrait être le monde de l’après-covid-19. Comme le disent très bien leurs auteurs, il faut rappeler que l’impératif qui nous réunit tous aujourd’hui est celui de la souveraineté alimentaire. Avis favorable.
Précisément, madame la rapporteure, il s’agit d’amendements symboliques. Or je sais que le Sénat veille à faire la loi, et non des textes symboliques !
Tout d’abord, je ne vois pas bien la portée de ces amendements. Ensuite, les notions de souveraineté et de sécurité ne sont pas tout à fait de même nature. D’ailleurs, une partie des actions et des dérogations que nous avons mises en œuvre dans le cadre de la pandémie relevaient de la sécurité alimentaire.
Je comprends bien la portée symbolique de ces amendements, d’autant que nous partageons – vous l’avez compris – la volonté d’une souveraineté alimentaire. Pour autant, je ne vois pas ce que leur adoption bouleversera, sans compter qu’on ne mesure peut-être pas tout à fait leur portée.
Cela ne signifie pas que nous ne nous soyons pas intéressés à la question, en particulier dans le cadre du projet de loi d’orientation. Comment introduire un concept de souveraineté venant contrebalancer les politiques publiques ?
N’étant pas certain que la formulation proposée soit la bonne, je demande le retrait de ces amendements. À défaut, je me verrais contraint d’émettre un avis défavorable.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 70 rectifié quinquies et 79 rectifié.
Les amendements sont adoptés.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l’article 1er.
Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre Ier du titre Ier, il est ajouté un article L. 611-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 611 -1 A. – Il est institué, auprès du ministre chargé de l’agriculture, un haut-commissaire à la compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires. Il assure un suivi régulier de toute difficulté de nature normative en matière de compétitivité, en propre ou à la suite d’une alerte des filières, des interprofessions, des organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs, et apporte son concours à la définition et à la mise en œuvre des politiques ayant un impact sur la compétitivité de ces filières. À ce titre, il a pour missions :
« 1° D’assurer le pilotage et le suivi du plan quinquennal pluriannuel de compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires mentionné à l’article L. 611-1-1 ;
« 2° De présider les conférences publiques de filière prévues à l’article L. 631-27-1 ;
« 3° De rédiger un rapport triennal public portant sur la compétitivité de l’ensemble des filières agricoles françaises, qu’il remet au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport analyse notamment les effets des évolutions législatives et règlementaires sur la compétitivité des filières, évalue l’efficacité des mécanismes d’aide et de soutiens existants, notamment régionaux et départementaux, met en évidence les déterminants de l’évolution de la balance commerciale agricole et agroalimentaire française et formule des recommandations ;
« 4° D’émettre des avis et recommandations publics sur tout sujet relatif à la compétitivité des filières agricoles.
« Pour l’exercice de ses missions, il peut faire appel, en tant que de besoin, aux services du ministère chargé de l’agriculture, de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, de l’Institut national de la recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, de l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer, des chambres d’agriculture et des instituts techniques agricoles.
« Lorsque le haut-commissaire est saisi d’une difficulté concernant plusieurs ministères, il peut recourir au concours des services des ministères concernés et en rend compte au Premier ministre et au ministre chargé de l’agriculture.
« Un décret précise les missions du haut-commissaire ainsi que les moyens qui lui sont attribués pour les mener à bien. » ;
2° L’article L. 631-27-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « égide », sont insérés les mots : « du haut-commissaire à la compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires mentionné à l’article L. 611-1 A, qui la convoque, et avec le concours » ;
b)
« La conférence publique de filière fait le bilan de l’évolution de la compétitivité agricole et agroalimentaire française de l’année précédente, en analyse les déterminants, et propose des perspectives à court et moyen terme pour l’améliorer. » ;
c)

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd’hui est une réponse nécessaire aux problèmes rencontrés par le monde agricole ou, plus exactement, l’une des réponses nécessaires.
Est-il utile de rappeler le truisme selon lequel de notre modèle agricole dépend notre souveraineté alimentaire ?
Le défi est grand : d’une part, assurer une production agricole répondant aux critères quantitatifs, qualitatifs et environnementaux ; d’autre part, contrecarrer l’épuisement et le découragement de nos agriculteurs, notamment des plus jeunes, qui s’interrogent sur la pérennité de leur métier ; Daniel Gremillet l’a très bien dit tout à l’heure.
L’inquiétude est alimentée par des statistiques mortifères : le nombre d’agriculteurs a été divisé par quatre en quarante ans !
Quand, à cette réalité structurelle implacable, se greffent de violents éléments conjoncturels, nous sommes en droit de comprendre une telle désaffection !
Permettez au sénateur picard que je suis de prendre l’exemple emblématique de la filière betteravière, victime, comme vous le savez, du séisme de la jaunisse, qui entraîne 30 % de pertes au niveau national et, parfois, jusqu’à 70 % localement.
Nous avions accordé des dérogations temporaires d’utilisation de protection des semences à la filière, dérogations finalement proscrites par une décision de la Cour de justice de l’Union européenne au mois de janvier dernier, la filière se retrouvant ainsi, seule en Europe, dans une situation d’impasse technique complète, ce qui est aussi dramatique qu’ubuesque !
Ce pan de l’économie agricole pèse de façon directe et indirecte, dans la mesure où les vingt et une sucreries de notre pays sont à l’origine d’environ 90 000 emplois.
La présente proposition de loi tente d’apporter une solution via son article 12, qui vise à lutter contre les surtranspositions de mesures législatives.
Si nous voulons que la maison agricole France reste debout dans les tempêtes climatiques, sanitaires, environnementales, économiques et administratives, nous devons la soutenir avec force.
Je sais que vous en êtes conscient et que tel est votre objectif. Je vous remercie, monsieur le ministre, de votre écoute et de votre détermination à relever ce défi compliqué.
Vous l’avez compris, je voterai naturellement en faveur de ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur certaines travées du groupe Les Républicains.

Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 11 est présenté par MM. Salmon, Labbé, Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel.
L’amendement n° 57 est présenté par M. Gay, Mmes Varaillas, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Daniel Salmon, pour présenter l’amendement n° 11.

L’institution d’un haut-commissaire à la compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires françaises nous semble non seulement inutile, mais aussi contre-productive.
L’article 1er vise à faire de la compétitivité-prix l’axe premier des politiques agricoles, alors que cet axe correspond à la course au moins-disant social et environnemental.
Comme l’affirme le rapport du Conseil économique, social et environnemental (Cese) intitulé Quels leviers pour renforcer la compétitivité de l ’ agriculture et de l ’ agroalimentaire français ?, il convient de redéfinir la compétitivité, qui ne doit pas être réduite à une question de prix et de coûts de production, mais au contraire prendre en compte la qualité gustative et sanitaire des produits, leur adéquation avec les attentes des consommateurs, les emplois créés et les impacts environnementaux. Ces derniers éléments sont susceptibles, vous le savez, d’engendrer d’importantes dépenses, assumées de manière collective.
Plutôt que de centraliser la gouvernance de l’agriculture sur une personne unique, il est de la responsabilité du ministère de l’agriculture, en lien avec les ministères de l’environnement et de la santé, de mener une politique à la fois agricole et alimentaire prenant en compte l’ensemble des dimensions économiques, mais aussi sociales, écologiques, territoriales et sanitaires.
C’est un ensemble ; il ne peut pas s’agir exclusivement d’une compétitivité-prix. Cessons de tout focaliser sur cet axe ! Pour cette raison, le groupe écologiste demande la suppression de cet article, dans la mesure où un haut-commissaire ne constituera pas, bien au contraire, l’élément déterminant d’une transition vers une agriculture durable.

La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas, pour présenter l’amendement n° 57.

Selon nous, la création d’un haut-commissaire à la compétitivité des filières agricoles et alimentaires n’apportera pas de réponse à la crise profonde que connaît le monde agricole. En effet, outre le fait que la compétitivité ne se décrète pas, elle ne saurait se résumer à une question de volumes et de prix dans une recherche d’optimisation économique.
Comme le souligne très justement le Cese dans son avis de 2018 : « La compétitivité ne peut se limiter à comparer des coûts de production et de vente ou les volumes et les prix de produits souvent standardisés. »
La compétitivité inclut une large palette d’enjeux sanitaires, environnementaux, sociaux, alimentaires, fonciers, ce qui n’apparaît pas dans la proposition de loi.
Et ce qui tue notre agriculture, ce n’est pas le manque de compétitivité, entendu dans un sens restreint, voire dépassé ; c’est bien la guerre des prix à laquelle se livrent les enseignes de la grande distribution et les grands groupes de l’agroalimentaire, ainsi que la concurrence entre États membres.
C’est bien la financiarisation et la banalisation du secteur agricole qui met en danger le modèle d’agriculture familiale. C’est bien le libre jeu du marché et la course effrénée au meilleur rendement qui entraînent une forte volatilité des prix, préjudiciable aux agriculteurs comme aux consommateurs. Le libre jeu du marché est en ce sens contre-productif dans le domaine de l’alimentation.
Enfin, il nous semble qu’en lieu et place d’une énième instance, il importe de s’appuyer sur l’existant. Je pense notamment au Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, présidé par le ministre chargé de l’agriculture. Cet organisme assure des missions de conseil, d’expertise, d’évaluation, d’audit et d’inspection, sur des questions stratégiques comme l’agroécologie, la lutte contre le changement climatique, la gestion de crises de marché ou de crises sanitaires, ainsi que l’appui à l’international. Il peut aussi participer à la conception des lois.
Dès lors, il nous semble que la création d’un haut-commissariat serait redondante.

L’institution d’un haut-commissaire répond au besoin de relais, exprimé à la fois par les agriculteurs et par les organisations professionnelles auprès des pouvoirs publics.
Monsieur le ministre chargé de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, ce haut-commissaire a vocation non pas à concurrencer votre poste, mais plutôt à alerter, à recenser les surtranspositions, à examiner la balance bénéfices-risques, et à être un véritable relais pour les filières.
Par ailleurs, de par les compétences que nous lui avons données, nous souhaitons également qu’il convoque et anime la conférence annuelle de filière, instituée dans le cadre de la loi dite loi Sapin 2. Nous avons en effet décidé d’octroyer à cette conférence, qui n’a jamais été réunie, des compétences supplémentaires.
Le rôle de ce haut-commissaire sera aussi un rôle d’agrégateur des différents plans que subit l’agriculture, à savoir, notamment, le plan eau, le plan de structuration des filières et le plan Écophyto. Il s’agit de trouver une forme de cohérence entre ces différents plans.
La commission est donc défavorable à ces deux amendements identiques.
Ne croyez pas que je sois juge et partie, mais il y a toujours quelque chose de paradoxal à demander que le ministre ait plus de poids politique dans les décisions et, en même temps, à vouloir instituer un haut-commissariat, ce qui pourrait, d’une certaine façon, créer une forme de concurrence politique à ses prérogatives de ministre.
Pour autant, je le reconnais, votre proposition a le mérite de poser la question légitime de la cohérence des politiques publiques. Y a-t-il un endroit où l’on se soucie de la cohérence des messages envoyés aux agriculteurs et de la mise en place d’une souveraineté agricole ?
Ces deux amendements identiques, qui, au fond, n’ont pas pour objet de remettre en cause l’idée d’un haut-commissariat, visent toutefois à supprimer cette création en raison de la référence à la « compétitivité ».
Je le répète, n’ayons pas peur du terme « compétitivité » ! Ce n’est pas seulement le rendement ! C’est la capacité, dans un marché ouvert – à moins que certains ne croient toujours à la possibilité de rester dans un marché fermé uniquement français –, d’avoir une ferme France compétitive, d’abord dans l’espace européen.
Il s’agit donc d’un vrai sujet de coordination des politiques publiques, qui pourrait concerner d’autres domaines que l’agriculture. Toutefois, je ne suis pas sûr que la création d’un haut-commissariat constitue la bonne réponse. Mais, comme je suis juge et partie, vous estimerez sans doute que mon avis n’est pas pertinent.
Je demande donc le retrait de ces amendements. À défaut, je m’en remettrai à la sagesse de la Haute Assemblée.
Les amendements ne sont pas adoptés.

L’amendement n° 27 rectifié, présenté par MM. Tissot, Montaugé et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla et Redon-Sarrazy, Mme Bonnefoy, M. J. Bigot, Mmes Monier et Préville, MM. Stanzione, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase et alinéa 4
Après le mot :
compétitivité
insérer le mot :
durable
La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy.

L’article 1er vise à instituer un haut-commissaire à la compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires, chargé notamment de piloter un plan quinquennal pluriannuel de compétitivité des filières.
Les sénateurs du groupe SER ne s’opposeront pas à cette création, même si nous nous interrogeons fortement sur, d’une part, la nécessité de créer un nouveau haut-commissaire, alors que nous pouvons questionner l’utilité de certains hauts-commissaires déjà en activité – celui auquel nous pensons tous ne fait pas grande concurrence à un ministre, eu égard à ses productions
Sourires sur les travées du groupe SER.

En effet, aux termes de l’article 1er, il pourra mobiliser à son gré des fonctionnaires ou des salariés de différentes structures du ministère de l’agriculture, des chambres d’agriculture, de FranceAgriMer, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, ou de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.
En tout état de cause, le présent amendement vise à préciser les missions de ce futur haut-commissaire à la compétitivité, en inscrivant explicitement dans la loi que la recherche de cette compétitivité devra se faire dans un cadre durable – le mot a tout son sens – et ne saurait être seulement guidée par des impératifs économiques ou des conquêtes de parts de marché.
Cet amendement pourrait paraître rédactionnel à certains. Toutefois, eu égard à la demande portée par cette proposition de loi, nous estimons qu’une telle précision est nécessaire, afin de ne pas perdre de vue l’un des objectifs rappelés par notre groupe.

Comme il n’est dans les intentions ni de l’auteur de l’amendement ni de la commission d’opposer durabilité et compétitivité, j’émets un avis favorable sur cet amendement.
L ’ amendement est adopté.

L’amendement n° 121, présenté par Mme Primas, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle examine la politique d’accompagnement à l’exportation des filières agricoles et agroalimentaires et évalue les dispositifs mis à la disposition des acteurs économiques au regard de leurs besoins.
La parole est à Mme le rapporteur.

Le rapport sur la compétitivité de la ferme France souligne à quel point la politique d’accompagnement à l’exportation de nos filières agricoles et agroalimentaires n’est pas à la hauteur des enjeux.
La conférence publique de filière semble être l’enceinte adaptée pour discuter de ces politiques d’accompagnement à l’exportation, en particulier pour ce qui concerne l’agriculture.
Avis de sagesse.
En vous écoutant, je me disais que nous aurions besoin de mieux organiser les différentes instances dont nous disposons, en particulier pour ce qui concerne l’agriculture. En effet, la multiplication des structures est sans doute à l’origine de l’absence de coordination nécessitant la création de ce haut-commissaire.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 1 er est adopté.

L’amendement n° 82, présenté par M. Bonhomme, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ….– L’agriculture répond aux besoins essentiels de la population en assurant l’accès à une alimentation sûre, saine et diversifiée de bonne qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant l’emploi, la protection de l’environnement et des paysages et contribuant à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique. La protection, la valorisation, le déploiement de l’agriculture sont reconnus d’intérêt général majeur et concourent à répondre aux besoins des générations présentes et futures. »
La parole est à M. François Bonhomme.

Par cet amendement, il s’agit de reconnaître le caractère d’intérêt général de l’agriculture dans le code rural et de la pêche maritime. L’agriculture est aujourd’hui, me semble-t-il, la grande oubliée des activités qualifiées d’« intérêt général », contrairement à des domaines comme la défense de l’environnement ou la mise en valeur des forêts.
L’accès à ce statut permettrait à l’agriculture d’être davantage protégée par l’État, en favorisant les actions en faveur du maintien des exploitations existantes et de l’installation de jeunes agriculteurs. Cela permettra aussi, et surtout, de protéger davantage les activités agricoles contre les différentes attaques ou entraves, qui se multiplient et dont certaines se traduisent par des actions violentes contre les biens ou les personnes. Il s’agit d’assurer les libertés publiques fondamentales, en particulier la liberté d’entreprendre et le droit de propriété.
Le droit de propriété a été singulièrement oublié au cours des événements qui se sont déroulés à Sainte-Soline. On a mobilisé des escadrons de forces de l’ordre pendant plusieurs week-ends, uniquement pour assurer la défense du droit essentiel de propriété.

La commission demande le retrait de cet amendement, qui est satisfait après l’adoption des amendements identiques n° 70 rectifié quinquies et 79 rectifié.
Là encore, nous sommes un peu dans le déclaratif.
Monsieur le sénateur, vous ne pouvez pas dire que nous n’avons pas défendu à Sainte-Soline – je souhaite rendre hommage aux forces de l’ordre – le droit de propriété. Ne croyons pas que l’adoption d’un tel amendement changerait quelque chose.
Le droit de propriété est un droit constitutionnel et figure même dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Essayons de ne pas caricaturer la situation : le droit de propriété et le droit à vivre dans des conditions pacifiques ont été défendus.

Non, je le retire, monsieur le président.
Je tiens à préciser que je ne mettais pas en cause le Gouvernement en particulier. Je pensais plutôt à tous les organismes et associations qui, sous prétexte de protection de l’environnement, mettent en cause de manière permanente, sous forme de mise en accusation et de suspicion, en se prévalant parfois d’études dont le caractère scientifique laisse à désirer, le droit de propriété.
Je citerai notamment Oxfam, dirigé par Cécile Duflot, qui diffuse dans le champ médiatique des études sans caution scientifique donnant lieu à des reportages mettant en cause notre modèle agricole. Cela entraîne des effets indirects comme les agressions, les violences et les intrusions dans les exploitations.
J’aimerais non seulement que l’État poursuive de plus en plus fortement les personnes qui se rendent coupables de violences à l’égard des agriculteurs, mais aussi qu’on remercie tous les matins les agriculteurs de produire pour la France. C’est en ce sens que je souhaitais que les agriculteurs soient reconnus d’intérêt général, au même titre que les boulangers et les agents du service public.
Imagine-t-on notre pays sans puissance agricole et sans capacité productive ? Il convient donc de changer complètement le logiciel sur l’agriculture et d’en finir avec les discours qu’on nous instille au goutte-à-goutte depuis quelques années.
Après l’article L. 611-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 611-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611 -1 -1. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° … du … pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France, puis tous les cinq ans à compter de la publication du premier plan, un plan quinquennal de compétitivité et d’adaptation des filières agricoles et agroalimentaires est élaboré par le ministre chargé de l’agriculture, en concertation avec les filières et en lien avec le haut-commissaire mentionné à l’article L. 611-1 A, qui en assure le suivi.
« Ce plan, qui a vocation à agréger et mettre en cohérence l’ensemble des plans et documents de planification existants, établit notamment la liste des investissements essentiels à la compétitivité et à la résilience de chaque filière. Les financements publics en faveur de l’investissement en agriculture et dans le secteur agroalimentaire tiennent compte des priorités ainsi établies. »

L’amendement n° 28 rectifié, présenté par MM. Tissot, Montaugé et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla et Redon-Sarrazy, Mme Bonnefoy, M. J. Bigot, Mmes Monier et Préville, MM. Stanzione, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
quinquennal de compétitivité
insérer le mot :
durable
La parole est à Mme Martine Filleul.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de l’amendement que nous venons de défendre sur l’article 1er. Il s’agit de préciser que le plan quinquennal qui sera mis en œuvre et piloté par le haut-commissaire devra intégrer une dimension durable. Le choc de compétitivité que certains de nos collègues appellent de leurs vœux ne saurait être guidé uniquement par des considérations économiques.
L’urgence climatique nous appelle à des solutions durables prenant en compte la préservation de notre environnement, de notre biodiversité et de notre santé.

En cohérence avec la position qu’elle a adoptée lors de l’examen de l’article 1er, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
L ’ amendement est adopté.

L’amendement n° 12, présenté par MM. Labbé, Salmon, Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
et d’adaptation des filières agricoles et agroalimentaires
par les mots :
économique, environnementale, de performance sociale et sanitaire de l’agriculture et de l’alimentation, permettant la transition agroécologique
2° Remplacer les mots :
et en lien avec le haut-commissaire mentionné à l’article L. 611-1 A, qui en assure le suivi.
par les mots :
en lien avec le ministère en charge de l’environnement, le ministère en charge de la santé, en concertation avec les filières agricoles et agroalimentaires, les syndicats agricoles représentatifs, des organisations agricoles professionnelles permettant la représentation d’une diversité de systèmes agricoles et notamment les systèmes en agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13, d’associations de protection de l’environnement, d’associations de protection des consommateurs, des associations de lutte contre la précarité alimentaire, d’association de solidarité internationale, d’associations de protection des animaux, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, et après une démarche d’association du public. Les concertations et associations sont organisées en donnant aux acteurs concernés et au public une information claire et suffisante, et dans des délais raisonnables permettant leur participation effective et éclairée.
II. – Après l’alinéa 2
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
« Ce plan est articulé avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement et avec la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 110-3 du même code, le plan d’action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques prévu à l’article L. 253-6 du présent code, et la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat, mentionné à l’article L. 1.
« Il permet de déterminer des échéances et des objectifs chiffrés :
« - en termes de réduction de l’usage des produits phytosanitaires et des engrais azotés, permettant d’organiser une trajectoire de sorties de ces usages ;
« - en termes de développement des surfaces en agriculture biologique ;
« - en termes d’installation agricole en fixant une trajectoire permettant d’augmenter le nombre d’exploitants agricoles ;
« - en termes de diversification des productions agricoles en priorité pour les cultures pour lesquelles la consommation alimentaire est majoritairement assurée par des produits importés, et de déspécialisation des territoires, notamment via le développement des productions de protéines végétales ;
« - en termes de développement de systèmes d’élevage respectueux du bien-être animal garantissant un accès à un espace de plein air des animaux ;
« - en termes de réduction de la précarité alimentaire et d’accès à une alimentation de qualité.
III. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
la liste des investissements essentiels à la compétitivité et à la résilience de chaque filière. Les financements publics en faveur de l’investissement en agriculture et dans le secteur agroalimentaire
par les mots :
les pratiques agricoles et les systèmes alimentaires qui permettent le plus efficacement de renforcer la compétitivité économique, environnementale, et la performance sociale et sanitaire de l’agriculture afin de réaliser la transition agroécologique. Les financements publics de la politique agricole
La parole est à M. Joël Labbé.

Par cet amendement, il s’agit d’élargir le périmètre du plan quinquennal, en en faisant un outil de planification au service d’une compétitivité prise dans sa définition élargie, qui comprend des dimensions sociale, environnementale et sanitaire.
La prise en compte de ces aspects permettra à ce plan de construire une véritable politique agricole et alimentaire de la transition agroécologique, nécessaire au regard des enjeux environnementaux, de santé, d’emploi et de bien-être animal. Nous en élargissons aussi la gouvernance, qui est, à ce stade, exclusivement agricole, au ministère de la santé et au ministère de l’environnement, mais aussi à une représentation de l’ensemble des modèles agricoles, à la société civile, aux élus locaux et aux citoyens.
Enfin, cet amendement vise à réorienter ce plan, uniquement axé sur l’investissement. À nos yeux, celui-ci ne représente pas l’unique solution et possède des effets pervers, à savoir la surcapitalisation, le surendettement, qui fige les systèmes et empêche les transmissions.
Il s’agit de déterminer les priorités d’accompagnement de projets de territoire, d’innovations sociales, d’accompagnement de pratiques agronomiques vertueuses, de rémunération des services écosystémiques via des paiements pour services environnementaux et agriculture de groupe.
Ce plan prévoit ainsi de définir collectivement des objectifs chiffrés ambitieux, afin d’organiser la nécessaire sortie des pesticides et des engrais azotés, de développer l’agriculture biologique dans des installations agricoles nombreuses.
Pour nous, il s’agit tout simplement de donner un cadre juridique pour définir un véritable plan de transition agricole et alimentaire, que notre groupe appelle de ses vœux.

Cet amendement vise en effet à élargir le plan quinquennal de compétitivité durable et d’adaptation très au-delà de ce que les auteurs de la proposition de loi souhaitaient et probablement très au-delà du possible.
Ce plan comportant un grand nombre d’objectifs, un tel dispositif constituerait une sorte de doublon avec le ministère de l’agriculture et diluerait l’objectif central, à savoir la compétitivité durable. Par ailleurs, il exclut le haut-commissaire, qui ne correspond pas à l’esprit du dispositif prévu.
En outre, je le souligne, cet amendement est d’ores et déjà partiellement satisfait, puisque, à l’issue des travaux en commission, ce plan quinquennal a été élargi, pour prendre justement en compte la problématique de l’adaptation des filières agricoles.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
D’une part, les auteurs de cet amendement prévoient des prérogatives très larges sur un périmètre interministériel, en allant plus loin que ce que j’ai déjà estimé original tout à l’heure. D’autre part, outre la création d’un haut-commissaire à la tête de trois ministères, ils veulent définir l’ensemble de la politique agricole française !
Cet amendement a donc un caractère excessif, même s’il concerne des sujets pour lesquels il convient de penser en termes d’interministérialité.
Le Gouvernement y est donc défavorable. Nous n’avons pas besoin d’instituer un système dépossédant de leurs prérogatives non seulement le ministre de l’agriculture, mais aussi le ministre de la transition écologique et le ministre de la santé.

Personne ne m’ayant demandé de retirer mon amendement, je me garderai bien de le faire !
Monsieur le ministre, il s’agit d’un amendement d’appel… au secours, sur un véritable plan ou trajectoire, dont nous avons besoin.
Vous disiez tout à l’heure qu’on ne peut pas changer de modèle du jour au lendemain. C’est vrai ! Mais, à un moment, on se doit de se donner des objectifs et une trajectoire pour les atteindre.
L’adoption de cet amendement ferait disparaître votre grande solitude, en vous permettant de travailler à égalité avec vos deux collègues chargés de la santé et de l’environnement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 122, présenté par Mme Primas, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
ministre chargé de l’agriculture,
insérer les mots :
prenant en compte les spécificités des territoires ultra-marins,
La parole est à Mme le rapporteur.

Cet amendement vise à indiquer que le plan quinquennal de compétitivité et d’adaptation doit tenir compte des spécificités des territoires ultramarins.
Je rappelle que les secteurs agricole et agroalimentaire représentent dans les outre-mer 60 % des effectifs salariés. Je souhaite donc que ce plan ne se focalise pas uniquement sur l’Hexagone, mais englobe l’ensemble de l’agriculture française.
Par souci de cohérence, j’émettrai un avis favorable. Il s’agit de montrer notre préoccupation à l’égard des territoires ultramarins, car la question de la souveraineté et de la sécurité alimentaire ne s’y pose pas de la même façon qu’ailleurs.
Il est utile de signifier que nous souhaitons relever ces défis absolument immenses, d’autant qu’il s’agit des territoires les plus éloignés de la métropole. Il importe d’avoir un regard particulier et de conduire sans doute des actions spécifiques sur ces questions de compétitivité et de souveraineté, qui se posent dans des termes très différents par rapport à la France hexagonale.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 2 est adopté.

L’amendement n° 86 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Artano et Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mmes Guillotin et Pantel et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les collectivités territoriales établissent des contrats avec les exploitants agricoles de leur territoire pour le paiement pour services environnementaux que ces exploitants génèrent par leur activité.
Ces paiements pour services environnementaux sont financés par le fonds spécial de soutien à la compétitivité des filières agricoles en difficultés prévu à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.
Les modalités d’application de ces contrats pour paiements pour services environnementaux seront fixées par décret.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Cet amendement, présenté par Henri Cabanel, a pour objectif de démocratiser le recours aux paiements pour services environnementaux (PSE), que les exploitants génèrent par leurs activités.
Si ces paiements ont déjà fait l’objet de débats au sein de notre assemblée, notamment lors du rejet en décembre 2018 de la proposition de résolution en faveur de la création de paiements pour services environnementaux rendus par les agriculteurs, il me semble important de rappeler que l’agriculture constitue un maillon l’essentiel dans la stratégie d’atteindre l’objectif de neutralité carbone à l’horizon de 2050.
Nos exploitations agricoles font face à des contraintes climatiques, économiques et conjoncturelles tout en s’exposant à des attentes sociétales de plus en plus fortes en termes de préservation de notre environnement, ainsi que de qualité des produits et des aliments que nous consommons.
Il est en cela nécessaire de repenser certains outils existants pour que nos politiques publiques puissent impulser de réelles mutations.
Par ailleurs, faut-il rappeler que l’agriculture française souffre d’un défaut d’attractivité dû, notamment, à un niveau de rémunération insuffisant de ses exploitants ? Nous faisons face à un défi inédit de renouvellement des générations. Il est désormais tant urgent que nécessaire de diversifier les ressources financières de nos agriculteurs.
Si nous souhaitons une agriculture attractive, innovante, compétitive, durable et souveraine, la restauration et le maintien des écosystèmes doivent devenir une source supplémentaire de revenus et non une contrainte supplémentaire par exploitant.
Ainsi, sur le modèle du principe « pollueur-payeur », selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur, cet amendement a pour objet de démocratiser ce dispositif sur le principe de « dépollueur-bénéficiaire » en se basant sur des critères mesurables de services écosystémiques.

Les paiements pour services environnementaux en agriculture sont des dispositifs qui rémunèrent les agriculteurs pour des actions contribuant à restaurer ou à maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages.
Ces paiements peuvent être réalisés par des entreprises ou des collectivités publiques. Le principe est en réalité similaire à celui du label bas-carbone, dont nous discuterons tout à l’heure à l’article 9.
Le fonds spécial de soutien à la compétitivité agricole est quant à lui destiné à soutenir des filières en difficulté, notamment en finançant la recherche. Ce fonds n’a pas vocation à financer les collectivités ou des entreprises voulant s’engager dans cette démarche.
Cependant, j’entends bien l’argument d’Henri Cabanel et de votre groupe sur la nécessité de massifier les PSE. Nous aurons l’occasion d’aborder de nouveau ce sujet prochainement à l’occasion d’une demande de rapport qui sera formulée un peu plus loin dans la discussion.
Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable.
Le Gouvernement a la même position que la commission.
À mon avis, nous avons encore besoin de creuser la question des paiements pour services environnementaux. C’est une démarche nouvelle. Comme l’a souligné Mme la rapporteure, nous aurons l’occasion d’en parler également à propos du carbone puisqu’il s’agit d’un service environnemental. Il faudra donc penser le système, car il n’est pas très simple de savoir ce qu’est un service environnemental.
Par ailleurs, autre argument de poids devant le Sénat, qui représente les collectivités, il convient d’être attentif à ne pas créer de distorsions. J’entends souvent tel ou tel jeune agriculteur dire qu’il aimerait dépendre de telle ou telle région, qui ne dispose pas des mêmes dispositifs d’aides que la sienne. Le sénateur Laurent Duplomb sait à quoi je fais référence.
Attention à ne pas mettre en place des distorsions de paiements pour services environnementaux entre collectivités. Ayons plutôt à cœur d’avoir une définition des services environnementaux homogène à l’échelon national. Prenons le temps de dialoguer avec les collectivités, si elles le veulent bien, pour penser globalement ce que sont les services environnementaux qu’il s’agisse de biodiversité, de paysages, d’eau, de stockage carbone, etc.
C’est un point qui nécessite davantage de réflexion. L’amendement ne va donc pas dans le bon sens : demande de retrait ou avis défavorable.

En l’absence de M. Cabanel, qui nous écoute très certainement, je maintiens son amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
I. – Le I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’État met en place un fonds spécial de soutien à la compétitivité des filières agricoles en difficultés.
« Ce fonds est géré par le haut-commissaire à la compétitivité des filières agricoles et agro-alimentaires mentionné à l’article L. 611-1 A.
« Un décret en détermine le mode de fonctionnement et les conditions d’éligibilité. »
II et III. –
Supprimés

L’amendement n° 13, présenté par MM. Salmon, Labbé, Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :
I.- Alinéa 2
Après le mot :
compétitivité
insérer les mots :
économique et environnementale, et à la performance sociale et sanitaire
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
le haut-commissaire à la compétitivité des filières agricoles et agro-alimentaires mentionné à l’article L. 611-1 A
par les mots :
par le ministère chargé de l’agriculture en concertation avec les ministères chargés de l’environnement et de la santé
III. – Après l’alinéa 3
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce fonds est orienté vers des solutions de transition agroécologique, et prioritairement vers l’accompagnement à la mise en place de solutions systémiques qui permettent la sortie ou l’absence d’usage de produits phytosanitaires et engrais de synthèse, ou de systèmes respectueux du bien-être animal.
« Il est doté d’outils spécifiques et de financements dédiés pour le soutien aux filières en agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13.
« Les montants proposés via ce fonds sont mis en œuvre de façon à être accessibles à toutes les exploitations agricoles quelle que soit leur taille, et sont plafonnés afin de ne pas encourager la concentration ou l’agrandissement excessif des exploitations.
La parole est à M. Daniel Salmon.

Cet amendement vise à réorienter le fonds prévu à l’article 3, axé presque exclusivement sur la recherche d’une compétitivité-prix via l’investissement, ce qui n’est pas souhaitable, vers une politique agricole prenant en compte une véritable définition de la compétitivité dans ses dimensions économique, sociale, environnementale et sanitaire.
Il tend ainsi à redéfinir l’objectif du fonds, à associer à sa gouvernance les ministères de la santé et de l’environnement et à le réorienter vers la transition agroécologique des filières en difficulté et vers le soutien à l’agriculture biologique, qui aujourd’hui n’entre pas dans les dispositifs existants de soutien aux filières.
Dans le même ordre d’idée, nous insistons pour que ces financements soient accessibles également aux petites fermes. Celles-ci sont trop souvent exclues des dispositifs de soutien.
Nous proposons également que les montants d’aide proposés soient plafonnés, afin de ne pas encourager l’agrandissement des exploitations. J’ai entendu tout à l’heure l’argument répété depuis cinquante ans : nos fermes – pardon, nos « exploitations », puisque dorénavant on exploite…
Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.

– sont trop petites. On est toujours dans ce rêve américain du toujours plus grand, avec plus de mécanisation.
M. Jean-Marc Boyer proteste.

Il convient, selon moi, d’orienter ces fonds vers une agriculture intensive en emplois et respectueuse de l’environnement, et non forcément vers des exploitations plus grandes et faisant la part belle à toujours plus de mécanisation.

Cet amendement vise à réorienter radicalement l’objectif du fonds institué par la proposition de loi, qui est de soutenir prioritairement les filières en déficit de compétitivité.
Aucun type d’agriculture n’est visé par ce fonds, ce qui signifie que l’agriculture biologique pourrait tout à fait bénéficier des financements disponibles.
De même, aucun type d’exploitation n’est visé en particulier, ce qui signifie là aussi que les petites exploitations ne sont pas exclues du dispositif.
A contrario, à la lecture de l’amendement, il apparaît que c’est vers un certain type d’agriculture que le fonds serait réorienté, ce qui n’est pas souhaitable.
Chaque agriculteur et chaque filière doivent être soutenus, qu’il soit en agriculture conventionnelle ou en agriculture biologique.
Par ailleurs, je laisse le soin au Gouvernement de rappeler l’ensemble des fonds et des soutiens qui bénéficient à la filière biologique.
Je propose de maintenir le périmètre de l’article 3 tel qu’il est issu des travaux de notre commission. Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
Un certain nombre de dispositifs existent sur la question du bio, qu’ils soient fiscaux ou qu’ils relèvent de la politique agricole commune (PAC) et autres. Je le souligne au passage, nous avons besoin d’améliorer la compétitivité – ce n’est pas un gros mot pour moi –, y compris du bio. L’objectif de ce fonds est donc aussi d’aller dans ce sens.
À mes yeux, la priorité est à la fois d’améliorer la compétitivité de toutes les filières, sans exclusive, et de couvrir la variété des demandes ou des besoins des consommateurs. J’annoncerai demain un certain nombre de mesures sur le bio, qui sont en dehors du registre, car nous avons besoin de conforter la filière bio, y compris dans sa part de compétitivité : sur les étals, c’est quand même ça que regardent les consommateurs ! La question du prix, que vous avez vous-même évoquée, a donc son importance.
Par ailleurs, sortons des caricatures : le modèle américain n’a rien à voir avec le modèle français. La taille moyenne des exploitations en France est de 66 hectares. Nul besoin de franchir l’Atlantique ou le Pacifique ; il suffit de passer les frontières avec nos voisins les plus proches. Vous verrez alors la taille des exploitations !
Nous souhaitons évidemment tous défendre notre modèle agricole, qui n’est pas le modèle industriel que certains caricaturent. Si on pouvait tous l’admettre, cela contribuerait à l’attractivité du secteur, y compris vis-à-vis des jeunes qui souhaitent s’installer. Reconnaissons donc tous que notre agriculture est plutôt exemplaire et cessons de forcer le trait.
Par ailleurs, il existe de petites structures agricoles, car la valeur ajoutée est importante. Mais d’autres types de productions nécessitent des exploitations de plus grande taille, y compris en élevage extensif. Acceptons-le et arrêtons de vouloir mettre les gens dans des cases. Si, pour vous, 66 hectares, en moyenne, c’est un modèle industriel et intensif, nous ne tomberons jamais d’accord.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Je voudrais juste revenir sur la genèse de cet article, car nous nous en éloignons.
Il s’agit ici de créer un fonds spécial pour soutenir les petites filières que nous avons connues en France et qui ont fait parfois le bonheur économique et l’équilibre des exploitations, notamment des plus petites d’entre elles, souvent diversifiées. Celles-ci commencent à disparaître en raison du dogme que vous développez, monsieur Salmon.
Je citerai l’exemple de la moutarde. Au début de la guerre en Ukraine, nous nous sommes tous offusqués de ne plus trouver de moutarde dans les magasins. Pourtant, les consommateurs cherchaient de la moutarde en provenance d’où ? De Dijon ! Et Dijon n’est pas en Ukraine !
Sourires.

Mais, année après année, à cause de votre dogme, on a pris toutes les mesures possibles pour empêcher la culture de la moutarde en Côte-d’Or.
M. Serge Babary opine. – MM. Daniel Salmon et M. Joël Labbé protestent.

Les agriculteurs s’en sont donc détournés et ont arrêté de produire de la moutarde en France. Voilà pourquoi nous nous sommes jetés dans les bras des Canadiens d’abord, puis des Ukrainiens, pour leur acheter cette même graine de moutarde. Le bon sens n’aurait-il pas plutôt été de moins interdire et de laisser la possibilité aux agriculteurs de faire leur travail ? Nous aurions ainsi toujours trouvé de la moutarde de Dijon française !
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC. – M. Daniel Chasseing applaudit également.

Concernant l’agrandissement, il suffit de regarder les trajectoires. Depuis des décennies, les tailles des exploitations augmentent.

Les 66 hectares sont une moyenne. Or les moyennes cachent beaucoup de diversité. Il faut donc regarder les choses dans le détail.
Vous évoquez la compétitivité. Or vous savez qu’il existe une certaine relativité dans les prix. Vous dites que le bio devrait être compétitif. Mais il l’est déjà, à condition que l’on fasse payer à l’autre agriculture ses externalités négatives !
En effet, le bio paraît plus cher de prime abord, puisque c’est le contribuable et la collectivité qui payent in fine les externalités négatives, tous les problèmes d’eau et les problèmes sanitaires liés à un type d’agriculture. Mais il existe une relativité de la compétitivité ; j’aimerais bien qu’on l’admette ici. Il me semble en effet fondamental de ne pas toujours externaliser les coûts vers le contribuable.

En 2014, nous avions demandé au ministre Le Foll une étude pour évaluer les externalités négatives. Cette étude, réalisée partiellement par l’Institut national de la recherche agronomique (Inra) et l’Institut technique de l’agriculture biologique (Itab), a été reprise.
La réhabilitation de la qualité de l’eau polluée par les pesticides et les nitrates est de l’ordre de l’ordre de 1 milliard d’euros à 1, 5 milliard d’euros chaque année. On sait aussi que les pollinisateurs, qui ont un rôle économique, vont mal en raison d’un certain type d’agriculture. Une fois que nous disposerons de l’ensemble des chiffres, comme le soulignait à juste titre Daniel Salmon, il apparaîtra clairement que les produits bio coûtent moins cher que les produits conventionnels.
M. Laurent Duplomb s ’ exclame.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 104, présenté par MM. Labbé, Salmon, Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À cette fin, ce fonds permet la mise en place d’une prise en charge des pertes liées à la destruction ou à la dévaluation de cultures consécutives à la détection de résidus de produits phytosanitaires sur ces cultures, lorsqu’une indemnisation par l’assurance responsabilité civile ne peut pas être sollicitée, faute de responsable identifiable.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Joël Labbé.

Cet amendement vise à alerter le Gouvernement sur une problématique aujourd’hui complètement orpheline des politiques publiques.
Chaque année, des centaines de milliers de tonnes de productions agricoles sont détruites ou déclassées du fait de contaminations phytosanitaires dues à l’épandage d’un pesticide sur une exploitation voisine, et ce sans qu’aucune indemnisation du producteur concerné soit possible.
Rappelons que certains produits phytosanitaires, notamment l’herbicide prosulfocarbe, ont une volatilité sur des kilomètres. Ainsi, bien souvent, dans le cadre de ces contaminations, le responsable ne peut pas être identifié.
Or le régime de la responsabilité civile, qui implique que la personne responsable de la contamination soit identifiée, est le seul dispositif permettant à ce jour une indemnisation. Cela laisse sans solution les agriculteurs, notamment les producteurs bio, qui sont particulièrement concernés. Cela pénalise des filières tout entières, particulièrement la filière du sarrasin bio, en cours de structuration.
Nos producteurs bio s’engagent pour mettre en œuvre des pratiques sans pesticides, mais ils subissent à leurs frais des déclassements et des destructions de production du fait de l’usage autour d’eux de produits phytosanitaires
Les producteurs bio ne sont pas les seuls concernés. L’ensemble de la filière cidricole est également touchée par cette problématique.
Cette situation, qui génère des difficultés humaines et économiques, doit cesser. C’est pourquoi cet amendement vise à mettre en place un système d’indemnisation pour les producteurs victimes d’une contamination par un produit phytosanitaire dont le responsable ne peut pas être identifié.

La question que cet amendement soulève relève plutôt de la politique d’indemnisation des assureurs, ainsi que du bon dialogue entre les agriculteurs eux-mêmes en cas de contamination d’une parcelle bio liée à l’utilisation d’un produit.
Par ailleurs, cette disposition est un peu décalée par rapport à la vocation du fonds, mis en place pour soutenir les filières, notamment en matière de recherche.
Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.
Il existe sur les questions de compétitivité – j’ai oublié d’en parler tout à l’heure – un certain nombre de dispositifs pour accompagner les filières. Les mesures prises sur les fruits et légumes viennent également encourager la filière bio sur un certain nombre de secteurs.
Le problème que vous soulevez est bien réel, monsieur le sénateur. Pour autant, il ne relève pas de cet article 3, mais dépend plutôt du système assurantiel, des pratiques entre agriculteurs et du projet de loi de finances. Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Les producteurs ont tenté de se tourner vers leurs assureurs. En vain. Ces produits sont volatils, ils peuvent avoir été utilisés à 3 kilomètres de l’exploitation. Au fond, il faudrait tout simplement interdire cet herbicide prosulfocarbe. Monsieur le ministre, ne pourriez-vous pas demander à l’Anses de revoir leur autorisation de mise sur le marché ?
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 29 rectifié, présenté par Mme Préville, MM. Tissot, Montaugé et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla et Redon-Sarrazy, Mme Bonnefoy, M. J. Bigot, Mme Monier, MM. Stanzione, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il veille à ce que la proportion de bénéficiaires de chaque sexe ne soit pas inférieure à 30 %.
La parole est à Mme Martine Filleul.

Cet amendement vise à faire en sorte que la gestion du fonds spécial de soutien à la compétitivité des filières agricoles en difficulté intègre un objectif de parité.
En effet, de nombreuses femmes agricultrices rencontrent des difficultés pour obtenir un crédit bancaire, soit pour lancer leur exploitation agricole, soit pour réaliser de nouveaux investissements.
Peu représentées, moins payées, parfois même pas comptées, les femmes sont les grandes oubliées de nos politiques agricoles.
Le ministère de l’agriculture estime que les femmes représentent 30 % des actifs agricoles en France. Plus nombreuses dans les petites structures, les femmes sont aussi plus diplômées et plus âgées que les hommes. Pourtant, leurs revenus sont quasiment un tiers plus faibles et leur retraite atteint péniblement 570 euros par mois.
Dans l’agriculture, les femmes font face à des inégalités multiples : revenu, accès au foncier, à l’investissement, aux aides et aux formations, charges domestiques. Les politiques sectorielles n’enrayent pas, voire renforcent ces inégalités de genre. La très faible disponibilité des données genrées est d’ailleurs un frein au traitement des inégalités.
Entre autres bâtons dans les roues, les agricultrices bénéficient de prêts bancaires plus faibles, de moins d’aides à l’installation et elles sont moins représentées dans les syndicats professionnels.
À l’instar de dispositifs existant déjà dans d’autres secteurs ou à travers l’action de la Banque publique d’investissement, il convient d’instaurer dans le fonds spécial de soutien à la compétitivité des filières agricoles une proportion minimale de bénéficiaires par sexe.

Je comprends et partage entièrement l’objectif de féminiser l’agriculture et de permettre aux exploitantes d’avoir accès aux mêmes dispositifs que les exploitants.
Pour autant, le fonds de soutien pourrait venir en aide à des exploitations, mais aussi et surtout à des filières, par l’intermédiaire de financements aux instituts techniques, par exemple ou encore d’appels à projets.
Il semble difficile, pour ne pas dire impossible, de faire la liste des potentiels bénéficiaires d’une mesure de soutien pour s’assurer de la juste représentation des femmes.
Par exemple, un soutien à la recherche de solutions pour lutter contre la drosophilia suzukii, qui infecte la cerise, sera un soutien non pas à un exploitant, mais à une filière. Il est donc impossible de calculer le nombre de femmes bénéficiant de ce soutien.
Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
Madame la sénatrice, vous soulevez ici deux difficultés, mais votre amendement ne vient pas répondre à la question principale, qui est celle d’une plus grande féminisation de la profession agricole.
Cet article vise à conforter la compétitivité des filières. Comme l’a très bien souligné Mme la rapporteure, ce n’est pas une question de genre ; c’est une question de filière.
Cela n’obère pas ce que vous dites par ailleurs. Mais vous proposez ici – c’est original, alors qu’il s’agit d’un texte visant à supprimer les surtranspositions – une nouvelle transposition dont on ne saurait pas comment la mettre en œuvre. En revanche, je partage votre sentiment, mais ça n’est pas qu’un problème de genre : c’est aussi un problème d’origine pour des jeunes qui veulent s’installer. La question du portage du foncier et des capitaux, à laquelle nous travaillons, est souvent un frein, notamment pour les femmes, à l’accès au statut d’exploitants agricoles.
Pour autant, votre amendement ne répond pas à ce problème. Il me semble que nous devrions envisager autrement la question de la compétitivité, notamment sous l’angle de l’accès aux moyens de production, au foncier, aux capitaux, aux sièges d’exploitation : c’est comme cela que l’on arrivera à féminiser cette filière.
Reconnaissons aussi que l’enseignement agricole est aujourd’hui en majorité féminin. De nombreuses femmes ou jeunes femmes y sont inscrites.
À terme, compte tenu du fait qu’une majorité de candidats ne sont pas issus du milieu agricole, la féminisation fera son œuvre. Notre seul travail sera de la favoriser.
Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.

Je suis choqué. Vraiment.
Nous sommes le seul pays en Europe où une femme peut devenir agricultrice au même titre que son mari. C’est comme cela que l’on a créé les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), parce qu’à l’époque, la constitution de groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec) n’était pas autorisée entre mari et femme. La France est le seul pays qui a fait évoluer le statut des groupements agricoles, puisque, dorénavant, la création d’un Gaec entre époux est possible.
Quand un dossier est examiné au niveau financier, comme vous l’évoquez dans votre amendement, jamais le sexe de la personne n’est pris en compte. Seul compte le projet d’installation et d’investissement !
Si je m’emporte quelque peu, c’est que de tels propos dissuadent des femmes et des hommes de se lancer dans la profession agricole. Personne n’a jamais été discriminé en fonction de son sexe. C’est toujours le projet qui l’a emporté. De nombreuses professions devraient s’inspirer de ce qui a été fait dans le monde agricole !
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC. – Mme Françoise Gatel et M. Daniel Chasseing applaudissent également.

Mme Marie-Claude Varaillas. Nous avons été huit membres de la délégation aux droits des femmes à rendre un rapport sur la situation des femmes dans la ruralité. À cette occasion, nous avons auditionné de nombreuses agricultrices. C’est un fait ; leurs témoignages sont concordants : elles ont des difficultés pour obtenir des emprunts. Mes collègues, qui n’étaient pas forcément de la même obédience que moi, ont partagé le même constat !
Mmes Martine Filleul et Émilienne Poumirol applaudissent. – Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.

Un tel débat est surprenant : on stigmatise les femmes à travers la profession agricole.

Du peu d’expérience que j’ai pu avoir comme enseignant dans l’enseignement agricole, j’ai constaté que les femmes étaient nombreuses à vouloir s’installer. Elles venaient souvent d’une famille d’agriculteurs. Lorsqu’elles demandaient des aides à l’installation, leur dossier était examiné en fonction non pas de leur sexe, mais de leur projet. Quand le projet tient la route, les femmes ont droit aux mêmes aides que les hommes.
En revanche, à l’heure actuelle, nombre de jeunes inscrits dans l’enseignement agricole ne sont pas issus de familles d’agriculteurs, comme c’était le cas voilà dix ans ou vingt ans. À peine 15 % à 20 % des élèves ont aujourd’hui des parents agriculteurs, avec un projet de transmission. Or s’ils présentent un projet sans avoir les moyens financiers de subvenir au fonctionnement de leur exploitation, ils vont rencontrer des difficultés. Il convient donc de trouver des solutions.
Mais, encore une fois, le critère, ce n’est pas le sexe de la personne ; c’est le projet.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 3 est adopté.

L’amendement n° 30 rectifié, présenté par MM. Montaugé, Tissot et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla et Redon-Sarrazy, Mme Bonnefoy, M. J. Bigot, Mmes Monier et Préville, MM. Stanzione, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant une définition législative des zones intermédiaires à faible potentiel agronomique. Sur la base du rapport du Conseil général de l’alimentation, l’agriculture et des espaces ruraux n° 18065 de 2019 éventuellement actualisé, le rapport précisera les enjeux, externalités et bénéfices d’une telle définition pour les territoires concernés, et dressera les conséquences potentielles d’un dispositif d’accompagnement financier et en ingénierie pour les agriculteurs de zones intermédiaires.
La parole est à M. Franck Montaugé.

Cet amendement vise à demander la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur la question des zones à faible potentiel agronomique et soumises à des conditions pédoclimatiques défavorables, appelées aussi zones intermédiaires. Les zones de piémont, nombreuses en France, sont concernées.
Le modèle économique des exploitations agricoles en zone intermédiaire est aujourd’hui à bout de souffle. Depuis les années 1980, ces exploitations n’ont cessé de s’agrandir – c’est un constat, et non un jugement de valeur – et de se spécialiser toujours davantage en grandes cultures.
Entre 1988 et 2010, le nombre total d’exploitations a été divisé par 2, le nombre d’exploitations avec vaches laitières a été divisé par 5 et le nombre de vaches allaitantes a été divisé par 2, 5.
Cette hyperspécialisation soulève de nombreuses difficultés.
Ces exploitations ont ainsi un problème structurel de rentabilité, avec des productions à faible valeur ajoutée. Leur forte dépendance aux marchés mondiaux, à cause de la monoculture, les rend très sensibles aux aléas économiques et peu résilientes.
Parallèlement, elles sont très dépendantes des aides de la PAC, qui ne suffisent plus à leur survie. L’hétérogénéité agronomique et pédoclimatique de la surface agricole utile (SAU) française justifie la proposition et la mise en œuvre de dispositions de politique agricole nationale de nature à soutenir de façon ciblée les territoires de plus en plus en difficulté au regard de critères de performances agroenvironnementales.
Sur certains de ces territoires, des mesures agroenvironnementales et climatiques (Maec) spécifiques apportent une première réponse, mais les écarts de performance et de rémunération observés restent très élevés. Sans préjudice des apports de la politique agricole commune, le rapport que nous demandons pourrait proposer une définition de ce que sont les zones intermédiaires, ainsi que des politiques territoriales pour rétablir l’équité entre terroirs français dans le sens que vous avez indiqué, monsieur le ministre, lors de la discussion générale.

Mon cher collègue, je connais votre engagement pour ces zones intermédiaires à faible potentiel. Cependant, vous savez que nous n’aimons pas beaucoup les rapports ; le texte en propose déjà deux, dans des domaines qui nous semblent essentiels.
La problématique du soutien à l’agriculture en zones intermédiaires à faible potentiel est très documentée dans un rapport du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) de janvier 2019, et est d’ores et déjà assez largement traitée dans le plan stratégique national (PSN) français, qui ne fait pas moins de 975 pages. Ce sujet est donc important, mais il est connu, et je crains qu’un rapport ne suffise pas à régler tous les problèmes. Différentes Maec ont été adaptées, mais je préférerais que nous passions de la parole à l’action. Aussi, je laisse la parole au ministre, non sans avoir donné un avis défavorable au nom de la commission.
Vous avez raison, madame la rapporteure, ce sujet est d’importance, et je ne dis pas cela pour éluder la question. Il y a des dispositifs en cours de déploiement. Au fond, votre rapport a vocation à déboucher sur une base législative pour un zonage.
En agriculture, on sait ce que c’est…
Aussi, je nous souhaite bon courage pour définir dans la loi ce qu’est une zone intermédiaire. Vous savez très bien qu’une telle définition va ouvrir partout la voie à des demandes reconventionnelles, et ce pour des situations très diverses. Les difficultés sont ainsi de nature très différente dans le Gers et dans le Berry, au sud de ma région.
Il peut y avoir des questions d’accès à l’eau, de potentiel agronomique, de modèle agricole. Bref, s’enfermer dans une définition législative contribue à une forme de rigidification. C’est un peu un mal français.
À mon sens, on a plutôt besoin de regarder territoire par territoire les mesures qui seraient utiles. Vous avez évoqué les Maec, qui peuvent être une première réponse, mais il s’agit d’outils de compensation. Or nous avons besoin aussi de penser la transition de ces modèles, et c’est tout l’objet du travail que nous sommes appelés à faire.
La question n’est pas tant de compenser leurs difficultés que d’imaginer le modèle sur lequel ces types d’agriculture, dans ces zones intermédiaires, peuvent fonctionner.
Je rejoins assez volontiers ce qu’a dit Mme la rapporteure. Au-delà de la solution type Maec, quelles sont les mesures de soutien que nous pouvons apporter, sans nous enfermer dans des zonages ?
Il faut avoir à l’esprit que la contrainte climatique n’est pas la même aujourd’hui que ce qu’elle était voilà dix ans et que ce qu’elle sera dans dix ans. Je le répète, nous avons besoin d’engager les agriculteurs dans ces transitions. C’est vrai que, dans certains cas, la réponse a pu être l’agrandissement, alors que l’on considère aujourd’hui que c’est de nature à aggraver la situation économique. Il faut le dire avec lucidité. Parfois c’est la réponse ; parfois cela ne l’est pas. C’est mon côté…
M. Marc Fesneau, ministre. Non, je ne suis pas caricatural, monsieur Salmon.
Sourires.
C’est une demande de retrait, faute de quoi l’avis sera défavorable.

Je vous ai tous les deux écoutés attentivement. D’une certaine manière, je rejoins vos arguments, mais je maintiens quand même mon amendement.
Monsieur le ministre, c’est très bien de manifester des intentions, surtout quand elles peuvent être largement partagées. Cependant, je constate que, lors de la discussion de la PAC et de l’élaboration du PSN, ce sujet n’a pas été abordé, en tout cas pas suffisamment. C’est en fait la question de la transition, que vous appelez de vos vœux, et sur laquelle nous sommes tous d’accord.
Nous allons encore perdre des années pour venir en aide à ces zones, à moins que vous ne proposiez des actions spécifiques dans le cadre du PSN. Les Maec apportent du positif dans certains terroirs, mais ils ne sont absolument pas à la hauteur des enjeux de la transition, qui nécessitent une action rapide et efficace.
Pour toutes ces raisons, je le répète, je maintiens cet amendement, même si je comprends les arguments invoqués, notamment ceux de Mme la rapporteure.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

TITRE II
RELANCER LA CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ DE LA FERME FRANCE PAR L’INVESTISSEMENT ET LE PRODUIRE LOCAL
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 221-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A, du livret de développement durable et solidaire régi par l’article L. 221-27 et du livre Agri régi par l’article L. 221-28 par les établissements distribuant l’un ou l’autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu au même article L. 221-28. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « ou le livret de développement durable et solidaire » sont remplacés par les mots : «, le livret de développement durable et solidaire ou le livret Agri » ;
– après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Elles sont employées, dans le cas du livret Agri, au financement des investissements matériels et immatériels des structures agricoles et agro-alimentaires, notamment pour l’amélioration de leur compétitivité, leur mécanisation, la réduction de leur empreinte climatique et l’atténuation des conséquences du changement climatique. Elles sont également employées dans le soutien à l’accès au foncier agricole des jeunes agriculteurs. » ;
– à la seconde phrase, les mots : « et les livrets de développement durable et solidaire » sont remplacés par les mots : «, les livrets de développement durable et solidaire et les livrets Agri » ;
c) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « ou le livret de développement durable et solidaire » sont remplacés par les mots : «, le livret de développement durable et solidaire ou le livret Agri » ;
2° Le I de l’article L. 221-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont employées en priorité au financement des investissements agricoles et agro-alimentaires dans le cadre du livret Agri. » ;
3° Après la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Le livret Agri
« Art. L. 221 -28. – Le livret Agri est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et les organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret sont employées conformément à l’article L. 221-5.
« Les versements effectués sur un livret Agri ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par voie réglementaire.
« Il ne peut être ouvert qu’un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
« Les modalités d’ouverture et de fonctionnement du livret Agri ainsi que la liste des investissements dans le secteur agricole et agroalimentaire auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret sont fixées par voie réglementaire.
« Les opérations relatives au livret Agri sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances. »

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 105, présenté par MM. Labbé, Salmon, Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 4, 6, 8, 9, 13, 15 et 18
Remplacer toutes les occurrences du mot :
Agri
par le mot :
Agroécologie
II. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
Agri, au financement des investissements matériels et immatériels des structures agricoles et agro-alimentaires, notamment pour l’amélioration de leur compétitivité, leur mécanisation, la réduction de leur empreinte climatique et l’atténuation des conséquences du changement climatique. Elles sont également employées dans le soutien à l’accès au foncier agricole des jeunes agriculteurs.
par les mots :
Agroécologie, au soutien à l’installation agricole en agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, ou dans un système agroécologique, défini selon des critères précisés par décret.
III. – Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 17
Remplacer les mots :
Agri ainsi que la liste des investissements dans le secteur agricole et agroalimentaire
par les mots :
Agroécologie ainsi que le cahier des charges encadrant les projets d’installations en agriculture biologique ou en agroécologie
La parole est à M. Joël Labbé.

Utiliser l’épargne pour soutenir l’agriculture est une bonne idée, mais ce livret Agri ne nous convient pas. Les subventions à l’investissement en agriculture sont déjà massives, entre France Relance, France 2030, plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles (PCAE) et suramortissement. Selon la Cour des comptes, ces subventions sont beaucoup trop importantes et freinent l’installation de nouveaux agriculteurs.
Ces mécanismes peuvent aussi conduire au surendettement et à l’agrandissement excessif des exploitations, un phénomène, hélas ! bien trop courant en agriculture.
De plus, ces incitations à l’investissement sont majoritairement orientées vers une forme d’industrialisation de l’agriculture, à rebours de la nécessaire prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux, mais aussi des attentes de nos concitoyens.
Or l’on nous propose, avec cet article, de mettre l’épargne des Français au service de cette industrialisation de l’agriculture ! Quant à nous, nous proposons de mieux cibler ce dispositif et de rebaptiser ce livret « livret A », A pour agroécologie. Il viendrait financer uniquement l’installation dans des systèmes en agroécologie ou en bio, avec un encadrement par un cahier des charges. Nous ne souhaitons en aucun cas venir ajouter une incitation de plus pour les agriculteurs à surinvestir au détriment de la viabilité économique de leur ferme et de la transition agroécologique.

L’amendement n° 31 rectifié, présenté par MM. Tissot, Montaugé et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Michau, Pla et Redon-Sarrazy, Mme Bonnefoy, M. J. Bigot, Mmes Monier et Préville, MM. Stanzione, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Après les mots :
structures agricoles et agro-alimentaires
insérer les mots :
dont la production bénéficie de signes ou mentions prévus à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime ou est issue de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91,
La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy.

Cet article 4 vise à remettre l’ouvrage du livret agricole sur le métier.
En effet, la création d’un livret Agri n’est pas une proposition nouvelle puisqu’elle a déjà été évoquée par le passé dans plusieurs textes agricoles, sans pour autant aboutir.
En 2015 et en 2016 avait ainsi été créé par le Sénat un livret vert, dans le cadre d’une proposition de loi portant sur la compétitivité agricole.
Cette proposition a toujours été rejetée in fine pour divers motifs.
Je tiens d’ailleurs à rappeler à mes collègues du groupe Les Républicains qu’en 2015, lors de l’examen de ce texte, c’est bien l’un de vos anciens collègues parlementaires, Antoine Herth, alors rapporteur à l’Assemblée nationale et membre du groupe UMP, qui s’interrogeait sur l’utilité d’une telle mesure. Il considérait alors que l’épargne des Français n’était pas extensible et que le fléchage de l’épargne sur ce livret ne se ferait qu’au détriment d’autres produits d’épargne.
En tout état de cause, si nous nous interrogeons également sur la pertinence d’un tel outil, nous proposons quand même, dans un esprit constructif, que les ressources collectées par les établissements distribuant le livret Agri soient employées au financement des investissements des structures agricoles et agroalimentaires sous signe de qualité ou en agriculture biologique.
Nous estimons en effet que ce livret, s’il venait à voir le jour, devrait accompagner la transition vers l’agroécologie et le soutien aux productions de qualité bénéficiant d’un signe ou d’une mention reconnue.

L’amendement n° 58, présenté par M. Gay, Mmes Varaillas, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Supprimer les mots :
l’amélioration de leur compétitivité, leur mécanisation,
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.

Avec ce livret Agri, vous souhaitez réorienter l’épargne populaire vers l’agriculture afin d’en améliorer la compétitivité, voire la mécanisation. Nous l’avons bien compris.
De notre point de vue, ce livret doit permettre de financer la transition de notre modèle agricole vers une agriculture durable et permettre de faire face au changement climatique. C’est l’urgence à laquelle nous devons tous faire face.
Comme le souligne le rapport de la commission, l’agriculture souffre non pas d’une insuffisance majeure de financement, les encours d’emprunt progressant d’année en année, mais du surendettement de nombreuses exploitations, ce qui fragilise l’installation des agriculteurs. Or ce surendettement est parfois dû à un suréquipement.
Si l’aide à l’installation des agriculteurs est une bonne chose, il n’en demeure pas moins que le vrai problème reste le renchérissement du coût du foncier. Or le risque est grand de voir ce livret Agri accompagner l’augmentation du coût du foncier, alors que nous avons plutôt besoin d’encadrement et de régulation pour lutter contre la pression de plus en plus forte de la part d’investisseurs parfois étrangers ou n’ayant rien à voir avec l’agriculture.
Enfin, comme le rappelle le réseau Solidarité Paysans, tout pousse les agriculteurs à investir. Les revues et salons spécialisés valorisent à outrance la technologie, signe de modernité, de performance, mais aussi d’appartenance à une profession.
M. Joël Labbé acquiesce.

Sur le plan fiscal, les agriculteurs sont encouragés à investir pour payer moins d’impôts et moins de cotisations sociales. Or le surinvestissement peut rendre une exploitation vulnérable et devenir un frein pour la transmission.

C’est pourquoi nous pensons que, tel qu’il est rédigé, cet article 4 va à rebours de la nécessité de redonner de l’autonomie aux fermes et de limiter les dépendances à l’égard du système bancaire.

Je ne résiste pas à l’envie de rendre hommage à la proposition de loi de notre ancien collègue Jean-Claude Lenoir, à l’origine de cette idée de création d’un livret agricole ayant pour but non pas de conduire au surinvestissement, mais de créer ce lien perdu entre les Français et leur agriculture.
Ces amendements, identiques dans leur finalité, mais différents dans leur forme, ont pour but de réorienter un livret Agri revu à la baisse soit vers l’agriculture biologique ou en agroécologie – c’est l’amendement de M. Labbé –, soit vers les exploitations sous signe de qualité ou en bio – c’est l’amendement de M. Redon-Sarrazy. C’est en contradiction avec l’objectif général du texte d’aider de façon indifférenciée l’ensemble des agriculteurs, en évitant d’opposer une fois de plus les agricultures les unes aux autres.
Je vous fais remarquer que nous avons ajouté dans les investissements éligibles les investissements immatériels, qui sont trop souvent oubliés, alors qu’ils permettent justement d’éviter des mécanisations trop poussées en allant vers des agricultures de précision.
Nous avons de surcroît rendu éligible l’accès au foncier agricole pour les jeunes agriculteurs. Je n’imagine pas en priver ceux qui seraient en conventionnel. Ce serait tout de même curieux…
Enfin, l’amendement de Mme Varaillas tend à faire disparaître le mot « compétitivité » de l’article, ce qui serait pour le moins incongru si l’on considère le titre de cette proposition de loi.
Vous l’aurez compris, l’avis est défavorable sur ces trois amendements.
Je veux en préambule redire l’intérêt que nous portons à cet article 4, même s’il y a encore du travail à faire.
À mes yeux, il a deux vertus.
D’abord, il permet de flécher l’épargne des Français vers l’agriculture et donc d’essayer d’améliorer la compétitivité. Tel est d’ailleurs l’objet plus large de cette proposition de loi.
Ensuite, dans l’esprit du travail que nous menons sur le pacte, il a l’immense mérite de tenter de mieux connecter la société avec l’agriculture. C’est une question de dialogue entre les Français et le monde agricole : l’épargne des Français doit servir l’agriculture.
J’y insiste, cet article 4 nous paraît intéressant, et ce débat se poursuivra dans le cadre de la loi d’orientation. Ces deux éléments, compétitivité et dialogue entre la société et ses agriculteurs, remontent beaucoup de nos échanges en région et au niveau national.
Par ailleurs, il ressort des trois amendements que la nature de ce lien que je viens d’évoquer n’est pas la même pour tous. Pour les uns, c’est le bio ; pour les autres, ce sont les circuits courts et les signes de qualité ; pour les troisièmes, c’est la question de l’investissement. Cela prouve que l’on a besoin de continuer à travailler sur ces sujets-là et de mieux qualifier les choses. C’est la raison pour laquelle je sollicite le retrait des trois amendements, faute de quoi l’avis sera défavorable.
C’est vrai, il faut envisager ces systèmes d’épargne en pensant à la transition. Qu’est-ce qui permet la transition ? On ne peut pas vouloir celle-ci et ne pas s’en donner les moyens. Cependant, ces trois amendements ne correspondent pas tout à fait à l’idée qu’on peut se faire de la compétitivité. Il y a aussi la question des jeunes ou du surinvestissement, qu’a évoqué Mme Varaillas. Sur ce dernier sujet, il faudrait poser plus globalement la question de la fiscalité. Quels sont les dispositifs fiscaux qui encouragent la transition et permettent de répondre aux inquiétudes de M. Montaugé sur les zones intermédiaires ? L’article 4 a vocation à favoriser le portage de capitaux plus que le surinvestissement, à faire en sorte que le foncier soit plus accessible aux jeunes, sans considération du modèle dans lequel ils souhaitent s’installer. N’oublions pas que le sujet principal, c’est le renouvellement des générations d’agriculteurs.
Pour conclure, je le redis, je suis favorable à l’idée de travailler, dans le prolongement de cet article 4, sur le sujet de la transition.

Cet article a une vocation très large, comme M. le ministre vient de le dire.
Nous souhaitons d’abord recomposer le lien que l’on n’aurait jamais dû perdre entre les Français et leur agriculture. Cette distanciation ne vaut pas partout. Nous sommes allés en Italie et nous avons vu la différence : aujourd’hui, les Italiens sont 57 millions d’ambassadeurs des produits italiens ; en France, il y a 30 millions de procureurs de l’agriculture française !
Les messages qui viennent de certaines travées, notamment de celles du groupe communiste, sont d’arrière-garde. Aujourd’hui, il n’y a plus d’agriculteurs qui investissent pour le plaisir d’investir ! Le suramortissement constitue certes une incitation fiscale, mais, dans les faits, il n’y a plus une exploitation qui n’achète pas dans le cadre d’une coopérative d’utilisation de matériel agricole (Cuma). Les agriculteurs se regroupent pour acheter du matériel, car l’évolution des prix fait qu’ils ne peuvent plus se payer le luxe d’acheter un tracteur pour le plaisir de s’acheter un tracteur ! Il y a dix ans, pour changer trois tracteurs sur mon exploitation, je devais payer 80 000 euros de soulte entre les anciens et les nouveaux ; aujourd’hui, c’est 240 000 euros ! Pensez-vous que les agriculteurs vont acheter des tracteurs simplement pour le plaisir de défiscaliser ? Ce temps est révolu ! Il faut arrêter de relayer ce type de message.
Au contraire, le livret Agri est une possibilité offerte aux Français de se reconnecter avec l’agriculture et de revenir à des choses que nous avons abandonnées trop vite. Nous parlons tous ce soir d’installation et de renouvellement des générations : ne faudra-t-il pas remettre en place demain des prêts bonifiés, compte tenu de l’évolution des taux d’intérêt, lesquels sont passés de 0 % voilà quelques mois à 4 % aujourd’hui, …

… surtout quand le patrimoine à transmettre représente une somme colossale en capital ? Le livret Agri aurait toute son utilité à cet égard.

J’entends les arguments selon lesquels ces aides doivent être larges et indifférenciées. Pour nous, c’est non ! Nous avons des préférences. Nous estimons qu’il y a des modèles plus vertueux que les autres. C’est ce qui nous différencie. Nous ne sommes pas caricaturaux : nous avons des convictions !
Selon nous, il y a des modèles qui s’inscrivent dans une vraie transition et qui vont nous apporter de la résilience. Aussi, nous voulons soutenir ces modèles, tout simplement, ce qui me semble limpide. Une politique publique doit servir à orienter l’agriculture, et nous souhaitons l’orienter d’une certaine manière. Nous ne sommes pas d’accord avec vous, et nous sommes cohérents avec notre vision de l’agriculture.
Pour terminer, je voudrais répondre à mon collègue Laurent Duplomb sur la moutarde. Il aura fallu le temps qu’elle me monte au nez…
Sourires.

Ce que vous nous avez dit sur la moutarde montre bien qu’il y a deux modèles totalement différents. Vous nous parlez d’un modèle ouvert, libéral, où nous sommes en concurrence avec les Ukrainiens. Selon vous, pour être compétitif sur ce marché, il faut s’asseoir sur nos normes environnementales et essayer d’avoir le coût salarial le plus bas possible. Vous êtes dans cette dynamique du libéralisme défendue depuis des décennies et qui se justifie pleinement à vos yeux.
Pour notre part, nous ne nous satisfaisons pas de ce cadre. Nous voulons des clauses miroirs pour protéger notre agriculture, notre environnement et la santé des Françaises et des Français dans un monde habitable.
Voilà notre différence : elle est macroscopique et porte sur la conception de l’économie.

Je voudrais à mon tour défendre ces amendements, comme vient de le faire mon collègue Daniel Salmon.
Puisque l’enjeu, à travers ce livret Agri, c’est de créer un lien entre la société et les agriculteurs, prenons exemple sur ce qui se passe avec le livret de développement durable et solidaire (LDDS), qui n’a de développement durable souvent que le nom, et qui n’incite pas un grand nombre de nos concitoyens souhaitant soutenir la transition écologique à s’engager sur ces produits financiers.
À mon sens, il serait très sage d’avoir un livret Agri qui vienne soutenir la transition écologique et qui permette à nos concitoyens de s’engager avec confiance sur ce produit financier, en soutien à un nouveau modèle agricole. Cela n’empêcherait pas, d’ailleurs, d’avoir un livret Agri conventionnel, mais il faut être clair : soutenir tous les modèles agricoles ne me paraît pas correspondre à ce que souhaitent beaucoup de nos concitoyens, …

… à savoir participer activement à la transition agroécologique, face aux dangers liés à la crise climatique, à la pollution et au modèle agro-industriel. Permettons-le !

Je voudrais préciser que, lors des auditions sur cette proposition de loi, j’ai eu l’occasion de rencontrer les dirigeants de La Ferme Digitale, que chacun connaît, et en particulier un chef d’entreprise qui a une plateforme de financement de l’agriculture assez intéressante. Celle-ci permet, selon son témoignage, de collecter des fonds en ligne pour financer beaucoup de projets agricoles très divers. Il importe à mon sens d’être neutre par rapport aux projets d’installation, notamment des jeunes, qui sont souvent financés par ces plateformes, et de permettre au livret Agri d’être très large pour ce qui est des conditions d’éligibilité. En effet, monsieur Salmon, c’est une différence idéologique, mais nous l’assumons pleinement.
Je vais faire un petit pas de côté par rapport à ce qui vient d’être dit. Nous devons essayer d’embrasser à la fois les problèmes liés à la transition et nos besoins de compétitivité et de souveraineté alimentaire.
Il faut savoir que nous manquons d’éleveurs en ovins. Pas en ovins bio, mais en ovins ! Vous ne pouvez pas dénoncer le fait que nous devions aller chercher des ovins en dehors des frontières et n’exiger que du bio. Vous le savez, ces marchés sont compliqués. J’ai aussi besoin de reconquérir quasiment 60 % de la filière fruits et légumes et de répondre à l’ensemble des besoins des consommateurs français, qui veulent parfois du bio, parfois autre chose.
Le corollaire de ce que vous revendiquez, c’est une capacité coercitive sur l’alimentation de nos concitoyens. Je ne pense pas que ce soit ce à quoi vous aspirez…
Si je veux assurer notre souveraineté, rien que pour ces deux seules filières, j’ai besoin de l’ensemble des modèles. J’ai cependant une petite différence avec Mme Primas : je pense que nous avons besoin d’encourager les transitions. Mais nous avons aussi besoin de reconquérir notre souveraineté ! Sinon, nous parlons dans le vide. Nous pouvons toujours donner notre préférence pour tel ou tel type de produits, mais si les gens n’en veulent pas… À la fin des fins, cela encourage ce qui vient de l’extérieur.
À cet égard, l’exemple de la moutarde est très parlant. Si j’ai bien compris, monsieur Salmon, vous proposez qu’il n’y ait pas de moutarde tout court si elle n’est pas produite en France.
Essayons de le comprendre et de trouver des solutions. Je ne me résous pas à ce que nous ne produisions plus de moutarde en France, mais je ne me résous pas non plus à ce que les Français n’aient pas de moutarde. Mais je préférerais quand même qu’ils aient de la moutarde de France !

Les trois amendements vont dans le sens de la transition que vous appelez de vos vœux, monsieur le ministre. Il ne s’agit que d’épargne populaire dans le cadre d’un livret Agroécologie, sachant que l’agriculture est déjà bien subventionnée pour ses investissements. C’est la Cour des comptes qui le dit. Avant votre prochaine loi, si une consultation populaire est menée pour savoir si nos concitoyens souhaitent financer un livret Agri ou un livret Agroécologie, une majorité se portera sans doute sur le second avec plus d’entrain.

M. Franck Montaugé. Monsieur le ministre, je suis un peu surpris de vos propos concernant la moutarde. Je vous invite à goûter celle d’Antras, le berceau de l’armagnac.
Sourires.
Mêmes mouvements.

C’est une excellente moutarde, faite localement. Plus sérieusement, j’ai un peu de mal à entendre dire qu’il n’y a plus de savoir-faire en France…

Non, ce n’est pas ce qu’il a dit ! Ce n’est pas un problème de savoir-faire !
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 123 rectifié, présenté par Mme Primas, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer la seconde occurrence de la référence :
L. 221-28
par la référence :
L. 221-7
La parole est à Mme le rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 4 est adopté.
Après l’article 39 decies du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 A ainsi rédigé :
« Art. 39 decies-0 A. – I. – Dans les secteurs les plus intensifs en main d’œuvre, les entreprises exerçant une activité agricole, agroalimentaire et les sociétés coopératives agricoles peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt d’une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, et dans la limite de 20 000 euros, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er avril 2023 et jusqu’au 1er avril 2026 lorsque ces biens, qui peuvent être de nature matérielle ou immatérielle, peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils ont pour finalité la réduction ou la participation à la réduction de leurs coûts de production, l’amélioration de leur compétitivité-prix, l’adaptation au changement climatique ou la gestion économe de l’eau.
« L’entreprise ou la coopérative qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut bénéficier d’un crédit d’impôt d’une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er avril 2023 et jusqu’au 1er avril 2026. Si l’entreprise ou la coopérative crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à bénéficier du crédit d’impôt. Le crédit d’impôt cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise ou la coopérative qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas bénéficier du crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du présent I.
« Un arrêté du ministère chargé de l’agriculture établit la liste des secteurs les plus intensifs en main-d’œuvre mentionnés au même premier alinéa ainsi que les équipements éligibles au crédit d’impôt.
« II. – Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et des coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I du présent article à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat par ces coopératives du 1er avril 2023 et jusqu’au 1er avril 2026, d’une part au titre des biens affectés exclusivement à des opérations exonérées, et d’autre part au titre des biens affectés à la fois à des opérations exonérées et à des opérations taxables au prorata du chiffre d’affaires des opérations exonérées sur le chiffre d’affaires total.
« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction ainsi déterminée, égale à la proportion :
« 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;
« 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.
« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.
« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.
« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier du crédit d’impôt pratiqué.
« Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, au règlement (UE) n° 717/2014 du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ainsi qu’au règlement (UE) n° 2019/316 du 21 février 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1408/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

Cet article 5 nous amène, à travers la création d’un crédit d’impôt, à aborder la question de la mécanisation en agriculture.
Nous ne sommes bien sûr pas favorables à la création d’un nouveau crédit d’impôt. Toutefois, la réécriture du texte par Mme la rapporteure, avec la mise en place d’un plafond, nous paraît un peu plus raisonnable. C’est pour cela que nous ne proposerons pas de suppression de l’article.
Pour revenir sur l’enjeu de la mécanisation, le CGAAER, qui accompagne votre ministère, monsieur le ministre, a rendu en 2021 un rapport intéressant sur les charges de mécanisation des exploitations agricoles.
Dans leurs conclusions, les auteurs rappellent que celles-ci peuvent représenter de 30 % à 50 % des charges totales et que le pouvoir de négociation des agriculteurs est bien faible face à un marché fermé, avec des prix en constante augmentation.
Sur le conseil à l’achat, ils indiquent également que la plupart des organisations d’appui au développement ont peu à peu quitté ce domaine et qu’il n’existe aujourd’hui que très peu d’outils d’aide à la décision pour aider les agriculteurs à raisonner leurs investissements. Je pense que tout l’enjeu est là.
Oui, les agriculteurs ont indéniablement besoin de machines agricoles, mais, car il y a un « mais », ces achats doivent se faire de manière raisonnée et adaptée à leur exploitation. Pour cela, je pense qu’ils ont davantage besoin d’un conseil indépendant que d’un crédit d’impôt, qui ne servira que d’argumentaire de vente aux producteurs et aux vendeurs de machines agricoles.
La surmécanisation, avec parfois des crédits très importants pour acheter des machines inadaptées, représente un risque bien plus concret, sur lequel les pouvoirs publics devraient se pencher plus sérieusement.

L’amendement n° 59, présenté par M. Gay, Mmes Varaillas, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Sans nier que de nombreuses exploitations font aujourd’hui face à la transformation des systèmes de production et que les outils de l’agroéquipement sont au cœur de celle-ci, nous considérons que la recherche d’optimisation des charges sociales et fiscales accélère bien souvent la prise de décision des agriculteurs et n’implique pas nécessairement une réflexion stratégique d’équipement. C’est un des constats du rapport du CGAAER, La charge de mécanisation des exploitations agricoles, réalisé en 2021.
Ce constat est partagé par la Cour des comptes : « Cet encouragement à l’investissement n’est pas sans lien avec des pratiques d’optimisation fiscale et sociale qui nuisent à la constitution de droits à la retraite des agriculteurs dans la mesure où elles réduisent le résultat comptable qui constitue l’assiette d’imposition et de cotisations. Il renchérit le montant des reprises et des installations et semble mal articulé avec les dispositifs destinés à pallier le coût croissant des équipements, comme les pratiques de mise en commun des équipements par les exploitants (coopérative d’utilisation de matériels agricoles, achats groupés, assolement commun), ou de recours, quand cela est pertinent, à des entreprises de travaux agricoles (ETA). En outre, si des investissements apparaissent indispensables pour réduire l’usage d’intrants et des énergies fossiles (recourir par exemple à des pulvérisateurs plus précis et plus coûteux), les avantages fiscaux ne sont pas toujours orientés vers des outils mécaniques ou d’aide à la décision qui s’inscriraient dans une dynamique d’activité agricole durable. »
C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.

Je comprends les arguments qui sont avancés par les auteurs de cet amendement de suppression. Qu’ils soient rassurés : l’article 5 n’a pas pour objet de permettre l’achat d’un tracteur à 150 000 euros, à 200 000 euros ou, mieux encore, à 300 000 euros ! En effet, la commission a plafonné le crédit d’impôt prévu à l’article 5 à 20 000 euros.
Ensuite, il est institué pour une durée de trois ans seulement, afin d’inciter les entreprises agricoles, notamment les plus modestes, à investir.
Je rappelle aussi que, en dépit de certaines pressions, nous avons maintenu le choix du crédit d’impôt, qui a l’avantage, contrairement à la défiscalisation, de permettre à des entreprises ayant un résultat modeste d’investir, en se faisant rembourser le surplus, si le montant du crédit d’impôt est supérieur au résultat.
Enfin, j’ai souhaité que ce crédit d’impôt puisse soutenir des investissements immatériels, qui peuvent aussi avoir des effets sur la compétitivité et sur l’adaptation au changement et aux transitions nécessaires.
Avis défavorable.
Madame la sénatrice, notre avis est favorable sur votre amendement. Nous ne sommes en effet pas d’accord sur la manière dont la proposition de crédit d’impôt a été formulée.
Nous sommes tous pétris des paradoxes… Nous ne voulons pas de surtranspositions, mais nous en produisons à chaque texte ; nous ne voulons pas de niches fiscales, mais nous en créons là une supplémentaire !
Il semble donc nécessaire de se demander quels sont les objectifs de la fiscalité de l’agriculture. Nous avons déjà abordé cette question, madame la rapporteure.
Je profite de cette question pour vous livrer mon sentiment sur la question plus générale de l’investissement agricole, dont nous avons besoin.
Mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai entendu vos propos sur la mécanisation et sur la robotisation. À moins d’être sur une île déserte, il n’y a pas d’autres chemins que celui de la mécanisation et de la robotisation, qui est celui que tous les pays agricoles du monde empruntent. Elles ont libéré, dans la majorité des cas, les agriculteurs d’un certain nombre de contraintes physiques. Personne, j’imagine, n’a envie ni ici ni ailleurs de revenir au temps de l’agriculture non mécanisée.
Ainsi, nous avons besoin de mécanisation ; nous avons donc besoin d’investissements, mais non de surinvestissements ! Du reste, nous devons nous fixer comme objectif global d’éviter le surinvestissement et d’orienter les investissements vers la transition.
Ensuite, nous devons penser aux évolutions des structures agricoles. Peut-être faudrait-il accroître les structures collectives. Monsieur Duplomb, contrairement à ce que vous dites, tout n’est pas tout blanc ou tout noir en matière d’investissement. Il y a encore des gens qui investissent. Ils ont tout à fait le droit de manière individuelle.
Certaines structures d’investissement prennent la forme de Cuma ; d’autres structures ou dispositifs existent, mais ils ne sont pas forcément connus. Il nous faudra travailler sur ces sujets, y compris dans le texte que je serai amené à vous soumettre, en nous interrogeant sur les pratiques collectives qui ne s’inscrivent pas forcément dans les structures collectives actuelles. Nous avons besoin d’encourager le collectif. Alors que d’autres types d’organisations collectives se forment, essayons de ne pas imposer un modèle en la matière.
Nous devons plutôt travailler à encourager la transition, d’une part, le collectif, d’autre part. Il faut renforcer les structures collectives, sous différentes formes, en particulier celles dont les membres ne sont pas tous issus du milieu agricole.
Madame la sénatrice, j’en viens aux raisons qui font que nous sommes favorables à l’amendement de votre collègue Fabien Gay, que vous avez défendu. Les dispositions de l’article 5 pourraient faire doublon avec des soutiens financiers déjà prévus dans le cadre du plan France Relance, tels que les aides à la conversion des agroéquipements, qui se sont élevées à 212 millions d’euros – c’est en faveur de la transition –, ou le guichet mis en place par FranceAgriMer pour aider les agriculteurs à réussir la transition et ceux d’entre eux, dans toutes les filières, qui veulent s’engager à acheter des agroéquipements.
Par ailleurs, cet outil fiscal viendrait peut-être doublonner – cela mériterait une expertise – avec le dispositif de déduction pour épargne de précaution prévu dans le présent texte.
Je précise que, favorable à cet amendement de suppression de l’article 5, je serai défavorable à tous les autres.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 106, présenté par MM. Labbé, Salmon, Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 2 à 5
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 39 decies-0 A. – Les cotisations versées par les entreprises exerçant une activité agricole aux organismes nationaux à vocation agricole au sens des articles L. 820-2 et L. 820-3 du code rural et de la pêche maritime ouvrent droit à un crédit d’impôt d’une somme égale à 66 % du montant de la cotisation. »
II. – Alinéa 6
1° Remplacer la référence :
II
par la référence :
Art. 39 decies-0 B
2° Remplacer les mots :
et des coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I du présent article
par les mots :
peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt d’une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens d’équipement hors frais financiers, lorsque ces biens, peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A
III. – Alinéa 7 à 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction ainsi déterminée, égale à la proportion de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole. »
IV. – Alinéa 12
Supprimer les mots :
les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 et
V. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent crédit d’impôt est plafonné à 10 000 euros. Il est limité à des équipements permettant la mise en place d’alternatives à l’usage de produits phytosanitaires ou d’engrais azotés. »
VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à V, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Joël Labbé.

J’ai formulé précédemment, à l’article 4, toutes nos réserves sur les dispositifs de soutien massif à l’investissement.
Il ne s’agit pas de nier qu’ils sont dans bien des cas nécessaires et utiles pour les exploitations. Je pense notamment aux investissements qui permettent de mettre en œuvre des solutions de remplacement aux engrais chimiques et aux pesticides, mais également à ceux qui permettent d’améliorer l’ergonomie et le confort de travail, notamment pour l’élevage et le maraîchage.
Mais la politique actuelle de soutien massif à l’investissement §encourage l’agrandissement des exploitations, nous l’avons déjà dit, qui emporte nombre de conséquences sur l’emploi. Elle organise la perte d’autonomie des agriculteurs.
Comme la Cour des comptes, nous pensons qu’il faut réorienter les soutiens à l’investissement vers la mutualisation de matériel. C’est pourquoi nous proposons de réserver ce crédit d’impôt aux Cuma.
Nous pensons aussi qu’il faut déployer une politique ciblée sur la transition écologique. C’est pourquoi nous proposons également de réserver ce crédit d’impôt aux alternatives aux pesticides et aux engrais de synthèse.
Par ailleurs, nous sommes convaincus que l’avenir de l’agriculture ne se joue pas seulement sur les investissements matériels ou numériques. Les échanges entre les agriculteurs, au sein des centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural (Civam), des groupements en agriculture bio, des systèmes de mutualisation et d’organisation collectives, comme les services de remplacement, ou comme Solidarité Paysans, Terre de Liens, et L’Atelier Paysan : ces structures sont reconnues par le code rural et de la pêche maritime sous l’appellation « organisme national à vocation agricole et rurale » (Onvar), mais elles sont peu soutenues, alors qu’elles sont bénéfiques pour notre agriculture.
Elles permettent aux agriculteurs de développer des solutions innovantes et collectives pour gérer différemment leur ferme, mettre en œuvre des pratiques agroécologiques, et améliorer leur qualité de travail.

Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 19 rectifié ter est présenté par MM. Canévet, Mizzon, Cadic, Levi et Henno, Mme N. Goulet, M. Le Nay, Mmes Havet, Billon, Herzog et Jacquemet, MM. Duffourg et Détraigne, Mme Perrot, M. Chauvet et Mme Doineau.
L’amendement n° 54 rectifié ter est présenté par Mme Loisier, MM. Bacci et Chasseing, Mmes Guidez et de La Provôté, MM. Hingray et Bonneau, Mme Gacquerre, MM. Savary et Bonnecarrère, Mme Sollogoub, MM. Cigolotti et Folliot, Mmes Lassarade et Saint-Pé et M. Gremillet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 39 decies-0 A. – I. – Les entreprises exerçant une activité agricole, dont celles de travaux agricoles telles que définies au premier alinéa de l’article 722-2 du code rural et de la pêche maritime et celles de travaux forestiers telles que définies à l’article 722-3 du même code, ou agroalimentaire, et les sociétés coopératives agricoles des secteurs les plus intensifs en main-d’œuvre peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt d’une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er avril 2023 et jusqu’au 1er avril 2026 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A du présent code et qu’ils ont pour finalité la réduction ou la participation à la réduction de leurs coûts de production, l’amélioration de leur compétitivité-prix ou l’adaptation au changement climatique.
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Élisabeth Doineau, pour présenter l’amendement n° 19 rectifié ter.

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour présenter l’amendement n° 54 rectifié ter.

Monsieur le ministre, pour rebondir sur votre intervention, je pense que les crédits d’impôt sont justement utiles pour « booster » une politique publique. Le véritable sujet est de savoir comment les gérer dans le temps.
Aujourd’hui, la mécanisation semble être un outil majeur au service des agriculteurs, au regard des nombreux enjeux que nous avons abordés : la réduction des coûts de production, l’amélioration de la compétitivité-prix, l’adaptation au changement climatique ou la lutte contre les aléas climatiques.
Cet amendement a pour objet d’ouvrir explicitement ce crédit d’impôt aux entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers, qui sont confrontées aux mêmes problématiques et enjeux. Ce sont en effet des entreprises polyvalentes, qui œuvrent à l’entretien des espaces naturels, à la défense des forêts contre les incendies, ainsi qu’à la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement (OLD). Or il est notoire que l’on manque d’entreprises pour agir et réaliser ces travaux absolument nécessaires pour préserver nos espaces et pour garantir la sécurité de nos concitoyens.
Il s’agit donc d’une demande d’élargissement de ce crédit d’impôt.

L’amendement n° 90, présenté par MM. Montaugé, Pla, Mérillou, Bouad et Michau et Mme Poumirol, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 39 decies-0 A. – I. – Les entreprises exerçant une activité agricole, dont celles de travaux agricoles telles que définies au premier alinéa de l’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime et celles de travaux forestiers telles que définies à l’article L. 722-3 du même code ou agroalimentaire, et les sociétés coopératives agricoles des secteurs les plus intensifs en main-d’œuvre peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt d’une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, et dans la limite de 20 000 euros, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er avril 2023 et jusqu’au 1er avril 2026 lorsque ces biens, qui peuvent être de nature matérielle ou immatérielle, peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A du présent code et qu’ils ont pour finalité la réduction ou la participation à la réduction de leurs coûts de production, l’amélioration de leur compétitivité-prix ou l’adaptation au changement climatique.
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Franck Montaugé.

Dans le même esprit, il s’agit d’accorder un crédit d’impôt de 20 000 euros au maximum, dans le but de réduire les coûts de production, au regard des objectifs liés à la compétitivité-prix et à l’adaptation au changement climatique.
Nous pensons également, comme cela vient d’être dit, que les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers doivent en bénéficier.
De plus, la notion de services immatériels agricoles doit entrer dans le cadre de ce crédit d’impôt d’une enveloppe maximale de 20 000 euros.

L’amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. Duplomb et J.M. Boyer, Mme Férat, M. D. Laurent, Mmes Puissat et Gruny, M. Rietmann, Mme N. Delattre, M. Menonville, Mme Belrhiti, MM. Paccaud, Hugonet et Henno, Mme Loisier, M. Bascher, Mme Berthet, M. Bacci, Mme Demas, M. Burgoa, Mme Thomas, M. Savary, Mme Schalck, M. Decool, Mme Lassarade, MM. Pellevat, Chauvet, Chasseing, Canévet, B. Fournier et Bouchet, Mmes Ventalon, M. Mercier et Drexler, MM. Daubresse, Verzelen, Pointereau, C. Vial et Détraigne, Mme Pluchet, M. Sautarel, Mmes Billon, Garriaud-Maylam et Joseph, M. Duffourg, Mmes Lopez, Malet et Bellurot, MM. Somon et J.P. Vogel, Mme Dumas, M. Charon, Mme Dumont, MM. Lefèvre, Genet et Chatillon et Mme Imbert, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
Dans les secteurs les plus intensifs en main-d’œuvre, les
par le mot :
Les
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Laurent Duplomb.

Il s’agit simplement d’élargir ce crédit d’impôt à tous les secteurs.
S’il a pour objet de favoriser, par exemple, les investissements relatifs aux aléas climatiques ou à l’aménagement en arboriculture, alors il faut l’ouvrir à tous les secteurs agricoles.

L’amendement n° 32 rectifié, présenté par MM. Tissot, Montaugé et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Michau, Pla et Redon-Sarrazy, Mme Bonnefoy, M. J. Bigot, Mmes Monier et Préville, MM. Stanzione, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer le montant :
par le montant :
La parole est à M. Jean-Claude Tissot.

Cet amendement vise à encadrer davantage l’article 5, qui, dans sa version initiale, ouvrait largement les vannes, sans fixer aucun plafond à ce dispositif.
Du reste, ce dernier demeure aujourd’hui bien complexe à mettre en œuvre, notamment pour les organisations sociétaires.
Nous tenons à rappeler que la course à la mécanisation et au suréquipement des exploitations agricoles conduit bien trop souvent à des situations de surendettement parfois fatales à nos agriculteurs.
Consciente que cet article allait beaucoup trop loin et ne respectait pas le régime des aides de minimis, la rapporteure a fait voter, en commission, un amendement visant à plafonner le montant maximal du crédit d’impôt « pour limiter les éventuels effets d’aubaine, d’une part, ainsi que le coût pour les finances publiques, d’autre part ».
Madame la rapporteure, pour une fois, nous partageons totalement et sans réserve vos préoccupations !
C’est pourquoi, pour les mêmes raisons, nous proposons d’aller plus loin dans votre démarche, en abaissant le plafond, afin de nous assurer que ce crédit d’impôt ne crée pas un appel d’air en direction du surinvestissement et de la spéculation, qui ne bénéficieront pas aux agriculteurs, comme chacun le sait.
Nous proposons donc de plafonner ce crédit d’impôt à 10 000 euros et non pas à 20 000 euros.

L’amendement n° 124 rectifié, présenté par Mme Primas, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer la date :
1er avril 2023
par la date :
1er juin 2023
et la date :
1er avril 2026
par la date :
1er juin 2026
La parole est à Mme le rapporteur pour présenter l’amendement et pour donner l’avis de la commission.

L’amendement n° 124 rectifié est rédactionnel.
Je prendrai un peu de temps pour donner l’avis de la commission sur les autres amendements, monsieur le président.
L’avis est défavorable sur l’amendement n° 106, de notre collègue Joël Labbé, qui tend à métamorphoser le principe de crédit d’impôt, lequel a bel et bien pour objet d’accompagner les petites structures.
La critique de la surmécanisation, je l’ai dit, et M. Tissot l’a rappelé, a été désamorcée en commission par l’instauration d’un plafonnement à 20 000 euros. À titre d’exemple, en arboriculture, investir dans des filets paragrêle, rendus souvent nécessaires du fait de l’augmentation des aléas climatiques, coûte 15 000 euros par hectare. Voilà un type d’investissement qui pourrait bénéficier de ce crédit d’impôt et qui me semble être de bon aloi.
Vous avez mentionné les Cuma – d’ailleurs, vous restreignez le crédit d’impôt à celles-ci –, qui sont en effet indispensables et très intéressantes. Aussi, elles sont intégrées au dispositif mis en place par l’article 5.
Les auteurs des amendements identiques n° 19 rectifié ter et 54 rectifié ter, ainsi que de l’amendement n° 90, proposent d’étendre le bénéfice du crédit d’impôt aux entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers. Or nous savons que, dans ce domaine-là, le défi actuel des forestiers est de faire face à la disponibilité de la main-d’œuvre. Ce sont des métiers assez pénibles.
Voilà pourquoi je proposerai à notre assemblée de voter tout à l’heure plusieurs amendements identiques visant à étendre le dispositif d’exonération pour les travailleurs occasionnels-demandeurs d’emploi à ces entreprises, ce qui constitue une réponse plus appropriée.
La commission demande donc le retrait de ces trois amendements. À défaut, son avis sera défavorable.
L’avis est également défavorable sur l’amendement n° 7 rectifié de M. Duplomb, qui vise à étendre ce crédit d’impôt à tous les secteurs d’activité, alors que le dispositif que nous proposons est destiné aux entreprises agricoles évoluant dans des secteurs intensifs en main-d’œuvre, en particulier les maraîchers et les arboriculteurs.
C’est aussi un souci de bonne gestion des deniers publics – monsieur le ministre, je sens que vous allez être taquin – qui veut que l’on maintienne ce ciblage du crédit d’impôt.
L’avis est tout aussi défavorable sur l’amendement n° 32 rectifié de M. Tissot, qui a pour objet de diviser par deux le plafond du crédit d’impôt. Sans reprendre l’exemple du filet paragrêle, il me semble que 20 000 euros est un montant raisonnable.
Mme la rapporteure m’a invité à être taquin… Eh bien, un certain nombre de nouveaux dispositifs ou de plus anciens dont vous proposez qu’ils soient élargis peuvent être couverts par d’autres mécanismes : je pense à ceux des plans France Relance ou France 2030.
Nous avons besoin, dans le débat qui s’ouvre aujourd’hui, de réfléchir aux aides fiscales et financières pour que les dispositifs soient cohérents. Nous ne pouvons pas créer trois ou quatre guichets ! Les agriculteurs nous diront que les démarches sont trop compliquées, car il y aurait trop de guichets, même s’ils étaient complémentaires. Nous avons besoin de lisibilité en la matière.
Par ailleurs, sur les sujets forestiers, il est également nécessaire de se poser cette question, mais elle doit être traitée à part. L’enjeu et les orientations ne sont pas les mêmes. C’est simplement une question de mécanisation, alors qu’il est nécessaire de réfléchir à la transition du modèle agricole, au moyen de nouveaux matériels.

Monsieur le ministre, certes, je suis d’accord avec vous, mais nous parlons là d’entreprises polyvalentes, qui émargent aussi aux guichets agricoles.
Madame la rapporteure, vous avez raison, il y a une pénurie de main-d’œuvre, mais la pénibilité est forte dans ces secteurs d’activité. La mécanisation est absolument essentielle pour attirer de la main-d’œuvre.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 19 rectifié ter et 54 rectifié ter.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 5 est adopté.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspen d ue à vingt heures, est reprise à vingt-et-une heures trente, sous la présidence de Mme Pascale Gruny.