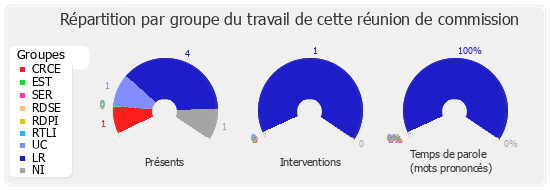Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale
Réunion du 22 février 2006 : 2ème réunion
Sommaire
La réunion
Au cours d'une seconde séance tenue dans l'après-midi, la commission a procédé à l'audition, en commun avec la Délégation du Sénat pour l'Union européenne, de MM. Philippe Léger, avocat général, et Jean-Pierre Puissochet, juge à la Cour de justice des communautés européennes.

a rappelé que MM. Jean-Pierre Puissochet et Philippe Léger exerçaient respectivement les fonctions de juge et d'avocat général auprès de la Cour de justice depuis 1994 dans un contexte marqué par l'élargissement de l'Union et l'augmentation du nombre de recours.
Il a jugé particulièrement intéressant de recueillir le témoignage de ces deux personnalités sur les conséquences de l'élargissement non seulement pour le fonctionnement de la Cour de justice, mais aussi pour l'élaboration d'une jurisprudence qui contribuait, a-t-il souligné, de manière décisive à l'élaboration du droit européen.
a d'abord exprimé ses remerciements pour l'attention apportée par le Sénat à la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) dont il a rappelé qu'elle faisait partie intégrante de l'ordre juridictionnel français. Après avoir rappelé que la Cour comptait un juge par Etat membre, huit avocats généraux et un effectif de 1.700 personnes comprenant des juristes des vingt-cinq Etats membres, il a souligné que la juridiction, conformément à la logique de subsidiarité, s'était vu confier des missions que les cours nationales n'exerçaient pas. D'une part, la Cour, a-t-il noté, était chargée d'apprécier la légalité des actes communautaires ; d'autre part, elle avait vocation à arbitrer les conflits entre les institutions de l'Union européenne ; enfin, elle fixait l'interprétation de la norme européenne dans le cadre de recours sur renvois préjudiciels dont elle pouvait être saisie par tout juge national appelé à trancher à l'occasion d'un dossier contentieux un point de droit communautaire.
a observé que la procédure écrite au sein de la Cour était inspirée pour une large part par la pratique française. Il a relevé que si pour chaque affaire la procédure faisait l'objet d'une traduction dans chacune des vingt langues officielles de l'Union, les projets d'arrêt étaient d'abord élaborés en français. En effet, l'usage de la langue française, initialement privilégié par les Etats fondateurs de l'Union européenne dont trois d'entre eux étaient totalement ou partiellement francophones, s'était maintenu dans la mesure où la jurisprudence de la Cour s'était développée à partir d'arrêts rédigés en français. Il a souligné les efforts des membres de la Cour, au fil des élargissements, pour s'adapter à cette tradition, en relevant notamment le souci de chacun d'entre eux de disposer, parmi ses collaborateurs, d'un juriste francophone. La CJCE comptait ainsi 300 Français sur 1.600 personnes. Il a ajouté qu'à l'exemple de la Cour, le français avait été également choisi comme langue du délibéré par le tribunal de la fonction publique européenne.
Evoquant alors les méthodes de travail de la CJCE, M. Philippe Léger a indiqué que chacun des membres de la juridiction disposait d'un cabinet de sept personnes (trois référendaires choisis parmi les juristes de haut niveau, trois personnels de secrétariat et un chauffeur) et d'une totale liberté de recrutement. Il a souligné la nécessité, pour les juges chargés chacun de traiter de 40 à 50 dossiers par an, de bénéficier du concours de collaborateurs de grande qualité. Il a relevé que les référendaires étaient chargés d'étudier les dossiers et de préparer, sur la base des orientations du magistrat, un projet de conclusions qui donnait lieu ensuite à une discussion conjointe entre celui-ci et les trois référendaires. Il a estimé que l'expérience acquise ainsi par de jeunes juristes dans le cadre de leur activité de référendaire leur permettait de se doter d'une formation très solide en droit communautaire qui leur était très précieuse dans la suite de leur carrière.
a relevé que le récent élargissement, qui s'était traduit par l'arrivée à la Cour de dix juges issus des nouveaux Etats membres, n'avait pas entraîné de bouleversement profond du fonctionnement de la Cour. Il a néanmoins observé que la difficulté de délibérer à vingt-cinq avait conduit à mettre en place un système inspiré de la Cour européenne des droits de l'Homme, selon lequel les affaires importantes étaient jugées par une grande chambre composée de treize juges, les autres pouvant être jugées par des chambres plus réduites, de trois, cinq ou sept juges. Cette évolution suscitait parfois l'insatisfaction des juges qui se trouvaient écartés d'une délibération.

a alors rappelé que la Cour de justice des communautés européennes avait été récemment mise en cause publiquement par plusieurs personnalités politiques de premier plan, parmi lesquelles le Chancelier autrichien Wolfgang Schüssel, qui avait reproché à cette juridiction d'étendre systématiquement les compétences de la Communauté à des domaines relevant de compétences nationales et le Premier ministre danois, M. Andres Fogh Rasmussen. Il a rappelé à cet égard que la Cour de justice avait rendu récemment deux décisions très importantes : la première, le 12 juillet 2005, qui cumulait pour la première fois deux types de sanctions en infligeant à la France à la fois une amende forfaitaire de 20 millions d'euros et une astreinte semestrielle de près de 58 millions d'euros, pour non-respect des règles communautaires en matière de pêche, et notamment de la taille minimale des poissons ; la seconde, en date du 13 septembre dernier, à propos de la protection de l'environnement, considérant que la compétence pour édicter des normes dans le domaine pénal ne constituait pas un monopole du « troisième pilier », mais pouvait également relever de la compétence de la Communauté.
a souhaité obtenir des précisions sur la portée de ces deux arrêts à propos desquels certains commentateurs avaient relevé que la Cour s'était éloignée de la lettre des traités. Par ailleurs, après avoir relevé que la Cour de justice n'avait jamais censuré une disposition communautaire pour non-respect du principe de subsidiarité, alors même qu'elle n'avait pas hésité à étendre au maximum les compétences de la communauté dans de nombreux domaines, il s'est demandé si la Cour de justice entendait exercer à l'avenir un réel contrôle juridictionnel sur ce principe.
En réponse à ces observations, M. Jean-Pierre Puissochet a estimé d'abord que si les critiques sur les arrêts rendus par la Cour étaient naturellement totalement libres, elles ne paraissaient pas toujours fondées. Il a indiqué que la jurisprudence de la Cour visait à assurer un bon équilibre entre les droits des Etats membres et ceux des institutions communautaires. Ainsi, dans l'un des arrêts auxquels le chancelier autrichien avait fait allusion, la Cour avait rappelé que le principe de non-discrimination imposait à l'Autriche de s'assurer que les titulaires de diplômes d'enseignement secondaire obtenus dans les autres Etats membres puissent accéder à l'enseignement universitaire autrichien dans les mêmes conditions que les titulaires des diplômes autrichiens d'enseignement secondaire.
Revenant alors sur l'arrêt du 13 septembre 2005, M. Jean-Pierre Puissochet a souligné que cette décision n'exigeait pas une harmonisation pénale, mais reconnaissait la compétence de la Communauté européenne pour obliger les Etats membres à prévoir des sanctions pénales liées à la protection de l'environnement. Il a noté que dans ce litige classique portant sur le choix de la base légale, il s'agissait de déterminer si la décision-cadre devait être prise sur le fondement du traité sur l'Union européenne ou du traité instituant la Communauté européenne avec les conséquences importantes que ce choix emportait sur le processus décisionnel (respectivement, selon que le premier ou le troisième « pilier » était retenu : majorité qualifiée ou unanimité, exclusivité de l'initiative de la commission ou initiative partagée avec les Etats membres ...). La Cour de justice, a-t-il rappelé, a estimé que la décision-cadre ne constituait pas l'acte juridique approprié et qu'il convenait de passer par une directive adoptée sur le fondement de l'article 175 du traité instituant la Communauté européenne (compétences communautaires en matière de défense de l'environnement). L'arrêt doit être entendu, selon M. Jean-Pierre Puissochet, comme posant le principe de la compétence communautaire pour obliger les Etats membres à prévoir des sanctions pénales en matière de protection de l'environnement lorsque, selon les termes de l'arrêt, « l'application de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives par les autorités nationales compétentes constitue une mesure indispensable pour lutter contre les atteintes graves à l'environnement ». Il a souligné que le caractère nécessaire du recours à l'instrument pénal emportait par lui-même la compétence communautaire.
Il a indiqué néanmoins que l'arrêt était strictement cantonné à la protection de l'environnement et se fondait sur la spécificité de cette matière, qui constituait un objectif essentiel, transversal et fondamental de la Communauté. Il a ajouté que la Communauté ne pouvait pas déterminer ces sanctions elle-même et qu'il appartenait aux Etats de les définir à condition qu'elles présentent un caractère effectif, proportionné et dissuasif. Il n'était pas possible ainsi, d'après M. Jean-Pierre Puissochet, de déduire de cet arrêt une communautarisation du droit pénal. Il a reconnu néanmoins que cet arrêt avait donné lieu à une interprétation différente, notamment de la part de M. Christian Philip, qui, dans un rapport élaboré au nom de la délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale, avait craint que le principe ainsi posé par la Cour ne soit étendu à d'autres matières importantes que le traité avait dévolues à la communauté. Ces craintes, a-t-il ajouté, s'étaient nourries de l'interprétation systématique faite par la Commission européenne de cet arrêt en lui donnant une portée générale. La Commission avait en effet estimé confirmée la position qu'elle avait prise à l'occasion de l'adoption de la décision-cadre du 27 janvier 2003 censurée par l'arrêt du 13 septembre 2005 selon laquelle la Communauté était compétente pour édicter des sanctions pénales nécessaires pour atteindre un objectif communautaire et, a ajouté M. Jean-Pierre Puissochet, elle a d'ailleurs décidé d'engager un recours contre une autre décision-cadre relative à la lutte contre la pollution par les navires.
a indiqué que l'arrêt du 12 juillet 2005, Commission contre France dit « Poisson sous taille », marquait la volonté de la Cour de justice des Communautés européennes d'obliger les Etats membres à mettre à exécution ses décisions. Il a expliqué qu'avant l'entrée en vigueur du traité de Maastricht (1992), il n'existait pas de procédure contraignante à l'égard des Etats qui n'exécutaient pas les arrêts en manquement de la Cour. La nouvelle procédure judiciaire dite de « manquement sur manquement » introduite par le traité de Maastricht (article 228 du Traité CE) consiste à permettre à la Commission qui constate l'inertie d'un Etat condamné par la Cour pour manquement à ses obligations communautaires de saisir une deuxième fois cette juridiction pour lui demander une nouvelle condamnation de cet Etat a-t-il expliqué, ajoutant qu'il appartenait à la Commission européenne de suggérer la mesure susceptible d'être prononcée, à savoir, une amende forfaitaire ou une astreinte périodique.
a signalé que le recours à ce dispositif, après avoir été peu utilisé au départ, s'était accru au cours des quatre dernières années. Il a indiqué que, dans un premier temps, la Cour avait jugé que la condamnation à une astreinte constituait le moyen le plus efficace pour conduire un Etat récalcitrant à respecter les obligations découlant du droit communautaire, ainsi que l'avaient illustré les premiers arrêts rendus -l'un concernant la Grèce en juillet 2000 et l'autre, l'Espagne, en novembre 2003. Il a observé que la sanction prononcée par la Cour dans ces deux affaires avait été très proche de celle demandée par la Commission.
a indiqué que le durcissement notable des sanctions pécuniaires infligées aux Etats membre qui refusent de tirer les conséquences d'une décision de justice introduit par l'arrêt du 12 juillet 2005 s'expliquait notamment par la persistance, pendant une longue période, du manquement de l'Etat récalcitrant, en l'espèce la France, à ses obligations communautaires. Il a précisé que l'évolution de la jurisprudence de la Cour n'était pas imputable à la Commission européenne qui, conformément à la pratique naissante, s'était bornée à demander la condamnation de l'Etat en cause à une astreinte. Il a ajouté que les juges s'étaient ralliés aux conclusions de l'avocat général, lequel avait proposé d'aller au-delà de la proposition de la Commission en prononçant à la fois une astreinte et une amende d'un montant financier très élevé (respectivement près de 58 millions d'euros par semestre de retard et 20 millions d'euros). Il a indiqué que la Cour de justice des Communautés européennes avait reconnu avoir interprété les sanctions financières prévues à l'article 228 du traité CE de manière extensive, considérant possible de cumuler astreinte et amende au regard de la finalité poursuivie, à savoir inciter les Etats membres défaillants à exécuter un arrêt en manquement et, ainsi, assurer l'application effective du droit communautaire.
s'est déclaré conscient de l'émoi suscité par cet arrêt eu égard aux montants très élevés des sanctions pécuniaires prononcées et à l'infléchissement de la jurisprudence antérieure de la Cour. Il a signalé qu'en outre, la position des juges de la CJCE avait eu des répercussions sur la mise en oeuvre par la Commission européenne de l'article 228 du Traité CE, rappelant que cette dernière avait adopté une communication le 13 décembre 2005 annonçant son intention :
- de demander systématiquement à la Cour la condamnation de l'Etat membre défaillant au paiement d'une astreinte et d'une amende dans toutes les affaires et dans toutes les hypothèses ;
- de ne plus se désister d'une procédure en manquement sur manquement lorsque l'Etat défaillant exécute tardivement la décision de la Cour avant le prononcé du second arrêt, contrairement à sa pratique antérieure.
a jugé prématuré de tirer des conclusions définitives sur l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de sanctions financières à l'égard des Etats qui ne respectent pas leurs obligations communautaires, après avoir néanmoins noté la détermination de la Commission européenne à assurer l'application la plus complète possible de recours formés devant la CJCE. Il a indiqué qu'on distinguait deux périodes distinctes dans la politique de la Commission, une première période allant jusqu'en 1975 caractérisée par un régime apaisé durant laquelle la Commission ne poursuivait les Etats qu'en cas de violations très graves aux obligations communautaires, étant précisé qu'on dénombrait peu de manquements et une seconde période à partir de la présidence Jenkins (1977-1981), qui a modifié cette pratique dans le sens d'une plus grande sévérité à l'égard des Etats récalcitrants. La poursuite systématique des Etats défaillants peut paraître rude, a-t-il constaté, mais lui a paru nécessaire pour éviter que certains membres de l'Union européenne n'aient un sentiment d'impunité.
a noté que le choix de l'instrument (directive ou décision-cadre) n'est pas neutre quant à l'étendue du contrôle de l'exécution de l'acte par la CJCE, une décision-cadre, à la différence d'une directive, ne pouvant donner lieu à un recours en manquement de la part de la Commission.

a remarqué que si les sanctions pécuniaires prononcées par la CJCE s'étaient limitées au domaine environnemental, de nombreux autres secteurs risquaient désormais d'être concernés, dans la mesure où la Commission européenne avait annoncé son intention d'utiliser ce mécanisme dans chaque affaire.
a observé que la CJCE se prononcerait au cas par cas.
Il a souligné que les fonctions juridictionnelles dévolues à la Cour étaient une déclinaison du principe de subsidiarité, dans la mesure où celles-ci ne pouvaient être exercées par les juridictions nationales. Il a expliqué que la subsidiarité subordonnait l'action de la Communauté à deux conditions : d'une part, que l'initiative envisagée ne puisse être réalisée de manière suffisante par les Etats membres (test de nécessité) et, d'autre part, que celle-ci puisse être mieux réalisée au niveau communautaire (test de la valeur ajoutée de l'action communautaire).
a précisé que l'analyse de la jurisprudence de la CJCE démontrait que les dispositions sur l'application du principe de subsidiarité et le principe lui-même sont justiciables du contrôle de la CJCE -par un contrôle a posteriori selon les voies de recours ordinaires- mais que cette dernière s'était bornée à exercer un contrôle très restreint en ce domaine. Il a souligné le faible nombre d'arrêts (23 sur 12.000) dans lesquels la violation de ce principe avait été invoquée, étant précisé que ce moyen avait toujours été invoqué conjointement à d'autres griefs, tel que l'erreur de base juridique et souvent confondu avec le principe de proportionnalité. Il a noté le caractère superficiel et peu développé du contrôle juridictionnel de la subsidiarité.
Evoquant la nature du contrôle exercé en la matière, il a précisé que la Cour s'était intéressée à son aspect formel en vérifiant que la Communauté européenne respectait l'obligation de motivation des normes communautaires au regard de la subsidiarité. Il a expliqué que, dans un arrêt du 13 mai 1997 (Allemagne contre Parlement européen et Conseil), confirmé par un arrêt du 12 novembre 1996 (Royaume-Uni contre Conseil), la Cour avait d'ailleurs développé une conception assez souple de cette obligation, estimant qu'il n'était pas nécessaire que le législateur communautaire prévoie de manière explicite une motivation au regard du respect du principe de subsidiarité.
S'agissant du contrôle matériel du respect de la subsidiarité, M. Philippe Léger a souligné que la Cour avait cantonné volontairement sa compétence à la recherche de l'erreur manifeste d'appréciation, après avoir estimé que la dimension politique de la subsidiarité donnait lieu à des appréciations et des choix complexes de la part du législateur difficiles à remettre en cause. En outre, il a estimé que l'importance attachée au principe de subsidiarité diminuerait au fur et à mesure que les conditions d'exercice d'une compétence communautaire seraient plus détaillées et précisées dans la clause d'attribution de compétence. Il a considéré qu'un tel contexte amènerait les contestations à porter plus sur le choix de la base juridique retenue que sur la subsidiarité.

s'est demandé si la jurisprudence de la Cour de justice sur la subsidiarité ne serait pas amenée à évoluer sous la pression des parlements nationaux, très attachés au respect de ce principe.
a relevé que la jurisprudence de la Cour ne lui semblait pas avoir connu d'évolution particulière en ce domaine ces dernières années.
a cependant estimé qu'une forte pression des requêtes invoquant la subsidiarité amènerait inévitablement la Cour à modifier ses pratiques.

a marqué son attachement au principe de subsidiarité, après avoir estimé qu'il constitue une des clefs pour renouer la confiance entre les citoyens et les institutions de l'Union européenne. Il a souhaité que la Cour se prononce plus souvent sur cette question.

a souhaité savoir si la Cour pouvait soulever d'office le non-respect de la subsidiarité.
a indiqué que tel pouvait être le cas en théorie dans le cadre d'un recours préjudiciel. M. Jean-Pierre Puissochet a souligné que l'absence de consensus entre les juges sur une définition des moyens d'ordre public rendait cette pratique difficile.

a souhaité savoir si les modifications apportées au projet de directive sur les services ayant conduit à revenir sur le « principe du pays d'origine » (PPO) étaient susceptibles de remettre en cause la jurisprudence de la Cour sur ce principe consacré comme un droit communautaire acquis depuis 1986.

Après avoir mis en avant le rôle moteur de la Cour de justice des Communautés européennes dans la construction de l'espace communautaire, M. Christian Cointat s'est demandé si l'approche très positive de cet organe ne comportait pas paradoxalement une limite intrinsèque en ce qui concerne le contrôle exercé sur le choix de la base juridique qui relevait d'une décision de pure opportunité politique du législateur. En outre, il a souhaité savoir dans quelles circonstances la CJCE avait été amenée à reconnaître une sorte d' « effet direct » à une décision-cadre prise sur le fondement du troisième pilier (arrêt Pupino du 16 juin 2005) en dépit du texte du Traité sur l'Union européenne qui précise expressément que les décisions-cadre, ne peuvent produire d'effet direct.
a précisé que la recherche de l'existence d'une base juridique par la CJCE lui paraissait conforme au principe de subsidiarité. A propos de l'arrêt Pupino, il a nuancé l'interprétation de M. Christian Cointat après avoir souligné que le juge communautaire n'avait pas reconnu un effet direct aux décisions-cadre mais s'était borné à indiquer que le juge national devait interpréter le droit national à la lumière des décisions-cadre.
En ce qui concerne le principe du pays d'origine, il a considéré que la confiance mutuelle entre les Etats sur la qualité de leurs normes respectives constituait un des principes fondateurs de la construction européenne, mais que, s'agissant des activités de services, il fallait tenir compte d'autres principes et qu'il serait prématuré de tirer des conclusions définitives sur ses modalités d'application.