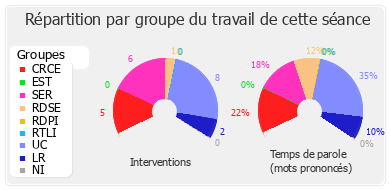Séance en hémicycle du 30 novembre 2007 à 10h45
Sommaire
La séance
La séance est ouverte à dix heures quarante-cinq.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

M. Hugues Portelli. Monsieur le président, lors du vote par scrutin public n° 43 sur l'ensemble du projet de loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française, M. Gaston Flosse a été déclaré, par erreur, comme votant pour, alors qu'il avait évidemment souhaité voter contre.
Sourires

Par lettre en date du 30 novembre 2007, Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a fait connaître à M. le président du Sénat qu'en application des articles L.O. 137 et L.O. 320 du code électoral, Mme Catherine Dumas est appelée à remplacer, en qualité de sénateur de Paris, M. Philippe Goujon dont le mandat a cessé hier à minuit à la suite de la décision du Conseil constitutionnel confirmant son élection à l'Assemblée nationale.
Mes chers collègues, je vous informe que le nombre de sénatrices est dorénavant de soixante.
Le mandat de Mme Catherine Dumas a commencé ce matin à zéro heure. Nous souhaitons que notre Haute assemblée soit pour elle un lieu où elle pourra vivre pleinement son engagement et qu'elle trouvera beaucoup de satisfaction dans l'exercice de ses responsabilités.

Je rappelle que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation d'un sénateur appelé à siéger au sein de la Commission nationale des compétences et des talents.
La commission des lois a fait connaître qu'elle propose la candidature de M. François-Noël Buffet pour siéger au sein de cet organisme extraparlementaire.
Cette candidature a été affichée et sera ratifiée, conformément à l'article 9 du règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure.


Le Sénat va examiner les crédits relatifs à la mission « Justice ».
La parole est à M. le rapporteur spécial.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, dans le projet de loi de finances pour 2008, la mission « Justice » est dotée de 6, 519 milliards d'euros de crédits de paiement, soit une augmentation de 4, 5 %.
Dans un contexte budgétaire globalement tendu, cette progression des crédits de la mission est particulièrement remarquable. Elle témoigne de l'importance attachée à la justice et de la priorité accordée à ses moyens.
Le programme « Justice judiciaire » compte 2, 73 milliards d'euros en crédits de paiement, soit une hausse de 5, 1 % très notable dans le contexte budgétaire actuel.
Un rapide bilan de la loi d'orientation et de programmation pour la justice montre que, au terme de la programmation, tous les objectifs n'ont pas été atteints, notamment en termes de création d'emplois. Le taux de réalisation est de 76 % pour les magistrats, ce qui est assez satisfaisant, mais de seulement 32, 6 % pour les fonctionnaires.
Le présent projet de loi de finances ne rompt toutefois pas avec le renforcement nécessaire des effectifs des juridictions, en prévoyant une création nette de 400 emplois.
Ce nouvel effort doit être salué, car le ratio actuel de 2, 57 fonctionnaires de greffe par magistrat continue de traduire une certaine faiblesse du soutien logistique susceptible d'être apporté aux magistrats. S'il faut se féliciter de l'accroissement des effectifs de magistrats, il convient aussi de rappeler que l'effort doit plus particulièrement porter, désormais, sur les greffiers. À cet égard, on peut penser que le recours accru aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, en 2008, devrait améliorer sensiblement les conditions de travail de ces derniers.
En 2008, une dotation de 405 millions d'euros est prévue pour couvrir les frais de justice, soit une hausse de seulement 1, 7 % par rapport à 2007. Même si ce poste de dépense devra encore rester sous observation, il faut saluer les résultats obtenus dans ce domaine par les magistrats, ainsi que la politique volontariste de maîtrise des frais de justice engagée durant ces dernières années par la Chancellerie. Cette maîtrise s'est en outre réalisée sans porter atteinte au principe d'indépendance de l'autorité judiciaire, ce qui mérite d'être tout particulièrement souligné.
Pour ce qui concerne la révision de la carte judiciaire, il convient de rappeler qu'aucune réforme structurelle de fond de l'institution judiciaire n'a été entreprise depuis 1958. L'objectif de rationaliser les moyens de la justice sur l'ensemble du territoire ne peut qu'être soutenu, dès lors qu'il tient compte de la réalité humaine des territoires.
La lucidité doit toutefois être de mise : cette réforme ne peut être envisagée à moyens constants. Si l'on est en droit d'en espérer des sources d'économies à terme, elle nécessitera d'abord, comme toute réforme de structures, une importante « mise de fonds » initiale.
Les regroupements envisagés, notamment, auront un coût immobilier. Lors de votre audition par la commission des finances, madame la ministre, vous avez d'ailleurs évoqué un programme immobilier - hors palais de justice de Paris - portant sur un montant total de 800 millions d'euros sur six ans.
Il convient, par ailleurs, d'insister sur le caractère inacceptable des conditions de détention aujourd'hui en France. Nombre de nos prisons souffrent de vétusté et le taux de surpopulation carcérale y atteignait 121 % au 1er août 2007.
Pour 2008, le programme « Administration pénitentiaire » comporte 2, 383 milliards d'euros de crédits de paiement, soit une progression de 6, 4 % par rapport à 2007.
Afin de répondre à l'ouverture de nouveaux établissements, il enregistre la création de 772 emplois équivalents temps plein.
Toutefois, à supposer que le nombre de détenus reste au niveau actuel et que les prévisions en matière de création de places de détention soient respectées, le nombre de places ne pourra pas égaler, à terme, le nombre de personnes détenues.
Au regard de la mesure de la performance, le programme « Administration pénitentiaire » est entré, après deux exercices de « rodage » en mode LOLF, dans une phase de « création » et de « consolidation » : douze indicateurs sur dix-huit sont nouveaux.
Si cette ambition doit être encouragée, elle emporte aussi, malheureusement, une contrepartie de court terme regrettable : plusieurs de ces indicateurs ne sont pas renseignés dans le projet annuel de performances.
Le programme « Protection judiciaire de la jeunesse » comporte, pour sa part, 809, 1 millions d'euros en crédits de paiement. Il est donc en progression de 1, 6 % par rapport à 2007.
Il bénéficie, lui aussi, d'un renforcement significatif de ses moyens humains. Avec 9 027 emplois équivalents temps plein, la protection judiciaire de la jeunesse, PJJ, sera en mesure d'assurer le fonctionnement à pleine capacité de sept établissements pénitentiaires pour mineurs, tout en maintenant son action éducative pour l'ensemble des 80 000 mineurs dont elle a la charge. L'augmentation du plafond d'emploi accompagne l'ouverture en 2008 de trois nouveaux établissements pénitentiaires pour mineurs, ainsi que le renforcement de la présence de la PJJ dans les quatre établissements ouverts en 2007.
S'agissant de ce programme, il convient tout particulièrement de se féliciter de la nette amélioration de la situation du financement des prises en charge du secteur associatif habilité. L'apurement du passif des charges de financement de ce secteur permet ainsi de mettre fin à une situation particulièrement anormale qui caractérisait pourtant ce champ d'action depuis plusieurs années : la charge de la trésorerie de l'État ne pèse plus sur le secteur associatif habilité.
En matière de performance, il faut relever que le coût d'une journée en centre éducatif fermé est de 627, 86 euros en 2007. Il enregistre une baisse régulière depuis 2005, avec une cible de 616, 40 euros en 2008.
De même, les taux d'occupation des établissements enregistrent des progrès significatifs. Ainsi, ce taux est passé de 67, 8 % pour les centres éducatifs fermés gérés par le secteur public en 2005, à 75 % en 2007, avec une cible de 78 % pour 2008, ce qui explique la baisse du prix de journée par individu.
Je ferai une dernière remarque, non négligeable, sur ce sujet : 64, 1 % des jeunes pris en charge au pénal n'ont ni récidivé, ni réitéré, ni fait l'objet de nouvelles poursuites dans l'année qui a suivi la clôture de la mesure.
Les moyens du programme « Accès au droit et à la justice » diminuent de 2 % en crédits de paiement, en passant de 342 millions d'euros à 335 millions d'euros.
L'action « Aide juridictionnelle » voit en particulier passer sa dotation de 326, 9 millions d'euros en 2007 à 318, 2 millions d'euros, soit une baisse de 2, 7 %.
Cette baisse pourrait susciter l'inquiétude, au vu de la dynamique de ce poste de dépense au cours des dernières années et des revendications récurrentes de la profession d'avocat à propos de l'insuffisance de la rétribution attachée aux missions d'aide juridictionnelle.
Pour autant, les hypothèses retenues par la Chancellerie pour établir le budget de cette action permettent a priori de dissiper d'éventuelles craintes. Ainsi, le nombre prévu de bénéficiaires de l'aide est stable par rapport à 2007 et s'élève à 905 000 admissions. En outre, la Chancellerie anticipe un rétablissement de crédits à hauteur de 8, 9 millions d'euros, au titre d'un meilleur recouvrement des dépenses d'aide juridictionnelle. J'espère qu'elle y parviendra.
Cette prévision est conforme à l'estimation théorique réalisée par l'audit de modernisation sur le recouvrement de l'aide juridictionnelle, l'AJ, paru en février 2007, à condition d'améliorer l'efficacité du recouvrement.
Dans cette perspective, la création d'un nouvel objectif « Améliorer le taux de recouvrement des frais de justice par l'État au titre de l'aide juridictionnelle » apparaît fort utile.
Prolongeant les conclusions de mon récent rapport d'information, j'estime naturellement, madame la ministre, que l'année 2008 doit être celle de la réforme de l'aide juridictionnelle. Nous vous aiderons bien entendu à dissiper tout malentendu.
Le programme « Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés », qui correspond essentiellement à un programme de soutien administratif et logistique de la mission, comprend 261, 8 millions d'euros, soit une progression de 3 %.
Ce programme concerne une large part des crédits informatiques du ministère de la justice. Mais il apparaît difficile de porter un jugement sur la gestion des grands projets menés en la matière. En particulier, il est regrettable qu'aucun indicateur ne porte sur le respect des délais dans le cadre de ces projets.
En conclusion, la justice de notre pays se trouve incontestablement à un tournant. Après la mise en oeuvre réussie de LOLF, voici que se profilent deux nouvelles réformes majeures : la révision en cours de la carte judiciaire et la réforme nécessaire de l'aide juridictionnelle.
Si, comme on l'a vu, l'institution judiciaire est dotée de moyens importants en 2008, cet exercice budgétaire devra offrir l'occasion d'avancées significatives et concertées dans ces deux chantiers essentiels de modernisation, avec pour horizon une justice toujours plus efficace, plus rapide et plus sereine.
Sous réserve de ces remarques, la commission des finances propose au Sénat l'adoption des crédits de la mission « Justice » et de chacun de ses programmes.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, avec une augmentation de ses crédits de 4, 5 % et la création de 1 615 emplois - dont 400 pour les juridictions -, le budget de la justice pour 2008 constitue sans aucun doute un budget privilégié. Sans entrer dans le détail des chiffres, je souhaite insister sur quelques points essentiels.
Le premier concerne l'influence de l'application de la LOLF sur le fonctionnement de l'institution judiciaire : nous en mesurons les conséquences positives dans le projet de loi de finances pour 2008. Les visites que j'ai pu faire tout au long de l'année, m'ont conforté dans l'idée que la démarche de performance et de responsabilisation était désormais bien intégrée par les juridictions. Les succès obtenus dans la réduction des frais de justice en constituent la plus belle démonstration.
Le renforcement des moyens alloués aux services administratifs régionaux, acteurs essentiels de la gestion déconcentrée des crédits de la justice, conforte la nouvelle donne budgétaire. Aussi, madame la ministre, ne pensez-vous pas qu'il serait opportun de donner aux juridictions une plus grande marge de manoeuvre dans l'utilisation des crédits qui leur sont délégués et dans la gestion des emplois ?
Je souhaite parler également de notre système d'aide juridictionnelle que notre collègue Roland du Luart, dans son récent rapport, estime « à bout de souffle ». L'absence de revalorisation de l'aide juridictionnelle dans le projet de loi de finances pour 2008, alors que tout n'a pas été réglé par l'augmentation obtenue en 2007, impose au Gouvernement de trouver une solution acceptable et pérenne.
À titre personnel, je ne suis pas favorable à l'idée d'instaurer un « ticket modérateur » qui resterait à la charge des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Il me semble, en effet, difficilement acceptable de taxer, pour ainsi dire, des personnes aux moyens financiers limités qui sont contraintes de recourir à l'institution judiciaire : ce n'est jamais pour le plaisir que l'on se retrouve devant la justice et rares sont ceux qui ont tendance à en abuser. Madame le garde des sceaux, pouvez-vous nous éclairer sur vos intentions dans ce domaine ?
Je voudrais également évoquer les créations d'emplois de greffiers et de fonctionnaires, au regard des évolutions à venir de l'institution judiciaire. La commission des lois se félicite que la Chancellerie crée en 2008 autant d'emplois de greffiers que de magistrats et qu'elle prenne conscience de la nécessité d'organiser des concours réguliers d'accès à l'École nationale des greffes pour faire face aux nombreux départs en retraite qui s'annoncent.
Toutefois, le déséquilibre entre le nombre de magistrats et le nombre de greffiers reste encore trop important et les créations d'emplois de fonctionnaires des greffes annoncées en 2008, bien qu'appréciables, devront être amplifiées au regard des charges nouvelles résultant de la multiplication des réformes tant en matière civile que pénale. Par exemple, la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs impose une révision de l'ensemble des mesures de protection ouvertes avant son entrée en vigueur : j'ai pu constater quelles inquiétudes cette tâche très importante faisait naître dans les juridictions concernées. Ne serait-il pas temps, madame le garde des sceaux, d'accompagner les projets de loi d'études d'impact afin de s'assurer que les moyens humains seront suffisants pour les appliquer ?
En accélérant la numérisation des procédures ainsi que la modernisation du parc informatique et des techniques de communication, le projet de loi de finances pour 2008 facilitera effectivement le travail des magistrats et des auxiliaires de justice, mais il ne réglera pas tous les problèmes.
De même, si la réforme de la carte judiciaire doit permettre de regrouper en un même lieu des moyens précédemment dispersés, elle ne dispensera pas pour autant le Gouvernement de rétablir un meilleur équilibre entre magistrats, d'une part, et greffiers et fonctionnaires du greffe, d'autre part. À défaut, quel peut être l'effet concret de la décision d'un juge, si celui-ci ne dispose pas d'un greffier pour l'éditer et la notifier dans des délais raisonnables ?
Avant de conclure, je dirai un mot sur la réforme de la carte judiciaire. La commission des lois la juge nécessaire depuis 1996. Je partage cet avis, mais je déplore, à titre personnel, le manque de pédagogie qui a présidé à l'ouverture de ce chantier difficile. Certes, la réalisation d'une telle réforme ne peut donner satisfaction à tous, mais un dialogue plus soutenu avec les acteurs concernés aurait permis de l'engager dans de meilleures conditions, d'autant que ses répercussions sur l'aménagement du territoire seront profondes et qu'elle trahit une approche malheureusement plus statistique que territoriale.
Vous avez indiqué, madame la ministre, que l'objectif de cette réforme était de garantir aux Français une « meilleure justice, plus efficace, plus lisible, plus rapide ». On ne peut qu'approuver un tel objectif.
Pourtant, je ne pense pas que le regroupement des moyens - même accompagné du développement des technologies de l'information et de la communication - puisse toujours compenser l'éloignement des juridictions, notamment pour les personnes n'ayant pas accès à ces technologies et pouvant difficilement s'éloigner de leur domicile. Aura-t-on vraiment réussi à rapprocher le citoyen de la justice, si certains de nos compatriotes rencontrent plus de difficultés à accéder, par exemple, aux tribunaux d'instance qui jugent précisément les contentieux du quotidien ? Mais nous aurons certainement l'occasion d'en reparler dans les prochaines semaines... Quoi qu'il en soit, la mise en oeuvre de cette réforme n'a que peu de conséquences pour le projet de loi de finances pour 2008 et il convient de ne pas se tromper de débat.
Aussi, compte tenu de l'incontestable amélioration prévue des moyens et des effectifs, qui permettra au budget de la justice d'atteindre 2, 4 % du budget de l'État alors qu'il ne dépassait pas 1, 72 % en 2002, la commission des lois émet un avis favorable à l'adoption des crédits consacrés aux services judiciaires et à l'accès au droit.
Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.

Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, mon rapport pour avis sur les crédits consacrés à l'administration pénitentiaire se devait de relever que bon nombre d'indicateurs sont franchement passés au vert.
Si les crédits accordés à la justice progressent de 4, 5 %, contre 1, 6 % en moyenne pour le budget de l'État, la priorité est encore plus affirmée pour la dotation réservée au programme « Administration pénitentiaire », qui augmente de 6, 4 %, représentant 36, 6 % de la mission « Justice » avec une enveloppe de 2, 383 milliards d'euros.
Cette augmentation sensible se justifie pour l'essentiel par l'ouverture de sept nouveaux établissements pénitentiaires en 2008 - trois établissements pour mineurs, une maison d'arrêt, un centre de détention et deux centres pénitentiaires - et l'allocation des moyens nécessaires à leur fonctionnement, ainsi que par la poursuite du programme de réalisation de 13 200 places prévu dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002, la LOPJ.
En 2008, 3 800 places nouvelles seront construites, soit, compte tenu de la fermeture corrélative des places les plus vétustes - et nul ne se plaindra, par exemple, de la fermeture des quartiers Saint-Joseph et Saint-Paul de la maison d'arrêt de Lyon - 3 000 places nettes supplémentaires.
L'augmentation des crédits permettra également la création de 842 emplois en équivalent temps plein travaillé, dont 150 emplois de conseillers d'insertion et de probation. Ils s'ajoutent aux 3 068 emplois votés au terme des lois de finances de 2003 à 2007 qui ont permis de réaliser, dans ce domaine, les objectifs de la loi d'orientation et de programmation pour la justice à hauteur de 82 %, ce qui n'est pas si mal.
L'importance et la continuité de l'effort poursuivi depuis plusieurs années s'avéraient indispensables, compte tenu de la situation de nos prisons et des retards considérables accumulés. Le rapport de la commission d'enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France, présidée par notre collègue Jean-Jacques Hyest, au titre évocateur de Prisons : une humiliation pour la République, en dressait un constat sans complaisance tout en traçant la piste des indispensables réformes. Certes, si beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire.
Je voudrais employer les quelques minutes de temps de parole qui me restent à vous poser quatre questions, madame le garde des sceaux.
Tout d'abord, en dépit de la progression des crédits consacrés à l'entretien du patrimoine immobilier, qui passent de 75 millions d'euros en 2007 à 83, 5 millions en 2008, ceux-ci demeurent bien insuffisants pour faire face à des besoins évalués, à tout le moins, à 150 millions d'euros. Une partie des infrastructures continuera donc de se dégrader. Or, vous savez aussi bien que moi combien le défaut d'entretien d'un bâtiment peut se révéler, à terme, lourd de conséquences pour les finances publiques. Prenons l'exemple de Fleury-Mérogis, dont la rénovation entière se révélera sans doute plus dispendieuse qu'une construction nouvelle ou qu'un entretien régulier. Pouvons-nous espérer de nouveaux efforts sur ce point dès l'an prochain ?
Ensuite, je m'inquiète du déficit en psychiatres publics, alors que l'un des maux les plus graves dont souffrent nos prisons résulte de la présence en leur sein d'un trop grand nombre de malades mentaux. J'ai pu constater, lors de visites aux Pays-Bas et en Belgique, que ces pays voisins ne souffrent pas de cette pénurie de psychiatres, parce qu'ils acceptent de recourir aux services de psychiatres libéraux conventionnés, qui gardent en outre une clientèle privée. Cette solution n'est-elle pas transposable en France, ne serait-ce que pour une période provisoire ?
Par ailleurs, je me suis récemment rendu au Royaume-Uni avec un certain nombre de collègues de la commission des lois : nous avons pu constater que l'incarcération y était beaucoup plus développée qu'en France. Alors que nous n'atteignons pas le ratio de 100 détenus pour 100 000 habitants, nos voisins britanniques avoisinent les 150. Pourtant, nous refusons de nous engager dans une course infernale entre l'augmentation des places disponibles et l'augmentation de la population carcérale. Lorsque le programme de 13 200 places en cours de réalisation sera achevé, il faudra que l'encellulement individuel, qui est un droit depuis 1875, soit devenu une réalité.
Pour cela, il nous faut absolument mettre en place une politique ambitieuse et exigeante d'alternative à l'incarcération et d'aménagement des peines, au risque de devoir parfois revenir sur des réformes récentes. Dans mon rapport, je cite à titre d'exemple un effet pervers de la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs. Celle-ci subordonne la libéralisation conditionnelle d'une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, à une expertise établissant la possibilité de soumettre l'intéressé à une injonction de soins. Or, compte tenu des délais nécessaires pour la mettre en oeuvre, cette disposition interdit en pratique toute libération conditionnelle des personnes condamnées à de courtes peines. La loi pénitentiaire nous offrira-t-elle l'occasion de corriger cet effet que ne souhaitait pas le législateur ?
Enfin, vous le savez, madame le ministre, j'attache une grande importance à la connaissance précise de l'incidence des conditions de détention sur la réinsertion. Je souhaite vivement que le ministère de la justice se dote d'une capacité d'évaluation du taux de récidive en fonction des grandes catégories d'établissements dans lesquels la peine précédant la nouvelle infraction a été exécutée.
Pardonnez-moi d'avoir donné l'impression de m'éloigner par trop des limites du projet de loi de finances pour 2008, mais l'administration pénitentiaire se trouve au milieu du gué. Ce projet de loi de finances ne prendra donc toute sa signification qu'en fonction de la grande loi pénitentiaire dont nous serons bientôt saisis.
Mes chers collègues, au vu du début de mon intervention, il va de soi que la commission des lois a rendu un avis favorable à l'adoption des crédits du programme « Administration pénitentiaire » de la mission « Justice » inscrits dans le projet de loi de finances pour 2008.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, dans le cadre des quelques minutes dont je dispose, il me semble nécessaire d'évoquer l'évolution de l'activité de la protection judiciaire de la jeunesse et les mesures prises pour la moderniser, avant d'examiner les moyens qui lui sont alloués pour répondre à l'ensemble de ses missions.
Ma première observation concernera l'activité de la protection judiciaire. En 2006, près de 335 000 jeunes ont été pris en charge au titre de la protection judiciaire, contre 275 000 à la fin de 2004. Ce total se décompose en 80 000 mineurs délinquants, 240 000 mineurs en danger, 7 700 jeunes majeurs protégés et 5 800 jeunes suivis à la fois au civil et au pénal. Plus des trois quarts ont ainsi été suivis au civil, la moitié par l'État, l'autre moitié par les départements.
Si l'on peut se féliciter de la réduction des délais de prise en charge des mesures judiciaires, les progrès réalisés restent bien entendu en deçà des objectifs fixés par la loi d'orientation et de programmation pour la justice, s'agissant notamment des mesures de milieu ouvert.
En outre, il faut tenir compte des délais de rédaction et de notification des décisions judiciaires imputables aux greffes des tribunaux de grande instance, qui restent importants. On connaît votre souci de les réduire, madame la ministre, mais il serait opportun de nous indiquer quels sont les moyens dont vous entendez vous doter pour améliorer encore la mise en oeuvre des mesures ordonnées par les magistrats.
Ma deuxième observation portera sur le fait que de nombreux efforts ont été entrepris depuis plusieurs années pour moderniser la protection judiciaire de la jeunesse, consistant à diversifier les modes de prise en charge, à rationaliser les moyens et à développer les contrôles.
L'augmentation des taux d'occupation des structures de placement du secteur public mérite d'être soulignée. Elle se traduit par une diminution des écarts de prix de journée avec les structures gérées par le secteur associatif habilité, diminution que nous avions déjà relevée l'an dernier. L'adaptation des structures aux besoins doit être poursuivie.
Ma troisième observation consistera à souligner, comme cela a déjà été fait, notamment, par M. le rapporteur spécial, que la commission des lois se félicite également de l'ouverture, en 2007, des quatre premiers établissements pénitentiaires pour mineurs sur les sept prévus par la loi d'orientation et de programmation de 2002. Leur création avait été recommandée par la commission d'enquête sénatoriale sur la délinquance des mineurs.
La commission des lois se réjouit tout autant de la fermeture corrélative des quartiers pour mineurs de certaines maisons d'arrêt. Ceux des prisons de Lyon étaient de sinistre mémoire, leur fermeture doit être saluée.
Ainsi, la capacité totale d'accueil des mineurs délinquants est actuellement de 1 176 places, dont 860 sont aux normes, réparties entre 66 établissements pénitentiaires. Au 1er janvier 2007, 729 mineurs étaient incarcérés.
Je voudrais insister sur la stabilité du nombre des mineurs incarcérés, lequel est voisin, bon an mal an, de 700. Sans doute cette stabilité est-elle imputable à la création des centres éducatifs fermés, où sont accueillis un certain nombre de mineurs qui auraient été auparavant placés en détention.
Madame la ministre, on peut s'interroger sur ce taux d'occupation. Compte tenu de celui-ci, ne pensez-vous pas que d'autres quartiers pour mineurs pourraient être fermés ?
Enfin, j'insisterai sur la nécessité de développer la coopération entre les services et associations chargés de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi que d'autres services de l'État, notamment les forces de sécurité et l'éducation nationale, et le corps médical, en particulier pour renforcer la prise en charge psychiatrique des mineurs.
À cet égard, vous avez annoncé, madame la ministre, le renforcement, à titre expérimental, des moyens de cinq centres éducatifs fermés en 2008. Pourriez-vous nous dire si ces centres ont vocation à accueillir des mineurs délinquants souffrant de troubles psychiques en provenance de toute la France ou s'il s'agit simplement d'améliorer la prise en charge des mineurs placés par les juridictions dans le ressort desquelles se trouvent lesdits centres ?
L'indispensable modernisation engagée depuis cinq ans permet-elle à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, compte tenu des crédits qui lui sont alloués par ce programme et du niveau de son activité, de remplir ses missions ?
J'observe qu'après avoir progressé de 8, 6 % dans la loi de finances initiale de 2007, les autorisations d'engagement augmenteront en 2008, comme a pu le souligner M. le rapporteur spécial, de 6, 4 %, pour s'établir à 870 millions d'euros, alors que les crédits de paiement n'augmenteront que de l, 6 %, pour atteindre 809 millions d'euros. Ces chiffres sont modestes, puisqu'ils correspondent au taux de croissance des dépenses de l'État.
Par ailleurs, 100 emplois supplémentaires seront créés, essentiellement pour permettre l'ouverture de trois nouveaux établissements pénitentiaires pour mineurs et de dix centres éducatifs fermés.
En outre, conformément aux souhaits exprimés par la commission des lois en 2005 et en 2006, la dette de l'État à l'égard du secteur associatif habilité est en passe d'être apurée, grâce à des dotations complémentaires et à la poursuite de la réduction des dépenses d'hébergement des jeunes majeurs.
J'insisterai enfin sur la double nécessité d'éviter, d'une part, de négliger les mesures de milieu ouvert, d'autre part, de laisser sans soutien les jeunes majeurs.
Je formulerai, en conclusion, deux réflexions personnelles.
Tout d'abord, quand on examine la situation avec un certain recul, les aspérités s'évanouissent. Si l'on met les choses en perspective sur les quatre ou cinq dernières années, c'est-à-dire depuis l'entrée en vigueur de la loi d'orientation et de programmation pour la justice de 2002, il apparaît vain de s'interroger pour savoir si cette programmation a entièrement rempli son office. Faut-il vraiment rappeler que nous avions prévu la création de 600 places en centres éducatifs fermés ? Nous serons un peu en deçà de ce chiffre.
Par ailleurs, alors que nous avions prévu, dans cette même loi, la création de 1 250 emplois au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, celle-ci ne bénéficiera que de 800 emplois nouveaux.
Cependant, cela reste relativement accessoire. Ce que je souhaite, c'est qu'une meilleure articulation s'établisse entre les services. La direction de la protection judiciaire de la jeunesse a maintenant acquis ses lettres de noblesse, et cela est probablement lié à l'importance des crédits qui lui ont été accordés depuis quelques années. Il faut établir des liens beaucoup plus serrés avec les départements et le secteur associatif habilité.
Enfin, il importe bien entendu de s'occuper des personnels - on sait quelles sont les difficultés de recrutement. Je ne peux, à cet instant, ne pas rendre une nouvelle fois hommage à leur abnégation et à leur dévouement.
Au bénéfice de ces observations, la commission des lois invite le Sénat à adopter les crédits du programme « Protection judiciaire de la jeunesse ».
Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.

Mes chers collègues, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque discussion comprend le temps d'intervention générale et celui de l'explication de vote.
En outre, en application des décisions de la conférence des présidents, aucune intervention des orateurs des groupes ne doit dépasser dix minutes.
Enfin, le Gouvernement dispose au total de trente-cinq minutes pour intervenir.
Dans la suite de la discussion, la parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Madame la ministre, c'est un euphémisme que de dire que la politique que vous menez ne suscite ni l'enthousiasme ni l'assentiment des avocats, des magistrats et des personnels relevant de votre ministère. Vous voyez que je m'exprime de manière très mesurée. En réalité, ces professionnels, inquiets, désapprouvent votre politique. Il y a beaucoup d'incompréhension et une dépêche de l'Agence France-Presse diffusée hier fait état d'une « vague profonde de révolte ». Notre collègue Robert Badinter a déclaré qu'il ne se souvenait pas avoir vu autant d'inquiétude, d'amertume, d'anxiété.
Telle est la situation, madame la ministre, et vous comprendrez que, au moment où nous abordons la discussion de votre projet de budget, je ne puisse passer sous silence cet événement majeur que constituent cette incompréhension, cette colère qui se sont encore manifestées hier. Je tenais à vous dire, et ce pourrait être là mon seul message, qu'il faudrait écouter ces professionnels, ouvrir le dialogue, considérer que tout peut être revu, mais ne pas agir d'une manière qui leur donne le sentiment qu'ils ne sont pas compris, ni même entendus.
J'évoquerai maintenant, bien sûr, la question de la carte judiciaire, qui suscite beaucoup d'inquiétude dans toute la France.
Tout d'abord, je trouve profondément anormal que le Parlement n'ait jamais été saisi de ce sujet, pourtant important. Je me permets de suggérer ici la création d'une commission d'enquête parlementaire sur ce thème, qui serait particulièrement opportune dans ces circonstances.
Par ailleurs, ce que nous constatons sur le terrain, dans nos départements, dans nos régions, c'est qu'il s'agit non pas d'une réforme, mais d'un plan de fermeture de tribunaux. Nous ne sommes pas pour le statu quo, nous pensons que des modifications doivent intervenir, mais il aurait fallu d'abord recenser les besoins, définir des orientations, dialoguer avec les personnels, les élus concernés pour bâtir une nouvelle organisation des tribunaux de ce pays.
Au lieu de cela, vous êtes allée, semaine après semaine, annoncer des fermetures de tribunaux. Comment voulez-vous qu'une telle méthode soit féconde, soit comprise, soit positive ?
Enfin, je soulèverai une contradiction : alors que l'on nous a beaucoup parlé, au cours des années précédentes, de justice de proximité - vous connaissez nos réserves à l'égard de l'instauration des juges de proximité -, comment expliquer que l'on porte aujourd'hui atteinte, dans une telle mesure, à la proximité de la justice ?
Je citerai d'ailleurs, à cet instant, le rapport de M. du Luart : « La réforme engagée de la carte judiciaire répond à une exigence d'efficacité, mais elle doit se concilier avec le souci de ne pas éloigner la justice du justiciable. »
Je pense, mon cher collègue, que l'on devrait faire connaître votre rapport dans un certain nombre de communes de ce pays !

M. Roland du Luart, rapporteur spécial. Je vous remercie, mais je ne touche pas de droits d'auteur !
Sourires

En tout état de cause, je trouve que vous dites tout en peu de mots, comme le recommandait Boileau.

J'ai entendu, dans mon département du Loiret, que l'on allait remplacer les tribunaux d'instance qui auront été fermés par des maisons de la justice et du droit. Là encore, je n'ai pas de désaccord de principe avec vous, madame la ministre, sur l'installation de ces maisons. Il en existe une dans la ville où je réside, Orléans, qui accomplit un remarquable travail.
Seulement, on nous a aussitôt indiqué que ces maisons de la justice et du droit ne fonctionneront pas forcément avec un greffier, parce que l'on manque de ces personnels. Attention ! Si vous supprimez des tribunaux d'instance pour les remplacer par des maisons de la justice et du droit dépourvues de personnels formés, vous risquez de ne pas répondre aux attentes de nos concitoyens et de les duper.
Pour ce qui est du coût de votre réforme, je relève qu'il y a tout de même un certain flottement. Madame la ministre, vous avez déclaré, sur Radio Monte-Carlo, qu'elle coûterait 500 millions d'euros.
Ensuite sont apparus deux documents de la direction des services judiciaires, qui à ma connaissance dépend de votre ministère et selon lesquels le coût de la réforme était estimé, à la fin de septembre, à 247, 6 millions d'euros pour les suppressions de tribunaux de grande instance et à 657, 8 millions d'euros pour les suppressions de tribunaux d'instance, de conseils de prud'hommes et de tribunaux de commerce.
Enfin, un communiqué de la Chancellerie, qui relève également de votre autorité, madame la ministre, conteste les chiffres de la direction des services judiciaires.
Vous admettrez que ces flottements sont la marque même de l'improvisation qui caractérise votre démarche !
Pour ce qui est du projet de franchise relatif à l'aide juridictionnelle, je tiens à redire le désaccord total de notre groupe avec cette mesure. Après la franchise sur les dépenses de soins, qui impose aux malades de financer l'assurance maladie, voilà que surgit cette idée nouvelle de faire financer par les victimes l'aide juridictionnelle, ou du moins une partie de celle-ci. Nous sommes en complet désaccord, je le répète, avec cette idée de franchise, qui fait fi de la solidarité.
Après la réforme de la carte judiciaire et la franchise concernant l'aide juridictionnelle, le troisième thème que j'aborderai est celui des personnels.
Le programme « Justice judiciaire » prévoit 29 349 équivalents temps plein travaillé pour 2008, contre 30 301 en 2007. Ces chiffres reflètent donc une diminution des moyens humains.
M. Jean-Paul Garraud, député, explique dans un rapport pour avis que j'ai lu que, derrière cette baisse, se cache en réalité une progression de 389 emplois en ETPT, équivalent temps plein travaillé. Si le plafond d'emplois autorisés pour 2007 a été fixé à 30 301, il a été ramené à 28 960 pour 2007, 1341 postes n'ayant pas été « consommés ». La terminologie en vigueur me semble quelque peu bizarre : que peut donc bien signifier l'expression « consommation de postes » ?
Compte tenu du manque de personnel dans la justice judiciaire et de la mise en oeuvre des différentes lois votées récemment, on comprend mal cette absence de consommation de postes sur laquelle je souhaite vous interroger. Madame la ministre, quelles garanties pourriez-vous nous fournir de votre engagement à « consommer » effectivement les postes, c'est-à-dire à les pourvoir physiquement, durant l'année 2008 ? De même, il m'est difficile de comprendre que la diminution optique du nombre de postes se traduise en réalité par une augmentation.
Par ailleurs, on ne peut que déplorer la dégradation du ratio entre le nombre de magistrats et celui de fonctionnaires des services judiciaires. Ce ratio est passé de 2, 85 en 1997 à 2, 53 en 2007 ...

Il y a qu'un écart de 0, 04 % entre nos deux chiffres, ce n'est pas vraiment un problème !
Mme Dati a déclaré devant la commission des lois de l'Assemblée nationale : « Sans greffier, aucun magistrat ne peut prendre de décision. »

Veuillez conclure, monsieur Sueur. Le temps qui vous est imparti est écoulé.

Madame le garde des sceaux, je voulais aussi vous interroger sur vos intentions concernant le nombre de greffiers.
Je terminerai, monsieur le président, en m'étonnant que les alternatives à la détention soient en régression. Depuis trois mois, le placement sous surveillance électronique a diminué de 13 % et, depuis cinq mois, le placement à l'extérieur sans hébergement pénitentiaire a baissé de 17 %.
M. Tournier, directeur de recherches au CNRS, dans de récents travaux sur la libération conditionnelle, évoqués, à juste titre, par M. Jean-René Lecerf, dans son rapport pour avis, relève que le taux de recondamnation est plus faible pour les condamnés ayant bénéficié d'une libération conditionnelle que pour ceux libérés à la fin de leur peine.
Cela montre bien que la libération conditionnelle a des effets très positifs. Nous ne pouvons donc que nous inquiéter de voir que le nombre de ces libérations régresse.
Par ailleurs, M. du Luart, dans son rapport, souligne que « à supposer que le nombre de détenus reste au niveau actuel et que les prévisions en matière de création de places de détention soient respectées, le nombre de places en prison ne pourra pas égaler à terme le nombre de personnes détenues ».
C'est bien la preuve que la question des alternatives à l'incarcération est centrale. Votre budget n'y répond malheureusement pas.
Pour toutes ces raisons, madame la ministre, vous ne vous étonnerez pas que notre groupe ne puisse voter votre projet de budget.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, une fois n'est pas coutume, nous pouvons pour cet exercice saluer un budget de la justice en très forte progression. Les crédits de la mission « Justice » se trouvent ainsi augmentés de 4, 5 % par rapport à 2007, soit la plus forte croissance après celle d'un autre secteur emblématique, l'enseignement et de la recherche.
Une telle progression est considérable au regard de la croissance globale du budget de l'État pour 2008 qui s'élève à 1, 6 % ; nous devons vous féliciter, madame le garde des sceaux, d'avoir réalisé une promesse du Président de la République, alors candidat.
Ce chiffre est surtout la traduction du caractère prioritaire de la politique menée par le Gouvernement en matière de justice. Longtemps parent pauvre des ministères régaliens, le ministère de la justice est désormais traité en fonction de la place centrale donnée aux politiques judiciaires et pénitentiaires dans la mise en oeuvre d'un État de droit moderne, où le droit n'est pas simplement l'affaire de professionnels qui monopolisent et filtrent les rapports entre l'État et le citoyen, mais le cadre dans lequel le citoyen, et pas seulement le justiciable, défend ses droits et respecte ses devoirs.
S'agissant tout d'abord de l'impératif d'assurer une meilleure efficacité de la justice, le projet de loi de finances envisage une augmentation d'effectifs des magistrats et des greffiers des juridictions. Face à une diminution globale du nombre de fonctionnaires de l'État, ce choix de pourvoir 187 postes de magistrats, et autant pour les greffiers, démontre une nouvelle fois que, dans l'esprit du Président de la République et de la majorité, la nécessaire sortie de la société française de l'enfermement bureaucratique n'est pas incompatible, au contraire, avec un renforcement de l'État dans ses missions essentielles qui doivent demeurer les siennes.
Par ailleurs, une augmentation des crédits des frais de justice est envisagée ; elle aura pour objet d'améliorer la qualité des services rendus au justiciable.
Ensuite, en ce qui concerne la sécurité des tribunaux, le dispositif de surveillance se trouvera renforcé, comme vous vous y étiez engagée à Metz, madame le garde des sceaux, à la suite de l'agression d'un magistrat. En effet, le projet de budget pour 2008 prévoit l'affectation de 39 millions d'euros à cette action contre 15 millions d'euros en 2007.
Quant à l'administration pénitentiaire, les crédits qui lui sont alloués connaissent une très forte augmentation de 6, 4 %. Le programme « Administration pénitentiaire » représente par ailleurs 36, 6 % de la mission « Justice ». Cette importante progression permettra la création de 842 emplois supplémentaires en ETPT pour l'ouverture de sept nouveaux établissements pénitentiaires, dont trois pour les mineurs. Par ailleurs, la loi d'orientation et de programmation pour la justice de 2002 avait prévu la création de 13 200 nouvelles places.
Ce budget est dans la continuité de l'effort particulier engagé pour la création de postes au sein du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Nous ne pouvons que nous en féliciter, car ce service joue un rôle primordial au sein de la prison en assurant le contrôle et le suivi des peines exécutées en milieux ouvert et fermé et parce qu'il favorise également la réinsertion sociale des détenus.
En ce qui concerne l'état de notre parc pénitentiaire, qui est encore indigne d'une démocratie moderne comme la nôtre, nous ne pouvons qu'encourager la poursuite de la rénovation des grands établissements pénitentiaires.
S'agissant de la protection judiciaire de la jeunesse, dont la mission essentielle est la prise en charge et l'accompagnement éducatif sur décision judiciaire des mineurs et des jeunes majeurs, les crédits de paiement ont un taux de croissance équivalent à celui des dépenses de l'État.
Le choix qui a été fait par le Gouvernement est de donner des moyens supplémentaires à l'ouverture d'établissements pénitentiaires pour mineurs et de centres éducatifs fermés, et de créer une centaine de nouveaux postes. Madame le garde des sceaux, permettez-moi de regretter que les moyens financiers alloués à ce programme soient inadéquats au regard de l'augmentation des réponses pénales apportées à la délinquance juvénile.
Enfin, en ce qui concerne l'accessibilité de la justice, la refonte de la carte judiciaire, dont le coût s'élève à 1, 5 million d'euros pour l'exercice 2008, marque une étape décisive. Ainsi, l'installation des pôles de l'instruction, le regroupement des conseils prud'homaux en 2008, suivis de la nouvelle répartition des tribunaux d'instance et de commerce en 2009 et la nouvelle carte des tribunaux de grande instance en 2010, permettront d'adapter enfin l'implantation des tribunaux aux réalités d'une société urbaine tout en rationalisant le travail judiciaire par une meilleure mutualisation de ses services et de son personnel. Nous l'approuvons totalement.
Dans cet esprit, il serait cependant utile que la carte judiciaire comprenne un quatrième volet qui étendrait l'implantation des maisons de la justice et du droit, actuellement au nombre de 123, sur l'ensemble du territoire en prenant comme référence les intercommunalités.
Ces structures qui ont été créées dans le Val d'Oise, en 1990, sur l'initiative de M. Moinard, à l'époque procureur de la République, et que j'ai moi-même contribué à installer sur le territoire de mon intercommunalité, sont des instruments particulièrement efficaces dans le rapprochement de la justice et du citoyen.
En conclusion, le groupe de l'UMP du Sénat est fier de vous apporter son soutien et votera sans hésitation ce projet de budget ambitieux.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Tout d'abord, je tiens à remercier Mme Borvo Cohen-Seat d'avoir bien voulu me laisser sa place en cet instant.
Le budget de la mission « Justice » connaît maintenant depuis plusieurs années - cette tendance ayant été amorcée du temps de votre prédécesseur - un taux de croissance significatif. Je tiens à saluer ce bon budget.
Petit à petit, la justice sort du premier de ses problèmes, le manque de moyens, pour aborder la question plus profonde, dont les aspects sont multiples, de sa rénovation et de sa réorganisation. Madame le garde des sceaux, je vous félicite de vous attaquer à cette vaste tâche avec une résolution à laquelle tout le monde rend hommage.
Le préalable absolu de cette réorganisation de la justice est la réforme de la carte judiciaire. Nous en sommes conscients depuis longtemps, puisque nous avions déjà soulevé ce problème il y a dix ans dans un rapport que j'avais rédigé avec M. Jolibois, au nom de la commission des lois. À l'époque, nous avions souligné que rien ne pouvait être entrepris pour réorganiser notre système judiciaire sans une révision préalable de la carte judiciaire.
Cette révision est nécessaire pour deux raisons, qui sont aussi évidentes l'une que l'autre.
Première raison, notre carte judiciaire, qui est un héritage non pas d'un demi-siècle, mais bien de l'Ancien Régime, voire pratiquement des anciens baillages, ne correspond plus du tout aux nécessités actuelles et à la géographie réelle des contentieux.
Je demande régulièrement que l'on publie la carte des juridictions et les volumes de contentieux pour chacune de ces juridictions. On pourrait y ajouter la carte des villes moyennes ou importantes qui ont un nombre d'affaires très important, mais qui n'ont jamais eu de TGI.
J'évoquais avec M. Philippe Nogrix l'exemple de la ville d'Avranches, où j'ai été élevé, qui avait un TGI pour 7 000 habitants alors qu'à Fougères, où il y avait trois fois plus d'habitants et donc d'activité, il y avait simplement un tribunal d'instance.
La situation était donc très inégalitaire. Nous ne parlons que des communes qui perdent des juridictions sans évoquer celles qui n'en ont jamais eu et qui donc n'ont pas l'occasion de pleurer sur ce qu'elles perdent ! Quelle maigre consolation !
Ce n'est pas la différence entre les situations qui soit choquante en elle-même, puisqu'elle est bien souvent utile. Ce qui est un mal, c'est l'insuffisant volume d'activité de certaines juridictions et la surcharge de certaines autres. Le mal le plus grave, c'est que la charge de travail puisse varier considérablement. À l'époque où nous avons mené notre enquête - je ne pense pas que la situation ait beaucoup changé -, le rapport était de 1 à 5, d'autant que cette disparité en engendre d'autres, notamment en termes de délais de traitement des contentieux.
Lors de cette mission, nous avions rencontré le président du TGI de Meaux qui avait moitié plus d'affaires à traiter que le tribunal de Nancy avec moitié moins de chambres. Il ne pouvait pas ne pas souffrir de cette situation inéquitable et véritablement absurde.
Quant à la seconde raison, nous l'évoquions déjà dans notre rapport il y a dix ans, elle a depuis pris de l'ampleur. Il s'agit de la nécessité de créer des équipes spécialisées, performantes, car notre droit est beaucoup plus sophistiqué qu'il ne l'était auparavant.
Ayant connu la justice et les tribunaux à une autre époque, ce n'est pas sans regret que je vois disparaître les charmes de ce monde d'autrefois.
Nous devons voir les choses en face, car nous sommes aujourd'hui dans un monde nouveau qui se caractérise par des éléments très différents, comme la concentration urbaine, le développement du contentieux de masse, la sophistication du droit, la nouvelle culture des magistrats actuels, qui ont absolument besoin de travailler dans des équipes, et la diversification des modes de traitement.
Pour faire face à cette différence, il faut, c'est certain, restructurer notre appareil judiciaire. Il faut le repenser en profondeur et adopter de nouveaux modes de fonctionnement.
Cette démarche soulève naturellement un certain nombre de questions.
Je dois dire que je supporte mal la protestation des villes moyennes contre la perte de leur tribunal. Je rappelle en effet que de nombreuses villes moyennes, et même parfois de taille plus importante, n'ont jamais eu de tribunaux. Ce fait assez singulier mérite d'être constaté.
Par ailleurs, les temps ont changé : le tribunal d'une ville moyenne ne joue plus le rôle d'animation culturelle et sociale - c'était un milieu humain plein de vitalité - que nous lui avons connu.
Ainsi, la moitié des magistrats ne résident pas dans la ville où ils rendent la justice. Ils résident ailleurs ! Et ceux qui y résident ne sont que très peu liés à la vie locale. M. du Luart sait cela mieux que moi.
C'est à la décentralisation que nous devons aujourd'hui l'animation des villes moyennes. Elle est source de nombreuses activités, de prises de responsabilités, de potentialités. Cela dépasse de beaucoup ce que les tribunaux pouvaient apporter à ces villes, et qu'ils ne leur apportent plus de toute façon aujourd'hui.
On avance l'argument de la proximité, mais c'est un peu la tarte à la crème, enfin ! On ne se rend tout de même pas au tribunal comme on se rend au bureau de poste, ...

M. Pierre Fauchon. ... à l'école ou au marché ! Dieu merci, on y va tout de même moins fréquemment. Il y a même des gens qui n'y vont jamais de toute leur vie. Grand bien leur fasse, car il faut se garder des tribunaux : moins on les fréquente, mieux on se porte !
Sourires

Nous disposons aujourd'hui de modes de communication modernes, qui rendent tout plus proche. On n'est plus obligé de monter sur son cheval de bonne heure le matin pour se présenter devant une juridiction. Tout cela, c'est du passé ! Nous vivons dans le monde moderne !
Je peux vous en parler, madame la ministre, car j'ai exercé la justice dans un pays qui ne vous est pas indifférent, à savoir le Maroc. J'y ai reconstitué la justice sur le terrain, la justice de proximité. Je n'ai pas eu besoin pour cela de multiplier les juridictions. Il suffisait que la juridiction se déplace, tout simplement. Ce que l'on faisait à cette époque-là à dos de mulet ou de cheval, on le fait maintenant en voiture.
À cet égard, j'attache de l'importance à la préservation des audiences foraines, ...

... car la présence physique d'une équipe de juges pendant une journée ou une demi-journée peut, d'un point de vue psychologique, être d'un très grand effet sans pour autant constituer une gêne réelle pour le fonctionnement de la justice ou représenter un coût excessif.
Par les temps qui courent, quand on ne sait pas trop quoi dire, on dit : « Ah ! Ce projet est intéressant, vous avez de bonnes raisons. Tout cela n'est pas mal, mais cela manque de concertation. » Cela manque toujours de concertation, l'argument est commode !
Disons les choses clairement : pour analyser le passé ou la situation actuelle, la concertation ne sert à rien ! Les chiffres sont là, nous les connaissons. Il n'est nul besoin de concertation pour s'apercevoir qu'un tribunal traite quatre fois plus ou moins d'affaires qu'un autre.
En revanche, la concertation a toute sa raison d'être s'agissant de la restructuration.
Pour l'avenir, il faut se garder du mythe des très grandes juridictions, comme du mythe de tout ce qui est très grand, en général. Il faut préserver un niveau moyen, où les gens se connaissent encore, où les responsables de juridiction peuvent assumer leurs responsabilités parce qu'ils connaissent leur monde.
Au-dessous de ce niveau moyen, il ne peut pas y avoir de spécialisation. On n'obtient pas l'efficacité voulue. Au-dessus de ce niveau moyen, on se retrouve avec de grandes juridictions, de vastes machines et, là où l'on pensait réaliser des économies d'échelle, on aboutit à une très grande déperdition en termes de qualité.
Madame le garde des sceaux, il faut s'attacher à trouver le bon niveau, la bonne dimension, afin de répondre aux conditions techniques actuelles. Il ne faut pas aller trop au-delà de ce niveau, sous peine de risquer une massification qui ne serait pas favorable à ce qui me paraît devoir être le point central de nos préoccupations : la restauration dans les juridictions, particulièrement de la part des chefs de juridiction et des chefs de cour, du sens de la responsabilité.
Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.

Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, la justice constitue, on le sait, un élément fondateur de notre République.
J'interviendrai assez brièvement et sur deux points : la carte judiciaire et les rapports entre la presse et la justice.
Je commencerai par évoquer la carte judiciaire.
Je dois vous dire, madame le garde des sceaux, que, sur ce sujet, en basse Normandie, la concertation avec les élus concernés, notamment ceux des communes de Flers et d'Argentan, sous l'égide du premier président de la cour d'appel de Caen, a été très efficace.
On ne peut pas dire - peut-être sommes-nous un cas isolé, mais nous existons, et je voulais en témoigner - que nous n'avons été ni informés ni entendus, je parle du moins de ceux des députés et sénateurs qui avaient bien voulu faire le déplacement, d'abord à la Chancellerie, puis dans les préfectures.
À titre personnel, j'ai été entendue puisque l'Orne conserve deux tribunaux de grande instance : Argentan et Alençon. Nous pouvons nous estimer très heureux de cette issue, qui n'était pas certaine, compte tenu de la faible population de notre département. Là encore, la réalité des territoires a sans doute gouverné ce maintien, et c'est très bien ainsi. Qui s'en plaindrait ?
S'agissant du reste des réformes que vous avez annoncées, j'aimerais réfléchir avec vous à une modification de la répartition des compétences entre les tribunaux d'instance et les tribunaux de grande instance, sur le modèle de ce qui prévaut à Nouméa, par exemple.
Dans le contexte actuel, nous n'avons que deux options : conserver les tribunaux ou les supprimer. Or nous pourrions très bien imaginer d'élargir les compétences du tribunal d'instance afin de mieux « coller » aux besoins des justiciables. Nous savons en effet que les litiges familiaux et les litiges relatifs aux tutelles représentent de 60 % à 80 % du volume des contentieux.
Pour mieux comprendre le sens de ma proposition, je précise que, en matière civile, le tribunal de première instance a la plénitude des compétences dans toutes les matières qui, en France métropolitaine, relèvent du tribunal de grande instance : divorce, adoption, protection de l'enfance, délinquance des mineurs, tutelles, baux d'habitation et saisies-arrêts.
Autrement dit, madame la ministre, une modification de fond des règles de compétence permettrait une réforme beaucoup plus proche et beaucoup moins violente que celle que vous nous proposez aujourd'hui et qui consiste parfois à supprimer les tribunaux.
En basse Normandie, la concertation a abouti à ce type de proposition. J'aimerais, madame la ministre, que vous vous exprimiez sur ce point, car je pense que le Sénat pourrait mener une concertation et réaliser un travail fructueux. Vous n'avez pas manqué de nous dire, à l'occasion de l'examen de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile, combien le travail du Sénat et de sa commission des lois était précieux à la réflexion générale.
S'agissant maintenant des conseils de prud'hommes, la concertation prévue par les textes est en cours, et je tiens à plaider ici une fois encore pour le maintien du conseil des prud'hommes de Flers. Aucune décision n'est encore prise, et c'est tant mieux.
Flers constitue, madame la ministre, la seule création de tribunal d'instance en basse Normandie. Elle correspond à une activité économique majeure. On n'effectuera donc aucune économie d'échelle, aucune économie de personnels ou de locaux - aucune économie d'aucune sorte ! - en transférant ce conseil de prud'hommes à Argentan.
Quant au tribunal d'Alençon, il n'est pas menacé, même si certains élus agitent des peurs qui n'ont pas lieu d'être, pour des raisons électorales liées à l'approche des élections municipales.
Madame la ministre, je vous répète donc qu'on ne peut pas supprimer le conseil des prud'hommes de Flers. Ce serait une hérésie et une décision contre-productive.
Enfin, madame la ministre, je ne veux pas manquer l'occasion qui m'est offerte de vous saisir d'un problème de société, celui des rapports entre la presse et la justice.
Je pense que nous devons engager une véritable réflexion avec tous les acteurs afin de mettre un terme aux dérives d'un journalisme sans scrupule, sans déontologie, en quête de sensationnalisme. Or les journalistes qui sont poursuivis pour diffamation devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris ne risquent qu'une amende inférieure à 10 000 euros. Je pense que ces peines ne sont pas dissuasives.
Par ailleurs, les supports internet qui irradient la galaxie ne sont absolument pas conformes à notre droit de la presse. Madame la ministre, notre droit de la presse date de 1881 !
Je pense que, dans votre oeuvre de dépoussiérage de notre justice, vous seriez bien inspirée, aujourd'hui, de vous attaquer également au droit de la presse !

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je vais également parler de la carte judiciaire. Nous ne pouvons évidemment pas rester insensibles au fort mouvement qui s'est déroulé hier dans les départements - il sera sans doute suivi par d'autres -, même si notre collègue Pierre Fauchon a déjà apporté une réponse à toutes les interrogations, à tous les mécontentements, à la fois des professionnels et de la population !
La réforme de la carte judiciaire concerne un nombre important de juridictions : 319 au total. Il est envisagé de supprimer 23 TGI, 178 tribunaux d'instance, 55 tribunaux de commerce et 63 conseils de prud'hommes.
Ces tribunaux sont supprimés pour des raisons comptables, mais les critères de choix sont flous et fluctuent bien évidemment en fonction des mécontentements des uns et des autres, et de leur poids respectif.
Ainsi la suppression du TGI de Moulins a-t-elle été annoncée à la dernière minute au lieu de celle du TGI de Montluçon. Moulins est pourtant la préfecture de l'Allier et la suppression de son tribunal n'était pas envisagée. De même, la suppression du tribunal d'instance d'Arles - qui perdra également son tribunal de commerce - a été préférée à celle du tribunal d'instance de Tarascon. Vous le voyez, tout cela est très bien pensé !
Vous n'avez cessé, madame la ministre, de parler de concertation. En réalité, les arbitrages ont été faits de manière pour le moins obscure et arbitraire. La réforme devait être le fruit d'un travail réalisé à partir des rapports rédigés par les chefs des trente-cinq cours d'appel. Ces rapports ont été officiellement remis à la Chancellerie le 30 septembre dernier. Or un document émanant de la direction des services judiciaires montre que la liste des vingt-trois villes concernées était déjà établie le 25 septembre !
Certes, d'autres arbitrages ont ensuite été réalisés, mais à la marge, pour des raisons d'opportunité.
Personne ne trouve cette réforme satisfaisante. Rarement un tel front de mécontentement s'est manifesté ! Vous avez réussi à mobiliser les professionnels de la justice, mais aussi les populations et les élus des villes concernées.
On peut toujours dire qu'une telle mobilisation est normale, que c'est toujours ainsi, qu'elle s'explique par les corporatismes des uns et des autres. Mais que dire du corporatisme des parlementaires de la majorité ?
M. Jean-Jacques Hyest s'exclame.

Monsieur Hyest, ils sont tous en tête des manifestations pour défendre leurs tribunaux ! On les y a vus ! Ils défendent leurs tribunaux, tout comme leurs bureaux de poste et leurs hôpitaux, alors que, au Parlement, ils votent leur suppression. C'est bien connu !
Comment en est-on arrivé là ? Le point de blocage, c'est évidemment la forme, mais il y a toujours un rapport entre la forme et le fond.

Je vous dis simplement que les parlementaires et les élus de la majorité participent tous aux manifestations contre la fermeture de leurs tribunaux.

Vous en tirez les conclusions que vous voulez !
Le fond et la forme finissent donc toujours par se rejoindre. Nombreux sont ceux qui plaidaient pour une réorganisation des juridictions en fonction des contentieux, souhaitaient le maintien des juridictions de proximité que sont les tribunaux d'instance et la concentration des contentieux plus complexes ou techniques nécessitant de véritables spécialités juridiques.
C'est d'ailleurs le point de vue que j'ai moi-même défendu, et ce tant dans cet hémicycle qu'à l'occasion de la dernière élection présidentielle. Au demeurant, pendant la campagne, certains membres de la majorité parlementaire, qui soutenaient alors un certain candidat, affirmaient qu'ils n'accepteraient jamais une modification de la carte judiciaire. Ils ont quelque peu changé d'avis depuis...
Madame la ministre, comme cela a été souligné à juste titre, votre réforme consiste à supprimer les juridictions de proximité, à commencer par les tribunaux d'instance, qui en sont l'illustration la plus évidente. Pourtant, nul ne peut nier que ces instances fonctionnent bien. Et si le critère de l'activité judiciaire, auquel M. le rapporteur spécial faisait référence, paraît simple a priori, il ne l'est pas dans les faits.
Mes chers collègues, nombre d'entre vous évoquent souvent, et en n'importe quelle occasion, la nécessité d'utiliser des « moyens modernes ». Honnêtement, traiter le surendettement des affaires familiales par vidéoconférence me paraît complètement surréaliste ! C'est méconnaître la situation concrète, précisément, de la justice de proximité.
En outre, cette réforme ne tient absolument pas compte de la réalité du territoire.
À cet égard, force est de constater que la question de l'aménagement du territoire n'est pas du tout prise en considération. Au nom de la réduction des dépenses publiques, la suppression de nombreux services publics autres que les tribunaux est également envisagée. À l'évidence, voilà un sujet qui mériterait au moins une réflexion d'ensemble.
Après la suppression de trésoreries, de bureaux de poste, de brigades de gendarmerie et, à présent, de tribunaux de proximité, on peut désormais s'attendre à la fermeture de sous-préfectures ou à la disparition de la moitié des brigades de gendarmerie qui existent encore. En clair, c'est la mort des services publics locaux qui est programmée !
Telle n'est pas notre vision du service public. D'ailleurs, comme la situation des territoires où ces suppressions ont déjà eu lieu en témoigne, de telles décisions ne sont pas très positives - c'est le moins que l'on puisse dire - pour le fonctionnement de notre société...
De surcroît, la réforme envisagée est particulièrement onéreuse. Certes, elle est destinée à réaliser des économies. Mais, en réalité, compte tenu de son étalement sur trois ans, elle aura un coût très élevé. En effet, elle va occasionner des dépenses liées au parc immobilier et des dépenses de nature sociale.
Madame la ministre, le 14 novembre dernier, lors de votre audition en commission, vous avez évoqué un programme immobilier portant sur un montant total de 800 millions d'euros sur six ans, hors projet relatif au tribunal de grande instance de Paris. J'ignore s'il s'agit du chiffre qu'il faudra retenir, sachant que nombre de tribunaux occupent aujourd'hui des locaux mis gratuitement à leur disposition par les collectivités locales.
Bientôt, il vous faudra acquérir ou louer de nouveaux bâtiments susceptibles de rassembler les juridictions qui auront été absorbées. À ce sujet, un emprunt est-il réellement envisagé auprès de la Caisse des dépôts et consignations ? Si c'était le cas, cela aurait évidemment un coût pour l'État.
Par ailleurs, la réforme aura également un coût élevé du point de vue des dépenses sociales. En effet, il faudra attribuer des indemnités de déménagement ou d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires qui seront mutés. Mais, il ne faut surtout pas l'oublier, ce sont les justiciables qui en subiront véritablement les conséquences financières. En effet, ils devront parcourir une plus grande distance, ce qui leur créera des frais de déplacement. Au demeurant, ce sont précisément les plus modestes de nos concitoyens qui sont concernés par les contentieux traités dans les tribunaux de proximité.
Il est inquiétant de constater, et M. le rapporteur spécial le faisait remarquer, que le coût total de la réforme ne peut pas être évalué définitivement.
Je m'interroge également sur le fait que la réforme s'accompagne de mesures coûteuses et, parfois, incohérentes. Je pense notamment aux dépenses - tout de même 20 millions d'euros - engagées pour la sécurité des tribunaux, afin d'installer des portiques de sécurité et de recruter des vigiles, et ce dans des juridictions qui vont être fermées !
Au demeurant, nous regrettons les choix qui ont été faits en termes de privatisation de la sécurité des tribunaux. Désormais, la surveillance de ces établissements sera assurée non pas par des fonctionnaires de police, mais par des vigiles travaillant pour des sociétés privées. Nous déplorons également que les mesures d'accueil du public soient, elles, totalement oubliées.
En outre, les salariés ne seront pas non plus épargnés : en décidant de supprimer 63 conseils de prud'hommes, le Gouvernement n'a pas manqué l'occasion de remettre en cause leur droit à se défendre.
Madame la ministre, il n'est pas trop tard pour abandonner votre réforme de la carte judiciaire dans sa version actuelle et pour organiser des états généraux de la justice, ainsi que le réclament de nombreux professionnels.
De surcroît, même si la réforme de la carte judiciaire relève du domaine réglementaire, la mise en oeuvre d'une réorganisation aussi importante de la justice de notre pays impliquerait à tout le moins que le Parlement soit saisi.
D'une manière plus générale, si l'augmentation des crédits de la mission « Justice », à hauteur de 4, 5 %, est indiscutable, elle masque sans doute à la fois le manque de moyens dont notre système judiciaire souffre, notamment par comparaison avec les autres pays européens - d'ordinaire, vous aimez bien les prendre en modèles, madame la ministre, mes chers collègues - et certains des choix qui sont opérés dans ce budget.
Ce sont les crédits affectés au programme « Administration pénitentiaire » qui connaissent la plus forte progression, en l'occurrence 6, 4 %. Mais pour quoi faire, sinon pour augmenter encore et toujours le nombre de places de prison, dans un mouvement qui n'aura évidemment jamais de fin sans toutefois permettre l'encellulement individuel du fait de l'augmentation constante de la population carcérale !
Surtout, je ne vois dans ce projet de budget aucune mesure destinée à améliorer les conditions de détention.
D'ailleurs, madame la ministre, en 2005, j'avais interpellé votre prédécesseur sur des points à la fois précis et modestes, mais qui font le quotidien des prisons, à savoir les postes de télévision dans les cellules ou le prix des produits disponibles au titre de la « cantine ». Il m'avait été répondu que la Chancellerie envisageait la gratuité des téléviseurs et s'apprêtait à mettre en place une mission chargée de réfléchir au mode d'organisation le plus efficace. J'aimerais savoir si cela fera partie des dépenses prévues dans le programme « Administration pénitentiaire ».
Par ailleurs, même si les crédits consacrés à la justice judiciaire sont en augmentation, celle-ci n'est toujours pas en capacité de faire face à sa crise actuelle. Et aux retards actuels s'ajoutent les effets des départs à la retraite, qui, tout comme l'an dernier, ne seront pas rattrapés cette année.
Les objectifs en termes de créations d'emploi de la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice ne sont pas non plus atteints, puisque leur taux de réalisation est de 76 % pour les magistrats et de seulement 32, 6 % pour les fonctionnaires.
S'agissant du programme « Protection judiciaire de la jeunesse », la philosophie est la même que celle guidant le programme « Administration pénitentiaire ». La priorité a été accordée aux mesures d'enfermement, ce qui n'est pas nouveau, et les créations d'emplois permettront, entre autres, d'assurer le fonctionnement à pleine capacité des sept établissements pénitentiaires pour mineurs prévus par la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice.
De tels choix sont-ils vraiment étonnants après l'adoption de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et de la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, qui ont instauré des peines plancher, et avant la discussion de futures lois qui auront certainement pour objet d'ajouter de nouvelles mesures d'enfermement ?
Enfin, permettez-moi d'exprimer ma très vive inquiétude s'agissant du programme « Accès au droit et à la justice », dont les crédits baissent de 2 % par rapport à la loi de finances pour 2007. Alors que la dotation consacrée à l'action « Aide juridictionnelle » avait fait l'objet d'une légère, mais néanmoins réelle, revalorisation l'an dernier, je suis au regret de constater qu'elle diminue de 2, 7 % cette année.
Je suis encore plus inquiète du fait de l'annonce de l'instauration d'éventuelles « franchises juridictionnelles ». Cela a été souligné, nous sommes résolument contre la politique qui consiste à accorder toujours plus d'exonérations de charges aux plus riches et à créer toujours plus de franchises pour les plus pauvres. Cela, nous ne pouvons vraiment pas le cautionner !
Pour toutes ces raisons, je voterai, ainsi que les membres de mon groupe, contre les crédits de la mission « Justice ».
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.
Monsieur le président, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, le budget de la justice pour 2008 est ambitieux.
Je tenais tout d'abord à saluer M. du Luart, rapporteur spécial de la commission des finances, ainsi que MM. Lecerf, Détraigne et Alfonsi, rapporteurs pour avis de la commission des lois, pour la qualité de leur rapport. J'associe à mes félicitations M. Simon Sutour, également auteur d'un rapport.
Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, monsieur Portelli, ce budget témoigne de l'engagement du Gouvernement.
Engagement d'abord à l'égard des Français, qui attendent que la justice s'améliore et se modernise.
Engagement ensuite à l'égard des magistrats et des fonctionnaires du ministère de la justice, auxquels le Gouvernement a voulu donner les moyens de remplir leur mission.
Comme vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur spécial, ce budget bénéficie d'une forte augmentation à la fois de ses crédits et de ses emplois.
Les crédits de la mission « Justice » sont de 6, 519 milliards d'euros, soit une augmentation de 4, 5 %, alors que le budget de l'État ne progresse que de 1, 6 %. Sont ainsi créés 1 615 emplois, qui viendront s'ajouter à ceux qui sont prévus pour le remplacement de tous les départs en retraite.
Monsieur Sueur, je vous précise que le ministère du budget a procédé à des « corrections techniques » des plafonds d'emplois de tous les ministères au printemps de l'année 2007
Dans de nombreux ministères, il y avait des emplois vacants, parfois depuis des années ; ils étaient souvent gelés. Et il n'y avait pas de crédits en face de ces postes. En réalité, de tels emplois n'existaient plus. Les plafonds d'emplois des ministères ont donc été mis à jour, et ce avant même notre arrivée.
C'est sur cette base nouvelle que s'apprécient les créations d'emplois pour 2008 pour tous les ministères.
Les 1 615 créations sont donc réelles et certaines et il suffira de constater sur le terrain qu'il y aura bien 1 615 recrutements supplémentaires.
Depuis mon arrivée à la Chancellerie, j'ai engagé une importante réforme de l'institution judiciaire. Dès l'été, d'importants chantiers de modernisation ont été lancés. La Parlement y a pris toute sa part.
Je vous demande aujourd'hui de soutenir l'effort engagé. Le budget de la justice pour 2008 permettra de continuer la réforme entreprise.
Notre réforme répond à quatre objectifs. Nous voulons rendre la justice plus humaine, plus ferme, plus efficace, mais également plus ouverte.
La justice est humaine quand elle accorde de l'attention aux victimes, qui ont souvent le sentiment d'être délaissées par l'institution judiciaire. J'ai reçu la semaine dernière les représentations d'associations de femmes victimes de violences. Elles m'ont fait part des difficultés rencontrées lors du parcours judiciaire. Il ne faut pas ajouter de la souffrance à la souffrance.
La justice doit être plus à l'écoute des victimes. Nous devons mieux les accompagner tout au long de la procédure judiciaire. Nous devons garantir aux victimes que les peines prononcées seront bien exécutées. Il faut améliorer et simplifier les conditions de leur indemnisation.
Le fonctionnement actuel de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions n'est pas satisfaisant. Les trois quarts des victimes n'y sont pas éligibles et il n'y a pas de véritable suivi de leur indemnisation. J'ai annoncé une série de mesures qui seront mises en oeuvre dès 2008.
Nous créerons un service d'assistance au recouvrement des indemnisations, afin d'aider les victimes non éligibles à cette commission, qui ne devront donc plus effectuer de démarches pour être indemnisées et n'auront aucun frais à avancer pour obtenir les dommages et intérêts auxquels elles ont droit. Elles n'auront plus de contact avec leur agresseur ou avec la personne condamnée : ce service servira d'intermédiaire entre la victime et la personne condamnée.
La Commission d'indemnisation des victimes d'infractions sera donc rendue plus accessible. Son président recevra les attributions de juge délégué aux victimes. Il pourra être saisi par toute personne ayant été victime d'une infraction ou par un avocat. Il sera en contact avec le juge de l'application des peines et le procureur de la République. Le décret sur le juge délégué aux victimes est paru au Journal officiel le 15 novembre dernier et il entrera en vigueur le 2 janvier 2008.
L'action des associations d'aide aux victimes sera plus soutenue. En 2008, les crédits qui leur sont destinés augmenteront de près de 15 %, pour atteindre 10, 9 millions d'euros.
L'accès au droit est une nécessité pour tous. L'an passé, 905 000 justiciables ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. La dépense devrait atteindre 320 millions d'euros en 2007. En 2008, 327 millions d'euros seront disponibles.
Monsieur Détraigne, vous avez évoqué la question de la refonte du système de l'aide juridictionnelle. M. le rapporteur spécial a présenté un rapport sur ce sujet le 9 octobre dernier. Vous proposez tous deux de faire évoluer le dispositif. C'est une réflexion que nous pourrons mener ensemble en 2008.
Par ailleurs, monsieur le rapporteur spécial, je tenais à vous rassurer au sujet du recouvrement des 8, 9 millions d'euros que vous avez évoqués. À ce jour, 8, 7 millions d'euros ont déjà été recouvrés au titre de l'année 2007 et nous parviendrons à faire encore mieux en 2008.
La justice est également plus humaine quand elle garantit la dignité des personnes détenues.
Cette volonté, vous l'avez exprimée. Ainsi, la loi du 30 octobre 2007 a institué un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, auquel vous avez accordé hier 2, 5 millions d'euros de crédits.
Le projet de loi pénitentiaire redéfinira le rôle des prisons. Il améliorera les conditions de prise en charge des détenus. Le 19 novembre dernier, le comité d'orientation restreint m'a remis sont rapport définitif, qui comporte 120 propositions.
Certaines concernent le régime de l'incarcération, ainsi que les droits et devoirs des détenus. Les autres s'attachent à améliorer les conditions de travail des personnels de l'administration pénitentiaire. Elles sont actuellement examinées par les services du ministère.
Un projet de loi est en cours d'élaboration. Je souhaite que vous puissiez l'examiner au cours du premier semestre de l'année 2008.
J'ai entendu les remarques de M. Lecerf sur les limites de la prise en charge psychiatrique dans les prisons. Nous examinerons ce sujet dans le cadre de la future loi pénitentiaire.
Pour répondre à votre question, monsieur Détraigne, cette réforme s'appuiera sur une étude d'impact. Vous avez raison de le rappeler, la mise en oeuvre des lois doit se faire dans de meilleures conditions. Il nous faut plus systématiquement réaliser des études d'impact.
Dans le projet de budget pour 2008, il est prévu la création de 1 100 postes supplémentaires dans l'administration pénitentiaire. C'est un effort tout à fait significatif. Il s'accompagne d'un renforcement de la sécurité des personnels. J'ai signé, le 12 septembre dernier, une convention avec les représentants des exploitants d'hélicoptères. Ce partenariat devrait permettre de réduire le nombre d'évasions par voie aérienne. Parallèlement, des travaux de sécurisation continueront à être réalisés dans les établissements pénitentiaires.
Je précise, s'agissant de ces créations de poste, que l'administration pénitentiaire comprend non seulement le personnel affecté aux établissements pénitentiaires, autrement dit les surveillants, mais aussi les services d'insertion et de probation.
Il n'est pas prévu de transférer à la justice les missions d'escorte et de garde des détenus dans les hôpitaux. Le Président de la République l'a indiqué hier devant les forces de police et de gendarmerie. Ces missions font peser des charges importantes sur ces services, il faut en avoir conscience et tout faire pour les alléger. Une véritable réflexion doit être conduite. Je pense, par exemple, au recours à la visioconférence. Cette technologie limite les déplacements et les escortes. Ce n'est que l'une des pistes qui sont actuellement examinées.
En 2008, sept nouveaux établissements ouvriront leurs portes. Trois d'entre eux seront des établissements pour mineurs.
M. Lecerf a appelé mon attention sur la nécessité de préserver des crédits d'entretien pour l'administration pénitentiaire. Je fais mienne cette préoccupation, tout en notant que cela n'a pas toujours été une priorité. C'est souvent, en effet, l'un des premiers postes budgétaires sacrifiés, mais les choses sont en train de changer. Entre 2003 et 2006, la moyenne des crédits d'entretien a été deux fois et demie supérieure à celle de la période 1999-2002. Ce n'est pas suffisant, mais l'effort sera poursuivi.
Monsieur Alfonsi, compte tenu de l'ouverture de ces établissements, vous m'avez interrogée sur l'opportunité de fermer davantage de quartiers pour mineurs. Dans un premier temps, il est nécessaire de conserver ces quartiers pour mineurs afin d'assurer un maillage territorial. Il est également important que les mineurs puissent rester proches de leurs familles ; c'est aussi un facteur de réinsertion.
Créer des places en détention ne réglera pas tout, vous avez raison de le rappeler. Nous devons mettre en oeuvre une politique ambitieuse d'aménagement des peines. C'est un outil qui facilite la réinsertion et qui limite la récidive.
À l'heure actuelle, seulement 10 % des personnes condamnées bénéficient d'un aménagement de peine. Ce n'est pas suffisant. Le décret que j'ai pris le 16 novembre dernier permet d'aller beaucoup plus loin. Il facilite les aménagements de peine et assouplit le régime des permissions de sortir pour favoriser les démarches de logement et d'emploi. Désormais, le juge de l'application des peines pourra déléguer à l'administration pénitentiaire les permissions de sortir, par exemple pour un rendez-vous à l'ANPE ou à la mission locale. Il ne sera plus nécessaire d'attendre une audience avec le juge.
Aujourd'hui, 2 307 personnes sont placées sous bracelet électronique, 1 724 personnes sont en semi-liberté et 800 personnes en placements extérieurs.
L'effort pour développer les aménagements de peine se poursuivra en 2008. Le budget du ministère de la justice consacrera 5, 4 millions d'euros au financement des bracelets électroniques, fixes ou mobiles ; 3 000 bracelets seront donc disponibles dès 2008.
Comme M. Lecerf, je souhaite développer la libération conditionnelle. Au cours du premier semestre de l'année 2007, je le dis notamment à l'intention de M. Sueur, le nombre de libérations conditionnelles a augmenté de 6 %.
Le taux d'aménagement des peines a donc augmenté de plus de 38 % en un an, ce qui est sans précédent.
Enfin, 1 million d'euros sera destiné au financement des associations qui accueillent des détenus et les accompagnent tout au long de leur aménagement de peine. En leur offrant un logement et un travail, elles augmentent considérablement les chances de réinsertion.
C'est par ces moyens que la justice deviendra plus humaine pour nos concitoyens.
La justice doit également veiller à la sécurité des Français, c'est même sa mission essentielle. Elle doit faire preuve d'autorité et de réactivité quand la situation l'impose.
Mardi dernier, à la suite des événements survenus dans le Val-d'Oise, j'ai demandé aux procureurs de la République de faire preuve de fermeté. Quarante-deux personnes impliquées dans des faits de violences et de dégradations ont déjà été déférées ; vingt et une personnes ont été jugées en comparution immédiate et treize peines d'emprisonnement ferme avec mandat de dépôt à l'audience ont été prononcées.
J'ai également demandé aux parquets d'assurer une information complète et immédiate des victimes. Il est nécessaire de les informer sur leurs droits et sur les suites judiciaires données.
Ces violences ne sont pas acceptables et la justice doit y répondre fermement.
Cette fermeté, nous l'avons manifestée aussi dans la lutte contre la récidive. Vous avez voté la loi du 10 août 2007. Sur son fondement, près de 2 500 décisions ont été rendues à ce jour. Cette loi respecte le pouvoir d'appréciation des juges et le principe d'individualisation des peines. Il n'y a pas d'automaticité de la sanction pénale, il y a seulement la volonté de sanctionner plus sévèrement et plus systématiquement ceux qui multiplient des actes de délinquance.
Chacun est responsable de ses actes. C'est aussi vrai pour les mineurs. J'ai posé un principe clair : « une infraction, une réponse. ». Il ne faut pas que la délinquance des mineurs s'installe. Les mineurs ne doivent pas avoir le sentiment d'être à l'abri de la justice. Entre les mois de juillet et d'octobre, les jugements de mineurs sur présentation immédiate ont augmenté de 30 %.
Le projet de budget améliore la prise en charge des mineurs délinquants. Elle sera plus rapide et plus efficace.
Les centres éducatifs fermés sont une réponse adaptée. Il est vrai, monsieur du Luart, qu'ils ont un coût, mais celui-ci ne tardera pas à se stabiliser. Il convient également de prendre en compte les résultats de ce dispositif : 61 % des mineurs qui en sortent ne récidivent pas. Les centres fermés permettent aux mineurs de réfléchir aux actes qu'ils ont commis. Ils leur donnent la possibilité de suivre un programme scolaire ou d'effectuer une formation. Ils offrent aux jeunes une nouvelle chance. Ils leur donnent les moyens d'affronter plus sereinement l'avenir.
Ainsi, dix nouveaux centres éducatifs fermés ouvriront en 2008. Nous en aurons donc au total quarante-trois d'ici à la fin de l'année 2008.
Par ailleurs, cinq centres à dimension pédopsychiatrique seront également opérationnels. Ils permettront de renforcer l'accompagnement des mineurs en difficultés. Ils ont vocation à accueillir des jeunes de toute la France, monsieur Alfonsi, pour une prise en charge adaptée.
La protection judiciaire de la jeunesse bénéficiera de 100 emplois supplémentaires en 2008. Ils seront destinés à l'encadrement des centres éducatifs fermés et des établissements pénitentiaires pour mineurs. Ils contribueront à améliorer le travail éducatif et à diversifier les prises en charges. C'est un point extrêmement important.
Pour les personnels comme pour les justiciables, nous renforçons la sécurité des palais de justice. Nous avons tous en tête les drames de Metz et de Laon du mois de juin dernier. Ils ne doivent pas se reproduire. Cet été, j'ai débloqué 20 millions d'euros de crédits qui avaient été gelés. Grâce au plan de sécurisation, 209 juridictions ont maintenant un portique de sécurité et 92 % des équipes de surveillance sont aujourd'hui en place. L'effort sera poursuivi en 2008 ; nous y consacrerons 39 millions d'euros.
Madame Borvo Cohen-Seat, vous avez déploré la privatisation de la sécurité. Je vous rappelle qu'une partie de cette surveillance est assurée par les réservistes de l'administration pénitentiaire.
Les chefs de cour et de juridiction jouent un rôle essentiel dans la mise en oeuvre de ce plan. Vous avez souhaité, monsieur Détraigne, leur donner davantage d'autonomie dans la gestion de leurs crédits. Cela a été le cas pour la sécurisation des juridictions. Les chefs de cour et de juridiction disposent donc d'une marge de manoeuvre. Ils peuvent l'estimer insuffisante, mais nous ne sommes qu'au début de l'application de la LOLF.
Pour protéger les Français, il est également essentiel de prévoir des mesures de sûreté contre les pédophiles et les délinquants dangereux en fin de peine.
C'est l'objet du projet de loi que j'ai présenté mercredi en conseil des ministres. Il concerne les personnes qui, condamnées à au moins quinze ans de réclusion pour des crimes commis sur des mineurs, sont toujours reconnues comme dangereuses en fin de peine. Elles pourront être placées dans des centres fermés, où elles bénéficieront d'une prise en charge médicale. Le bien-fondé du placement sera réexaminé chaque année.
Le second volet de ce projet de loi concerne les irresponsables pénaux pour troubles mentaux. Il s'agit de mieux prendre en compte les victimes. La procédure judiciaire ne s'achèvera plus par un « non-lieu ». Ce terme est mal vécu par les familles des victimes. Il donne l'impression que les faits n'ont jamais eu lieu. Désormais, une audience publique sera tenue si les victimes le souhaitent. Les juges pourront ordonner des mesures de sûreté, comme l'interdiction de rencontrer les victimes.
Ce projet de loi est inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale du 18 décembre prochain.
Comme vous l'avez souligné, monsieur du Luart, la justice est en pleine mutation et ses principes fondamentaux évoluent pour mieux s'adapter aux attentes de notre société. La justice doit gagner en fermeté, mais aussi en efficacité. Pour cela, nous devons moderniser l'organisation territoriale de la justice.
Le Parlement a voté la loi du 5 mars 2007 instaurant la collégialité de l'instruction. La collégialité est une réponse au drame d'Outreau. Cette affaire a montré que la solitude du juge pouvait être dangereuse. Il faut que les magistrats puissent échanger entre eux et que les plus expérimentés puissent conseiller ceux qui prennent leurs fonctions.
C'est pourquoi la loi du 5 mars 2007 a prévu en son article 6 que, « dans certains tribunaux de grande instance, les juges d'instruction sont regroupés au sein d'un pôle de l'instruction ». Le Parlement a confié au Gouvernement le soin de fixer par décret la liste des tribunaux concernés.
Il ne peut pas y avoir de pôle de l'instruction dans tous les départements, c'est la loi qui l'indique. Ces pôles seront installés dans les tribunaux de grande instance ayant une activité suffisante pour trois juges d'instruction, ce qui suppose nécessairement une réflexion territoriale. Nous avons recherché un équilibre pour chaque région.
Notre carte judiciaire date de 1958, elle n'a donc pas été modifiée depuis cinquante ans. Chacun connaît les difficultés de fonctionnement qu'elle engendre. Chacun comprend que l'on ne peut pas continuer à disperser nos moyens au sein de 1 200 juridictions, sur 800 sites. Cette réforme est une nécessité, comme l'a très justement souligné M. Pierre Fauchon, dont j'ai beaucoup apprécié la démonstration.
La nouvelle carte judiciaire dessine une justice renforcée, dans l'intérêt des justiciables. J'ai entendu vos interrogations, monsieur Détraigne, madame Borvo Cohen-Seat, et je puis vous assurer que la future implantation des tribunaux correspondra aux réalités démographiques, sociales et économiques de notre territoire. Elle améliorera la qualité et l'efficacité de la réponse judiciaire, comme l'attendent les Français.
La réforme de la carte judiciaire n'a été ni mécanique, ni partisane, ni comptable.
Pour les tribunaux de grande instance, nous avons recherché les meilleurs équilibres locaux. Un tiers des départements en métropole continueront à compter au moins deux tribunaux de grande instance.
Par ailleurs, 176 tribunaux d'instance sur 462 seront regroupés, soit 38 % d'entre eux. Nous n'avons pas créé de « désert judiciaire » puisque nous ne supprimons aucun poste : nous en regroupons et nous en créons.
La proximité de 2007 ne correspond pas à la proximité de 1958.
Aujourd'hui, ce n'est plus la proximité physique du tribunal qui importe, c'est la qualité de la justice rendue.
Madame Borvo Cohen-Seat, vous indiquiez que les affaires familiales étaient des contentieux de proximité, mais celles-ci relèvent de la compétence des tribunaux de grande d'instance, et non pas des tribunaux d'instance. Il importe de le rappeler.
Justement, les tribunaux d'instance renforcés que nous créons auront dans leurs compétences les affaires familiales. Il faut donc dire la vérité aux Français : les contentieux jugés par les tribunaux d'instance ne correspondent pas forcément à la justice de proximité de 2007.
Nous allons expérimenter, dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire, les audiences foraines pour les affaires familiales, que ce soit dans une maison de justice et du droit ou dans un tribunal d'instance renforcé.
Par conséquent, s'agissant de la justice de proximité dont les Français ont besoin, que ce soit pour les affaires familiales ou pour les contentieux dits « civils », les contentieux seront traités par le tribunal d'instance renforcé ou au sein d'une maison de justice et du droit.
Monsieur Sueur, la proximité, c'est la satisfaction rapide du besoin de justice. Et M. Fauchon a raison de souligner que l'on ne va pas au tribunal comme au bureau de poste ou à l'hôpital.
Il convient de faire la différence entre l'accès au droit et l'accès au juge.
Monsieur le sénateur, en matière pénale, on vient généralement vous chercher. En matière civile, nous maintenons la proximité : le contentieux est traité au sein d'une maison de justice et du droit, d'un tribunal d'instance renforcé ou d'un tribunal d'instance regroupé. Pour les contentieux dits de proximité ou civils, je l'affirme à cette tribune, le justiciable n'aura pas à faire les kilomètres que vous indiquez.
Au pénal, comme vous le savez, la victime est prise en charge par la justice quand elle est amenée à se déplacer.
L'Assemblée nationale a d'ailleurs adopté un amendement visant à développer la politique de l'accès au droit en tenant compte des contraintes géographiques.
C'est pourquoi, je tiens à le dire une fois encore à cette tribune, le service public de la justice de proximité ne sera pas supprimé. Il faut dire la vérité aux Français. Nous les écoutons, et ils souhaitent une justice de qualité, rapide et lisible. Quand une décision de justice est rendue, ils souhaitent la comprendre.
Quand, dans une centaine de tribunaux d'instance, il n'y a pas de magistrats, pas de greffiers, pas de fonctionnaires, il faut expliquer aux Français concernés pourquoi ils n'ont pas accès à la justice de la même manière que sur une autre partie du territoire.
Il est donc important de renforcer la présence de la justice sur tout le territoire, pour des raisons d'égalité d'accès, mais aussi pour des raisons pratiques.
En effet, mesdames, messieurs les sénateurs, quand il n'y a qu'un seul juge d'instance dans un tribunal et que celui-ci est appelé à prendre ses congés, part en formation ou, tout simplement, tombe malade, le tribunal d'instance ne peut plus fonctionner. Or il est important d'assurer la continuité du service public de la justice. C'est dans cette optique que nous procédons à des regroupements, à des renforcements et à une augmentation des moyens.
Pour les tribunaux de commerce, 55 ont été regroupés sur 185, soit 30 %. Le transfert des compétences commerciales des tribunaux de grande instance aux tribunaux de commerce nous conduit à créer 56 nouvelles juridictions commerciales.
J'ai entendu que nous n'aurions pas tenu compte des réalités du territoire. Vous constatez que nous avons créé de nombreuses juridictions non seulement civiles, mais également commerciales.
S'agissant des conseils de prud'hommes, le code du travail prévoit une consultation spécifique. Un avis du ministère du travail est paru au Journal officiel du 22 novembre. Les collectivités, les organismes syndicaux et professionnels ont un délai de trois mois pour faire connaître leurs observations aux préfets de département.
Madame Goulet, le conseil des prud'hommes de Flers a traité à peine une centaine d'affaires cette année - cent seize, je crois -, pour trente-deux conseillers prud'homaux...
Comme vous le voyez, il est important de regrouper les moyens de la justice afin qu'elle soit plus efficace.
Je souligne que le regroupement des conseils de prud'hommes n'a pas diminué le nombre de conseillers prud'homaux. Ainsi, les délais sur ces contentieux extrêmement importants pourront être réduits.
Monsieur Sueur, vous avez relevé que cette réforme suscitait des inquiétudes. Je les entends et je les comprends.
Quand une organisation n'a pas changé depuis plus de cinquante ans, voire, comme l'a rappelé M. Fauchon, depuis l'Ancien Régime, sa réforme peut susciter des inquiétudes et quelques mouvements de protestations. Après tout, c'est un signe de bonne santé démocratique !
Il faut tout de même relativiser ces inquiétudes. Hier, les « grévistes » étaient moins de 20 %, nombre « sans précédent », pour reprendre les termes de M. Badinter. Je rappelle qu'ils avaient été 44 %, en 2000, contre la loi relative à la présomption d'innocence présentée par Élisabeth Guigou. Or, à l'époque, il ne s'agissait non pas d'une réforme de structure, mais d'une réforme de procédure.
Dans le même ordre d'idée, les dispositions relatives au suivi socio-judiciaire, issues de la loi de 1998, et la loi instituant le juge des libertés et de la détention ont été mises en oeuvre sans aucun moyen supplémentaire. On s'est contenté de procéder à un redéploiement, et les magistrats en ont beaucoup souffert, comme je peux en témoigner moi-même, car j'étais alors en juridiction.
Pour notre part, nous nous attachons à être extrêmement réalistes. Nous avons en effet un infini respect pour la justice, en particulier pour les magistrats. Nous ne réformons donc pas sans moyens : le budget de la justice est en augmentation, tous les départs à la retraite sont remplacés et nous réorganisons. L'objectif est d'avoir une justice plus efficace et de meilleure qualité.
Nous agissons de même avec les nouvelles technologies, j'y reviendrai, qui permettront d'améliorer les conditions de travail des magistrats et des greffiers. Ils attendaient ce geste depuis 1999 !
Monsieur Sueur, vous indiquez que les parlementaires n'ont pas été associés à la concertation.
Tous ont été entendus lors des réunions régionales.
Cela étant, beaucoup d'élus, notamment de l'opposition, ne sont pas venus à ces réunions pensant que nous ne conduirions pas la réforme à son terme. Ils ont commencé à réagir le jour où les chefs de cours ont remis leurs rapports.
Il est facile de dire ensuite qu'il n'y a pas eu de concertation quand les élus ne se sont même pas déplacés !
S'agissant du comité consultatif, j'ai reçu, non des propositions au cas par cas et cour d'appel par cour d'appel, mais des orientations générales - vous pouvez les consulter en ligne - que j'ai intégrées dans les schémas que nous avons proposés.
Je me suis rendue dans chaque région pour expliquer les propositions fondées sur les rapports des chefs de cours, auxquels je souhaite rendre un hommage particulier. Ils se sont en effet fortement impliqués dans cette concertation. Dire qu'elle n'a pas eu lieu, c'est faire injure à leur travail ! Pendant trois mois, ils se sont mobilisés, ont rencontré tout leur personnel, les fonctionnaires, toutes les professions judiciaires afin de pouvoir rédiger leurs rapports, qu'ils m'ont remis entre le 30 septembre et le 15 octobre. Et c'est dans un souci de transparence que j'ai décidé de mettre en ligne nos propositions concernant la nouvelle organisation judiciaire.
Dans la majorité des cas, les rapports ont été suivis. Dans d'autres cas, des réajustements ont été nécessaires pour tenir compte de l'aménagement du territoire. J'ai également pris en compte les observations de certains élus. Au final, il est de notre responsabilité politique d'arbitrer et de décider de l'allocation des moyens.
Monsieur Sueur, vous demandez la création d'une nouvelle commission. Je vous rappelle qu'il y a déjà eu la commission Outreau.

C'était une commission d'enquête parlementaire ! C'est prévu par la Constitution !
Mais nous n'avons même pas mis en oeuvre toutes les recommandations de la commission Outreau.
Le rapport de la commission d'enquête comprend en effet un volet concernant la réforme de la carte judiciaire, ne serait-ce que s'agissant de la dispersion des moyens, qui, vous ne l'ignorez pas, nuit à la qualité de la justice.
On connaît la technique qui consiste à créer une commission ou un comité pour mieux enterrer une réforme.
Cette réforme n'est ni de droite ni de gauche ! Je vous renvoie aux travaux, dont je me suis inspirée, de Mme Lebranchu, de Mme Guigou ou de M. Nallet.
On n'est jamais satisfait d'une réforme que l'on n'a pas faite !
M. Henri Nallet est venu me voir, et il a salué le courage et le sens des responsabilités du Gouvernement. Il m'a lui-même dit que vous n'aviez pas pu réaliser cette réforme à l'époque, alors que tout le monde considérait qu'elle était indispensable.
Vous me parlez de concertation et d'aménagement du territoire. Mais savez-vous quels étaient les critères retenus à l'époque pour réformer la carte judiciaire ? Pour Henri Nallet, c'était la départementalisation : autrement dit - je réponds là à Mme Borvo Cohen-Seat -, fin de la justice de proximité, fin des tribunaux d'instance ! Pour Mme Guigou, c'était le seuil d'activité : au-dessus, on garde ; en dessous, on supprime !
Ce n'est pas notre méthode. Nous, nous avons choisi la concertation, les propositions des chefs de cours, et nous avons décidé de tenir compte de la réalité du territoire, de l'évolution démographique et du bassin économique.
Je vous en prie, monsieur le président de la commission des lois.

La parole est à M. le président de la commission des lois, avec l'autorisation de Mme le garde des sceaux.

Le Sénat a consacré de nombreux travaux à la justice : je pense au rapport Haenel-Arthuis, au rapport Fauchon-Jolibois ou encore au rapport de la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice : tous concluaient à l'urgente nécessité de réformer la carte judicaire.
On peut toujours dire qu'on est favorable à une réforme, puis ne rien vouloir changer. Cette fois-ci, la réforme est mise en oeuvre, ce dont nous nous réjouissons, car elle est indispensable à l'amélioration de la qualité de la justice.
Rassurez-vous, madame le garde des sceaux, j'ai connu par le passé des réactions à peu près comparables lorsque l'on a enfin réformé la répartition territoriale des commissariats de police et des gendarmeries. Vous, vous avez entrepris de moderniser la justice. Il fallait le faire, et je vous en félicite.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
Sans plus attendre, en effet, nous souhaitons agir. C'est pourquoi nous ne voulons pas de commissions ou de comités supplémentaires.
La réforme de la carte judiciaire se fera progressivement. Étalée sur trois ans, elle commencera en 2008, pour s'achever en 2010.
Un accompagnement social des personnels concernés par la réforme sera mis en place. Il est en cours d'élaboration. Dès 2008, une provision, prévue dans le cadre de ce projet de budget, de 1, 5 million d'euros sera consacrée aux premières mesures d'aide aux personnels.
Nous étudions également les possibilités d'apporter des compensations financières aux avocats touchés par la réforme. À cet égard, j'ai rencontré, le 23 novembre dernier, tous les bâtonniers des barreaux concernés. Nous nous sommes mis d'accord pour examiner des pistes d'accompagnement. Nous devons nous revoir au début de 2008.
Une fois que cette nouvelle organisation territoriale sera stabilisée, il nous faudra réfléchir à une nouvelle répartition du contentieux au profit des justiciables.
Je l'ai évoqué tout à l'heure, pour renforcer son efficacité, la justice doit aussi utiliser les outils de son temps.
Les nouvelles technologies facilitent l'accès à la justice. Elles la rendent plus rapide, plus réactive, plus efficace. Un décret du 15 novembre 2007 prévoit la dématérialisation des procédures pénales ; elle sera donc effective en 2008. La dématérialisation des procédures civiles, quant à elle, interviendra en 2009.
Plus de 67 millions d'euros seront consacrés, en 2008, aux programmes informatiques de la justice.
Par ailleurs, nous souhaitons rendre la justice plus ouverte et faire en sorte qu'elle reflète plus la diversité de notre société.
L'École nationale de la magistrature sera modernisée. C'est la mission de son nouveau directeur. Comme l'ont souligné MM. Fauchon et Gautier dans leur récent rapport, cette école doit former des magistrats efficaces, responsables, ouverts sur le monde. Elle doit développer chez les auditeurs de justice les qualités humaines indispensables à l'exercice de leurs futures fonctions.
La formation des magistrats et des personnels judiciaires sera l'un des chantiers de la présidence française de l'Union européenne. J'ai d'ailleurs demandé à ce qu'un groupe d'auditeurs de justice puisse me suivre dans la préparation de la présidence française de l'Union européenne.
La justice prend également toute sa part dans la politique d'égalité des chances.
Ainsi, une classe préparatoire intégrée à l'École nationale de la magistrature ouvrira en janvier 2008. Elle est destinée à accueillir quinze étudiants de condition sociale modeste qui veulent préparer le concours de la magistrature. Nous avons déjà reçu à ce jour 176 candidatures de toute la France.
D'autres classes préparatoires ouvriront en 2008 à l'École des greffes, à l'École de l'administration pénitentiaire et au Centre national de la protection judiciaire de la jeunesse.
Je souhaite également que les femmes soient mieux représentées au plus haut niveau de responsabilités du corps judiciaire. Je me suis engagée à renouveler et à assurer la parité dans les nominations, en tenant bien évidemment compte des compétences. Dix nouveaux procureurs généraux ont été nommés le 14 novembre - c'est un mouvement sans précédent -, dont cinq femmes.
Cette politique d'ouverture sera encouragée par la mise en place d'une véritable politique des ressources humaines.
La gestion des carrières des magistrats et des greffiers doit être modernisée.
Il y a de nombreux talents dans les juridictions : talents dans l'organisation, talents dans certains contentieux, talents dans les perspectives d'une fonction en administration centrale. Il faut les valoriser. Je pense notamment aux possibilités offertes par les détachements de personnels. Ils donnent la possibilité d'une ouverture vers une autre administration, vers le secteur privé ou vers la sphère internationale. Ce sont toujours des expériences très riches.
En 2008, 400 emplois supplémentaires seront créés au profit des juridictions. Des emplois de magistrats sont destinés aux pôles anti-discrimination, au secrétariat général de tribunaux de grande instance, aux futurs pôles de l'instruction ; d'autres seront utilisés pour des missions de magistrats placés, qui remplacent leurs collègues absents.
Une bonne gestion des ressources humaines, c'est mettre les bonnes personnes aux bonnes fonctions et non pas attendre que celui qui s'est dévoué au service de la justice avec beaucoup de passion et de professionnalisme soit en fin de carrière pour lui proposer un haut poste à responsabilité.
J'ai créé cet été à la Chancellerie une véritable direction des ressources humaines pour améliorer les conditions de carrière des magistrats et des greffiers.
Pour répondre à vos préoccupations, messieurs du Luart et Détraigne, je peux vous dire qu'il y aura autant d'emplois nouveaux de greffiers que d'emplois nouveaux de magistrats, soit 187 magistrats et 187 greffiers. Je partage votre vision des choses : la qualité du travail judiciaire, c'est aussi l'assistance qu'apporte le greffier au magistrat.
Ces créations de postes et le recours aux nouvelles technologies permettront aussi, comme vous l'avez souhaité, de réduire le délai d'exécution des décisions de justice.
Mesdames, messieurs les sénateurs, comme vous le voyez, la justice est en pleine modernisation. Le budget constitue l'un des outils de cette modernisation. Celle-ci demandera de grands efforts. Elle se fera grâce à l'engagement de toutes les forces, de toutes les volontés de notre pays, et donc de la vôtre.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
justice

Nous allons procéder à l'examen de l'amendement portant sur les crédits de la mission « Justice » figurant à l'état B.
En euros
Mission
Autorisations d'engagement
Crédits de paiement
Justice
Justice judiciaire
Dont titre 2
1 860 379 440
1 860 379 440
Administration pénitentiaire
Dont titre 2
1 504 149 003
1 504 149 003
Protection judiciaire de la jeunesse
Dont titre 2
409 352 424
409 352 424
Accès au droit et à la justice
Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés
Dont titre 2
102 768 647
102 768 647

L'amendement n° II-51, présenté par M. du Luart, est ainsi libellé :
Modifier comme suit les crédits des programmes :
En euros

Programmes
Autorisations d'engagement
Crédits de paiement
Justice judiciaireDont Titre 2
Administration pénitentiaireDont Titre 2
Protection judiciaire de la jeunesseDont Titre 2
Accès au droit et à la justice
Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachésDont Titre 2
TOTAL
SOLDE
La parole est à M. Roland du Luart.

Cet unique amendement portant sur les crédits de la mission « Justice » a été déposé en plein accord avec M. le président de la commission des finances.
Les aumôniers jouent un rôle éminent au sein de l'univers carcéral. Ils y accomplissent une mission d'accompagnement importante, du point de vue tant moral que spirituel. Le code de procédure pénale reconnaît d'ailleurs l'assistance spirituelle parmi les actions de préparation à la réinsertion des détenus.
Garants de la modération du message religieux, les aumôniers favorisent en outre une meilleure harmonie entre les personnes dans les lieux de détention. Ils représentent un facteur d'apaisement dans des établissements souffrant malheureusement pour beaucoup d'entre eux de surpopulation et étant, parfois, le théâtre de poussées d'agressivité et de violence.
L'administration pénitentiaire dénombre aujourd'hui 1 015 personnels cultuels. Parmi eux, 325 sont rémunérés et correspondent à 160 emplois équivalents temps plein travaillé.
Leur répartition selon les confessions est la suivante : 536 catholiques, 254 protestants, 94 musulmans, 74 israélites, 16 orthodoxes et 39 représentants des divers autres cultes.
La dotation allouée aux cultes dans cette perspective s'élève, pour 2007, à 1, 7 million d'euros. Elle est inchangée dans le projet de loi de finances pour 2008.
Or, dans l'intervalle, de nouveaux établissements pénitentiaires auront été ouverts. Je pense, en particulier, aux sept établissements pénitentiaires pour mineurs, dont le fonctionnement atteindra sa pleine capacité en 2008.
Cet amendement vise donc à majorer la dotation allouée aux cultes afin de créer de nouveaux postes d'aumôniers de toutes confessions indemnisés dans les établissements.
Plus précisément, cette majoration consiste en un abondement de 150 000 euros de l'action 2 « Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice » du programme « Administration pénitentiaire », gagée par une diminution correspondante des crédits de l'action 4 « Gestion administrative commune » du programme « Conduite et pilotage des politiques de la justice et organismes rattachés ».
Cet effort budgétaire s'inscrit dans le prolongement de celui réalisé, pour un même montant, en loi de finances pour 2007.
Il renvoie également à la prochaine loi pénitentiaire, en cours de préparation, qui consacrera les droits fondamentaux des personnes détenues, notamment en ce qui concerne l'exercice effectif du culte dans chaque établissement pénitentiaire.
L'amélioration des conditions de l'exercice de la liberté du culte en prison correspond à un enjeu essentiel qu'il convient de ne pas sous-estimer.
Si l'église catholique peut s'appuyer, en la matière, sur une longue tradition et une charte de l'aumônerie de prison promulguée en 2007, il n'en va pas nécessairement de même pour d'autres cultes.
Il faut, en particulier, souligner les efforts d'organisation de l'aumônerie musulmane, sous l'impulsion du Conseil français du culte musulman, avec la nomination d'un aumônier national centralisant toutes les désignations d'aumôniers.
Cette structuration se révèle d'autant plus importante qu'elle permet de ne pas laisser place aux courants intégristes dans nos prisons.
La majoration de l'enveloppe demandée a bien évidemment vocation à être répartie entre l'ensemble des cultes.
Tel est l'objet de cet amendement que j'ai déposé à titre personnel, mais, je le répète, avec l'accord du président de la commission des finances.
Je suis totalement d'accord avec les observations qui viennent d'être faites.
Le Gouvernement est évidemment favorable à cet amendement, qui tend à mieux garantir l'accès à tous les cultes.
L'administration pénitentiaire s'est en effet rendu compte que cet accès était également d'un facteur d'apaisement.
L'amendement est adopté.

Nous allons procéder au vote des crédits de la mission « Justice » figurant à l'état B, modifiés.
La parole est à Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Je serai très bref, car j'ai déjà eu l'occasion tout à l'heure d'expliquer les raisons pour lesquelles notre groupe ne pourra voter en faveur de ce budget.
Je veux intervenir de nouveau sur la question de la carte judiciaire et dénoncer le raisonnement que l'on nous oppose.
Certes, la réforme de la carte judiciaire est nécessaire, certes, elle n'a pas été engagée avant ce jour. Cela signifie-t-il pour autant qu'il n'y avait qu'une méthode pour la mettre en oeuvre, à savoir la vôtre, madame le garde des sceaux ? Certainement pas !
Il ne faut pas dire à ceux, très nombreux aujourd'hui, qui contestent la méthode et font part d'un sentiment d'abandon dans un certain nombre de villes, d'arrondissements, de départements de notre pays, que la carte judiciaire est excellente et que tout va bien.
Il ne faut pas leur répondre que, s'ils protestent, c'est qu'ils sont contre toute réforme de la carte judiciaire !
Il aurait été possible, premièrement, d'organiser au préalable un débat devant le Parlement, deuxièmement, de définir des orientations, troisièmement, de prendre le temps de mettre en oeuvre une nouvelle organisation territoriale de la justice.
Vous avez choisi une autre méthode qui a, en effet, été marquée par une grande rapidité d'exécution. La vérité, c'est qu'elle a été perçue et qu'elle est vécue comme une suppression d'un certain nombre de juridictions, sans qu'on voie bien pour autant les avantages d'une orientation nouvelle.
À cet égard, nous pensons vraiment qu'il aurait été possible de procéder autrement. Bien sûr, il est toujours très facile de parler au conditionnel. Mais nous ne pouvons accepter l'argument circulaire qui consiste à dire qu'il n'y a qu'une seule bonne méthode pour réformer, celle qui a été employée, et que celle qui a été employée est naturellement la bonne parce que c'est celle qui a été choisie. À quoi bon discuter, dans ces conditions ?
Nous avons le sentiment qu'il était possible de faire autrement, et j'ai l'impression que cette opinion est largement partagée.

Nous voterons contre ce budget.
Bien évidemment, les réponses apportées ne sont pas satisfaisantes et les arguments avancés pour justifier cette réforme ne répondent ni aux interrogations des gens qui manifestent ni aux interrogations de ceux qui ne manifestent pas, d'ailleurs, mais qui n'en pensent pas moins !
Je suggère simplement aux élus de la majorité d'aller expliquer sur le terrain la réforme de la carte judiciaire et d'essayer de la défendre contre les « trublions » qui voudraient l'empêcher !
Concernant ma position, il est évident que j'étais favorable à la réforme de la carte judiciaire et que je le suis toujours. Cependant, je ne peux accepter ni le sens de cette réforme ni la façon dont elle est conduite !

Dans cette assemblée, nous essayons toujours de prendre des mesures cohérentes.
Force est de constater aujourd'hui que le Gouvernement n'est pas très cohérent dans ce qu'il nous propose.
En effet, de plus en plus, nous faisons appel à la responsabilité territoriale. Nous demandons l'élaboration de projets de développement territoriaux, nous accordons un rôle de plus en plus important aux collectivités dans le maillage et l'animation de l'ensemble du territoire national.
Or, ici, nous avons véritablement l'impression que l'on dévitalise nos territoires, au moment même où nous sommes tous mobilisés et où nous nous battons tous pour les faire vivre.

Certes, dans l'absolu, il était nécessaire d'étudier et de réformer cette carte judiciaire. Mais il faut faire preuve de cohérence : on ne peut pas, d'un côté, dévitaliser les territoires et, de l'autre, exiger la mobilisation des élus !
Il est véritablement très difficile de prendre parti et de s'accorder sur la totalité de l'aménagement de la carte judiciaire proposé.
C'est pourquoi, au sein du groupe UC-UDF, quelques collègues voteront contre ce budget et d'autres s'abstiendront.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
Ces crédits sont adoptés.

Je rappelle que la commission des lois a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.
La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement.
En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame M. François-Noël Buffet membre de la Commission nationale des compétences et des talents.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures.