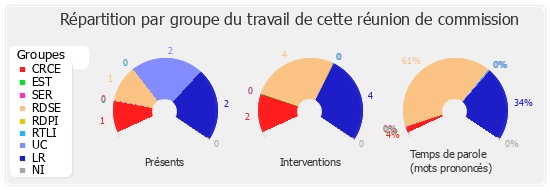Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
Réunion du 25 juillet 2007 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion
La commission a tout d'abord entendu une communication de M. Jean Faure sur la Force de gendarmerie européenne.

a indiqué qu'il s'était rendu, du 21 au 23 mai dernier, avec le Président de la commission, M. Serge Vinçon, à Vincenza, en Italie, au quartier général de la Force de gendarmerie européenne.
Etant donné que la Force de gendarmerie européenne a été créée en 2004 à l'initiative de la France, il semblait en effet particulièrement utile de faire le point trois ans après sa création.
Au cours de ce déplacement, ils ont pu s'entretenir avec les principaux officiers de l'état-major, issus des cinq pays participant à la Force de gendarmerie européenne (la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie et les Pays-Bas), dont son premier commandant, le général de brigade français, M. Gérard Deanaz, qui vient de laisser sa place à un officier des carabiniers italiens.
Ces entretiens ont permis de faire le point sur l'état actuel de la force de gendarmerie européenne et ses perspectives d'avenir.
M. Jean Faure, rapporteur, a, dans une première partie, présenté la situation actuelle de la Force de gendarmerie européenne.
Il a rappelé que la Force de gendarmerie européenne avait été créée en 2004, à l'initiative de l'ancien ministre de la Défense, Mme Michèle Alliot-Marie. Cette force n'est pas un organisme de l'Union européenne, mais une coopération intergouvernementale, une sorte de « coopération renforcée », menée entre cinq pays membres de l'Union européenne.
Les cinq forces de police à statut militaire parties prenantes à cette force sont la garde civile espagnole, la gendarmerie nationale française, l'arme des carabiniers italiens, la maréchaussée royale hollandaise et la garde nationale républicaine portugaise.
Même si la force de gendarmerie européenne pourra être mise à disposition de l'Union européenne, mais aussi de l'ONU, de l'OSCE, de l'OTAN ou d'autres organisations internationales, elle a été d'abord créée afin de contribuer au développement de la politique européenne de sécurité et de défense, et, plus particulièrement, à l'objectif de doter l'Union européenne d'une capacité à conduire toutes les missions d'une force de police lors d'opérations de gestion de crise.
La principale « valeur ajoutée » de la Force de gendarmerie européenne tient au fait qu'il s'agit d'une force « robuste », capable d'agir dans un environnement non stabilisé et de faire face aux différentes situations de maintien de l'ordre et de sécurité publique.
Le caractère « militaire » de cette force lui permet, en effet, d'être utilisée dans un très large spectre de missions, et dans l'ensemble de l'arc de la crise, depuis la phase militaire, jusqu'à la phase de stabilisation, avec une aptitude particulière pour les situations intermédiaires entre la guerre et la paix.

L'expérience des Balkans ou de l'Irak, a souligné M. Jean Faure, rapporteur, montre, en effet, qu'il existe une phase intermédiaire, entre l'action militaire proprement dite et le rétablissement de la paix, qui nécessite une action parfois « musclée » de maintien de l'ordre, pour laquelle ni les responsables militaires, ni les autorités civiles ne sont bien préparés et pour laquelle les forces de police à statut militaire, de type « gendarmerie », paraissent particulièrement adaptées.
En ce qui concerne l'organisation de la Force de gendarmerie européenne, M. Jean Faure, rapporteur, a indiqué qu'à l'image de l'OTAN, la Force de gendarmerie européenne n'est pas un corps de gendarmerie multinational, qu'elle ne dispose pas en propre de personnels ou d'équipements et que chaque composante de cette force reste placée sous les ordres de ses autorités nationales.
Elle comprend un état-major permanent, multinational, modulable et projetable, installé à Vicenza, qui se compose d'une trentaine d'officiers et de sous-officiers supérieurs, issus des cinq pays participant à la force. La répartition des différents postes fait l'objet d'une rotation égalitaire entre les cinq pays tous les deux ans.
Un comité interministériel de haut niveau (CIMIN), composé des représentants des différents ministères des cinq Etats participants, agit comme un véritable conseil d'administration, chargé de la direction politico-stratégique de la Force. Toutes les décisions se prennent à l'unanimité.
Elle dispose d'une capacité initiale de réaction rapide de 800 gendarmes pouvant être déployés sur un théâtre extérieur dans un délai inférieur à 30 jours. L'effectif maximal mis à la disposition de la Force peut atteindre 2 300 hommes et femmes. Les forces sont regroupées en unités, comprenant chacune environ cent vingt gendarmes. La gendarmerie française est le plus gros contributeur en personnels de la Force.
La Force de gendarmerie européenne est financée par des contributions des Etats participants, selon une clé de répartition fondée sur le nombre d'officiers de la nationalité de l'Etat concerné. Le budget dont dispose la Force de gendarmerie européenne est relativement modeste. Pour 2007, il était de 370 000 euros. La France, qui compte sept officiers à l'état-major de la Force, contribue à hauteur des 7/30e ; sa participation est prélevée sur les crédits de la gendarmerie.
M. Jean Faure, rapporteur, a évoqué ensuite les perspectives d'avenir de la Force de gendarmerie européenne.
Tout d'abord, il a mentionné l'existence de plusieurs difficultés de trois ordres différents, qui nuisent à l'efficacité de cette force.
La première tient aux différences d'ordre juridique, administratif ou culturel existant entre les forces de police à statut militaire participant à la Force de gendarmerie européenne. Ces différences n'ont néanmoins pas empêché la création d'un certain sentiment d'identité commune. Ainsi, les membres de cette force portent un insigne spécifique, tout en gardant leurs uniformes nationaux. Ainsi, la gendarmerie nationale française est la seule à ne pas être contrainte par une limite horaire de travail. Ces différences pourraient d'ailleurs s'accentuer avec l'adhésion de nouveaux pays.
Une autre difficulté tient au manque d'inter-opérabilité en raison de la diversité des matériels, notamment dans les transmissions.

Le statut juridique n'est pas non plus très clair, selon M. Jean Faure, rapporteur. En effet, la Force de gendarmerie européenne repose actuellement sur une simple « déclaration d'intention », signée par les cinq gouvernements. Celle-ci devrait être remplacée prochainement par un véritable traité international, soumis à une procédure de ratification par les Parlements nationaux des pays participants.
Ce traité devrait permettre de clarifier un certain nombre de questions d'ordre juridique, comme les droits et obligations du personnel de la Force ou encore le droit applicable dans le cadre d'opérations extérieures.
Enfin, M. Jean Faure, rapporteur, a regretté que, malgré le fait que la force ne compte aucun pays anglophone, l'anglais soit l'unique langue de travail utilisée au sein de la Force de gendarmerie européenne.
Evoquant ensuite l'extension éventuelle de la Force de gendarmerie européenne à d'autres pays, M. Jean Faure, rapporteur, a souligné qu'elle n'est pas un « club fermé », mais qu'elle a vocation à s'élargir à d'autres pays désireux de s'y associer.
Trois conditions doivent être réunies pour faire partie de la Force de gendarmerie européenne :
- être un pays membre de l'Union européenne,
- disposer d'une force de police à statut militaire de type « gendarmerie »,
- qui doit exercer au quotidien toutes les missions confiées habituellement à une force de police.
L'admission de nouveaux pays, comme membre de plein droit, comme partenaire ou observateur, est soumise à l'acceptation unanime des Etats participants.
Plusieurs Etats membres ou pays candidats (Roumanie, Pologne, Turquie) ont déjà déposé formellement leur candidature en 2006.
La Pologne, qui vient de se doter d'une force de police à statut militaire, vient d'ailleurs de se voir reconnaître le statut de pays partenaire de la Force de gendarmerie européenne.
En revanche, la candidature de la Turquie, qui dispose pourtant d'une véritable gendarmerie, très nombreuse et bien équipée, suscite une opposition en raison des réticences de certains pays à l'égard de son adhésion éventuelle à l'Union européenne.
Enfin, il faut souligner que deux « grands » pays de l'Union européenne, le Royaume-Uni et l'Allemagne, qui ne disposent pas de force de police à statut militaire de type « gendarmerie », restent à l'écart de cette initiative.
Enfin, M. Jean Faure, rapporteur, a évoqué l'emploi de la force dans des opérations extérieures.
Il a rappelé que la Force de gendarmerie européenne a été déclarée opérationnelle en juillet 2006 et que deux exercices, avec des troupes déployées sur le terrain, ont été menés en 2005 et en 2006.
En mars 2007, les cinq pays participants ont proposé l'engagement de la Force de gendarmerie européenne dans la mission de police de l'Union européenne « Althea » en Bosnie Herzégovine. La décision n'a toutefois pas encore été prise.
L'emploi éventuel de la force de gendarmerie européenne pour une mission de police au Kosovo a également été évoqué, mais cette idée se heurte à des difficultés d'ordre politique, en raison des divergences entre les pays participants à propos de l'avenir du statut de cette province.
Alors que la France est très favorable à l'idée d'envoyer la Force de gendarmerie européenne au Kosovo, comme l'a confirmé récemment le ministre de la Défense, M. Hervé Morin, lors de son audition devant la commission, cette idée se heurte aux réticences de certains pays participants, qui craignent que l'indépendance de cette province ne crée un précédent et n'encourage les mouvements séparatistes sur leur territoire.
En conclusion, M. Jean Faure, rapporteur, a estimé que, malgré certaines difficultés qui subsistent, la Force de gendarmerie européenne semble aujourd'hui pleinement opérationnelle. Afin que cette force ne demeure pas « virtuelle » et qu'elle puisse faire ses preuves, il lui paraît donc souhaitable de l'engager le plus tôt possible sur le terrain.

A l'issue de cette communication, M. Jean François-Poncet, président, a remercié le rapporteur pour son intervention.
a estimé que la création de la Force de gendarmerie européenne était intéressante, car cette force répondait à un véritable besoin, étant donné que les forces de police à statut militaire sont particulièrement adaptées pour remplir certaines missions de maintien de l'ordre dans le cadre d'opérations extérieures, comme le montre l'expérience des conflits des Balkans.
La structure de cette force semble inspirée de l'OTAN, avec un état-major et des composantes mises à disposition par des pays participants. Il faut toutefois souligner que, seul, un petit nombre d'Etats membres de l'Union européenne disposent d'une force de police à statut militaire de type « gendarmerie » et qu'il existe des différences entre ces composantes.
Enfin, M. Jean François-Poncet, président, s'est étonné que l'anglais soit l'unique langue de travail utilisée au sein de la force, alors même que celle-ci ne compte aucun pays anglophone.

a déploré la mauvaise place du français au sein de la Force de gendarmerie européenne, qui ne semble pas correspondre à la volonté de notre pays de défendre et de promouvoir notre langue sur le plan européen et au niveau international.
a souhaité avoir des précisions sur la représentation de la France au sein de l'état-major. Il a également souhaité savoir si, en dehors de la France, les autres forces de police à statut militaire membres de la gendarmerie européenne avaient déjà été envoyées dans le cadre d'opérations extérieures et s'il était envisageable que la Force de gendarmerie européenne participe à la future mission de l'Union européenne au Tchad.

En réponse, M. Jean Faure, rapporteur, a précisé que la répartition des postes au sein de l'état-major était fondée sur une rotation égalitaire entre les pays participants. Avec sept officiers à l'Etat-major, la France dispose du même nombre d'officiers que ses partenaires. Le premier commandant de la force était d'ailleurs un général français.
a également précisé que, si lors de son déplacement, l'éventualité d'une mission de l'Union européenne au Tchad pour venir en aide aux réfugiés du Darfour n'avait pas encore été évoquée, mais la Force de gendarmerie européenne lui paraissait particulièrement adaptée.

s'étant interrogée sur l'état de préparation de cette force, M. Jean Faure lui a répondu que plusieurs exercices, avec des troupes déployées sur le terrain, avaient été menés en 2005 et en 2006 et que la force semblait aujourd'hui pleinement opérationnelle.

s'est interrogé sur le délai de 30 jours prévu pour l'envoi de la force de gendarmerie européenne dans le cadre d'opérations extérieures.

a répondu que le délai de trente jours pour l'envoi de la force était un délai maximal et M. Jean François-Poncet, président, a précisé que ce délai correspondait au délai maximal prévu pour l'envoi d'une force de police par l'Union européenne.

a rendu compte des travaux conduits avec MM. Jacques Pelletier et Bernard Barraux, de mars à mai 2007, sur le co-développement et les flux migratoires. Elle a précisé que les investigations de la délégation avaient été menées à Paris auprès des ministères concernés, à Bruxelles, auprès des différentes directions générales compétentes, puis au Maroc et au Mali, les deux pays qui concentrent, dans l'immédiat, l'essentiel des actions de co-développement.
Elle a tout d'abord noté que la question des migrations s'affirmait de plus en plus comme un sujet majeur de l'agenda international. Elle a indiqué que très récemment, du 9 au 11 juillet dernier, un forum mondial des migrations s'était ainsi réuni à Bruxelles sous l'égide des Nations unies.
a souligné que dans les années à venir, le phénomène des migrations devrait enregistrer une croissance sans précédent, à la mesure des écarts considérables entre les Etats sur le plan du développement, de la démocratie et de la démographie.
Elle a rappelé qu'entre 1975 et 2003, le nombre de migrants avait plus que doublé, pour atteindre 175 millions de personnes, et que l'Afrique, qui comptait moins de 100 millions d'habitants dans les années 1960, en comptait 600 millions actuellement et devrait en compter un milliard en 2020.
Les projections démographiques laissent ainsi augurer une pression migratoire historiquement inégalée. Elle a estimé que la migration était un phénomène normal, surtout dans le processus de mondialisation, mais que l'on pouvait s'alarmer que dans de nombreux pays, la majorité des jeunes ne puissent concevoir leur avenir qu'en quittant leur pays d'origine.
a observé que si les migrations incontrôlées posaient une série de problèmes aux pays du Nord en termes d'accueil et d'intégration, ils étaient sans commune mesure avec ceux rencontrés par les pays du Sud, principaux destinataires des flux migratoires : 90 % des migrants africains partaient pour un autre pays d'Afrique.
Elle a constaté que les migrations incontrôlées, enjeu économique, enjeu pour l'emploi, pour l'environnement, pour l'Etat de droit, pouvaient l'être également pour la stabilité dans un contexte de repli identitaire comme le montre la crise ivoirienne.
Elle a fait valoir qu'il était donc légitime de lier migrations et développement, mais que la nature de cette relation, complexe, devait faire l'objet d'un examen attentif.
La rapporteure a estimé qu'à long terme, le développement était à l'évidence la meilleure des réponses pour contenir les flux migratoires incontrôlés, mais qu'à court et moyen terme, cette évidence était à nuancer. D'une part, une évolution favorable du niveau de vie des populations augmentait dans un premier temps l'émigration et d'autre part cette émigration apportait une contribution positive au développement : les transferts d'argent des migrants sont plus de deux fois supérieurs à l'aide publique au développement ; ils sont plus fiables et moins soumis à l'évolution des priorités des bailleurs.

a souligné que cette contribution positive des migrants au développement de leur pays d'origine était au coeur de la définition du co-développement.
Elle a rappelé que le co-développement avait occupé une place importante dans la dernière campagne présidentielle, sans toutefois être défini précisément ni signifier selon les uns ou les autres la même chose. Chez nos partenaires du Sud, la confusion était la même, comme la délégation avait pu le constater. Développement concerté pour les uns, réponse aux migrations pour les autres, une clarification de la notion de co-développement s'imposait. S'agissait-il d'une rénovation complète de l'aide publique au développement, dans un sens plus partenarial ? S'agissait-il d'une forme d'accompagnement du retour au pays d'origine des migrants présents sur le sol français ? S'agissait-il enfin du point de convergence entre politique de développement et politique de gestion des flux migratoires, susceptible d'apporter une réponse aux défis migratoires, de façon concertée avec les pays d'origine ?
En tant que politique publique, le co-développement est défini comme le soutien aux initiatives des migrants en faveur de leur pays d'origine.

a tout d'abord rappelé les origines du codéveloppement, et présenté les actions mises en oeuvre à ce titre avant de tirer quelques enseignements pour l'avenir.
Elle a tout d'abord relevé que le co-développement n'était pas exactement une nouveauté. Il était pratiqué depuis les années 1960 par les associations de migrants qui se sont progressivement structurées. Le co-développement en tant que politique publique, objet de la communication, était en revanche plus récent, un peu moins de dix ans si l'on prenait comme point de départ la création d'une mission interministérielle en 1998. Il a été redéfini à plusieurs reprises.
La rapporteure a rappelé que l'idée originelle venait du ministère de l'intérieur et reposait sur le principe que le soutien aux actions menées par les migrants dans leur pays d'origine pouvait faciliter leur intégration dans notre pays. Cette idée était toujours présente aujourd'hui, mais de façon plus secondaire.
a indiqué que le co-développement était ensuite apparu comme une forme particulière de coopération non gouvernementale et avait été soutenu par le ministère de la coopération au même titre que les ONG ou la coopération décentralisée, via des cofinancements.
Plus récemment, le co-développement a été redéfini comme la valorisation de l'action des migrants en faveur de leur pays d'origine, quelle qu'en soit la forme : valorisation de l'épargne au service d'investissements productifs, transfert de compétences, apport d'expériences sociales et culturelles. L'accent est mis sur la mobilité et la circulation entre deux espaces, le pays d'accueil et le pays d'origine. Elle a noté que l'accompagnement du retour des migrants dans leur pays d'origine était rangé sous ce vocable de codéveloppement, et qu'en volume de crédits budgétaires, il en constituait même la substance.
a rappelé que Mme Brigitte Girardin, alors ministre de la coopération, avait énoncé, devant la Commission, les trois axes de la politique de co-développement : le développement local, singulièrement celui des régions d'origine des migrants, la mobilité des personnes et la mobilité de l'épargne des migrants.
Elle a précisé sur ce dernier point que le gouvernement cherchait à renforcer l'information des migrants et par là même la concurrence, sur les différentes offres de transferts disponibles sur le marché. Le coût des transferts est peu transparent et il peut être très élevé (15-20 %) sur les petits montants. En outre, une part très importante empruntait des canaux informels, ce qui est peu fiable pour le migrant et peu souhaitable dans un contexte où l'on souhaite assurer la transparence des circuits financiers, éviter le blanchiment et le financement du terrorisme. L'Agence française de développement a été chargée de développer un site Internet permettant de comparer les offres, sur le modèle du site réalisé par le ministère britannique du développement international. Parallèlement, des réflexions sont menées sur des modes de transferts innovants, sur la mobilisation de l'épargne des migrants avec la création d'un compte épargne co-développement et sur les moyens d'orienter cette épargne, massivement destinée à la consommation (95 %) vers le secteur productif.
Evoquant la mobilité des personnes, le rapporteur a indiqué qu'il était proposé à des migrants qualifiés de transmettre leurs compétences lors de missions de courte durée. S'ajoutaient à cette possibilité des dispositions de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration créant des titres de séjour spécifiques aux étudiants étrangers en première expérience professionnelle, aux saisonniers, ainsi qu'aux professionnels ayant des « compétences et talents » particuliers, dont ils font profiter la France pendant une durée maximale de 6 ans avant de retourner dans leur pays d'origine.
Pour la partie « développement local », le rapporteur a noté que le co-développement avait fait l'objet de réalisations concrètes plus importantes au Maroc et au Mali.
a souligné que, de façon assez classique, des co-financements avaient été apportés à des associations de migrants pour la réalisation de projets locaux (dispensaires, écoles, hydraulique, électrification...). Ils s'associaient parfois, de façon très intéressante, aux initiatives de la coopération décentralisée. Au Mali, dans la région très enclavée de Yélimané, un projet associe des migrants, la coopération française, la ville de Montreuil et le Viet Nam dans un programme de développement agricole de 10 millions d'euros portant notamment sur la culture du riz.
Elle a indiqué qu'une part limitée des crédits était par ailleurs destinée aux initiatives menées par les jeunes issus de l'immigration, en particulier dans le domaine culturel (concerts, expositions...). Ce volet, qui porte sur les échanges entre les deux espaces, rappelle la conception originelle du co-développement, selon laquelle le travail sur l'identité peut faciliter l'insertion dans le pays d'accueil.
Enfin, a ajouté la rapporteure, le dernier aspect du développement local présentait deux aspects, tous deux destinés non pas aux associations mais aux individus.
Le premier aspect est relatif à l'investissement à distance des migrants.
Au Maroc, un programme de construction de gîtes ruraux et de soutien aux entreprises innovantes, géré par l'Agence française de développement, est financé pour un tiers par le migrant, un tiers par la Commission européenne et pour le dernier tiers par un fonds d'amorçage marocain.
Au Mali, un dispositif s'appuyant sur les transferts des migrants prévoit l'octroi de prêts bancaires aux entrepreneurs.
a précisé que le second aspect impliquait, à la différence de tous les autres, le retour du migrant dans le pays d'origine et consistait en sa réinsertion économique. Elle a décrit le mécanisme selon lequel le ministère de la cohésion sociale finance, via l'Agence nationale d'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM), une aide au démarrage de micro-projet à hauteur de 7 000 euros, le ministère des Affaires étrangères assurant, quant à lui, la rémunération de l'opérateur chargé d'accompagner le migrant et, le cas échéant, une étude de faisabilité du projet, dans la limite de 1 300 euros. Au total, le dispositif coûtait donc 8 300 euros cumulables avec l'aide au retour volontaire proposée aux étrangers invités à quitter le territoire français. Elle a indiqué que lors d'une visite de terrain au Mali la délégation avait ainsi visité une école privée, l'atelier d'un tailleur ou encore une petite entreprise de textiles « bio ».
Elle a précisé que ces différents aspects du co-développement pouvaient être insérés dans un accord dit de « gestion concertée des flux migratoires » à l'exemple de celui signé l'hiver dernier avec le Sénégal. Cet accord prévoit, en contrepartie de la lutte contre l'immigration illégale et de la réadmission des clandestins, une circulation facilitée et des actions de co-développement.
Dressant un premier bilan des différents dispositifs, elle a relevé que pour certains, toute évaluation était prématurée, car ils n'avaient encore reçu aucune application concrète, ce qui était le cas du site Internet de comparaison du coût des transferts, de la carte de séjour « compétences et talents », du livre d'épargne co-développement ou encore de l'accord de gestion concertée des flux migratoires avec le Sénégal.
D'autres, quoique lancés, ne sont pas encore opérationnels. Ainsi, les gîtes ruraux du Maroc, sur le point d'être achevés, ne sont pas encore commercialisés.
Pour les autres dispositifs, la rapporteure a estimé que le bilan était contrasté.
Elle a tout d'abord considéré que les dispositifs de soutien à l'investissement à distance, pourtant prometteurs, étaient clairement un échec : seules, trois entreprises innovantes ont été créées au Maroc en quatre ans, deux autres seraient en passe d'être lancées. Quatre bénéficiaires de prêts ont été recensés au Mali, et sur ces quatre bénéficiaires, trois sont défaillants et n'honorent pas leurs remboursements.
Elle a estimé que le bilan de l'aide à la réinsertion était plus positif. 300 projets de réinsertion économique ont été financés en trois ans. 80 % des migrants se sont réinsérés socialement et les trois quarts des entreprises fonctionnaient encore au bout de deux ans, permettant la création d'environ mille emplois.
Quant au développement local, 22 projets avaient été co-financés dans la région de Kayes, principale région d'émigration du Mali, pour un montant de 625 000 euros.
a souligné que d'autres projets de co-développement avaient été lancés dans d'autres pays d'Afrique, le dispositif ayant été élargi en 2006 mais que pour l'essentiel, les réalisations se concentraient au Mali et au Maroc.
La rapporteure a ensuite formulé plusieurs observations.
Tout d'abord, elle a souligné le caractère expérimental de la politique de co-développement, considérant qu'il s'agissait d'un prototype de politique publique qui n'avait pas l'ampleur que l'on pouvait de prime abord imaginer.
Les crédits budgétaires mobilisés restent très limités : 14 millions d'euros sur la période 2003-2006, montant porté à 22 millions d'euros pour 2006-2008.
Les actions de codéveloppement sont sans commune mesure avec la politique d'aide bilatérale au développement et avec les flux migratoires.
Bien que faisant intervenir trois ministères (Affaires étrangères, Intérieur, Affaires sociales), et dans la nouvelle configuration gouvernementale un quatrième, le ministère de l'immigration, elle ne concerne à plein temps qu'un nombre très limité de personnes : un ambassadeur au co-développement assisté d'une équipe restreinte et d'assistants techniques sur place.
Se pose, dès lors, la question de la possibilité du changement d'échelle de cette politique de co-développement pour laquelle les obstacles et les difficultés sont nombreux.
Tout d'abord, elle a noté que si le volume des transferts des migrants était important globalement, les transferts individuels représentaient une capacité d'investissement limitée (évaluée, avec difficultés, à environ 2.000 euros par an et par migrant pour le Maroc). En second lieu, il s'agit de flux privés, dont l'emploi relève de décisions individuelles. Enfin, ces transferts constituent en général un transfert de revenus indispensable pour satisfaire des besoins de consommation courante dans des régions où les opportunités d'investissement sont par ailleurs limitées.
La rapporteure a observé que l'élargissement du champ géographique d'intervention du co-développement nécessitait l'existence de communautés structurées, comme le sont les communautés marocaines et maliennes, au sein desquelles de nombreuses associations ont pour objet le développement du pays d'origine. C'est moins vrai pour des communautés, plus récentes, plus réduites et plus atomisées.
Elle a considéré que la montée en puissance du codéveloppement ne pouvait se résumer à l'augmentation des crédits budgétaires qui y sont alloués.
a estimé que si l'on poussait à l'extrême la logique de l'aide au retour, sa faisabilité financière n'était pas assurée et qu'elle conduirait à privilégier les personnes « passées par la case France », ce qui n'était pas l'objectif de cette politique.
Elle a souligné que, plus que les crédits, c'étaient les projets à soutenir qui faisaient défaut. De surcroît, l'aide financière n'est pas suffisante pour faire du retour un succès : l'accompagnement du migrant dans son projet est déterminant alors que les bailleurs ne sont pas en mesure de l'assurer et que les ONG compétentes ne sont pas nombreuses.
Elle a insisté sur le fait que le passage du micro-projet où le migrant est son propre employeur, à un niveau macroéconomique, où la création d'emplois pourrait avoir des effets significatifs sur la migration restait à réaliser et qu'il se révélait très difficile, car l'ensemble de l'environnement économique était en cause : le co-développement rejoignait ici le développement.
a relevé qu'un autre changement d'échelle envisagé consistait dans l'implication de l'Union européenne.
Elle a indiqué que la délégation avait pu constater à Bruxelles que le co-développement, d'inspiration française, rencontrait un écho favorable. La Commission était disposée à y consacrer des moyens financiers, elle le faisait déjà au Maroc. Elle développait parallèlement un cadre intellectuel fécond, celui de la migration circulaire, qui vise à favoriser la circulation des personnes, notamment dans le cadre de la migration de travail.
a considéré que le cadre réglementaire développé par la Commission était plus convaincant que ses développements opérationnels. Elle a souligné le besoin de pratiques harmonisées en matière d'immigration, par exemple sur la question de la biométrie en matière de visas, et d'un dialogue apaisé avec nos partenaires africains sur la question des migrations, ce que le cadre européen facilite certainement.
Sur le terrain, en revanche, a souligné la rapporteure, les intérêts des Européens diffèrent, en fonction des communautés présentes sur leur sol et elles sont très différentes d'un pays à l'autre. En application de l'approche globale des migrations qui associe la lutte contre l'immigration clandestine à l'encouragement de la circulation des personnes, la Commission conduit un projet emblématique à Bamako avec le soutien de la France et, de façon plus mesurée, de l'Espagne. Ce projet de Centre d'information et de gestion des migrations (CIGEM) a pour objet de favoriser la recherche sur les migrations, d'accompagner les migrants de retour, mais aussi d'informer les candidats à l'émigration sur les risques liés à la migration illégale et sur les opportunités d'emplois dans le pays, dans la sous-région et dans d'éventuels pays d'accueil. Mme Catherine Tasca, rapporteure, a indiqué que ce projet avait paru précipité à la délégation et marqué par une ambiguïté originelle dommageable. Il s'élève à 10 millions d'euros sur trois ans, dont six millions seulement pour des projets concrets, soit à peine plus du double de ce que la France consacre sur trois ans au codéveloppement (2,5 millions d'euros). Mais surtout, il laisse à penser qu'il pourrait s'agir d'une agence d'émigration, sentiment renforcé par la future cohabitation avec le projet de « maison des Maliens de l'extérieur ». Or, il est peu vraisemblable que la France ait des propositions concrètes à faire en matière d'emplois. Enfin l'implication de nos partenaires européens a paru mesurée aux rapporteurs, ce qui risque fort de faire mettre la France en première ligne une fois encore dans ce dossier.
a observé que si le codéveloppement était une politique expérimentale, dont le changement d'échelle semblait malaisé, il ouvrait certaines perspectives pour la politique de développement dont elle se distingue.
Tout d'abord, le dialogue avec les pays d'origine sur la migration est indispensable. Elle a insisté sur le fait que du point de vue des pays d'origine, qu'elle soit clandestine ou non, la migration était positive par les transferts financiers qu'elle permet mais aussi par la soupape sociale qu'elle représente. L'émigration est un enjeu du débat politique intérieur, une exigence des populations à l'égard des autorités. Par conséquent, un constat partagé est un préalable à la recherche de solutions concertées. Les accords de gestion concertée des flux migratoires peuvent être un bon outil, mais ils doivent être équilibrés.
Ce dialogue doit être franc et exigeant, les difficultés économiques n'étant pas seules responsables des migrations. L'absence totale de perspectives de mobilité sociale, la corruption quotidienne ou un environnement des affaires incertain sont autant de leviers sur lesquels les Etats, avec l'appui des bailleurs, doivent agir. Un engagement résolu en matière de « gouvernance » est indispensable.
a souligné que l'aide bilatérale française n'était plus à la hauteur des besoins d'un dialogue équilibré. La France a cédé la première place de bailleur bilatéral du Mali pour occuper le 4e rang. Dans un pays « prioritaire » elle n'intervient qu'à hauteur de 50 millions d'euros.
Sous l'angle de la question migratoire, d'autres secteurs de la politique de développement doivent faire l'objet d'une attention particulière : l'éducation et la formation professionnelle, sinistrées dans les deux pays de la mission mais déterminants, l'accès à l'emploi et le développement du secteur productif, le développement du système bancaire et l'accès au crédit. Sans progrès dans ces domaines, il est illusoire d'espérer un ralentissement de l'immigration.
La question migratoire, a estimé la rapporteure, devait donner l'occasion d'envisager la politique de développement non pas seulement sous l'angle des moyens qui y sont consacrés, mais aussi sous l'angle des résultats. Un partage plus clair entre le ministère des affaires étrangères, chargé de définir la stratégie de développement, et l'AFD, chargée de l'appliquer, est également souhaitable.
En conclusion, Mme Catherine Tasca, rapporteure, a souligné que le co-développement, politique encore largement expérimentale, n'était pas encore à la hauteur des enjeux, tant du développement que de la maîtrise des flux migratoires.
Elle présente l'avantage de rechercher une cohérence dans nos politiques publiques et de montrer que la maîtrise des flux migratoires ne se joue pas seulement aux frontières, mais bien dans des écarts de condition qui rendent les mouvements de population irrépressibles.
Les objectifs du co-développement gagneraient à être clarifiés : s'il s'agit d'accompagner le retour des migrants, il a sa place au nouveau ministère de l'immigration, dont l'évaluation du rôle est, à ce stade, prématurée, et a vocation à rester relativement limité. S'il s'agit d'une politique plus globale, elle interroge en profondeur notre politique de développement, ses instruments et ses priorités, donc le ministère des Affaires étrangères, et doit faire intervenir plus fortement l'AFD.
a rappelé que l'horizon temporel des politiques de développement n'était pas celui de la maîtrise des flux migratoires ; il n'interdisait pas la poursuite d'objectifs communs, dans l'intérêt de notre pays et de ceux avec qui la France partage souvent une langue et une histoire.

A l'issue de l'exposé de la rapporteure, M. Jean François-Poncet, président, a souligné la nécessité de préciser la notion de co-développement, mise en exergue dans les discours, tout particulièrement s'il s'agit d'une politique expérimentale. Il s'est interrogé sur la prise en considération du co-développement conçu comme la mise en oeuvre de politiques de développement concertées dans le rapport présenté par Mme Catherine Tasca.

a souligné que le co-développement était à la fois une ambition et une réalité. L'ambition souhaitable et possible de cette politique est d'être un aiguillon pour la révision des politiques de développement dans un sens plus partenarial, ce qui suppose une conception plus globale et conduit à s'interroger sur la clarification des rôles entre le ministère des affaires étrangères et celui chargé du co-développement.
Elle a observé que les pays partenaires de la France eux-mêmes avaient des conceptions très différentes de cette politique. Les autorités marocaines en ont par exemple une vision très globale de partenariat Nord-Sud dans la mondialisation.
Elle a rappelé que, pour sa part, la délégation s'en était tenue à la définition exposée par le ministre de la coopération devant la Commission.

a souligné la nécessité d'une clarification des relations entre développement et co-développement, dans la mesure où la politique de développement a toujours été co-déterminée avec les pays bénéficiaires. Si l'on veut aller plus loin dans une conception partenariale, il faudrait préciser selon quelles modalités.

évoquant son expérience de coopération décentralisée au Mali, a souligné les difficultés pour sélectionner les projets et pour les accompagner, dans la mesure où la formation des personnes est souvent inadaptée.

a exprimé son inquiétude sur l'articulation entre politique de développement et politique de gestion des flux migratoires, qu'il a jugée illusoire et dangereuse. Il a estimé que l'immigration choisie conduisait au pillage des cerveaux et était un obstacle au développement. Il a considéré que les relations entre la France et l'Afrique devaient être révisées.

a souligné que le choix des micro-projets était effectivement décisif et que les interlocuteurs de la délégation au Maroc avaient parfois souligné leur inadéquation avec les priorités de l'économie marocaine. L'accompagnement des migrants, qui ne sont pas toujours des « entrepreneurs nés », est également une donnée très importante.
Une meilleure place devrait être faite aux projets portés par des initiatives locales, et non venus de l'extérieur. Pour ce qui concerne l'articulation entre la politique de gestion des flux migratoires et la politique de développement, il est vrai qu'il n'y a pas concordance de temps entre ces deux politiques. Pour autant, il est clairement apparu aux rapporteurs que la question migratoire devrait être intégrée dans la politique de développement.
Deux perspectives sont possibles : ou le co-développement se résume à une politique de contrôle de l'immigration, ou il est un instrument du renouveau de la politique de développement.

a fait observer qu'une addition d'initiatives individuelles ne pouvait constituer une politique globale. La question migratoire, pour laquelle la France est en première ligne, appelle une réflexion globale sur le développement.

s'est inquiété de « l'appel d'air » et de l'encouragement à la migration que pourraient représenter les aides au retour. Il s'est interrogé sur leur efficacité.

a indiqué que la délégation s'était interrogée sur les conséquences d'une politique consistant à privilégier des entrepreneurs de projets venus de France. Elle a réfuté les effets incitatifs à la migration des aides au retour, considérant que l'écart des situations suscitait au premier chef les courants migratoires. Le co-développement tente précisément de rendre le retour profitable pour le pays d'origine.

a considéré que le développement était l'un des principaux problèmes auxquels le monde actuel était confronté. Il a estimé qu'il consistait trop souvent à plaquer des solutions venues de l'extérieur sur des réalités nationales, sans les modifier en profondeur. Il a souligné que les compétences et les savoir-faire acquis en France par les migrants pouvaient favoriser une meilleure articulation du développement avec la réalité sociale. Le recours à ce mécanisme pour la gestion des flux migratoires en détournerait l'objet. Le co-développement offre des orientations intéressantes, mais difficiles à mettre en oeuvre. Il a jugé intéressante l'idée de promouvoir le fait d'avoir passé quelques années en France avant de réussir au Mali.
Il a ensuite souhaité que la rapporteure apporte des précisions sur le coût des transferts, la nécessaire structuration des communautés, ainsi que sur le concept de migration circulaire.

a souligné que le coût des transferts tenait pour beaucoup à la faiblesse des circuits bancaires locaux, qui laisse certains prestataires en situation de quasi-monopole.

a rappelé que le projet de création d'une banque d'investissement euroméditerranéenne s'était heurté à l'hostilité des autres banques de développement.

a rappelé qu'une des préconisations de la délégation était le renforcement de l'accès au crédit.

a insisté sur la nécessité de réviser en profondeur les modes de fonctionnement de l'économie mondiale.
A l'issue de ce débat, la commission a donné acte au rapporteur de sa communication, dont elle a autorisé la publication sous la forme d'un rapport d'information.
La commission a ensuite procédé à l'examen du rapport de M. Xavier Pintat sur le projet de loi n° 273 (2006-2007) autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et l'Agence spatiale européenne relatif à l'ensemble de lancement Soyouz (ELS) au centre spatial guyanais (CSG).

a indiqué que l'accord signé le 21 mars 2005 entre la France et l'Agence spatiale européenne concernait la construction par cette dernière, sur le site du Centre spatial guyanais à Kourou, d'un ensemble de lancement destiné à accueillir, à compter de 2009, le lanceur russe Soyouz.
Il a rappelé l'historique de ce programme, qui doit permettre à la société européenne de lancement Arianespace de diversifier sa gamme de lanceurs pour améliorer ses positions sur le marché très concurrentiel des lancements de satellites commerciaux. Aux côtés du lanceur lourd Ariane 5, adapté aux gros satellites de la classe 10 tonnes, ou à l'emport simultané de 2 satellites de 3 tonnes, elle disposera, à compter de 2008, du petit lanceur Vega, en cours de réalisation en Europe et destiné aux lancements de satellites de 300 kg à 2,5 tonnes, puis en 2009 du lanceur moyen Soyouz pour les satellites de l'ordre de 3 tonnes. Lanceur le plus ancien et le plus fiable de l'histoire spatiale, Soyouz est actuellement commercialisé par la société euro-russe Starsem pour des lancements depuis Baïkonour, au Kazakhstan. L'utilisation de Soyouz depuis Kourou prolongera cette coopération en permettant à l'Europe d'éviter le développement de son propre lanceur moyen.
a présenté les grandes lignes de l'organisation du Centre spatial guyanais et précisé les rôles respectifs du Centre national d'études spatiales (CNES), propriétaire des terrains, de l'Agence spatiale européenne, propriétaire de l'ensemble de lancement Ariane et du futur ensemble de lancement Soyouz, et d'Arianespace, en charge de l'exploitation opérationnelle de tous les lanceurs à Kourou.
Le rapporteur a indiqué que le projet « Soyouz à Kourou » représentait un budget global de 344 millions d'euros, dont 121 millions d'euros à la charge d'Arianespace pour les travaux et opérations effectués en amont en Russie, et 223 millions d'euros à la charge de l'Agence spatiale européenne pour la réalisation de l'ensemble de lancement à Kourou. La contribution de l'Agence est répartie entre sept Etats-membres, la France étant le principal souscripteur, avec plus de 63,1 % du financement, soit environ 140 millions d'euros.
a ensuite détaillé les stipulations de l'accord signé le 21 mars 2005 entre la France et l'Agence spatiale européenne, en soulignant qu'il transposait à l'ensemble de lancement Soyouz les principes déjà arrêtés pour Ariane.
L'accord autorise l'Agence spatiale européenne à construire l'ensemble de lancement Soyouz à Kourou. Il définit les responsabilités du gouvernement français, exercées par l'intermédiaire du CNES, en matière de sauvegarde et de sûreté. Il fixe le régime de responsabilité civile pour les lancements Soyouz.
Le rapporteur a estimé que la possibilité de lancer Soyouz depuis Kourou serait bénéfique pour les positions d'Arianespace sur le marché des lancements spatiaux, et qu'elle renforcerait la coopération à long terme entre l'Europe et la Russie dans le domaine spatial, avec la perspective d'une mise au point en commun d'une nouvelle génération de lanceurs. Il a invité la commission à approuver le projet de loi.

A la suite de l'exposé du rapporteur, Mme Maryse Bergé-Lavigne a observé que Soyouz était un lanceur moyen positionné sur la même gamme qu'Ariane 4 et a demandé des précisions sur le devenir de cette dernière. Elle s'est interrogée sur l'impact de l'exploitation de Soyouz à Kourou en termes d'emplois dans la société Arianespace.

a répondu qu'Ariane 4 n'était plus exploitée et que le programme « Soyouz à Kourou » visait à permettre à Arianespace de disposer d'une gamme diversifiée de lanceurs : le lanceur lourd Ariane 5 pour les satellites de 6 à 10 tonnes ou le lancement couplé de deux satellites moyens ; le lanceur moyen Soyouz, pour les satellites de l'ordre de 3 tonnes ; et le petit lanceur Vega, pour les satellites de 300 kg à 2,5 tonnes.
S'agissant de l'impact économique du projet, le rapporteur a précisé que l'exploitation de Soyouz depuis Kourou devait permettre d'améliorer la rentabilité de l'exploitation des lanceurs confiés à Arianespace et d'accroître l'activité économique au sein du département concerné, la création de 250 emplois étant envisagée. Il a également évoqué les retours industriels en Europe liés à l'adaptation de Soyouz en vue de son lancement à Kourou. Enfin, il a souligné que ce programme ouvrait des perspectives pour la conception de nouvelles générations de lanceurs en faisant appel à l'expertise russe.

Après que Mme Maryse Bergé-Lavigne eut indiqué qu'elle s'abstiendrait, la commission a adopté le projet de loi, puis proposé qu'il fasse l'objet d'une procédure d'approbation simplifiée en séance publique.
La commission a ensuite entendu le point d'information de Mme Catherine Tasca sur la convention relative à la Maison de la Francophonie.
En préambule, Mme Catherine Tasca a indiqué qu'elle aurait dû initialement présenter aujourd'hui son rapport sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention relative à la Maison de la Francophonie, mais qu'à la suite de l'intervention de la commission des finances et de M. Adrien Gouteyron, rapporteur spécial de la mission « Action extérieure de l'Etat », le gouvernement avait décidé de ne pas inscrire ce projet de loi à l'ordre du jour du Sénat, comme cela avait été prévu dans le décret de convocation du Parlement en session extraordinaire.

Lors de l'audition du ministre des Affaires étrangères sur l'exécution du budget pour 2006 devant la commission des Finances du Sénat, le mardi 17 juillet, M. Adrien Gouteyron, rapporteur spécial, s'est inquiété de « la dérive des coûts du projet de Maison de la Francophonie », provoquant une polémique reprise dans plusieurs médias (journaux, radio et télévision).
Le lendemain, le Président de la République a demandé au Premier ministre d'expertiser cette question afin de trouver la meilleure solution et, dans l'attente, le gouvernement a jugé qu'il était préférable de ne pas inscrire le projet de loi à l'ordre du jour des travaux du Sénat, sans toutefois le retirer définitivement.

a indiqué qu'elle avait estimé, en accord avec le président de la commission, qu'il était utile qu'elle informe la commission des évolutions de ce dossier, en tant que rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de la convention relative à la Maison de la Francophonie.
a tout d'abord rappelé que l'idée de regrouper dans un site unique, appelé « Maison de la Francophonie », toutes les institutions de la francophonie ayant leur siège à Paris a été évoquée pour la première fois par l'ancien Président de la République, M. Jacques Chirac, lors du Sommet de la francophonie qui s'est tenu à Beyrouth, le 18 octobre 2002.
Actuellement, les institutions de la francophonie présentes dans la capitale (l'Organisation internationale de la francophonie, l'Agence universitaire, l'Association internationale des maires francophones, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, etc.) sont implantées sur sept sites différents, ce qui suscite d'importants doublons.
Après avoir envisagé plusieurs sites, le choix du gouvernement s'est finalement porté sur un bâtiment, situé 20 avenue de Ségur, qui a abrité le siège du ministère des Postes et Télécommunications.
Un tiers de la surface de cet immeuble (soit environ 11 000 mètres carrés) a été rendu disponible par le départ d'agents du ministère de l'économie et des finances.
Le gouvernement a donc estimé que l'on pouvait y installer la Maison de la Francophonie, les deux tiers restants étant actuellement occupés par le ministère de l'Ecologie et du Développement durable.
Le choix de ce site pour installer la Maison de la Francophonie a d'ailleurs reçu, en 2004, l'avis favorable de l'Inspection générale de l'Administration.
Le Gouvernement a donc signé, le 28 septembre 2006, une convention avec l'Organisation internationale de la Francophonie, prévoyant la mise à disposition à titre gratuit et pour une durée de trente ans, renouvelable, après achèvement des travaux d'aménagement, de locaux dans ce bâtiment destinés à l'installation de la Maison de la Francophonie.
Etant donné qu'il s'agit d'un bâtiment assez ancien (il date des années 1930), il a toutefois été jugé nécessaire de le rénover.
Le coût de la rénovation de l'ensemble de ce bâtiment a d'abord été évalué à 35 millions d'euros.
a précisé que sur ces 35 millions d'euros, seul un tiers, soit 12 millions d'euros, était directement lié à l'installation de la Maison de la Francophonie.
De plus, elle a indiqué qu'il était prévu que l'Organisation internationale de la francophonie contribue à cette charge par la vente des deux immeubles qu'elle possède, l'un à Paris, quai André Citroën (estimé à 8 millions d'euros), l'autre situé à Bordeaux, d'une valeur de 3 millions d'euros.
Au total, la charge pour l'Etat de l'installation de la Maison de la Francophonie était donc de l'ordre d'1 million d'euros dans la première évaluation.
Le coût de la rénovation de l'ensemble du bâtiment a ensuite été porté en juillet 2006, de 35 à 60 millions d'euros, à la suite de la découverte d'amiante dans les sols.
Puis, en janvier 2007, ce montant a été porté à 85 millions d'euros, 25 millions d'euros supplémentaires étant nécessaires pour mettre l'immeuble aux normes thermiques, à la suite de la demande du ministère de l'Eologie et du Développement durable.
On peut certes s'étonner de l'amplitude de la variation des montants en jeu et regretter la mauvaise évaluation financière initiale de ce projet, a noté Mme Catherine Tasca, rapporteure, mais on ne peut pas pour autant accuser la Maison de la Francophonie d'être à l'origine de ces surcoûts et encore moins d'un véritable scandale financier, qui coûterait plus de 550 millions d'euros aux contribuables français, tel que le rapportait le journal Le Figaro, a-t-elle estimé.
Elle a rappelé que la Maison de la Francophonie n'est concernée que pour un tiers de la surface du bâtiment. Etant donné que le coût de la rénovation de l'ensemble du bâtiment est évalué à 85 millions d'euros, la Maison de la francophonie est concernée pour 28,3 millions d'euros, dont il faudrait retrancher le produit de la vente des deux immeubles que possède l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) (soit 11 millions d'euros), ce qui ferait donc un total d'environ 17 millions d'euros pour la Maison de la Francophonie.
Selon Mme Catherine Tasca, rapporteure, on ne peut pas non plus prétendre sérieusement ajouter à ce montant le coût du déménagement et de l'installation provisoire du personnel du ministère de l'Ecologie et du Développement durable dans un autre site pendant toute la durée des travaux.
En réalité, le projet de Maison de la francophonie semble faire les frais des nombreux atermoiements du ministère de l'Ecologie et du Développement durable, directement à l'origine du retard pris dans la rénovation du bâtiment, a estimé Mme Catherine Tasca, rapporteure.
A ce jour, on ne sait toujours pas si le ministère de l'Ecologie et du Développement durable réintégrera ou non le bâtiment à l'issue des travaux.
Par ailleurs, on peut s'étonner qu'au même moment, l'annonce du rachat par l'Etat du bâtiment de l'Imprimerie nationale pour un montant de 376,7 millions d'euros, alors que l'Etat l'avait cédé il y a quatre ans au fond d'investissement américain Carlyle pour une somme de 85 millions d'euros n'ait pas suscité plus de réactions. Il semblerait pour Mme Catherine Tasca, rapporteure, que la francophonie soit une cible plus facile que les fonds de pension anglo-saxons.
Après ce rappel des faits, Mme Catherine Tasca, rapporteure, a souhaité faire trois observations.
Tout d'abord, elle a rappelé que personne ne conteste le bien-fondé du projet de créer une Maison de la Francophonie à Paris, pour regrouper sur un site unique des organismes aujourd'hui dispersés sur sept sites différents.
Il devrait donc entraîner une réduction des coûts de fonctionnement par la suppression des frais de location (évalués à 1,7 million d'euros par an) et la mise en commun de certains services (comme, par exemple, le service de l'accueil, de la sécurité, du courrier ou de l'informatique). Surtout, il devrait faciliter le travail en commun des différents organismes. Il participe donc au mouvement actuel de modernisation institutionnelle de la francophonie, et notamment à l'unité de commandement décidée lors du Sommet de Ouagadougou, en novembre 2004.
Ensuite, Mme Catherine Tasca, rapporteure, a rappelé que la mise à disposition par la France d'un bâtiment pour accueillir la Maison de la Francophonie correspondait à une obligation d'Etat-hôte, c'est-à-dire aux engagements internationaux de la France.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur spécial, a évalué à 14 millions d'euros par an le coût pour l'Etat de l'abandon de loyer du bâtiment situé au 20 avenue de Ségur. Mais peut-on réellement parler d'abandon de loyer pour un bâtiment mis à la disposition d'une organisation internationale ? Ce serait comme si on essayait d'évaluer le coût de la mise à la disposition par l'Etat du bâtiment accueillant le siège de l'UNESCO, a estimé Mme Catherine Tasca.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur spécial, a préconisé la vente de l'immeuble de l'avenue de Ségur et l'achat d'un autre bâtiment, sans travaux, pour accueillir la Maison de la Francophonie, ce qui a toujours été l'option privilégiée par les ministères de l'Economie et des Finances. Mme Catherine Tasca, rapporteure, a indiqué que cette proposition devait être accueillie avec prudence, étant donné qu'il faut tenir compte de la décision qui sera prise de réinstaller ou non le ministère de l'Ecologie et du Développement durable dans le bâtiment du 20 avenue de Ségur, de la difficulté de trouver des locaux équivalents dans la capitale et du prix de l'immobilier à Paris.
Enfin, Mme Catherine Tasca, rapporteure, a indiqué qu'il ne faudrait pas que, dans cette affaire, l'image de la francophonie soit ternie, compte tenu de son importance pour la place de notre langue, mais aussi pour la défense de valeurs communes, comme la diversité culturelle, les Droits de l'Homme et la démocratie. Selon Mme Catherine Tasca, rapporteure, la francophonie, qui regroupe aujourd'hui 55 Etats membres et 13 Etats observateurs, soit 10 % de la population mondiale, mérite mieux que son image souvent véhiculée dans les médias et mieux qu'un procès injuste et assez humiliant pour l'ensemble des Etats membres de l'Organisation internationale de la francophonie et pour son Secrétaire général, M. Abdou Diouf.

A la suite de cette intervention, M. Jean François-Poncet, président, a souhaité faire plusieurs observations.
Tout d'abord il a constaté que le projet de regrouper dans un site unique, appelé « Maison de la Francophonie », l'ensemble des organisations de la francophonie ayant leur siège dans la capitale n'était contestée par personne, étant donné qu'il permettra de donner une visibilité accrue à la francophonie, de rationaliser les coûts de fonctionnement et de favoriser le travail en commun de tous les opérateurs.
Ensuite, il a indiqué que M. Adrien Gouteyron est parfaitement dans son rôle de rapporteur spécial de la mission « Action extérieure de l'Etat » pour la commission des Finances lorsqu'il s'interroge sur le choix de l'implantation, le montant des travaux et la maîtrise d'ouvrage déléguée retenue pour l'installation de la Maison de la Francophonie.
a aussi relevé qu'il ressortait de l'intervention de la rapporteure qu'en réalité, le ministère de l'Ecologie et du Développement durable était directement responsable du retard pris dans la réalisation des travaux. Il s'est d'ailleurs étonné que les services de ce ministère n'aient toujours pas déménagé malgré la présence d'amiante dans le bâtiment en question.
En conclusion, M. Jean François-Poncet, président, a invité Mme Catherine Tasca, rapporteure, à continuer de suivre attentivement cette affaire et à tenir régulièrement informée la commission des évolutions de ce dossier.

a estimé que l'intervention de M. Adrien Gouteyron, en sa qualité de rapporteur spécial de la mission « Action extérieure de l'Etat » pour la commission des finances, était parfaitement légitime et qu'elle avait eu le mérite de soulever une véritable difficulté. Compte tenu du surcoût financier, du retard pris dans la réalisation des travaux et de l'incertitude concernant la réinstallation ou non du ministère de l'Ecologie et du Développement durable dans le bâtiment, il semblait préférable de se donner un peu plus de temps pour trouver la meilleure solution. M. Robert del Picchia s'est interrogé sur le fait de savoir si la vente de l'immeuble de l'avenue de Ségur et l'achat d'un autre bâtiment, sans travaux, pour y installer la Maison de la Francophonie, comme l'avait préconisé M. Adrien Gouteyron, n'était pas la meilleure solution.

En réponse, Mme Catherine Tasca, rapporteure, a indiqué que son propos n'avait pas pour objet de contester l'intervention de M. Adrien Gouteyron, qui était dans son rôle de rapporteur spécial de la mission « Action extérieure de l'Etat ». Il convient cependant de tenir compte des engagements internationaux de la France, concrétisés par convention signée entre le gouvernement et l'Organisation internationale de la Francophonie.
Par ailleurs, Mme Catherine Tasca, rapporteure, a indiqué que le fait que cette implantation soit située à proximité immédiate de l'UNESCO avait du sens, compte tenu de l'importance de la francophonie pour la promotion de la diversité culturelle, comme l'ont illustré les débats autour de la convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle.
En définitive, pour Mme Catherine Tasca, rapporteure, le choix d'installer ou non la Maison de la Francophonie dans le bâtiment situé au 20, avenue de Ségur devrait dépendre de la décision qui sera prise de réinstaller ou non les services du ministère de l'Ecologie et du Développement durable dans le même bâtiment.

a regretté que, comme souvent, cette question ait été examinée uniquement sous un angle comptable, à l'exclusion de toute autre considération diplomatique ou culturelle.

Puis la commission a examiné le rapport de M. Jean-Pierre Plancade sur le projet de loi n° 222 (2006-2007) autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif aux transports routiers internationaux et au transit des voyageurs et des marchandises.
a indiqué que cet accord, identique à ceux qui lient la France à d'autres pays extérieurs à l'Union européenne, notamment le Maroc ou la Tunisie, s'appliquerait au fret routier et aux transports par bus à destination ou en provenance de l'Algérie, via une liaison maritime. Il a ajouté qu'avait été signé le même jour entre les deux pays un accord sur le transport maritime, puis, le 16 février 2006, un nouvel accord sur le transport aérien, cet ensemble d'accords témoignant de la volonté de normaliser le cadre juridique applicable aux relations de transport entre la France et l'Algérie.
Le rapporteur a présenté le dispositif de l'accord sur les transports routiers, qui vise à lever certains obstacles juridiques résultant de l'application des réglementations nationales et agissant comme autant de freins à l'exploitation de liaisons routières internationales entre les deux pays. L'accord permet notamment la mise en place de services réguliers de transport de voyageurs par bus entre la France et l'Algérie et, s'agissant du fret routier, il prévoit l'octroi aux transporteurs d'autorisations valables pour une année, ces autorisations étant accordées dans la limite de contingents annuels fixés d'un commun accord entre la France et l'Algérie.
Le rapporteur a estimé qu'il ne fallait pas attendre de cet accord un développement spectaculaire des liaisons par route entre les deux pays, mais qu'il pouvait encourager des initiatives intéressantes. Il a cité, à ce propos, la création, par cinq entreprises françaises de transport de marchandises de la région Languedoc-Roussillon, d'une société de droit algérien spécialisée dans l'expédition d'Algérie vers l'Europe de fruits et légumes ou de produits de la mer algériens. Il a considéré que l'accord devrait ainsi permettre de diversifier les modes de transport, dans un contexte de fort développement des échanges entre la France et l'Algérie.
a rappelé que sous l'effet de la conjoncture pétrolière, l'Algérie connaissait aujourd'hui une situation économique très favorable et que l'assainissement de sa situation financière lui permettait de lancer un vaste plan d'investissements publics, qui prévoit notamment un programme ambitieux d'infrastructures ferroviaires et routières. Il a souligné l'intérêt pour la France, premier fournisseur de l'Algérie et premier investisseur hors hydrocarbures, d'accompagner la modernisation économique de l'Algérie et d'y maintenir ses positions. Il a indiqué que le partenariat économique avait constitué un point fort de la visite à Alger du Président de la République, le 10 juillet dernier, et qu'il serait également au centre d'une prochaine visite d'Etat prévue en novembre prochain.
Suivant les recommandations de M. Jean-Pierre Plancade, rapporteur, la commission a adopté le projet de loi et proposé qu'il fasse l'objet d'une procédure d'approbation simplifiée en séance publique.
La commission a ensuite examiné le rapport de M. Jean-Pierre Plancade sur le projet de loi n° 243 (2006-2007) autorisant la ratification de l'acte constitutif de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (ensemble une annexe).

a tout d'abord rappelé que l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation, plus connue sous l'acronyme anglais de FAO, avait été créée en 1945 dans le cadre du système des Nations unies et que son siège était à Rome.
Il a indiqué que l'organisation comptait actuellement 190 Etats membres, dont la France, qui figurait parmi les membres fondateurs, mais qui n'avait jamais sollicité de son Parlement la ratification de l'acte constitutif de l'organisation.
Le projet de loi soumis au Sénat vise à réparer cette omission. Il intègre les nombreuses modifications du texte original intervenues depuis 1945.
Le rapporteur a précisé que l'acte constitutif de la FAO prévoyait, de façon classique, les organes directeurs de l'institution. Une conférence regroupe les Etats membres selon le principe de l'égalité ; le conseil, organe exécutif de la Conférence regroupe quarante-neuf membres et le secrétariat est dirigé par un directeur général élu par la Conférence. Le Directeur général actuel, le sénégalais Jacques Diouf, élu en 1994, a entamé un troisième mandat en janvier 2006.
a rappelé les fonctions principales de l'organisation :
- information sur l'agriculture, l'alimentation et la nutrition dans le monde ;
- enceinte de négociation de textes internationaux relatifs à l'alimentation ;
- appui à la décision nationale ou multilatérale en matière agricole ;
- mission d'assistance technique ;
- appui à la recherche en matière de nutrition, d'alimentation et d'agriculture ;
- lutte contre la faim et la malnutrition.
Encore actuellement, a souligné le rapporteur, l'équilibre entre ces différentes missions suscitait des débats entre les tenants d'un rôle « normatif » de l'organisation et les partisans d'un rôle d'appui au développement.
a fait valoir que le rôle d'expertise et de production normative est incontesté. Parmi les textes adoptés par la FAO, on peut citer la convention internationale pour la protection des végétaux ou le traité international sur les ressources phytogénétiques. Etabli conjointement avec l'OMS, le codex alimentarius élabore des normes alimentaires internationales décisives pour la sécurité alimentaire des aliments, domaine où la France est très active.
En revanche, les actions de terrain de la FAO ont une valeur ajoutée moins évidente, alors que le système opérationnel des Nations unies, mais aussi celui des autres bailleurs, s'est considérablement étoffé depuis 1945.
Le rapporteur a ainsi rappelé que de nouvelles entités avaient été fondées au sein du système, notamment dans les domaines intéressant la FAO, le Programme alimentaire mondial (PAM) en 1963, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en 1965, le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) en 1972 et le Fonds international de développement agricole (FIDA) en 1977. De plus, le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI), étroitement lié au système des Nations unies, avait été créé en 1971.
Il a ajouté que la FAO se débattait depuis plusieurs années dans les difficultés financières et avait régulièrement recours à l'emprunt pour couvrir ses dépenses.
L'organisation emploie 3 600 personnes, dont 2 200 au siège et 1 400 dans des bureaux locaux et sur le terrain. Le dernier budget voté s'élevait à 765 millions de dollars pour 2006-2007. La France se situe au cinquième rang des contributeurs obligatoires, avec 10,8 millions d'euros par an.
Mais, comme les autres institutions spécialisées des Nations unies, la FAO fonctionne pour une large part par le biais de fonds alimentés par des contributions volontaires. En bilatéral, notre pays se situe au seizième rang des contributeurs volontaires, avec 8 millions de dollars. Toutes contributions financières confondues, en prenant en compte la part française de l'importante contribution communautaire (70 millions d'euros en 2006), la France figure au septième rang des donateurs.
a indiqué que la France était attachée aux deux dimensions, normative et opérationnelle, de la FAO, mais qu'il avait soutenu un processus d'évaluation externe de grande ampleur, dont les conclusions étaient attendues pour l'automne. L'Organisation est un pôle d'excellence et d'expertise irremplaçable sur les questions d'agriculture et d'alimentation. Elle pourrait en revanche laisser progressivement à d'autres opérateurs les activités opérationnelles où sa valeur ajoutée n'est pas démontrée.
Il a souligné en conclusion que la pertinence d'une institution spécialisée dans la lutte contre la faim et la malnutrition n'était pas moindre actuellement qu'en 1945.
Le rapporteur a rappelé que plus de 800 millions de personnes, soit une personne sur huit, souffraient de la faim.
L'oubli de la ratification française de l'acte constitutif de la FAO devait donc être réparé.
Pour autant le système des Nations unies a crû à un point tel que sa cohérence et l'efficacité de son action sont en jeu.
a estimé que la France devait donc encourager, soutenir et accompagner les processus de réforme en cours et à venir, afin de donner à ses engagements multilatéraux non seulement une justification théorique, mais aussi des résultats opérationnels.
Suivant l'avis du rapporteur, la commission a adopté le projet de loi et proposé qu'il fasse l'objet d'une procédure d'approbation simplifiée en séance publique.

Puis, pour tenir compte de la nouvelle maquette des missions et programmes de la LOLF, la commission a décidé de nommer rapporteurs pour avis M. Jean-Guy Branger pour la mission « Immigration, asile et intégration », en particulier sur le programme 303, « Immigration et asile », et M. Hubert Haenel pour la mission « Direction de l'action du gouvernement », programme 306, « Présidence française de l'Union européenne ».
Par ailleurs, la commission a désigné Mme Joëlle Garriaud-Maylam pour la représenter au sein de la délégation du Sénat à l'Office parlementaire d'évaluation de la législation.