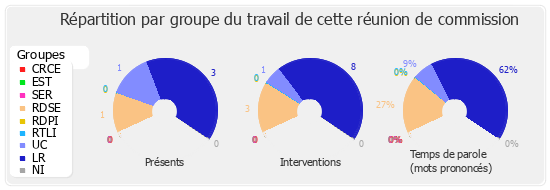Mission commune d'information sur la filière viande en France et en Europe
Réunion du 15 mai 2013 : 1ère réunion
Sommaire
- Audition de mm. philippe chalmin président et philippe boyer secrétaire général de l'observatoire des prix et des marges (voir le dossier)
- Audition de m. jean-michel serre président et mme caroline tailleur chargée de mission
- Audition de m. philippe lecouvey directeur général de l'institut français du porc ifip (voir le dossier)
- Audition de m. christophe marie directeur du bureau de protection animale et porte-parole de la fondation brigitte bardot (voir le dossier)
La réunion

Nous recevons aujourd'hui l'observatoire des prix et des marges pour nous aider à y voir plus clair sur la répartition de la valeur ajoutée entre les éleveurs, les abatteurs, les transformateurs et les distributeurs.

L'observatoire des prix et des marges mesure en effet l'évolution entre les prix à la production et les prix à la consommation, rôle indispensable alors que le panier de la ménagère est de plus en plus cher, que la grande distribution affirme que ses rayons boucherie perdent de l'argent, et que les agriculteurs voient leurs revenus diminuer.
La vente à perte étant interdite, comment expliquer les résultats négatifs de la grande distribution ? Pourquoi les éleveurs servent-ils de variable d'ajustement lorsqu'il s'agit de rééquilibrer les marges ?
Peut-on connaître la décomposition des charges et marges brutes et nettes des acteurs intermédiaires, de l'abattage au négoce ?
La grande distribution ne paie-t-elle pas les problèmes de compétitivité de notre appareil de production et les distorsions de concurrence que font peser certains de nos concurrents comme l'Allemagne ?
La structure que je préside a pour titre complet « Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ». Elle a été créée par la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche de 2010, et existe formellement depuis l'automne de la même année. Elle remplace une structure gérée jusqu'alors par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et la direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires (DGPAAT) du ministère de l'agriculture. Bien que nos moyens proviennent essentiellement de FranceAgrimer, nous sommes une structure totalement indépendante.
L'ambition de l'observatoire est d'être un vecteur de transparence, mais aussi de confiance entre les partenaires des différentes filières agricoles et agroalimentaires. Ceux-ci ont en effet une conception du dialogue souvent conflictuelle, ce qui impose souvent, en définitive, l'arbitrage des pouvoirs publics. Une structure comme la nôtre est unique en France, où la confiance est une « denrée rare », et où l'on préfère souvent laisser les crises éclater avant de les régler politiquement : nous offrons aux producteurs, industriels et distributeurs un lieu d'échange neutre, une enceinte de déminage des problèmes.
Notre comité de pilotage réunit l'ensemble des professionnels : syndicats agricoles, représentants des industriels, des distributeurs ainsi que des consommateurs. De manière parfaitement transparente, nous produisons un rapport tous les ans. Ceux de 2011 et 2012 ont fait l'objet de l'approbation générale des membres du comité de pilotage. Certes, nos analyses sur les marges nettes des rayons boucherie en grande distribution ont ainsi fait hurler certains, mais elles ont été validées par tous.
Nos missions sont essentiellement techniques : nous suivons l'évolution des prix à tous les stades du cycle de vie des produits - production, transformations successives, jusqu'à la commercialisation au détail.
Une autre particularité de l'observatoire est d'avoir à sa tête un universitaire.
Pour remplir nos missions, nous disposons d'un outil statistique de grande qualité. Nous pouvons suivre les prix aux différents stades de la vie des produits puis, par exemple, reconstituer, tous les mois, le prix d'une carcasse de viande bovine au stade de la consommation. En outre, nous analysons les coûts de production des différents systèmes de production agricole, ce qui nous permet d'appréhender la totalité du parcours des produits. Dans notre dernier rapport figure ainsi une analyse du chemin emprunté par chaque euro dépensé par un ménage en alimentation.
Notre comité de pilotage est secondé par des groupes de travail spécialisés par filière, et ouverts à l'ensemble des parties prenantes. Nous couvrons ainsi la viande bovine et porcine, la viande et le lait de mouton, les caprins - le lait de chèvre pose quelques problèmes , la volaille, les produits laitiers et les fruits et légumes. Nous espérons ajouter à notre prochain rapport le suivi de l'ensemble des produits aquatiques ; nous travaillons en outre sur les céréales et les pâtes alimentaires.
L'observatoire est une structure très légère. Elle n'est dotée que de 5 agents équivalents temps plein (ETP). Nous bénéficions du travail statistique du ministère de l'agriculture et de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), et de la contribution des instituts techniques professionnels. Nous ne coûtons donc pas grand-chose au contribuable : nous faisons la synthèse des données existantes ou produites par les fédérations professionnelles. Ainsi l'analyse relative aux marges nettes de la grande distribution figurant dans le rapport 2012 n'a été réalisable que grâce à la contribution des sept grands groupes de ce secteur.
L'observatoire a vu le jour à l'automne 2010, en pleine crise de la viande bovine. J'avais alors été auditionné au Sénat, avant que l'observatoire ne rende un rapport en urgence. Un autre rapport a été rendu en 2012. D'ici à l'expiration de mon mandat, à l'automne 2013, nous aurons publié un troisième rapport. L'avenir de notre structure dépend du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ainsi que de celui de la consommation.
L'évolution des marges brutes et nettes est marquée par le contexte agricole dans lequel évoluent les acteurs économiques. Notre rapport pour 2012 contient toutes les données relatives aux marges brutes et nettes. Nous pouvons calculer le prix au détail d'une carcasse de vache moyenne, c'est-à-dire un mélange fictif entre une race laitière et une race allaitante. Nous analysons les évolutions du prix de la carcasse, les marges brutes de la première et de la deuxième transformation, les marges brutes de la troisième transformation et de la distribution. Ces deux dernières années, la situation a été difficile, surtout pour les viandes blanches, mais aussi pour les systèmes allaitants, essentiellement à cause de la hausse des coûts de l'alimentation du bétail. C'est le résultat de trois crises majeures survenues en cinq ans sur les marchés des céréales et du soja. Gardez à l'esprit que la production d'un porc nécessite trois mois d'engraissement à base de maïs et de soja, et qu'une volaille doit être nourrie pendant 45 jours... L'été dernier, les prix des céréales ont été portés à la hausse par la sécheresse historique survenue aux États-Unis, ainsi que par l'insuffisance de précipitations dans la région de la mer Noire. Le prix du blé atteint aujourd'hui 240 euros la tonne, contre la moitié en 2009. Quant au boisseau de soja, il vaut aujourd'hui environ 12 dollars, contre 5 ou 6 dollars en temps normal. Les variations de prix sont plus ou moins sensibles selon les filières. En 2011, l'impact de ces évolutions a été amorti par la hausse du prix de la viande bovine et porcine. Depuis, le marché du porc s'est retourné.
En matière de coûts de production, nous analysons les données annuelles, car les données mensuelles n'ont pas beaucoup de sens. Nous suivons néanmoins les variations des marchés au jour le jour.
Grâce aux données fournies par les industriels, nous avons pu ventiler les marges selon les niveaux de transformation des produits. En 2011, nous ne pouvions calculer qu'une marge agrégée industrie-distribution. C'était insuffisant. Nous avons isolé ces deux éléments. Un problème se pose toutefois dans la viande bovine, car le distributeur peut être également transformateur, comme c'est le cas des rayons boucheries des grandes surfaces. Les métiers s'interpénètrent. Comment savoir si une barquette de viande a été conditionnée sur place ou par l'industrie, ce que les professionnels nomment une unité de vente consommateur fabriquée chez l'industriel (UVCI) ?
Dans le premier cas, ce sont des unités de vente consommateur magasin (UVCM).
En 2011 en outre, nous n'avions que les marges brutes, soit la différence entre le prix de vente et le coût d'achat. La grande distribution s'est émue de ce qu'elle ne reflétait aucunement leurs bénéfices. Nous calculons désormais la marge nette, en déduisant du prix de vente le prix de la matière première (76 %), les frais de personnels spécifiques, élevés dans les rayons boucherie (plus de 10 %) car nous manquons de bouchers de qualité, les autres charges (autres personnels, caisse, coûts fonciers, frais financiers éventuels, soit environ 15 %). Le rayon boucherie dégage ainsi une marge nette négative de - 1,9 %. Dans la poissonnerie, elle est encore plus dégradée. Mais les autres filières, comme les fruits et légumes par exemple, affichent une marge nette équilibrée, car leurs rayons sont très vastes, ce qui allège comptablement les charges supportées par mètre carré. Les chiffres de marges nettes pour l'ensemble des rayons sont les suivants : 5,1 % pour la charcuterie, 0,6 % pour les légumes, 5,9 % pour la volaille, 1,9 % pour les produits laitiers.
La révélation du chiffre de marge nette négative de - 1,9 % pour la viande bovine en grande distribution, a fait hurler dans les campagnes, ce qui, à y regarder de près, n'est pas étonnant. Les hypermarchés sont peut-être sur-représentés par rapport aux supermarchés, qui gèrent peut-être leur rayon boucherie comme une boucherie indépendante. On peut penser que si les distributeurs étaient rationnels, ils supprimeraient leurs rayons boucherie... C'est ignorer toutefois que ceux-ci ont une image forte : les grandes enseignes ne peuvent raisonnablement se passer d'un rayon boucherie.
Rappelons que la grande distribution fonctionne selon un principe simple : les marges sont faibles, mais les volumes importants. L'ensemble des comptes de la grande distribution fait apparaître pour l'année 2011 un taux de profit net rapporté au chiffre d'affaires de 0,75 %. La plupart des rayons sont au-dessus de cette moyenne : imaginez le profit générés par la masse de produits vendus. Notez que ces moyennes cachent également les résultats disparates selon les enseignes.
Nous sommes tenus par un secret total sur ce point. Le respect de la confidentialité est essentiel pour que les enseignes continuent à nous fournir leurs chiffres.
Les entreprises de grande distribution ne sont pas toutes organisées de la même façon : il existe un modèle intégré pour Carrefour ou encore Auchan, le magasin étant considéré comme un simple comptoir de vente dans lequel tous les comptes sont centralisés ; il existe aussi un modèle décentralisé, comme chez Intermarché, dans lequel des distributeurs indépendants sont fédérés autour d'un grossiste, ce qui rend complexe l'agrégation des données.
Il faut enfin faire attention aux illusions de la comptabilité analytique, bien qu'elle donne une bonne illustration de la contribution de chaque rayon à la rentabilité globale de l'enseigne. A la lecture des résultats nets rayon par rayon, il est tentant de vouloir remplacer les moins rentables par les plus rentables. En réalité, la boucherie draine de la clientèle vers les autres rayons : en un sens, elle est rentable. De plus, 90 % des charges d'un magasin sont communes à tous les rayons. Leur répartition chaque rayon se fait selon des clés de répartition somme toute assez contestables : nombre d'articles passés en caisse, valeur des articles,...

Merci pour votre plaidoyer en faveur de l'observatoire : j'ai été rapporteur de la loi qui l'a créé. Y a-t-il des observatoires des prix et des marges dans les autres pays européens ? Tous les acteurs concernés jouent-ils tous le jeu ? Leurs comptes sont-ils fiables ? La comptabilité analytique et la certification des comptes devraient nous le garantir.
Depuis 2010, l'observatoire a fait du bon travail. C'était une demande des organisations professionnelles agricoles dans le but d'y voir plus clair dans la formation des prix et des marges. Ce qui compte désormais, c'est qu'il contribue à l'anticipation des crises.

Votre plaidoyer, ne m'a pas totalement convaincu. Il y a d'une part une population à nourrir à prix raisonnable et à qualité correcte, d'autre part des producteurs qui doivent vivre de leur activité. Un vieux proverbe dit que « Le soleil se lève pour tout le monde ». Il faut concilier ces différents objectifs.
Or, en tant que consommateur, je n'ai pas l'impression que les rayons boucherie perdent de l'argent... Mon souhait, c'est que la transparence soit faite : que l'on sache par exemple, pour une carcasse, combien touche l'éleveur. Certes, c'est difficile lorsque sa production est utilisée dans des lasagnes. Mais il n'y a pas de raisons de s'opposer à davantage de transparence.
Pendant longtemps, l'essence a coûté un franc le litre, voire moins. Puis les producteurs ont contraints les distributeurs à augmenter les prix. Cela a marché : nous nous sommes adaptés. Il n'est pas faux de penser que les consommateurs s'adapteront si les prix de la viande augmentent, mais il faut aussi éviter de faire disparaître les producteurs.
Ne mélangeons pas tout. Selon les produits, les systèmes de commercialisation sont très différents. La production de volaille s'inscrit dans un système assez intégré : un même acteur peut fournir les aliments pour le bétail, payer l'éleveur et avoir une relation directe avec la grande distribution. De ce fait, il n'y a pas de cotation du poulet à Rungis.
Pour le porc, la situation est différente. Il existe un marché au cadran qui détermine le prix du porc en fonction de l'offre et de la demande immédiates. On constate parfois des effets de ciseaux avec une baisse du prix du porc sur le marché alors que les prix de revient ont augmenté en raison de la hausse des prix de l'alimentation.
En viande bovine, la logique du marché est encore différente. D'abord, les systèmes de production sont diversifiés.

Lorsque j'achète ma viande, je choisis des races de viande, car je suis certain alors que les bêtes ont été nourries à l'herbe.
Dans la viande bovine que nous mangeons, la moitié est issue de vaches laitières de réforme, l'autre de races à viande. Une partie est d'ailleurs de la viande de réforme allaitante.
La viande que vous mangez dans la restauration, y compris dans les circuits de qualité, est issue quasi exclusivement de vache de réforme laitière. Il y a donc des systèmes de production différents. Dans certains cas, la viande n'est qu'un sous-produit du lait. En viande bovine, les morceaux sont également valorisés très différemment.
En juillet 2012, le prix moyen d'une carcasse avoisinait les 6,5 euros le kilo au stade du consommateur. Le prix du steak haché issu du « minerai », totalement stable ces dernières années, avoisine les 10 euros le kilo. En revanche, le coût de l'entrecôte a bondi, pour atteindre au moins 16-17 euros le kilo.
La viande à braiser en revanche ne coûte guère plus de 6 euros le kilo. Bref, il y a une grande hétérogénéité de produits.
Le rapport de l'observatoire de 2012 présente l'évolution depuis 1998 des marges brutes agrégées des industriels et des distributeurs. Un choc a eu lieu au moment de la crise de la vache folle, car les coûts de production ont alors été grevés par les nouvelles exigences de traçabilité et d'évacuation des quartiers moins valorisés. Au même moment, le consommateur a modifié son comportement : alors qu'il se contentait, chez son boucher traditionnel, de ce que celui-ci pouvait lui vendre selon l'état des carcasses qui lui parvenaient, il veut désormais, chaque jour, le choix de n'importe quel morceau. Ainsi, tout est mis sous barquette et assorti d'une date limite de vente. Or, cette dernière génère 2 % à 3 % de perte supplémentaire. Ce qui n'est pas vendu est jeté.
Avant, le boucher gérait ses carcasses. Nous achetons désormais un service, plus qu'un produit agricole. C'est ce qui explique la diminution de la part revenant à l'agriculture dans la décomposition de l'euro consacré à l'alimentation. Il y a une contradiction à vouloir en permanence un produit de qualité à bas prix. Les prix des morceaux les plus nobles ont augmenté, tandis que ceux des bas morceaux ont diminué : on mange moins de pot-au-feu, et plus de côtes de boeuf, c'est ainsi.
Je crois pouvoir dire que tous les acteurs du secteur jouent le jeu de la transmission d'informations à l'observatoire. J'ai été membre du Haut Conseil des biotechnologies (HCB) : je connais donc bien les structures qui ne fonctionnent pas. Ce n'est pas le cas au sein de l'observatoire. Peut-être la distribution traînait-elle des pieds dans les premiers temps. Lorsque nous avons publié notre première analyse des marges brutes, les distributeurs n'étaient pas très contents. Ils ont été forcés de fournir leurs chiffres pour aboutir au calcul de marges nettes. Comparer les données entre distributeurs est toutefois difficile, d'autant que ces grandes enseignes ne sont pas unies. Aujourd'hui, il faut compter avec quatre enseignes au sein de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD) et trois groupes qui n'y sont pas : Système U, Leclerc et Intermarché. Mais tous les sept ont joué le jeu. Ceux relevant de la FCD ont demandé à KPMG, un cabinet d'audit, un travail d'harmonisation de leurs domaines de comptabilité analytique. Si une chaîne trichait, on s'en rendrait compte.
Notre observatoire est unique en Europe ; nous avons même fait l'objet d'un article dans une revue australienne !
L'observatoire peut avoir une fonction d'anticipation. Cela fait six mois que j'indique que le porc court à la catastrophe. L'année 2012 fut relativement tranquille car l'augmentation des cours de la viande bovine s'est poursuivie et parce que la sensibilité de la viande bovine à la baisse des coûts de l'alimentation du bétail est assez faible. Mais les problèmes de fond demeurent, notamment sur les races allaitantes. Voyez le rapport : si l'on prend en compte les coûts du travail et les coûts du foncier, le secteur est dans le rouge, même en tenant compte des aides directes de la PAC. Heureusement qu'elles existent d'ailleurs !
Une question se pose au secteur de l'élevage : quelle est la fonction d'une vache ? Est-ce produire du lait ? Ou de la viande ? Ou entretenir l'espace ? Si l'on n'élevait pas de moutons sur le plateau de Millevaches ou dans les Pyrénées, on en reviendrait vite à la sylve gauloise.
Le prix du porc a augmenté considérablement l'an dernier, jusqu'à deux euros le kilo au mois d'octobre. Cela a amorti la hausse du coût de l'alimentation animale, mais le prix est désormais redescendu à 1,40 euro. Il s'agit d'une production homogène, intensive.

Les éleveurs de porcs réclament une hausse de trente centimes sur le prix du kilo, est-ce possible ? Ramené au prix de la tranche de jambon, c'est peu de choses...
Certes, mais le prix du porc se forme sur un marché. Pour le lait, une relation contractuelle peut s'instaurer entre producteurs, industriels et distributeurs, avec un marché mondial influent mais lointain. Pour le porc il existe un marché au cadran, qui détermine le prix par confrontation entre offre et demande à l'échelle européenne.
Non... Il est plus difficile à la grande distribution de faire un geste sur le porc ou la viande bovine que sur le lait ou la volaille.
Sur le porc, la confrontation entre offre et demande détermine le prix. Le marché n'est qu'un thermomètre : brisez-le, il fera toujours la même température.

Avez-vous constaté, lors du passage à l'euro, un effet psychologique d'augmentation des prix ?
Le prix moyen du kilo en grandes et moyennes surfaces (GMS) de 1998 à 2012 a augmenté pour le filet, pour l'entrecôte et le rumsteak, il est resté stable pour le steak haché et a baissé pour le pot-au-feu... Je ne crois pas qu'il y ait eu un effet euro. Le vrai changement, c'est la fin de la gestion des prix de marché par la PAC. Autrefois les prix étaient décidés une fois par an par la Commission européenne. Le ministre revenait les annoncer aux agriculteurs, ce qui a assuré à certains un grand avenir politique... Le système actuel est instable, c'est tout le problème pour le lait. Actuellement le prix flambe à cause de la sécheresse en Nouvelle-Zélande : ce sont les enchères de Fonterra qui déterminent le prix du lait entre le producteur français et sa laiterie... Nous avons changé de paradigme, en passant de prix stables à des prix instables.
C'est vrai pour tous les produits agricoles. Si les conditions climatiques sont bonnes, la tonne de blé se négociera à 150 euros à l'automne sur les marchés mondiaux. Mais les prévisions de récoltes sont sujettes à de forts aléas. La seule réponse à cette incertitude serait l'instauration de relations de confiance telles que dans certaines filières on puisse dépasser la logique de contractualisation, et à terme s'abstraire du marché. Soit on revient à une détermination politique des prix, soit l'on accepte le marché.

Serait-il possible, par la contractualisation, de garantir un prix minimal ? La profession d'éleveur, seule dans ce cas, est confrontée à une stagnation de ses prix de ventes depuis trois décennies.
Ce n'est pas exact. Le prix du kilogramme de carcasse de vache moyenne a baissé de 1998 à 2003, jusqu'à atteindre deux euros, mais il a remonté ensuite et s'établit aujourd'hui de 3,10 euros, après la crise de la vache folle, notamment du fait de la baisse de la demande mondiale de viande bovine et de l'ouverture de certains marchés, comme le marché turc, qui était fermé aux importations.
Or, même ainsi, les éleveurs s'en sortent à peine.
Pour qu'un maillon accepte la contractualisation, il faut qu'il soit sûr de pouvoir revendre le produit à un prix supérieur. Dans un marché atomisé comme celui des fruits et légumes frais, c'est difficile de contractualiser. La contractualisation doit ainsi avoir lieu à tous les niveaux de la chaîne. Plus il y a d'intermédiaires, plus c'est difficile.
Entre le premier semestre 2011 et le premier semestre 2012, le prix des matières premières agricoles a augmenté. En viande bovine, la marge brute de l'industrie s'est réduite, ainsi que celle de la grande distribution. La hausse des prix de la viande bovine n'a donc pas été intégralement répercutée par l'outil d'industrie et de distribution : il faut tenir compte du pouvoir d'achat du consommateur.

Je suis d'accord avec une contractualisation qui concerne tous les maillons de la chaîne. Je suis convaincu qu'une baisse des prix n'est jamais intégralement répercutée au niveau du consommateur. Il y a donc des marges de manoeuvres pour les intermédiaires, qui recherchent évidemment le profit. Or nous ne pouvons pas faire l'impasse sur le pouvoir d'achat. Certaines personnes n'ont plus les moyens de choisir les morceaux qu'ils souhaitent. Sont pénalisées les deux extrémités de la chaîne : le producteur et le consommateur.
Le producteur, oui, le consommateur, pas forcément : il demande des produits toujours plus élaborés, intégrant toujours plus de service, avec le maximum de sécurité alimentaire.

Les distributeurs s'ingénient à induire de nouveaux goûts : je serais curieux de savoir combien de yaourts sont encore consommés nature !
C'est aussi le fait des industriels. Nous avons en France un déficit de confiance. Les négociations annuelles entre producteurs et distributeurs donnent toujours lieu à un psychodrame et l'encre de l'accord est à peine sèche qu'il est remis en cause. En Allemagne les distributeurs sont durs mais une fois l'accord signé il n'est pas remis en cause. Certes, l'élasticité des prix est toujours plus faible à la baisse qu'à la hausse, comme l'a bien montré l'évolution récente du prix de la baguette.

La contractualisation est un rêve de longue date, mais qui s'éloigne toujours. Elle ne peut fonctionner que si nous approvisionnons intégralement nos industriels. S'ils se fournissent sur le marché mondial, c'est impossible. En ce qui concerne le prix de la viande bovine, j'ai le sentiment que ce n'est pas le prix de la viande de qualité qui a évolué, mais celui de la viande de « fin de carrière ». La consommation de viande bovine baisse de 7 % à 8 % par an depuis deux ans : le consentement à payer du consommateur a donc évolué.

Je suis partisan des solutions simples et intelligentes. Envoyer à Rungis, pour les vendre à Montpellier, des salades cultivées dans le Roussillon, ce n'est pas simple. De même, des abattoirs de proximité éviteraient d'avoir à transporter tant d'animaux sur nos routes, et d'ajouter à leur prix final le coût de transport - sans parler du bilan carbone. En France, il y a de l'élevage partout : le système intégré n'est donc pas le meilleur.
Et d'un problème de coût. Le profit des abattoirs est si réduit qu'il est difficile de le représenter sur nos graphiques : de l'ordre de 0,3 %. Dès lors, la seule solution est la concentration, qui aboutit à de grosses installations. Il reste quelques abattoirs performants de taille réduite, mais ils sont spécialisés dans le très haut de gamme. Pour le reste, c'est le steak haché qui rentabilise les installations, et il réclame des outils coûteux ainsi qu'une parfaite maîtrise de la chaîne du froid.
Il est possible de mettre en place des contractualisations dans la filière laitière, par bassin, car les échanges de produits laitiers sur longue distance restent marginaux. Pour le mouton, le marché est très ouvert : nous importons 60 % de la consommation. Il faudrait un énorme effort européen pour nous doter de cotations de références suffisamment fiables. L'an dernier, la collecte du lait a baissé en France quand elle augmentait en Allemagne.
J'en suis très fier. Nous sommes utiles, peu coûteux. Malgré quelques tensions, nous avons réussi à bâtir une certaine affectio societatis, notamment grâce à la règle de l'unanimité, que j'ai imposée. Nous ne devons pas devenir un organisme coercitif.

L'origine de cette MCI est la fraude sur la viande de boeuf contenant en réalité du cheval, révélée au mois de février. Elle porte sur les productions animales, sur l'abattage et la transformation des produits, et sur leur commercialisation.

La FNP, dans une lettre ouverte à l'ensemble de la filière porcine française, a estimé que le scandale de la viande de cheval remet au coeur des débats la nécessité de mentionner, sur les étiquettes, l'origine nationale de la viande fraîche ou utilisée comme ingrédient dans les produits transformés. Alors que la FNP oeuvre depuis très longtemps pour une communication des filières sur nos produits et nos métiers français, elle souhaiterait que tous se positionnent clairement sur un tel étiquetage pour les produits transformés. La Commission européenne y semble opposée, et les transformateurs européens refusent un étiquetage faisant mention du pays d'origine, y préférant la mention « européen » ou « non européen ». Pouvez-vous nous apporter des précisions sur ce point ?
L'étiquetage des viandes nous tient à coeur. Nous avons signé en 2010 avec les acteurs de la filière porcine un accord volontaire sur l'identification de l'origine de la viande de porc vendue fraîche ou dans des produits transformés : ces derniers représentent 75 % des débouchés de la production porcine, il ne suffit donc pas de parler de la viande fraîche. L'interprofession porcine, Inaporc, a décidé d'accompagner le financement de la promotion de la viande porcine française. Nous fonctionnons avec des cotisations volontaires et non obligatoires, ce qui est rare pour une interprofession, et nous autorise à financer une campagne de promotion de la « viande française » sans que Bruxelles n'intervienne. En début d'année, 40 % des références et 60 % de l'ensemble des produits de charcuteries étaient concernés par l'identification VPF (viande de porc française). Nous avons décidé de faire un effort pour que l'origine soit mieux identifiée, afin d'améliorer ce pourcentage.
Au sein du Comité des organisations professionnelles agricoles européennes (COPA-COGECA), nous n'avons jamais su trouver un accord entre producteurs et coopératives : les pays fortement exportateurs ne sont pas favorables à une identification du pays d'origine. Les Danois couvrent 600 % de leurs besoins, les Belges 250 % : ils sont favorables au statu quo défendu par la Commission européenne. Nous souhaitons au moins pouvoir indiquer « viande porcine française ». La mention « transformé en France » nous agace : elle trompe le consommateur. L'accord signé en 2010 est bon, il faut le faire vivre. Les distributeurs sont signataires de l'accord. Ils collectent 50 % des cotisations interprofessionnelles. Ils devraient contribuer davantage à mettre en évidence l'origine française ; il semble en particulier que le logo ne soit pas très parlant. Nous leur demandons d'identifier les produits français dans l'organisation de leurs rayonnages de manière durable. Un accord européen nous comblerait, mais il reste hypothétique : nous avons donc pris les devants.
La filière porcine est en mauvaise santé depuis cinq ans : depuis que le prix des aliments pour animaux a considérablement augmenté, malgré une baisse en 2009-2010. Les éleveurs français sont compétents, mais ils ont perdu en compétitivité. Le secteur abattage-découpe souffre, comme le secteur industriel. Les éleveurs porcins sont à 95 % organisés en groupements de producteurs, sans que cela suffise à nous rendre compétitif en Europe. Depuis sept ou huit ans, de nombreux regroupements ont eu lieu, mais sans restructuration : jusqu'en 2011 la production est restée stable, car la productivité des élevages s'est améliorée mais le nombre de truies à baissé. En 2012 la production a baissé de 2,5 %, et une baisse de 4 % est attendue pour 2013. La baisse sera sans doute aggravée par les mises aux normes obligatoires au nom du bien-être animal. Les tailles des élevages sont faibles : 200 truies en moyenne. Ce chiffre est comparable en Allemagne, mais avec des disparités considérables entre les anciens et les nouveaux Länder. Les Allemands parviendront cependant à maintenir leur production tout en effectuant la mise aux normes de leurs élevages. Au Danemark la taille moyenne des exploitations est de 600 truies par élevage, avec un objectif de mille élevages de mille truies. Le Danemark produit 29 millions de porcs et de porcelets. En France, nous en sommes à moins de 24 millions : nous perdons pied. En Espagne, la moyenne est de 700 truies par élevage, et aux Pays-Bas elle est de 350. Nous ne sommes pas obsédés par la taille mais la réglementation française est très pénalisante : à partir de 450 places de porcs charcutiers ou équivalents il faut passer par une procédure lourde d'enquête publique pour créer ou agrandir les installations, ce qui n'a pas son pareil pour animer les mouvements qui nous sont hostiles. La procédure est longue, coûteuse et décourageante. Le manque de restructuration qui en résulte est grave car les investissements suscitées par une restructuration améliorent la qualité environnementale, la performance énergétique, la compétitivité...
Le ministre de l'agriculture a réuni les acteurs de la filière porcine le 30 octobre dernier. Les conclusions qu'il a présentées le 15 avril préconisent de revenir à une production de 25 millions de porcs par an en France. A défaut d'alignement des règles relatives aux installations classées sur les seuils européens, un système d'enregistrement devrait être mis en place pour les élevages entre 450 et 2 000 places. Nous avons beaucoup discuté : cela semble un bon compromis, dans la mesure où le pouvoir des préfets sera encadré. Nous ne demandons aucune concession sur l'environnement, mais l'enquête publique est souvent un véritable défouloir, qui rend la situation invivable, en particulier dans certains départements comme la Saône-et-Loire. Dans mon département, la Somme, je n'ai pas de problèmes, mais dans le Pas-de-Calais c'est plus compliqué. La proposition du ministre nous intéresse, mais elle doit être mise en oeuvre rapidement, pour redonner l'envie d'investir. Les producteurs ont effectué les mises aux normes de bien-être des truies a minima, car la conjoncture était mauvaise, mais aussi car le traitement des dossiers d'extensions d'élevages aurait été trop complexe. C'est une occasion ratée de moderniser les élevages.
Nous aurons les chiffres définitifs dans quelques semaines, mais ce pourcentage est très faible.

Le refus d'investir est-il surtout le fait des petits élevages, pour lesquels la mise aux normes serait trop coûteuse ?
Oui, mais les refus de mise aux normes viennent aussi d'exploitants qui disposent de possibilités alternatives.

La modification des seuils d'application de la règlementation des installations classées ne conduira-t-elle pas à une augmentation du contentieux ?

Le plan de méthanisation annoncé par le ministre peut-il apporter une solution ?
Nous avons besoin d'une plus grande sécurité juridique en matière d'installations classées car les règles sont en permanence remises en cause. C'est la raison pour laquelle la FNSEA a fini par refuser de participer à ces réunions incessantes. Lorsqu'après 2 ou 3 ans d'instruction, un dossier finit par aboutir et que la réglementation a changé entre temps, c'est terrible pour l'éleveur. En Allemagne, nos homologues considèrent qu'une procédure qui dure 6 mois est déjà longue. Ici c'est quasiment le temps qu'il faut pour recevoir le récépissé de la préfecture...
Le plan de méthanisation annoncé va dans le bon sens mais sa mise en oeuvre risque d'être difficile, crise oblige. Pour que les banques accordent les prêts nécessaires au financement des installations, encore faut-il que les exploitations soient en bonne santé financière. Même si les éleveurs peuvent se regrouper à deux ou trois, l'investissement est tout de même compris entre 1 et 1,5 million d'euros. Tant que nous n'aurons pas procédé à une remise à niveau réglementaire ainsi qu'en matière de taille des élevages et tant que nous n'aurons pas développé la filière, la méthanisation ne pourra pas être perçue comme une solution réellement intéressante.

J'ai bien noté la proposition de porter de 450 à 2 000 porcs le seuil des enquêtes publiques. La méthanisation ne peut-elle pas contribuer à une meilleure acceptation des élevages par les riverains ? Sinon, faute d'enquête publique, les populations confrontées à une augmentation du nombre de porcs et donc de l'épandage risquent de multiplier les recours.
La Bretagne est logiquement la région d'expérimentation de la méthanisation. Mais pour le reste, il existe d'autres solutions au problème des odeurs, tels que l'enfouissement du lisier.
Nous nous heurtons parfois à des oppositions injustifiées. A la moindre mauvaise odeur en période d'épandage, on désigne immédiatement les éleveurs de porcs. C'est par exemple le cas dans le Nord alors même qu'il s'agit de compost qui arrive de Belgique. Nous payons très cher cette mauvaise réputation alors que, dans la mesure, où il s'agit d'installations classées, nous faisons beaucoup d'efforts pour éviter les nuisances.

Combien faut-il de porcs charcutiers pour rentabiliser une unité de méthanisation ?
Je ne suis pas spécialiste de la méthanisation. Je sais toutefois que l'une des difficultés consiste à se procurer les autres matières premières, le lisier de porc n'étant pas très méthanogène. Nous ne sommes pas partisans de la méthode allemande d'alimentation des méthaniseurs au maïs car, pour nous, le maïs doit aller à l'alimentation des animaux. Une autre crainte existe lorsque les méthaniseurs sont aussi alimentés par des déchets des collectivités : il faut que les éléments aient la garantie d'être durablement approvisionnés.

Ajouter à l'étiquetage de l'origine un cahier des charges qualité serait-il un facteur supplémentaire de valorisation des produits ?
Si l'on excepte le label rouge ou quelques productions typées comme le porc basque, le porc gascon ou le porc noir du Limousin, la réponse est non. Nous avons fait l'erreur de nous engager dans une démarche de certificats de conformité des produits, assortis d'exigences règlementaires. Au début, la grande distribution, nous accordait quelques centimes supplémentaires. Après quelques années, cette rémunération déjà chiche a disparu, mais les contraintes sont restées.
Ainsi, sauf pour le soja, nous n'utilisons pas d'aliments pour animaux génétiquement modifiés. En outre, même si la Commission européenne autorise de nouveau les farines de viande, nous nous l'interdirons sans doute. Nous n'utilisons pas non plus de graisses animales. Nous n'avons pas touché au cahier des charges Viande porcine française (VPF) et nous ne l'alourdirons pas. Prise individuellement, chaque contrainte ne représente pas grand-chose mais leur addition devient vite pénalisante, surtout quand la compétition européenne est si dure.

Pourrions-nous connaître sur la viande de porc un scandale comparable à celui que nous avons eu sur la viande de cheval ?
e. - Un scandale résulte de tricheries qui ne sont jamais de notoriété publique. Bien que nous ne soyons jamais à l'abri, je suis raisonnablement optimiste.
Oui, bien que cette formule agace beaucoup les producteurs. La France produit deux millions de tonnes, en exporte 600 000 et en importe 500 000. Notre balance commerciale est excédentaire en volume, mais déficitaire en valeur de 100 millions d'euros. L'expression est dévalorisante pour des producteurs qui ont un haut niveau de performance, d'exigence et de compétence. Si les problèmes de rentabilité pèsent sur le renouvellement des générations, nous avons été pendant longtemps l'une des filières installant les jeunes disposant du plus haut niveau de formation.
La principale difficulté rencontrée par la filière porcine française reste la distorsion de concurrence avec un pays comme l'Allemagne, dans l'élevage comme dans l'industrie. Le coût de la main d'oeuvre allemande représente en effet le tiers de la nôtre ; nous ne pouvons pas lutter. Notre compétitivité souffre de ce mal profond.

Je signale au passage que notre collègue Bocquet vient de présenter, au nom de la commission des affaires européennes, un rapport sur les travailleurs détachés qualifiés de « low cost ».

Le Danemark connaît aussi des difficultés. Les porcs danois sont désormais engraissés ailleurs ?
Oui, les porcelets danois le sont, pour partie en Allemagne, pour partie en Pologne. Il y a quelques années, des animaux étaient aussi engraissés dans les pays baltes ; c'est plus simple et moins cher.
Si l'Allemagne abat chaque année 60 millions de porcs, le coût de la main d'oeuvre y est pour beaucoup.

Notre déficit commercial s'explique-t-il par le fait que nous importons des parties nobles ?
Il est lié à nos habitudes de consommation. Nous sommes de gros importateurs de jambons tandis que nous exportons vers la Chine et la Russie des produits à faible valeur ajoutée, à la différence de ceux que nous vendons, en bien moindre quantité, à la Corée ou au Japon. La baisse de notre production n'arrange rien.

Vous avez évoqué les protéines animales transformées (PAT), nouveau nom des farines animales. Voyez-vous d'autres pistes d'évolution de l'alimentation animale ? Un plan protéines dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune (PAC) serait-il pertinent, sachant que nous ne souhaitons pas une culture des OGM en Europe ?
Nous sommes évidemment favorables à un plan protéines car, toutes espèces confondues, le déficit européen en protéines végétales atteint 70 %. La France n'est qu'à 40 % parce que nous sommes fortement producteurs de diester à partir du colza. Les OGM posent un problème de politique agricole générale et de société ; il faut faire avec la règlementation. Il s'agit d'un élément de distorsion de concurrence. Ceux qui répondent à la forte sensibilité du consommateur sont peu récompensés. Carrefour, qui a une filière sans OGM, verse un supplément de 2 centimes d'euros par kilo de carcasse. Le distributeur améliore son image ? Oui, mais à ce prix-là, dans ma région, on ne peut pas répondre.
Les bons de livraison consacrent une page entière à la composition du produit.
Il y a un seuil...

Les produits sans OGM peuvent contenir jusqu'à 0,9 % de traces d'OGM. On l'explique par le fait que les moulins utilisés dans la fabrication des aliments du bétail ont pu traiter des produits avec OGM. On dit la même chose pour la viande de cheval... Quelle est la part de l'alimentation dans vos coûts de production ? Comment avez-vous été affectés, ces cinq dernières années, par la volatilité des cours des céréales et du soja ?
L'alimentation du bétail représente environ 70 % de nos coûts, ce qui est énorme. Depuis cet hiver, les cours sont à un point haut, ce qui porte nos coûts de production à 1,80 euro par kilo, pour un prix de vente de 1,50 euro. Voilà pourquoi, les éleveurs manifestent pour une augmentation du prix de 30 centimes.
Comme nous le déplorons, la côte de porc en fond de rayon est proposée à 7 euros quand les promotions sont affichées à moins 3 euros ! Dans les deux cas, les niveaux de prix sont déraisonnables.

L'Observatoire de la formation des prix et des marges a publié une étude sur l'évolution du prix du porc frais entre 2010 et 2012. Elle met en évidence l'importance du coût de la matière première.
Sans remettre en cause les compétences de l'Observatoire, j'ai du mal à croire que les produits de charcuterie laissent une aussi faible marge aux distributeurs. Les abattoirs sont en mauvaise santé, l'industrie de la charcuterie souffre, ce qui est particulièrement inquiétant parce que la filière emploie 80 000 personnes, le secteur commercial se porte bien et les grandes surfaces n'auraient qu'une marge de 5 à 6 % ?

Notre mission d'information s'intéresse à tous les secteurs producteurs de viande et notamment la viande porcine. Pouvez-vous nous présenter l'Institut française du porc (IFIP) ?
Né du regroupement de l'Institut technique du porc et du Centre technique de la salaison, l'IFIP est l'un des rares instituts à disposer d'une vision complète de la filière. Peut-être est-ce plus facile parce que l'amont et l'aval s'équilibrent en termes de chiffre d'affaires. Nous sommes qualifiés au sein du réseau des instituts techniques agricoles comme dans celui des instituts techniques agro-industriels, deux réseaux qui gagneraient à fusionner afin d'adapter l'offre à la demande, en allant « de la fourchette à la fourche ».
Notre métier consiste à produire des connaissances et des références pour les acteurs de la filière. Nous sommes placés sous deux tutelles, l'une, ministérielle, qui vérifie la bonne utilisation des fonds distribués par le compte d'affectation spéciale développement agricole et rural (CASDAR), l'autre, professionnelle. Notre conseil d'administration, présidé par Jacques Lemaître, est composé à parité de mandataires issus du monde agricole et à l'exception de la distribution, des autres intervenants de la filière, de la génétique aux artisans-charcutiers. Nos moyens expérimentaux répondent à des questions très techniques ; notre laboratoire a une antenne au sein de l'École vétérinaire de Maisons-Alfort.
Notre institut est structuré autour d'un service économie, large et fort, qui a réalisé l'essentiel du dossier d'étude sur les distorsions de concurrence avec l'Allemagne, d'une activité génétique qui nous conduit à travailler en relation très étroite avec l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), ainsi que d'activités liées aux techniques d'élevage - énergie, eau, environnement, gaz à effet de serre, reproduction, aspects sanitaires - et d'actions dans le domaine de la viande et de la charcuterie, à la fois sous l'aspect technique et microbiologique. Nous sommes aussi en charge du code des usages qui fait référence en matière de fabrication de charcuteries.
Nous bénéficions de crédits de la direction générale de l'enseignement et de la recherche (DGER), de FranceAgriMer ainsi que, pour 15 %, de financements liés à la réalisation d'études professionnelles. La part croissante de nos ressources propres soulève la question de l'articulation entre action collective et intérêts privés.
La consommation de viande de porc s'inscrit dans la tendance baissière qui affecte toutes les viandes. La consommation de porc est descendue à 32,5 kilos par an et par personne contre 36 il y a dix ans ; la moyenne européenne s'établit à 40 kilos, mais l'Allemagne est entre 52 et 55 kilos et l'Espagne à 56. Chez nous, la viande perd des parts de marché face aux produits élaborés. La charcuterie se maintient grâce à sa très grande diversité. Plus nous élaborons et plus nous consommons ; cependant, il n'y a pas corrélation entre valeur ajoutée et élaboration, celle-ci alourdissant les coûts.
La France présente une spécificité : la part du jambon cuit y est de 25 %, celle des produits secs de 13 % (4 % pour le jambon sec ; 9 % pour les saucissons). 90 % de la viande de porc est vendue en grande et moyenne surface (GMS), plus de la moitié sous forme de promotion. Le porc est, dit-on, une viande de petit budget, ce qui pose un problème de répartition de la marge brute : pour la distribution, le porc est une « vache à lait » qui amène beaucoup de profits. La tendance baissière de la consommation se retrouve globalement en Europe avec un déplacement vers les produits élaborés qui affecte dans une moindre mesure l'est du continent.

Puisque le porc est une viande abordable souvent vendue en promotion, ne bénéficie-t-elle pas d'un effet de report quand la consommation de boeuf, de volaille ou de mouton recule?
Il existe deux marchés de la viande fraîche et celui de la salaison. Lorsque vous n'avez pas vendu votre viande fraîche le vendredi aux grandes et moyennes surfaces (GMS), vous êtes contraint de la brader. Il nous faut donc rechercher davantage de valeur, soit par les exportations, soit par la valorisation de produits transformés. Ce n'est pas évident car, faute de main d'oeuvre dans la boyauderie, il devient difficile de fabriquer andouillettes ou andouilles, qui sont pourtant des produits nobles du patrimoine français. Il nous faut en outre travailler sur les questions de microbiologie et de santé liés à ces produits et les exporter vers l'Asie. Lorsque l'on voit comment les Chinois importent tous nos abats et nos déchets, on peut tout à fait espérer qu'ils puissent nous acheter cinq ou six fois notre production actuelle.
La viande de porc est encore trop peu élaborée. Il n'y a plus de pays où elle est proposée en côtelettes avec os. Nous sommes restés dans une logique jusqu'au-boutiste de rendement : « grammage, grammage », disait Jean Floc'h. N'arrivant pas à revaloriser la viande de porc, nous restons sur des produits standards. Qui, demain, cuisinera des côtelettes ? C'est un cercle vicieux.
Absolument. D'ailleurs le jambon se vend bien... jusqu'à un certain prix.

Qu'en est-il des aspects sanitaires, par exemple du taux de cholestérol ?
Il y a d'abord les préjugés selon lesquels le porc serait gras et favoriserait le cholestérol. L'erreur est grossière, car il est plus dangereux de consommer des viandes aux acides gras saturés ou même du saumon ou des oeufs. Le gras de la viande de porc est de bonne qualité. Ensuite, tout est question de quantité, qui n'est évidemment pas la même dans des rillettes, dans une Knack et dans un rôti. Le monde médical n'y connaît pas grand-chose.

Il suffit de voir un rôti, un filet ou une échine de porc, pour savoir que ce n'est pas gras...
A la limite, pas assez puisque le goût et les arômes se déposent dans les gras. La fabrication du jambon sec devient même problématique dans la mesure où nous sommes contraints de travailler sur des jambons cuits, où la moindre aponévrose effraie nos enfants qui ne sont plus habitués aux filets blancs. Il n'y a plus assez de gras pour faire de la charcuterie sèche.
Élaborer une formule d'aliment avec de l'énergie pour fabriquer du gras revient plus cher que de fabriquer du maigre avec des protéines. Nous sommes pris dans un étau économique mais aussi comportemental, puisque si le monde paysan peut se montrer solidaire, les choses se compliquent lorsque l'on est en concurrence pour l'attribution des mètres linéaires ou la répartition des marges brutes.
L'Asie dope la demande.
Globalement oui. D'après les statistiques, les Chinois sont à 38 kilos de porc par personne et par an mais 4 kilos de viande bovine. Il en est de même en Asie du sud-est, cela fait partie de leur patrimoine
Les Japonais mangent beaucoup moins de viande, de l'ordre au total de 40 kilos par personne et par an.
Depuis dix ans, il n'y a plus de croissance et plus d'investissement ni en élevage ni en abattage-découpe.
A la marge. Les normes auraient pu constituer un fantastique levier, à condition de rationaliser les élevages. Les éleveurs n'ont fait que répondre à l'évolution de la réglementation sans procéder à des réorganisations. Ils ont manqué l'occasion.

On nous a dit que certaines techniques permettent de limiter les nuisances liées aux élevages porcins.
Les bonnes techniques parviennent à supprimer les odeurs, encore faut-il investir. Nous disposons de la technologie, les éleveurs n'ont pas toujours les moyens pour en tirer parti. Notre station de Villefranche-de-Rouergue est située à 80 mètres d'un hypermarché Leclerc. Sa partie nouvelle récupère les eaux de pluie et utilise des lits de roseaux qui absorbent l'azote ; rien n'est évacué, il n'y a aucun épandage. On sait aujourd'hui faire de la filtration ou du lavage d'air, mais uniquement dans un bâtiment neuf : les odeurs ont été supprimées quand il y a eu reconfiguration de l'élevage ; il reste quelques odeurs ailleurs.
Notre perte de compétitivité s'explique par des règles sur les installations plus strictes que dans le reste de l'Europe, par les coûts de main d'oeuvre, et par le manque d'investissements alors que les nouvelles technologies dégageraient d'importantes économies. Parallèlement l'Allemagne a connu un rebond que personne n'avait anticipé. La chute du mur de Berlin en 1989 avait été suivie d'une très forte décapitalisation mais, à partir de la fin des années 1990, le pays s'est doté d'élevages de grande dimension. De même, les Danois qui travaillaient il y a une quinzaine d'années comme en France, avec des élevages familiaux de 150 à 180 truies, sont passés à 800 par exploitation. Et nous, nous n'avons pas avancé.

Que pensez-vous de l'étiquetage de l'origine de la viande et des produits transformés ? Doit-on tout écrire ?
Voilà la question la plus difficile pour notre Institut. Actuellement, 85 à 90 % de la viande fraîche et 50 % du jambon cuit sont étiquetés « Viande de porc française » ou « Origine France ». La grande distribution est encore frileuse, de même que les industriels, contraints d'importer. Il faut s'engager dans cette démarche qui constitue une protection a minima en lui donnant un contenu à l'instar du standard Qualität und Sicherheit (QS) allemand. Nous ne devons pas nous contenter d'un acte politique, il convient de lancer une véritable dynamique : soyons force de proposition. Faisons-le avec une stimulation.
Oui. Un groupe de distribution indépendant sera obligé d'importer des jambons. Comment mettra-t-il sur le marché 100 % de viande de porc française ?

Nous ne produisons pas assez de pièces nobles, en particulier de jambons ; en revanche nous fournissons des pièces moins prisées, qu'il nous est difficile de vendre.
Nous avons un déficit structurel de jambons.

Si, pour répondre à la demande de jambons, nous augmentions la production porcine, nous nous retrouverions paradoxalement avec un reliquat très difficile à compenser. La viande de poulet revient-elle plus cher au consommateur ?
La viande de porc est très bien positionnée en termes de prix.

La France ne produit plus de volailles de qualité moyenne, mais des volailles de grande qualité, labellisées (Loué, Bresse, etc.) et d'autres destinées à l'exportation, notamment vers le Moyen-Orient. Entre les deux, c'est l'Allemagne qui nous fournit. De même, nous importons des arrières de boeuf, et nous vendons des avants...Nous préférons en effet les grillades !

Qu'en est-il des indications géographiques protégées (IGP) et de l'impact des labels ? Dans les Pyrénées-Atlantiques, le jambon de Bayonne est produit à dix kilomètres de chez moi. Oui. Les labels me semblent déterminants. Nous avons reçu de Bruxelles une IGP pour le jambon de Bayonne, puis pour le porc frais du sud-ouest. Pour la première, sont définies des zones de production, de transformation, de salaison. La consommation augmente. L'aval marche bien. C'est en amont que se situent les difficultés. Or, souvent, en agriculture, l'amont fonctionne mieux que l'aval ; là, c'est l'inverse. On ne produit pas suffisamment pour satisfaire la demande de jambon de Bayonne. On sait très bien qu'entre minuit et demie et une heure du matin, le dimanche, arrivent les jambons de Navarre qui sont transférés sur les lieux de séchage...

Ils n'ont pas droit à l'appellation s'ils n'ont pas été produits en France...
La zone de production du jambon de Bayonne regroupe une quinzaine de départements du sud-ouest, jusqu'en Poitou-Charentes. Sa fabrication doit avoir lieu dans le pays de l'Adour. Se pose un problème de quantité et de qualité, en matière de jambons en général. Il faut des produits stables. Le label est une bonne idée, qui achoppe sur le déséquilibre du marché, lié à nos habitudes de consommation, qui ne changent guère...
L'IFIP a engagé de grands programmes impliquant des aspects génétiques, sur le porc gourmet, pour redonner du goût à certains produits. Même pour le jambon de Bayonne, je mets en garde contre le standard. J'ai jeté mon dévolu sur le sud-ouest et l'Aquitaine pour nous lancer sans effrayer la Bretagne...Nous travaillons sur le goût et la recherche de valeur. Nous n'avons pas été capables de valoriser la filière bio que j'ai lancée il y a quinze ans. Pourtant, les industriels veulent du jambon bio.
Les cinq D : découenné, désossé, dégraissé, dénervé, dépiécé !
Le système français est celui du naisseur engraisseur. Il faut lutter contre les idées préconçues. Le plan officiel de surveillance et de contrôle des résidus d'antibiotiques dans la viande a mis en évidence un taux inférieur à 0,3 %. L'usage des antibiotiques comme facteurs de croissance a été interdit en Europe en 2006. La France avait amorcé leur retrait dès les années quatre-vingt-dix. Désormais, 60 % des dépenses de santé portent sur la prévention. On parle beaucoup des antibiotiques, mais cela fait quinze à vingt ans que la profession a pris conscience du danger. Il est faux de prétendre qu'elle les utilise. Il faut rendre hommage, à cet égard, aux politiques publiques sanitaires. Quelle différence avec la Chine !
Depuis plusieurs années, nous travaillons avec la profession autour de cinq axes : promouvoir les bonnes pratiques dans tous les corps de métiers, c'est en route ; développer les alternatives et les outils d'auto-évaluation, c'est fait ; renforcer l'encadrement des hommes et réduire les pratiques à risque, c'est globalement réalisé ; disposer d'un suivi, cela se fait avec les politiques publiques ; promouvoir les approches européennes d'initiative. Nous sommes très sensibles aux enjeux sanitaires. Un très gros travail a été accompli dans ce domaine, dont on tire peu parti. Les antibiotiques ne sont plus utilisés qu'à titre préventif et plus comme facteurs de croissance. Nous savons désormais intervenir au niveau de la salle, sinon de l'individu.
Nous devons maintenant travailler sur les vaccins. Mais attention aux distorsions de concurrence en Europe ! Ainsi, l'emploi du zinc peut supplanter celui des antibiotiques pour le porcelet à la naissance. Les Danois en utilisent jusqu'à 2 500 ppm (parties par million) avant 15 jours, les Espagnols beaucoup plus, sans le dire ; chez nous, on se limite à 140 ou 150 ppm, pour éviter des résidus de métaux lourds dans les terres : nous nous imposons ainsi des contraintes supplémentaires. Nous travaillons encore sur les nanotechnologies en substitut. Au total, nous utilisons 22 % de produits en moins au cours des dix dernières années. Le ministre a même félicité la profession.

Nous souhaitions aussi vous interroger sur l'organisation nouvelle de l'abattage et sur l'état des installations d'abattage.
Des investissements et des restructurations ont été et demeurent nécessaires pour mettre en place de nouvelles usines. Il convient de raisonner en fonction des réalités de l'économie du porc, qui est fondée sur les coûts et non pas sur les marges. L'indicateur prix sert de référence à toutes les transactions. La transparence est totale. Dans ces conditions, il est nécessaire d'optimiser en permanence la gestion.
Cette spécificité française impose de rechercher systématiquement la valeur, de valoriser les produits et les coproduits. Ceux-ci posent problème, car nous n'avons plus de main d'oeuvre ! Le cinquième quartier, qui a longtemps constitué le résultat des entreprises, n'est pas suffisamment valorisé - je vous invite à faire témoigner les entreprises concernées. L'abattage ne connaît pas la recherche et développement ; on ne travaille pas suffisamment sur l'innovation produit. C'est un débat permanent dans la profession : la recherche doit-elle être collective ou privée ? Les entreprises y voient un élément de différenciation.
Les GMS provoquent une véritable asphyxie : la distribution apparaît plus dure que dans d'autres pays : c'est ce que montrent nos études comparatives internationales...
Pour la viande porcine, en effet. Il faut se poser en permanence la question : comment vend-on les produits, qu'en fait-on, sur quels créneaux ?
Un mot sur la Chine, où nous exportons nos technologies et notre savoir-faire depuis 2008. Il faut en avoir conscience : un porc sur deux dans le monde est en Chine. Nous avons créé un consortium avec des entreprises de la filière. Notre qualité technique y est reconnue. Nous sommes considérés comme l'un des meilleurs pays, avec une excellente image en génétique, processus, sécurité sanitaire, gestion durable. C'est un atout considérable. L'image de notre pays est meilleure à l'étranger que chez nous. Je me rends tous les deux mois environ en Chine. Les Danois et d'autres pays s'y investissent de façon considérable. Nous avons encore des marges de progression. Soyons conscients de notre potentiel et de nos atouts, sachons les valoriser ! Le cochon devrait être reconnu au même titre que l'aéronautique...

Les associations de défense des animaux devraient être plus attentives aux conséquences de leurs actions sur les circuits économiques. Les contraintes sont très fortes, des normes sont démentielles...
Nous risquons de mourir avec la meilleure technique. Songez à ceux qui, au XIXe siècle, refusaient que le rail passe chez eux... Le porc est un secteur passionnant, très technique, où les enjeux de gestion sont importants. Prenons garde à l'écologie dogmatique : il ne faudrait pas que des végétariens viennent influer sur une profession qui fait vivre beaucoup de monde. Les salariés ne sont pas responsables de grand-chose.

Nous sommes heureux de vous entendre devant cette mission commune dont vous connaissez l'origine et la portée.

Vous disposez sans doute de chiffres, en particulier pour l'abattage rituel, sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Vous avez mis en ligne des données, des rapports, qui semblent être contestés par le ministère de l'agriculture. Les chiffres se contredisent : la Fondation Brigitte Bardot diffuse-t-elle de fausses informations ou le ministère cache-t-il la vérité ?
Nous travaillons avec l'OEuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs (OABA), qui accède aux abattoirs. Il est vrai qu'il est difficile d'obtenir des chiffres officiels sur l'abattage rituel. Le dernier rapport officiel date de novembre 2011 ; nous l'avons mis en ligne sur le site internet www.abattagerituel.com : il estime qu'il y a 51 % d'abattages rituels en France. C'est un communiqué de la chambre interdépartementale d'agriculture qui donne le chiffre de 100 % d'abattage rituel en Île-de-France. Nous ne lançons pas des chiffres au hasard.
L'OABA a également étudié les abattoirs. La comparaison entre ces chiffres et les derniers pourcentages publiés, exprimés en tonnage de viande, en retirant le poids des carcasses et autres déchets, et non en nombre d'animaux, peut prêter à confusion. Le ministère de l'agriculture a fait état de 14 % du tonnage. Cependant, avec 3,5 millions de grands bovins, on arrive à 1,3 million de tonnes, contre 83 000 tonnes pour 4,4 millions d'ovins.
Le rapport de novembre 2011 donne ce détail : 40 % pour les bovins adultes, 26 % pour les veaux, 58 % pour les ovins et 22 % pour les caprins. Depuis la publication d'un décret encadrant l'abattage rituel, nous devrions disposer de chiffres actualisés et reconnus par le ministère. Ce matin même, la Direction générale de l'alimentation (DGAL) m'a indiqué qu'ils ne seraient pas connus avant la fin de l'année. Nous saurons alors quel est, officiellement, le pourcentage d'animaux abattus sous forme rituelle.
Tous les nouveaux projets d'abattoirs prévoient un abattage halal. Or le ministère persiste dans son refus de ne pas soutenir l'étiquetage du mode d'abattage que nous demandons. Il n'y pourtant aucune raison que la majorité de la viande soit distribuée ainsi sans que les consommateurs le sachent. De plus en plus d'éleveurs ne veulent plus être pris en otages. La Fondation, qui a un rôle auprès du public, constate la demande des consommateurs. Il n'est pas normal de devoir établir des guides pour les informer.
Selon un rapport officiel datant de 2005, intitulé « Enquête sur le champ du hallal », 80 % de l'abattage ovin en France se pratiquerait sans étourdissement préalable. Quoique commandé par le ministère de l'agriculture, ce rapport a été mis de côté parce qu'il ne plaisait pas. Nous l'avons mis en ligne...Au sein de l'Union européenne, la France et la Belgique sont pointées du doigt, pour leur manque de volonté de mieux contrôler l'abattage rituel. Le récent décret que j'ai évoqué témoigne d'une volonté de traçabilité, pour s'assurer que les bêtes abattues rituellement correspondent à une demande spécifique. Toutefois, une bonne partie de la bête se retrouvera dans le circuit classique, et il est légitime d'informer les consommateurs. Il est urgent de mettre cette traçabilité, cette information, cette transparence en place.
L'un des premiers combats de Brigitte Bardot, dès 1962, a été de limiter la souffrance de l'animal au moment de sa mise à mort. Nous demandons qu'il soit préalablement étourdi. Nous avons rencontré le recteur Boubakeur, alors président du Conseil français du culte musulman, en 2004, à la mosquée de Paris. Il nous a clairement indiqué que rien ne s'opposait à cet étourdissement préalable, du moment qu'il était réversible, ce qui n'est pas le cas du pistolet perforant Matador. C'est possible avec la technique de l'électronarcose, largement utilisée en Australie. Un abattoir doit y avoir recours en France.
Dans la réglementation européenne et française, il y a exception à l'étourdissement si le rite oblige à ce que l'animal soit conscient. Ce n'est pas le cas pour l'abattage musulman. Des autorités musulmanes nous l'ont dit et répété. Un groupe plus radical demande que l'animal soit conscient. Faut-il donner raison à ceux qui refusent le dialogue alors que la majorité souhaite que l'animal souffre le moins possible ? La nouvelle règlementation sur l'abattage apportera des améliorations, ainsi qu'en matière de formation des personnels des abattoirs, peu qualifiés et souvent originaires des pays de l'Est.

Comment expliquer une telle proportion d'abattage rituel, alors que notre pays ne compte que 5 à 7 % de musulmans pratiquants et 1 à 2 % de juifs pratiquants, selon mes informations ?
Le secteur économique des abattoirs sait se faire entendre. Il refuse de se compliquer la vie, puisque l'étiquetage n'est pas obligatoire ; comme aucune traçabilité n'est exigée, les viandes issues d'animaux abattus rituellement peuvent être recyclées dans le circuit classique.
Non sans hypocrisie, les autorités prétendent que la législation européenne est en cause. Mais lorsque le débat a eu lieu, la France a fait barrage. Mme Alliot-Marie, par exemple, a pris fermement position contre l'étourdissement lors d'un dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF). De plus les États membres de l'Union européenne sont libres de prendre des dispositions selon les accords passés avec les cultes. La volonté d'encadrement fait défaut. Le secteur économique a été entendu, les cultes un peu, les associations de défense des animaux pas du tout.

Des tests scientifiques ont montré que les bovins pouvaient ne perdre conscience qu'au bout de 11 à 14 minutes. Or les abattoirs en abattent un toutes les 45 secondes. La qualité de la viande doit pâtir de la souffrance des animaux.
Nous demandons que l'animal reste un temps minimal dans le piège de contention, pour contraindre les abattoirs à diminuer les cadences. Cela inciterait à développer l'électro-narcose ou l'étourdissement juste après la saignée, même si nous souhaitons plutôt un étourdissement préalable. Il faut que l'animal passe un temps suffisant dans le box pour garantir l'étourdissement.

Le rapport du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) de 2011 explique que l'égorgement est très douloureux, voire insupportable. Étourdir l'animal après est-il pertinent ?
Nous ne cessons de revoir nos demandes à la baisse. Depuis toujours nous réclamons un étourdissement préalable. En dépit d'échanges intéressants avec les cultes et de promesses que M. Sarkozy a renouvelées quand il est devenu président de la République, rien n'a suivi.

L'abattoir de Sablé pratique l'abattage rituel avec égorgement puis étourdissement dans les cinq secondes qui suivent. Son ancien directeur affirme que cette méthode ne cause aucune souffrance aux animaux.
Cette méthode se développe dans plusieurs abattoirs, comme à Charal. Si l'étourdissement est immédiat, on peut considérer que le système nerveux n'a pas le temps de ressentir la douleur.

C'est vrai. L'animal fonctionne différemment de l'homme. Quand l'animal réagit à la douleur, l'homme qui l'intellectualise, se lamente et elle augmente d'autant. Le délai de quelques secondes me paraît un compromis raisonnable.
C'est juste. Il en va de même quand on se coupe : sauf si on voit la blessure, la douleur n'est pas immédiate. Souvent l'animal relève la tête au moment de la saignée et est étourdi à ce moment-là. Qu'il échappe ainsi à l'agonie est un moindre mal.

Avez-vous connaissance d'incidents dans les abattoirs ? Portez-vous plainte dans ces cas ?
Nous n'y sommes pas habilités. Nous intervenons sur les sites d'abattage rituels temporaires ou contre les abattoirs clandestins, parce que l'on peut retenir un acte de cruauté sanctionné pénalement. Le contrôle des abattoirs relève des services vétérinaires. Dans des cas particulièrement graves, par exemple d'animaux suspendus vivants, ils nous demandent de nous porter partie civile.
Il y a de grandes différences entre les abattoirs. Certes un taux d'erreur sur le système d'étourdissement de 1 à 2 % est acceptable, mais il peut monter à plus de 20 %. Les États-Unis ont établi un barème de contrôle pour évaluer les erreurs.
Nous espérons que les formations prévues par la nouvelle règlementation sur les abattages apportera des améliorations. Toutefois, les procédures simplifiées applicables aux personnes travaillant depuis trois ans, dispensées de formation, nous inquiètent. On peut commettre des erreurs pendant trois ans sans le savoir.
De plus les contrôles dans les abattoirs sont effectués post-mortem. Cela crée un risque sanitaire pour les consommateurs. Surtout, comment apprécier l'état des animaux à l'arrivée à l'abattoir ?

Absolument ! Il faut surveiller ce qui se passe en amont des abattoirs. On découvrirait bien des manquements.
Ainsi de l'abattage dit d'urgence quoique réalisé en dernier, pour des animaux qui arrivent dans un état lamentable !

Le mauvais traitement à animal mène en correctionnelle. Je partage votre point de vue sur la formation. Celui qui est formé aura un geste un geste plus sûr.
N'oublions pas que la règle est l'étourdissement. L'exception doit être justifiée par une demande spécifique. Or la pratique s'est inversée. Nous récupérons de nombreux animaux en souffrance : 600 bovins, 400 chevaux en situation de maltraitance. A cet égard de nombreux éleveurs en difficulté laissent leurs animaux dépérir et les syndicats agricoles témoignent de peu de solidarité.

Quelle technique concilierait-elle l'intérêt de l'animal, l'abattage à des fins rituelles et l'abattage destiné au circuit commun ?
De nombreux pays musulmans pratiquent l'étourdissement. Certains abattoirs d'ovins usent de la saignée après étourdissement avec l'accord des autorités religieuses. En revanche, je ne connais pas d'exemple de pays ayant passé des accords avec les représentants du culte juif pour un abattage avec étourdissement.