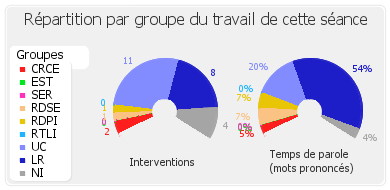Séance en hémicycle du 28 novembre 2014 à 22h30
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à vingt heures trente, est reprise à vingt-deux heures trente.

Le Sénat va examiner les crédits de la mission « Sécurités » (et article 59 septies) et du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ».
La parole est à M. Philippe Dominati, rapporteur spécial.

Monsieur le président, monsieur le ministre de l’intérieur, mes chers collègues, il y a plusieurs manières d’apprécier la politique de sécurité de l’État que retracent les programmes « Police nationale » et « Gendarmerie nationale » : d’un point de vue strictement budgétaire et d’un point de vue davantage politique, en appréciant leurs résultats.
Sur le plan budgétaire, les crédits proposés au titre des programmes « Police nationale » et « Gendarmerie nationale » s’élèvent à 17, 76 milliards d’euros en crédits de paiement, en progression de 0, 49 % par rapport aux crédits ouverts en loi de finances initiale pour 2014. Cette hausse reflète pour partie les créations de postes, qui se poursuivent en 2015, à hauteur de 405 emplois, dont 243 pour la police et 162 pour la gendarmerie.
Par rapport aux autres pays de l’Union européenne, la France se situe dans la moyenne, avec un policier ou un gendarme pour 270 habitants. Selon les années, certaines missions pèsent cependant sur l’activité des policiers ou des gendarmes, comme l’établissement des procurations de vote, qui ont requis l’équivalent de 737 emplois équivalent temps plein en 2012. Or notre pays connaîtra deux élections en 2015.
Enfin, les transfèrements de détenus font l’objet de la reprise d’un processus de transfert entamé en 2012 entre le ministère de l’intérieur et le ministère de la justice et interrompu pour des raisons techniques. Ce transfert de compétences est nécessaire pour recentrer l’action des forces de sécurité sur leur cœur de métier.
S’agissant des postes pourvus, des écarts croissants sont observés entre les prévisions et les exécutions du plafond d’emplois de la gendarmerie nationale : la sous-exécution a atteint 1 810 emplois équivalent temps plein travaillé en 2013, soit 1, 86 % des emplois du programme, ce qui traduit la difficulté des gestionnaires à appréhender les comportements individuels des agents, notamment les départs à la retraite. En conséquence, les effectifs de trop nombreuses brigades de gendarmerie sont aujourd’hui incomplets.
Concernant la masse salariale, la stabilisation des dépenses de personnel de la police nationale entre 2014 et 2015 s’explique par une surévaluation des crédits de titre 2 en loi de finances initiale pour 2014. À périmètre constant, les dépenses de personnel augmentent en réalité de 1, 1 % par rapport à 2014. Pour la fin de la période couverte par le budget triennal, entre 2015 et 2017, la masse salariale devrait en revanche se stabiliser, sous l’effet d’un repyramidage et d’une baisse considérable des mesures catégorielles : de 20, 88 millions d’euros en 2015, ces dernières chuteraient à 13, 62 millions d’euros en 2016 et à moins de 1 million d’euros en 2017, soit un niveau historiquement bas. Une telle réduction des mesures catégorielles risque de poser un problème d’attractivité des métiers de la sécurité.
Une autre question récurrente est celle du stock d’heures supplémentaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, estimé à 15 749 640 heures par le ministère de l’intérieur. La Cour des comptes a considéré que cette situation requérait la constitution d’une provision, dont elle a évalué le montant à 322 millions d’euros.
En investissement, je déplore que le rythme de renouvellement des flottes de véhicules entraîne leur vieillissement.
Si l’on considère à présent, d’un point de vue plus politique, les résultats de la politique de sécurité, force est de constater que les indicateurs de mission montrent une hausse généralisée de la délinquance en 2013.
L’évolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique des personnes constatés a augmenté l’an passé tant en zone police, de 1, 29 %, qu’en zone gendarmerie, de 3, 2 %. L’évolution des violences physiques non crapuleuses et des violences sexuelles a été en hausse de 1, 1 % en 2013 en zone police et de 9, 8 % en zone gendarmerie, au lieu d’une baisse de 9, 2 % en 2012.
Le nombre de cambriolages a progressé de 7 %, tant en zone police qu’en zone gendarmerie, pour atteindre au total 390 000 en 2013. Le nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens constatés a augmenté en zone police de 2, 7 % et en zone gendarmerie de 3, 9 %.
Les résultats du premier semestre de 2014, détaillés dans le rapport spécial, sont contrastés.
De telles évolutions, en partie imputables à la situation économique, laisseront des traces durables sur le sentiment d’insécurité de nos concitoyens, même lorsque la situation s’améliorera, ce qui constitue un argument supplémentaire pour l’élaboration d’un indicateur sur le sentiment d’insécurité. En effet, il y a lieu de regretter que le sentiment d’insécurité ne soit toujours pas mesuré au sein du dispositif de performance. Dans les réponses au questionnaire budgétaire, la direction générale de la gendarmerie nationale a répondu que le calendrier des enquêtes conduites par l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales ne permettait pas de les intégrer dans les documents budgétaires. Il est dommage que les données issues des outils statistiques pourtant disponibles ne puissent pas être recueillies ni valorisées en cohérence avec la démarche de performance qui sous-tend les politiques publiques depuis l’adoption de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Par ailleurs, un indicateur mesurant la part des activités dédiées à la prévention et à la répression par les forces de police pourrait utilement être construit à partir de recueils de données auprès des agents sur leurs activités. Ce pourrait être l’un des objectifs du nouveau service statistique ministériel de la sécurité intérieure, créé cette année.
Enfin, l’Assemblée nationale a adopté un nouvel article tendant à permettre aux collectivités territoriales de participer, jusqu’en 2017, au financement d’opérations immobilières de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la justice. Ces dispositions, initialement instituées jusqu’en 2007 par la loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, avaient déjà été rétablies une première fois par la deuxième loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure entre 2011 et la fin de 2013. Il est donc proposé de rétablir une nouvelle fois ce dispositif, au regard de la nécessité de conduire des opérations d’investissement en partenariat avec les collectivités territoriales. Un tel article est nécessaire pour conduire à bien ces opérations.
Je tiens enfin à saluer le courage et l’engagement des forces de sécurité, dont j’ai pu rencontrer les syndicats, ainsi que les directeurs généraux de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Mais la question des suicides est révélatrice d’un malaise : quelles sont les données actuelles, monsieur le ministre ? Quelles réponses le Gouvernement entend-il apporter ?
Je souhaite évoquer un dernier point, bien qu’il ne concerne pas directement les crédits de cette mission : le Gouvernement, par négligence, a paralysé l’action des forces de sécurité en supprimant toutes les écoutes légales. Il serait bon que vous nous apportiez un certain nombre de précisions.
Sous le bénéfice de ces observations, la commission des finances a décidé de proposer au Sénat d’adopter sans modification les crédits de la mission « Sécurités », qui concourt à la mise en œuvre d’une politique régalienne, et l’article 59 septies rattaché.
Applaudissements sur les travées de l’UMP.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la politique de sécurité routière a porté ses fruits, puisque le nombre de tués et de blessés sur les routes françaises a fortement diminué de 2008 à 2013 : nous avons déploré 3 268 morts en 2012, et le Gouvernement entend passer sous la barre des 3 200 morts en 2015. Toutefois, il convient de ne jamais baisser la garde, car on relève une légère hausse du nombre de morts dans les huit premiers mois de 2014.
L’indicateur permettant de connaître l’évolution des facteurs de risques a disparu du projet annuel de performances, ce que je regrette, et les réponses au questionnaire budgétaire ne permettent pas de le remplacer.
Les dépenses inscrites sur le programme 207 « Sécurité et éducation routières » de la mission « Sécurités » restent stables, la forte diminution apparente étant due en fait à un transfert. En effet, à l’occasion du rattachement de la politique de sécurité et d’éducation routières au ministère de l’intérieur, l’ensemble des crédits et emplois correspondants sont transférés au programme 216. Les dépenses de personnel disparaissent ainsi du programme 207.
Le contexte des faibles taux d’intérêt permet de réduire la charge financière de l’État au titre du « permis à un euro par jour », dont la dotation diminue de 1 million d’euros. J’avais fait cette observation l’an dernier, et je constate qu’elle a été prise en compte cette année.
Enfin, une réforme du permis de conduire a été annoncée. J’y suis favorable sur le fond, mais je souhaite qu’elle se fasse à crédits constants, sans coût supplémentaire pour le budget de l’État.
En ce qui concerne le compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », le produit total des amendes de la circulation et du stationnement en 2014 devrait atteindre 1, 671 milliard d’euros. Sur ce total, une somme de 1, 377 milliard d’euros est inscrite en dépenses sur le compte.
Le Gouvernement prévoit la stabilisation du nombre de radars en 2015, soit à hauteur de 4 200, mais 253 d’entre eux seront remplacés, en particulier par des radars « chantier » et des radars « vitesse moyenne ». Le coût d’installation et de maintenance des radars s’établit à 117 millions d’euros, dont plus de 26 millions d’euros afin de remplacer les dispositifs anciens.
Je m’interroge néanmoins sur l’opportunité, dans le contexte budgétaire actuel, d’installer 40 nouveaux radars « vitesse moyenne », pour un coût unitaire de 167 000 euros, soit le triple d’un radar mobile-mobile par exemple, et 43 radars « chantier » pour un coût unitaire d’environ 200 000 euros. C’est pourquoi je proposerai un amendement tendant à réduire les nouvelles installations à 20 radars « vitesse moyenne » et 20 radars « chantier », soit une économie de 7, 3 millions d’euros, cette économie pouvant augmenter d’autant le programme 754, « Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières ».
La dotation affectée à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions, l’ANTAI, diminue légèrement à 123, 6 millions d’euros. Je vous proposerai d’adopter un amendement tendant à diminuer la subvention à l’ANTAI de 20 millions d’euros, afin de procéder à un prélèvement à due concurrence sur son fonds de roulement – nous avons beaucoup évoqué ce type d’opération pour d’autres organismes. Il me semble que ce fonds de roulement, dont le montant officiel n’a pu m’être communiqué à ce jour, dépasse le seuil prudentiel de 14, 5 millions d’euros, même après un premier prélèvement au profit de l’Agence nationale des titres sécurisés.
En 2014, l’État dépensera 15, 7 millions d’euros pour envoyer 17 millions de lettres simples informant du retrait ou de la restitution de points sur le permis de conduire. Or les automobilistes disposent aujourd’hui de moyens efficaces pour connaître leur nombre de points, même si leur efficacité peut être améliorée. Tel est le cas du site internet Télépoints, très fiable pour les permis de conduire obtenus à partir de 2013, mais un peu moins pour les permis antérieurs ; avec un mot de passe, son fonctionnement pourrait être très sérieusement amélioré.
En outre, le nombre de points retirés à chaque infraction est indiqué sur l’avis de contravention. Il est possible pour chacun de faire ses comptes très facilement. C’est pourquoi je vous proposerai, en vue de modifier le code de la route, deux amendements tendant à supprimer l’obligation d’envoyer des lettres simples à l’occasion du retrait ou de la restitution de points.
Le procès-verbal électronique, qui remplace le carnet à souches pour la constatation des infractions de la circulation et du stationnement routiers, est maintenant complètement déployé dans les forces de l’ordre au sein de l’État – plus de 15 600 outils de verbalisation électronique ont été répartis entre police nationale et gendarmerie nationale. Au 1er septembre 2014, 1 954 communes avaient fait le choix de doter leur police municipale du système de procès-verbal électronique, et ce nombre va bien sûr croissant. À cet égard, le fonds d’amorçage destiné à aider les communes à acquérir leurs équipements électroniques de verbalisation a été prorogé jusqu’en 2015 par la loi de finances pour 2014.
Il convient enfin de souligner que la mise en œuvre à compter du 1er janvier 2016 de la dépénalisation du stationnement payant, prévue par l’article 63 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, modifiera profondément le périmètre du compte d’affectation spéciale sur le contrôle de la circulation et du stationnement routiers.
Sous réserve de l’adoption des amendements que je présenterai, qui ont reçu un avis favorable de la commission des finances, je propose d’adopter ces crédits.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les crédits du programme « Sécurité civile » de la mission « Sécurités » ne couvrent qu’une partie des moyens dédiés à la sécurité civile. S’agissant des moyens de l’État, ils forment 48 % des crédits de paiement de la politique transversale de sécurité civile.
Par ailleurs, le budget total des services départementaux d’incendie et de secours, les SDIS, atteint 4, 36 milliards d’euros dans les budgets primitifs pour 2014, soit cinq fois les crédits inscrits aux missions du budget de l’État. La politique de sécurité civile relève donc bien d’une responsabilité partagée. À cet égard, s’agissant de l’avenir des SDIS, vous avez confirmé, monsieur le ministre, lors du 121e congrès national des sapeurs-pompiers de France, le 4 octobre dernier, le rôle de l’échelon départemental, garant de la proximité, comme niveau d’organisation de la réponse opérationnelle. Peut-être pourriez-vous nous en dire davantage sur l’organisation future des SDIS et leurs perspectives de financement par l’État.
S’agissant du programme « Sécurité civile », les crédits de paiement proposés, à hauteur de 439, 55 millions d’euros, sont en hausse de 0, 6 % par rapport à 2014, sous l’effet d’une hausse des dépenses de personnel.
Le schéma d’emploi du programme traduit une diminution de 24 postes ou emplois équivalent temps plein. Malgré cette baisse, le projet de loi de finances propose une hausse de plus de 2 % des dépenses de personnel. En réalité, cette progression traduit la correction – attendue – d’une sous-budgétisation chronique des dépenses de personnel de la mission par rapport à l’exécution.
Cette année est marquée par la refonte et la simplification du dispositif de performance : cinq objectifs et neuf indicateurs sont proposés, au lieu de neuf objectifs et onze indicateurs dans le projet de loi de finances initiale pour 2014. Cette évolution tend à accroître la lisibilité des moyens dédiés à la politique de sécurité civile. Cependant, le changement d’indicateur mesurant la disponibilité des hélicoptères ne permet plus d’établir des comparaisons d’une année sur l’autre, alors qu’apparaissaient les conséquences néfastes du vieillissement de la flotte sur la performance. Avoir modifié cet indicateur apparaît comme une façon de « casser le thermomètre ».
S’agissant de la flotte d’aéronefs, le renouvellement de la composante aérienne de la sécurité civile, trop longtemps différé, devient urgent. Le remplacement des neuf Tracker, dédiés à l’attaque des feux naissants, est toujours prévu à l’horizon de 2020.
Dans les réponses au questionnaire budgétaire, vos services, monsieur le ministre, ont seulement indiqué que « la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, la DGSCGC, remettrait des propositions techniques pour le renouvellement de la composante Tracker, en étudiant différents modèles économiques – achat, location... ». Or, comme le reconnaît la DGSCGC, « la flotte d’avions d’investigation et de coordination Beechcraft 200 est vieillissante – âge moyen vingt-sept ans – et confrontée à des obsolescences », mais des réponses semblent en mesure d’être apportées à court et moyen terme puisque, toujours selon le ministère de l’intérieur, « dans le cadre du nouveau marché de maintien en condition opérationnelle, une rénovation avionique est prévue qui permettra de prolonger leur durée de vie. L’équipement de deux des trois avions de la flotte en moyens optroniques permettra de moderniser l’approche des missions d’investigation feux de forêt et de développer de nouvelles missions subsidiaires au profit du ministère de l’intérieur ».
Dans l’immédiat, ces choix engendrent des dépenses de maintenance accrues. Il serait donc utile d’effectuer des simulations sur les surcoûts liés au maintien de la flotte actuelle, en termes de maintenance et de révision des appareils, et le coût de l’acquisition de nouveaux appareils, au regard de l’obsolescence des appareils et de la nécessité d’assurer le plus haut niveau de sécurité des pilotes.
Il conviendrait aussi d’envisager de développer les mutualisations dans le recours aux appareils de la flotte des hélicoptères, au sein du même ministère, avec les forces de police et de gendarmerie, ou au niveau interministériel, par exemple avec les acteurs de la santé publique, en prenant bien sûr en compte les différences d’usage.
Il pourrait ainsi être envisagé une flotte nationale unique regroupant l’ensemble des hélicoptères actuels de la sécurité civile, de la gendarmerie et du SAMU, en définissant chaque année le crédit d’heures qui serait alloué pour chacune des missions, ainsi que de prédéfinir les règles de priorité d’emploi entre ces différents services. Cette disposition présenterait l’avantage d’une homogénéité du parc aérien et donc une économie du coût de sa maintenance, ainsi qu’une optimisation de l’emploi opérationnel des vecteurs aériens.
Je voudrais enfin dire un mot du développement du projet ANTARES – Adaptation nationale des transmissions aux risques et aux secours –, qui vise une meilleure interopérabilité des systèmes de communication des forces de sécurité. D’ici à 2018, le coût total d’investissement s’élèvera à 118, 85 millions d’euros pour l’État. Le financement de l’investissement est partagé entre l’État, s’agissant du financement des infrastructures, et les SDIS, en ce qui concerne les postes mobiles et l’adaptation technique des dispositifs radio.
Au regard des investissements que doivent continuer à consentir les SDIS, il est regrettable que, depuis la loi de finances initiale pour 2013, il ne soit plus inscrit de crédits budgétaires en autorisations d’engagement au titre du Fonds d’aide à l’investissement instauré par l’article 129 de la loi de finances pour 2003, pour soutenir les SDIS dans leurs efforts d’investissement en équipements et en matériels. En effet, une partie importante des crédits du FAI concourait spécifiquement, depuis 2007, au financement du programme ANTARES.
En 2015 et 2016, le Gouvernement concentrera ses investissements sur la couverture par ANTARES de l’ensemble du territoire national, alors que le taux de couverture national du territoire, qui s’établirait à 95 %, pose toujours le problème de « zones blanches » non couvertes. Ce taux de couverture de 95 % correspond vraisemblablement aux résultats issus d’une modélisation de la couverture radio réalisée par l’emploi de modèles informatiques. Les mesures de couverture radio effectuées sur le terrain par certains SDIS font apparaître un taux de couverture du territoire sensiblement inférieur.
Il convient d’envisager des solutions techniques pour améliorer la couverture du territoire, tout en veillant à ce que leur coût ne soit pas excessif au regard de l’objectif poursuivi. À cette fin, je propose que soit créé un nouvel objectif de performance « Couverture optimale du territoire national par le réseau ANTARES en vue de la protection des populations », auquel serait associé un indicateur mesurant le pourcentage de la population couverte par le réseau, renseigné notamment par les résultats de mesures de couverture qui seraient réalisées sur le terrain.
Au final, et sous le bénéfice de ces observations, la commission des finances a décidé de proposer au Sénat d’adopter sans modification les crédits de la mission « Sécurités », qui correspond à la mise en œuvre d’une politique régalienne, y compris en ce qui concerne la sécurité civile.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au sein de la mission « Sécurités », l’enveloppe des crédits consacrés à la gendarmerie nationale s’élève à environ 8 milliards d’euros. Elle affiche une légère augmentation pour 2015, tant en autorisations d’engagement – 1, 6 % – qu’en crédits de paiement – 0, 4 %. C’est une progression certes modeste, mais qui démontre le caractère prioritaire de la gendarmerie et, plus largement, de la sécurité, dans un contexte budgétaire difficile.
Les crédits de personnel, soit 6, 85 milliards d’euros, représentent une bonne part de cette enveloppe et enregistrent pour 2015 une évolution maîtrisée. Ils intègrent la création de 162 postes, qui viennent conforter le mouvement de remontée des effectifs entrepris en 2013, après des années de forte baisse. Ces créations de postes sont donc particulièrement bienvenues.
Hors titre 2, les crédits de la gendarmerie sont en augmentation de 95 millions d’euros en autorisations d’engagement et de 4 millions d’euros en crédits de paiement.
En ce qui concerne les crédits de fonctionnement courant, leur augmentation ne signifie en aucun cas un desserrement de la contrainte puisqu’elle est essentiellement liée à la progression des loyers du parc immobilier. Ces loyers représentent à eux seuls 500 millions d’euros, soit près de la moitié de ces crédits. En conséquence, un certain nombre de postes subiront une modération, c’est le cas de l’entretien des véhicules, des dépenses de carburant, des déplacements ou encore de l’entretien léger du casernement. Dans tous ces domaines, les besoins sont estimés au plus juste et les crédits gérés à l’économie.
En revanche, ce budget comporte plusieurs avancées en matière de crédits d’investissement.
Première avancée : des moyens sont dégagés pour permettre l’achat d’équipements informatiques indispensables, tels que des ordinateurs, des terminaux 3G pour les véhicules de patrouille et pour permettre aussi de lancer un plan de modernisation des systèmes d’information et de communication, même si la dotation consacrée à ce plan en 2015 demeure limitée.
Par ailleurs, une expérimentation relative à l’utilisation de tablettes numériques devrait démarrer en 2015, l’idée étant que, à terme, chaque gendarme soit doté de sa propre tablette et donc connecté en permanence au réseau, même quand il se trouve en dehors de son véhicule.
Deuxième avancée : 41, 4 millions d’euros en autorisations d’engagement devraient être consacrés à l’acquisition de 2 000 véhicules légers et motocyclettes. Cela va dans le bon sens, même si on est encore loin des 3 000 véhicules qu’il faudrait commander chaque année pour renouveler le parc automobile de la gendarmerie. Ce parc, vous le savez, est relativement ancien, les véhicules légers ayant en moyenne plus de six ans et les motocyclettes plus de cinq ans.
Troisième avancée, troisième motif de satisfaction : les crédits d’investissement destinés à l’immobilier sont en augmentation, s’élevant à 79, 3 millions d’euros en autorisations d’engagement. Sur cette enveloppe, 70 millions d’euros serviront à financer la première année d’un plan de réhabilitation – attendu ! – du parc domanial et 9, 3 millions d’euros seront consacrés à des opérations urgentes – très urgentes ! – de maintenance et au lancement d’études pour la réhabilitation de la caserne de Melun, dont l’état de délabrement est bien connu.
Ces crédits sont pourtant insuffisants au regard des besoins importants du parc domanial, dont la vétusté pèse sur le moral de nos gendarmes et de leurs familles. Selon la Cour des comptes, il faudrait au moins 160 millions d’euros par an pour remettre à niveau ce parc de logements.
J’ai relevé que 6 millions d’euros étaient prévus pour le versement de subventions aux collectivités territoriales qui investissent en faveur des casernes.
Il est en revanche regrettable qu’aucun crédit ne soit, cette année encore, consacré au renouvellement des hélicoptères et des véhicules blindés. Or l’âge moyen des hélicoptères Écureuil est de trente ans et celui des blindés de quarante ans. Cela laisse d’autant plus songeur que rien n’est prévu non plus dans le budget triennal, une telle dépense étant hors de portée.
Au final, ce budget pour 2015, bien que calculé au plus juste, répond aux besoins de la gendarmerie.
Notre principale préoccupation porte sur la régulation budgétaire, qui obère, dès le début de l’année, les faibles marges de manœuvre de ce budget et gèle pendant des mois les projets d’acquisition ou d’investissement. Il est absolument nécessaire que la levée de la réserve intervienne le plus tôt possible dans l’année. Monsieur le ministre, nous attendons de votre part des assurances sur ce sujet.
Pour conclure, je voudrais exprimer mon soutien à la gendarmerie nationale et saluer l’action remarquable qu’elle mène au quotidien, avec un dévouement tout républicain, pour la sécurité des Français sur une grande partie de notre territoire.
À titre personnel, je m’abstiendrai, estimant que c’est à la lumière de l’augmentation de la violence de notre société que les moyens de nos gendarmes doivent être examinés, puis déterminés. Ce que j’entends au sein de la commission d’enquête sénatoriale sur l’organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe me conforte dans le jugement selon lequel nous devons aller beaucoup plus loin.
Applaudissements sur les travées de l'UMP . – Mme Nathalie Goulet applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’actualité récente a par deux fois braqué ses projecteurs sur la gendarmerie et ses gendarmes : une première fois à Sivens ; une deuxième lors de survols simultanés par des drones de plusieurs de nos centrales nucléaires, dont la surveillance et la sécurité dépendent en partie, mais en partie seulement, des PSPG, les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie.
Ces deux événements, dont l’un a eu, hélas ! une issue tragique, illustrent les difficultés que rencontrent la gendarmerie départementale et la gendarmerie mobile pour remplir les missions de sécurité et d’ordre publics qui sont les leurs. À ce sujet, la question se pose dans un certain nombre de départements du terrain d’action des PSIG, les pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie, jugé trop vaste, et donc inopérant à sa périphérie.
Pour rester dans le domaine de l’ordre public et de la sécurité, force est de constater que nous connaissons un contexte de progression de la délinquance sur l’ensemble du territoire et de développement d’une nouvelle criminalité : itinérante, transnationale, organisée, en réseau, sans oublier la cybercriminalité.
Nous connaissons votre ambition, monsieur le ministre, d’équiper tous les gendarmes de tablettes afin qu’ils puissent communiquer plus rapidement que les voyous. Cet équipement permettra aussi de géolocaliser les gendarmes. Mais il faut également des véhicules puissants. Qu’en est-il, à cet égard, des avoirs criminels saisis, parmi lesquels on trouve de puissantes voitures, ainsi que de l’accélération et de la simplification de la procédure de transfert de ces véhicules à la gendarmerie ou à la police ?
Le travail accompli conjointement par les gendarmes mobiles et les gendarmes départementaux en prévention de proximité a permis de faire baisser depuis quelques mois, et parfois de façon assez notable, certaines formes de délinquance. Comment comptez-vous amplifier ces résultats ?
Nous pouvons d’ores et déjà vous féliciter d’avoir inversé la tendance baissière des effectifs de la gendarmerie.
Les gendarmes sont en attente d’une révision de la répartition des zones de compétence de la gendarmerie et de la police. Est-ce aussi le cas pour les policiers ?
La création des SGAMI, les secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur, en mai 2014, élément favorisant les fonctions de soutien partagé entre police et gendarmerie, est-elle un outil de mutualisation efficace pour ces deux corps et quel en est le rythme de développement ? Le directeur général de la gendarmerie nationale souhaiterait, par ailleurs, procéder à des regroupements de brigades et, donc, aussi à des fermetures de brigades trop petites. Permettez-moi, monsieur le ministre, sachant le choc que peut causer la fermeture d’une brigade lorsque cela semble nécessaire, de suggérer que cela soit fait en concertation approfondie avec les élus locaux. La proximité est aujourd’hui affirmée et revendiquée fortement par les élus locaux, parce qu’elle permet confiance et réactivité.
Une autre forme de proximité, le numérique, la généralisation des smartphones, peut constituer un nouveau lien entre gendarmes et population en ce qu’il implique cette dernière. Quelles suites pensez-vous donner à ces pratiques et à ces nouvelles technologies ?
L’accent mis sur la proximité a sans aucun doute contribué aux bons résultats obtenus en 2014 dans l’application du plan national de lutte contre les cambriolages et les vols à main armée, notamment au niveau des exploitations agricoles. Rappelons que le ministre de l’intérieur avait lancé ce plan en septembre 2013, après le constat d’une forte augmentation du nombre des cambriolages commis. L’action multiforme mise en œuvre par la gendarmerie dans ce cadre – les groupes d’enquête et de lutte anti-cambriolages, les GELAC, les brigades d’observation et de surveillance, les BOS, au niveau local, la présence dissuasive sur le terrain, la surveillance des flux sur les axes de circulation, les systèmes d’alerte, le travail au sein de l’Office central de lutte contre la délinquance itinérante, l’OCLDI, conjointement avec la police, sur le démantèlement de gros réseaux... – lui a permis d’inverser la tendance en 2014, avec une baisse de plus de 8 % du nombre de cambriolages sur les six premiers mois de l’année.
En ce qui concerne les autres missions de la gendarmerie, celles en rapport avec l’activité pénale sont très prenantes. Nous notons, notamment, qu’un accord a finalement été trouvé en ce qui concerne les transfèrements, lesquels devraient entièrement revenir à l’administration pénitentiaire à l’horizon de 2019.
Concernant la sécurité routière, la gendarmerie poursuit l’objectif de réduire le nombre de tués sur les routes en deçà de 2 000 par an. La lutte contre ce fléau incombe à la fois aux brigades et à des unités spécialisées, les escadrons départementaux de sécurité routière, les EDSR, et ce sur près de 85 % du réseau routier français.
Pour conclure, je voudrais préciser que, si mon collègue Gournac a annoncé qu’il s’abstiendra à titre personnel, pour ma part, je suis favorable, à l’instar de la commission des affaires étrangères, au budget de la gendarmerie pour 2015, …

M. Jean-Pierre Raffarin. C’est la diversité de la commission des affaires étrangères, mais aussi son unité !
Sourires.

… lequel, même s’il reste en effet contraint, prend en compte les besoins de ce corps.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais avant toute chose rendre hommage aux forces de l’ordre, en particulier aux agents qui ont fait le sacrifice de leur vie dans l’exercice des missions qui leur étaient confiées.
Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2015, les crédits examinés au titre de la mission « Sécurités », hors sécurité civile – le budget de ce dernier programme étant rapporté pour avis par ma collègue Catherine Troendlé –, s’élèvent à 17, 8 milliards d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur un total de 18, 2 milliards d’euros pour la mission, soit une stabilisation des crédits en euros courants par rapport aux crédits ouverts en loi de finances pour l’année 2014.
En tant que rapporteur pour avis de la commission des lois pour les crédits de la mission « Sécurités », hors sécurité civile, je souhaiterais insister sur la question particulière des crédits de fonctionnement, notamment ceux dédiés à l’entretien et à la maintenance du parc immobilier et au renouvellement du parc automobile.
Si l’on peut saluer les efforts en matière immobilière, en particulier le plan triennal de 210 millions d’euros pour réhabiliter le parc immobilier de la gendarmerie nationale ou les crédits accordés pour le renouvellement du parc automobile des deux forces de la police et de la gendarmerie nationales pour l’année 2015, je souhaiterais souligner que les débats au sein de la commission des lois ont moins porté sur le montant des crédits accordés que sur les conditions d’exécution du budget. En effet, le gel précoce des crédits, et leur dégel parfois très tardif, est une pratique choquante : la représentation nationale ignore les montants qui seront gelés au moment du vote du projet de loi de finances.
Au-delà de l’effet direct sur l’activité opérationnelle des forces de l’ordre, car le gel des crédits de fonctionnement se répercute, par exemple, sur les dépenses de carburants, une telle pratique déresponsabilise les gestionnaires et désorganise les programmes d’achat. Ainsi, au 1er juillet de cette année, dans la gendarmerie nationale, 37 véhicules seulement avaient été commandés ; les 1 400 autres véhicules nécessaires pour renouveler le parc automobile n’ont été commandés qu’en octobre, à la faveur du dégel des crédits.
Enfin, cette situation a un effet direct sur le moral des agents des forces de l’ordre, que j’ai senti très affectés lors des auditions.
Face à ces contraintes sur les moyens de fonctionnement, il est nécessaire de réfléchir à d’autres sources de financement. En matière immobilière, le dispositif de l’article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, qui permet à ces collectivités de conclure des conventions pour construire, acquérir ou rénover un immeuble en vue de le mettre à disposition de l’État, en échange d’une subvention et d’une compensation des dépenses éligibles au Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, le FCTVA, prolongé par la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite LOPPSI 2, jusqu’en 2013, a été à nouveau prolongé par l’article 59 septies du présent projet de loi de finances jusqu’en 2017, ce dont je me félicite. En effet, ce mécanisme permet de financer la construction de brigades de gendarmerie ou de commissariats de police.
Pour ce qui concerne les moyens de fonctionnement en général, j’observe que, lors de votre audition par la commission des lois la semaine passée, vous avez évoqué, monsieur le ministre, l’idée d’attribuer aux services une fraction du produit des avoirs criminels saisis. C’est une excellente idée.
Je souhaiterais appeler votre attention sur les deux points précis suivants, dans le prolongement des débats qui ont eu lieu en commission.
Tout d’abord, quelles sont les mesures envisagées pour améliorer la situation actuellement constatée en matière de dépenses de fonctionnement des forces ? En particulier, nous souhaiterions savoir en quoi l’instauration des SGAMI permettra de mieux lisser dans le temps les programmes d’achat.
Ensuite, vous avez évoqué la possibilité d’attribuer au budget de fonctionnement des forces de l’ordre une fraction des avoirs criminels saisis. Pouvez-vous nous préciser l’état d’avancement des réflexions sur ce point ?
Sous réserve des observations liées aux effets particulièrement négatifs de l’utilisation de mesures de régulation budgétaire lors de l’exécution du budget, la commission des lois a émis un avis favorable sur les crédits de la mission « Sécurités », hors sécurité civile.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais rendre hommage à tous lespersonnels de la sécurité civile, aux sapeurs-pompiersvolontaires et professionnels, à tous les secouristes, qui, aupéril de leur vie, s’engagent au quotidien au service desautres.
Je voudrais également saluer l’engagement des jeunes sapeurs-pompiers, qui contribueront, je le souhaite ardemment, à pérenniser notre modèle de sécurité civile en grande partie fondé sur le volontariat citoyen.
Monsieur le ministre, je ne reviendrai pas sur les éléments strictement budgétaires qui ont été très précisément exposés par l’excellent rapporteur spécial, notre collègue Jean-Pierre Vogel.
Ce budget s’inscrit dans le droit fil des précédents, à commencer par le Fonds d’aide à l’investissement, pour lequel aucune autorisation d’engagement nouvelle n’est inscrite. Comme pour le présent exercice, la dotation correspondante de 3, 8 millions d’euros en crédits de paiement est destinée au financement des investissements qui avaient bénéficié d’une subvention du FAI au cours des années précédentes, mais n’avaient pas encore été achevés.
La disparition programmée de ce fonds rend d’autant plus urgente l’adaptation de l’environnement normatif des secours aux moyens justement nécessaires requis par chaque mission afin de ne pas mobiliser inutilement des hommes et des matériels qui, tous, ont un coût pour la collectivité. Il importe aujourd’hui de mieux rationaliser l’organisation des secours en France, alors que les sapeurs-pompiers sont quotidiennement appelés à pallier l’indisponibilité des urgences médicales.
J’évoquerai deux autres grands chantiers portés par la sécurité civile.
Le premier grand chantier concerne le calendrier de mise en service du nouveau système d’alerte et d’information des populations, qui connaît des retards.
La loi du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure prévoyait l’achèvement du déploiement des sirènes de l’État pour la fin de 2015. Sur la base des crédits inscrits pour le triennat 2015-2017, il est aujourd’hui fixé à 2019. En outre, le solde des 32 millions d’euros destinés au volet téléphonie mobile n’est pas programmé à ce jour. Il s’agit pourtant d’un dispositif essentiel pour l’efficacité des secours. Sa réalisation doit donc s’inscrire parmi les priorités du programme.
Le second grand chantier a trait au réseau de radiocommunications numériques ANTARES.
Ce service est aujourd’hui disponible dans toute la métropole, puisque 95 % du territoire national est couvert et qu’aucun département n’est totalement exclu de la couverture. En revanche, dans certaines zones, en raison de leurs caractéristiques géographiques, la couverture est insatisfaisante, voire inexistante.
Je sais que votre ministère s’attache prioritairement à achever le développement du service et à améliorer son fonctionnement à la suite d’interruptions constatées lors de la survenance d’incidents climatiques. Une enveloppe budgétaire est destinée à des travaux d’optimisation du réseau.
La réflexion en cours sur les solutions permettant d’équiper la flotte d’aéronefs de la sécurité civile d’un système de radio compatible avec le réseau devrait parvenir – je l’espère ! – à identifier une solution d’ici à l’été prochain. Le règlement de cette difficulté est impératif pour permettre une pleine efficacité du réseau ANTARES, dont je rappelle que le déploiement a mobilisé des crédits très importants.
C'est sur ma proposition que la commission des lois a émis un avis favorable sur le budget de la sécurité civile. Cependant, monsieur le ministre, il reste deux questions que je souhaiterais vous poser.
La première porte sur le secours à personne. Le secours à victime et l’aide à personne constituent aujourd’hui près des quatre cinquièmes de l’activité des sapeurs-pompiers. Ces interventions sont en constante progression.
Sur la base de l’évaluation réalisée par l’Inspection générale de l’administration et l’Inspection générale des affaires sociales, le comité de suivi et d’évaluation du référentiel commun SAMU-SDIS a engagé une réflexion qui s’appuie notamment sur la clarification des missions et la coopération des acteurs, la complémentarité des moyens humains et matériels, tant terrestres qu’héliportés. Les travaux menés entre sapeurs-pompiers et SAMU devraient déboucher au début de l’année 2015.
Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer les mesures engagées par l’État pour remédier aux dysfonctionnements qui perdurent depuis de longues années ? Ces dysfonctionnements affaiblissent la pertinence et la réactivité des secours et sont coûteux en moyens humains et financiers.
J’achèverai mon propos en évoquant les sapeurs-pompiers volontaires. L’engagement recule régulièrement, même si cette désaffection s’est ralentie en 2013. Quels sont les moyens mis en œuvre pour conforter le volontariat et consolider le modèle français de sécurité civile dont il est une composante essentielle ?
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Mes chers collègues, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe comprend le temps d’intervention générale et celui de l’explication de vote.
Je vous rappelle également que, en application des décisions de la conférence des présidents, aucune intervention des orateurs des groupes ne doit dépasser dix minutes.
Le Gouvernement, quant à lui, dispose au total de vingt-cinq minutes pour intervenir.
La parole est à Mme Éliane Assassi.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens à saluer le travail des forces de police et de gendarmerie dans notre pays, qui assurent leurs missions dans des conditions souvent difficiles. J’ai une pensée particulière pour celles et ceux qui nous ont quittés : trente-six policiers et dix-sept gendarmes se sont suicidés au cours de l’année 2014.
Tout comme l’an dernier, nous ne pouvons que saluer la pérennité des moyens alloués à la mission « Sécurités ». Ainsi, les crédits de la police et de la gendarmerie nationales enregistrent, comme cela a été dit, une progression de 0, 5 %. Vous annoncez même, monsieur le ministre, la création de 405 postes. Il y a donc, comme l’an dernier, une rupture avec la tendance qui prévalait depuis le début de l’application de la révision générale des politiques publiques, en 2008. Toutefois, les efforts consentis ne permettront toujours pas de garantir l’existence d’une véritable police ou gendarmerie de proximité.
Il faut donc aller plus loin et plus vite, car, d’une part, le sentiment d’insécurité – réel ou provoqué, c’est-à-dire le ressenti de nos concitoyens – continue malheureusement à être chaque jour un peu plus exacerbé et, d’autre part, le risque est grand de voir, sans réelle implication financière de l’État, ses missions décentralisées – ce que nous ne souhaitons pas – ou, pis, de les voir confisquées par une sécurité privée en expansion continue.
La même remarque vaut pour les investissements. Si nous notons avec satisfaction la progression des budgets d’investissement de la police nationale et de la gendarmerie et saluons les efforts supplémentaires destinés aux systèmes d’information et de communication, force est de constater que les budgets consacrés à l’équipement des fonctionnaires ou aux moyens mobiles demeurent stables, quand ils ne sont pas revus à la baisse. C’est une situation dommageable au regard du vieillissement préoccupant et de l’obsolescence des matériels.
Le budget qui nous est présenté est en trompe-l’œil – pardonnez-moi cette expression, je n’en trouve pas d’autres pour l’instant – et ne répond pas au besoin du service public qu’est la mission de prévention et de maintien de l’ordre public sur l’ensemble du territoire. En effet, les crédits de fonctionnement des deux forces, police nationale et gendarmerie, demeurent contraints, alors même que les attentes de nos concitoyens en matière de sécurité restent extrêmement élevées.
La mission « Sécurités » n’est pas épargnée par l’austérité que vous avez choisie, avec pas moins de 120 millions d’euros sur le budget triennal 2015-2017 de manque à gagner. L’économie atteindra 42 millions d’euros en 2016 et 45 millions d’euros en 2017.
Tout comme l’an dernier, nous déplorons que les fonds nécessaires à la réhabilitation du parc immobilier de la gendarmerie ne soient pas à la hauteur des enjeux et des besoins, puisque seulement 70 millions d’euros sont prévus, alors que ce sont près de 300 millions d’euros par an dont nous aurions besoin, tant pour les réhabilitations lourdes que pour la construction de nouvelles casernes.
Les crédits du programme « Sécurité civile » sont en légère augmentation par rapport à l’an dernier. Toutefois, cela ne parvient pas à endiguer la fragilisation progressive de la situation de la sécurité civile française. Cette fragilisation porte sur les moyens humains et, plus particulièrement, sur les sapeurs-pompiers volontaires, dont les effectifs diminuent de façon inquiétante. Comme nous avons eu l’occasion de le rappeler lors de l’examen de la proposition de loi de M. Courteau, en dix ans, pas moins de 14 000 volontaires sont partis sans pouvoir être remplacés. En cinq ans, pas moins de 600 casernes ont dû fermer sur tout le territoire.

Or les sapeurs-pompiers volontaires représentent 80 % du contingent des pompiers français.
De plus, comment adapter la réponse opérationnelle à l’évolution des missions, notamment à l’augmentation des secours à personne et aux contraintes de disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires, alors que de lourdes contraintes financières pèsent sur les budgets des collectivités territoriales, limitant ainsi le recours au recrutement de sapeurs-pompiers professionnels supplémentaires, et qu'il existe de fortes tensions juridiques par rapport au régime de travail des sapeurs-pompiers professionnels ?
Si on l'aborde de manière transversale, ce budget est donc bien faible en comparaison de l'ensemble des missions qui lui incombent. La sécurité civile illustre parfaitement le désengagement de l'État, qui transfère des compétences aux collectivités – pourtant déjà en phase d'asphyxie avancée – sans leur donner, évidemment, les moyens financiers de les assurer, voire de les assumer.
Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons sur les crédits de cette mission. Il s'agit en quelque sorte d’une abstention « de vigilance », en songeant à l’avenir.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la sécurité est légitimement au cœur des préoccupations de nos concitoyens. Il s’agit d’une prérogative régalienne, et le groupe du RDSE est attaché à ce qu’elle le reste. La question centrale est donc bien celle des moyens dédiés à cette mission et des priorités qu’elle se fixe.
Les deux derniers budgets, ceux de 2013 et de 2014, se sont caractérisés par une rupture avec la politique dite de « révision générale des politiques publiques », ou RGPP, menée de 2009 à 2012. Au cours de cette période, les programmes de la mission « Sécurités » ont perdu au total 9 269 emplois équivalent temps plein. Principalement fondée sur un objectif de suppression d’effectifs, la RGPP appliquée à la sécurité a montré ses limites, avec les effets qu’on lui connaît désormais : dégradation qualitative des emplois, précarisation et recul de l’État dans l’exercice de l’une de ses fonctions régaliennes par excellence.
Si la mission « Sécurités » participe à l’effort de maîtrise des dépenses publiques avec une économie de 120 millions d’euros sur le budget triennal 2015-2017, le budget pour 2015, dans le prolongement des deux précédents budgets, emprunte une direction salutaire pour la sécurité nationale. Nous ne pouvons que l’approuver.
Le projet de loi prévoit une hausse de 0, 5 % des crédits de la police et de la gendarmerie nationales. Dans le contexte budgétaire actuel particulièrement contraint, le groupe du RDSE salue cet effort, qui traduit la mise en œuvre d’une priorité du Gouvernement. Plus précisément, dans une logique de rupture avec la RGPP, qui avait conduit à la suppression, entre 2007 et 2012, de 13 726 postes dans les deux forces de sécurité intérieure, il est proposé de créer 243 emplois dans le programme « Police nationale » et 162 emplois dans le programme « Gendarmerie nationale ». Cet effort – encore trop faible – doit être poursuivi.
La privatisation de la sécurité nationale, qui découle inévitablement de la suppression des moyens, ne pourrait advenir qu’au détriment du droit fondamental de tous à la sûreté.
Par ailleurs, le mouvement de mutualisation entrepris ces dernières années en matière logistique doit trouver un terrain d’application avec la mutualisation de la formation et de l’information. Là résident les vraies sources d’économies, car la réduction des effectifs conduirait à une dégradation continue du service public. Ainsi, si les groupes d’intervention régionale, les GIR, sont un bon exemple de la coopération opérationnelle entre la police et la gendarmerie, la mutualisation, elle, est par ailleurs très limitée. Des expérimentations locales doivent être menées en la matière afin de mesurer l’efficacité de tels regroupements.
Suivant la même ligne, le groupe du RDSE soutient l’effort de maintien des crédits du programme « Sécurité civile ». Le terme générique de « sécurité civile » recouvre une réalité protéiforme, qui conditionne la tranquillité de nos concitoyens. Elle va des sapeurs-pompiers aux militaires des unités d’instruction et d’intervention, en passant par les pilotes d’avions et d’hélicoptères ou les démineurs et porte sur des missions relatives à des inondations, des incendies, des crues, des cyclones tropicaux, des malaises… Bien vaste programme !
Nous savons tous qu’il n’est pas possible de rogner sur ce genre de dépenses, mais qu’il est difficile a contrario de les augmenter dans le contexte budgétaire serré qui est le nôtre.
La politique de sécurité civile est traditionnellement partagée entre sa définition, apanage de l’État central, et sa mise en œuvre, laissée à la discrétion des collectivités locales. Les dépenses d’ensemble de l’État pour la sécurité civile s’élèvent à 1 milliard d’euros. De leur côté, les collectivités locales y consacrent annuellement 5 milliards d’euros. Par exemple, dix ans après la départementalisation, le financement des services départementaux d’incendie et de secours repose à 56 % sur les départements. La pérennité de ce tandem touche aujourd’hui à la question de la définition d’un partenariat équilibré et renouvelé entre l’État et les collectivités, notamment en matière de dépenses.
Comme le soulignait la Cour des comptes, l’amélioration de l’efficacité des dépenses requiert une meilleure coordination entre les intervenants. Elle ajoutait : « L’État doit jouer tout son rôle dans la maîtrise des dépenses, au niveau central pour les normes d’équipement et la gestion des personnels, comme au niveau local pour une rationalisation des implantations et une plus grande mutualisation des moyens. » À ce titre, un rapport récent de notre ancien collègue François Trucy soulignait qu’il existait des gisements d’économies dans la mutualisation des moyens départementaux de la sécurité civile. Le rapporteur identifiait quatre priorités.
La première consiste en l’approfondissement de la démarche de mutualisation des achats des SDIS. Leur montant total s’élève aujourd’hui à 1 420 millions d’euros, dont 1 062 millions d’euros seraient susceptibles de faire l’objet de regroupements.
La deuxième priorité concerne le regroupement des centres de traitement de l’alerte, SDIS et SAMU, pour optimiser les effectifs.
La troisième priorité réside dans la rationalisation de l’emploi et le développement des équipements de formation. Le coût d’une « maison à feu », par exemple, s’élève à 2 millions d’euros environ et représente donc une charge qui pourrait être avantageusement répartie sur plusieurs SDIS.
La quatrième priorité est de définir un niveau pertinent de coordination des équipes et des moyens spécialisés des SDIS, qui serait celui de la zone de défense et de sécurité. L’économie résultant d’une telle réforme serait de l’ordre de 8 millions d’euros.
En outre, alors que nous venons de débattre de la proposition de loi déposée par notre collègue Courteau relative aux sapeurs-pompiers volontaires, il faut rappeler que la remise en cause du modèle binaire volontaires-professionnels conduirait au recrutement de plus de 60 000 sapeurs-pompiers professionnels, pour un montant de 2, 5 milliards d’euros, qui serait supporté par les collectivités territoriales. Pour cette raison, le modèle doit être pérennisé et le volontariat encouragé par tous les moyens.
Mutualisation des moyens, rationalisation des structures, volontariat : tels sont aujourd’hui les enjeux d’avenir, qui permettront à la fois de ne pas brader notre sécurité civile et de réaliser des économies d’échelle efficientes.
Dans ces conditions, vous l’aurez compris, le groupe du RDSE approuvera les crédits de cette mission.
Applaudissements sur les travées du RDSE et du groupe socialiste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la sécurité est la première des libertés que doit garantir l’État dans le cadre de ses missions régaliennes. Voilà une évidence devant laquelle tout le monde ici tombera d’accord. Mais, s’il s’agit d’une évidence dans la déclaration, tel n’est plus du tout le cas, et depuis longtemps, dans les faits. Pourtant, la sécurité est à la société ce que les fondations sont à une maison. Sans sécurité, la maison France est condamnée à la violence, à l’anarchie et à l’effondrement. Sans sécurité, point d’activités économiques viables, si ce n’est l’économie souterraine, l’économie de la drogue, qui fait des ravages à Marseille, dans un silence assourdissant du premier magistrat de la ville.

Nous nous devons par conséquent de considérer la sécurité comme la priorité, car elle conditionne tout le reste. Aussi l’augmentation des effectifs de police et de gendarmerie actée ici est-elle très loin d’être suffisante. Elle ne fait qu’entamer un timide début de rattrapage de la fonte des effectifs opérée sous la présidence de Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012, qui avait contribué, durant la même période, à une augmentation de 45 % des agressions sur les personnes physiques.
Depuis lors, l’insécurité a continué de se développer, malgré les statistiques coupées des réalités dont nous abreuve le ministère de l’intérieur. C’est ce que confirme le rapporteur spécial, en soulignant une hausse généralisée de la délinquance en 2013, conforme à la réalité du terrain.
Malgré les 18 milliards d’euros qui seront votés, l’insécurité n’est pas prête de reculer dans notre pays. Fidèle à son idéologie, qui veut qu’il n’y ait d’insécurité que d’insécurité sociale, rejetant toute responsabilité individuelle, le Gouvernement s’obstine à agir contre le seul sentiment d’insécurité. Cela se traduit par l’absence de réelle réponse judiciaire. Quant aux réponses apportées, elles vont à l’encontre du bon sens, découragent les forces de l’ordre et révoltent les victimes.
Depuis trop longtemps – les récents événements de Sivens l’ont rappelé –, la gauche et la droite sont en échec total face aux violences. Elles restent toutes deux prisonnières de leurs dogmes : laxisme, victimisation des coupables, désengagement de l’État, affaiblissement matériel et moral des forces de l’ordre. En bon Marseillais, j’ai peut-être tendance à exagérer…

Pourtant, lorsqu’il s’est agi de réprimer la Manif pour tous, l’État s’est montré impitoyable, usant de violences inouïes à l’encontre de familles qui manifestaient pacifiquement.

Nous aimerions observer autant de fermeté lorsqu’il s’agit de bandes d’extrême gauche qui saccagent les centres-villes pour contester les grands projets d’infrastructure. Nous aimerions autant de volontarisme lorsque des bandes de jeunes attaquent et détroussent en plein Paris des boutiques et des cars de touristes médusés et horrifiés. Encore une fois, les milliards d’euros consentis ici ne porteront leurs fruits que s’ils sont précédés de l’abandon de l’idéologie au profit du bon sens, et ce en apportant un soutien total aux honnêtes gens et aux victimes plutôt qu’aux délinquants, de la considération et des moyens matériels aux forces de l’ordre, qui risquent leur vie et la perdent trop souvent pour protéger nos compatriotes. Des tablettes face à des kalachnikovs, il y a là, assurément, un léger déséquilibre dans le rapport de forces !
Vider les prisons, panacée, semble-t-il, de Mmes Dati et Taubira, ce n’est pas respecter le travail des policiers et des gendarmes, et encore moins les victimes !
J’évoquerai très brièvement le volet de la sécurité routière. Je tiens simplement à souligner qu’il s’agit là du seul domaine où le tout-répressif est appliqué. On nous impose la prévention pour résoudre la délinquance, mais, pour la sécurité routière, la répression tourne à l’acharnement. Peut-être ce gouvernement, comme les précédents, trouve-t-il là une manne fiscale à peine déguisée.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en tant que présidente de la commission d’enquête sur l’organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe, je ne pouvais manquer de venir m’exprimer ce soir.
J’irai droit au but, monsieur le ministre : ce serait un bon budget si nous étions en période normale. Dans les circonstances présentes, il faut plus de moyens, plus d’hommes, plus de matériels. Comprenez-moi bien, je ne cherche pas à critiquer votre action, et encore moins celle des forces de police et de gendarmerie, auxquelles tous ceux qui m’ont précédée à cette tribune ont rendu hommage à juste titre, mais j’exprime une inquiétude.
Dimanche dernier, M6 a diffusé un reportage sur les réseaux djihadistes en France. L’équipe de journalistes est parvenue à remonter une filière de vente de drapeaux à la gloire de Daech, dont le cœur était dans le département de l’Ain. En dépit des précautions prises par les journalistes pour masquer le nom des rues, ce sont les habitants du village concerné qui ont prévenu les forces de l’ordre, après avoir eux-mêmes reconnu les lieux à la télévision.
Cette anecdote pourrait s’arrêter là si elle ne venait malencontreusement renforcer ma conviction que nous ne consacrons pas assez de moyens à la lutte contre les réseaux djihadistes. Je connais votre détermination et vous connaissez la nôtre à cet égard. Il n’y a donc aucune d’ambiguïté. Simplement, il existe un décalage grandissant entre nos moyens de lutte contre ces réseaux et leurs récentes mutations. Nous avons aujourd’hui sur notre territoire des filières qui font l’apologie du terrorisme et qui travaillent à son financement. Ces mêmes filières se sont imposées comme la direction des ressources humaines de l’ennemi que nous sommes partis affronter en Irak et en Syrie.
J’ai lu avec beaucoup d’attention les rapports budgétaires. Pas un seul ne comporte le mot « terrorisme ». Pas un seul ne mentionne les enjeux auxquels nous devons faire face. Or ces moyens doivent bien servir à quelque chose. Certes, il s’agit de rapports budgétaires, mais nous ne sommes pas dans un cas de figure tout à fait classique à une époque tout à fait tranquille. Appelons un chat un chat : la délinquance de tous les jours n’est pas la délinquance djihadiste !
Dans le cadre de l’État de droit, auquel nous sommes tous attachés, nous avons voté avec plus ou moins de bonne humeur, le 13 novembre dernier, un texte relatif à la lutte contre le terrorisme, qui prévoit l’interdiction administrative de sortie du territoire, le blocage – qui a été obtenu avec beaucoup de difficultés – des sites internet faisant l’apologie du terrorisme, la création d’un délit d’entreprise terroriste individuelle. Mais toutes ces mesures ne suffiront pas !
Ce matin, j’ai demandé à votre collègue François Rebsamen s’il s’était assuré que ces djihadistes étaient bien répertoriés, notamment par les services de l’ANPE. En effet, des informations que nous pouvons avoir montrent que ces gens fraudent obstinément et avec beaucoup d’entrain nos services sociaux. Même si les sommes ne sont pas très importantes, il n’y a aucune raison que nous financions par les assurances sociales ou les indemnités chômage ceux qui s’apprêtent à commettre des actions terroristes et criminelles en Syrie ou en Irak.

Par ailleurs, nous devons améliorer la coordination entre les services de sécurité des aéroports et la police, afin d’assurer le contrôle de mobilité que réclame depuis longtemps la police de l’air et des frontières, et renforcer la surveillance de l’aviation privée, qui est moins contrôlée que les compagnies traditionnelles.
Facilitons l’accès aux listes de passagers aériens par les autorités de police européennes. Je veux parler des fameux Passenger Name Record, ou PNR. Je sais que vous travaillez sur cette question, monsieur le ministre, à laquelle vous êtes extrêmement attaché. Le coordinateur européen de la lutte antiterroriste milite comme vous pour plus de données. Là aussi, il faudra des moyens supplémentaires pour contrôler tous ces gens.
Vous avez mis en place un numéro vert. C’est une excellente initiative, qui fonctionne très bien. Il faut continuer ce type d’action préventive.
Je profite du temps qu’il me reste pour vous dire, puisque vous êtes aussi le ministre en charge des cultes, qu’il faut renforcer les dispositifs de formation des aumôniers et des imams. Nous devons discuter de cette question sans stigmatiser personne. Je glisse ce sujet dans mon intervention, car je ne pourrai malheureusement pas être là vendredi matin. Quoi qu’il en soit, je lirai avec beaucoup d’attention votre réponse dans le compte rendu des débats.
Je sais que nos préoccupations sont aussi les vôtres. Toutes mes remarques n’ont donc d’autre but que de renforcer notre volonté collective de lutter contre un ennemi commun.
Je terminerai mon intervention en évoquant un dossier qui me soucie beaucoup. Je veux parler de la plateforme nationale des interceptions judiciaires.
Voilà déjà quelques mois, j’ai lu des choses qui m’ont beaucoup inquiétée. J’avais d’ailleurs posé une question d’actualité au Gouvernement le 17 juillet dernier à ce sujet. Que des sociétés réalisant les écoutes judiciaires menacent d’interrompre leurs activités, ce n’est ni républicain, ni courtois, ni conforme aux règles de droit et de protocole. Pour ma part, les gens qui me menacent ne m’intimident pas du tout. Ils auraient même tendance à m’agacer prodigieusement.
Qu’en est-il de ces écoutes ? Le système a été confié à la société Thales, qui est éminemment compétente. Reste que nous sommes tout de même passés de 17 millions d’euros à 47 millions d’euros. Mais peut-être faut-il soulever cette question dans le cadre de l’examen des crédits de la mission « Justice » ? Je me suis laissé dire que c’est une problématique que vous avez en partage avec Mme Taubira et que, lorsqu’on s’adresse à l’un, il faut ensuite s’adresser à l’autre... Je sens que ceux qui ont aimé le logiciel Louvois vont adorer la plateforme des écoutes judiciaires.
Monsieur le ministre, les écoutes constituent un moyen extrêmement important pour lutter contre ces réseaux. Nos adversaires, eux, ne s’embarrassent pas des règles de l’État de droit, des décisions du Conseil constitutionnel ou du contrôle de la CNIL. C’est parce qu’il est difficile de combattre avec des moyens légaux des gens sans foi ni loi, c’est parce que la situation budgétaire est très tendue, c’est parce que les enjeux sont fondamentaux que nous avons décidé de voter les crédits de la mission.
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE et du groupe socialiste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’examen des crédits de la mission « Sécurités » nous donne un bref aperçu de la politique que le Gouvernement souhaite mener en matière de sécurité, un aperçu qui reste néanmoins éclairé par les résultats fournis par les statistiques.
Depuis 2002, la gauche semble avoir opéré une véritable inflexion dans son approche des thématiques sécuritaires. Je le dis avec bienveillance, monsieur le ministre : nous croyons tous ici à votre détermination personnelle à lutter contre l’insécurité sous toutes ses formes. Ainsi, l’examen des crédits de cette mission est de nature à conforter notre groupe dans cette appréciation, même si les derniers chiffres de la délinquance, conjugués à la politique pénale du Gouvernement, qui reste sujette à caution, nous conduisent à penser que la route est encore longue.
Tout d’abord, malgré une augmentation du budget et des réorganisations fonctionnelles louables, les forces de l’ordre manquent de moyens opérationnels suffisants.
Lorsqu’on examine les crédits de la mission « Sécurités », un chiffre émerge immédiatement, c’est celui des créations de postes. Ainsi, dans le projet de loi de finances pour 2015, il est proposé de créer, comme en 2014, 405 postes dans la police et la gendarmerie. Avec ce choix, vous portez le total des créations d’emplois à 1 290 équivalents temps plein depuis 2013. Bien sûr, et vous auriez tort de faire autrement, l’essentiel de la communication gouvernementale en matière de sécurité s’articule autour de ces deux chiffres.
Cela se traduit par une augmentation par rapport à 2014 des crédits de paiement et des autorisations d’engagement pour atteindre respectivement 17, 76 milliards d’euros et 17, 74 milliards d’euros. En d’autres termes, la gendarmerie et la police nationales seront épargnées par les coupes budgétaires que subissent d’autres secteurs.
Cet arbitrage aura néanmoins un prix, celui d’une significative réduction des mesures catégorielles. Une comparaison est éloquente à ce sujet : les mesures catégorielles dans la police nationale passeront de 20, 88 millions d’euros en 2015 à 13, 62 millions d’euros en 2016 et à 0, 65 million d’euros en 2017. Ce n’est pas tout : l’impact du schéma d’emplois ne sera que de 0, 5 million d’euros en 2016, contre 19, 5 millions d’euros pour l’année 2015. C’est à ce prix qu’on arrive à stabiliser une masse salariale malgré une augmentation des effectifs. Et je ne m’attarderai pas sur le stock d’heures supplémentaires, qui pourrait s’élever à plus de 300 millions d’euros !
Une stabilisation de ces dépenses est attendue pour les exercices 2016 et 2017 en ce qui concerne les dépenses afférentes à la police nationale.
Pour la gendarmerie, la situation est identique. La hausse des effectifs doit être compensée par « l’effet de repyramidage et la limitation des nouvelles mesures catégorielles ». Pour illustrer cette situation, signalons que les schémas d’emplois pour 2014 et 2015 n’entraînent qu’une hausse de 1, 5 million d’euros de la masse salariale.
L’autre difficulté que pose ce « dogme des effectifs », si je peux m’exprimer ainsi, c’est la question des redéploiements qui visent à mettre davantage de personnels de police sur la voie publique.
Pour revenir un instant sur l’action du précédent gouvernement, de la précédente majorité, il est utile de rappeler que la nouvelle organisation de la police, notamment en ce qui concerne les patrouilleurs et les forces mobiles, nous avait permis, à effectif constant, d’augmenter le nombre de patrouilles sur la voie publique de près de 25 %.
Dans le cadre de l’examen de ce projet de loi de finances, le rapport souligne que des synergies administratives et directionnelles ont permis le redéploiement de 547 postes de policiers nationaux en deux ans. La méthode est sans doute la bonne, mais l’ampleur des redéploiements est insuffisante pour être véritablement perceptible par nos concitoyens.
Pour la gendarmerie, on observe un mouvement inverse puisque le plafond d’emplois consacré à l’exercice des missions de sécurité et de paix publiques a été diminué de 180 équivalents temps plein travaillé par rapport à l’année dernière.
L’autre dommage collatéral de ce budget, c’est l’effritement progressif des moyens opérationnels pour les forces de l’ordre, et cela, malgré des mutualisations croissantes entre police nationale et gendarmerie, même si nous saluons ce mouvement de mutualisation.
À ce titre, je dirai un mot de la création du service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure. Le SAELSI s’est vu confier la synergie de la logistique de la gendarmerie et de la police nationales ; malheureusement, les économies faites n’apporteront pas de moyens matériels supplémentaires. Bien que le projet de loi de finances amorce un cycle d’investissement, il n’en demeure pas moins que les plus hauts responsables nous font part de leurs difficultés à répondre à la demande de leurs équipes, en ce qui concerne aussi bien l’entretien des véhicules, l’accès au carburant que le parc immobilier de l’État.
À présent, passons à l’épineuse question des chiffres de la délinquance, qui est extrêmement inquiétante dans ses manifestations. Je veux dire un mot de la méthode de calcul de ces chiffres, car ils révèlent quelques surprises.
Nous apprenions, il y a quelques mois, que vous aviez mis sur pied un nouveau service statistique ministériel visant, de manière impartiale, à intégrer les chiffres des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie « dans le champ labellisé de la statistique publique ». Pourquoi pas ? Mais alors que va devenir l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, l’ONDRP, qui vient de mettre en place un nouveau tableau de bord de la délinquance ? Avec quels instruments statistiques va-t-on mesurer les chiffres et leur évolution ?
Enfin, toujours en matière de statistiques, nous reprenons à notre compte les propos du rapporteur spécial, qui regrettait « que ne soit toujours pas mesuré le sentiment d’insécurité ».
Concernant les violences non crapuleuses, les chiffres sont particulièrement inquiétants. Selon le dernier bilan de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, on observe une hausse très significative des violences non crapuleuses au cours de la dernière année : de l’ordre de 4 % en zone police et de 7 % en zone gendarmerie.
En regardant plus attentivement la tendance de fond pour l’année 2013, les chiffres sont encore plus alarmants : le nombre de cambriolages est en augmentation de 7 %, pour atteindre au total le chiffre de 390 000 en 2013. Pour un certain nombre d’entre nous, maires de banlieue, nous savons ce qu’est l’inquiétude des populations face à l’accroissement du nombre des cambriolages.
On note également une hausse des crimes et délits en matière d’atteintes aux biens, aussi bien en zone police – près de 3 % – qu’en zone gendarmerie – près de 4 %. Plus important sans doute, on remarque une évolution préoccupante du nombre des crimes et délits en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique des personnes, tant en zone police qu’en zone gendarmerie.
En matière de taux d’élucidation, les résultats doivent encore davantage nous interpeller. Ainsi, en zone police, ils ont nettement baissé pour les vols avec violence ainsi que pour les homicides. En ce qui concerne la gendarmerie, on ne constate pas d’évolution significative.
Pour conclure sur les chiffres de la délinquance, je reprendrai à mon compte les propos d’Alain Bauer. Interrogé en avril 2014 sur le système pénal français, qui ne permet pas de faire baisser la délinquance, il disait : « Le maillon faible aujourd’hui, c’est la justice » – certes, vous n’êtes pas garde des sceaux – « pas tellement parce qu’elle fait mal son travail, mais parce qu’elle est marquée par ce que j’appelle la théologie de la libération, qui considère que toute politique pénale forte est injuste et discriminatoire. » En d’autres termes, alors que leur travail est de plus en plus difficile, comment les forces de l’ordre peuvent-elles encore être certaines que leurs efforts aboutiront à la neutralisation des malfaiteurs ?
À ce sujet, je voudrais dire un mot du mal-être des policiers. Malheureusement, l’actualité récente me touche personnellement puisque, dimanche dernier, nous apprenions qu’une policière de trente-trois ans s’était suicidée avec son arme de service. Elle était affectée au commissariat de Charenton-Saint-Maurice, qui pourtant n’est pas soumis à une très forte pression. Cet événement est d’une exceptionnelle gravité. De même, jeudi dernier, une capitaine de police s’est suicidée au commissariat de Bastia.
Ces deux policiers sont respectivement les quarante-huitième et quarante-neuvième à se donner la mort depuis le début de l’année. Ces chiffres doivent nous interpeller. Nous en sommes donc à nous demander si le record de suicides dans la police, qui date de 1996 et qui s’élevait à soixante-dix, ne va pas être battu.
Conséquence de cette triste actualité, le directeur général de la police nationale, Jean-Marc Falcone, a réuni les syndicats de police sur ce sujet, le mercredi 5 novembre. Il a été évoqué la création d’un comité d’hygiène et de sécurité, qui se réunira après les élections professionnelles du 4 décembre prochain, et enfin une réunion que vous allez présider, ministre de l’intérieur, dès le début de l’année 2015. Pouvez-vous nous préciser ce qu’il en est, car les personnels de police sont manifestement très inquiets ?
Enfin, je veux dire un mot du revirement de dernière minute du Gouvernement en ce qui concerne le permis de conduire à puce électronique.
Nous apprenions, le 6 novembre, que le ministère de l’intérieur souhaitait retirer la puce électronique des nouveaux permis de conduire. Une directive européenne impose le format de carte de crédit à tous les États membres pour leurs permis de conduire. Au départ, la date de janvier 2013 avait été évoquée pour sa mise en place, avant d’être reculée à l’automne de la même année. Un an plus tard, trois millions de permis de conduire à puce électronique ont été distribués. Or, à partir de janvier 2015, les nouveaux permis de conduire, désormais délivrés au format « carte de crédit », ne disposeront plus d’une puce électronique.
Le Gouvernement justifie cette décision en invoquant le coût de ce type de permis de conduire, qui s’élèverait à 6 millions d’euros par an. Au total, il semble que le Gouvernement puisse espérer une économie de 90 millions d’euros étalés sur toute la durée de remplacement des anciens permis de conduire.
Permettez-moi, avec un certain nombre de nos collègues, de vous faire part de mon étonnement face à cette mesure, qui, à court terme, va pénaliser les entreprises françaises responsables de la fabrication des composants de ces puces électroniques, et qui, sur le long terme, est un bien mauvais calcul. En effet, le permis de conduire doté d’une puce électronique devait se transformer à terme en carte intelligente multi-usage, offrant des services divers et facilitant le travail des forces de police, qu’il s’agisse des différents types de permis, de l’assurance, des taxes ou du certificat du véhicule, qui auraient pu ainsi être contrôlés de manière globale.
En conclusion, comme j’ai eu l’occasion de le dire précédemment, mon groupe politique et moi-même ne porterons pas le fer sur les grands arbitrages de cette mission « Sécurités », notamment en ce qui concerne les effectifs. Pour autant, le choix d’augmenter légèrement les effectifs à enveloppe constante n’est pas sans conséquence ; c’est ce que nous avons vu avec les mesures catégorielles. Aussi, tâchons de rester vigilants afin que la hausse du nombre de patrouilles sur la voie publique, élément essentiel de notre politique de sécurité, ne se fasse pas au détriment de la carrière de nos forces de l’ordre. Sans doute les redéploiements d’effectifs doivent-ils être davantage utilisés.
Malgré ces arbitrages acceptables, le groupe UMP estime que les mesures opérationnelles ne sont pas de nature à apporter une réponse adaptée aux chiffres inquiétants de la délinquance qui viennent d’être dévoilés.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis 2012, la sécurité et la justice font partie, tout comme l’éducation et l’emploi, des priorités du Gouvernement.
La maîtrise des dépenses, à laquelle le contexte budgétaire nous contraint, ne s’est pas accompagnée d’un désengagement de l’État de ses missions régaliennes, qui ont été au contraire préservées et qui ont vu, cette année encore, leurs budgets augmenter.
Les crédits de la mission « Sécurités », qui comprend non seulement la police et la gendarmerie, mais également la sécurité civile et la sécurité routière, sont globalement en hausse. La police voit son budget augmenter de 0, 5 %, avec 9, 69 milliards d’euros, et la gendarmerie de 0, 4 %, avec 8 milliards d’euros.
Cette hausse des moyens a permis de mener à bien des réformes d’envergure, telles que la création, dès juillet 2012, de zones de sécurité prioritaires – il en existe aujourd’hui quatre-vingts – et le déploiement du plan anti-cambriolages et anti-vols à main armée en septembre 2013, dont l’efficacité est probante. En effet, les chiffres du service statistique ministériel de la sécurité intérieure présentés le 20 novembre dernier par le Premier ministre et vous-même, monsieur le ministre, ont démontré une baisse significative des crimes et délits sur les dix premiers mois comparés à ceux de 2013. Cette transparence vous honore. Néanmoins, je souhaiterais que nous restions dans la logique que vous avez initiée, en faisant preuve de prudence par rapport à ces chiffres et en ne tombant pas dans les travers du précédent quinquennat.
L’efficacité des actions que vous avez menées repose également sur les moyens qui ont été déployés. La révision générale des politiques publiques avait supprimé 13 338 postes de policiers et gendarmes depuis 2007. En 2015, comme en 2014 d’ailleurs, 405 policiers et gendarmes supplémentaires seront recrutés. Nous ne pouvons que saluer ce renforcement des moyens humains après des années de réduction d’effectifs.
Je souligne aussi l’effort exceptionnel, à hauteur de 90 millions d’euros, qui a été effectué pour le renouvellement du parc automobile plus que vieillissant de la police et de la gendarmerie. Il ne permettra pas d’acheter les 6 800 véhicules dont la gendarmerie a cruellement besoin ou les 10 896 qui font défaut à la police, mais il faut rappeler que le retard pris dans ce domaine est ancien et particulièrement important.
La vétusté du parc immobilier de la police et de la gendarmerie est également un réel problème, pointé par de nombreux rapports, dont le plus récent, celui de Jean-Pierre Blazy, député du Val-d’Oise, portait sur la lutte contre l’insécurité sur tout le territoire.
La police nationale devrait disposer d’une enveloppe de près de 41 millions d’euros, soit 4, 3 % de plus que le budget précédent, dédiés en partie à la modernisation de ses locaux. S’agissant de la gendarmerie, un plan de réhabilitation de 70 millions d’euros sera alloué pour des investissements similaires. Là encore, ces crédits ne seront sans doute pas suffisants, mais le mouvement impulsé démontre votre volonté d’améliorer les conditions de travail des forces de l’ordre et les conditions de vie de leur famille.
Il convient enfin de souligner la priorité donnée à la lutte contre le terrorisme. Je pense notamment à la loi du 13 novembre dernier visant à renforcer les dispositions relatives à ce fléau. Je me permets d’ailleurs d’appeler votre attention sur le phénomène de radicalisation observé depuis peu dans les territoires d’outre-mer.
Vous ne m’en voudrez donc pas, monsieur le ministre, si je m’appesantis sur le problème de l’insécurité dans ces territoires. Les zones géographiques dans lesquelles ils se situent sont particulièrement sensibles en matière de sécurité, en raison notamment de leur éloignement et de leur placement à des carrefours stratégiques.
Nos territoires ultramarins connaissent un niveau de violences particulièrement élevé : en 2013, les atteintes volontaires à l’intégrité physique y ont augmenté de 7 %, prolongeant un mouvement de hausse enregistré depuis 2006 ; 12, 48 faits pour 1 000 habitants étaient recensés contre 7, 88 en moyenne en métropole. La part des mineurs ou des jeunes majeurs impliqués est en constante augmentation.
Au-delà de ces caractéristiques communes, la situation de chaque territoire est spécifique. Ainsi, les Antilles françaises doivent faire face au développement des trafics illicites en mer, en particulier des trafics de stupéfiants. En Guyane, l’orpaillage clandestin est à l’origine du développement d’une criminalité importante. À Mayotte, les cambriolages sont en très forte augmentation.
Dans le domaine de la sécurité civile, une attention particulière doit être portée aux territoires les plus exposés aux accidents climatiques ou naturels, tels que les cyclones ou les glissements de terrain. Mayotte a d’ailleurs accusé de nombreux dégâts à la suite du passage du cyclone Hellen en mars dernier.
Enfin, la situation en matière de sécurité routière est problématique. Le nombre de tués sur les routes ultramarines reste élevé. Ce constat nécessite une action forte et ciblée des pouvoirs publics.
Comme vous l’avez justement énoncé lors de votre visite à Mayotte en juin dernier : « Partout en métropole et outre-mer, chacun a un même droit à la sécurité ». Pourriez-vous nous préciser, monsieur le ministre, quelles mesures le Gouvernement compte prendre localement pour lutter contre cette insécurité grandissante ?
Pour conclure, je dirais que le budget que vous nous présentez marque la volonté du Gouvernement de préserver, malgré un contexte de crise sans précédent, la capacité opérationnelle des forces de sécurité, afin de faire face aux nombreuses menaces qui planent sur le pays.
Permettez-moi, monsieur le ministre, une parenthèse : je tiens à vous dire ici que, à titre personnel, j’ai été véritablement choqué par les attaques d’une extrême violence dont vous avez fait l’objet ces dernières semaines. Chacun doit mesurer la résonance de ses propos en pareilles circonstances.
Le groupe socialiste ne peut qu’encourager le Gouvernement à poursuivre ses efforts pour garantir à tous les Français le droit légitime à la sécurité et votera les crédits de la mission « Sécurités ».
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, monsieur le ministre de l’intérieur, chers collègues, je vais faire une petite rétrospective, tirée de mes modestes souvenirs, puisque, il y a quelques années, entre 2007 et 2011, j’étais un habitué du sujet, l’un de ceux qui avaient coutume d’intervenir sur cette mission que l’on appelait alors la mission « Sécurité intérieure ». Elle traitait de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Aujourd’hui, nous parlons de la mission « Sécurités » – au pluriel – dans laquelle nous associons à la fois les gendarmes, les policiers et les sapeurs-pompiers.
Même si nous étudions aujourd’hui comme les autres jours les dépenses à caractère financier, je tiens à rendre hommage, à l’instar de tous mes collègues, au travail et au dévouement de nos gendarmes, policiers et sapeurs-pompiers. Ce sont de grandes familles, rassemblant actifs et retraités, jeunes ou plus âgés dans un métier qu’ils exercent ou ont exercé avec conviction et passion. Tous contribuent à la sécurité des personnes et des biens au risque de leur vie.
Chaque année, les journées nationales annuelles, journées d’hommage rendu aux gendarmes, aux policiers et aux sapeurs-pompiers, nous touchent profondément et nous rappellent le respect et la reconnaissance que nous leur devons. La Sainte-Geneviève, par exemple, est une fête très importante ; elle permet de réunir les gendarmes, actifs et retraités, jeunes et moins jeunes, mais aussi les élus et tous les partenaires, les forces vives. C’est l’occasion d’évoquer des difficultés tout à fait légitimes et partagées. C’est pourquoi il convient de privilégier l’aspect humain.
Les rapporteurs l’ont rappelé, dans le projet de loi de finances pour 2015, les programmes « Police nationale » et « Gendarmerie nationale » atteignent 17, 76 milliards d’euros en crédits de paiement, dont 45, 5 % sont affectés à la gendarmerie nationale. Je me permets d’insister, monsieur le ministre de l’intérieur, sur la réelle nécessité de soutenir police et gendarmerie, principalement en moyens humains. Même si des créations de postes sont prévues au plan national – 405 postes pour l’année 2015 –, leur répartition sur le territoire demeure incertaine.
Le département que je représente, les Ardennes, compte 283 000 habitants. Les brigades de proximité, réunies en communautés de brigades, y manquent très souvent d’effectifs. De nombreux postes ne sont pas pourvus. Les renforts de réservistes sont de plus en plus réduits en raison des contraintes budgétaires. Sur le terrain, les gendarmes ont de plus en plus de mal à être présents. Ils ont même de plus en plus de mal à rencontrer les élus de proximité que sont les maires, en particulier ceux des petites communes dont je fais modestement partie. Ils ont aussi de plus en plus de mal à rencontrer leurs interlocuteurs de proximité : acteurs économiques, sociaux, enseignants et autres.
Je tiens au nom de mes collègues élus et des habitants à réaffirmer la nécessité de maintenir toutes les brigades de gendarmerie. Elles sont indispensables à la sécurité des personnes et des biens, notamment dans nos territoires ruraux. Car, pour les maires de petites communes, les interlocuteurs de proximité, ce sont les gendarmes, les pompiers et les urgentistes.
Alors, ne cassons pas nos services publics ! La lutte contre la délinquance – je pense à la LOPSSI 2, de 2011 –, la lutte contre les nouvelles formes d’escroquerie et la lutte contre l’insécurité routière doivent rester des priorités.
Donnons des moyens humains à nos brigades de gendarmerie, aux escadrons motorisés, mais donnons-leur aussi des moyens de fonctionner, en remplaçant les véhicules à bout de souffle ou en leur fournissant le carburant nécessaire. Donnons-leur également des casernements dignes de ce nom.
La tâche reste immense, mais la sécurité doit être renforcée, car les missions de nos gendarmes sont très variées, de plus en plus variées. Je pense notamment aux interventions à caractère social.
Leur statut militaire doit toujours être préservé, pour prendre en compte leur engagement et leurs actions relevant du devoir de mémoire.
En conclusion, il est réellement indispensable pour la sécurité des habitants, pour les personnes les plus fragiles de soutenir nos forces de police, de gendarmerie et nos sapeurs-pompiers en leur accordant les moyens humains dont ils ont besoin sur le terrain et en proximité, tant en secteur urbain qu’en zone rurale.

Nous devons retrouver cette confiance à tous les niveaux entre l’État et tous nos territoires.
Vive la police ! Vive la gendarmerie ! Vive les sapeurs-pompiers !
Applaudissements sur diverses travées.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en 2015, les crédits alloués à la police nationale et à la gendarmerie connaîtront une nouvelle hausse. L’ensemble des sénateurs socialistes s’en félicitent.
Le Président de la République s’était engagé à faire de la sécurité des Français l’une de ses principales priorités. Dans un contexte de contrainte budgétaire, cette priorité du chef de l’État se traduit dans les faits. Il faut le souligner, car cela n’a pas été toujours été le cas par le passé. Souvenons-nous que, sous le précédent quinquennat, la sécurité des Français était un sujet largement instrumentalisé, mais les moyens alloués à celle-ci n’allaient pas forcément de pair avec les beaux discours. Peu avare en rodomontades et coups de menton, le précédent exécutif l’était beaucoup plus lorsqu’il s’agissait d’octroyer des moyens à celles et ceux qui assurent la sécurité des Français.
De 2007 à 2012, sous l’effet de la triste RGPP, nous avons assisté à une érosion continue des moyens des forces de sécurité. M. Cambon, qui a cité de nombreux chiffres, aurait pu en mentionner deux autres : 7 000 postes ont disparu dans la police et pratiquement autant – 6 800 – dans la gendarmerie durant cette période. Cela montre bien que nos forces de police ont été sacrifiées pendant cinq ans et que la pente sera particulièrement dure à remonter.
Notre candidat, François Hollande, s’était engagé à inverser la tendance. Nous constatons que, depuis son élection, cet engagement a été tenu. L’an prochain, les effectifs des deux forces continueront encore de progresser : 405 postes seront créés en 2015 ; ils étaient 493 en 2013 et 405 en 2014.
On peut toujours dire que ce n’est pas suffisant. Nous tous ici aimerions qu’ils soient encore plus nombreux, mais ces créations de postes doivent être mises en relation avec les coupes qui ont été effectuées sous le précédent quinquennat et avec les difficultés budgétaires rencontrées pour boucler le budget de l’État. Ces créations de postes permettront de renforcer la présence humaine sur le terrain. Nous savons qu’elle est la meilleure arme en termes de prévention, pour lutter contre la délinquance et la criminalité ainsi que pour maintenir un lien avec la population.
À côté de ces efforts destinés aux moyens humains, un effort d’investissement est également indispensable.
En ce qui concerne le renouvellement de la flotte automobile, les crédits prévus sont malheureusement gelés en début d’année et débloqués seulement à la fin, ce qui perturbe complètement la politique d’achat. Par exemple, pour 2014, les appels d’offres pour l’achat des véhicules n’ont pu être lancés, semble-t-il, que voilà quelques semaines. Il faudrait trouver des solutions pour accélérer le processus afin que, en 2015, les nouveaux véhicules soient livrés rapidement à la police et à la gendarmerie.
En matière d’immobilier, nous avons ressenti la même gêne sur toutes les travées devant les conditions de vie des familles de gendarmes et la vétusté des locaux qui accueillent nos policiers. Depuis de très nombreuses années, bien peu a été entrepris. Il y a maintenant urgence ! Ce budget permettra d’accélérer les rénovations et les travaux immobiliers, mais il faudra aller encore plus loin.
Permettez-moi de citer quelques exemples dans un département que je connais bien, celui des Hauts-de-Seine.
À Boulogne-Billancourt, depuis deux mois, il est interdit d’ouvrir les robinets d’eau au sein du commissariat, car la vétusté des canalisations rend l’eau impropre à la consommation.
À Nanterre, le dysfonctionnement des toilettes du premier étage du commissariat a récemment causé l’effondrement du plafond du rez-de-chaussée sur les cellules.
Ces deux exemples se situent dans mon département, mais ils illustrent bien les difficultés que l’on retrouve un peu partout en France. La rénovation des locaux est donc une priorité si l’on veut que nos forces de l’ordre aient les moyens de travailler dignement et de recevoir nos concitoyens dans de bonnes conditions.
Ces moyens, il faut bien évidemment les mettre en relation avec les résultats. Or j’avoue que j’ai été pour le moins surpris par les chiffres de la délinquance qu’ont avancés certains sénateurs de l’UMP ; c’est à croire que ce groupe dispose d’un observatoire spécifique pour la délinquance. La COCOE se serait-elle reconvertie, mes chers collègues ? §Quoi qu’il en soit, les chiffres annoncés ne correspondent pas du tout à la réalité. En effet, la mobilisation en matière de moyens humains et matériels depuis trois ans produit des résultats encourageants.

Comparés à 2013, les faits de crimes et délits constatés en zone police et en zone gendarmerie connaissent une baisse significative sur les dix premiers mois de l’année 2014. C’est notamment le cas pour les cambriolages, qui enregistrent un recul de 4, 3 %, le premier depuis six ans. Bien sûr qu’il y a encore trop de cambriolages – personne ne dira le contraire –, bien sûr que c’est à chaque fois extrêmement traumatisant pour les victimes, mais reconnaissez que les chiffres sont à la baisse.
Monsieur le ministre, en tout début d’année, j’interrogeais ici votre prédécesseur sur la forte augmentation, depuis 2008, du nombre de cambriolages. Il avait alors présenté le dispositif spécifique déployé pour enrayer la hausse des cambriolages. Dix mois plus tard, je constate avec satisfaction que le plan spécifique dédié à la lutte contre les cambriolages est déjà porteur de résultats. Nous espérons que cette tendance positive va se poursuivre et qu’elle nous apportera d’autres bonnes nouvelles. En outre, s’agissant des vols à main armée, qui avaient également pris des proportions très inquiétantes depuis 2008, nous constatons un repli de 14 %.
Une baisse de 4 % des cambriolages et de 14 % des vols à main armée constitue une évolution significative dont j’aurais aimé qu’elle soit notée par nos collègues du groupe UMP ! Les violences crapuleuses, quant à elles, baissent de 9 %.
On le constate, les zones de sécurité prioritaires, avec leurs actions ciblées dans le temps, produisent des résultats positifs.
Je le rappelle, l’ensemble de ces statistiques intervient après la réforme de l’outil statistique de la mesure de la délinquance, qui a été réalisée en 2012 afin de renforcer sa fiabilité et sa sincérité. En effet, nous le savons, avant cette date, rodomontades et coups de menton s’accompagnaient également d’une certaine liberté prise dans le recensement des faits de délinquance.
Monsieur le ministre, tout comme votre prédécesseur, vous avez fait le choix courageux de la transparence avec la réforme de l’appareil statistique. Vous avez voulu porter une rupture nette avec le gouvernement précédent…

… et en finir avec la politique du chiffre, dont les effets ont été largement dénoncés dans des rapports officiels. Nous ne pouvons que vous en féliciter, car, sur ce sujet aussi, il faut tenir aux Français un discours de vérité et en finir avec la manipulation des chiffres.
Pour conclure, j’aimerais dire que, sur toutes les travées, nous rendons hommage de façon unanime à l’action de nos forces de sécurité. Leur implication quotidienne et leur professionnalisme méritent notre respect et notre reconnaissance. D’ailleurs, lors de mes visites fréquentes dans des collèges, je sens bien que les élèves sont toujours en admiration devant les forces de l’ordre. Dans les forums de l’emploi, les stands de la police ou de la gendarmerie rencontrent également le plus grand succès auprès des jeunes.
Avec ce projet de budget, nous démontrons notre volonté, en dépit de la contrainte budgétaire qui s’impose à nous, d’être pleinement attentifs aux conditions dans lesquelles ces femmes et ces hommes exercent leurs missions. Oui, mes chers collègues, la sécurité est une priorité du Gouvernement ! C’est la raison pour laquelle les sénateurs socialistes voteront vos crédits et rendent hommage à votre action, monsieur le ministre.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je veux avant toute chose remercier l’ensemble des orateurs. Sur toutes les travées, des interrogations légitimes, des interventions justes ont été exprimées. D’ailleurs, je remarque que, en cette fin de semaine, un vendredi, nuitamment, lors de l’examen des crédits d’une mission du ministère de l’intérieur, vous êtes nombreux à être présents.
Avant de répondre à toutes les questions qui ont été posées, sans être aussi exhaustif que je le souhaiterais, car cela nous conduirait très tard dans la nuit, je formulerai quelques remarques sur la politique que nous conduisons et les chiffres y afférents, répondant en cela à quelques considérations générales qui ont été exprimées par des sénateurs de toutes sensibilités.
Je comprends les inquiétudes au sujet des effectifs, des mesures catégorielles et des moyens relevant du « hors T2 », c’est-à-dire des moyens que nous allouons notamment à la politique d’équipement, à la politique immobilière et à la politique de modernisation.
Pour ce qui concerne les effectifs tout d’abord, comme vous le savez, sur la période allant de 2007 à 2012, c’est près de 13 000 postes qui ont été supprimés : 7 000 dans la police et 6 000 dans la gendarmerie.
Ces suppressions ont conduit – je ne le dis pas du tout dans un esprit polémique, mais simplement parce que c’est une réalité à laquelle nous devons faire face – à une attrition d’un certain nombre de forces de sécurité dans les territoires. C’est le cas notamment dans des départements de la région parisienne, où des problèmes de sécurité significatifs se posent. Je recevais récemment le président de l’Assemblée nationale, venu évoquer la question de l’évolution des effectifs en Seine-Saint-Denis. Il me racontait la manière, dans un département particulièrement sensible sur les questions de sécurité, dont les effectifs avaient évolué lors des dernières années, les conséquences que cela avait entraînées au long cours sur l’évolution des statistiques de la délinquance. C’est vrai aussi en zone gendarmerie, parce que 6 000 emplois de moins dans la gendarmerie en cinq ans, cela se voit incontestablement.
Il m’arrive de constater que ceux qui ont participé à cette déflation d’effectifs considèrent désormais que l’augmentation à laquelle nous procédons n’est pas suffisante pour en combler les effets. Je peux comprendre le raisonnement, car, je ne peux le nier, il faudra du temps avant que les 500 créations d’emplois par an depuis 2012 compensent les effets des 13 000 suppressions d’emplois. Mais mieux vaut malgré tout créer 500 emplois que d’en supprimer plusieurs milliers tous les ans quand on veut assurer la sécurité dans le pays.
J’en viens ensuite aux moyens dits « hors T2 ».
Lorsque l’on agrège l’évolution des différents crédits immobiliers, qui sont déterminants pour les conditions de vie des gendarmes dans les casernes et des policiers dans les commissariats, on constate une diminution de 17 % de 2007 à 2012. Le budget que je propose augmente, lui, de 22 % en autorisations d’engagement et de 9, 1 % en crédits de paiement. Je ferai la même remarque que pour les effectifs : il faudra longtemps avant qu’une telle augmentation permette de corriger les effets de la diminution entérinée au cours de la période allant de 2007 à 2012.
Je pourrais citer d’autres exemples. Ainsi, nous investissons chaque année 70 millions d’euros en faveur des casernes de gendarmerie. C’est considérable, mais c’est encore trop peu, je le reconnais volontiers, compte tenu de la diminution significative des crédits au cours des années précédentes.
Lorsque nous décidons de dégeler la fin de gestion 2014 et d’augmenter de 40 millions d’euros les crédits alloués aux forces pour l’acquisition d’automobiles, nous créons les conditions du financement de 2 000 véhicules neufs par an. Aujourd’hui, quand vous interrogez le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur général de la police nationale, ils vous indiquent que, pour assurer le bon état de marche d’un véhicule, cela implique d’en désosser trois autres, affichant entre 250 000 et 300 000 kilomètres, pour récupérer les pièces détachées.
Je vous propose également, dans le cadre du budget triennal, d’effectuer 108 millions d’euros d’investissements en équipements numériques et en munitions, dont les forces ont besoin pour assurer la sécurité.
Madame Goulet, vous présidez une commission d’enquête où vous faites, avec un très grand nombre de vos collègues, un travail excellent. Vous soulignez qu’il faut des moyens pour lutter contre le terrorisme. Vous avez tout à fait raison et, je vous rassure, nous le faisons. La direction générale de la sécurité intérieure, qui consacre aujourd’hui 50 % de ses effectifs à la lutte contre le terrorisme, les a vus diminuer sur la période de 2007 à 2012 de 127 équivalents temps plein. Dans le présent budget, nous en créons 130 cette année – après en avoir déjà créés 127 –, avec un objectif de 436 dans le cadre du budget triennal. En outre, nous prévoyons une augmentation des crédits hors T2 par an de 12 millions d’euros, soit 36 millions d’euros pour le budget triennal.
Madame la sénatrice, tous ces éléments, vérifiables dans les documents budgétaires, vous apportent les garanties attendues. C’est la raison pour laquelle je n’arrive pas à comprendre pourquoi vous ne votez pas avec plus d’enthousiasme mon budget. Je ne vous en tiens pas rigueur, parce que la politique est ainsi faite, mais tenez compte de ce qui s’est passé et de ce que je fais – non sans mal, parce qu’il faut se battre ; certains arbitrages budgétaires sont compliqués et nécessitent d’âpres négociations. En tout cas, notre budget, en dépit des 50 milliards d’euros d’économies, préserve les moyens de nos forces.
Voilà les éléments de réponse que je souhaitais vous apporter, mesdames, messieurs les sénateurs, afin d’éviter toute ambiguïté sur notre action, sur les raisons qui la motivent et sur les moyens pour y parvenir.
J’en viens aux questions précises qui m’ont été posées.
MM. Dominati et Cambon, qui connaissent bien ces sujets et dont je salue les excellentes interventions, m’ont interrogé sur les emplois dans la gendarmerie, la baisse des mesures catégorielles dans le budget triennal et le stock d’heures supplémentaires non payées dans la police.
S’agissant de la gendarmerie nationale, l’écart observé entre les prévisions et l’exécution du plafond d’emploi, qui atteint 1 810 équivalents temps plein en 2013, traduit essentiellement la difficulté des gestionnaires à appréhender les comportements individuels des agents, notamment les départs à la retraite. Ce phénomène structurel fait l’objet, de la part des gestionnaires, d’un travail extrêmement approfondi, destiné à assurer une analyse plus fine de l’évolution des effectifs. Ces derniers, au demeurant, se révèlent relativement stables depuis 2009.
En revanche, ce qui change, pour la gendarmerie comme pour la police, c’est la politique de création d’effectifs. Je l’ai rappelé à l’instant, et je ne reviendrai pas sur cette question.
Quant aux dépenses catégorielles de la police et de la gendarmerie, le Gouvernement, au terme d’une réflexion transversale, a décidé de ne pas mettre en œuvre de nouvelles mesures relevant de son objectif de redressement des comptes publics. En effet, pour ce qui concerne les armées comme le ministère de l’intérieur, nous avons constaté que les grandes réductions d’effectifs opérées n’étaient pas allées de pair avec une diminution de la masse salariale, et pour cause : la baisse des effectifs a été compensée par une augmentation significative des mesures catégorielles, laquelle était nécessaire pour rendre cette évolution socialement soutenable.
Cela étant, animé par un souci de loyauté, le Gouvernement honore les engagements pris par la précédente majorité. Ce choix se traduit par des enveloppes catégorielles de 21 millions d’euros pour la police et de 16 millions d’euros pour la gendarmerie. Il aboutit par ailleurs à une stabilisation des crédits de la sécurité civile, notamment des forces de sécurité, dans le cadre du nouvel espace statutaire, le NES.
Vous le constatez, mesdames, messieurs les sénateurs, pour la police comme pour la gendarmerie, nous faisons les efforts nécessaires.
J’en viens aux statistiques de la délinquance. Nous devons, à mon sens, leur appliquer la méthode suivie pour élaborer les chiffres du budget et déterminer ceux du chômage.
Lorsque j’étais ministre délégué chargé du budget, personne ne contestait les chiffres de déficit que nous publiions. En revanche, tout le monde dénonçait la politique qui avait conduit à la résorption trop lente des déficits. Je souhaiterais qu’il en soit de même des statistiques de la délinquance : que l’on ne conteste plus les chiffres en tant que tels, et que les critiques se concentrent sur les politiques qui ne les font pas diminuer suffisamment vite, voire qui conduisent à leur progression.
Voilà pourquoi nous avons décidé de mettre en place un service statistique ministériel. Ce n’est pas un service « au boulier », situé quelque part entre les directions générales de la gendarmerie nationale et de la police nationale, et qui cesserait de fonctionner, comme cela a pu être le cas par le passé, la troisième semaine du mois, dès lors que les chiffres du mois précédent ont été atteints.
Ce service est rattaché au ministère de l’intérieur, mais il dépend de l’INSEE, dont relèvent ses personnels. Il suit les protocoles d’élaboration statistiques de cet institut. Les chiffres qu’il publie, partant, ne sont pas contestables. À cet égard, ils peuvent être repris par l’Office national de la délinquance et des réponses pénales, l’ONDRP, en vue de réaliser des analyses plus fines et territorialisées. Par ce biais, ils peuvent fournir des réponses à diverses interrogations formulées au cours de ce débat : tel phénomène délinquant peut décliner dans telle localité, sans qu’il en soit de même dans tel ou tel département de la région parisienne. Les cartographies de l’ONDRP sont, à cet égard, on ne peut plus fiables.
Pour ma part, je tiens à vous rappeler les chiffres collectés au titre de cette année. Depuis le 1er janvier dernier, les cambriolages ont baissé de 4, 3 %. Les vols à main armée ont reculé de 15 % et les violences crapuleuses de 10 %. Je le concède, nous enregistrons de mauvais résultats au titre des atteintes volontaires à l’intégrité physique, les AVIP. Cette catégorie regroupe les violences non crapuleuses et les violences crapuleuses. Or les premières, à savoir les violences intrafamiliales, croissent de manière très sensible.
J’ajoute que, dans les zones de sécurité prioritaire, nous enregistrons une baisse assez significative des violences urbaines et des troubles à l’ordre public.
À ce titre, je proposerai prochainement à M. Philippe Bas de me rendre moi-même devant la commission des lois, qu’il préside, pour communiquer les statistiques de la sécurité et de la délinquance deux fois l’an, sur le modèle des rendez-vous existant déjà pour les questions budgétaires. Je ferai part à la commission des lois de l’ensemble des chiffres produits par notre service statistique ministériel et par l’ONDRP.
Prenons l’exemple des cambriolages. Dans l’ensemble, ils affichent une diminution de 4, 3 %. Mais ce chiffre recouvre des réalités très contrastées. Il faut avoir l’honnêteté de le dire et examiner les situations en détail. Nous enregistrons de bons résultats dans les zones gendarmerie et dans les zones police au titre des résidences principales – les cambriolages y reculent respectivement de 6, 8 % et de 5, 4 % –, mais les chiffres sont mauvais pour les résidences secondaires. J’ai demandé à ce que l’on mobilise tous les moyens nécessaires pour lutter contre ce fléau.
Les résultats ne sont pas non plus satisfaisants concernant ce que l’on appelle les « autres locaux », catégorie qui comprend, entre autres, les caves d’immeubles.
En d’autres termes, cet agrégat fournit une estimation qui est positive dans l’ensemble, mais il faut encore travailler sur certains items.
Je le précise d’emblée : les chiffres de certains mois, de certains trimestres, pourront se révéler mauvais. Cela étant, je souhaite que nous nous accordions pour élaborer un outil statistique solide, afin d’aborder ces questions avec tout le sérieux nécessaire.
À l’instar de M. Dominati, rapporteur spécial, et de M. Cambon, Mme Assassi a évoqué avec beaucoup de justesse la question des suicides, et je l’en remercie. Ce problème renvoie aux conditions de travail des forces de sécurité et à la manière dont elles peuvent percevoir leur propre image dans la société.
Pour ma part, je n’ai jamais compté au rang de ceux qui théorisent les violences policières. L’idée selon laquelle la violence serait inhérente à la police et à la gendarmerie ne peut que heurter ces fonctionnaires humbles, qui sont mus par l’esprit du service public, …
… et qui sont engagés sur l’ensemble de notre territoire. Ils peuvent être confrontés à des violences extrêmes, verbales ou physiques, qui éclatent fréquemment à l’occasion de manifestations. Ces policiers et ces gendarmes ne méritent pas les commentaires dont ils font parfois l’objet.
Je suis solidaire de ces forces, non pas en vertu des fonctions que j’exerce, non parce que je suis ministre de l’intérieur, mais tout simplement en tant que républicain.
Bien sûr, aucune faute ayant conduit à des difficultés ou à des drames commise par les forces dont j’ai la responsabilité ne peut être excusée. Mais, alors que ces forces sont victimes de violences croissantes, il me semble tout à fait irresponsable de propager l’idée selon laquelle, dernière chaque gendarme ou chaque policier, se trouverait, non un serviteur de la République, un fonctionnaire épris de ses valeurs, mais un individu potentiellement violent.
Aujourd’hui, la violence est partout. Elle est sur internet, où l’on peut lire des propos antisémites, islamophobes, homophobes ou xénophobes d’une rare agressivité. Elle est quelquefois dans la rue, lors de confrontations extrêmes. Elle est dans la sphère politique, où sont parfois proférées des paroles blessantes, par exemple dans l’hémicycle des assemblées parlementaires, où elles n’ont pourtant pas lieu d’être. On oppose ainsi les forces et les acteurs politiques sur les sujets les plus divers.
Or la République c’est tout autre chose et, en tant que ministre de l’intérieur, je préconise, dans tous ces domaines, l’apaisement, la responsabilité et le respect des forces de l’ordre.
Madame Assassi, vous avez dit à quel point nos forces de l’ordre devaient être respectées, à quel point leur travail est difficile, à quel point elles sont dignes de notre estime. Vos propos sont justes, et ils me vont droit au cœur.
M. Delahaye, rapporteur spécial, a, ainsi que d’autres orateurs, évoqué le rapport général sur la sécurité et l’éducation routières. Il a regretté la disparition de certains indicateurs du volet « performance » du projet annuel de performance, ou PAP, annexé au projet de loi de finances pour 2015.
Le Gouvernement a souhaité alléger ce document, en réduisant le nombre de critères le composant, afin de le rendre plus lisible. Les indicateurs ne figurant plus dans le PAP sont les suivants : le nombre de personnes tuées dans un accident impliquant au moins un conducteur présentant un taux d’alcool supérieur au taux légal, le nombre de passagers de deux-roues motorisés tués dans un accident et le nombre de jeunes tués dans un accident.
Si ces indicateurs ne sont plus affichés dans le PAP, le Gouvernement ne cesse pas pour autant de les suivre. Ils continuent, avec d’autres, à guider son action sur le front de la sécurité routière. Monsieur Delahaye, je vous en donne toute garantie.
Le transfert des dépenses de personnel du programme 207 vers le programme 216 permettra une gestion simplifiée des personnels par la direction des ressources humaines du ministère de l’intérieur. Tel est le sens de cette modification.
Longtemps annoncée, notamment en 2009, la réforme du permis de conduire n’a, jusqu’à présent, jamais été mise en œuvre. Je l’ai décidée, je l’ai engagée, elle a suscité un mouvement social, qui a été maîtrisé par la négociation. En effet, nous ne cessons de dialoguer avec les organisations syndicales. Mon but est simple : la mise en œuvre d’un permis moins cher, qui puisse être passé dans des délais plus resserrés par les jeunes, car, pour eux, le permis de conduire, c’est le permis de travailler. Parallèlement, nous tenons à maintenir cet examen du permis de conduire dans le cadre du service public.
Plusieurs orateurs, notamment M. Vogel, rapporteur spécial, ont posé diverses questions relatives à la sécurité civile. Mme Troendlé a, quant à elle, exprimé un certain nombre d’interrogations au sujet d’ANTARES. §
Notre flotte de bombardiers d’eau constitue un premier sujet. Le transfert de la base avions de la sécurité civile, la BASC, de Marignane à Nîmes-Garons, se poursuit conformément au calendrier fixé. Je me suis rendu à Marignane cet été, puis à Nîmes. Le renouvellement des contrats de maintenance est en cours, le renouvellement de la flotte de Tracker sera assuré d’ici à 2020, selon des modalités qui seront arrêtées en 2015. La piste de l’avion Air Tractor n’a pas encore été jugée assez satisfaisante eu égard à nos besoins. Ce projet n’a donc pas abouti.
Vient ensuite la question de notre flotte d’hélicoptères. Dans ce domaine, nous progressons également au sujet des coûts de maintien en conditions opérationnelles et de leur poids dans les divers budgets. Nous œuvrons à la coordination opérationnelle entre la gendarmerie et la sécurité civile, et j’ai constaté avec grand plaisir que les équipes en place à Nîmes-Garons commencent à mutualiser les fonctions d’entretien et de maintenance, conformément au principe de subsidiarité missionnelle. Ainsi, la situation évolue dans le bon sens.
Quant au déploiement d’ANTARES, projet prioritaire conduit par l’État, il vise à améliorer et à unifier les moyens de communication des services départementaux d’incendie et de secours, les SDIS.
Madame Troendlé, le calendrier initial est respecté, et nous visons toujours la couverture de 100 % des SDIS par ce dispositif à l’horizon de 2017. En cette fin d’année 2014, 79 SDIS sont couverts. En 2015, 17, 8 millions d’euros de crédits de paiement et 7, 6 millions d’euros d’autorisations d’engagement seront mobilisés. Cet investissement, qui bénéficie directement aux SDIS, est, je le rappelle, intégralement financé par l’État.
Vous l’avez signalé, la couverture territoriale assurée par ce réseau subit encore divers problèmes. Mes services s’emploient à les résoudre, en lien avec les SDIS. Il faut que cet outil moderne qu’est ANTARES couvre de manière homogène l’ensemble de notre territoire.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous le savez, la saisie des avoirs criminels est un sujet qui me tient très à cœur. Les sommes collectées par nos forces croissent dans des proportions considérables. Elles s’élevaient à 357 millions d’euros en 2013. Pour l’heure, l’augmentation enregistrée cette année par rapport à l’année dernière est de l’ordre de 27 %, ce qui est exceptionnel.
À mon sens, il serait normal que ces sommes soient réparties de la sorte : le premier tiers serait affecté au budget général ; le deuxième tiers serait destiné à l’administration de la justice ; le troisième et dernier tiers serait consacré au financement des équipements dont nos forces ont besoin.
Je dois admettre, en toute honnêteté, que je n’ai pas toujours tenu ce discours : il fut un temps, lorsque j’étais ministre délégué au budget, où je préconisais que 100 % de ces avoirs soient portés au budget général de l’État.
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Toutefois, les nouvelles missions et les nouvelles fonctions aidant, on finit par gagner en sagesse
Sourires.

Mme Nathalie Goulet. Autrement dit, il ne faut pas revenir au ministère du budget…
Nouveaux sourires.
… – je le dis en l’absence de mon collègue chargé du budget…
Plus sérieusement, il faut le souligner : plus nous motiverons nos troupes pour ce qui concerne la collecte de ces avoirs, plus les sommes récoltées seront élevées – c’est ce que l’on observe dans les faits – et plus le budget général tirera profit de cette politique.
Dans un contexte où le terrorisme et, plus globalement, les problèmes de sécurité de proximité et de sécurité civile deviennent prégnants, la République doit être à même d’assumer ses missions régaliennes. À cet égard, il n’est pas illogique de vouloir procéder de la sorte.
Madame Assassi, si ma mémoire est bonne, vous avez déclaré que le nombre de sapeurs-pompiers volontaires diminuait. Telle n’est pas la conclusion à laquelle me conduisent les chiffres dont je dispose. Au reste, si vous le souhaitez, je vous adresserai dès la semaine prochaine une note synthétique spécifiquement consacrée à ce sujet. §À ce jour, notre pays dénombre un peu plus de 193 000 sapeurs-pompiers volontaires. Les vingt-cinq mesures de l’engagement pour le volontariat signé voilà un an à Chambéry devraient permettre de porter ce chiffre à 200 000.
Aussi, le mouvement est amorcé. En matière de logement, des efforts sont accomplis. Au titre des conventions avec les employeurs, permettant de laisser aux sapeurs-pompiers volontaires le temps d’accomplir ces missions de service public, les négociations avancent. Nous avons lancé une campagne de volontariat, intitulée « Sapeur-pompier + volontaire = moi aussi ». Nous nous battons pour que le modèle français de volontariat et de services d’incendie et de secours demeure.
La Haute Assemblée peut le constater, nous agissons de manière très volontariste, ce qui n’est pas absurde en matière de volontariat. J’ai confirmé la volonté qui nous anime, les moyens que nous mobiliserons et le calendrier que nous suivrons, à l’occasion du congrès national des sapeurs-pompiers de France qui s’est tenu cette année à Avignon. Nous serons en mesure d’atteindre les objectifs fixés.
Mesdames, messieurs les sénateurs, telle est la réponse que je voulais vous apporter. Certes, elle n’est pas exhaustive – je vous prie de bien vouloir m’en excuser –, mais l’exhaustivité nous conduirait trop loin.
Je renouvelle ce soir l’engagement que j’ai pris devant la commission de communiquer à l’ensemble des intervenants des réponses écrites précises aux questions qui m’ont été posées : tous les points que j’ai abordés de façon allusive feront l’objet de courriers de la part de mon cabinet, adressés à chacune et à chacun d’entre vous dans les jours ou les semaines qui viennent. §

Nous allons maintenant procéder au vote des crédits de la mission « Sécurités », figurant à l’état B.
En euros
Mission
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
Sécurités
Police nationale
Dont titre 2
8 718 418 488
8 718 418 488
Gendarmerie nationale
Dont titre 2
6 848 898 820
6 848 898 820
Sécurité et éducation routières
Sécurité civile
Dont titre 2
166 611 496
166 611 496

Je n’ai été saisi d’aucune demande d’explication de vote avant l’expiration du délai limite.
Je mets aux voix les crédits de la mission « Sécurités ».
Ces crédits sont adoptés.

J’appelle en discussion l’article 59 septies qui est rattaché pour son examen aux crédits de la mission « Sécurités ».
Sécurités
Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
L'article 59 septies est adopté.

Nous allons procéder à l’examen des crédits du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », figurant à l’état D.
En euros
Mission
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
Radars
Fichier national du permis de conduire
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières
Désendettement de l’État

L'amendement n° II-74, présenté par M. Delahaye, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Modifier ainsi les crédits des programmes :
en euros

Programmes
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
Radars
Fichier national du permis de conduire
Contrôle et modernisation de la circulation et du stationnement routiers
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières
Désendettement de l’État
TOTAL
SOLDE
La parole est à M. Vincent Delahaye, rapporteur spécial.

Je suis heureux de pouvoir défendre cet amendement en séance publique ! J’en présente un similaire depuis deux ans à la commission des finances qui a obtenu à chaque fois un avis favorable, y compris cette année. Une mesure identique figure en outre parmi les propositions de Thierry Mandon visant à simplifier les procédures.
Il s’agit de supprimer les envois de lettres d’information, au nombre de dix-sept millions, relatives au retrait ou à la restitution de points qui mobilisent 15, 7 millions d’euros. Des alternatives existent pour obtenir cette information : un site internet, qui doit être amélioré pour permettre à tous d’y accéder facilement, ou une demande à la préfecture. Par ailleurs, chacun peut également tenir le compte de ses points, puisqu’il est informé, au moment de la réception du procès-verbal, du nombre de points qui lui sont retirés.
Les lettres dont je vous propose de supprimer l’envoi arrivent avec un certain décalage – je le sais par expérience, ayant déjà commis quelques infractions sanctionnées
Sourires.

Je présenterai dès à présent l’amendement n° II–75, qui tend à supprimer le dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route, lequel dispose : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif. »
Sur le relevé de points, nous sommes dans une phase d’expérimentation au terme de laquelle nous souhaitons parvenir avant d’élaborer des dispositifs différents.
Accepter la proposition de M. le rapporteur spécial, dont je comprends pourtant la logique, conduirait à désorganiser les services, à remettre en cause une expérimentation en cours, et perturberait la cohérence de notre action.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement, je n’irais pas jusqu’à dire à regret, car je suis attaché à la cohérence de son action. §
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.

L'amendement n° II-73, présenté par M. Delahaye, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Modifier ainsi les crédits des programmes :
en euros

Programmes
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
Radars
Fichier national du permis de conduire
Contrôle et modernisation de la circulation et du stationnement routiers
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières
Désendettement de l’État
TOTAL
SOLDE
La parole est à M. Vincent Delahaye, rapporteur spécial.

Une expérimentation est peut-être en cours, monsieur le ministre, mais durant ce temps, de l’argent est dépensé qui ne sert pas à grand-chose ! Je trouve dommage que le Gouvernement n’ait pas soutenu l’amendement précédent.
Cela étant, le présent amendement tend à prélever 15 millions d’euros sur le fonds de roulement de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions, l’ANTAI. Selon les informations officieuses dont je dispose, car je n’ai pas réussi à obtenir de réponse officielle, le montant de ce fonds est supérieur à 40 millions d’euros.
Il semble raisonnable que ce montant soit maintenu entre 15 millions d’euros et 20 millions d’euros. Cette agence recevant 123 millions d’euros de subventions de l’État, il me paraît possible de récupérer 15 millions d’euros sans la mettre en péril. Tel est l’objet de cet amendement.
Le Gouvernement est très réservé sur cet amendement, parce que le montant du fonds de roulement de l’ANTAI n’est pas celui que vous avez indiqué, monsieur le rapporteur spécial.
Nous avons déjà prélevé 14, 5 millions d’euros. Si nous prélevons 15 millions d’euros supplémentaires, nous compromettons les investissements dont l’ANTAI a besoin, s’agissant notamment de la dépénalisation des amendes. Ce prélèvement supplémentaire aurait des conséquences très préjudiciables sur la capacité d’action de l’ANTAI.

Le groupe UDI-UC soutient, bien entendu, cet amendement, car l’opacité qui règne sur les comptes de l’ANTAI est absolument inacceptable ! Normalement, le Parlement doit être informé de la situation réelle des comptes. Cacher ainsi certains éléments, cela veut dire que quelque chose ne va pas.
L’adoption de cet amendement permettrait – enfin ! – de clarifier la situation.

Monsieur le ministre, vous ne nous avez pas donné le montant du fonds de roulement de l’ANTAI. La semaine dernière, le secrétaire d’État chargé du budget, qui ne nous a pas non plus informés du montant de ce fonds, nous a annoncé qu’il proposerait un prélèvement dans le cadre du projet de loi de finances rectificative. Dès lors, pourquoi ne pas l’adopter dès aujourd'hui dans ce projet de budget ?
Quoi qu’il en soit, un prélèvement supplémentaire me semble nécessaire.
La transparence est totale sur ce sujet. Le conseil d’administration de l’ANTAI se réunira dans les prochains jours, et c’est au terme de l’arrêté définitif des comptes que le montant du fonds de roulement sera connu. Si je ne vous le communique pas, c’est par souci non pas d’opacité, mais de rigueur. Ce ne serait pas très correct de ma part d’anticiper cette réunion !
Cela étant, je puis vous dire que le fonds de roulement ne s’élève pas à 40 millions d’euros ; il est inférieur, selon les informations dont je dispose. J’aurai des renseignements fiables lorsque le conseil d’administration aura définitivement arrêté ses comptes.
Nous prélevons déjà 14, 5 millions d’euros pour financer l’ANTS. Si nous ponctionnons 15 millions supplémentaires, comme vous le proposez, monsieur le rapporteur spécial, l’ANTAI pourra difficilement réaliser les investissements et les adaptations dont elle a besoin.
Je le répète, il ne s’agit pas d’un refus de transparence. Simplement, si la Haute Assemblée décide d’adopter cet amendement – et je m’emploie à l’en dissuader ! –, cela risque de compromettre les missions de l’ANTAI, qui vont devenir extraordinairement problématiques, car, au total, on aura prélevé 29, 5 millions d’euros, une somme considérable.

À cette heure tardive, je ne voudrais pas ergoter. Toutefois, nous avons ponctionné tout ce que nous avons pu sur tous les fonds de roulement de l’ensemble des agences, des centres, des chambres de commerce et d’industrie, des chambres d’agriculture…
Au vu de vos explications, monsieur le ministre, nous comprenons que nous ne puissions pas connaître le montant exact du fonds de roulement de l’ANTAI. Mais, au cours de la navette parlementaire, nous pourrons toujours ajuster le montant du prélèvement, s’il n’est pas compatible avec celui du fonds de roulement arrêté par le conseil d’administration.
Nous pourrions adopter cet amendement ne serait-ce que par concordance entre l’annonce du secrétaire d’État chargé du budget et la proposition du rapporteur spécial.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.

L'amendement n° II-72, présenté par M. Delahaye, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Modifier ainsi les crédits des programmes :
en euros

Programmes
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
Radars
Fichier national du permis de conduire
Politique du contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières
Désendettement de l’État
TOTAL
SOLDE
La parole est à M. Vincent Delahaye, rapporteur spécial.

Cet amendement concerne la politique de remplacement des radars. Il vise à attirer l’attention sur le nombre de radars remplacés, alors que les appareils de nouvelle génération coûtent très cher : autour de 200 000 euros pour les radars « vitesse moyenne » ou « chantiers ». La politique de maintenance est également très onéreuse.
Faut-il aller aussi loin dans la période actuelle ? Je propose de ne mettre en œuvre que la moitié des remplacements prévus initialement et ainsi de réaliser une économie de 7, 35 millions d’euros, qui, sans être extraordinaire, pourrait alimenter les crédits du programme « Collectivités territoriales » afin d’aider à l’investissement en matière d’aménagements et de sécurité routière.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement en raison de l’efficacité des radars dans la lutte contre l’insécurité routière. Le parc de radars ayant vieilli, des investissements sont indispensables pour le maintenir en état de fonctionnement. Les statistiques de sécurité routière pour 2014 ne sont pas bonnes – je fais volontiers état des bonnes statistiques, mais je n’entends pas dissimuler les mauvaises. En conséquence, je ne suis pas favorable à ce que l’on diffère les investissements sur le parc installé.

Je suis très défavorable à cet amendement. Depuis de nombreuses années, nous assistons à une diminution tendancielle du nombre de morts sur les routes qui est liée aux contrôles de vitesse opérés et, par conséquent, aux nombres de radars installés.

Moins les voitures roulent vite, moins nous déplorons de décès. Il ne faut pas mettre un terme à l’effort mené depuis de nombreuses années. Il est certes toujours désagréable d’être contrôlé, d’être flashé, voire de perdre des points – on est alors bien content qu’un courrier nous en informe ! –, mais étant donné l’enjeu, limiter le nombre de morts, il est important de conserver les radars. Des vies sont sauvées, et nous en sommes tous satisfaits.

Le groupe UDI-UC est favorable à l’adoption de cet amendement. Il est en effet préférable d’affecter les crédits à la prévention, c'est-à-dire à des mesures d’amélioration de la sécurité mises en œuvre par les collectivités locales, plutôt qu’à la sanction, ainsi qu’il était initialement prévu. Pour autant, je n’en disconviens pas, la répression peut être utile.
Par ailleurs, une bonne partie des crédits visés serait affectée, outre au remplacement des radars anciens, à l’installation de nouveaux matériels, alors qu’il y en a déjà suffisamment. Calmons-nous quant à l’installation de nouveaux radars !
L'amendement est adopté.

Je n’ai été saisi d’aucune demande d’explication de vote avant l’expiration du délai limite.
Je mets aux voix les crédits, modifiés, du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », figurant à l’état D
Ces crédits sont adoptés.

J’appelle en discussion l’amendement tendant à insérer un article additionnel qui est rattaché pour son examen aux crédits du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ».
L'amendement n° II-75, présenté par M. Delahaye, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 64
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route est supprimé.
II. – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
La parole est à M. Vincent Delahaye, rapporteur spécial.

Par coordination avec le vote intervenu précédemment, je le retire, monsieur le président.

L'amendement n° II-75 est retiré.
Mes chers collègues, nous avons achevé l’examen des crédits de la mission « Sécurités », ainsi que du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ».

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, samedi 29 novembre 2014, à dix heures et à quatorze heures trente :
Suite du projet de loi de finances pour 2015, adopté par l’Assemblée nationale (n° 107, 2014-2015).
Examen des missions :
- Culture (+ article 50 bis).
MM. Vincent Eblé et André Gattolin, rapporteurs spéciaux (rapport n° 108, tome 3, annexe 7) ;
MM. Jean Claude Luche, Philippe Nachbar et M. David Assouline, rapporteurs pour avis de la commission de la culture (avis n° 112, tome 2).
- Solidarité, insertion et égalité des chances (+ article 60)
M. Éric Bocquet, rapporteur spécial (rapport n° 108, tome 3, annexe 30) ;
M. Philippe Mouiller, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales (avis n° 111, tome 7).
Régimes sociaux et de retraite.
Compte spécial : pensions (+ article 65).
M. Jean Claude Boulard, rapporteur spécial (rapport n° 108, tome 3, annexe 25) ;
Mme Agnès Canayer, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales (avis n° 111, tome 5).
Santé (+ article 59 sexies).
M. Francis Delattre, rapporteur spécial (rapport n° 108, tome 3, annexe 28) ;
M. René Paul Savary, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales (avis n° 111, tome 6).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le samedi 29 novembre 2014, à une heure cinq.