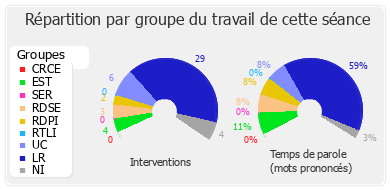Séance en hémicycle du 9 juillet 2015 à 10h30
Sommaire
La séance
La séance est ouverte à dix heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

M. le président du Sénat a reçu hier un rapport de Mme Leila Aïchi au nom de la commission d’enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l’air, créée le 11 février 2015, à l’initiative du groupe écologiste, en application de l’article 6 bis du règlement.
Ce dépôt a été publié au Journal officiel, édition « Lois et décrets », de ce jour. Cette publication a constitué, conformément au paragraphe III du chapitre V de l’Instruction générale du Bureau, le point de départ du délai de six jours nets pendant lequel la demande de constitution du Sénat en comité secret peut être formulée.
Ce rapport sera publié sous le n° 610, le mercredi 15 juillet 2015, sauf si le Sénat, constitué en comité secret, décide, par un vote spécial, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie de ce rapport.

M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de sénateurs appelés à siéger au sein de deux organismes extraparlementaires.
La commission de la culture, de l’éducation et de la communication a fait connaître qu’elle propose les candidatures de Mme Dominique Gillot pour siéger comme membre titulaire au sein du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche et de M. François Commeinhes pour siéger au conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs.
Ces candidatures ont été publiées et seront ratifiées, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.

L’ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (projet n° 466, texte de la commission n° 530, rapport n° 529, avis n° 505 et 491).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.
Madame la présidente, messieurs les présidents de commission, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, me voici à nouveau devant vous après qu’en mars dernier vous ayez adopté en première lecture le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte que j’avais eu l’honneur de défendre dans cet hémicycle et que la Haute Assemblée a enrichi de très nombreux apports.
J’avais tenu, à l’issue de ce premier vote, à saluer le remarquable travail accompli par le Sénat et la qualité du débat démocratique auquel, sur toutes les travées, l’examen de ce texte avait donné lieu. Signe de cette coconstruction législative à laquelle je suis très attachée, plus de 80 % des amendements que vous aviez adoptés en commission avaient fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement.
Je sais donc que nous sommes ici toutes et tous convaincus de la nécessité de lutter efficacement contre le dérèglement climatique pour bâtir un nouveau modèle énergétique français qui nous permette non seulement de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de développer des filières d’avenir, de créer des activités nouvelles et des emplois durables.
Je ne ferai pas ici de nouvelle présentation exhaustive d’un texte dont le Sénat connaît parfaitement les lignes de force et les dispositions.
Je voudrais simplement insister sur l’effet que ce texte a déjà produit dans la société française : à partir d’un débat solide, nous avons fixé un cap et clarifié les différents enjeux.
Je crois que le mouvement est lancé. En effet, avant même l’adoption définitive de cette loi et sa promulgation, on voit déjà se mettre en mouvement l’ensemble des forces vives du pays. On voit aussi une confiance des investisseurs dans les énergies renouvelables ou dans l’économie circulaire. On voit les citoyens se mobiliser, se saisir du crédit d’impôt de la transition énergétique. On voit une prise de décisions à différents échelons.
Je donnerai quelques exemples de cette dynamique.
Premier exemple, les décisions prises à l’échelle européenne, auxquelles nous avons activement œuvré, confortent les choix et les engagements actés par le Sénat en première lecture. La plus volontariste est la contribution de l’Union européenne à la lutte contre le changement climatique, dans le cadre de la préparation de COP 21. Elle réaffirme l’objectif de 40 % au moins de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre d’ici à l’horizon 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Elle précise quels secteurs et quels gaz nocifs pour le climat sont concernés. L’Europe prend ses responsabilités et, ce faisant, elle renforce la stratégie choisie par la France.
Le Conseil européen de l’environnement a permis de progresser vers une véritable Union de l’énergie, l’un des objectifs désormais mentionnés dans le projet de loi, avec l’accord d’interconnexion électrique et gazière conclu entre l’Espagne, le Portugal, la France et la Commission européenne. C’est là un nouveau pas pour réduire notre commune dépendance énergétique, en ces temps géopolitiquement incertains, et pour mutualiser entre nos pays les énergies renouvelables.
Afin d’accélérer l’élaboration de cet outil de pilotage prévu par le projet de loi, j’ai lancé, en mars dernier, les travaux relatifs à la programmation pluriannuelle de l’énergie. Cette programmation traitera, dans un cadre intégré, de toutes les sources d’énergies, de la maîtrise de la demande, de la diversification et de la sécurité de nos sources d’approvisionnement, du stockage et des réseaux.
Ainsi, comme je m’y étais engagée avant même la lecture et le vote définitif de la loi, ce travail d’accompagnement et d’application de la loi est activement conduit.
Un autre exemple de mouvement est constitué par les territoires à énergie positive, qui sont l’aile marchante de la transition énergétique et qui ont été très nombreux à répondre à l’appel à projets lancé par le ministère de l’écologie : 528 collectivités locales et regroupements de communes ont exprimé leur volonté de s’engager pour réduire la consommation énergétique de leurs bâtiments. Ont été retenus comme lauréats 212 territoires, ceux dont les projets sont les plus complets. À ce titre, ils vont recevoir une aide financière de 500 000 euros versée grâce à une avance de la Caisse des dépôts et consignations, consolidée dans le texte qui vous est soumis. Cette aide est susceptible d’être portée à 2 000 000 euros en fonction de la qualité des projets et de leur contribution effective aux objectifs inscrits dans le projet de loi. Au moment où je vous parle, plus d’une centaine de conventions financières ont déjà été signées par mes soins avec les différentes collectivités territoriales et regroupements de communes de toutes sensibilités politiques.
D’autres projets, moins complets, ne sont pas laissés à l’écart : j’ai en effet créé les contrats régionaux ou locaux de transition énergétique qui permettent d’obtenir des aides complémentaires, notamment de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME.
J’ai tenu, comme je m’y étais engagée devant vous, à donner un élan renforcé à la recherche-développement, car j’y vois une condition essentielle de la réussite de la transition énergétique.
Deux nouvelles conventions ont ainsi été signées avec l’ADEME pour soutenir les programmes des investissements d’avenir concernant, d’une part, les « démonstrateurs de la transition énergétique et écologique », d’autre part, « les véhicules du futur » qui bénéficieront de crédits additionnels et d’une procédure simplifiée d’instruction.
La décarbonation des énergies et de leurs usages, les bâtiments durables et énergiquement performants, l’économie circulaire, l’eau, la biodiversité, l’innovation et l’industrialisation de nouvelles solutions favorisant une mobilité terrestre et maritime propre : voilà autant de thèmes stratégiques pour accélérer notre mutation énergétique, stimuler la croissance verte et soutenir nos entreprises, qu’il s’agisse de grands groupes, de PME ou d’entreprises de taille intermédiaire, ou ETI, qui sont très dynamiques sur ces secteurs et que nous devons consolider pour les aider à créer des activités et des emplois.
De nombreuses actions d’accompagnement concernent le titre II du projet de loi, intitulé « Mieux rénover les bâtiments pour économiser l’énergie, faire baisser les factures et créer des emplois », et en premier lieu l’impulsion que j’ai voulu donner au grand chantier de la rénovation des logements et des bâtiments. Vous connaissez l’état des lieux : 123 millions de tonnes de CO2 émises par le bâtiment, 20 millions de logements mal isolés, une facture moyenne de chauffage de 900 euros par ménage et par an, mais aussi un gisement d’économies d’énergie considérables et d’emplois pour les artisans si nous accélérons le chantier de l’isolation thermique des bâtiments.
Le crédit d’impôt a été rapidement mis en place. Les décrets et l’arrêté relatifs à la simplification et à l’extension de l’écoprêt à taux zéro, le prêt transition énergétique, ont été publiés à la fin de l’année 2014 pour que cette aide soit en place dès le 1er janvier 2015. Le décret relatif au tiers financement a été publié le 17 mars afin que l’absence d’épargne pour certaines familles ne fasse pas obstacle au lancement des travaux qui sont aussi bons pour le climat que pour la baisse des factures !
La même volonté de rapidité et le même souci d’obtenir des résultats concrets ont conduit à la publication, en novembre 2014, des décrets sur l’audit énergétique de 5 000 entreprises de plus de 250 salariés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros. Avec l’aide de l’ADEME et de BPI-France, cet audit doit être réalisé avant le 31 décembre 2015. Il va permettre aux entreprises de repérer rapidement leurs gisements d’économies d’énergie, de définir des actions immédiates et les investissements qui vont faire baisser leurs factures et d’améliorer leur compétitivité tout en contribuant à la réduction de notre consommation énergétique globale.
Nous avons également, avec le ministre de l’économie, validé le contrat de filière relatif à l’efficacité énergétique lors de la réunion du comité stratégique des éco-industries.
Évoquons à présent le renfort de deux appels à projets lancés au mois de mai dans le cadre des plans de la « Nouvelle France industrielle » : d’abord, l’appel à projets pour les entreprises du recyclage – recyclage des déchets plastiques, des déchets électroniques, des déchets du BTP, des fibres de carbone et de verre –, ensuite, l’appel à projets sur l’eau avec quatre axes stratégiques : les usines d’épuration de la ville durable, les réseaux intelligents, la gestion efficace de la ressource et les unités de dessalement.
On le voit, il y a là pour notre pays un enjeu climatique et économique de la première importance afin de valoriser les savoir-faire français, de pousser en avant les entreprises non seulement sur le marché national, mais aussi sur le marché international. En effet, tous les pays qui sont en train d’élaborer leur contribution nationale dans le cadre de la préparation de la Conférence de Paris sur le climat vont bien devoir passer à l’action et réaliser les travaux relatifs à la performance énergétique. Il est absolument crucial que les entreprises françaises soient bien positionnées sur ces nouveaux marchés.
S’agissant du titre III intitulé « Développer les transports propres pour améliorer la qualité de l’air et protéger la santé », je voudrais signaler le nouveau plan national « Santé-Environnement » pour la période 2015-2019, que j’ai présenté avec la ministre de la santé. Il prévoit des mesures concrètes pour lutter contre la pollution de l’air, qui reste un problème majeur en milieu tant urbain que rural, et qui est aussi un facteur aggravant du dérèglement climatique.
Le texte qui vous est soumis prévoit pour la première fois dans notre droit positif l’économie circulaire. Depuis le mois de juillet 2014, le titre IV intitulé « Lutter contre les gaspillages et promouvoir l’économie circulaire : de la conception des produits à leur recyclage » a fait l’objet de plusieurs plans d’action. Il y a d’abord eu l’appel à projets pour des « territoires zéro déchet, zéro gaspillage », qui a rencontré un très vif succès. Alors que je pensais recevoir une trentaine de réponses, ce sont 293 collectivités réparties dans toutes les régions rassemblant plus de 7, 5 millions d’habitants qui se sont engagées dans une démarche volontaire de lutte contre le gaspillage et les déchets ! C’est dire à quel point nos débats ont permis de déclencher une action dynamique d’action, de valorisation, de reconnaissance, d’accélération dans les territoires qui étaient pourtant déjà en avance !
Les collectivités les plus ambitieuses visent une réduction de plus de 10 % des déchets, ce qui correspond à plus de 240 000 tonnes de déchets évités et à 43 millions d’euros d’économies par an et de recyclage. Les 58 projets lauréats, dans l’Hexagone et les outre-mer, sont les plus aboutis et bénéficient d’un accompagnement du ministère de l’écologie, via l’ADEME, laquelle leur apporte son expertise technique, son soutien financier pour l’animation de leur démarche et l’accès à des aides bonifiées à l’investissement. Ces projets exemplaires, dont j’ai réuni hier les responsables, témoignent de la créativité et de la réactivité des territoires dès lors que le cap est clairement fixé et que des moyens facilement accessibles sont mis en place.
Ajoutons, dans le cadre des « territoires zéro déchet, zéro gaspillage », la montée en puissance tout à fait particulière de la lutte contre le gaspillage alimentaire, à propos de laquelle nous aurons l’occasion de débattre et de compléter le dispositif législatif.
En lien direct avec le titre V, consacré à la montée en puissance des énergies renouvelables, je veux mentionner la part prise par les énergies renouvelables – c’est un effet des initiatives opérationnelles prises au cours de ces six derniers mois et un signe des premiers résultats engrangés –, qui représentent désormais près de 20 % de notre consommation électrique selon Réseau de transport d’électricité, ou RTE et dépassent pour la première fois, hors hydraulique, la production thermique d’origine fossile. Il reste bien sûr du chemin à parcourir, mais l’éolien et le photovoltaïque repartent à la hausse pour ce qui concerne le nombre d’équipements. Les projets se multiplient, encouragés par le permis unique. Pour la transition énergétique, c’est une excellente nouvelle.
Les appels à projets lancés par le ministère de l’écologie portent leurs fruits, que ce soit pour les hydroliennes fluviales, pour les installations photovoltaïques de grande, moyenne et petite puissance, dont les premiers lauréats viennent d’être désignés, pour les installations solaires destinées aux outre-mer et à la Corse, qui allient technologies innovantes de stockage et solutions d’autoconsommation dans une perspective d’autonomie énergétique, pour l’éolien sur terre et en mer, etc.
Dans le cadre du soutien apporté aux démonstrateurs d’énergies marines, l’hydrolienne expérimentale Sabella D10, l’une des machines les plus puissantes du monde, a été inaugurée en avril dernier et le suivi de ses incidences environnementales fait l’objet d’un protocole rigoureux avec le Parc naturel marin d’Iroise.
Le doublement du fonds chaleur de l’ADEME ainsi que l’extension de son champ d’action, notamment aux récupérateurs de chaleur en amont des réseaux, à l’injection de biogaz issu de la méthanisation, à la production de froid renouvelable, à l’optimisation de l’utilisation de la biomasse issue du bois et aux petits projets faisant l’objet d’un financement participatif, conformément à la loi, des citoyens vivant sur le territoire concerné, permettront de changer d’échelle dans des domaines essentiels à la réussite de la transition énergétique.
La relance de la filière du solaire thermique, avec l’appel à projets Dynamic bois lancé avec le ministère de l’agriculture pour optimiser la biomasse issue de l’exploitation forestière, apporter un complément de rémunération aux agriculteurs et maximiser la séquestration du carbone par les arbres, le lancement avec le ministère de l’industrie de l’appel à projets « Réseaux intelligents », la participation active de la France au programme européen sur les smart grids, la simplification et la transparence accrue des certificats d’économie d’énergie, dont le projet de loi prévoit la réforme sont autant d’avancées sur la voie des objectifs fixés par le texte qui vous est soumis.
J’ai parallèlement veillé à ce que les tarifs de rachat, dont la loi sur la transition énergétique actuellement en discussion permettra de clarifier et de stabiliser le mécanisme, ne fassent pas obstacle au déploiement des énergies renouvelables, mais soutiennent au contraire ce dernier, de manière adaptée à chaque type d’énergie et à la puissance des installations, tout en protégeant le pouvoir d’achat des Français.
Pour ce qui concerne plus particulièrement l’éolien, terrestre et offshore, permettez-moi de souligner deux points.
Tout d’abord, l’arrêté relatif à l’implantation d’éoliennes à proximité des radars de Météo France a été publié en novembre. Il permet de réduire les cas d’incompatibilité et de débloquer les projets qui étaient immobilisés tant que les règles n’avaient pas été clarifiées, ce qui correspondait à plus de 40 parcs éoliens.
Ensuite, s’agissant de la distance à préserver entre habitations et éoliennes, je souhaite bien évidemment qu’une solution d’équilibre puisse être trouvée, qui tienne compte en particulier de l’étude d’impact. Tout en prenant la mesure des nuisances susceptibles de résulter de ces installations pour le voisinage, il ne faut pas freiner l’essor de cette énergie verte, qui doit devenir pour la France une filière d’excellence.
Les six parcs offshore dont le ministère de l’écologie a lancé la construction représentent un potentiel de 10 000 emplois directs et indirects ancrés dans les territoires. L’usine Alstom, qui construit à Saint-Nazaire des composants pour l’éolien en mer, va créer 300 emplois directs et 2 000 emplois indirects, preuve de la contribution à l’emploi de la croissance verte en général et de ce secteur en particulier.
La mutation énergétique de notre pays bénéficiera en outre des 15 000 missions « Transition énergétique, climat et biodiversité », créées dans le cadre de l’extension du service civique. Nous en avons annoncé le lancement en février, avec le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. J’observe que, dans les territoires à énergie positive qui ont été retenus, de nombreux maires ont recours au service civique pour appuyer leurs actions.
Enfin, comme j’en avais pris l’engagement à différentes reprises devant vous, j’ai tenu à lancer sans tarder, en concertation avec toutes les parties prenantes, le chantier de l’élaboration des décrets d’application, en vue d’une publication la plus rapide possible de ces derniers une fois la loi promulguée.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, voilà quelques éléments très opérationnels permettant d’illustrer vos travaux. En reprenant chacun des axes de ce projet de loi sur lequel vous voulez bien vous pencher de nouveau, on constate que le mouvement de la transition énergétique monte en puissance. Nous aurons à cœur, j’en suis sûre, de l’accélérer dans les territoires, en fixant un cadre clair montrant à chacun qu’une telle évolution est désormais irréversible. Bien souvent, en effet, lorsqu’il existe un doute sur la stabilité des règles, on est conduit à remettre en cause capacité d’innovation et sécurisation des investissements.
Permettez-moi, pour conclure, d’évoquer la Conférence scientifique internationale, qui réunit des scientifiques du monde entier. Elle se tient en ce moment à Paris à l’UNESCO, sur l’initiative de deux grands climatologues français, Jean Jouzel, vice-président du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, ou GIEC, qui en préside le haut comité, et Hervé Le Treut, membre de l’Académie des sciences, qui en préside le comité d’organisation.
Cette rencontre de haut niveau réunit durant quatre jours plus de 2 000 chercheurs de toutes les disciplines, venus d’une centaine de pays, autour de la question du dérèglement climatique. C’est l’un des événements majeurs de la préparation du Sommet de Paris sur le climat. C’est aussi, pour l’action législative de la France, un puissant encouragement.
J’ai participé avant-hier à la séance inaugurale de cette conférence. J’ai fait part de nos travaux aux participants, leur expliquant que je ne pouvais rester parmi eux compte tenu de l’examen de ce projet de loi. Une telle articulation m’a semblé tout à fait opportune : nous sommes ici dans un cadre national, tandis que ces chercheurs sont rassemblés dans un cadre mondial. Or, on le sait bien, ce sont les actions opérationnelles, sur chacun de nos territoires nationaux et, en leur sein, dans chacun de nos territoires de grande proximité que j’ai évoqués tout à l’heure, qui permettront l’articulation entre le local et le global, pour tenir, je l’espère, notre engagement du maintien du réchauffement climatique en deçà des deux degrés, afin que nous puissions transmettre aux générations futures une planète en bon état, sur laquelle il fera bon vivre.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du CRC, du groupe écologiste et du RDSE, ainsi qu’au banc des commissions.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en première lecture de ce projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, la commission des affaires économiques avait fait le choix d’accompagner la démarche du Gouvernement, tout en faisant valoir des convictions fortes sur certains points. De cette position d’équilibre, nous espérions qu’un accord en commission mixte paritaire pourrait naître, ce qui ne fut, hélas ! pas le cas. Nous avons même eu droit à une caricature de CMP, et ce n’est pas le président de la commission des affaires économiques, M. Jean-Claude Lenoir, qui me contredira !

Aussi aurions-nous pu décider, pour cette nouvelle lecture, de « radicaliser » nos positions ; mais ce faisant, nous aurions alors renoncé à la dernière possibilité qui nous est offerte d’enrichir encore le texte, à la condition de convaincre nos collègues députés de reprendre certaines de nos propositions en lecture définitive, ce qu’ils ne sont absolument pas obligés de faire.
J’ajoute que nous sommes d’autant plus enclins à poursuivre sur cette voie qu’un bon nombre des apports du Sénat en première lecture ont été préservés : il en est ainsi, par exemple, en matière d’isolation par l’extérieur des bâtiments, de soutien aux industries électro-intensives, pour lesquelles nous avons fait, je crois, œuvre utile, ou de compensation des hausses futures de la part carbone. Je pense également à l’objectif de 10 % de gaz renouvelables en 2030, à la définition et à la mise en œuvre d’une stratégie nationale de mobilisation de la biomasse, ou encore à l’interdiction des frais de rejet de paiement dans le cadre du chèque énergie. Ainsi, sur les 209 articles encore en navette à l’issue de nos travaux, 78 ont fait l’objet d’un vote conforme des députés en nouvelle lecture et une centaine d’autres n’ont été modifiés qu’à la marge.
Dès lors, la commission des affaires économiques s’est attachée à proposer deux types de modifications : celles qui, par cohérence avec les positions défendues en première lecture, visent à rétablir le texte du Sénat et celles qui tendent à compléter ou à corriger, pour des raisons essentiellement techniques, le texte voté par l’Assemblée nationale.
Dans la première catégorie, vous ne serez pas étonnée, madame la ministre, de retrouver la question du nucléaire. Encore une fois, si nous adhérons au principe d’une diversification du mix électrique, nous ne pouvons pas accepter la date couperet de 2025. Et nous n’accepterons jamais la fermeture de 23 de nos 58 réacteurs.

C’est techniquement impossible, économiquement irréaliste pour nos entreprises et insupportable pour nos concitoyens. En fermant progressivement, comme nous le proposons, des réacteurs à mesure du vieillissement naturel du parc, l’on s’épargnerait bien des problèmes : pas d’indemnisation à verser à l’exploitant, préservation de notre indépendance énergétique et garantie d’une électricité compétitive et décarbonée, le temps d’assurer la montée en puissance des énergies renouvelables, de résoudre la question de leur intermittence et le problème du stockage.
J’ajoute que, à l’heure où le devenir d’AREVA est en question, une réduction trop brutale de la part du nucléaire en France déstabiliserait encore davantage la filière et enverrait un message particulièrement négatif à l’international et à l’export.
Par cohérence, nous avons de nouveau relevé le plafonnement de la capacité de production nucléaire, afin d’y inclure l’EPR de Flamanville – sa création, je vous le rappelle, a été décidée en 2007 –, alors que le plus grand flou règne sur sa date de démarrage : il n’y a donc aucune raison de lier sa mise en service à la fermeture de la centrale de Fessenheim, ce à quoi conduirait automatiquement le plafonnement actuel.
D’autres objectifs méritent aussi d’être amendés, tout en préservant l’esprit du texte. Ainsi, nous sommes nombreux à avoir des doutes sur l’objectif de réduction de la consommation énergétique finale. La commission des affaires économiques a donc réintroduit la notion d’intensité énergétique, ce qui a le mérite de lier consommation et croissance économique.
Mes chers collègues, parier sur la décroissance est une erreur, …

… au moment où la France compte, toutes catégories confondues, plus de 5, 7 millions de chômeurs. Nous croyons au contraire à la reprise et nous parions sur la croissance.
De la même façon – j’aborde ainsi le volet de la rénovation des bâtiments –, nous avons rétabli l’échéance de 2030 pour la rénovation des bâtiments les plus énergivores, car la date de 2025 reviendrait à rénover un million de logements par an, ce qui, vous en conviendrez, n’est pas réaliste ! Quant à l’obligation de rénover tous les bâtiments privés résidentiels en cas de mutation à compter de 2030, nous l’avons supprimée au vu des très nombreuses difficultés qu’elle poserait du fait, notamment, de son caractère imprécis et potentiellement source de contentieux, de la non-prise en compte des « ventes contraintes » ou encore de ses effets économiques. L’immobilier ne va pas bien, et ce n’est pas le moment de l’enfoncer encore plus. Enfin, la commission des affaires économiques a souhaité, pour des raisons pratiques, que le carnet numérique de suivi et d’entretien ne s’applique qu’aux logements neufs.
En matière de soutien aux énergies renouvelables, nous avons apporté deux modifications principales, l’une pour soutenir la filière hydroélectrique, en autorisant les installations à bénéficier plusieurs fois, sous condition d’investissement, d’un complément de rémunération adapté, l’autre pour conforter le financement participatif des projets de production en l’ouvrant aux groupements de collectivités, en protégeant mieux les investisseurs et en assurant la parfaite solidité juridique du dispositif.
S’agissant de la régulation des marchés, nous avons notamment limité l’obligation de résultats de performance énergétique, imposée par les députés en contrepartie des conditions particulières d’approvisionnement, à certaines catégories seulement d’électro-intensifs. Une telle obligation n’existe en effet nulle part ailleurs : alors que nous cherchons à rétablir leur compétitivité, n’imposons pas à tous nos industriels des obligations que n’ont pas leurs concurrents !
La commission des affaires économiques a approuvé le principe d’un soutien aux installations de cogénération industrielle introduit par les députés, mais a souligné les difficultés posées par le dispositif – j’y reviendrai dans la discussion des articles.
En matière de gouvernance et de pilotage, le Gouvernement a été à l’initiative de deux modifications importantes : la première remplace l’exclusion du méthane entérique de la stratégie bas-carbone par une prise en compte explicite de son faible potentiel d’atténuation. J’ai bien compris que l’exclusion posait problème au regard du respect de nos engagements internationaux. Mais, madame la ministre, était-ce bien le moment d’alourdir les charges de nos éleveurs qui traversent une crise sans précédent ?
La seconde modification a consisté à renforcer les obligations de reporting et de gestion des risques environnementaux des entreprises. Sans entrer dans le détail, je rappellerai simplement que le Sénat avait déjà adopté, en séance publique, un dispositif insuffisamment cadré qui méritait d’être modifié. Aussi, bien qu’étant toujours vigilants sur l’ajout de nouvelles contraintes pesant sur nos entreprises, nous n’avons pas remis en cause ces mesures, qui sont justifiées par l’urgence climatique et auxquelles, madame la ministre, vous avez fait allusion : elles s’appliqueront à des entreprises – sociétés anonymes, établissements financiers et investisseurs institutionnels – d’une taille suffisante pour les assumer sans surcoût excessif.
La commission des affaires économiques a en revanche rétabli la réforme de la contribution au service public de l’électricité, la CSPE, initiée par la commission des finances du Sénat – mon collègue Jean-François Husson reviendra sur ce point, je n’en doute pas – et sur laquelle nous étions, me semblait-il, parvenus à un accord avec vous en séance publique, madame la ministre. Or, si cette réforme n’épuise pas le sujet, elle a le mérite de poser des bases saines : un fonctionnement plus transparent et démocratique au travers d’un vote annuel du Parlement, une lisibilité accrue et une compatibilité avec le droit communautaire assurée par un recentrage sur le soutien aux énergies renouvelables. J’ajoute que, contrairement à ce que l’on a pu entendre ici ou là, le financement de la péréquation tarifaire et des dispositions sociales est préservé puisque cette nouvelle CSPE n’entrera en vigueur qu’en 2016, à charge pour le Gouvernement, qui y travaille, de présenter de nouvelles modalités de financement dans le projet de loi de finances.
En matière de lutte contre la précarité énergétique, enfin, nous avons pris acte du report de l’entrée en vigueur généralisée du chèque énergie au plus tard à la fin de l’année 2018, et avons supprimé la possibilité de réduire le débit d’eau servi aux ménages non précaires qui ne règlent pas leurs factures, dispositif dont nous doutons du caractère opérationnel.
Pour cette nouvelle lecture, la position de la commission des affaires économiques n’a donc pas varié : nous nous engageons résolument en faveur d’un modèle énergétique décarboné, comme en témoigne encore l’introduction dans le texte d’une cible de valeur de la tonne carbone en 2020 et en 2030 ; mais nous plaidons pour une transition réaliste qui préserve la croissance de nos entreprises et nos emplois.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, il n’est plus temps d’attendre. Il n’y a pas d’autre voie que celle d’engager toutes nos forces, tout de suite, dans une transition énergétique. Il y va de l’avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Le réchauffement climatique, la disponibilité des ressources, l’érosion de la biodiversité, l’impasse économique de notre modèle de développement nous poussent à agir vite, et à voir loin.
Désormais, la prise de conscience indispensable pour pouvoir agir est universelle. Les États-Unis et la Chine, les deux plus grands pollueurs du monde, viennent enfin de signer un accord dans ce domaine. Le vice-ministre chinois de l’environnement a confirmé, voilà quelques jours, ici même au Sénat, la volonté de son pays de s’engager résolument dans la lutte contre le changement climatique. Le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki Moon, rappelle qu’il n’y a pas de planète B, et un autre leader mondial, le pape François, vient de publier une encyclique décapante, Laudato si, sur la sauvegarde de la « maison commune ». C’est dire si l’alerte est massive et générale !
La question qui nous est posée est simple : « Comment réduire notre dépendance aux énergies fossiles pour aller vers une économie décarbonée, et réussir ainsi la transition énergétique pour une croissance verte, qui est absolument indispensable ? »
Mes chers collègues, le texte adopté par le Sénat en mars dernier a considérablement enrichi et équilibré le projet initial. La Haute Assemblée avait fait preuve d’un état d’esprit particulièrement constructif. Je vous remercie, madame la ministre, de l’avoir confirmé.
Détermination, responsabilité et pragmatisme ont été le fil conducteur de nos travaux. La conférence sur le climat, la COP 21, qui se déroulera en décembre prochain à Paris, ajoute un degré d’exigence supplémentaire. La France, honneur oblige, se doit de se distinguer pour sauver l’avenir de la planète.
C’est pourquoi, madame la ministre, comme mon collègue Ladislas Poniatowski, je regrette profondément l’échec de la commission mixte paritaire du 10 mars dernier, exclusivement dû – nous le savons tous – au refus du Président de la République et de la majorité de l’Assemblée nationale de tout compromis sur la seule question de l’échéance de la réduction de la part du nucléaire dans le mix électrique.
La plus grande partie du projet de loi faisait l’objet d’un large consensus. Le texte avait été enrichi par tous les groupes, sur toutes les travées de nos deux assemblées. C’est le seul article premier qui a fait échouer, pour des raisons idéologiques, la tentative de mettre en œuvre une transition énergétique unanime et consensuelle.
Le Sénat avait fait un pas significatif en acceptant l’objectif de réduction du nucléaire à 50 %. En revanche, l’Assemblée nationale n’a pas souhaité faire un pas vers nous, torpillant ainsi un consensus qui était à portée de main. Il y a là à mon avis un immense gâchis.
Malgré cela, je vous le redis, madame la ministre, les sénateurs sont attachés aux bienfaits de la co-construction législative. Ce texte, qui a été sensiblement amélioré, a confirmé la modernité démocratique que constitue le bicamérisme.
À l’issue de la nouvelle lecture du projet de loi par l’Assemblée nationale, sur les 111 articles sur lesquels la commission du développement durable était compétente, 67 articles restent en discussion. Je tiens à souligner que nombre de nos apports ont été conservés par l’Assemblée nationale, ce dont je me félicite.
J’en viens au détail des principales dispositions restant en discussion. Concernant le titre III relatif aux transports, un quart des articles sont encore en discussion. La commission du développement durable a apprécié favorablement la principale modification introduite à l’Assemblée nationale par le Gouvernement, dans la mesure où elle constitue l’aboutissement de la réflexion sur la notion de « véhicule propre ». Nous avions en effet soulevé la limite intellectuelle qu’il y avait à appeler « propres » des véhicules qui ne peuvent l’être complètement si l’on tient compte de l’ensemble de leurs émissions au cours de leur cycle de vie, c’est-à-dire de leur empreinte écologique. L’Assemblée nationale a donc remplacé dans tout le projet de loi la notion de « véhicules propres » par une distinction entre « véhicules à faibles émissions » et « véhicules à très faibles émissions », qui seront définis par référence à des seuils fixés par décret. La commission du développement durable a choisi de conserver cet apport, qui combine exigence en matière de qualité de l’air et accompagnement gradué de la filière industrielle automobile, auquel je rends hommage : si le moteur diesel n’avait fait aucun progrès pendant près d’un demi-siècle, six normes européennes différentes – une tous les trois ans – sont intervenues en l’espace de dix-huit ans, nous permettant d’obtenir le meilleur dans ce domaine.
Quant à la nouvelle obligation introduite concernant les flottes de bus de transports urbains, la commission du développement durable a tenu à préciser que le décret devrait aussi tenir compte de leur date d’acquisition.
Enfin, la commission a choisi de revenir au texte du Sénat sur deux points durs : d’une part, la fixation par la programmation pluriannuelle de l’énergie d’objectifs de biocarburants conventionnels et, d’autre part, le caractère facultatif des plans de mobilité que les entreprises doivent mettre en œuvre.
Concernant le titre IV, relatif aux déchets et à l’économie circulaire, de nombreuses modifications ont été apportées par les députés. La commission du développement durable n’est pas revenue sur les améliorations techniques intégrées par l’Assemblée nationale. En revanche, nous avons souhaité, par cohérence, revenir à la position du Sénat sur plusieurs sujets.
Concernant les installations de tri mécano-biologique, ou TMB, nous avons voulu préciser au maximum la portée de l’objectif d’évitement de création de ces nouvelles installations. Un consensus s’est dégagé pour dire qu’il ne faut pas faire de TMB en première intention, à la place du tri à la source des biodéchets, mais que ces structures peuvent être pertinentes dans d’autres cas, notamment pour préparer des combustibles solides de récupération. Ce cadre étant posé, notre philosophie, au Sénat, est de faire confiance aux collectivités et aux élus locaux.
Quant aux déchets plastiques, la commission du développement durable est revenue à la position du Sénat qui nous a semblé constituer le bon équilibre entre ambition et réalisme. Nous avons supprimé l’interdiction de la vaisselle jetable en plastique et rétabli une obligation de tri à la source de ces déchets. Concernant les sacs en plastique, nous sommes revenus au texte, construit en séance publique lors de la première lecture avec vous, madame la ministre, qui autorise les sacs de caisse compostables, je le précise, en compostage domestique.
Enfin – et c’est probablement l’un des apports les plus significatifs dans ce titre IV –, nous avons sécurisé le dispositif de la responsabilité élargie du producteur concernant les bateaux, « la REP navires », introduit par le Sénat. Un prélèvement, déterminé chaque année en loi de finances, sera effectué sur le droit annuel de francisation et de navigation, afin de résoudre le problème du stock historique de bateaux hors d’usage. De cette manière on ne remet pas en cause le principe de la REP : le flux sera financé par les metteurs sur le marché. Mais on pourra ainsi traiter enfin le stock de près de 300 000 navires hors d’usage, sans mettre en danger les ressources du Conservatoire du littoral.

En ce qui concerne le titre VII relatif à la simplification des procédures, le principal sujet – il est d’ailleurs particulièrement suivi – reste celui des éoliennes et de leur distance par rapport aux habitations. Une dizaine d’amendements propose toutes les versions possibles, …

… du retour aux 500 mètres, sans le pouvoir d’adaptation du préfet introduit par les députés, aux solutions bavaroises de type « dix fois la hauteur », en passant par les 1000 mètres de notre regretté collègue Jean Germain. Pour ma part, je préconise, comme en première lecture, de s’en tenir au texte actuel, c’est-à-dire 500 mètres, mais modulables par le préfet, ce qui constitue à mon avis un élément très fort d’adaptation à la réalité des territoires, le tout, je le maintiens, en attendant l’avis à l’automne prochain de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES. En revanche, je suis favorable à ce que l’avis du préfet soit également fondé sur le résultat de l’enquête publique, et non uniquement sur l’étude d’impact, qui peut se révéler incomplète.
Concernant le titre VIII, la commission du développement durable a rétabli, à chaque fois que cela avait été supprimé, la concertation avec les collectivités territoriales, pour permettre une transition efficace sur les territoires.
Madame la ministre, mes chers collègues, je forme le vœu que nous puissions aujourd’hui et les jours qui viennent continuer à travailler dans le même état d’esprit qu’il y a cinq mois : avec rigueur, passion parfois, mais surtout exigence et responsabilité. L’exemplarité est à notre portée et à celle de la France.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l’UDI-UC.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui en nouvelle lecture le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
Cette nouvelle lecture intervient à la suite de l’échec de la commission mixte paritaire, en raison principalement du désaccord portant sur la part de l’énergie nucléaire dans le mix énergétique français. Là où la majorité sénatoriale défend une position ambitieuse, mais équilibrée, qui est un objectif de réduction de cette part à 50 % sans l’associer à une date butoir, la majorité gouvernementale s’obstine à vouloir inscrire dans le texte l’échéance de 2025.
Pourtant, la plupart des experts que nous avons entendus nous ont affirmé qu’une telle réduction dans un temps aussi court était irréaliste, …

M. Jean-François Husson, rapporteur pour avis de la commission des finances. … sauf à engager des investissements considérables, pour ne pas dire insoutenables !
M. Ronan Dantec s’exclame.

Le Gouvernement devrait à tout le moins nous expliquer comment il compte parvenir à une telle réduction et nous en indiquer le coût. Une baisse dans cette proportion de la production d’électricité d’origine nucléaire sera en effet nécessairement coûteuse, en raison des fermetures et du démantèlement de réacteurs et de l’indemnisation que l’État devra verser à EDF. Nous devons cette transparence et cette honnêteté à nos concitoyens. Nous leur devons la vérité.
Le manque de transparence du Gouvernement est également patent s’agissant du financement de la transition énergétique, qui aura, elle aussi, un coût certain. Comme je l’avais souligné lors de la première lecture, nous attendons toujours de la part du Gouvernement des informations relatives aux modalités de financement des mesures présentées dans ce texte. Or, à ce stade, nous sommes toujours dans le flou. À cet égard, le texte adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture a accentué les incertitudes au lieu de les lever.
J’en veux pour preuve l’introduction, sur l’initiative du Gouvernement, d’une nouvelle disposition à l’article 5 quater visant à créer un fonds dénommé « Enveloppe spéciale transition énergétique » au sein du Fonds de financement de la transition énergétique, dont on peut s’étonner de l’apparition aussi tardive…
Nous ne connaissons pas exactement les ressources de l’enveloppe, qui doivent être définies en loi de finances. Nous n’en savons pas tellement plus sur son champ concret d’intervention ou ses modalités de gestion et de fonctionnement. Quels projets pourront être soutenus ? Pour quels montants ? Selon quels critères ?
En l’absence de telles précisions, il est demandé au Parlement de voter sur un dispositif obscur, dont on peut espérer qu’il ne constituera pas une nouvelle « coquille vide ». Nous aurons l’occasion d’en débattre lors de l’examen de l’article ; j’espère que le Gouvernement pourra nous apporter les éléments d’information nécessaires.
Surtout, la commission des finances a souhaité se saisir sur ce texte en nouvelle lecture, parce qu’elle a jugé nécessaire de proposer le rétablissement de la refonte de la CSPE, que l’Assemblée nationale a malheureusement supprimée.
Nos collègues députés, tout en saluant le travail que nous avons accompli au Sénat, ont décidé de revenir à leur texte initial, estimant qu’il n’était pas « opportun d’engager à moitié ce chantier, alors que le Gouvernement a confié à plusieurs administrations une mission visant à identifier des pistes de réforme en vue du prochain projet de loi de finances ».
Je tiens à le rappeler, cette mission a été confiée aux inspections après notre proposition de réforme, et le rapport, qui était attendu pour la fin avril, n’a toujours pas été remis au Parlement. Je m’interroge donc : la demande de rapport constitue-t-elle réellement un progrès ou s’agit-il d’une manœuvre destinée à nous faire attendre six mois supplémentaires avant de procéder à la refonte de la CSPE ?
Il serait d’autant plus regrettable de ne pas agir tout de suite que la réforme de la CSPE intégrée au texte du Sénat en première lecture a fait l’objet d’un accord avec le Gouvernement – avec vous, madame la ministre – sur le taux de la contribution et le plafond des charges qu’elle compense !
D’ailleurs, madame la ministre, à l’issue du débat, vous-même vous étiez félicitée du travail accompli, en déclarant ceci : « Ainsi, me semble-t-il, nous sommes parvenus à un juste équilibre entre le pouvoir qui est celui du Parlement en matière de fixation des règles, en l’occurrence du plafond, et la nécessaire souplesse qui conduira ce même Parlement à redéfinir annuellement un seuil et, éventuellement, à le faire pour chacune des filières, sans que rien soit figé dans le présent projet de loi. »
De mon point de vue, une telle réforme est essentielle et urgente, au regard notamment de l’impératif démocratique et des enjeux juridiques et financiers qui s’attachent à la CSPE.
Je tiens à le souligner, la réforme a pour objet de permettre au Parlement de voter le taux d’un impôt qui rapporte 6 milliards d’euros par an, et bientôt le double, et qui représente déjà 15 % de la facture d’électricité des consommateurs. Actuellement, le taux de la CSPE est fixé par arrêté ministériel, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. Cette situation n’est pas acceptable. Il est donc urgent d’agir sans attendre.
La commission des affaires économiques a ainsi fait œuvre utile en intégrant l’amendement de la commission des finances à son texte. Je tiens à l’en remercier vivement.
Mes chers collègues, j’espère vous avoir convaincus que nous ferions acte de courage et de responsabilité en adoptant cette réforme d’initiative parlementaire.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, permettez-moi de citer les propos d’un autre : « Pour la première fois, l’humanité est en mesure d’anéantir sa propre espèce. » D’une manière moins pessimiste, on pourrait dire qu’il est bien moins coûteux d’agir dès maintenant que de ne rien faire, sur bien des plans et dans bien des domaines.
Madame la ministre, je vous remercie de la dynamique positive que vous impulsez, afin de nous doter d’une réelle capacité d’entraînement sur le plan mondial lors de la Conférence de Paris, au mois de décembre. En effet, comment serait-il possible d’entraîner d’autres nations si nous n’étions pas capables de nous fixer à nous-mêmes des objectifs à la hauteur des enjeux ?
Nous partageons avec vous l’ambition de faire de ce texte une grande loi, plus en avance que ce que prévoient les directives européennes et capable de favoriser l’avènement d’un nouveau modèle de développement porteur d’activités nouvelles et d’emplois durables.
Alors que les sirènes de l’urgence climatique se font de plus en plus stridentes, il faudrait être parfaitement irresponsable pour ne pas réagir et pour hésiter à impulser une nouvelle dynamique de transition.
Les événements climatiques et autres dérèglements nous imposent de bousculer les vieilles lunes pour gagner cette nouvelle bataille.
La planète Terre n’est pas menacée. Elle en a vu d’autres en 4, 5 milliards d’années. Ce qui est menacé, c’est la biodiversité et, vraisemblablement, l’Humanité !
Ce texte tient le plus grand compte de l’urgence climatique. Il apporte la meilleure réponse qui soit, celle qui concilie écologie et économie en inventant un nouveau modèle, porteur de croissance et d’emplois.
Mes chers collègues, certains points d’achoppement que nous avons malheureusement rencontrés en première lecture nous ont amenés à nous abstenir…

… sur un texte par ailleurs porteur de grandes avancées. Ils portaient sur des objectifs fondamentaux en première lecture. On peut craindre qu’ils ne soient autant de points durs pour cette nouvelle lecture.
Évoquons par exemple la question du nucléaire. Je constate que la majorité sénatoriale partage notre souci d’établir un meilleur équilibre au sein du bouquet énergétique, en acceptant de ramener la part du nucléaire à 50 %. Monsieur le rapporteur, vous êtes d'accord sur la pente, mais pas sur la date. Or il ne peut pas y avoir de feuille de route sans date ! Résultat : rien ne se passe !
Je le répète, au sein du groupe socialiste et républicain, nous ne sommes ni pour le « tout-nucléaire » ni pour la sortie du nucléaire. Nous recherchons un équilibre, une sorte de juste milieu qui garantisse les intérêts de la France en modifiant et en rééquilibrant progressivement notre modèle énergétique.
Une autre divergence est également apparue en première lecture sur les coupures d’eau pour non-paiement des factures. Nous restons cohérents avec notre position d’alors. À nos yeux, interrompre la fourniture d’eau, bien vital et de première nécessité, cela constitue non seulement une violence, mais également une humiliation. D’ailleurs, la récente décision du Conseil constitutionnel nous conforte sur ce point. Nous aurons l’occasion de revenir sur les réductions du débit de l’eau que proposent certains de nos collègues ; nous ne sommes pas d'accord.
Sur la distance d’éloignement des éoliennes par rapport aux zones d’habitation, nous recherchons, nous aussi, un équilibre entre certains problèmes sanitaires ou paysagers évoqués et le nécessaire développement de cette énergie. Je ne doute pas qu’il y aura un débat sur ce point. J’espère que nous saurons écarter toute disposition à caractère « éolicide » !
La réforme de la CSPE est un autre point dur entre nous. En l’occurrence, et après réflexion, nous préférons revenir sur notre position de première lecture : le Gouvernement devrait déposer en loi de finances pour 2016 un projet de réforme globale qui traitera aussi non seulement des énergies renouvelables, mais également des zones non interconnectées, des tarifs sociaux et du chèque énergie.
Certes, une réforme de la CSPE s’impose. Comme cela vient d’être souligné, cette contribution représente un montant de plus de 6 milliards d’euros et compte à hauteur de 15 % dans la facture d’un consommateur moyen. Si rien n’est fait, l’impact sera de 25 % en 2025.
Cela dit, je ne souhaite pas m’attarder uniquement sur les sujets qui fâchent.
Majorité et opposition se retrouvent sur un grand nombre d’objectifs volontaristes de ce texte que je ne rappellerai pas. Elles se retrouvent sur le tournant de l’économie circulaire et les mesures qui donnent à la France l’élan nécessaire vers cette économie différente où les déchets des uns peuvent constituer les ressources des autres. En effet, il est urgent de sortir du schéma linéaire : « produire, consommer, jeter ».
Madame la ministre, vous nous avez rassurés sur l’hydroélectricité et le renouvellement des concessions. Notre patrimoine ne sera pas sacrifié par une ouverture à la concurrence sèche, comme les gouvernements d’avant 2012 l’avaient envisagé. Les dispositifs que vous nous proposez sont autant de dispositions préservant les intérêts nationaux, tout en respectant le droit européen de la concurrence.
Par ailleurs, nous apprécions – et je reprends vos termes, madame la ministre – le socle « solide et irréversible » qui se met en place, notamment avec les territoires à énergie positive, ou TEPOS, véritables moteurs de la transition.
On évoque souvent la nécessaire instauration d’un prix du carbone sur les plans européen et mondial. C’est le signal attendu des acteurs économiques pour faire pencher la balance, dans les choix des investissements, du côté des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et de la recherche.
Des signaux de prix clairs, sortes de boussoles, sont donc indispensables aux acteurs économiques pour définir leurs priorités en faveur de solutions bas carbone.
Madame la ministre, nous apprécions également que vous n’ayez point perdu de temps pour amorcer le mouvement de rénovation des 20 millions de logements, dont certains sont assurément des logements passoires.
Je pense au crédit d’impôt développement durable, ou CIDD, à 30 %, à l’écoprêt à taux zéro, au tiers financement ou encore aux certificats d’économie d’énergie en faveur des situations de précarité énergétique.
Vous avez raison d’affirmer que le « mur de l’argent » ne doit pas faire obstacle au lancement des travaux.
Faut-il également évoquer les mesures prises en direction des PME, avec les prêts verts de la Banque publique d’investissement, Bpifrance, ou des collectivités, avec le fonds de financement ? Faut-il mentionner le doublement du Fonds chaleur d’ici à 2017, donc la réduction de nos importations d’énergies fossiles ? Faut-il également insister sur la lutte contre les gaspillages alimentaires, avec les amendements de nos collègues députés Guillaume Garot et Marie-Hélène Fabre, la valorisation des déchets, les transports propres ou la mise en place d’un service civique ?
Oui, madame la ministre, le mouvement est lancé grâce à vous ! Ce texte d’avant-garde sonne le départ d’une révolution de la croissance verte et le début d’un basculement culturel de forte ampleur !
Par conséquent, et au nom du groupe socialiste et républicain, je salue l’esprit ambitieux et l’audace d’un texte qui nous donne rendez-vous avec l’Histoire, en espérant que le Sénat lui préservera toute sa force !
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ce projet de loi est un texte important qui organise enfin en France une transition énergétique urgente, dans un pays qui a trop longtemps délégué ses stratégies énergétiques à quelques-uns, en dehors de tout débat collectif et démocratique. On oublie souvent que c’est pourtant un sujet qui agite notre pays depuis maintenant plusieurs années. C’est pourquoi le texte qui nous revient en nouvelle lecture est tout à fait historique : c’est la première fois que le Parlement passe autant de temps à discuter au fond des stratégies énergétiques. Pour ceux qui se rappellent l’histoire, même les promesses de François Mitterrand s’étaient soldées à l’époque par un faux débat d’une demi-journée au Parlement. Cette fois, nous avons eu un vrai débat !
Il ressort de nos discussions que le système énergétique français n’est pas durable. Nous devons faire face tout d’abord à un déficit très important de la balance extérieure en raison des importations d’énergies fossiles, notamment de produits pétroliers. Nous sommes ensuite confrontés à des émissions de C02 qui baissent assez lentement – nous avons été nombreux à évoquer les échéances sur le climat – à cause du développement particulièrement fort en France du transport routier. Le chapitre mobilité est un chapitre important de ce projet de loi. Par ailleurs, notre système électrique est dans l’impasse, avec une filière nucléaire en quasi-faillite et un grand opérateur historique qui a perdu cette année 4 milliards d’euros – c’est ce que nous a annoncé son président lors d’un petit-déjeuner avec le groupe énergie.
Il y avait donc urgence, et notre responsabilité de parlementaire était donc de nous lancer dans ce débat lucidement et sans tabou. Cela n’aura malheureusement pas été tout à fait le cas. Je reste, je vous l’avoue, toujours interrogatif sur les présupposés politiques qui empêchent un débat sérieux sur le nucléaire, une sorte de « nucléo-déisme », nourri d’intérêts immédiats ou d’une certaine idée d’une France aussi éternelle et irradiante qu’une barre de plutonium.

« Touche pas à ma centrale » reste donc le slogan du Sénat, et je m’en désole.
Une nouvelle fois, en commission, les rapporteurs l’ont rappelé, notre assemblée est revenue sur la date de 2025 pour la réduction à 50 % de la part du nucléaire et a tenté de retarder le débranchement de la première centrale en fin de vie, grand tabou du lobby qui craint plus que tout que, à partir du moment où l’on commence à éteindre les centrales, on y prenne goût. Je reconnais qu’ils n’ont pas tout à fait tort…
Tout cela est un peu de la posture sans grande conséquence puisque nous sommes en nouvelle lecture, après l’échec de la commission mixte paritaire. Néanmoins, ce choix d’opposition systématique sur la question du nucléaire n’aura pas permis au Sénat d’avoir de l’influence sur l’ensemble du débat, ce que je regrette.
Quoi qu’il en soit, Mme la ministre l’a souligné, nous avons bien travaillé – je salue les deux rapporteurs et vos services, madame la ministre –, comme le prouve le maintien par l’Assemblée nationale de nombreux amendements qui ont été votés au Sénat. Je pense notamment aux chapitres liés à la rénovation et aux déchets où nous avons fait œuvre utile. Louis Nègre vient de le rappeler, nous avons créé une filière pour les bateaux de plaisance, qui n’était absolument pas envisagée au départ, et nous avons retravaillé positivement le texte sur ce point en nouvelle lecture. Je regrette simplement que la réhabilitation du parc privé, que nous avions votée ici, ait disparu en commission et que le Sénat ait un peu fait rimer immobilier et immobilisme.
Je serai plus prudent sur le développement du renouvelable, notamment de l’éolien terrestre, où une certaine hostilité s’exprime régulièrement dans cet hémicycle et a laissé quelques traces au cours de la navette.

Je crois que nous avons encore à rassurer les opérateurs, qui soulignent l’existence de quelques insécurités juridiques et arcanes administratifs inutiles.
Je soulignerai quelques avancées apportées par le Sénat en nouvelle lecture, qui mériteraient, selon moi, d’être conservées par l’Assemblée nationale.
Nous avons, par exemple, complété – je remercie Mme la ministre et M. le rapporteur – l’accès aux données pétrolières pour la réalisation des plans climat territoriaux. Le fait d’avoir comblé ce manque permettra aux territoires de faire leur travail. Surtout, nous avons intégré dans cette nouvelle version l’augmentation progressive de la contribution climat-énergie, qui restait bloquée à 2016. C’est un vrai point d’accord entre pro-nucléaires et écologistes : c’est dire le niveau de consensus ! Il serait dommage de ne pas le conserver.
Le projet de loi sera bientôt adopté. En conclusion, madame la ministre, je voudrais insister sur deux points qui font écho à votre discours liminaire.
Tout d’abord, c’est bien maintenant la rapidité de mise en œuvre de ce texte qui doit nous mobiliser. Ce sera en particulier la responsabilité des territoires. Je crois qu’ils sont prêts à s’engager, c’est du moins ce qu’ils ont affirmé à Lyon la semaine dernière lors du sommet mondial, où nous avons eu le plaisir de vous accueillir ainsi que le Président de la République. C’est bien par les territoires que passera la transition énergétique. Le projet de loi contient d’ailleurs des avancées majeures en ce qui concerne la place des territoires et l’articulation des différents échelons : Europe, État, région et intercommunalité.
Ensuite, je rappelle que, à partir du moment où nous avons redonné à l’État la capacité de stratégie sur les grands choix énergétiques, à travers notamment la programmation pluriannuelle de l’énergie, cette PPE se doit de traduire cette volonté. Il s’agira d’un vrai moment de vérité. Il va bien falloir dire à un moment – c’est d’ailleurs le sens du travail engagé avec la PPE – quel sera le niveau de la puissance nucléaire installée à l’horizon de 2023, ce qui témoignera du caractère inéluctable de cette transition énergétique. Cela restera, j’en suis convaincu, l’une des grandes œuvres de ce quinquennat.

Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, en nouvelle lecture du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, il nous faut évidemment encore apporter des améliorations au texte, éclairer les points de vue des uns et des autres et enrichir les dispositions qui restent en débat. Nous voulons aussi réaffirmer des oppositions fondamentales qui ne sont pas des postures, mais sont des alertes sur les dérives d’un système énergétique libéralisé.
Le temps du débat parlementaire ne peut être le temps médiatique. Il n’est pas anormal que la corédaction de projets de loi toujours plus techniques et volumineux prenne de nombreux mois. Je souhaite, madame la ministre, réaffirmer que notre groupe partage les objectifs affichés par votre projet de loi.
Bien sûr, il faut engager notre pays dans la transition énergétique, promouvoir des transports propres, l’économie circulaire, la rénovation énergétique des bâtiments, le déploiement d’énergies renouvelables, décarbonnées. Bien sûr, il faut encourager les comportements vertueux afin d’engager notre pays dans une lutte efficace et résolue contre le réchauffement climatique, poser les bases d’une nouvelle croissance plus économe en énergie ; cela ne fait aucun doute pour les sénatrices et sénateurs du groupe CRC, qui soutiennent une transition énergétique raisonnée et raisonnable. Nous affirmons même, comme d’autres, que c’est une question de survie pour l’humanité et pour la planète.
Si la France a aujourd’hui une électricité parmi les moins chères d’Europe, il faut s’en féliciter et non utiliser cet argument pour légitimer des hausses du tarif du kilowattheure. Si la France a une énergie compétitive, c’est bien grâce aux choix fait à la Libération, avec la maîtrise publique de la production nucléaire dont il y aurait grand danger à sortir sans précaution. À cet égard, pour nous, l’Allemagne n’est pas un modèle, avec sa pollution record due au lignite.
Cela me conduit à une remarque sur l’éolien. Les évolutions législatives se sont multipliées pour en permettre le développement : il nous est proposé, dans ce projet de loi, de ramener à 500 mètres la distance minimale entre les éoliennes et les zones urbanisées. Bref, nous allons vers un mitage anarchique du territoire. C’est pourquoi nous avons déposé un amendement tendant à porter la distance à 1 000 mètres.
Nos autres d’amendements concernent la réponse aux besoins de nos concitoyens, avec la garantie du maintien des tarifs réglementés pour l’électricité et le gaz, une fixation des prix de vente par l’État, des dispositions concrètes contre la précarité énergétique douze mois sur douze. Par ailleurs, il nous semble important d’afficher la nécessité d’une maîtrise publique du secteur de l’énergie. Nous avions déjà mis en avant la nécessité d’une définition d’une planification énergétique nationale et européenne, qui flèche les moyens financiers alloués par l’État pour chacun des objectifs et chacune des actions de la politique de transition énergétique autour d’un pôle public de l’énergie incluant EDF, GDF, Areva et Total renationalisés. Nous persistons dans ces choix.
C’est ce qui nous conduit à dénoncer encore une fois la création d’un marché spéculatif, celui de l’effacement diffus en lieu et place d’un service public de l’effacement.
Nous reviendrons évidemment sur les concessions hydrauliques et sur l’ouverture à la concurrence. Comme le rappellent justement nos collègues de l’Assemblée nationale, les barrages représentent 2, 5 millions d’euros d’excédents chaque année et ce qu’on appelle la « rente hydraulique » représente plus de 1 milliard d’euros. La logique de privatisation, sous quelque habillage que ce soit, risque d’entraîner une augmentation des tarifs de l’électricité.
L’acharnement à privatiser est d’autant plus grave que vous reproduisez ce faisant un schéma que nous avons déjà expérimenté lors de la privatisation des concessions autoroutières ou avec les privatisations d’aéroports : ayons en tête le scandale en cours de l’aéroport de Toulouse.
Plus largement, il faut rappeler que le transport routier est l’une des premières sources de pollution, quoi qu’en pense M. Macron, qui a fait le choix de généraliser le transport par autocar. Pour en rester au texte, nous n’y trouvons aucune véritable mesure pour limiter la circulation des véhicules. Le projet de loi, en particulier, n’aborde pas la généralisation du fret ferroviaire ou le développement du transport fluvial, sujets sur lesquels ma collègue Évelyne Didier a déposé des amendements.
Nous l’avons dit en première lecture, le projet de loi porte en germe un modèle de territorialisation rampante de l’énergie, une mise en concurrence entre les territoires à travers la régionalisation de la production et de la distribution : c’est la péréquation et l’égalité de traitement à l’échelle de l’ensemble du territoire national qui sont mises en danger.
Nous nous interrogeons également sur les moyens financiers pour soutenir les ambitions de votre projet puisque 10 milliards d’euros sont prévus sur trois ans alors que les besoins en investissement sont estimés à 14 milliards d’euros par an, voire à plus de 20 milliards d’euros par l’ADEME. Le compte n’y est pas ! L’économie participative et l’initiative privée ne pourront pas combler ce manque à gagner !
Enfin, un autre grand sujet est le bâtiment. L’objectif est d’atteindre en 2017 le rythme de 500 000 logements rénovés par an. C’est souhaitable, très ambitieux, mais là encore avec quels moyens ?
Pour les membres du groupe CRC, l’État stratège doit se donner les moyens de ses ambitions et soutenir les collectivités locales qui auront la mission de décliner sur l’ensemble du territoire les objectifs de la transition énergétique. Or ces moyens font défaut. Néanmoins, nous partageons les objectifs que le Gouvernement se fixe.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

M. Jean-Claude Requier. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, j’interviens en lieu et place de M. Mézard. Je suis donc une énergie de remplacement, sinon de substitution.
Sourires.

Nous examinons une dernière fois l’un des principaux projets de loi du quinquennat, fortement enrichi par des avancées introduites en première lecture par le Sénat et maintenues, pour certaines, par l’Assemblée nationale. Comme d’autres avant moi, je tiens à saluer le travail des deux assemblées, qui nous a permis de converger sur un certain nombre de points, même si je regrette que le « temps de la réflexion » ait été perturbé par l’engagement de la procédure accélérée et les conditions d’examen du présent projet de loi en nouvelle lecture, sectionné sur deux semaines et amputé cet après-midi par la discussion de deux projets de loi.
Nous partageons la volonté de diversifier notre mix énergétique, d’y faire progresser la part des énergies renouvelables, de rénover les bâtiments pour en améliorer la performance énergétique ou encore de développer des modes de transports propres. Nous partageons aussi la plupart des objectifs du projet de loi, à commencer par la réduction des émissions de gaz à effet de serre en dépit de divergences d’appréciation, essentiellement sur le nucléaire.
La nécessité de prendre en considération, dans le secteur agricole, le faible potentiel d’atténuation des émissions de méthane entérique produites par les ruminants est désormais unanime, …

… et nous nous en réjouissons.
Si les objectifs sont in fine les mêmes, les moyens d’y parvenir feront toujours l’objet d’intenses débats, de prises de position tout à fait respectables et respectées. Leur expression est saine en démocratie, où la représentativité de tous les intérêts doit concourir à l’intérêt général, bien qu’en l’espèce nous n’ayons pas pu transcender nos clivages.
Comme vous ne l’ignorez pas, le groupe auquel j’appartiens reste profondément attaché à l’énergie nucléaire : sans elle, la France ne serait pas une puissance énergétique indépendante, elle pâtirait d’une baisse de compétitivité bien plus grave et le pouvoir d’achat des ménages serait fortement grevé. C’est pourquoi nous confirmerons notre soutien au compromis adopté par la Haute Assemblée visant à réduire à 50 % la part du nucléaire dans la production électrique française à terme et évitant de fixer une date incantatoire et irréaliste. La responsabilité politique qui est la nôtre nous impose un discours de vérité et le vote de dispositions tenant compte du réel.
Certes, la situation peut évoluer dans dix ans avec la maturation des filières d’énergies renouvelables ou la simplification du cadre juridique. Toutefois, des obstacles tels que la nécessité de développer les moyens de stockage de l’énergie ou la réalisation des réseaux intelligents rendent quelque peu illusoire l’échéance de 2025. Il convient également de tenir compte des coûts financiers et environnementaux d’une transition précipitée par la fermeture des centrales nucléaires. S’il convient de fixer une stratégie énergétique nationale avec des objectifs, ces derniers doivent être atteignables pour être pris au sérieux.
En ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, l’insertion de toute une série d’articles additionnels au sein du chapitre portant sur la simplification des procédures est d’autant plus contestable qu’il s’agit, en réalité, de mesures qui complexifient paradoxalement le droit en vigueur, contrairement à l’esprit du présent projet de loi. Ces nouvelles dispositions visant les éoliennes terrestres constituent autant de mauvais signaux qui ne feront que raviver la crainte des investisseurs et engendrer de nouvelles brèches dans lesquelles se glisseront certaines associations représentant des intérêts particuliers dans un domaine où les recours abusifs sont légion. Elles vont à l’encontre du processus de modernisation du droit de l’environnement, de l’expérimentation de l’autorisation environnementale unique et du certificat de projet. Pourtant, le projet de loi allait dans le bon sens en introduisant, par exemple, le financement participatif et en renforçant ainsi l’acceptabilité des projets d’installations de production d’énergies renouvelables. Aussi, comme en première lecture, nous avons déposé des amendements dans un objectif de simplification, qui doit véritablement constituer un impératif catégorique.
En matière de mobilité durable, il est regrettable que l’hydrogène n’ait pas eu la place qui devrait être la sienne au sein de ce projet de loi qui ne garantit pas, à notre sens, la neutralité technologique en mettant uniquement en avant les véhicules électriques à batterie, avec notamment le déploiement de sept millions de bornes de recharge. Or l’hydrogène est intéressant sur le plan de l’autonomie des batteries et éviterait à nombre de nos concitoyens de faire plusieurs arrêts contraignants et rédhibitoires sur une longue distance afin de recharger leur véhicule. Les constructeurs japonais, allemands ou américains l’ont bien compris. C’est finalement à l’étranger que nos entreprises investissent, je pense en particulier à Total en matière de stations-service hydrogène.
On ne peut pas se contenter de la remise d’un rapport sur l’élaboration d’un plan de développement du stockage des énergies renouvelables par hydrogène décarboné prévu par l’article 28 bis. Je crains que nous n’ayons un jour à regretter ce non-choix de l’hydrogène, alors qu’on exploite depuis maintenant deux ans des émanations naturelles d’hydrogène.
Enfin, comme en première lecture, nous espérons que la fiscalité écologique sera à l’honneur lors de l’examen du prochain projet de loi de finances. Il convient cependant d’être vigilant pour que la valeur cible de la tonne carbone, adoptée par la commission des affaires économiques du Sénat en nouvelle lecture, ne se traduise pas par une fiscalité supplémentaire pesant notamment sur les ménages les plus modestes.
Madame la ministre, qu’est devenue la grande réforme fiscale promise par le Gouvernement ? Une remise à plat s’impose sous peine d’accentuer la crise de légitimité de l’impôt.
Pour conclure, mes chers collègues, j’indique que le groupe du RDSE, favorable à la transition énergétique, qu’il conçoit comme un passage progressif – j’insiste sur cet adjectif – de notre modèle actuel de production d’énergie centralisé et limité vers un modèle moins émetteur de gaz à effet de serre, décentralisé et interconnecté, et s’appuyant sur la force et l’excellence de sa filière nucléaire, prendra une nouvelle fois toute sa part dans la discussion qui s’ouvre devant la Haute Assemblée.
Applaudissements sur plusieurs travées du groupe socialiste et républicain, de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je suis toujours très partagée sur les discours qui suivent les commissions mixtes paritaires. Aujourd’hui, c’est une certaine déception qui nous réunit.
Nous sommes déçus par l’échec de la CMP et déçus de ne pas avoir retrouvé le consensus du Grenelle de l’environnement.
Nous sommes déçus, car les oppositions ne sont bien souvent que politiques. Si le Gouvernement n’avait pas eu besoin d’un accord avec Europe Écologie les Verts, je suis à peu près certaine que nous aurions trouvé un accord sur la date à laquelle la part du nucléaire doit être réduite à 50 %.

En réalité, ce n’est qu’une partie de la droite qui est opposée à une partie de la gauche. Cette date de 2025, nous savons à peu près tous qu’elle est une illusion.

Jamais en 2025, la part du nucléaire ne sera réduite à 50 %. C’est impossible techniquement, en tout cas sans augmenter à court terme les émissions de gaz à effet de serre.

À l’UDI, nous sommes favorables à la réduction de la part du nucléaire à 50 % dans le mix énergétique. Nous avions d’ailleurs déposé une proposition de résolution sur ce sujet voilà environ un an. Nous avions proposé la date de 2040, qui nous semblait plus raisonnable. Nous étions cependant tout à fait prêts à en discuter, car cela ne doit pas constituer un point de blocage au consensus. Malheureusement, c’en est un aujourd’hui.
Nous sommes donc de nouveau réunis. Je ne doute pas que des corrections seront apportées, mais je pense que ce texte ne sera pas à la hauteur du débat ni en tout cas des enjeux.
Les rapports, qui sont toujours plus inquiétants et plus consensuels, se multiplient sur l’impact des changements climatiques. Ainsi, les dix pays les plus pauvres de la planète seront les plus touchés par les dérèglements climatiques. Ce sera aussi le cas de notre grand voisin l’Afrique. Des millions de personnes seront contraintes de migrer, les fameux « déplacés environnementaux », qui aujourd’hui n’ont aucun statut. Les rendements agricoles vont baisser de 25 %, alors même qu’ils devraient augmenter de 60 % d’ici à 2050 si nous voulons faire face à l’augmentation des besoins de la population. Inégalités accrues, crise alimentaire mondiale et frein à la croissance : ces quelques mots devraient parler aux oreilles des sceptiques, et il s’en trouve encore.
Mais laissons les sceptiques de côté, dont certains sont à mon avis indécrottables, et parlons plus aux modérés, aux raisonnables, à ceux qui plaident la mesure. Ce sont, par exemple, ceux qui, bien que pas trop défavorables aux éoliennes, disent que l’on pourrait revoir les distances.
Si vous vous intéressez un peu à l’histoire de notre planète, qui est passionnante, car les choses se répètent, vous devriez savoir que la troisième grande crise d’extinction, la plus importante, a vu 96 % de toutes les formes de vie disparaître de la planète. Il ne restait donc presque plus rien et il a fallu dix millions d’années pour que réapparaisse l’état de diversité originelle. Cette grande crise était corrélée à une forte hausse des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, tout particulièrement du méthane, en raison de la fonte du permafrost.
Nous sommes sur une trajectoire à peu près comparable. Ce qui est très étonnant, c’est que nous ne changions pas de trajectoire. La consommation d’énergies fossiles va augmenter de presque 40 % d’ici à 2040.

Nous ne nous inscrivons nullement dans la perspective d’un développement des énergies, notamment renouvelables, à l’échelle mondiale, qui est pourtant nécessaire. Et pourquoi une hausse des énergies fossiles ? Parce qu’elles sont dans le monde cinq fois plus subventionnées que les énergies renouvelables.
On dit que l’écologie doit être raisonnable, qu’elle ne doit pas faire peur, qu’elle ne doit pas être « punitive ». Pourtant, quand on tape « écologie » sur Google, « punitive » est le premier terme qui apparaît. Quel beau succès… Il me semble pourtant que ce qui est punitif, c’est l’absence d’écologie, qui est une grande source d’inégalités, un frein à la croissance. Ce qui est punitif, c’est de plaider la mesure pour laisser la facture à nos enfants. C’est d’ailleurs ce que bon nombre de politiques font depuis des années.
Je comprends tout à fait les craintes. La peur du changement est toujours plus forte que les habitudes, même si elles sont délétères. Mais il ne s’agit pas, en réalité, d’un changement si profond. Il faut simplement revenir à ce qui a fait la richesse de nos civilisations : le primat des valeurs spirituelles sur celui de l’accumulation des richesses matérielles et d’habitudes ultra-consuméristes qui caractérisent notre époque. C’est d’ailleurs le message de la dernière encyclique, qui a été citée par Louis Nègre, comme celui de la plupart des grandes religions. Il n’y aura pas de changement sans spiritualité. Il n’y aura pas de grande transition sans remise à plat de nos valeurs, tout particulièrement notre conception du PIB, notre modèle économique, donc notre système fiscal.
Si nous voulons réellement nous engager dans une transition énergétique ou écologique, la première de nos priorités devrait être de mettre fin progressivement à toutes les formes de subventions aux énergies fossiles. Le projet de loi ne le fait pas.
Notre deuxième priorité devrait être de taxer le carbone, comme nous y incite la Banque mondiale, et de le faire de manière progressive selon une pente qui soit clairement affichée. C’est ce qui est fait dans le projet de loi, mais grâce uniquement au vote de la commission des affaires économiques, qui a effectivement fixé une pente à la contribution carbone. J’espère, cher Ronan Dantec, que le consensus trouvé au Sénat va perdurer à l’Assemblée nationale, car ce serait un message extrêmement positif.
Notre troisième priorité devrait être de taxer fortement les pollutions, ce que le texte ne fait pas non plus.
Notre quatrième priorité, parce que nous sommes décentralisateurs au sein de notre parti, devrait être de laisser une réelle liberté aux collectivités d’expérimenter, de développer leurs propres formes d’initiative – c’est ce qui nous différencie –, notamment énergétiques, ce que, là non plus, le texte ne fait pas. Il y a donc un certain cynisme à survendre ce projet de loi.
Cette dernière discussion sera certainement utile, des corrections seront apportées. Les débats au Sénat sont d’ailleurs souvent très riches et passionnants, car nous avons des présidents et des rapporteurs excellents, …

… et aucun de nous n’aime la caricature.
Le projet de loi aura amélioré certaines dispositions techniques, je n’en doute pas, mais je n’y vois ni rupture ni grande transition. Je n’y vois surtout, même si elles sont nécessaires, que de simples adaptations. Notre groupe reste donc très ouvert à la discussion, mais sans excès d’illusions ni d’enthousiasme.
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.

Nous étions en effet tous convaincus que la classe politique se retrouverait sur les objectifs et même les ambitions, quelle que soit la personne qui les aurait portés, affichés par le projet de loi. Naguère, la gauche, minoritaire, a apporté sa voix à des textes…

… qui, d’une façon très forte, ont confirmé l’engagement de notre pays sur la voie de la protection de notre planète et de notre environnement. De la même manière, beaucoup parmi nous ont apporté leur pierre à l’édifice de ce texte annoncé par le Président de la République, adopté en conseil des ministres et qui s’annonçait très consensuel.
Madame la ministre, lors du débat au Sénat, vous n’avez pas hésité, nous l’avons constaté, à convaincre les vôtres, c’est-à-dire les membres de l’opposition, à retenir leur élan de voter contre des dispositions que nous proposions. Je me souviens également que le président du groupe socialiste a participé à la recherche d’un consensus au Sénat. Nous avons en outre été marqués par l’abstention du groupe socialiste sur des points forts du texte.

… et, surtout, que le pragmatisme primerait, d’autant que ce texte, déjà très riche, a été étoffé par les apports de l’Assemblée nationale, que le Sénat a confirmés, et par ceux du Sénat, que l’Assemblée nationale a validés.
Nous aurions pu aboutir à un texte qui aurait été porté par l’ensemble de la classe politique. Il aurait d’ailleurs été bon que le Gouvernement et le Président de la République du pays qui accueille la COP 21, c'est-à-dire la conférence climat de décembre prochain, puissent afficher le consensus de leur classe politique sur de tels objectifs. Tout cela s’est effondré en raison de petits calculs politiciens…

… et électoraux : les socialistes n’ont pas voulu rompre avec les écologistes à un moment sensible – j’en conviens –, quelques jours avant les élections départementales.

Or nous avons été confrontés à la position brutale et intransigeante du président de la commission mixte paritaire, par ailleurs président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Celui-ci nous a annoncé qu’il ne pouvait pas suivre notre orientation, car le Président de la République avait pris des engagements qu’il entendait suivre.

Quid de la séparation des pouvoirs ? Êtes-vous vraiment, mes chers collègues, tenus de mettre un mouchoir sur vos propres convictions, que nous connaissons bien ?

Les protestations du président du groupe socialiste confirment que j’ai mis le doigt là où ça fait mal.
Il y avait – dois-je le rappeler ? – une majorité à la commission mixte paritaire pour approuver les dispositions du Sénat.

Si nous avions procédé au vote, la commission mixte paritaire aurait adopté des conclusions et un texte commun aurait pu être présenté à l'Assemblée nationale et au Sénat. Pourtant, au dernier moment, le président de la commission mixte paritaire s’est levé…

… en affirmant qu’il n’y avait pas d’accord possible et a refusé le vote. C'est un véritable coup de force auquel nous avons assisté.

Je pense d’ailleurs, et je le dis très sérieusement, que nous donnerons une suite à cette affaire, car, du point de vue institutionnel, nous ne pouvons pas accepter que la réunion d’une commission mixte paritaire ne se conclue pas par un vote.
Cela étant, et je m’en tiendrai à cette observation, le débat auquel nous assistons révèle une chose : les écologistes participent à une manœuvre d’acharnement contre le mot « nucléaire ».
Il faut rappeler les chiffres de la consommation d’énergie finale en France : le pétrole représente à peu près 45 %, le gaz 30 % et l’électricité à peine 25 %, au sein de laquelle – puisqu’il y a également des sources carbonées et de l’hydraulique – le nucléaire représente 16 %. On assiste donc à une chose incroyable, à un blocage politique lourd de conséquences dans le seul but de plaire aux écologistes, simplement parce que 16 % de l’énergie finale consommée en France provient des centrales nucléaires !
Mes chers collègues, je vous invite à vous intéresser aux trois quarts de l’énergie consommée qui provient de sources carbonées. Nos collègues écologistes et ceux qui, dans ces quelques parenthèses de la vie parlementaire, apportent leur soutien à ces thèses souvent utopistes et très éloignées du pragmatisme, ne pourraient-ils pas, enfin, s’attacher à examiner la façon de sauver la planète en réduisant la part d’énergie carbonée consommée ?

Aujourd'hui, nous ne sommes sans doute pas les meilleurs élèves au monde, mais nous faisons malgré tout partie, grâce au nucléaire, des pays qui sont les plus protecteurs de l’environnement.

M. Jean-Claude Lenoir. Notre débat nous permettra d’approfondir ce sujet.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l’importance du texte n’est plus à démontrer au regard des enjeux qu’il pose et de la richesse des débats dans nos deux hémicycles.
Quel est le bilan de ces débats ? Sur l’ensemble du texte, ce sont 82 articles qui ont été adoptés conformes par l’Assemblée nationale et une trentaine d’entre eux qui ont été modifiés à la marge. Seule une soixantaine d’articles a fait l’objet d’une modification sensible à la suite de l’examen par les députés.
Permettez-moi d’orienter mon intervention sur le titre IV, qui vise à lutter contre le gaspillage et à promouvoir l’économie circulaire, de la conception des produits à leur recyclage.
Sur les 36 articles que comporte ce titre, 16 ont été adoptés conformes. Nous pouvons nous féliciter tant du travail accompli par le Parlement que de la qualité de nos débats. Cette coconstruction a permis d’enrichir le projet de loi initial dans le respect des positions de chacune des deux assemblées. Au Sénat, nous pouvons être fiers de l’adoption de nombreux amendements qui renforcent les dispositifs initiaux. Cela démontre une volonté forte des sénateurs de participer à l’écriture d’une nouvelle page, celle de la transition écologique de la France, comme vous nous y invitez, madame la ministre.
Je souhaite rappeler ici ces quelques mesures adoptées par notre assemblée : la réduction de 50 % des quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché ; la généralisation à l’échéance de 2022 de l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages en plastique, ce qui obligera les collectivités territoriales à se soumettre à un seuil minimal de 25 % de papier recyclé à compter de 2017 et de 40 % en 2020 ; l’ouverture de la possibilité de mettre en place une tarification incitative de deuxième niveau pour récompenser les collectivités volontaires en matière de déchets.
Nos collègues de l’Assemblée nationale se sont, eux aussi, inscrits dans cette perspective lorsqu’ils ont examiné le projet de loi en nouvelle lecture. Des mesures nouvelles ont ainsi été intégrées, parmi lesquelles on peut citer : l’introduction d’une expérimentation d’affichage de la durée de vie pour certains produits définis par décret ; l’intégration de l’« écologie industrielle et territoriale » au sein des concepts généraux dont le développement doit être assuré par les politiques publiques ; celle de commande publique durable dans les objectifs de l’économie circulaire ; enfin, l’inclusion de la lutte contre le gaspillage dans les nouvelles missions confiées à l’ADEME.
En matière de réduction de la consommation de matières premières, les députés ont défini un objectif chiffré de découplage entre croissance économique et consommation de matières premières, à hauteur de 30 % entre 2010 et 2030. Ils ont également prévu l’interdiction de l’utilisation des emballages en plastique non biodégradables et non compostables en compostage domestique pour l’envoi de la presse et de la publicité.
Des amendements adoptés à l'Assemblée nationale sont venus préciser le dispositif visant à obliger les opérateurs de gestion de déchets à passer un contrat avec les éco-organismes pour pouvoir traiter les DEEE.
Les députés ont aussi décidé de réduire la consommation de papier de l’État et des collectivités, avec un objectif affiché de 30 %, de déléguer les missions de l’ADEME à une personne morale indépendante, impartiale et objective, et de mettre en place une contribution annuelle à la filière REP des navires de plaisance, laquelle serait fixée chaque année dans la loi de finances.
Madame la ministre, vous avez porté les REP sur les fonts baptismaux avec la loi de 1992. Aujourd'hui, il en existe de nombreuses qui font l’originalité du système français et sa performance. Les REP doivent nous permettre d’aller encore plus loin. En effet, sur les 34 millions de tonnes de déchets collectés, seuls 10 millions contribuent aux divers éco-organismes : 5 millions de tonnes d’emballages, 2 millions de tonnes de papier, 1 million de tonnes de textile et 2 millions de tonnes de DEEE. C'est la raison pour laquelle je préconise souvent d’élargir le champ des REP aux assimilés.
Pouvons-nous encore enrichir ce texte ? Je le crois. En effet, si certains articles doivent faire l’objet de précisions rédactionnelles, d’autres peuvent nous permettre d’éclaircir certaines incompréhensions ou interprétations. Je limiterai, là aussi, mon propos au titre IV.
Concernant l’interdiction des ustensiles en plastique jetables, les députés veulent maintenir l’interdiction des gobelets, verres et assiettes jetables, alors que, au Sénat, nous avions souhaité la mise en place obligatoire en 2018 d’un tri à la source, qui nous paraissait beaucoup plus efficace.
S’agissant de l’interdiction des sacs en plastique de caisse, nous sommes favorables à la possibilité de continuer à autoriser ces sacs compostables en matières biosourcées, à la différence des députés qui y sont opposés.
Sur l’épineux sujet de la limitation des installations de tri mécano-biologique, devons-nous condamner toutes les initiatives locales ou pouvons-nous encourager certains dispositifs perfectibles ? Le traitement de la part résiduelle appelle des réponses différentes en fonction des zones géographiques et de la densité de la population. Il ne faut pas opposer un système à un autre. Au contraire, ils sont souvent complémentaires. Ne nous débarrassons pas du tri mécano-biologique quand nous avons la preuve, sur certains territoires, de son efficacité.

De plus, il permet de récupérer les plastiques et les métaux. À terme, ces installations devront évoluer, comme beaucoup d’autres, pour traiter une part d’OMR et les résidus de tri et pour préparer les combustibles solides de récupération. Tous les systèmes de méthanisation avec récupération de l’énergie peuvent être, dans certains cas, intéressants.
Concernant l’obsolescence programmée, quelle définition devons-nous retenir pour enclencher une prise de conscience collective ? Méfions-nous des solutions qui, sous prétexte de rentabilité, « cassent » l’emploi et qui, à terme, se révéleront plus coûteuses, présenteront un bilan carbone bien moins avantageux et sont contraires à la notion d’économie circulaire. Tenons compte des installations existantes en les faisant évoluer. Simplifions et harmonisons les messages pour donner plus de lisibilité à nos concitoyens. Organisons-nous à l’échelle pertinente, laquelle peut varier en fonction des territoires.
Pour réussir la mise en œuvre de cette loi ambitieuse, il faut une volonté politique. Les résultats obtenus dans certaines grandes villes du monde en ont fait l’éclatante démonstration. Madame la ministre, vous incarnez cette volonté politique. Les sénateurs sauront, j’en suis sûr, la déployer dans tous nos territoires.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous nous apprêtons à relever un défi de taille, celui de la transition énergétique, qui pourrait bien être l’une des étapes marquantes de notre histoire. La France a les cartes en main pour le relever : de formidables richesses renouvelables, un capital humain hautement qualifié et des entreprises innovantes. Toutefois, la transition énergétique sera synonyme de croissance uniquement si nous avons la sagesse de la rendre supportable pour les familles, les entreprises, la société tout entière et si nous faisons le pari de la réussir sans nous retrancher derrière des objectifs chiffrés et des injonctions inopérantes sur le plan économique, social et environnemental.
Dans cette perspective, je suis convaincu de la nécessité de ne pas adopter une posture prescriptive et de ne pas imposer des changements brutaux à nos modes de production et de consommation. Le propre de l’histoire de l’humanité est que l’amélioration des techniques de production s’est toujours opérée de manière continue, au fil des connaissances scientifiques.
J’axerai de nouveau mon propos sur la nécessité de croiser l’ambition environnementale à la préservation de la compétitivité de nos entreprises, à la nécessaire reconquête industrielle, à la préservation de notre modèle social, à la richesse et la diversité territoriale de notre pays.
À la lecture de votre projet de loi, madame la ministre, je m’interroge sur au moins quatre points.
En premier lieu, je veux à nouveau mettre en garde contre les objectifs chiffrés, assignés à l’article 1er, de notre politique énergétique, à savoir notamment « poursuivre un objectif de réduction de la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à l’année de référence 2012 ». Cette disposition poursuit un objectif de décroissance qui place notre économie et nos entreprises dans une situation dangereuse de distorsion de concurrence. Je rappelle que, en trente ans, le PIB provenant de l’activité industrielle est passé de 30 % à 19 %. Nous ne retrouverons le plein-emploi que si l’activité industrielle redémarre en France, ce qui implique que la consommation énergétique reparte à la hausse.
En deuxième lieu, je déplore l’amoncellement de nouvelles contraintes administratives que recouvre ce texte pour les entreprises et les ménages, à l’inverse des engagements pris pour les diminuer et rendre plus lisible l’action publique. Ainsi, le projet de loi appelle une traduction dans près de 100 mesures réglementaires, dont près de 50 sont des décrets en Conseil d’État. Il prévoit par ailleurs une demi-douzaine d’instances nouvelles. On ne peut pas continuer à négliger la simplification administrative de la France !
Le projet de loi n’apporte pas non plus de réponses satisfaisantes en matière de logement et de transport, deux postes qui grèvent encore trop souvent le budget des ménages.
En ce qui concerne le logement – c’est mon troisième point –, le fait de rendre les rénovations énergétiques obligatoires en cas de travaux risquerait dans un premier temps d’alourdir la facture pour les ménages et non de la faire baisser. L’article 3 C introduisait cette disposition en prévoyant que « les bâtiments privés résidentiels doivent faire l’objet d’une rénovation énergétique à l’occasion d’une mutation ». Je me réjouis donc de la position de notre rapporteur et de son travail, qui a permis de supprimer cet article en commission des affaires économiques.
De même, je me félicite de l’adoption de l’amendement de M. le rapporteur à l’article 4, qui a rétabli la possibilité pour les personnes morales de droit public de faire construire des bâtiments à énergie positive ou à haute performance environnementale, alors que l’Assemblée nationale voulait cumuler les deux obligations.
Le texte multiplie par ailleurs les dispositifs visant à faciliter les rénovations énergétiques via un fonds de garantie de la rénovation énergétique mais n’assure aucune cohérence ni aucune visibilité par rapport aux dispositifs existants. Sur ce point, les amendements proposés par la commission des affaires économiques me semblent pertinents, puisqu’ils instaurent plus de liberté dans le choix du type d’isolation lors de travaux de rénovation sur des bâtiments.
J’en arrive à mon quatrième point : même constat à propos des transports, peu de mesures concrètes !
On a trop facilement tendance à rejeter la voiture. Faisons confiance aux constructeurs, faisons confiance à l’innovation, et je suis persuadé que nous aurons, demain, des véhicules propres qui permettront à la population de se déplacer ! En effet, n’oubliez pas, madame la ministre, que, pour une grande partie de nos concitoyens, il n’existe pas de transports en commun pour aller travailler, étudier, se soigner ou pour tout autre déplacement. La voiture est donc absolument indispensable ; aussi, faisons confiance au progrès et donnons à la recherche les moyens nécessaires !
À la lecture de ces quatre points, un constat ressort : les mesures proposées pour amorcer la transition énergétique risquent de s’appliquer trop souvent au détriment de la compétitivité des entreprises et du pouvoir d’achat des ménages. Or notre ambition en matière de transition énergétique doit s’articuler avec notre volonté en matière économique, notre conception du rôle de la France au sein de l’Union européenne et dans le monde et notre ambition sociale. Je ne pourrai donc voter le projet de loi que si nous avons la sagesse de rendre supportable cette transition énergétique pour notre économie, notre société et les Français.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur certaines travées de l’UDI-UC.

Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, le projet de loi relatif à la transition énergétique que nous examinons souffre des deux faiblesses qui caractérisent une bonne partie de la production législative depuis trois ans. D’une part, l’idéologie occupe une place prépondérante au détriment des faits ; or chacun sait que les faits sont têtus :…

… le sort réservé à l’énergie nucléaire dans le projet de loi en est une parfaite illustration. D’autre part, le texte se perd dans mille et un détails, qui se traduiront par autant de tracas pour nos concitoyens, au moment où il faudrait obtenir leur adhésion et mobiliser leur énergie pour faire face à la dette, au chômage et à l’insécurité.
Première faiblesse : l’idéologie et même le calcul politique. En effet, le projet de loi vise à plafonner puis à diminuer rapidement la part du nucléaire dans la production d’électricité. Il s’agit ainsi de tenir une promesse de la campagne présidentielle de 2012 et de ne pas donner prétexte à une candidature écologiste à la présidentielle de 2017.

Or diminuer la production nucléaire n’est pas conforme à l’intérêt de la France. En effet, cette production électrique est la moins chère d’Europe, à raison de 54, 40 euros par mégawatts, selon la Cour des comptes. Cela donne donc un avantage compétitif aux entreprises établies en France, et c’est bien le seul que l’État leur donne actuellement.
Ainsi, plafonner puis diminuer la part du nucléaire dans la production électrique supprimerait des milliers d’emplois dans chaque territoire concerné par l’arrêt des réacteurs. Ce serait le cas en premier lieu en Alsace, avec la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Rien ne justifiant, du point de vue de la sûreté, cette fermeture, l’Alsace n’acceptera pas que sa centrale nucléaire soit sacrifiée sur l’autel de l’élection présidentielle de 2017 !
Seconde faiblesse : le projet de loi se perd dans les détails et prétend modifier les modes de vie de nos concitoyens. Ce n’est pas la première fois qu’il en est ainsi, mais, cette fois, on va plus loin dans la vie quotidienne des Français en mettant leur patrimoine dans le viseur. On rappelle que le logement a déjà été mis à mal par la loi Duflot, au point que le Gouvernement a neutralisé ses dispositions les plus négatives avec la loi Macron.
C’est donc avec la foi du charbonnier que le projet de loi prévoit, après son examen par l’Assemblée nationale, trois dispositions nouvelles.
Premièrement, son article 5 dispose que, avec effet quasiment immédiat, tous les travaux de rénovation, tels que ravalement de façade ou réfection de la toiture, devront être l’occasion de travaux d’efficacité énergétique pour atteindre les objectifs de la politique énergétique nationale.
Deuxièmement, son article 3 B précise que tous les bâtiments privés résidentiels ayant une consommation en énergie primaire supérieure à 330 kilowattheures par mètre carré et par an doivent subir une rénovation énergétique avant 2025, c’est-à-dire dans les dix ans.
Troisièmement, son article 3 C prévoit que, à partir de 2030, les bâtiments privés résidentiels devront faire l’objet d’une rénovation énergétique à l’occasion d’une mutation.
Il est vrai que les bâtiments privés et publics occupent une part prépondérante dans la consommation nationale d’énergie. C’est d’ailleurs pourquoi les économies d’énergie sont fiscalement encouragées depuis des années et la réglementation thermique 2012, la norme RT 2012, s’applique à toutes les constructions nouvelles.
On peut évidemment considérer que l’effort doit être amplifié, mais encore faut-il raison garder : les dispositions mentionnées ci-dessus concernent des millions de logements. En conséquence, aucune des dates butoir qui seront votées ne pourra être tenue. Aucune ! Il faudrait abandonner la mauvaise habitude de fixer des dates dans la loi en sachant qu’on ne pourra pas les respecter. Cela a ainsi été le cas pour la suppression des décharges publiques, pour l’assainissement de nos villes et villages ou encore pour l’accessibilité des bâtiments. Cette façon de faire affaiblit la loi dès son adoption.
De plus, les finances de l’État étant ce qu’elles sont, les incitations à atteindre les objectifs légalement fixés iront en diminuant, de sorte que l’effort d’investissement demandé aux propriétaires et, par ricochet, aux locataires sera nettement au-dessus des capacités de la majorité d’entre eux. Toutes ces obligations seront approuvées par les bobos, mais elles angoisseront les petits propriétaires qui seront souvent acculés à la vente.
Le projet de loi s’immisce par ailleurs trop dans la vie quotidienne des Français. J’en veux pour preuve l’article 19 bis, tel que voté par l’Assemblée nationale, qui prévoit l’interdiction pure et simple de tous les sacs de caisse, même biodégradables. J’en veux encore pour preuve la valse-hésitation entre l’Assemblée nationale et le Sénat sur les couverts en plastique, si pratiques pour nos milliers d’associations de bénévoles qui organisent des manifestations festives.
Ainsi, avant de multiplier les interdits en tout genre au nom des bonnes causes successives du Gouvernement, il serait judicieux de méditer les résultats d’un récent sondage de l’Institut Viavoice en partenariat avec La Revue Civique. Ce sondage indique clairement qu’un point de rupture a été atteint en matière d’interdits en tout genre et que les Français sont exaspérés par les restrictions de leurs libertés. Cette exaspération se trouve en particulier chez les plus modestes, face à des messages à sens unique de la France d’en haut vers celle d’en bas.
Face à un projet de loi qui présente les faiblesses que je viens d’énoncer, le travail de nos commissions et de nos rapporteurs pour son amélioration est méritoire, et je le salue. Espérons que ce travail permettra d’aboutir in fine à un texte plus équilibré et plus réaliste, c'est-à-dire entraînant l’adhésion des Français, indispensable pour la réussite de la transition énergétique de notre pays.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur certaines travées de l’UDI-UC.
Je tiens à tous vous remercier, mesdames, messieurs les sénateurs. Vos interventions ont soit témoigné d’un soutien sans faille – notamment de la part du groupe socialiste et républicain –, soit porté un discours constructif, ce qui reflète bien l’état d’esprit du Gouvernement et le mien dans le cadre de ce dialogue avec le Sénat. Votre contribution, votre créativité et votre imagination nous permettront de concevoir ensemble le futur énergétique de notre pays.
J’entends également les divergences de vues qui demeurent, principalement à propos de la place de l’énergie nucléaire, mais c’est le propre du débat démocratique. Sachez que ce sujet n’est pas tabou. Je souligne d’ailleurs que c’est la première fois que la représentation nationale s’en saisit pour l’étudier en profondeur et qu’elle met sur la table les différences de points de vue, qui sont tout à fait légitimes.
Il s’agit évidemment d’une question très importante pour notre filière industrielle ; vous savez d’ailleurs à quel point je suis attachée au maintien et à la continuité de cette filière, ainsi qu’à l’investissement et à l’innovation, sources de performance. Pourtant, pour nos concitoyens, ce n’est pas le principal sujet. Il ne faudrait donc pas que cette divergence occulte le reste de l’œuvre de la transition énergétique. Je pense ainsi aux mesures attendues par les familles – les économies d’énergie ou la performance énergétique des logements –, par les entreprises – les investissements dans le secteur de la croissance verte et dans toutes les filières industrielles du futur – ou par les territoires, qui s’engagent dans la transition énergétique, comme je le rappelais précédemment. Je pense également à l’économie circulaire et au traitement des déchets, à propos desquels Gérard Miquel a fait des propositions tout à fait offensives et innovantes.
Roland Courteau l’a souligné, sur tous ces sujets, nous avons collectivement fait œuvre d’imagination, mais nous devons garder à l’esprit leur poids relatif, même s’il est vrai que la question nucléaire occupe beaucoup l’espace public. Il faut dire qu’il s’agit d’un sujet majeur entraînant des choix parfois idéologiques. Or ce que j’ai justement voulu éviter dans ce texte, ce sont les choix idéologiques.
Je l’ai souvent dit : nous ne devons pas opposer les énergies les unes aux autres. Nous allons d’abord fixer notre mix énergétique, faire la programmation pluriannuelle de l’énergie et étudier les moyens de monter en puissance à la fois en termes de performance énergétique et d’énergies renouvelables, pour qu’il y ait un maximum d’emplois dans ces secteurs. Nous verrons ensuite, en fonction de ces efforts, quelle sera la part de l’énergie nucléaire. Par conséquent, la promulgation de la loi ne marquera pas la fin du débat. Celui-ci se poursuivra par la programmation pluriannuelle de l’énergie, qui fera l’objet, pour la première fois dans notre pays et en toute transparence, de consultations, de décisions, d’actualisations et d’adaptations. Cela nous permettra ainsi d’atteindre nos objectifs : la baisse de 40 % des émissions de gaz à effet de serre, l’augmentation de la part des énergies renouvelables jusqu’à 32 %, la contribution de la France au maintien du réchauffement climatique sous les deux degrés et la réduction de la part de l’énergie nucléaire.
Il me semble donc que cet esprit constructif dont vous venez une nouvelle fois de témoigner prouve bien que le Sénat est au service de l’intérêt général, qu’il s’efforce d’avoir une vision, de fixer un cap et des objectifs de nature à engager la France vers la transition énergétique, tout en sécurisant les investissements, ce qui est essentiel.
Il y a finalement peu de domaines où les responsables politiques peuvent échapper aux échéances électorales et projeter un pays à l’horizon de 2025, de 2030 ou de 2050. Nous projetons donc le pays vers le futur. On dit souvent que les Français sont en panne d’espérance, mais la meilleure façon de renouer avec celle-ci consiste à pouvoir fixer un horizon…
Mme Ségolène Royal, ministre. … et savoir ainsi quelle est notre communauté de destin, tant sur le plan national que mondial. Je veux donc de nouveau vous remercier d’avoir contribué, par vos interventions, à la recherche de cette vérité commune et d’avoir participé à la construction de notre communauté de destin.
Applaudissementssur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Le Gouvernement a déposé ce matin des amendements et en déposera d’autres cet après-midi. Dans d’autres circonstances, un président de commission aurait protesté contre ce dépôt tardif. Cependant, comme nous examinons le projet de loi en nouvelle lecture, l’Assemblée nationale ne pourra, en lecture définitive, retenir que des amendements votés par le Sénat.
Je ne préjuge pas le fond de ces amendements, dont je ne connais pas encore le contenu ; mais je suppose qu’ils présentent un caractère technique et viennent conforter un certain nombre de dispositions. En les adoptant, nous permettrons à l’Assemblée nationale de les adopter définitivement. Je le dis à l’attention de nos collègues qui estimeraient que nous travaillons dans de mauvaises conditions.
Je réunirai donc la commission des affaires économiques à dix-sept heures.

À cette heure-là, je dois présider une réunion dans le cadre des travaux du groupe de suivi des négociations sur le partenariat transatlantique de commerce et d’investissement. De toute façon, compte tenu de l’ordre du jour de cet après-midi, nous ne devrions pas reprendre l’examen du projet de loi avant dix-huit heures ou dix-huit heures trente.

La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
Je rappelle que, en application de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.
En conséquence, sont irrecevables les amendements remettant en cause les articles adoptés conformes ou les articles additionnels sans relation directe avec les dispositions restant en discussion.
Titre Ier
DÉFINIR LES OBJECTIFS COMMUNS POUR RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, RENFORCER L’INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE ET LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE, PRÉSERVER LA SANTÉ HUMAINE ET L’ENVIRONNEMENT ET LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
I. – L’article L. 100-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 100 -1. – La politique énergétique :
« 1° A
Supprimé
« 1° Favorise l’émergence d’une économie compétitive et riche en emplois grâce à la mobilisation de toutes les filières industrielles, notamment celles de la croissance verte qui se définit comme un mode de développement économique respectueux de l’environnement, à la fois sobre et efficace en énergie et en consommation de ressources et de carbone, socialement inclusif, soutenant le potentiel d’innovation et garant de la compétitivité des entreprises ;
« 2° Assure la sécurité d’approvisionnement et réduit la dépendance aux importations ;
« 3° Maintient un prix de l’énergie compétitif et attractif au plan international et permet de maîtriser les dépenses en énergie des consommateurs ;
« 4° Préserve la santé humaine et l’environnement, en particulier en luttant contre l’aggravation de l’effet de serre et contre les risques industriels majeurs, en réduisant l’exposition des citoyens à la pollution de l’air et en garantissant la sûreté nucléaire ;
« 5° Garantit la cohésion sociale et territoriale en assurant un droit d’accès de tous les ménages à l’énergie sans coût excessif au regard de leurs ressources ;
« 6° Lutte contre la précarité énergétique ;
« 7° Contribue à la mise en place d’une Union européenne de l’énergie, qui vise à garantir la sécurité d’approvisionnement et à construire une économie décarbonée et compétitive, au moyen du développement des énergies renouvelables, des interconnexions physiques, du soutien à l’amélioration de l’efficacité énergétique, de la mise en place d’instruments de coordination des politiques nationales et de l’achèvement du marché intérieur de l’énergie. »
II. – L’article L. 100-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 100 -2. – Pour atteindre les objectifs définis à l’article L. 100-1, l’État, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les associations et les citoyens, veille, en particulier, à :
« 1° Maîtriser la demande d’énergie et favoriser l’efficacité et la sobriété énergétiques ;
« 2° Garantir aux personnes les plus démunies l’accès à l’énergie, bien de première nécessité, ainsi qu’aux services énergétiques ;
« 3° Diversifier les sources d’approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de production d’énergie et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale ;
« 3° bis Procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d’une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d’autres produits, travaux ou revenus ;
« 3° ter Participer à la structuration des filières industrielles de la croissance verte ;
« 4° Assurer l’information de tous et la transparence, notamment sur les coûts et les prix des énergies ainsi que sur l’ensemble de leurs impacts sanitaires, sociaux et environnementaux ;
« 5° Développer la recherche et favoriser l’innovation dans les domaines de l’énergie et du bâtiment ;
« 5° bis Renforcer la formation initiale et continue aux problématiques et aux technologies de l’énergie, notamment par l’apprentissage, des professionnels impliqués dans les actions d’économies d’énergie ;
« 6° Assurer des moyens de transport et de stockage de l’énergie adaptés aux besoins.
« Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises, les associations et les citoyens associent leurs efforts pour développer des territoires à énergie positive. Est dénommé “territoire à énergie positive” un territoire qui s’engage dans une démarche permettant d’atteindre l’équilibre entre la consommation et la production d’énergie à l’échelle locale en réduisant autant que possible les besoins énergétiques et dans le respect des équilibres des systèmes énergétiques nationaux. Un territoire à énergie positive doit favoriser l’efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution de la consommation des énergies fossiles et viser le déploiement d’énergies renouvelables dans son approvisionnement. »
III. – L’article L. 100-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 100 -4. – I. – La politique énergétique nationale a pour objectifs :
« 1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030, conformément aux engagements pris dans le cadre de l’Union européenne, et de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ;
« 2° Porter le rythme annuel de baisse de l’intensité énergétique finale à 2, 5 % d’ici à 2030, en poursuivant un objectif de réduction de la consommation énergétique finale de 20 % en 2030 et de 50 % en 2050 par rapport à l’année de référence 2012. Cette dynamique soutient le développement d’une économie efficace en énergie, notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l’économie circulaire, et préserve la compétitivité et le développement du secteur industriel ;
« 3° De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à l’année de référence 2012, en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction du facteur d’émissions de gaz à effet de serre de chacune ;
« 4° De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter 40 % de la consommation d’électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz ;
« 5° Réduire, à terme, la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % en accompagnement de la montée en puissance des énergies renouvelables et sous réserve de préserver l’indépendance énergétique de la France, de maintenir un prix de l’électricité compétitif et de ne pas conduire à une hausse des émissions de gaz à effet de serre. Cette réduction intervient à mesure des décisions de mise à l’arrêt définitif des installations prises en application de l’article L. 593-23 du code de l’environnement ou à la demande de l’exploitant ;
« 5° bis De contribuer à l’atteinte des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique prévus par le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques défini à l’article L. 222-9 du code de l’environnement ;
« 6° De disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes “bâtiment basse consommation” ou assimilées, à l’horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements concernant majoritairement les ménages aux revenus modestes ;
« 7° De parvenir à l’autonomie énergétique dans les départements d’outre-mer à l’horizon 2030, avec, comme objectif intermédiaire, 50 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2020 ;
« 8° De multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030.
« II. – L’atteinte des objectifs définis au I du présent article fait l’objet d’un rapport au Parlement déposé dans les six mois précédant l’échéance d’une période de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-3. Le rapport et l’évaluation des politiques publiques engagées en application du présent titre peuvent conduire à la révision des objectifs de long terme définis au I du présent article. »
IV. –
Non modifié
V. – §(Non modifié) Le I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 1°, la référence : « l’article 2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique » est remplacée par la référence : « l’article L. 100-4 du code de l’énergie » ;
2° La deuxième phrase du 3° est supprimée.
VI et VII. –
Non modifiés
VIII

Je vous remercie, madame la ministre, d’avoir dit que le nucléaire n’était pas un sujet tabou, car je veux précisément souligner, au moment où nous abordons l’article 1er, que, si la montée en puissance des énergies renouvelables est nécessaire, la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires au-delà de quarante ans reste la meilleure solution sur les plans écologique, industriel et économique.
D’un point de vue environnemental, d'abord, ce n’est que par cette prolongation que nous pourrons mettre en œuvre une diversification du mix suffisamment progressive pour éviter l’écueil auquel sont aujourd'hui confrontés nos voisins allemands. À vouloir basculer brutalement du nucléaire vers le renouvelable, nous serions contraints de recourir à davantage de moyens thermiques et donc d’accroître d’autant nos émissions de gaz à effet de serre. À cet égard, la prolongation au-delà de quarante ans permettra de lisser l’effort sans risquer de dégrader, ne serait-ce que transitoirement, notre bilan carbone.
Sur le plan industriel, ensuite, cette extension est parfaitement réalisable en toute sûreté. Les deux parties non remplaçables d’une centrale que sont la cuve et l’enceinte de confinement sont capables de fonctionner au-delà de quarante ans et tous les autres composants peuvent être remplacés, y compris pour atteindre un niveau de sûreté comparable à celui des réacteurs de dernière génération, comme l’Autorité de sûreté nucléaire le demande.
D’un point de vue économique, enfin, cette prolongation est encore le moyen le plus compétitif de produire de l’électricité, même lorsqu’on intègre le coût du grand carénage. Au reste, ce sont plusieurs dizaines de milliards d’euros qui seront investis sur la durée dans tous nos territoires, créant ou préservant ainsi des dizaines de milliers d’emplois qualifiés et très localisés.

À l’occasion de l’examen de l’article 1er, je souhaite rappeler que le secteur de l’énergie est le bien commun de tous. J’espère que nos discussions nous permettront de réaffirmer qu’aucune transition énergétique ne sera possible sans que nos concitoyens puissent y jouer un rôle majeur. En effet, nous devons prendre collectivement conscience de l’état dans lequel se trouve le secteur public de l’énergie. Certes, celui-ci n’est pas encore complètement démantelé, comme peuvent l’être d’autres services publics, mais le risque est réel. Peut-être l’ouverture ou la libéralisation du marché fera-t-elle gagner quelques euros sur les factures de nos concitoyens, mais affaiblir le service public de l’énergie ne permet d’avoir aucune certitude sur l’avenir dans ce domaine.
Le projet de loi tend, entre autres dispositions, à développer l’éolien et l’hydroélectricité. C’est positif, tant que cette transition s’effectue dans le cadre du service public. Une transition énergétique ambitieuse ne peut se réaliser qu’en faveur du bien commun, et non sous le seul prisme de la concurrence comme unique solution pour une énergie moins chère. Échapper aux pratiques spéculatives et fixer un cadre juridique aux nouvelles filières industrielles de l’énergie sont des nécessités absolues.
Le cap que souhaitent tracer cet article et, au-delà, l’ensemble du projet de loi est louable, puisqu’il s’agit de développer les énergies renouvelables, de réduire les consommations et le gaspillage par l’essor de l’économie circulaire et, enfin, de faire adopter par le plus grand nombre des comportements éco-responsables. Consommer, se déplacer, se divertir, rénover ou construire autrement : autant de gestes qui comptent pour préserver la planète et ses habitants et pour construire un avenir durable pour tous. Cependant, tout cela ne pourra être réalisé sans un service public fort. Cela veut dire non pas « étatisation », mais « contrôle ». C’est à cette seule condition que l’on pourra parler d’avenir énergétique serein, maîtrisé et ambitieux.

Avant que nous ne commencions l’examen des amendements déposés sur l’article 1er, je voudrais revenir sur la genèse des événements.
Certains intervenants ont mis en cause l’honnêteté intellectuelle et même, parfois, les capacités de réflexion des membres de notre groupe, ainsi que du Président de la République et du Gouvernement.
Quand on fait de la politique, on prend des engagements et, quand on prend des engagements, on doit les respecter !

Le Président de la République a annoncé, lors de sa campagne électorale, et a répété, au travers du projet de loi présenté par Mme Royal, que notre mix énergétique devait évoluer et que la part du nucléaire devait baisser, en se donnant pour horizon l’année 2025. De grâce, ne mettez pas en cause l’honnêteté intellectuelle du chef de l’État ni celle des sénateurs socialistes !

Comme Mme la ministre l’a indiqué sur plusieurs sujets, en prenant de la hauteur, lorsque l’on fixe des orientations, il faut aussi fixer un cap. En l’occurrence, le cap a été fixé.
Je me rappelle que, lors du Grenelle de l’environnement, il était interdit de parler du nucléaire, pour ne pas prendre le risque de fâcher certains… Et, de fait, le Grenelle n’a pas traité du nucléaire !

Par ailleurs, nous avons essayé de discuter, et d'abord avec vous, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission des affaires économiques, notamment en séance. Nous avons également rencontré le président du Sénat et le président du groupe UMP. Je me permets de vous rappeler que c’est vous qui avez refusé les propositions de consensus que nous vous avions soumises dès la première lecture !
Bien évidemment, en commission mixte paritaire, le choc a eu lieu : les deux textes étaient très éloignés. J’entends que certains en font grief au président de la commission mixte paritaire. Je ne développerai pas ce sujet n’étant pas membre de la CMP. Je veux simplement dire ici que la volonté des sénateurs du groupe socialiste et républicain qui suivent ces questions est de continuer à affirmer nos convictions avec force. Ces convictions sont très simples : nous pensons, comme Mme la ministre, que le nucléaire est une filière d’avenir, qu’il permet de développer beaucoup d’emplois sans impacter le bilan carbone de notre pays, mais que, parallèlement, une évolution est absolument nécessaire. Nous ne pouvons en rester aux schémas des années soixante, soixante-dix ou quatre-vingt ! Nous détaillerons ces positions tout au long du débat.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.

L'amendement n° 138, présenté par MM. Bosino et Le Scouarnec, Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« 1° A Réaffirme le besoin d’une maîtrise publique du secteur de l’énergie ;
La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

Avec cet amendement, nous souhaitons réaffirmer que la maîtrise publique du secteur de l’énergie doit être un élément incontournable de la politique énergétique et qu’elle doit, à ce titre, être inscrite dans le texte.
Il nous a été répondu, en première lecture, que l’État actionnaire détenait une part importante du capital des grandes entreprises du secteur – 84 % d’EDF, 36 % d’Engie, ex-GDF-Suez, et 87 % d’Areva – et que le présent projet de loi démontrait le maintien du rôle de stratège dévolu à l’État en matière de politique énergétique, en lui assignant des objectifs ambitieux et en renforçant les outils de pilotage et de gouvernance à sa disposition.
Dès lors, pourquoi ne pas mettre le droit en accord avec les faits ? Sans doute parce que, derrière la notion de « maîtrise publique », nous souhaitons, nous, inscrire dans la loi un impératif, à l’opposé de la récente cession d’actifs de l’État dans GDF, mais aussi des dispositions du projet de loi Macron facilitant les cessions d’actifs publics, et, surtout, parce que la maîtrise publique sous-entend une remise en cause du « tout-concurrence », qui ne fonctionne pas.
Ainsi, le Médiateur national de l’énergie dresse un bilan des plus nuancés : outre la multiplication des litiges avec les fournisseurs alternatifs, il souligne que, « si la concurrence devait apporter une baisse des prix, celle-ci est loin d’être au rendez-vous ». Et de continuer en rappelant que la facture a augmenté de « 33 % depuis 2007 pour un client au chauffage électrique » et de « 35 % pour un client avec un autre mode de chauffage ». Concernant les prix de l’électricité, ils sont, selon l’INSEE, restés dynamiques, avec une hausse de 5, 7 % en 2014.
Pour toutes ces raisons, nous considérons aujourd’hui que la France a plus que jamais besoin d’un nouvel élan industriel et économique, lequel ne pourra évidemment se faire sans prise en compte de l’exigence écologique. C’est pourquoi nous considérons qu’il faut un secteur public de l’énergie.

Mon cher collègue, de très nombreux amendements que vous avez déposés en nouvelle lecture, à l’instar de celui-ci, sont identiques au mot près, dans leur texte comme dans leur objet, à des amendements que vous aviez déposés en première lecture, en commission, puis en séance – conformément à votre droit le plus strict –, et représentés, en nouvelle lecture, en commission. À chaque fois, la commission a émis un avis défavorable sur ces amendements, et le Gouvernement a fait de même lors de leur examen en séance en première lecture.
Bien entendu, la commission s’en tiendra à cet avis défavorable. Vous comprendrez donc que je sois assez bref à leur sujet dans la suite du débat.
Pour ce qui concerne le présent amendement, je veux simplement vous rappeler que l’énergie est et reste un secteur stratégique. C’est d'ailleurs pourquoi l’État actionnaire détient toujours aujourd’hui une part importante du capital des grandes entreprises du secteur énergétique – 84, 49 % d’EDF, 36, 7 % d’Engie et 87 % d’Areva –, comme je vous l’ai dit en première lecture.
En outre, le projet de loi démontre que l’État conserve son rôle de stratège en matière de politique énergétique, en fixant les grands objectifs et en renforçant les outils de pilotage et de gouvernance à sa disposition, qui font l’objet de la moitié des articles de ce texte. C'est la raison pour laquelle la commission a considéré que la maîtrise publique du secteur de l’énergie était plus que jamais effective et qu’il n’était pas utile de le repréciser une énième fois.
Je crains que la France ne meure quelque peu de la loi bavarde. Il en va des articles de loi comme des communes : notre pays compte autant de communes que l’ensemble de nos voisins européens et nos codes autant d’articles que l’ensemble des autres codes européens ! Nous sommes certes très bons – je n’irai pas jusqu’à dire les meilleurs –, nous sommes très productifs, mais nous sommes aussi un peu trop bavards. Répéter dans ce texte des choses déjà présentes dans d’autres textes n’est pas forcément utile. C'est la raison pour laquelle je me suis permis, cette fois un peu longuement, d’exprimer l’avis défavorable de la commission.
Monsieur le sénateur, vous dites qu’il faut affirmer un principe de maîtrise publique du secteur de l’énergie. Il s’agit donc, en quelque sorte, de donner aux pouvoirs publics des outils de pilotage de la politique de l’énergie. Or c’est ce que nous faisons : le Parlement fait partie des pouvoirs publics. Nous sommes précisément en train de redonner aux pouvoirs publics la maîtrise de l’énergie.
Par ailleurs, plusieurs articles de ce texte de loi renforcent le principe de maîtrise publique : l’article 48, par exemple, prévoit la stratégie bas-carbone et l’article 49 la programmation pluriannuelle de l’énergie… C’est la première fois qu’un document de planification va regrouper l’ensemble des enjeux énergétiques.
Enfin, la maîtrise publique s’applique aussi par les tarifs réglementés de vente de l’électricité aux particuliers qui sont confortés par le projet de loi. Ce texte prévoit également les contrats de service public avec nos grands énergéticiens et les opérateurs de réseaux.
Sur le fond, votre demande me semble satisfaite, raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, je me verrai contrainte d’émettre un avis défavorable.

Oui, monsieur le rapporteur, nous avons redéposé un certain nombre d’amendements dont nous avons déjà débattu en première lecture !

Comme je l’ai dit lors de la discussion générale, nous souhaitons revenir sur un certain nombre d’aspects fondamentaux, au nombre desquels figure la question de la maîtrise publique d’un secteur public de l’énergie.
J’ai bien entendu vos arguments, mais, à l’instar de nos amendements, vos explications sont les mêmes. Nous sommes manifestement en désaccord total sur la notion de « secteur public de l’énergie ».
Madame la ministre, vous nous dites que notre amendement est satisfait par ce texte. Je ne partage pas ce point de vue : quand nous parlons d’une maîtrise publique d’un secteur public de l’énergie, nous faisons référence à la mise en place d’un certain nombre d’outils, à travers de grandes entreprises, comme ce fut le cas, par exemple, à la Libération. On pouvait alors véritablement parler d’une maîtrise publique du secteur de l’énergie. Aujourd’hui, même si l’État demeure majoritaire dans un certain nombre de ces entreprises, cette maîtrise est bradée, ce qui entraîne non seulement des hausses de tarifs pour nos concitoyens, mais aussi des pertes de compétence et de savoir-faire.
Il a beaucoup été question du nucléaire. Peut-être faudrait-il évoquer également ce qui est en train de se passer à Flamanville avec Areva.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 137, présenté par MM. Bosino et Le Scouarnec, Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 6
1° Remplacer les mots :
au plan
par les mots :
aux plans national et
2° Après le mot :
international
insérer les mots :
, maintient des tarifs réglementés pour l'électricité et le gaz naturel
La parole est à Mme Évelyne Didier.

Encore une fois, par cet amendement, nous souhaitons réaffirmer le principe d’une fixation des prix de vente de la fourniture d’énergies par la puissance publique. Eh oui, nous insistons !
La libre concurrence, qualifiée de « logique » au sein d’un marché européen ouvert, ne peut être considérée comme une bonne chose ni pour les PME-PMI ni pour les collectivités locales, qui, elles aussi, vont quitter les tarifs réglementés.
Enfin, il nous a été dit que la disparition progressive, entre le 19 juin 2014 et le 1er janvier 2016, des tarifs réglementés de vente de gaz naturel et d’électricité pour les consommateurs professionnels est justifiée par la nécessité de nous conformer au droit européen et qu’il faudrait simplement en prendre acte. Nous pensons au contraire – l’actualité nous donne peut-être raison – qu’il faut résister à la manière de voir prônée au niveau européen.
La France peut proposer d’autres alternatives. Ce secteur est trop stratégique, tant pour les particuliers que pour les activités économiques, pour être placé sous la pression des marchés avec les risques inhérents aux fluctuations excessives des prix de ces énergies. Tel est le sens de cet amendement.
Par ailleurs, nous savons bien que la productivité s’accroît toujours au détriment de la sécurité et des salaires.

Le 1° de cet amendement a déjà été présenté en première lecture au Sénat et rejeté après les demandes de retrait de la commission et du Gouvernement, au motif que l’attractivité s’entend nécessairement par comparaison avec d’autres pays et donc nécessairement sur le plan international.
Le 2° de l’amendement avait également été présenté, mais d’une manière différente, en première lecture dans un autre amendement. Je vous ferai donc la même réponse : votre demande est satisfaite par le droit actuel et notamment les articles L. 337-4 et L. 445-1 du code de l’énergie.
Pour ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Madame Didier, s’agissant des tarifs réglementés de vente aux particuliers, vous avez satisfaction. Ils sont même confortés par l’article 41 du projet de loi.
Il est vrai que le Gouvernement, tenu d’appliquer les décisions de la Commission européenne en la matière, a engagé la suppression progressive des tarifs réglementés de vente aux moyens et grands consommateurs dès le 31 décembre 2014 pour le gaz et à compter du 31 décembre 2015 pour l’électricité. Le retour sur expérience montre que cette suppression s’est faite dans l’intérêt du consommateur, les tarifs du gaz ayant baissé.
Par ailleurs, nous avons mis en place des mesures transitoires pour accompagner les acteurs dans ce changement. Les dispositions du titre VII, par exemple, permettent de maintenir et de renforcer la compétitivité des électro-intensifs. Nous avons mis en place un juste équilibre entre protection des consommateurs et compétitivité des entreprises.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, je me verrai contrainte d’émettre un avis défavorable.

Je ne voterai pas cet amendement, dont la rédaction ne me convainc pas, mais il pose une véritable question sur l’évolution des prix.
Depuis le débat national et le début de l’examen du projet de loi, les choses ont beaucoup évolué. Je ne suis pas sûr que l’on ait pris la mesure de l’échéance de 2016.
Notre système est historiquement basé sur une péréquation forte et des tarifs extrêmement encadrés et maîtrisés. Je l’ai déjà dit – à la surprise de certains de mes camarades –, je suis pour un tarif maîtrisé, une péréquation nationale, une solidarité forte.
Pour le patron d’EDF, M. Lévy, le coût réel du nucléaire est de 55 euros. Or un certain nombre de prestataires arrivent sur le marché – je pense, par exemple, à Énergie Coop, entreprise venant du même monde idéologique que le mien – et annoncent qu’ils vont être moins cher. Pour ce faire, ils vont adosser leur offre à un certain nombre de productions renouvelables très maîtrisées.
Tout va aujourd’hui très vite. Notre système ne marche plus à un moment où la dimension européenne va prendre toute son importance : nous trouverons en Europe de l’électricité à un coût inférieur aux 55 euros dont parle M. Lévy. Le nucléaire, quoi qu’on en dise, n’est donc plus concurrentiel.
Par ailleurs, certaines entreprises commencent à proposer des solutions de stockage individuel. Les premières batteries Tesla arrivent sur le marché, tout comme Bolloré, qui s’appuie sur le photovoltaïque dont les coûts baissent très rapidement. Ceux qui auront les moyens d’investir vont donc peut-être choisir de sortir du réseau.
Le système évolue à une vitesse supersonique sans qu’on ait su l’anticiper. Nous devons mener une vraie réflexion pour maintenir la solidarité. Il ne faut pas que, demain, seuls les clients captifs modestes payent le réseau. Or cela peut très bien arriver d’ici à dix ans.
Je ne soutiens pas cet amendement en l’état, mais je reconnais qu’il s’agit là d’une véritable question. Je pense que la solidarité doit rester au cœur du système français, mais que ce dernier ne tiendra pas face aux évolutions en cours.
J’ajouterai enfin que l’une des raisons de la déstabilisation du système, c’est le nucléaire.

Le groupe socialiste a toujours été favorable aux tarifs réglementés et c’est la loi NOME, que nous n’avons pas votée, qui a prévu de les supprimer pour certains professionnels – je crois qu’il s’agit des sites supérieurs à 36 kVA de puissance souscrite.
Le Gouvernement a pris, dans ce projet de loi, un certain nombre de mesures particulièrement appréciables visant à conforter les tarifs réglementés, ce dont nous nous réjouissons. Ces tarifs ont été jusqu’à présent préservés pour les ménages. Cela étant dit, rien n’est jamais définitivement acquis et Bruxelles pourrait voir dans cette réglementation un obstacle à la libre concurrence. C'est la raison pour laquelle nous devons être vigilants.
Toujours est-il que les tarifs réglementés permettent de protéger les consommateurs contre les fluctuations du marché. À cet égard, je rappelle que le groupe socialiste avait déposé une proposition de loi visant au maintien des tarifs réglementés pour l’électricité et le gaz naturel. Les propos de Mme la ministre nous ont toutefois rassurés et confortés, raison pour laquelle nous ne voterons pas cet amendement.

Un certain nombre d’interventions me conduisent à rappeler ce qu’il en est des tarifs réglementés.
Ces tarifs sont proposés depuis la nuit des temps – c’est-à-dire depuis la Libération – à tous les consommateurs. Il s’agit d’un prix fixé par le Gouvernement.
La loi du 10 février 2000 a ouvert les marchés aux gros consommateurs et aux industriels, les tarifs réglementés étant maintenus pour les professionnels et les particuliers.
En février 2002, un sommet important s’est tenu à Barcelone. Y ont participé le Président de la République et le Premier ministre de l’époque, Jacques Chirac et Lionel Jospin. Une déclaration commune a alors été adoptée par l’ensemble des participants annonçant une extinction progressive des tarifs réglementés, y compris pour les particuliers. Dès lors, la machine s’est mise en route.

Nous n’avons eu de cesse ensuite, les uns et les autres – plus les uns que les autres, c’est-à-dire les majorités de droite –, de ralentir, voire de modifier le cours des choses. Nous nous sommes notamment efforcés, Ladislas Poniatowski et moi-même, lorsque nous étions tous deux rapporteurs de la loi autorisant les petits consommateurs domestiques et non domestiques d’électricité et de gaz naturel à accéder ou à retourner au tarif réglementé, lui au Sénat et moi à l’Assemblée nationale, de protéger le consommateur.
Quelle est la situation aujourd’hui ? Ne faisons pas peur aux consommateurs : les tarifs réglementés ne vont pas disparaître pour les particuliers. Ceux qui disent le contraire n’ont aucun argument à faire valoir, ils ne se basent sur rien ! En revanche, les tarifs réglementés n’existeront plus pour les professionnels, lesquels vont être soumis à la loi du marché tant pour l'électricité que le gaz. Il serait faux de rendre la loi NOME responsable de cette situation, alors qu’elle n’a fait que transposer une directive du début des années 2000 s’appliquant à l’ensemble des États membres.
Rendons grâce et justice à ceux qui ont tout fait pour protéger le consommateur-particulier de la manière dont il l’est aujourd’hui.
L'amendement n'est pas adopté.

La commission de la culture, de l’éducation et de la communication a proposé des candidatures pour deux organismes extraparlementaires.
La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.
En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame :
- Mme Dominique Gillot membre titulaire du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
- M. François Commeinhes membre du Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Françoise Cartron.