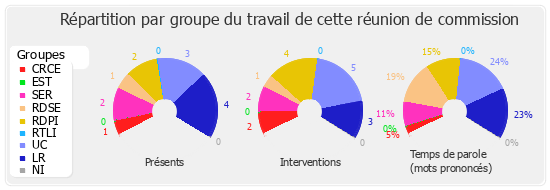Commission des affaires européennes
Réunion du 2 juillet 2015 à 9h05
Sommaire
- Politique de voisinage
- Sommet de riga sur le partenariat oriental : rapport d'information de mm. pascal allizard gérard césar yves pozzo di borgo jean-claude requier andré reichardt et simon sutour (voir le dossier)
- Économie finances et fiscalité
La réunion

Le rapport d'information qui va nous être soumis fait suite au sommet de Riga, qui s'est tenu le 22 mai dernier et a réaffirmé les grands principes du Partenariat oriental. Comme l'a rappelé Angela Merkel en marge de ce sommet, celui-ci ne doit pas être confondu avec l'élargissement. La confusion en cette matière, réelle ou organisée, a eu les conséquences que l'on sait. La différenciation doit aussi prévaloir si l'on veut être efficace. Je rappelle que nous avons mis en place un groupe de travail qui est composé de Pascal Allizard, Gérard César, Yves Pozzo di Borgo, Jean-Claude Requier, André Reichardt et Simon Sutour. Pascal Allizard et Jean-Claude Requier vont intervenir en premier. Les autres membres du groupe de travail prendront la parole ensuite, avant qu'un débat s'engage.

Le Partenariat oriental aurait pu être un prolongement européen de l'Ostpolitik ou un plan Marshall européen. Comme l'un et l'autre, il a des enjeux politiques et économiques. S'il n'est ni l'un ni l'autre, c'est d'abord parce que l'Union européenne ne considérait pas qu'elle avait un voisin hostile à l'Est et se reposait depuis 1989 sur l'ordre issu de la chute du mur et ensuite, c'est parce que l'Union européenne ne dispose pas d'une force de frappe financière suffisante pour offrir un plan Marshall.
De toute manière, un plan Marshall eût été prématuré et serait voué à l'échec dans la mesure où les pays du Partenariat oriental sont pour la plupart sortis très mal en point du système soviétique et ils sont incapables d'offrir les infrastructures nécessaires pour recevoir un plan Marshall et en bénéficier.
Ainsi, le Partenariat oriental est plutôt l'esquisse d'une politique de bon voisinage. Il est essentiellement la manifestation d'une bonne volonté de l'Union européenne à l'égard de sa frontière orientale. Si l'on préfère, il est la proposition faite par l'Union à ses voisins d'adopter le modèle européen de la démocratie et de la libre entreprise.
En pratique, l'objectif premier du Partenariat oriental est la réalisation d'une association politique et d'une intégration économique de ces six pays - Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie et Ukraine - avec l'Union européenne ainsi que la promotion, à l'est de l'Europe, d'une stabilité et d'une prospérité qui profiteront à l'Union européenne comme à ses partenaires, dans une zone où les tensions demeurent nombreuses.
L'enjeu est également économique et commercial puisque les six partenaires orientaux réunissent 75 millions d'habitants et que leur marché est doté d'un fort potentiel de croissance et d'une main d'oeuvre assez bien qualifiée. La conclusion d'accords d'association comprenant la création d'une zone de libre-échange approfondi et complet permet à cet égard, pour ceux qui l'auront souhaité, une convergence réglementaire avec l'Union.
Le Partenariat oriental est financé par des crédits de l'instrument européen de voisinage (IEV) qui disposera de 15,4 milliards d'euros entre 2014 et 2020. Cet instrument est le prolongement du dispositif précédent, l'instrument européen de voisinage et de partenariat 2007-2013 : il finance les pays mitoyens dans le cadre de la politique européenne de voisinage par le biais de programmes de coopération. Ces programmes se divisent en trois catégories - bilatéraux, régionaux et transfrontaliers -, mais ils sont tous destinés à promouvoir les réformes politiques économiques et sociales et à encourager l'harmonisation des politiques et l'adoption des normes européennes.
En 2014, pour le Partenariat oriental, 2,297 milliards d'euros ont été engagés et 1,623 milliard payé, dont 341,1 millions pour la seule Ukraine.
Pour donner une dimension parlementaire au Partenariat oriental, le Parlement européen a créé, en mai 2011, l'Assemblée Euronest, qui rassemble 60 députés européens ainsi que dix députés de chaque pays partenaire, hors Biélorussie. L'Assemblée Euronest reste ainsi le lieu d'échanges parlementaires favorisant les conditions nécessaires à l'accélération de l'association politique et au renforcement de l'intégration économique entre l'Union européenne et ses partenaires d'Europe orientale. Elle participe au développement et à la visibilité du Partenariat oriental, en tant qu'institution responsable de la consultation parlementaire, du contrôle et du suivi du partenariat.
Quelle est l'attitude de la Russie face à ce partenariat ? Après l'avoir refusé, elle ne cache plus son hostilité. Elle a fait pression sur Kiev pour obtenir une volte-face et le refus de signer l'accord d'association. Elle interfère sur la crise ouverte en Ukraine qui n'est pas terminée même si entretemps, au bénéfice de nouvelles élections, l'accord d'association a finalement été signé.
Pour faire pièce au Partenariat oriental, la Russie a tourné ses projecteurs vers l'Asie et lancé le projet de l'Union économique eurasienne qui pourrait regrouper à terme la Russie, la Biélorussie, Le Kazakhstan, l'Arménie, le Kirghizstan et le Tadjikistan.
Le Partenariat oriental est de surcroît sérieusement gêné dans son action par les conflits gelés, l'annexion de la Crimée et la guerre en Ukraine. Les conflits gelés, hérités du découpage des anciennes républiques soviétiques - Ossétie et Abkhazie en Géorgie, Transnistrie en Moldavie, Haut-Karabagh en Azerbaïdjan - créent une tension régionale constante en l'absence de règlement politique durable et nuisent à la stabilité et à la sécurité entravant par conséquent les progrès de la démocratie et de l'économie de marché dans ces pays.
Le Partenariat oriental fait l'objet de critiques diverses et la première d'entre elles vise ce qu'il est convenu d'appeler son ambiguïté.
La politique du Partenariat oriental est distincte du processus d'élargissement et ne saurait s'y substituer, même si elle peut, dans certains cas, constituer une première étape vers la candidature. Pourtant en aucun cas, le projet du Partenariat oriental ne préjuge de l'évolution future des relations des pays voisins de l'Union à l'est. La force du partenariat varie d'un pays à l'autre et elle dépend de la rapidité avec laquelle les réformes démocratiques nécessaires sont mises en place par les pays concernés.
Toutefois, certains ont relevé une ambiguïté dans ce projet de Partenariat oriental ou en tout cas un risque, celui de laisser espérer aux pays concernés plus que ce que l'Union peut effectivement leur apporter.
Comme la politique du Partenariat oriental s'inspire, par la force des choses, de l'habitude et des traditions de « screening » de la politique d'élargissement - technique en usage dans l'administration bruxelloise et qui consiste, si j'ai bien compris, à polariser des valeurs en les faisant passer par un filtre - elle nourrit, malgré des moyens limités, des ambitions comparables et elle demande, grosso modo, aux pays partenaires de reprendre 80 % de l'acquis communautaire. De là a pu naître une certaine confusion, car il faut reconnaître que le projet du Partenariat oriental est calqué dans sa méthodologie sur la politique d'élargissement et sur la politique d'aide au développement dans ses aspects financiers.
L'avenir du partenariat aurait dû être tranché à Riga, mais l'Union européenne hésite peut-être sur son but exact, et se refuse à dire que l'adhésion serait une perspective automatique - fût-elle très lointaine - pour tous les pays partenaires qui souhaitent s'en donner les moyens. L'Union précise toutefois qu'il n'appartient pas à la Russie de déterminer qui peut adhérer ou non à l'Union européenne.
Comme il a été dit, l'Union s'engage maintenant à soutenir le principe « faire plus pour recevoir plus » : les crédits doivent aller à ceux qui ont fait les plus grands progrès. Même si l'Azerbaïdjan a d'intéressantes réserves d'hydrocarbures, il n'y a aucune bonne raison d'être plus indulgent avec ce pays qu'on ne l'est à l'égard de Biélorussie aujourd'hui, par exemple.
Si les pays de ce partenariat mettent vraiment en oeuvre les réformes préconisées et respectent les textes qu'ils adoptent sur le modèle européen, l'Europe, dans cette région du monde, finira par avoir un autre visage beaucoup plus démocratique. Il faut reconnaître sans ambages que le Partenariat oriental est un moyen pour ces pays de rompre de manière définitive avec le modèle soviétique qu'ils ont déjà ouvertement rejeté mais dont ils continuent à subir les conséquences, faute d'avoir réformé profondément leurs institutions.
La crise ukrainienne pèse comme une épée de Damoclès : il faut qu'elle se termine de manière satisfaisante et que l'Ukraine soit sauvée, alors que son PIB a chuté de 17 %, de la faillite qui la menace. Un échec en Ukraine mettrait un terme au Partenariat oriental, en nuisant à la crédibilité de l'Union européenne à l'extérieur de ses frontières.
Les conclusions du sommet de Riga, qui s'est tenu le 22 mai dernier, réaffirment les grands principes du Partenariat oriental et énumèrent les progrès accomplis, qui tiennent, pour l'essentiel, à la signature de trois accords d'association, avec l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie. Plus importante est la déclaration de la Chancelière Angela Merkel en marge du sommet, qui soulignait que « le partenariat n'est pas un instrument pour l'élargissement » mais seulement un rapprochement.
Le sommet de Riga est surtout apparu comme l'occasion d'apaiser le Kremlin en insistant sur le fait que le Partenariat oriental était plus que jamais à géométrie variable. C'est donc le principe de la différenciation qui l'emporte et à ce titre, on perd un peu de la cohésion d'ensemble mais on gagne en efficacité. On perd un peu des grands principes pour gagner en réalité.

Le sommet de Riga s'est voulu un sommet de l'apaisement. Il y a été rappelé que le Partenariat oriental ne se construit contre personne, et certainement pas contre la Russie.
La politique européenne de voisinage (PEV) a été fondée en 2004 afin de donner corps à l'idée d'un cercle de pays qui, situés aux marches de l'Union européenne, partagerait ses valeurs et ses objectifs fondamentaux et serait décidé à s'engager avec elle dans une relation plus étroite allant au-delà de la coopération, c'est-à-dire - et c'est là que résident les premiers germes de l'ambiguïté - impliquant un haut niveau d'intégration économique et politique.
Romano Prodi souhaitait, à l'époque, « créer un cercle d'amis » et préconisait de « mettre en commun tout sauf les institutions ». Au fond, il fallait surtout éviter l'émergence de nouvelles lignes de division entre l'Union nouvellement élargie à l'Est et ses voisins et en conséquence, renforcer la prospérité, la stabilité et la sécurité de tous.
L'idée sous-jacente est bien celle d'un progrès continu à l'est, progrès qui amène à effacer pas à pas, et sur le long terme, les différences encore criantes dans le domaine institutionnel et économique qui existent, encore aujourd'hui, entre l'ouest et l'est de l'Europe. En ce sens, il s'agissait d'un acte de foi dans l'avènement d'une Europe totalement réunifiée et prospère.
L'autre idée, tacite, était qu'une politique dédiée à cette zone permettrait de manifester l'intérêt de l'Europe pour cette région et de renforcer sa normalisation après 70 ans d'antagonisme.
Même si ce partenariat se distingue de la politique d'élargissement, l'idée reste que tous doivent participer à la construction d'un espace commun de prospérité. C'est pourquoi l'Union européenne a également proposé cette politique à la Russie, qui a décliné l'offre mais qui a accepté un simple partenariat stratégique, lequel ne s'est pas vraiment concrétisé jusqu'à présent.
Aujourd'hui le Partenariat oriental constitue un des piliers de la politique européenne de voisinage qui comprend aussi la politique méditerranéenne. On peut, au reste, s'interroger sur cette politique de l'Union européenne, si tant est qu'elle en ait une, qui consiste à agir à l'Est, pour rééquilibrer aussitôt au Sud. Malheureusement, ce pilier de la politique de voisinage est devenu politiquement très sensible dans la mesure où la Russie, qui le remet en cause, est aussi un acteur régional important.
Le Partenariat oriental, né à la demande de la Pologne et de la Suède - ce qui donne tout son sens aux évènements actuels - visait à accorder une attention particulière aux voisins de l'Est. S'appuyant sur les conclusions du Conseil européen de décembre 2007, ces deux États membres ont conjointement présenté au conseil Affaires générales-Relations extérieures du 26 mai 2008 une « proposition pour un Partenariat oriental », officialisé lors du sommet du 7 mai 2009 à Prague.
Cette initiative, qui vise à promouvoir le renforcement des relations de l'Union européenne avec ses six voisins de l'Est, reprend les principes essentiels de la politique de voisinage. Elle réaffirme les axes directeurs : promotion de l'État de droit et de la démocratie - il reste du travail à faire chez certains de nos partenaires - ; l'intégration économique ; la libéralisation des échanges et le développement de la mobilité.
La plus-value essentielle de cette politique est d'offrir aux six pays voisins la perspective attrayante de bénéficier un jour d'un régime sans visa avec l'Union européenne ainsi que d'un accord d'association - association politique et intégration économique à travers la négociation d'un accord de libre-échange approfondi et selon une logique de différenciation.
L'évolution de ce partenariat se lit dans la succession de ses sommets. Le Sommet de Prague, du 7 mai 2009, a vu l'adoption d'une déclaration conjointe qui précise l'ambition du Partenariat oriental : en substance, les négociations relatives à la conclusion d'accords d'association ne seront lancées qu'avec les pays partenaires ayant la volonté et la capacité de respecter les engagements qui en découlent.
En matière de visas, il s'agissait de conclure des accords de facilitation avec les pays partenaires qui n'en ont pas encore. La libéralisation totale des visas constituerait un objectif à long terme quand les conditions seraient remplies.
Deux ans plus tard, le sommet de Varsovie, des 29 et 30 septembre 2011, fut l'occasion de préciser les objectifs fixés en 2008 en vue d'une reconnaissance d'une communauté de valeurs et de principes démocratiques, et de prendre acte des aspirations et du choix européen de certains partenaires et de leurs engagements en faveur du développement d'une démocratie approfondie et durable tout en maintenant une distinction entre la politique d'élargissement et la politique de voisinage. Lors de ce sommet, on supprima la mention « à long terme » concernant l'objectif de libéralisation du régime des visas de court séjour. Les intentions, comme on le voit, étaient alors toujours aussi bénignes.
Le Sommet de Vilnius des 28 et 29 octobre 2013 fut l'occasion de souligner les progrès réalisés, même s'il a été surtout marqué par le refus inattendu des autorités ukrainiennes de signer l'accord d'association avec l'Union européenne après cinq années de négociation.
Cependant les deux accords d'association avec la Géorgie et la Moldavie ont été paraphés à Vilnius. Ils visent par leurs dispositions ambitieuses en matière d'État de droit, de libre échange commercial et de coopération sectorielle à moderniser en profondeur ces pays.
Par une déclaration séparée, on a encouragé l'Arménie à poursuivre son rapprochement avec l'Union européenne et sa modernisation, malgré son choix - et l'on trouve là aussi les germes de la crise actuelle - de rejoindre l'Union douanière Russie-Biélorussie-Kazakhstan, qui a entraîné la suppression du paraphe de l'accord d'association initialement prévu à Vilnius.
Le sommet de Vilnius a fait naître les premières inquiétudes sur l'avenir du Partenariat oriental et révélé l'hostilité de la Russie à ce projet, ou tout au moins ses inquiétudes.
Dernière étape en date, enfin, le sommet de Riga du 22 mai 2015. La crise ukrainienne a incité l'Union européenne à se pencher sur la situation des pays voisins à l'Est et sur l'avenir du Partenariat oriental, rendu pour le moins difficile et incertain.
La coopération avec les pays voisins reste une priorité évidente pour l'Union européenne, car il existe une double interdépendance : économique et sécuritaire. Les accords signés sont ambitieux et peut être trop ambitieux puisqu'aussi bien les pays du partenariat oriental sont encore très loin des normes de l'Union européenne quel que soit le domaine envisagé et malgré les réformes entreprises. Les liens commerciaux avec la Russie sont encore dominants et la dépendance énergétique totale pour quatre d'entre eux. L'actualité d'hier après-midi sur les livraisons de gaz russe à l'Ukraine en témoigne.
Trois scénarios pour l'avenir du Partenariat oriental restent possibles. En premier lieu, celui d'un rapprochement progressif et vertueux : la coopération devient plus étroite, plus fructueuse et les six pays se rapprochent chacun à son rythme des normes de l'Union européenne et d'un idéal bâti sur la démocratie et la libre entreprise - il y a encore un peu de chemin à faire. Deuxième scénario, le Partenariat oriental dépérit lentement, l'Union européenne, sous la pression de la Russie, décidant de se montrer discrète et cessant d'intensifier son appui à la réforme des six pays concernés ; la Russie retrouverait ainsi son glacis défensif face à l'Union européenne, souci qui est le sien depuis des siècles et n'est pas propre à M. Poutine : l'histoire nous a déjà servi ce scénario.
Troisième scénario : les conflits gelés sont réactivés, la Russie affirme son emprise sur l'Ukraine et la Biélorussie ; l'esprit de la guerre froide l'emporte et dans les faits, la guerre dite « hybride » s'installe dans tous les foyers de tension actuels.
La crise ukrainienne et les tensions avec la Russie ont sensiblement accéléré le processus de signature des accords d'association avec l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie en 2014. Ces accords doivent encore être ratifiés par les États membres.
Les relations de l'Union européenne avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan avancent à un rythme différent. Les négociations pour un accord sont en cours avec l'Azerbaïdjan mais sans volet de libre-échange, car Bakou n'est toujours pas membre de l'OMC - il n'est d'ailleurs pas sûr que sur le volet de la démocratie, les choses aient non plus beaucoup avancé. Quant au paraphe de l'accord avec l'Arménie, il est suspendu en raison du souhait de l'Arménie de rejoindre l'Union économique eurasienne, comme il a été dit.
Les relations entre l'Union européenne et la Biélorussie sont plus complexes, la Biélorussie ne participant qu'au volet multilatéral. La politique européenne à l'égard de Minsk repose sur une double approche : pression, d'un côté, pour obtenir une amélioration de la situation des droits de l'homme, de l'État de droit et des principes démocratiques et, de l'autre, soutien à la société civile.
À l'heure actuelle, trois pays, l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie, envisagent à terme leur entrée dans l'Union, les autres - Biélorussie, Arménie et Azerbaïdjan - pratiquent une realpolitik tendant à tirer un maximum d'avantages de leur position intermédiaire entre la Russie et l'Union européenne.

Simon Sutour veut-il nous dire quelques mots sur la ventilation des crédits ?

Mon propos ira un peu au-delà. La politique de voisinage est une politique de l'Union européenne à l'égard d'un certain nombre de pays à ses frontières. Elle se décline en deux volets : Partenariat oriental, à l'Est, et politique euro-méditerranéenne au Sud - sur laquelle nous vous soumettrons prochainement, avec Louis Nègre, un rapport. Les crédits vont pour les deux tiers à la politique euro-méditerranéenne, et pour un tiers au Partenariat oriental. Ces crédits, qui ne sont pas intégralement consommés, restent assez modestes. En 2014, l'Arménie a reçu 23,2 millions d'euros ; l'Azerbaïdjan, 6,8 millions - en a-t-il vraiment besoin, sachant qu'il engrange par ailleurs des revenus substantiels ? La Biélorussie, 22,3 millions ; la Géorgie, 41,1 millions ; la Moldavie, 93,7 millions ; l'Ukraine, 314,1 millions.
La ventilation des crédits entre Partenariat oriental et politique euro-méditerranéenne est le fruit d'un accord tacite, qui peut être remis en cause. Je suis de ceux qui défendent la clé de répartition actuelle, mais il faut avoir conscience que c'est une question qui peut à tout moment revenir sur le tapis, sous la pression des pays baltes.
Je souhaiterais, personnellement, que certaines modifications soient apportées au rapport, dont je suis signataire, car certains termes me semblent excessifs. Qu'il suffise de dire que l'Union européenne a proposé également cette politique à la Russie qui a décliné l'offre mais qui a accepté un simple partenariat stratégique, sans retenir les considérations sur les limites physiques de l'Europe et sur la relation de la Russie au modèle européen.

Dire, au sujet du sommet de Vilnius, que la dégradation des relations entre l'Union européenne et la Russie n'a rien d'une fatalité et doit beaucoup à la personnalité du dirigeant russe actuel me paraît un peu polémique.

Vous n'êtes pas signataire du rapport, je le suis.
Je souhaiterais, enfin, que l'on supprime le développement que récapitule l'intitulé : « L'hostilité de la Russie a conduit à une entreprise de déstabilisation », car il me semble très polémique. Ce qui suppose aussi de modifier la première phrase du développement suivant, relatif au bilan 2009-2015, pour la faire commencer ainsi : « Le bilan du Partenariat oriental est en demi-teinte ».

Sur laquelle nous travaillons avec Yves Pozzo di Borgo. Ce regard peut se prévaloir d'une expertise.

Ce projet de rapport contient un certain nombre de rappels fort intéressants, mais je souscris totalement aux demandes de Simon Sutour. C'est un sujet difficile, qui appelle à rester prudent dans le jugement.
Prenons l'exemple du sommet de Vilnius : il est évident que la précipitation maladroite des pays baltes à souscrire à un accord avec l'Ukraine est à l'origine des problèmes que l'on connaît aujourd'hui. On ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur le sujet. Le sommet de Vilnius est pour beaucoup dans le cancer qui est en train de se développer en Ukraine, et n'est pas près de reculer. Le Président de la République lui-même a déclaré, à Astana, que le refus de l'Union européenne de voir l'Ukraine entrer dans le partenariat eurasiatique était une erreur.
Je ne puis souscrire en l'état au rapport. Le Partenariat oriental est indépendant de la relation avec la Russie.

On touche à un sujet délicat. J'avoue que personnellement, qu'il soit écrit que l'hostilité de la Russie a conduit à une entreprise de déstabilisation ne me heurte pas, mais je conçois que d'autres puissent avoir un autre avis. On prend bonne note de vos remarques et on en reparlera lors d'une prochaine réunion.

Je me demande si les remarques qui ont été faites, et auxquelles je souscris ne trouvent pas leur cause efficiente, dans le propos relatif à « l'exportation du modèle européen », qui me rappelle des époques révolues où ce mot de modèle était brandi par certains comme un repoussoir. Écrire qu'« il n'y a aucune raison valable de ne pas reconnaître que l'Europe est un modèle politique et économique ni de renoncer qu'elle propose ce modèle à tous ceux qui l'entourent » me paraît un bien mauvais début pour créer de bonnes relations de voisinage. Il me semble que nous devons rester dans le ton d'un rapport d'information.
Nous ne rédigeons pas un manifesto, pour reprendre l'expression anglaise. Que l'on milite en faveur de l'exportation d'un modèle, cela me gêne.

Nous pouvons apporter les modifications demandées par notre collègue Simon Sutour. Nous ne devons pas donner l'impression de présenter des positions quelque peu fermées sur les relations avec la Russie. Ce n'est pas l'objet de la mission. Et comment prétendre posséder la vérité quand on n'a pas toujours démontré que tout est parfait dans notre modèle ? Enfin, je me pose la question : la politique actuelle de la Russie est-elle directement liée à la personnalité de M. Poutine...

ou ne tient-elle pas plutôt à des fondamentaux, qui reviennent en force ; à une volonté de reconquête par la Russie de sa zone d'influence, qui est en partie liée à sa géographie - c'est bien de cela qu'il s'agit quand on parle de la Crimée et de l'Ukraine. Ces sujets méritent qu'on y travaille un peu plus.

Pour donner corps à votre remarque, nous allons demander à nos rapporteurs de prendre en compte ces diverses observations en vue du rapport final. Dans ce qui a été dit, je retiens deux idées qui ne me paraissent pas inconciliables : ce n'est pas à la Russie de dicter à l'Union sa politique orientale, mais d'un autre côté, l'Union ne peut envisager son développement sans un dialogue avec son grand voisin.

Je reviens sur ce qui a été dit au sujet de la situation économique de ces pays. Pour avoir vécu en Pologne au début des années 1990, je sais ce qu'y était, à cette époque, la situation. Et je sais aussi qu'à partir du moment où des réformes, celles de Leszek Balcerowicz, ont été conduites, qui ont coupé certaines racines du mal, la Pologne a connu une croissance soutenue durant plus de vingt-cinq ans. Certains pays, qui faisaient alors encore partie de l'Union soviétique, n'ont pas eu cette chance, et leur économie a conservé le caractère oligarchique qui marquait l'économie soviétique. Que certains pays d'Europe centrale considèrent, sur le fondement de leur expérience propre, que l'on puisse arriver à un résultat semblable pour peu que l'on extirpe les racines du mal dans les anciens pays de l'Union soviétique, et qu'ils en soient partisans, parce que cela leur a réussi, n'a rien que de normal.
Le fait est qu'un décalage s'est creusé, dès le départ, entre les pays, entrés dans l'Union européenne entre 2004 et 2007, qui appréhendent le Partenariat oriental comme la voie vers l'adhésion, et les autres. D'où la situation que l'on connaît aujourd'hui.
On a vu ce qu'il s'est passé en Ukraine depuis deux ans. Je ne dis pas que les choses évolueront de la même manière en Arménie, mais reconnaissons que la situation politique à laquelle on assiste depuis une semaine témoigne que la société civile se réveille, de toute autre façon que ces vingt dernières années, ce qui conduit à une situation que la Russie considère déjà comme une entreprise de déstabilisation. Vu les perspectives de rapprochement entre les États-Unis et l'Iran, il convient de faire évoluer l'Arménie : c'est ainsi que la Russie lit les évènements qui se déroulent aujourd'hui en Arménie.
Je partage ce qui a été dit sur les scénarios décrits dans le rapport. L'approche pragmatique qui consistait à penser que la Russie n'a certes pas le même projet politique que l'Union européenne, mais qu'en échangeant sur le plan économique, on arriverait à évoluer ensemble s'est fracassé, comme on l'a vu l'an dernier, sur la question de la Crimée. Peut-on encore tabler sur un tel scénario, le pouvoir restant entre les mêmes mains ? L'idéal serait bien sûr de faire émerger un projet plus fort entre l'Union européenne et la Russie, mais cela paraît un peu complexe aujourd'hui. Quant aux autres perspectives, elles sont plutôt négatives : soit la persistance de conflits gelés, soit un mouvement qui verrait l'Union européenne se détourner de ses voisins orientaux et les deux grands blocs de la région tourner le regard dans des directions différentes. Mais l'Europe en serait affaiblie.
Je rebondis sur ce qu'a dit Simon Sutour : à partir du moment où l'on a distingué, d'un côté, le Partenariat oriental, avec la perspective qui a été rappelée, et de l'autre, une politique de voisinage avec les pays du pourtour méditerranéen, l'action vers l'Est apparaît comme une entreprise de désoviétisation, donc une politique antirusse. Mieux vaudrait unifier la politique de voisinage, afin qu'elle cesse d'apparaître comme une volonté européenne de soustraire à l'orbite de la Russie une partie de ses voisins. J'ajoute qu'une relation entre l'ouest et l'est de l'Europe ne saurait se développer indépendamment de toute considération sur ce qui se passe au sud ; ce serait oublier tout ce qui se passe entre les deux, dans les Balkans, dans le Caucase, dans le triangle entre l'Irak, la Syrie et la Turquie. Comment mener, en Azerbaïdjan, une politique qui prend la démocratisation pour ligne de mire et ne pas se donner les mêmes moyens en Tunisie, et dans les pays du sud en général ? A négliger cet enjeu, de taille, on encourrait de terribles reproches.

Mon intervention sera de même esprit. Le rapport doit mentionner que la Biélorussie vient d'opter, comme l'Arménie, pour le Partenariat eurasiatique. Et l'on sait que cela n'a pas été sans pression de la part de la Russie.
Il faut aussi prendre en compte la dimension géostratégique du problème, avec le cas de la Transnistrie. La tension est forte. Des élections locales viennent de se dérouler en Moldavie, qui ont fait passer la capitale aux mains des pro-européens, qui tiennent le gouvernement. L'économie de ce pays est très dynamique. La Moldavie devient le nouvel atelier textile de l'Europe. Son agriculture est également très dynamique, au point que les pays européens, inquiets, ne lui offrant guère de débouchés, le pays vient de passer avec la Chine un accord qui va lui ouvrir le marché asiatique. Comment dire à un pays qui se considère comme européen, dont l'économie est dynamique, qu'une adhésion à l'Union européenne est inenvisageable ? Le même problème se pose pour l'Ukraine. Je comprends la difficulté diplomatique, mais si l'on n'offre pas de perspective à ces pays, les populations ne le comprendront pas. Il faut s'y prendre avec beaucoup de précautions, mais ne pas renoncer à considérer qu'elles ont un droit à l'autodétermination. On peut considérer qu'il reste beaucoup de retards - retard économique, problèmes structurels, corruption endémique, État de droit à consolider - mais on a vu, avec le cas exemplaire de la Pologne, qu'ils pouvaient être comblés. Comment dire à ces populations que l'adhésion ne sera jamais possible ? Sauf à considérer qu'on leur oppose une fin de non recevoir au seul motif que c'est le pré carré de la Russie. Au nom de la realpolitik ?
Certes, l'Europe doit faire évoluer ses relations avec son grand voisin, mais on n'en sait pas moins que le prochain conflit aura lieu en Transnistrie, où la Russie, qui y détient encore des millions d'armes, est militairement présente et où le pouvoir, déchiré entre plusieurs influences, est instable. Si le regard de la France, qui a toujours été bienveillant envers son grand allié historique, a évolué, c'est bien parce que la Russie a rompu le principe de non violation des frontières. Au reste, les Chinois, même si les relations avec la Russie se réchauffent, n'apprécient guère non plus, car ils pensent au Tibet. Bref, on va se trouver, dans les mois qui viennent, en Transnistrie, avec une situation très difficile à gérer avec la Russie, l'Ukraine et, au premier chef, la Moldavie.

Au vu des réflexions qui viennent d'être échangées, je crois que nous pouvons encore approfondir notre travail. Ce qui n'enlève rien à la pertinence du Partenariat oriental, voulu, en son temps, par Romano Prodi, comme un glacis de pays alliés et voisins.
Je n'entends pas relancer la polémique sur le partage de la politique de voisinage, mais je citerai simplement ce que j'ai entendu dire par la délégation polonaise que nous avons récemment reçue : si le danger est au sud, le drame, lui, est à l'est. C'est éloquent.

Comme je l'ai indiqué, nos rapporteurs prendront en compte nos échanges en vue de finaliser le rapport.

Notre collègue Claude Kern a participé, le 17 juin dernier, à une réunion interparlementaire à Bruxelles sur l'épineuse question des rescrits fiscaux. Cette réunion était organisée sur l'initiative d'Alain Lamassoure qui préside la commission spéciale du Parlement européen qui a été créée à la suite des révélations de l'affaire « Luxleaks ».
Je lui donne la parole pour qu'il nous dise les enseignements qu'il a tirés de cette réunion.

Cette affaire n'est pas étrangère au regain d'intérêt des États pour un renforcement de la législation fiscale, de même que la nécessité où se trouvent certains États d'accroître leurs recettes fiscales.
L'affaire « Luxleaks » a révélé au grand jour des accords fiscaux préalables, appelés rescrits, souvent très avantageux pour les entreprises comme pour le fisc concerné. De tels accords ont été conclus pour le fisc luxembourgeois par le cabinet de conseil Price Waterhouse Coopers (PWC) pour le compte de nombreux et importants clients internationaux dont Apple, Amazon, Heinz, Pepsi, Ikea et Deutsche Bank, entre autres.
La révélation de ces accords au grand public a permis de mettre en lumière le problème et de chercher une solution à l'échelle européenne, avec un double objectif : éviter de trop grandes distorsions de concurrence et augmenter les recettes fiscales. Invoquant la nécessité d'une harmonisation fiscale européenne, la France, l'Allemagne et l'Italie ont réclamé, le 28 novembre 2014, une directive européenne sur l'optimisation fiscale. Les trois États membres ont, dans ce cadre, demandé, notamment, la mise en place de registres facilitant l'identification des bénéficiaires de sociétés écrans et milité en faveur de l'édiction de mesures contre les juridictions qui favorisent l'optimisation fiscale et les « montages inappropriés » permettant un avantage fiscal.
Ces demandes sont dans le sillage du G20 de 2014 qui appelait à achever le chantier de lutte contre l'optimisation fiscale en 2015 en exigeant l'absolue transparence. La pratique du « tax ruling », ou rescrit fiscal, permet en effet à une entreprise de demander à l'avance comment sa situation sera traitée par l'administration fiscale d'un pays et d'obtenir ainsi certaines garanties juridiques, voire certains avantages. Or, certaines multinationales utilisent cette disposition, qui est parfaitement légale, pour faire de l'optimisation fiscale en répartissant leurs coûts et leurs bénéfices imposables entre plusieurs de leurs branches ou filiales situées dans différents pays, et cela avec l'accord des pays concernés.
Toutes ces initiatives hostiles à l'optimisation fiscale ont conduit la Commission européenne à présenter, le 18 mars 2015, sa proposition sur l'échange automatique d'informations. Elle souhaiterait une entrée en vigueur dès le 1er janvier 2016 pour les « tax rulings » (ou « rescrits fiscaux » dits aussi « décisions anticipatives en matière fiscale »), qui ont un impact frontalier. Les « rulings » concernés par la directive sont les accords donnés par une autorité fiscale d'un État membre qui clarifient ou interprètent une disposition juridique ou administrative relative à la législation fiscale d'un État, et sont relatifs à des transactions transfrontalières, en amont desquelles ils sont accordés.
Il faut savoir que tous les États membres accordent des rulings même si ceux-ci n'ont pas partout la même forme ni la même ampleur. Le champ d'application de ce projet de directive sera naturellement le point le plus discuté par les États membres. Je rappelle qu'au sein du Conseil, il faudra, comme pour toute décision sur la fiscalité, se prononcer à l'unanimité.
Il est prévu que les États membres échangent entre eux mais également avec la Commission, certaines informations sur les rulings et les arrangements préalables en matière de prix de transfert, y compris ceux accordés depuis dix ans. Ces échanges, d'une fréquence trimestrielle, permettront à la Commission d'avoir à sa disposition une image globale de cette pratique. Sur cette base, elle pourra juger de ce qui est acceptable ou pas dans la conception de certains rulings. La Commission n'exclut pas de travailler avec les États pour définir les conditions à réunir avant d'accorder des tax rulings.
Certains demandent, outre l'absolue transparence, un « reporting » pays par pays. M. Alain Lamassoure a déclaré : « La transparence entre les États membres est une première étape. La suivante doit être la transparence maximale possible entre les acteurs économiques eux-mêmes et les consommateurs ».
Dans la continuité de cette politique, on s'attend désormais à ce que la Commission présente d'un moment à l'autre un « paquet législatif » sur la fiscalité des entreprises qui pourrait donner un second souffle à un dossier enlisé depuis quatre ans, celui de « l'assiette commune consolidée sur l'impôt des sociétés » (ACCIS). Les États hostiles à ce projet ont déjà fait savoir qu'il ne doit pas conduire à l'harmonisation fiscale. Certains craignent en effet que la détermination d'une assiette commune définie de la même manière dans tous les États ne conduise à un taux commun à tous les États...
Il faut toutefois raison garder dans la mesure où l'optimisation fiscale est une pratique légale répandue, qui se distingue de l'évasion et de la fraude. Entre l'optimisation et l'évasion ou la fraude, il y a une différence de nature, et non une différence de degré, comme le laissent entendre certaines ONG et même certains gouvernements. En outre, l'optimisation fiscale n'est possible que parce que la législation fiscale varie d'un pays à l'autre dans des proportions importantes. Parfois même, certains États dans le besoin pratiquent ce qui apparaît aux yeux des uns - par comparaison avec la fiscalité lourde et mature des États voisins - comme une forme de dumping fiscal, quand d'autres y voient une pratique concurrentielle. Enfin, les taux d'impôt sur les sociétés - comme la base taxable -, très différents d'un pays à l'autre, apparaissent souvent confiscatoires dans certains États où ils dépassent 30 %, plafond considéré comme la limite extrême du consentement à l'impôt.
Dans ce contexte, il semble en effet plus que jamais nécessaire de réactiver les négociations qui doivent aboutir à l'établissement d'une « assiette communautaire commune de l'impôt des sociétés » (ACCIS). Tant que l'assiette et les taux varient d'un pays à l'autre au sein même de l'Union européenne, on ne peut espérer décourager l'optimisation fiscale.
Cela dit, il faut naturellement préférer que les rescrits fiscaux soient transparents dans la mesure où ils peuvent représenter un frein sérieux à une juste concurrence. En effet, si une entreprise obtient un rescrit fiscal avantageux, la charge d'impôt dont elle est dispensée par le rescrit peut s'apparenter à une aide indirecte de l'État qui a accordé le rescrit. Il n'est pas faux alors de considérer qu'il y a distorsion de concurrence entre les entreprises. Ce qui paraît difficile à déterminer, c'est l'ampleur de cette concurrence déloyale. Et c'est pour cela que l'émergence d'une plus grande transparence est justifiée.
Le rescrit fiscal apparaît aussi comme le produit des efforts toujours plus importants des acteurs économiques pour réduire le poids de l'impôt. Cette tendance doit être analysée comme une réaction de survie face à des systèmes fiscaux européens peu compétitifs. L'optimisation fiscale qu'autorise le rescrit fiscal apparaît dans certains cas comme une réaction rationnelle au malaise généré par les systèmes fiscaux très complexes de nos vieilles démocraties. L'optimisation fiscale est le symptôme d'un véritable dysfonctionnement de nos systèmes fiscaux.
Dans la mesure où l'optimisation fiscale relève d'un choix intelligent à l'intérieur d'un système fiscal donné et avec l'assentiment de ce même système, elle illustre une vérité économique bien connue : les acteurs économisent leurs ressources. Ainsi quand un impôt excessif réduit l'activité et la croissance, ils produisent moins ou ils cherchent à obtenir une moindre pression fiscale. Dans les deux cas, le produit fiscal diminue comme l'a très bien montré Laffer dans sa célèbre courbe dont la signification est traduite par l'adage : « trop d'impôt tue l'impôt ».
Il s'agit donc de comprendre pourquoi certains obtiennent des rescrits fiscaux qu'il faut bien appeler par leur nom : des lois privées, c'est-à-dire des privilèges. Il faut croire que ces rescrits sont une soupape de sécurité dans une économie mondialisée où, si l'on rejette la concurrence fiscale, il y a fort à parier qu'on finira par limiter les investissements. En effet, une moindre pression fiscale devrait permettre un meilleur autofinancement et davantage d'investissements.
En outre, le rescrit fiscal trouve tout son sens dans la mesure où il offre une stabilité et une clarté juridique quand certains États ont laissé se développer l'instabilité fiscale en changeant les règles à chaque loi de finances, instabilité fiscale elle-même source d'instabilité juridique.
Ainsi, l'on voit que la question du rescrit fiscal n'est pas aussi simple à régler puisqu'aussi bien il est le fruit direct de systèmes fiscaux complexes et peu clairs faisant peser sur les acteurs économiques une forte pression fiscale et une grande insécurité juridique. La pratique du rescrit fiscal réintroduit de la souplesse et un peu de bon sens, illustrant l'idée simple dont on s'est écarté qu'un bon impôt doit avoir une large base et un taux faible.
Pour information, Alain Lamassoure a dû renoncer à faire adopter un texte de consensus par les parlementaires des vingt-et-un États membres présents à la réunion, voyant qu'un nombre trop important d'entre eux n'étaient pas prêts à le suivre.

Merci de ces éclairages sur ce que vous avez nommé, par une expression assez savoureuse, une « soupape de sécurité ». Dans une économie mondialisée, on n'atteindra pas l'idéal ; il faut essayer de se situer dans un couloir acceptable.

Il est important de rappeler ce qu'est un rescrit fiscal, et toutes les nuances qu'il peut prendre. Dans certains cas, ce sont des adaptations bienvenues, et un certain nombre de ces rescrits sont, d'ailleurs, publics. Mais c'est loin d'être le cas général : un réel problème de transparence se pose.
C'est bien de compétition fiscale qu'il convient de parler, car le terme de compétitivité, dès lors que tout est déterminé par des négociations, ne veut rien dire. Pour en avoir discuté avec plusieurs ministres de Bercy, je sais que la première demande des entreprises internationales qui envisagent une implantation est de négocier un rescrit.
Il faut rappeler que la commission spéciale présidée par Alain Lamassoure n'est qu'un pis-aller. Elle a été mise en place à défaut d'une commission d'enquête, dont le principe avait recueilli 194 voix, au-delà de la majorité de 188. Par un tour de passe-passe institutionnel, c'est, en fait de commission d'enquête, cette commission spéciale qui a été mise en place, pour six mois, éventuellement renouvelables. Et tout cela pour ne pas déplaire à M. Juncker, dont le gouvernement a négocié secrètement des rescrits fiscaux. On ne peut pas déclarer qu'il faut taxer les GAFA sans balayer devant sa porte. Les parlementaires qui participent à cette commission spéciale, qui n'a rien de partisan, en sont à se demander si l'on ne cherche pas à la saboter : à l'exception de Total SA, toutes les grandes entreprises qu'ils ont souhaité entendre se sont dérobées. C'est le cas de McDonald's, d'Ikea, de Google, de Fiat, de Chrysler, d'Amazon Europe, de HSBC. Quant à certains groupes comme Coca Cola, Barclays, Walt Disney ou Facebook, ils tentent de négocier les conditions de leur audition ! On peut reprocher beaucoup de choses au système américain, mais quand le Congrès met en place une commission, aucune entreprise ne peut se soustraire à une audition. On en est loin ici. C'est même à se demander si une recommandation de ne pas s'y rendre émanant du plus haut niveau de la Commission ne leur a pas été adressée. L'autorité du Parlement est bafouée. Qu'une commission parlementaire, qui ne dispose pas, de surcroît, de pouvoirs exorbitants, ne puisse pas même imposer des auditions à de grands groupes qui bénéficient de rescrits très discutables témoigne d'une réelle faiblesse de l'Union européenne.

Je remercie notre rapporteur. L'échange automatique d'informations est souvent considéré comme la panacée. Mais j'attire l'attention sur ce qu'il se passe déjà pour les personnes physiques. Nombre de conventions bilatérales ont été signées entre États membres, qui mobilisent considérablement les services fiscaux, parce que toutes sont différentes. On en arrive un peu à la situation des services de renseignements... Avoir l'information sans être capable de la traiter ne sert pas à grand-chose. La seule solution est d'aller au-delà, et de décider d'un certain nombre de principes communs. Il ne sera certes pas facile d'en venir rapidement à une assiette fiscale commune, tant ce qui est déductible, pour les entreprises, varie d'un pays à l'autre. Mais c'est un horizon qu'il faut avoir en tête, car l'échange automatique d'information charge la barque des services, au risque d'introduire de l'arbitraire dans les traitements. Ce n'est pas en compliquant les choses que l'on avancera : il faut insister sur la nécessité d'une harmonisation.

Chacun comprend bien que le sujet n'est pas purement technique. Pour certains, une fiscalité excessive justifie l'optimisation fiscale, qui ne serait qu'une mesure de bonne gestion. Soit, mais quid de la transparence ? On en est arrivé, en matière de fiscalité - laquelle n'est pourtant qu'un des paramètres de la gestion des entreprises, à côté de la qualité de la main d'oeuvre, des infrastructures, du prix de l'énergie, etc - à de véritables excès. J'ai récemment rencontré Margaret Hodge, parlementaire britannique qui a travaillé sur la fiscalité des grands groupes comme Starbuck, Amazon, Google. En 2013, Amazon a réalisé, au Royaume-Uni, un chiffre d'affaires de 4,3 milliards de livres et acquitté un impôt de 4,2 millions de livres - 0,1 %. On est assez loin de l'impôt excessif dont il a été question. L'impôt est une loi, votée par un parlement démocratiquement élu. J'ai du mal à imaginer qu'il puisse être négocié. Il existe un barème de l'impôt, auquel personne ne devrait échapper. Il est inacceptable de penser qu'il puisse être négocié, comme on l'a vu faire au Luxembourg. La Commission avait décidé de mener une enquête sur l'affaire Luxleaks : où en sont les évolutions dans ce pays ?
L'harmonisation fiscale n'est certes pas pour demain, tant la compétition fait rage. C'est un chantier immense pour l'Union européenne, qui a déjà du mal à avancer sur ACCIS. La règle de l'unanimité est, sans nul doute, un frein.

Les refus d'audition évoqués par André Gattolin sont une réalité. Alain Lamassoure a lancé un appel aux parlementaires présents pour qu'ils pèsent auprès des autorités de leurs pays, afin qu'elles lui prêtent la main.

La France n'est pas concernée, puisque la seule entreprise française convoquée s'est rendue à l'audition.

C'est juste, mais je crains malheureusement que cet appel ne soit pas répercuté dans tous les pays.
L'harmonisation de l'assiette est bien l'objectif. La première étape est de faire le point sur les déductions, très différentes selon les pays.
Les évolutions au Luxembourg ? La question a été posée, mais la réponse n'est pas venue.

On est loin d'en être, sur ce sujet de la fiscalité, à l'épilogue. Il est vrai que la règle de l'unanimité en matière fiscale conduit à une forme de paralysie. On sait que nos amis anglais sont excessivement sourcilleux sur le sujet...
Nous continuerons à suivre les travaux de la commission Lamassoure, et nous pourrions envisager, le cas échéant, d'adopter une proposition de résolution européenne.

En juin 2014, nous avions adopté une proposition de résolution européenne sur la directive relative à la protection du secret des affaires. C'est Sophie Joissains qui en était la rapporteure. La résolution est devenue définitive le 11 juillet 2014.
Dans le cadre du suivi des résolutions européennes du Sénat, que nous réalisons régulièrement, il était important de faire un point sur l'état des négociations en cours. Je remercie Claude Kern d'avoir accepté de se charger de ce dossier. En outre, je remercie très sincèrement en votre nom à tous Constance Le Grip, qui est rapporteure de ce texte au Parlement européen, d'avoir accepté de venir échanger avec nous aujourd'hui sur ce dossier. Elle nous présentera l'état des travaux en cours au Parlement européen à l'issue de la communication de Claude Kern.
Nous souhaitons développer ce type de rencontres avec les rapporteurs du Parlement européen. C'est une façon d'aller vers une « coproduction législative ». Nous l'avons déjà fait, nous devons le faire davantage. Le traité de Lisbonne invite d'ailleurs à approfondir le dialogue avec les parlements nationaux et le Parlement européen. En outre, c'est une bonne première que de le faire avec une compatriote que je sais à l'écoute des préoccupations du Parlement français et du Sénat en particulier !
Je donne la parole à Claude Kern.

Le 4 juin 2014, notre commission, sur le rapport de notre collègue Sophie Joissains, avait adopté une proposition de résolution européenne, devenue résolution du Sénat le 11 juillet suivant, sur la proposition de directive relative à la protection des secrets d'affaires, que la Commission européenne avait présentée le 28 novembre 2013.
1. Rappel sur la proposition de directive
Je rappelle que ce texte a pour objet de protéger les savoir-faire et les informations commerciales non divulguées, dits « secrets d'affaires », contre leur obtention, utilisation et divulgation illicites.
En effet, les secrets d'affaires ne peuvent généralement pas faire l'objet d'une protection au titre des droits de propriété intellectuelle, qui, eux, font l'objet d'une publication, et leur détenteur n'a donc pas de droits exclusifs sur les informations concernées qui relèvent davantage de la confidentialité. Pour autant, les particuliers comme les entreprises ont un intérêt réel à protéger ce type d'informations.
Or, les lois en vigueur dans les États membres varient fortement en matière de protection offerte contre l'appropriation illicite de secrets d'affaires. Généralement, ceux-ci ne sont ni définis ni protégés et s'inscrivent dans le droit commun de la responsabilité civile. La loi française est ainsi dépourvue de dispositions spécifiques relatives à la protection des secrets d'affaires, mais certains textes permettent de sanctionner l'accès frauduleux à des secrets. C'est le cas de l'article 1382 du code civil qui constitue le fondement du droit commun de la responsabilité civile. Notons que l'article L. 1227-1 du code du travail, reproduit à l'article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle, seule disposition pénale française en la matière, vise le vol de secrets de fabrique par des collaborateurs d'une entreprise1(*).
Le texte de la Commission ne comprend pas de dispositions pénales. En effet, la pénalisation de la captation des secrets d'affaires est quasiment inexistante en Europe et les États membres conservent la faculté d'instituer un délit spécifique qui viendrait compléter l'harmonisation de la procédure civile réalisée par la proposition de directive.
2. La résolution européenne du Sénat
Je rappelle que notre résolution européenne, dont le texte vous a été distribué pour mémoire, approuve l'objectif et les grandes lignes de la proposition de directive, en particulier l'harmonisation de la définition des secrets d'affaires dans l'Union européenne pourvu que cette harmonisation soit minimale. Elle fait de même pour ce qui concerne la reprise dans la proposition de directive de la définition des secrets d'affaires donnée par l'article 39 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC).
Notre résolution européenne fait valoir la nécessité de préserver l'équilibre auquel les négociations au Conseil sont parvenues sur la rédaction de l'article 8 de la proposition de directive relatif à la protection du caractère confidentiel des secrets d'affaires au cours des procédures judiciaires de manière à assurer leur protection tout en respectant les principes fondamentaux de la procédure civile. Elle prend également position sur des questions relatives au respect du principe de la publicité des débats et à plusieurs règles fondamentales de la procédure (accès aux pièces et à l'audience et publicité du jugement, pour l'essentiel).
Le Conseil Compétitivité du 26 mai 2014 avait approuvé à l'unanimité le texte de compromis auquel était parvenue la Présidence grecque et invité la Présidence à entamer les négociations avec le Parlement européen. La résolution européenne du Sénat est venue conforter les orientations qui donnent largement satisfaction aux États membres, dont la France, dans la perspective des débats devant le Parlement européen.
3. Un texte controversé qui a connu des développements nationaux
Il nous a semblé opportun de revenir sur cette proposition de directive dans le cadre du groupe de travail sur la propriété intellectuelle constitué au sein de notre commission, au titre à la fois du suivi des résolutions européennes que nous adoptons et du dialogue avec nos collègues députés européens puisque nous avons la chance de pouvoir échanger avec Constance Le Grip, rapporteure de la proposition de directive au Parlement européen.
Avant d'engager le débat avec notre collègue, je voudrais rappeler que la protection des secrets d'affaires a été évoquée au niveau national à l'occasion de l'examen du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dit « projet de loi Macron ». L'Assemblée nationale avait en effet adopté des amendements présentés en commission par notre collègue député Richard Ferrand visant à introduire les secrets d'affaires et leur protection dans le code de commerce (peine de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende et de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende en cas d'atteinte à la sécurité ou aux intérêts économiques essentiels de la France).
Ces dispositions ont toutefois suscité de nombreuses critiques eu égard aux atteintes qu'elles pourraient porter à la liberté de l'information et à l'action des syndicalistes et des lanceurs d'alerte, en particulier de la part de Transparency International France, des sociétés des journalistes et des rédacteurs de grands médias, de l'Association de la presse judiciaire ou encore du Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne. Ces derniers ont en effet considéré que, sous couvert de lutter contre l'espionnage industriel, les dispositions introduites risquaient d'établir une « censure de fait » et qu'elles pourraient empêcher de rendre publiques des affaires comme celles du Médiator, de l'amiante, de Karachi ou encore du Crédit Lyonnais.
Alors que le gouvernement avait déposé des amendements de manière à prendre en compte ces objections, les dispositions controversées ont finalement été retirées du projet de loi. Sans doute est-ce finalement une bonne chose car la transposition de la directive aurait pu être rendue délicate par la pré-existence d'un texte national.
Le débat se retrouve désormais au niveau européen et vise directement la proposition de directive, soixante organisations issues de neuf États membres, dont la Confédération européenne des syndicats, Wikileaks ou encore le Syndicat des avocats de France, ayant publié une tribune contre ce texte le 8 avril dernier.
Il me semble toutefois que ce texte a souffert d'une incompréhension sur ses intentions véritables. Le débat a viré à la polémique : le texte empêcherait les médias de mener leurs investigations et porterait atteinte aux droits des salariés.
Pourtant, le Conseil avait déjà évoqué ces questions et le compromis auquel il avait abouti comporte des dispositions visant à les prendre en compte. Ainsi le considérant 12 précise-t-il que « la protection des secrets d'affaires ne devrait pas s'étendre aux cas où la divulgation d'un tel secret sert l'intérêt général dans la mesure où elle permet de révéler une faute ou malversation ».
De même, l'article 4, alinéa 2 détermine les cas d'obtention, d'utilisation et de divulgation licites de secrets d'affaires et leurs exceptions, dont l'usage légitime du droit à la liberté d'expression et d'information ; la révélation d'une faute, d'une malversation ou d'une activité illégale, à condition que l'obtention, l'utilisation ou la divulgation présumée du secret d'affaires ait été nécessaire à cette révélation et que le défendeur ait agi dans l'intérêt public ; la divulgation du secret d'affaires par des travailleurs à leurs représentants dans le cadre de l'exercice légitime de leur fonction de représentation, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice ; et la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit national ou le droit de l'Union.
Nos collègues députés ont toutefois souhaité aller plus loin dans la proposition de résolution européenne qu'ils ont adoptée en demandant notamment l'exclusion des activités des journalistes du champ d'application de la directive, le renforcement de la protection des représentants des salariés et l'institution d'une forme d'exemption pour les lanceurs d'alerte agissant à titre individuel dans une démarche citoyenne.
La commission JURI du Parlement européen s'est réunie le 16 juin dernier et a adopté douze amendements qui apportent des modifications substantielles au texte. Constance Le Grip pourra nous en dire plus sur la façon dont le Parlement européen est parvenu à un équilibre entre la lutte contre l'espionnage industriel et la préservation de la liberté d'expression et d'information, ainsi que sur les échéances à venir pour ce texte.
Je vous remercie vivement pour votre invitation. Je suis moi aussi attachée au renforcement de la coopération interparlementaire et je souhaite qu'elle progresse. Il s'agit d'un enjeu pour la consolidation du fonctionnement de nos démocraties et les échanges entre le Parlement européen et les parlements nationaux doivent y contribuer.
Je rappelle que le Conseil avait abouti, le 26 mai 2014, à un compromis sur la proposition de directive relative à la protection des secrets d'affaires. Après les élections européennes de mai 2014, le Parlement européen a repris ses travaux sur ce texte à la rentrée dernière. Sa commission des questions juridiques en est saisie au fond, alors que les commissions du marché intérieur et de la protection des consommateurs, d'une part, et de l'industrie et de la recherche, d'autre part, en sont saisies pour avis. Le vote de mon rapport par la commission JURI a eu lieu le 16 juin dernier et il a été adopté à une très large majorité, soit 19 voix pour, 2 voix contre, et 3 abstentions. À cette occasion, j'ai également obtenu mandat pour engager les négociations en trilogue. Celles-ci devraient démarrer en septembre et il est envisageable que le texte soit définitivement adopté au début de l'année prochaine.
Sur le fond, la commission, à mon initiative, a adopté douze amendements de compromis qui avaient été préalablement négociés avec les principaux groupes politiques. La commission a jugé utile l'existence d'un dispositif juridique permettant de définir ce qu'est un secret d'affaires et donnant aux entreprises un outil pour lutter contre leur divulgation. Elle a également manifesté la volonté de renforcer l'équilibre entre la protection des intérêts des entreprises et de l'innovation contre l'espionnage industriel, qui est aujourd'hui massif, et l'exercice des libertés fondamentales telles que les libertés d'expression et d'information, et la mobilité des salariés. Au cours des auditions que j'ai effectuées, beaucoup d'entreprises ont manifesté leur souhait de disposer d'un outil leur permettant d'instaurer la confiance avec leurs partenaires, et, par conséquent, d'affirmer des obligations de transparence et d'information.
Sur cette base, j'ai proposé un certain nombre de modifications au texte. Ainsi, ont été introduits des considérants allant plus loin dans l'affirmation de l'exercice des libertés d'information et d'expression et la protection des sources des journalistes. En outre, le considérant 12 précise que les États membres doivent appliquer la directive dans le respect de la liberté de la presse et des médias, conformément à la Charte européenne des droits fondamentaux. Ainsi, la directive ne pourra pas faire obstacle à l'exercice de la profession de journaliste. À l'article 1er, relatif au champ d'application du texte, une disposition a été introduite selon laquelle la directive ne doit en rien affecter la liberté et le pluralisme des médias. Le texte de l'article 4 a été restructuré de manière à le dédier aux exceptions. Une référence claire à la Charte européenne des droits fondamentaux et à la liberté des médias a été faite, ce qui aura des conséquences importantes au moment de la transposition de la directive dans les États membres. La référence à la protection de l'intérêt général du public vise les lanceurs d'alerte, même s'il n'existe pas encore de statut européen des lanceurs d'alerte, une réflexion étant toutefois ébauchée sur ce sujet au niveau européen.

J'observe que la notion d'« intérêt général du public » est extrêmement large et, par conséquent, sujette à de nombreuses interprétations. Par ailleurs, le principal reproche que l'on peut adresser à cette proposition de directive tient au flou du concept même de secret d'affaires, alors que les dispositions restrictives, elles, sont très précises. J'observe également une forte augmentation des frais de justice pour les entreprises de presse, de nombreuses entreprises harcelant les journalistes devant les tribunaux. Il faut surtout s'interroger sur l'existence de cas précis de violation des secrets d'affaires. En outre, je crains que l'application de ce texte mette en évidence de fortes inégalités entre ceux qui pourront se défendre en justice et ceux qui n'en auront pas les moyens. Ce texte est très imprécis et repose sur une étude d'impact peu crédible qui a été réalisée sur des critères partiaux et sous l'influence de grandes entreprises. De manière plus générale, on dit vouloir protéger les lanceurs d'alerte, mais cette notion n'est pas définie. Tout cela est incohérent. Je conclurai en posant une question : un rescrit fiscal non public constitue-t-il un secret d'affaires ?
Je partage certaines de vos observations et je note que plusieurs réflexions sont en cours au niveau européen, en particulier sur les lanceurs d'alerte et sur les rescrits fiscaux. Je suis tout à fait favorable à ce que ces notions soient articulées avec la directive sur les secrets d'affaires. Je note également que de nombreuses avancées ont été obtenues sur ce texte depuis sa présentation par la Commission à la fin 2013.

Le déroulement des travaux de la commission sur les rescrits fiscaux présidée par Alain Lamassoure au Parlement européen illustre la difficulté à obtenir des informations de grandes entreprises qui refusent d'être auditionnées, ce qui porte atteinte à l'autorité du Parlement. Je considère que la proportionnalité et l'examen de cas concrets doivent présider à l'élaboration d'un texte législatif. Dans le cas d'espèce, il s'agira de voir quelles entreprises pourront concrètement utiliser ce texte et je doute que ce soit des PME, ne serait-ce qu'en raison du coût élevé des contentieux. Le débat me semble revêtir une dimension bien plus large alors que l'industrie européenne rencontre des difficultés pour se protéger.
Vous avez raison, mais la proposition de directive n'a pas vocation à couvrir ce type de problématique. Il s'agissait initialement de protéger le patrimoine immatériel des entreprises, alors que le brevet européen venait enfin d'entrer en vigueur. Il s'agissait aussi d'harmoniser des dispositions nationales disparates. Je note d'ailleurs que la base juridique du texte est l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui concerne le rapprochement des législations nationales en vue de favoriser le marché intérieur. Les négociations qui vont commencer avec le Conseil vont également permettre d'améliorer encore le texte. Je continue de faire d'ailleurs des auditions, en particulier d'associations de journalistes et de lanceurs d'alerte. L'intention générale de notre commission n'était pas de dénaturer et de vider de sa substance la proposition de directive.

Je remercie encore une fois Constance Le Grip et je propose que l'on revienne sur cette question, éventuellement sous la forme d'une proposition de résolution européenne.
La réunion est levée à 11 h 10.
* 1 Peine d'emprisonnement de deux ans et amende de 30 000 euros.