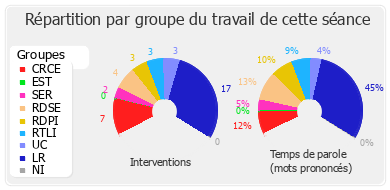Séance en hémicycle du 24 octobre 2017 à 14h30
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à quatorze heures trente-cinq, sous la présidence de M. Gérard Larcher.

La séance est reprise.

L’ordre du jour appelle le débat, organisé à la demande de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sur la revue stratégique de défense et de sécurité nationale.
Pour ce débat, la conférence des présidents a retenu une nouvelle organisation, plus interactive.
L’auteur du débat, en l’occurrence la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, disposera d’un temps de parole de dix minutes, y compris la réplique, puis le Gouvernement répondra pour une durée qui ne devra pas excéder dix minutes. Nous entamerons ensuite une séquence de questions-réponses. Chaque orateur disposera de deux minutes maximum, y compris la réplique, avec possibilité d’une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente.
Dans le débat, la parole est à M. le président de la commission.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste, ainsi que sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et du groupe socialiste et républicain.

Monsieur le président, madame la ministre des armées, mes chers collègues, c’est avec gravité que nous abordons le débat de cet après-midi, dans un monde de plus en plus dangereux, où le terrorisme frappe à nos portes et où la guerre est à nouveau possible, du Moyen-Orient à l’Asie nucléarisée, mais aussi aux frontières de l’Europe, avec l’annexion de la Crimée.
Pourquoi une revue stratégique ? C’est notre commission, par la voix de mon prédécesseur, Jean-Pierre Raffarin, qui avait suggéré dès le mois de juin dernier au Président de la République et à vous-même, madame la ministre, la formule souple d’une revue stratégique plutôt qu’un Livre blanc, pour aller, sans perdre de temps, vers une nouvelle loi de programmation militaire. Au fond, la menace était connue : du terrorisme djihadiste asymétrique jusqu’aux stratégies de puissance dans le haut du spectre – les grandes puissances –, dans un environnement de plus en plus incertain et instable, nous assistions à une accélération de tendances déjà en germe dans le Livre blanc de 2013.
La revue remarquablement menée par le député européen Arnaud Danjean confirme pleinement notre analyse. Je voudrais lui rendre hommage personnellement, car il a accepté de consacrer ses compétences, son temps, voire ses vacances d’été, au service de ce devoir important. Il a su réunir autour de lui une équipe compétente et il nous livre aujourd’hui un diagnostic imparable.
Mettons de côté les deux composantes de la dissuasion, que le Président de la République lui-même, dans sa lettre de mission, indiquait vouloir maintenir et qui sont donc hors du champ du débat. La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées souscrit à cette approche, comme nous l’avons dit dans notre rapport d’information de juin dernier sur la modernisation des forces nucléaires.
Ce qui est frappant, c’est évidemment le décalage, le hiatus, pour ne pas dire la contradiction manifeste entre l’aggravation de la menace décrite par la revue stratégique et l’état de nos armées, aujourd’hui saturées d’engagements – je rappelle que plus de 30 000 hommes sont actuellement en opérations intérieures et extérieures – et fragilisées par une décennie d’éreintement et de sous-investissement. Nous en sommes tous responsables !
La description de la menace est saisissante à la lecture de la revue.
Le durcissement des engagements est vécu chaque jour par nos soldats confrontés, au Mali, en moyenne, à un engin explosif improvisé par jour ou, en République centrafricaine, à des scènes dépassant l’horreur.
Une attaque nucléaire n’est plus, aujourd’hui, impensable. Les crises sont dispersées, depuis les immensités sahéliennes jusqu’à la mer de Chine méridionale et même à l’espace extra-atmosphérique.
L’incertitude, la confusion, les menaces hybrides, les postures d’ambiguïté stratégique sèment le doute partout, répandant ce « brouillard de la guerre », parfois jusqu’au cœur de nos alliances. La menace se numérise : cyberattaques sur nos économies et sur nos systèmes politiques, guerre informationnelle et bataille de la communication.
Nos engagements, enfin, sont écartelés entre un temps politique précipité par la pression médiatique et un temps des opérations, lequel se compte en années, voire en dizaine d’années.
Si la revue n’adopte pas d’approche géographique, une priorité euro-méditerranéo-sahélienne se dessine toutefois, avec une attention particulière portée à notre voisinage immédiat, en particulier à la rive sud de la Méditerranée. Nous y souscrivons pleinement : le danger n’est pas loin. Que se passerait-il si un pays à nos rives était déstabilisé ? Cette revue stratégique doit nous inciter à y réfléchir plus activement.
Forts de ce constat, c’est maintenant vers l’étape d’après que nous devons nous tourner : la préparation de la loi de programmation militaire. Or l’état des armées offre, en comparaison, un singulier contraste. Le maintien d’un modèle d’armée complet et équilibré, prôné par la revue, implique, il faut le mesurer pleinement, un considérable effort sur les moyens, car le modèle est bon, mais il est exsangue !
Trente capacités sont nécessaires pour assumer les cinq fonctions stratégiques. Le maintien de certaines d’entre elles est un défi, la revue le dit sans détour : entrer sur le champ de bataille en premier et durer, en particulier. Entrer en premier sur un théâtre d’opérations, c’est pouvoir agir seul, contre tout type d’ennemi, c’est avoir la capacité d’agréger des alliés, c’est conserver son autonomie stratégique. Cela implique non seulement de combler nos lacunes capacitaires bien connues – moyens de surveillance, ravitailleurs, hélicoptères, moyens de transport stratégique… –, mais aussi de mener une action réparatrice de régénération du potentiel et d’intégration de l’innovation pour conserver notre ascendant sur l’ennemi.
Durer, c’est avoir suffisamment de masse, de chair, pour pouvoir tenir. Or les faits sont têtus.
Nos forces armées ont perdu, entre 2008 et 2015, 50 000 effectifs ; la force opérationnelle de l’armée de terre entrerait tout entière dans le Stade de France, elle compte moins d’effectifs que la RATP !
Les véhicules de l’avant blindé ont quarante ans ; il faudra attendre 2028 pour doter tous les fantassins de leur nouveau fusil d’assaut ; quant au pistolet automatique de l’armée de terre, il a soixante ans.
Parmi les pilotes d’hélicoptères de l’ALAT, 20 % d’entre eux ne sont pas aptes aux « missions de guerre », faute d’heures de vol.
Le format de la marine nationale a fondu ; le programme de frégates multi-missions n’atteindra même pas la moitié de sa cible initiale. Pendant ce temps, la Chine produit chaque année l’équivalent du quart de la marine française. Les pétroliers ravitailleurs, d’âge canonique, ne sont pas aux normes environnementales, les patrouilleurs outre-mer, désarmés, ne sont pas remplacés et les hélicoptères Alouette volaient déjà à l’époque de Fantômas !
Les vingt avions de combat de l’armée de l’air engagés en opérations consomment à eux seuls le potentiel de cinquante appareils en pièces détachées. Les ravitailleurs de l’armée de l’air, qui servent à la dissuasion nucléaire, ont cinquante-cinq ans. Mes chers collègues, c’est comme si nous voyagions toujours en Caravelle quand nous prenons l’avion !
Tout cela démontre l’ampleur du besoin de régénération, de réparation et de modernisation.
Je n’évoque pas le secteur sinistré qu’est le soutien, l’éternel sacrifié, ou l’état déplorable du parc immobilier de la défense. Après avoir bradé l’hôtel de l’Artillerie à Sciences Po ou l’îlot Saint-Germain à la Ville de Paris, mieux vaudrait conserver le Val-de-Grâce pour loger les soldats de Sentinelle.

Il manque 400 logements pour les militaires en région parisienne. La proportion de logements sociaux destinés aux militaires doit d’ailleurs être augmentée dans l’îlot Saint-Germain : cinquante sur un total de deux cent cinquante, ce n’est évidemment pas assez ! Nous en espérons plus dans votre plan Famille.
Pourtant, nos armées gagnent, elles sont respectées. C’est grâce aux hommes et aux femmes qui y servent ! Je salue ici solennellement, en notre nom à tous, leur valeur et leur force morale. C’est leur courage, c’est leur compétence qui font la différence dans l’affrontement des volontés que constitue la guerre. Je salue également l’effort et les sacrifices consentis par leurs familles.
Dans ce contexte, la remontée en puissance des moyens est indispensable. C’est tout l’enjeu de la prochaine loi de programmation militaire.
Le Sénat avait chiffré en juin dernier à 2 milliards d’euros et 4 500 recrutements l’effort supplémentaire nécessaire chaque année à partir de 2018. Nous n’y sommes pas, même si – j’en donne volontiers acte au Gouvernement – l’inflexion positive, pluriannuelle, clairement affichée, nous permet enfin de sortir d’une décennie de déconstruction. Mais quel paradoxe ! On nous fait miroiter une magnifique remontée en puissance, il ne s’agira en fait que d’une « simple » consolidation. Pourquoi ?
Tout d’abord, parce qu’il faut payer les ardoises du passé. Les impasses se chiffrent en milliards d’euros pour les recrutements Sentinelle non financés, sans parler des conséquences de la régulation budgétaire de 850 millions d’euros en 2017, qui sera évidemment tout sauf indolore. Et ce n’est pas fini ! Quand les 700 millions d’euros restant seront-ils dégelés ? Qui va payer les 360 millions d’euros d’opérations restant à couvrir pour clore le budget de 2017 ?
Ensuite, parce que, sous couvert de vertu budgétaire, la loi de programmation des finances publiques organise un véritable transfert de charge vers la défense pour « neutraliser », voire « siphonner » la hausse des crédits annoncée courageusement par le Président de la République. Attention danger ! La « sincérisation des OPEX » – belle expression… – ou la résorption forcée de la « bosse budgétaire » sont en fait des outils pour vider de sa substance l’effort de défense annoncé par le Président de la République.
Or la défense, c’est aussi 200 000 emplois, de haute technologie et non délocalisables ; c’est le premier budget d’investissement de l’État ; ce sont des investissements de rupture et d’innovation, qui tirent toute l’économie ; c’est également 14 milliards d’euros d’exportations par an.
Nous ne sommes pas seulement confrontés à un enjeu de souveraineté, il s’agit aussi d’une question économique de premier plan, sans parler des dimensions sociale et territoriale, évidentes pour les élus que nous sommes. Les armées intègrent, forment et remettent sur le marché du travail des jeunes qui trouvent un emploi.
Madame la ministre, vous le voyez, il nous reste du travail. Après cette revue stratégique, les choses sérieuses commencent. Vous pouvez compter sur le Sénat, sur notre vigilance et notre combativité pour ne pas laisser les armées aux seules mains des comptables. Il faut reconstituer une force armée solide et apte à répondre fermement aux désordres du monde. La revue stratégique en démontre la nécessité, mais notre plus forte exigence reste la sécurité de la France !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste, ainsi que sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, du groupe La République En Marche et du groupe socialiste et républicain.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, dès son élection, le Président de la République a souhaité que soit menée une revue stratégique. Cette étude avait un objectif : produire une analyse fine et complète de la situation stratégique internationale et en tirer les conséquences pour notre défense. J’ai confié ce travail à un comité d’experts venus de toutes les disciplines et présidé par M. Danjean, qui a abouti à cette revue stratégique à la fois lucide et ambitieuse pour nos armées, fixant un cap clair et une vision pour la prochaine loi de programmation militaire.
Dans quelques instants, je répondrai aux questions que ce document pose sur notre environnement stratégique et l’avenir de notre défense. Je suis particulièrement heureuse de pouvoir le faire par ces échanges que vous avez voulus plus libres et plus francs et qui permettront d’aborder vos interrogations – celles de la représentation nationale – sans tabou ni fausse pudeur, ce qui est précisément l’objectif de la revue stratégique.
Ce travail était un exercice ambitieux. Il visait, bien sûr, à actualiser l’analyse menée dans le Livre blanc de 2013. Depuis quatre ans, le monde a sans doute changé plus vite et plus fortement que nous nous y attendions. Plus largement, cette revue a permis d’identifier les intérêts de la France dans un contexte particulièrement imprévisible et mouvant. Elle prépare l’avenir de notre défense, définit notre vision en France et en Europe et, enfin, établit les aptitudes requises pour atteindre notre ambition.
La revue stratégique fait d’abord un constat : aujourd’hui, la France est plus sollicitée et plus engagée qu’elle ne l’a été depuis longtemps. La menace du terrorisme djihadiste reste centrale pour notre sécurité. Nos ennemis ont changé d’organisation, de visages, de noms, mais ils sont encore plus violents et peut-être encore plus déterminés. Ne nous y trompons pas, la prise de Raqqa et la défaite, sans doute très proche, de Daech ne signifient pas la fin du terrorisme, de son idéologie et de sa barbarie.
À cette menace s’ajoute une instabilité croissante aux portes de l’Europe. J’ai à l’esprit les vulnérabilités persistantes dans le Sahel, la déstabilisation durable du Proche et du Moyen-Orient ou la crise migratoire, mais aussi des phénomènes plus larges qui nous touchent et qui appellent le monde entier à s’adapter : les risques pandémiques, les dérèglements climatiques, les trafics ou la criminalité organisée.
Face à ces menaces, la France répond fermement et chaque fois que c’est nécessaire. Elle est impliquée dans un grand nombre d’opérations, supérieur à nos prévisions. Nos armées sont très sollicitées, à l’extérieur comme sur le territoire national, avec pour conséquence une forte mise sous tension de nos capacités et de nos ressources.
La revue stratégique, ensuite, prend acte de ce que nous soupçonnions déjà : l’équilibre du monde tel que nous le connaissions à la sortie de la guerre froide est révolu. L’environnement stratégique est aujourd’hui articulé autour de multiples pôles dont les équilibres, les forces et les intentions sont changeants et parfois imprévisibles. Chaque État cherche à affirmer sa puissance, notamment militaire, et entre dans une logique de compétition pour l’accès aux ressources, pour le contrôle des espaces stratégiques et pour l’armement.
C’est l’objet d’un troisième constat dressé par la revue : nos forces sont plus contestées et nos ennemis plus équipés et mieux armés. La diffusion des technologies et la dissémination d’équipements conventionnels modernes ont permis à certains acteurs de détenir et de maîtriser des capacités qui, il y a peu, étaient seulement accessibles à certains États.
Les terrains de conflits évoluent eux aussi. À la terre, à la mer et aux airs, qui nous étaient familiers, s’ajoutent désormais l’espace et le cyberespace. Ceux-ci sont devenus des domaines d’affrontement à part entière, impliquant des acteurs parfois inconnus ou intraçables, dont les actes peuvent avoir des conséquences dramatiques sur notre sécurité et sur le quotidien de nos concitoyens.
Enfin – c’est le quatrième constat issu de la revue stratégique –, les nouvelles technologies ont radicalement changé nos forces et nos vulnérabilités. Elles représentent une opportunité formidable. L’intelligence artificielle, la robotique ou les biotechnologies déboucheront sans doute sur des applications militaires décisives. Cependant, la révolution technologique est aussi un enjeu, car nous devons la saisir pleinement, sous peine d’être dépassés. Enfin, elle peut également devenir une source de vulnérabilité. C’est pourquoi l’espace numérique, dans son ensemble, doit se trouver au centre de nos priorités.
Dans cet environnement stratégique à la fois instable et imprévisible, la France est et restera une puissance majeure. Elle continuera à intervenir partout où ses intérêts sont menacés. Sa voix sera entendue, écoutée et respectée.
Notre autonomie stratégique n’est pas négociable. Nous la consoliderons, notamment en renouvelant les deux composantes de la dissuasion nucléaire. Nous poursuivrons nos efforts en faveur du renseignement et nous renforcerons de front les cinq fonctions stratégiques : dissuasion, prévention, protection, intervention et connaissance et anticipation, en prêtant une attention particulière à la prévention des risques et des conflits.
L’assurance de notre autonomie stratégique passe également par un modèle d’armée complet et équilibré. C’est le gage de notre souveraineté comme de notre liberté. Nous devons être en mesure de détenir toutes les aptitudes et toutes les capacités pour répondre à toutes les menaces.
Nous protégerons et nous garantirons notre autonomie totale dans les domaines de la dissuasion, de la protection du territoire et de ses approches, du renseignement, du commandement des opérations, des opérations spéciales ou de l’espace numérique. Dans les autres champs, nous mènerons les partenariats et les coopérations nécessaires pour assurer la pleine capacité d’action de nos forces.
Nous assumerons pleinement notre dimension européenne. Nous avons tout intérêt à ce qu’une défense européenne puisse se construire autour d’intérêts partagés. La France, comme l’a indiqué le Président de la République à la Sorbonne le 26 septembre dernier, sera à l’initiative de cette dynamique. Nous avancerons avec ceux qui le peuvent et ceux qui le souhaitent. Nous assumerons également pleinement nos responsabilités au sein de l’OTAN et nous renforcerons nos partenariats bilatéraux partout dans le monde.
Quand je parle d’Europe, je pense aussi à notre industrie. Nous devons accompagner et encourager le développement d’une industrie européenne de défense solide et réputée. Plus largement, l’industrie et la recherche doivent être au fondement de notre stratégie. C’est un socle économique puissant, une garantie du succès de nos exportations comme de notre innovation.
L’innovation, justement, nous devons la prendre à bras-le-corps, en faire notre force et notre moteur. Je parle d’innovation technologique, de recherche, mais également de cet esprit d’innovation qui doit guider toutes les femmes et tous les hommes de la défense. L’audace doit les accompagner dans leurs décisions, dans la recherche de processus plus efficaces, dans la modernisation de notre action. Cet esprit d’innovation est une condition pour l’attractivité de la défense, pour l’efficacité de nos missions et donc pour la sécurité et la liberté des Français.
Cette revue stratégique nous offre un apport immense : identifier nos aptitudes prioritaires et agir, agir vite et fermement. Ce sera précisément l’objet de la prochaine loi de programmation militaire à qui la revue donne un corps et une vision.
Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, ainsi que sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.

Je tiens à remercier Mme la ministre des engagements très forts qu’elle a pris. Comme je l’ai dit, nous l’accompagnerons. Je veux simplement la mettre en garde contre les dangers qui, au-delà de Bercy, nous guettent. L’actualité récente nous fournit quelques sujets d’inquiétude : il faut absolument que le Gouvernement obtienne que les militaires soient exclus de la directive sur le temps de travail, faute de quoi des milliers d’emplois disparaîtront de nouveau – c’est une véritable préoccupation.
Par ailleurs, le service national universel est une belle idée, mais les armées ne peuvent pas la porter seules : il n’y a pas de nécessité au titre des seules armées, c’est peut-être une nécessité sociale. Aussi, nous contribuerons, si vous nous y associez, comme vous en avez pris l’engagement, à travailler sur ce sujet.
Soyons vigilants à reconstituer une belle armée, dont notre sécurité a absolument besoin !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste. – M. Bernard Cazeau applaudit également.

Nous allons maintenant procéder au débat sous forme de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents.
Les auteurs de questions disposent chacun de deux minutes, y compris la réplique. Le Gouvernement a la possibilité d’y répondre pour une durée équivalente.
Dans le débat interactif, la parole est à Mme Hélène Conway-Mouret.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ainsi que le Président de la République l’avait annoncé le 13 juillet dernier à l’hôtel de Brienne, la revue stratégique examine notre environnement et les menaces auxquelles nous sommes confrontés. Elle s’inscrit d’ailleurs très naturellement dans le sillage du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013. On y retrouve la même volonté de jeter un regard lucide et sans concession, pour reprendre vos mots, madame la ministre, sur un contexte « en dégradation rapide et durable », tout en affirmant notre ambition de maintenir notre autonomie stratégique. Elle dresse le constat d’un durcissement des environnements opérationnels, avec le retour des États-puissance – la Russie – ou la fragilisation croissante de certains acteurs étatiques, ou de l’omniprésence des menaces terroristes ou cyber toujours plus diffuses.
S’y ajoutent « des fragilités multiples » : démographie, climat, risques sanitaires, criminalité organisée.
On ne peut donc que saluer la volonté de relever le défi pour le quinquennat en cours de conserver un modèle de défense complet et équilibré pour agir et répondre à l’ensemble des menaces. Néanmoins, l’intention affichée par la revue stratégique se heurte à la dure réalité des premières annonces. En effet, comme l’a rappelé le président Cambon, outre la coupe budgétaire de juillet dernier qui a affecté les armées à hauteur de 850 millions d’euros, l’intégration au budget de la défense des mesures de « resoclage » budgétaires des OPEX, qui dépassent les 200 millions d’euros par an, le financement des mesures non prises en compte dans la loi de programmation militaire actuelle, décidées en 2016, à savoir 996 millions d’euros, auxquels s’ajoutent les coûts à venir engendrés par le renouvellement des deux composantes de la dissuasion nucléaire, ne doivent pas compromettre la poursuite d’autres programmes pour nos armées sur le terrain.
Certes, l’orientation de notre budget de la défense est à la hausse, avec une augmentation de 1, 8 milliard d’euros pour 2018 et 1, 7 milliard d’euros en 2019 et 2020. Mais cette hausse utile se révèle en réalité bien limitée.
Je vous remercie, madame la ministre, de nous apporter des garanties sur la question centrale des moyens, point d’inquiétude majeure pour nos armées, mais également, et plus généralement, pour nos concitoyens, car il y va aussi des questions de sécurité intérieure.
Je vous remercie tout d’abord, madame la sénatrice, d’avoir reconnu la qualité du travail réalisé par le comité des experts. Je les remercie moi-même d’avoir insisté sur la double nécessité de réaffirmer une ambition et une autonomie stratégique propres à la France, sans pour autant écarter, bien au contraire, la construction de partenariats.
Vous appelez mon attention sur le fait que, au-delà des grands engagements, il faut évidemment tenir un certain nombre de promesses. C’est exactement dans cet esprit que s’est inscrit le Gouvernement. Les premières décisions du Président de la République témoignent d’une remontée en puissance d’un budget qui, comme cela a été rappelé, a été malmené au regard de l’écart croissant entre les engagements qui sont allés bien au-delà de ce que la présente loi de programmation militaire prévoyait et les moyens qui, pour ce qui concerne, en tout cas, la première période de la loi de programmation, étaient en forte déflation, même si un coup d’arrêt a été réalisé en fin de période.
Durant le quinquennat, la remontée en puissance sera très significative : 1, 8 milliard d’euros en 2018 et, les années suivantes, 1, 7 milliard chaque année. Ce sont 30 milliards de plus par rapport au quinquennat précédent qui seront alloués au budget du ministère des armées.
Néanmoins, vous avez raison d’appeler mon attention, la vigilance s’impose quant aux décisions qui peuvent se prendre ici ou là.
Permettez-moi de profiter des dix-huit secondes qui me restent pour vous dire que les 850 millions d’euros d’annulations de crédits étaient en quelque sorte le prix collectif à payer pour régler un certain nombre d’impasses budgétaires, notamment celle qui portait, par exemple, sur le financement des OPEX, mais pas seulement. C’est un coup d’entrée, si je puis dire, dans le quinquennat. J’exercerai la plus grande vigilance pour faire en sorte que ces annulations de crédits n’aient pas d’impact, comme je m’y suis engagée, sur les forces, en particulier nos forces en opération.
Par ailleurs, le président de votre commission nous a invités à faire preuve d’une grande vigilance à l’égard du ministère des finances et, croyez-moi, je m’y attelle.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la revue stratégique souligne à quel point nos armées sont sollicitées de façon croissante, dans un contexte de durcissement, d’instabilité et de diffusion des menaces.
La défense et la sécurité nationale, c’est avant tout des femmes et des hommes qui s’engagent pour notre pays. Leurs engagements impliquent leurs familles, qui en subissent les conséquences de plein fouet. Le récent rapport du Haut Comité d’évaluation de la condition militaire met en évidence de forts enjeux de fidélisation. Difficulté à concilier vie militaire et vie personnelle, mobilité professionnelle du conjoint, reconversion, lassitude face aux difficultés rencontrées en matière d’hébergement sont autant d’écueils.
Je voudrais insister ici en particulier sur la politique immobilière du ministère. Même si les crédits vont augmenter en 2018, le parc est très dégradé, sa maintenance ayant été longtemps sacrifiée pour préserver les dépenses d’infrastructures des grands équipements, des grands programmes d’armement.
Le rattrapage doit s’inscrire dans la durée et se poursuivre résolument. Il manque 400 logements de militaires en région parisienne. Les logements sociaux de l’îlot Saint-Germain ne seront que partiellement affectés aux familles des militaires : 50 sur 250. C’est insuffisant, d’autant que cet immeuble subit une forte décote, de près des deux tiers de son prix, ce qui représente un préjudice important pour le budget des armées.
Dans ce contexte, peut-on se passer du Val-de-Grâce, alors que la revue mentionne que les enjeux de protection du territoire vont durer, particulièrement en Île-de-France, et que les besoins de nos soldats en termes d’hébergement sont considérables ?
Vous avez raison, monsieur le sénateur, de pointer du doigt l’une des difficultés sans doute majeures qu’éprouvent les militaires et leurs familles en matière de logement.
Vous avez rappelé la nécessité de fidéliser nos soldats. Le récent rapport du Haut Comité d’évaluation de la condition militaire a fait état de chiffres qui montrent qu’il n’y a pas de difficultés particulières en matière de recrutement pour nos soldats. En revanche, il convient de porter une attention particulière pour assurer la fidélisation dans le temps ; le logement y contribue probablement ou insuffisamment, suivant où l’on se place.
Pour ce qui me concerne, l’immobilier est une priorité. L’augmentation du budget du ministère le montre, avec 1, 2 milliard d’euros en 2017 et 1, 5 milliard d’euros en 2018.
Par ailleurs, dans le cadre du plan Famille que j’annoncerai prochainement, un chapitre entier sera consacré à la question du logement, tant celle-ci est majeure.
Il est vrai que nos emprises ont fait l’objet d’une réorganisation en profondeur en Île-de-France du fait de la mise en service, si je puis dire, du grand ensemble de Balard il y a quelques mois. C’est dans ce contexte que le Val-de-Grâce ainsi que l’îlot Saint-Germain ont été mis en vente, dans des cadres différents.
Pour ce qui concerne le Val-de-Grâce, c’est une cession en bloc qui a été décidée dans son principe. Elle fait l’objet d’un appel à projets, qui est géré par la Ville de Paris. Concernant l’îlot Saint-Germain, c’est-à-dire la seconde fraction, celle-ci sera cédée par morceaux ou par sous-ensembles.
Vous avez appelé mon attention sur le fait que des décotes importantes ont été réalisées pour les emprises qui avaient déjà été cédées. C’est en effet un sujet de préoccupation, mais, vous le savez, ces décotes sont aussi la contrepartie d’autres engagements, qui permettent également de récupérer, dans le cadre des emprises cédées, un certain nombre de logements pour nos militaires. Il nous revient de trouver le point d’équilibre entre un prix de cession convenable et un nombre de logements obtenus en contrepartie satisfaisant.

Madame la ministre, votre réponse ne me satisfait pas pleinement pour ce qui concerne le Val-de-Grâce. Nous souhaitons voir clairement figurer dans la future loi de programmation militaire la résolution qui sera la vôtre de faire en sorte que les questions immobilières ne soient pas un rattrapage de l’instant, mais qu’elles s’inscrivent véritablement dans la durée.
S’agissant du plan Famille, nous serons évidemment très vigilants sur le fait d’y trouver toutes les données que nous attendons, notamment les annonces du Gouvernement.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, dans un monde en pleine mutation, où les dangers se multiplient et les périls s’accentuent, notre pays doit adapter et faire évoluer ses réponses en termes de défense, de sécurité et de protection. La revue stratégique le fait avec mesure et intelligence.
Je tiens, madame la ministre, à saluer la qualité du travail réalisé dans des délais contraints, tout en rattachant cette analyse pointue de la capacité militaire de la France au récent plaidoyer du Président de la République pour une Initiative pour l’Europe, Europe qui est, permettez-moi de le citer, « notre histoire, notre identité, notre horizon, ce qui nous protège et ce qui nous donne un avenir ».
Je m’attarderai sur un point précis que je considère comme essentiel, l’Europe de la défense et, plus précisément, le fonds européen de la défense.
Oui, les défis à relever aujourd’hui et demain en termes de sécurité et de défense sont multiples et complexes ! Les États membres ne sont pas en mesure de les relever seuls. Et il n’appartient pas à la France de les relever seule…
Avec l’annonce de la création de ce fonds européen le 7 juin dernier, ce constat est désormais contrarié. Il s’agira dorénavant de coordonner intérêts nationaux et autonomie stratégique, industrielle et technologique de l’Europe, d’offrir à l’ensemble des États membres des ressources militaires communes, ce qui permettra ainsi à l’Union européenne de mettre en œuvre une véritable politique de coopération en matière de défense. La Commission a annoncé que son financement aurait lieu selon les cycles budgétaires de l’Union européenne et à partir de financements nationaux.
Madame la ministre, ma question est simple : pouvez-vous nous apporter des précisions sur le calendrier de mise en activité de ce fonds ainsi que sur les estimations en termes de coûts et d’économies pour notre budget national ?
Vous l’avez rappelé, monsieur le sénateur, l’un des objectifs fixés par le Président Macron lors de son intervention à la Sorbonne est de faire en sorte que l’Union européenne dispose à l’avenir d’un véritable budget commun de défense. De ce point de vue, le fonds européen de la défense, qui est en cours de création, constitue l’une des premières pierres de cette politique, même si le Président de la République nous appelle à aller au-delà.
Il faut aussi saluer les efforts récents que consentent ensemble les Européens. Cela est certainement lié à une prise de conscience de l’importance des menaces qui pèsent tout autour de l’Europe pour avancer dans le domaine de l’Europe de la défense.
Le fonds européen de la défense est une étape vraiment décisive puisqu’il permettra de financer la recherche de défense ainsi que certaines phases de développement de programmes capacitaires, notamment le développement de prototypes. En effet, l’Union européenne s’apprête à accepter de financer à hauteur de 20 % de telles dépenses, contrairement à ce qui se faisait auparavant.
Le financement partiel du développement de programmes capacitaires est une proposition phare de la Commission qui, au-delà, souhaite pouvoir créer un programme européen de développement industriel de défense.
Vous m’avez interrogée sur le calendrier de mise en œuvre de ce fonds. L’objectif est d’adopter le règlement permettant d’engager ces dépenses dans les prochaines semaines ; une réunion aura lieu au mois de novembre à Bruxelles sur cette question. De plus, il est envisagé d’affecter 500 millions d’euros en 2019, 500 millions d’euros en 2020, puis, pour les années suivantes, de passer à 1 milliard d’euros par an.
Il conviendra évidemment d’être très attentif aux modalités de mise en œuvre, en vue de nous assurer que les projets financés soient bien définis par les États eux-mêmes.
Naturellement – mais il vaut mieux le dire –, ces fonds bénéficient à la base industrielle et technologique de défense européenne.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, j’ai lu avec intérêt la revue stratégique de défense et de sécurité nationale. On y insiste sur la remise en cause des certitudes et le brouillage des lignes, comme le monde en connaît depuis la chute du mur de Berlin.
Face à un monde de plus en plus chaotique, complexe et souvent incertain, notre diplomatie a besoin d’un cadre d’action fort, cohérent et ambitieux.
Nous avons aujourd’hui le devoir d’œuvrer en faveur d’un ordre collectif, avec nos alliés et tous nos partenaires. Pour ce faire, la revue préconise plusieurs axes forts pour renouveler la diplomatie de la France : une sécurité qui prenne en compte l’émergence de nouveaux acteurs ; une indépendance qui impose de revisiter les termes de la souveraineté, y compris européenne ; enfin, une influence qui va de pair avec la défense des biens communs universels.
À cet égard, mon interrogation porte sur l’enjeu que constitue le renseignement économique et financier, sujet actuellement à la croisée de diverses sphères et de plusieurs administrations. En effet, nos impératifs de sécurité nationale s’étendent non seulement à la défense du territoire, mais aussi à la préservation des capacités économiques de la Nation. L’interdépendance et la concurrence économiques à l’échelle mondiale se sont accrues et se révèlent des sources importantes de tensions et de conflits possibles entre les États. L’information s’avère désormais une condition essentielle de la compétitivité.
Dans le cadre de la nouvelle loi de programmation militaire, je souhaite connaître les intentions de Mme la ministre des armées concernant le développement de l’intelligence économique, sachant que son importance reste sous-évaluée en France, contrairement à nos partenaires anglo-saxons qui en ont fait une de leurs priorités en matière de renseignement.
Vous avez raison de le souligner, monsieur le sénateur, le renseignement économique et financier est un enjeu absolument majeur pour la protection de nos intérêts vitaux, si je puis dire. Au travers des intérêts de nos entreprises, il y va des intérêts du pays.
Cette question est à l’intersection de l’action de plusieurs ministères, et le ministère des armées y contribue naturellement. En effet, il participe à l’accompagnement des capacités économiques de la Nation.
Ce renseignement recouvre différentes thématiques : une thématique politico-économique, une thématique concurrentielle, technologique ou bien financière. Pour ce qui nous concerne, nous nous intéressons à la lutte contre l’ingérence économique extérieure.
De ce point de vue, je veux souligner le travail réalisé par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, qui contribue à déceler et neutraliser les menaces affectant le potentiel scientifique et technique de la Nation.
Ce combat a enfin une dimension cybernétique, un domaine dans lequel les services de renseignement et l’état-major des armées jouent là encore, aux côtés de l’ANSSI, un rôle central.
Vous m’interrogez sur les moyens. Ceux-ci sont en constante augmentation : de 2014 à 2017, les fonctions globalement entendues de cyberdéfense et de renseignement auront vu leurs effectifs augmenter de près de 1 800 emplois. Pour ce qui concerne la seule année 2018, dans le cadre du prochain budget qui sera soumis à votre approbation, ces effectifs augmenteront encore de 848 emplois. Il s’agit d’une dynamique que nous souhaitons poursuivre ; mais nous aurons bien entendu le loisir d’y revenir dans le cadre de la prochaine loi de programmation militaire. Je n’en doute pas, nous chercherons à maintenir cette priorité.

Madame la ministre, la parution de la revue stratégique de défense et de sécurité nationale me laisse perplexe sur bien des points, notamment pour ce qui concerne le développement de programmes nucléaires en France.
Au-delà du traité de non-prolifération des armes nucléaires, auquel notre pays n’a adhéré qu’en 1992, 122 pays ont adopté en juillet dernier à l’ONU un traité d’interdiction des armes nucléaires. Dans ce contexte, comment expliquer le refus de notre diplomatie de participer a minima aux discussions menées à l’ONU ?
Par ailleurs, comment expliquer le poids toujours plus important de la part de la dissuasion nucléaire dans notre budget ?
Madame la sénatrice, le désarmement nucléaire reste un sujet de préoccupation majeur pour notre pays. Il est nécessaire si l’on veut aboutir un jour à un monde sans armes. Ce principe de désarmement est actuellement encadré par un traité de non-prolifération, qui reste aujourd’hui la norme fondamentale en matière de désarmement nucléaire.
Par ailleurs, un traité d’interdiction a été récemment signé, et le prix Nobel de la paix a été attribué au mouvement ICAN. Pour légitime qu’il soit, ce traité d’interdiction ne tient pas compte, de notre point de vue, de la réalité géostratégique actuelle. Pourquoi ?
On le voit bien, les démonstrations de force actuelles de certaines nations, tel le programme nucléaire nord-coréen, traduisent l’émergence d’une menace vitale pour notre pays que peuvent représenter les États qui cherchent à adopter l’arme nucléaire. Il nous semble donc tout à fait prioritaire, essentiel même, de prendre toutes les mesures visant à renforcer la non-prolifération et le désarmement dans le cadre des structures internationalement reconnues aujourd’hui.
Ne vous méprenez pas sur mes propos, la France est et reste adhérente au traité de non-prolifération, et elle mettra toute son énergie pour faire en sorte que celui-ci soit respecté et mis en œuvre.

Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse, qui me satisfait au moins sur un point : vous insistez sur le traité de non-prolifération. Le groupe CRCE demande évidemment à aller bien au-delà.
Les superpuissances, dont nous faisons partie, ont manqué, selon nous, une occasion historique avec le traité d’interdiction des armes nucléaires. C’est un peu comme si l’on avait remis en cause la volonté des 122 pays qui l’ont signé. Certes, vu le contexte, dites-vous, on doit se préparer à intervenir au regard des conflits qui existent dans le monde entier. Vous avez évoqué la Corée du Nord, mais il y a aussi les États-Unis, voire peut-être le Japon, en pleine réflexion.

Comme l’a dit le président de la commission, plus l’escalade est grande, plus on a tendance à renforcer la dissuasion nucléaire. Or c’est ce que nous souhaitons remettre en cause.

La revue stratégique montre que la présence des armées sur le territoire national est appelée à durer. Au-delà de la menace terroriste, il y a les enjeux migratoires, le contrôle des frontières, la protection des événements sportifs et culturels notamment.
L’évolution récente de l’opération Sentinelle semble au final assez homéopathique : elle permettra sans doute à l’armée de terre de sortir du sur-régime, mais le totem des 10 000 soldats est toujours là, et l’articulation avec les forces de sécurité intérieure n’est pas repensée en profondeur.
La vraie question me semble aller au-delà des effectifs et de l’articulation des différentes forces. Il faut s’interroger sur le rôle même de l’armée en matière de sécurité intérieure. Est-ce, par exemple, à l’armée d’assurer des missions de police aux frontières ?
Alors que les forces de police et de gendarmerie sont à bout de souffle après des mois de lutte contre le terrorisme et de maintien de l’ordre, l’armée elle-même extrêmement sollicitée sur les théâtres extérieurs fait office de palliatif.
L’opération Sentinelle devait être provisoire, comme, d’ailleurs, l’état d’urgence. On sait aujourd’hui que la menace terroriste ne cesse de se renforcer. Les revers de l’État islamique en Irak et en Syrie font craindre le retour rapide des djihadistes français et de leurs familles, qui cultivent la haine des juifs, des mécréants et de toutes nos valeurs humanistes et républicaines.
Ne faut-il pas alors, madame la ministre, repenser complètement le système et clarifier la situation afin de savoir si nos armées doivent se concentrer sur les opérations extérieures ou assurer la sécurité intérieure, à moins que vous ne souhaitiez renforcer considérablement leurs effectifs ?
Madame la sénatrice, je crois que l’armée est bien dans son rôle lorsque, dans un certain nombre de cas très particuliers, elle apporte sa contribution aux forces de sécurité du ministère de l’intérieur. C’est le cas pour la lutte contre les feux de forêt ; cela a été le cas, de manière éclatante, lorsque l’ouragan Irma a saccagé les îles des Antilles.
Des savoir-faire et des matériels particuliers viennent donc en appui de tous les secouristes, civils ou autres, qui se sont engagés sur ces terrains. De ce point de vue, la présence du bâtiment de projection et de commandement Tonnerre a été un appoint décisif pour ce type d’opération. À cet égard, je rends hommage à tous ceux qui se sont mobilisés.
S’agissant de l’opération Sentinelle, beaucoup de débats ont en effet eu lieu. Les militaires doivent-ils passer du temps pour défendre le territoire national ? La réponse a été donnée de façon extrêmement claire.
D’une part, des moyens importants ont été conférés à l’armée de terre, qui a vu le nombre de ses effectifs progresser de manière importante pour pouvoir répondre à ses besoins. D’autre part, l’efficacité des interventions réalisées par les hommes et les femmes qui sont engagés dans cette opération se passe de longs discours. Leur présence est sécurisante, dissuasive. Lorsqu’ils font face à une menace, ils agissent avec professionnalisme et protègent la sécurité des Français.
Il ne s’agit pas du tout de mélanger les genres. Il faut continuer à entraîner et à maintenir nos soldats dans des opérations qui se déroulent sur des fronts extérieurs. Néanmoins, il faut aussi continuer à les entraîner à une mission différente, mais tout aussi utile à notre pays, à savoir la protection du territoire national.

Je vous remercie de cette réponse, madame la ministre. Je veux simplement appeler de nouveau votre attention sur l’état d’épuisement de nos forces armées, de ces hommes et de ces femmes qui se dévouent au quotidien pour défendre nos valeurs et protéger nos vies.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la revue stratégique présentée la semaine dernière devant la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées par Arnaud Danjean est un document « solide », pour paraphraser le président Cambon. Je souhaite remercier et féliciter son auteur, ainsi que le comité de rédaction, de ce travail remarquable : ils ont travaillé vite et bien, ce qui nous permet de nous concentrer sur la loi de programmation militaire sans perdre de temps.
Madame la ministre, la revue prône le maintien d’un modèle d’armée complet et équilibré. Entre les menaces diffuses de basse intensité et le retour des États-puissance, il va falloir dessiner des priorités pour nos armées. Dans ce contexte, il s’agit de définir les pays européens volontaires politiquement et, surtout, capables militairement de participer à une coopération. Des choix stratégiques majeurs vont devoir être faits ; les sujets sont évidemment nombreux, mais il en est un sur lequel je souhaite m’arrêter, celui des drones.
Je souhaite saluer votre décision de suivre les recommandations que Gilbert Roger et moi avions formulées dans un rapport, celle d’armer nos drones.
Se pose aussi la question de la surveillance aérienne du territoire national, qui doit être repensée. La surveillance des frontières ou des grands événements comme les Jeux olympiques de 2024 est à préparer dès maintenant.
Les drones sont un nouvel outil à exploiter. Les besoins et les demandes en la matière vont exploser et, tout comme nous ne faisons plus aujourd’hui d’opération militaire sans un drone, sans doute demain n’organiserons-nous plus aucune manifestation ni aucun grand événement sans un drone.
Les Harfang seront prochainement retirés du service, les Reaper et les Patroller seront largement, voire exclusivement mobilisés pour les opérations extérieures. La prochaine loi de programmation militaire permettra peut-être – vous nous le direz – de mobiliser de nouveaux moyens de nature à aller dans le sens que je viens d’évoquer.
Enfin, quelle étape supplémentaire faut-il franchir pour préparer l’avenir ? Envisagez-vous de passer du drone armé au drone de combat ? Quel sera le système de combat du futur ?
Vous le savez mieux que personne, monsieur le sénateur, les drones sont devenus un système d’arme incontournable dans les opérations modernes, auxquelles ils apportent, d’une part, une capacité à durer sur les zones d’action et, d’autre part, une complète discrétion, laquelle permet de réduire les risques encourus par les équipages. J’ai donc fixé trois priorités au ministère des armées.
La première consiste à conforter notre capacité d’acquérir du renseignement au moyen de drones aériens. Pour cela, nous allons poursuivre la livraison des systèmes de drones Reaper, mettre en service le système de drones tactiques Patroller et préparer le futur drone MALE européen.
La deuxième priorité consiste à élargir le champ des capacités permises par les drones. C’est ainsi que, au cours des prochaines années, vous l’avez rappelé, les drones MALE seront armés. Ces drones aériens seront d’abord introduits sur les bâtiments de la marine, au travers du programme SDAM, ou « système de drone aérien marine », ainsi que les drones de surface et sous-marins, dans le cadre de la guerre des mines navales, au travers du programme « système de lutte anti-mines marines futur ». Ce programme s’accompagnera de la robotisation de l’action terrestre, dans le cadre du programme Scorpion.
Enfin, troisième priorité, nous devons penser plus loin, et explorer la place que pourront en effet prendre les drones de combat, dans le cadre du « système de combat aérien futur » ; tel est le sens de ce programme, que nous conduisons en coopération avec nos alliés britanniques.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la revue stratégique dresse un tableau global de l’environnement dans lequel notre pays et l’Europe évoluent. Sur ce point, la partie touchant à la sécurité continentale mérite, me semble-t-il, une attention particulière. L’analyse de la « déconstruction de l’architecture de sécurité en Europe » paraît singulièrement juste, au regard notamment des entreprises de déstabilisation engagées par Moscou à l’endroit de l’Ukraine, qui font fi de tous les traités et des fondements les plus élémentaires du droit international.
Dans le même temps, force est de constater que l’unilatéralisme dont l’administration Trump se prévaut participe de ce registre et nous touche collectivement en tant qu’Européens. En témoignent ainsi non seulement sa volonté de désengager les États-Unis de la COP 21, qui met en péril l’ambition de réguler le changement climatique, mais également celle de remettre en cause l’accord historique de Vienne sur le nucléaire iranien, alors même que celui-ci a vocation à être un important outil de stabilisation d’une partie du monde pour le moins tourmentée.
Cette posture, qui devient une constante de la politique extérieure américaine et qui va à l’encontre des intérêts européens, suscite des interrogations sur le lien transatlantique, pourtant valorisé par la revue stratégique comme un « élément clé de la sécurité européenne », l’OTAN restant « pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l’instance de sa mise en œuvre ».
N’y a-t-il pas, madame la ministre, une contradiction entre, d’une part, la telle valorisation d’une alliance, certes importante au regard de l’histoire et du rôle qu’elle joue mais qui semble tout de même peu ou prou en voie de délitement, et, d’autre part, la volonté de tendre vers « une autonomie stratégique européenne », actée par la revue ? Comment envisagez-vous de concilier le nécessaire développement d’une Europe de la défense avec le maintien de ce lien transatlantique aujourd’hui fortement fragilisé et pour le moins imprévisible ?
Madame la sénatrice, vous soulevez une question que je comprends et qui est largement partagée dans le monde – d’ailleurs, nos alliés américains nous la posent –, mais qui, en même temps, me paraît théorique. En effet, aujourd’hui, les pays européens prennent conscience, je l’indiquais précédemment, de la nécessité de se protéger et d’investir dans leur propre sécurité. Par ailleurs, l’OTAN appelle à une montée en puissance des budgets de ses membres. Il y a donc de ce fait, me semble-t-il, une parfaite cohérence entre la démarche que les Européens adoptent dans le cadre de l’Union européenne et ce que l’OTAN appelle de ses vœux dans le cadre d’une alliance plus large.
La France est à la fois un allié sûr, fiable, au sein de l’OTAN, et un membre de l’Union européenne, au sein de laquelle elle prône la montée en puissance d’une Europe de la défense, dont je parlais tout à l’heure.
Je ne vois pas de contradiction entre l’un et l’autre ; je vois au contraire un renforcement et des synergies qui vont s’exercer de l’un vers l’autre. En outre, le fait que nous soyons aux avant-postes de la construction de l’Europe de la défense ne signifie nullement que nous nous désengagions en quoi que ce soit de l’alliance atlantique. Ainsi, j’étais récemment sur la frontière estonienne, où nous avons des bataillons engagés aux côtés de bataillons britanniques dans le cadre d’une force de l’OTAN ; c’est un engagement que nous n’avons pas l’intention de remettre en question. Nous avons été présents en Lituanie en 2017 et nous y serons encore en 2018.
On ne peut donc pas, selon moi, parler de contradiction mais, au contraire, de complémentarité.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, c’est à un triple défi que nos armées sont confrontées dans leurs opérations extérieures.
D’abord, les menaces persistent, voire s’accroissent. Il y a certes des victoires au Levant – saluons le symbole de Raqqa –, mais le Sahel n’est pas stabilisé et Boko Haram reste actif. Qu’adviendra-t-il si les djihadistes chassés du Levant se replient dans cette zone ? La République centrafricaine mais aussi la République démocratique du Congo ne peuvent qu’inspirer de vives inquiétudes…
Ensuite, deuxième impératif, il faut ménager l’outil pour durer, car notre niveau d’engagement est éprouvant pour les hommes et pour le matériel. Cet aspect a été maintes fois souligné.
Enfin, troisième point, il faut chercher des soutiens, en Europe, d’abord, quand nos partenaires ne partagent pas notre priorité sahélienne, aux Nations unies, ensuite, alors que l’attitude des États-Unis a compliqué l’adoption de la résolution 2359 sur la force du G5 au Sahel, et auprès de la société civile des pays en crise, enfin, car toute intervention, même justifiée, finit par susciter, quand elle dure, des oppositions.
La seule manière d’attaquer à la racine ce triple défi, dans le cadre d’une « approche globale », est bien identifiée par la revue stratégique : « l’autonomie stratégique ne saurait se penser en termes exclusivement militaires et suppose une articulation étroite avec […] [la] diplomatie […] [et le] développement. »
Madame la ministre des armées, comment contribuerez-vous à créer, avec M. le ministre des affaires étrangères, une véritable dynamique défense-diplomatie-développement, dans une optique de sortie de crise au Levant et au Sahel, mais aussi dans une perspective préventive dans un Maghreb fragile ?
Vous avez raison, monsieur le sénateur, il est plus difficile de faire la paix que de mener des guerres. Nous l’avons vu en Irak en 2003, en Afghanistan depuis 2001 et nous pourrions le voir, à terme et dans une moindre mesure, au Sahel.
Nous voyons bien que nos adversaires sont des groupes armés terroristes et que l’action contre de tels groupes ne peut être uniquement militaire ; cela ne serait pas suffisant. Il faut, vous l’avez rappelé, lier de façon cohérente une approche diplomatique et politique – l’engagement opérationnel de nos forces armées – avec une aide au développement qui permet, au fond, de répondre à la racine du mal : la pauvreté et la détresse dont se nourrissent les terroristes.
Nous devons poursuivre, au profit de ces populations, cette approche globale, qui n’est pas nouvelle. Au sein du ministère des armées, le Centre interarmées des actions sur l’environnement est spécifiquement chargé de contribuer à sa mise en œuvre, en complémentarité, bien sûr, avec l’action du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui est plus spécifiquement chargé du volet développement.
Sur le terrain et à l’échelon local, nous mettons également quotidiennement en œuvre cette approche au travers d’actions civilo-militaires ou de l’aide médicale déployée en faveur des populations partout où nos troupes sont présentes. D’une façon plus ambitieuse, à l’échelon de la région sahélienne, la création de l’alliance pour le Sahel répond également à cette logique.
Nous devons donc garder à l’esprit que, dans tout conflit, au Sahel comme ailleurs, c’est l’État tout entier qui s’engage, et non seulement ses armées.

M. le président. Mes chers collègues, j’ai le grand plaisir, au nom du Sénat tout entier, de saluer la présence, dans notre tribune officielle, d’une délégation du Sénat du Cambodge, conduite par Mme la présidente de la commission des affaires étrangères et de la coopération internationale du Sénat cambodgien.
Mmes et MM. les sénateurs ainsi que Mme la ministre se lèvent.

Cette délégation effectue actuellement un séjour d’étude dans notre pays, notamment sur le thème de la diplomatie parlementaire. Après une journée d’entretiens au Sénat hier, au cours de laquelle elle a été reçue par notre collègue Vincent Éblé, qui préside notre groupe d’amitié France-Cambodge, la délégation s’est entretenue tout à l’heure avec notre collègue Jérôme Bignon, membre de la délégation du groupe français auprès de l’Union interparlementaire. Elle rencontrera tout à l’heure M. Philippe Mouiller, membre de la section française de l’Assemblée parlementaire de la francophonie.
Nous sommes sensibles à l’intérêt que la délégation porte à notre institution, dans le cadre des relations inscrites dans l’histoire et fructueuses qui existent entre nos deux assemblées.
Au nom du Sénat de la République française, je lui souhaite la plus cordiale bienvenue et je forme des vœux pour que son séjour en France lui soit profitable et contribue à renforcer encore les liens qui unissent nos deux pays.
Applaudissements.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, comme nous tous ici, j’ai pris connaissance avec beaucoup d’intérêt de la revue stratégique de défense et de sécurité nationale. Je veux saluer la qualité du travail réalisé par son comité de rédaction, présidé par notre collègue député européen, Arnaud Danjean.
Nous ne pouvons que partager le constat d’une France exposée et engagée dans un environnement de plus en plus instable et en proie à des menaces de plus en plus diffuses. Ce contexte périlleux nous oblige plus que jamais à être en capacité d’action et de réaction sur notre territoire national, bien sûr, mais aussi en de nombreux points du globe.
Madame la ministre, considérant que cette revue stratégique est le préalable à la préparation d’une nouvelle loi de programmation militaire, je souhaite vous sensibiliser à la nécessité d’envisager d’ores et déjà la construction d’un porte-avions nucléaire à même de succéder au Charles-de-Gaulle.
Véritable fer de lance de notre capacité de projection et d’intervention lors de situations de crise, le porte-avions constitue une composante majeure de cet « outil de défense agile, projetable et résilient » qu’appelle de ses vœux le Président de la République dans la préface de la revue stratégique, de ce « modèle d’armée complet et équilibré […], le seul à [même de] donner à la France les moyens de son autonomie stratégique et de sa liberté d’action » que vous évoquez vous-même, madame la ministre, dans son avant-propos.
Il ne s’agit pas d’entrer aujourd’hui dans un débat sur le budget futur des armées, mais bien d’anticiper – près de vingt ans ont séparé les premières études pour la construction du Charles-de-Gaulle et son admission au service actif en 2001 –, avec cette exigence qui doit être la nôtre : leur donner des moyens opérationnels modernes et maintenir ces moyens à un niveau très élevé de performance.
Il s’agit aussi de ne pas perdre un savoir-faire technologique et industriel qui a fait ses preuves et de conserver une position forte en matière de défense en Europe, plus particulièrement au sein de l’Union européenne post-Brexit.
Enfin, envisager la permanence de cette capacité constituerait un signal fort vis-à-vis de nos armées, dont nous ne saluerons jamais assez le sens du devoir, le professionnalisme et la compétence.
Monsieur le sénateur, ce modèle d’armée complet que la revue stratégique appelle de ses vœux repose notamment sur la capacité de se projeter depuis la mer. Pour cela, nous disposons déjà de trois bâtiments de projection et de commandement, ou BPC, qui permettent de projeter des troupes, de conduire des opérations amphibies et de projeter outre-mer les moyens de l’État, comme cela s’est récemment fait aux Antilles.
Au-delà, la capacité de projection depuis la mer passe aussi par les avions, qui doivent pouvoir décoller d’un porte-avions.
La résurgence des États-puissance se traduit en ce moment par la construction de nombreux porte-avions dans le monde : en Chine, en Inde ou encore au Royaume-Uni. Ce constat nous rappelle que les porte-avions sont des outils militaires exceptionnels, qui fournissent non seulement une capacité de projection vers la terre mais encore une capacité d’acquisition autonome de renseignement et, surtout, de contrôle des espaces aéromaritimes. Bref, c’est un outil majeur du combat naval.
C’est aussi – cela n’est pas négligeable – un outil politique, car il a une très forte visibilité médiatique, et c’est aussi un vecteur de crédibilité vis-à-vis de nos alliés ; les récentes opérations que nous avons menées en Méditerranée, en lien avec nos alliés américains, en attestent.
Dès la prochaine loi de programmation militaire, nous devrons lancer des études pour renouveler cette composante des porte-avions. Il faudra à tout le moins préparer la succession du porte-avions Charles-de-Gaulle, qui devrait être retiré du service actif à l’horizon de 2040. Par ailleurs, l’opportunité de disposer ou non d’un second porte-avions fera partie des travaux à mener dans le cadre de la préparation de cette future loi.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, j’en viens à une question qui n’est pas souvent abordée.
L’industrie spatiale française bénéficie de nombreux atouts. Elle est l’un des leaders au niveau mondial ; il faut désormais tirer avantage de son excellence pour enraciner dans le paysage industriel français des compétences incomparables tournées vers les besoins du futur, facteurs d’indépendance technologique et de rayonnement politique et stratégique.
Comme le précise la revue stratégique de défense et de sécurité nationale, l’espace exoatmosphérique est en profonde mutation et en proie à des logiques de compétition tant militaire que stratégique. Des acteurs étatiques et non étatiques disposent aujourd’hui de moyens industriels leur permettant de mettre en place des satellites.
Les prouesses technologiques et scientifiques des dernières années ont contribué à l’essor d’une nouvelle manière de concevoir et d’exploiter les systèmes spatiaux, sur fond de compétition accrue entre acteurs étatiques, sur le plan tant politique qu’industriel. Support de services aujourd’hui indispensables de navigation, de communication, de météorologie ou d’imagerie, le domaine spatial est aussi un espace de confrontation ; des États peuvent aujourd’hui être à l’initiative de la mise en place de technologies potentiellement antisatellites.
Les activités liées à ce nouveau schéma posent également des questions d’ordre juridique. Le problème de l’« arsenalisation » de l’espace se pose donc en des termes renouvelés.
Face à ces nombreux défis, nous devons nous doter d’une politique spatiale ambitieuse. Pouvez-vous nous indiquer, madame la ministre, quel pourraient en être les contours dans la prochaine loi de programmation militaire ?
La revue stratégique a effectivement insisté sur la nouvelle dimension que constitue l’espace en tant qu’espace militaire potentiel, même si la politique spatiale n’est évidemment pas nouvelle, et elle met le doigt sur les menaces que tout cela comprend.
D’abord, les nouvelles technologies banalisent l’accès à l’espace ; ce qui était autrefois l’apanage de quelques très rares grandes puissances devient aujourd’hui possible pour des entités non étatiques, avec, finalement, peu de moyens.
Par ailleurs, vous l’avez souligné, en l’absence de réglementation permettant d’en assurer la maîtrise, il y a un risque de militarisation accrue du domaine spatial.
À l’inverse, le domaine spatial offre de très nombreuses opportunités ; les technologies à l’œuvre sont bien sûr duales et le spatial permet d’accéder, à des coûts toujours plus faibles, à de nouveaux services, qui bénéficient tant au monde civil qu’au monde militaire.
Enfin, le spatial est un domaine particulièrement approprié pour développer les coopérations européennes.
Comme nous avons souligné la nécessité de maintenir une capacité d’appréciation autonome, l’axe spatial constituera bien sûr un élément tout à fait majeur de notre prochaine loi de programmation militaire.
Dès l’année 2018, nous allons assurer la mise en service de trois satellites d’observation relevant de la Composante spatiale optique, ou CSO, qui permettront, dans la continuité du système Hélios II, de disposer de prises de vue d’une précision et d’une résolution très élevées ; notre réactivité devrait s’en trouver tout à fait renforcée.
Mme Florence Parly, ministre. Nous travaillons par ailleurs à l’introduction d’un certain nombre de systèmes spatiaux dans la prochaine loi de programmation militaire. J’ai participé ce matin à une réunion du CoSpace, au ministère de la recherche, en présence du ministre de l’économie et de l’ensemble des industriels ; la conclusion en a été que nous avons aussi grand besoin d’une équipe de France unie, associant les entités institutionnelles et les industriels, afin de développer une préférence européenne et une capacité industrielle autonome, sans laquelle notre autonomie de renseignement et d’observation ne sera pas possible.
M. Claude Haut applaudit.

La revue stratégique de défense et de sécurité nationale fait le constat inquiétant de la multiplication des menaces non étatiques du fait de la dissémination plus importante des armes.
Sous le précédent quinquennat, l’industrie de l’armement servait de variable d’ajustement à notre balance commerciale, c’est du moins notre vision.
Madame la ministre, le Gouvernement entend-il revoir notre politique d’exportation d’armement ?
Madame la sénatrice, le développement de l’exportation en matière d’armement est un prolongement indispensable du développement de ces programmes eux-mêmes. Aujourd’hui, sans l’exportation, un certain nombre de programmes militaires ne pourraient pas être menés à bien. L’exportation fait donc partie intégrante, en quelque sorte, du modèle de développement de ces programmes.
L’exportation en matière d’armement contribue à résorber le déficit commercial de la France à hauteur de 14 milliards d’euros par an. Globalement, l’industrie de défense compte plus de 4 000 entreprises, grandes ou petites, et représente plus de 160 000 emplois sur notre territoire. Ces emplois sont pérennisés grâce à la commande publique, mais aussi, je viens de l’indiquer, à l’existence de marchés à l’extérieur.
Exporter ne signifie bien évidemment pas qu’il faille le faire dans n’importe quelles conditions. Il existe des règles internationales que nous respectons, sous la surveillance des entités compétentes.

Merci, madame la ministre, vous êtes toujours précise dans vos réponses.
Cela dit, en la matière, il est difficile d’appeler à la diminution de l’armement quand on figure, comme c’est notre cas à nous, Français, parmi les plus gros vendeurs à l’échelon mondial.
Nous respectons, dites-vous, des règles internationales ; je n’en doute pas, mais le groupe communiste républicain citoyen et écologiste souhaiterait, et je pense qu’il n’est pas le seul, que nous soyons plus stricts – sous quelle forme ? Je ne saurais le dire dans l’immédiat – dans la sélection des pays acheteurs.
On sait qu’il existe des circuits parallèles et qu’une partie des armes que nous vendons dans des pays comme l’Irak, la Syrie ou autres est détournée ; mais, au-delà de ces marchés parallèles, nous avons d’autres inquiétudes, qui plaident pour cette exigence sur nos ventes. Je pense par exemple au Yémen, et aux soupçons de crime de guerre qui émeuvent la communauté internationale.

Aussi, quel commerce entretenir avec ces pays ?
Enfin, pour revenir sur votre conclusion, madame la ministre, je pense qu’il ne faut pas opposer, mais vous le savez bien, le nombre d’emplois au maintien de la paix.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ma question porte sur les engagements extérieurs.
Deux axes contradictoires ressortent avec force de la revue stratégique : d’une part, des enjeux sécuritaires de première importance – en effet, la menace se renforce, se généralise, se durcit, se complexifie, rendant improbable un reflux des interventions extérieures – et, d’autre part, une concomitance d’opérations et de déploiements dans la durée, qui engendre un phénomène d’usure de nos ressources humaines et matérielles.
Les armées françaises ont un grand besoin de se régénérer et le maintien de nos capacités est un véritable défi. Des programmes de renouvellement du matériel ont été engagés ; je pense principalement au programme Scorpion, qui devrait offrir un certain renouvellement des capacités de combat et de soutien de l’armée de terre à moyen terme.
En attendant, la situation est particulièrement tendue. L’exemple le plus symptomatique, évoqué par notre président, est celui des véhicules de l’avant blindé. Leur taux de disponibilité est d’à peine plus de 42 %, et leur âge moyen de trente et un ans. Leurs coûts de maintien opérationnels sont extrêmement importants et les mécaniciens ne pourront pas faire éternellement des miracles.
Madame la ministre, ne pensez-vous pas qu’il serait plus efficace de concentrer les crédits sur un renouvellement accéléré de ces engins, ce qui permettrait d’offrir un niveau de protection plus important à nos militaires, plutôt que de subir des coûts extrêmement élevés de maintien en condition opérationnelle ?
Cette disponibilité des matériels comporte des dimensions plus globales, c’est la seconde partie de ma question : les opérations extérieures françaises vont-elles être réarticulées en fonction des priorités dégagées par la revue stratégique ?
Monsieur le sénateur, vous évoquez un problème auquel nos armées sont actuellement confrontées, à savoir l’usure d’un certain nombre de matériels due à leur utilisation intense sur de multiples théâtres extérieurs, en particulier au Sahel. C'est la raison pour laquelle j’ai souhaité que, dans le cadre du projet de loi de finances dont nous discuterons prochainement, une enveloppe particulière soit réservée à ce que nous avons appelé la protection. Il s’agit de pouvoir régénérer un certain nombre de matériels, notamment en améliorant le niveau du blindage des véhicules légers qui sillonnent les pistes du Sahel et qui sont très exposés à la menace d’engins explosifs. Nous aurons l’occasion d’y revenir, mais il s’agit là de l’une des priorités du prochain projet de loi de finances.
Vous m’interrogez par ailleurs sur l’évolution dans le temps des OPEX. Il est vrai que nous ne voyons pas à ce stade de réduction possible à très court terme de nos engagements. En revanche, l’évolution de la situation militaire sur un certain nombre de fronts, en particulier au Levant, appelle à revisiter ce dispositif. À cet égard, il faut se féliciter des victoires militaires qui s’accumulent ces derniers jours. Bien sûr, nous revisiterons ce dispositif en lien avec nos alliés. Le Président de la République nous a également demandé d’examiner dans quelles conditions le dispositif au Sahel pourrait être adapté pour faire face aux conditions présentes auxquelles nos armées sont confrontées.

Madame la ministre, la principale nouveauté de la revue stratégique par rapport au Livre blanc de 2013 est la reconnaissance – « enfin ! », diront certains – du cyberespace comme un lieu important de conflictualité.
La prise en compte des menaces a été amorcée par le développement d’une politique de cybersécurité par l’ANSSI. Sans doute faudra-t-il aller plus loin, compte tenu de l’évolution des menaces qui persistent.
Nous savons que le Secrétariat national de la défense et de la sécurité nationale prépare une revue stratégique de cyberdéfense. Il est dommage, de notre point de vue, que ce travail n’ait pas été mené en relation plus étroite avec l’élaboration de la revue stratégique de défense, dont le volet « protection » apparaît dès lors moins, voire insuffisamment développé.
La revue préconise le renforcement prioritaire des moyens de défense et le développement de capacités offensives, mais aussi défensives. Elle annonce que « la France a décidé de se doter d’une posture permanente de cybersécurité » et va jusqu’à poser le postulat d’une invocation de l’article 51 de la charte des Nations unies dans l’hypothèse d’une cyberattaque, ce qui nous permettrait de riposter sans avoir à attendre l’avis de qui que ce soit.
Pouvez-vous nous indiquer, madame la ministre, si le Gouvernement entend remettre en cause le modèle original français de séparation des instances qui sont chargées de la protection et de celles qui s’occupent de la lutte informatique offensive ?
En matière de lutte informatique offensive, la revue stratégique insiste sur les capacités de détection et d’attribution, c'est-à-dire la recherche des coupables – ce n’est pas le plus facile –, ainsi que sur la capacité pour nos armées de planifier et de conduire les opérations dans l’espace numérique jusqu’au niveau tactique de façon intégrée et d’exploiter ainsi la numérisation croissante de nos adversaires. S’agit-il d’une évolution de cette doctrine ?
Enfin, quel format pensez-vous donner au commandement cyber dans le cadre de la loi de programmation militaire ? À combien évaluez-vous le montant des crédits nécessaires pour doter nos armées de capacités crédibles en personnels, bien évidemment – il faut les former –, mais aussi en moyens techniques ?
Monsieur le sénateur, les capacités cyber du ministère des armées peuvent être distinguées en trois catégories : la mission de renseignement et d’investigation, celle de protection et de défense, celle de riposte et de neutralisation.
Dans le domaine cyber, la mission de renseignement et d’investigation revêt une très grande importance. Elle suppose des moyens dédiés, qui ne sont pas tous de nature numérique. Nous avons en effet besoin de mobiliser l’ensemble de la panoplie, laquelle comprend également le renseignement humain.
La deuxième mission de la fonction cyberdéfense, c’est la posture de protection et de défense. Elle intègre une défense en profondeur, qu’on appelle la cyberprotection. Cette cyberprotection consiste à bâtir d’épaisses murailles, ainsi qu’à veiller en permanence à leur efficacité, face à une menace toujours évolutive. La fonction cyberdéfense intègre également une défense de l’avant, qui est la lutte informatique défensive. Elle consiste à patrouiller, à guetter et à intervenir dans l’espace numérique en cas d’intrusion pour éradiquer la menace et reconstruire la muraille.
Enfin, la troisième mission est la lutte informatique offensive, que je caractériserai par deux termes : riposte et neutralisation. Il y a une distinction entre ce que fait l’ANSSI, qui est focalisée sur les aspects de défense, et ce que font les armées, qui sont centrées sur l’offensive. Cette distinction n’a pour l’instant pas lieu d’être remise en question.
La revue stratégique de cyberdéfense va très prochainement rendre ses conclusions. À cet égard, je signale qu’elle a apporté sa contribution à la revue stratégique de défense dont nous parlons aujourd'hui, ce qui devrait normalement faciliter les convergences.
Enfin, j’indique que le nombre de combattants cyber au sein du ministère des armées – ils sont 3 000 aujourd'hui – est très probablement appelé à croître, comme je l’ai indiqué tout à l’heure, dans le cadre de la prochaine loi de programmation militaire.

Madame la ministre, chacun s’accorde aujourd’hui à considérer que les avancées technologiques vont conditionner, bouleverser le futur de certains pays, dans le domaine tant économique que militaire. La revue stratégique se fait l’écho de ces préoccupations.
Nombre des technologies disruptives d’intérêt militaire dérivent plus que par le passé, et de façon croissante, de technologies civiles. Ces évolutions sont manifestes dans la sphère numérique. L’hyper-connectivité, les technologies du big data, l’internet des objets, la robotique, l’utilisation de l’intelligence artificielle vont avoir un impact considérable non seulement sur les armements, mais aussi sur la conduite des opérations de renseignement et de combat.
La diffusion de ces technologies efface les écarts de puissance entre États et offre également des capacités à des groupes terroristes ou criminels incontrôlés. Il faudra donc également prémunir nos administrations, nos services publics et, bien sûr, nos armées contre les risques de détournement et de pertes de contrôles de leurs propres systèmes.
Comment ces évolutions sont-elles intégrées par nos armées dans leur réflexion doctrinale ? Impliquent-elles de nouveaux modes d’organisation dans la conduite des opérations ?
Comment le commandement militaire prépare-t-il ces évolutions et y prépare-t-il les personnels ? Quels projets concrets vont, dans un avenir proche, trouver une application opérationnelle jusqu’au niveau du combattant ?
La conduite des programmes d’équipement doit-elle être pensée pour être plus agile, intégrer plus rapidement des technologies dérivées d’applications civiles, voire faire travailler ensemble start-up, officiers de programme et chercheurs sur des projets, tout en préservant nos capacités souveraines ? Un projet comme Intelligence Campus, soutenu par la direction du renseignement militaire, vous paraît-il correspondre à ces nouveaux modes d’organisation ?
Madame la sénatrice, vous mettez le doigt sur l’un des sujets majeurs qui nous préoccupe en ce moment : la bonne façon de faire cohabiter des modes d’innovation différents, à savoir les modes d’innovation qui se développent dans le monde civil, sur des cycles très courts, et les modes d’innovation et de développement technologiques sur des temps plus longs, tels que ceux que nous avons l’habitude de mettre en œuvre au sein du ministère des armées.
Nous souhaitons que la délégation générale à l’armement, au-delà du rôle très prééminent qu’elle joue, puisse contribuer à créer, avec l’ensemble des acteurs du ministère des armées, ce qu’on appelle aujourd'hui un écosystème favorable à l’innovation afin de permettre des fertilisations croisées entre le monde civil et le monde militaire. Il s’agit également de permettre l’accélération de l’innovation au profit des armées, ainsi que – pourquoi pas ? – une innovation plus sobre, plus frugale en termes de coût des technologies.
J’avoue ne pas avoir encore eu l’occasion de visiter Intelligence Campus, mais ce campus fait partie des sujets dont je vais m’entretenir avec la direction du renseignement militaire. Ce que je peux vous dire également, c’est qu’il est extrêmement important de disposer d’un certain nombre de plateformes permettant d’effectuer des simulations. La simulation est aujourd'hui un élément majeur pour assurer le caractère sûr et opérationnel de nos équipements. Nous devons développer nos outils de simulation et intégrer le volet cyber dont nous parlions tout à l’heure…
… dans tous les travaux de conception de nos futurs équipements, tels que les navires. Comment éviter que nos futurs navires puissent être contrôlés par un tiers ?
Veuillez me pardonner cette réponse trop longue. J’espère que nous aurons l’occasion de reparler de ce sujet, qui mérite d’être abordé de façon plus détaillée.

Pour que la France maintienne son engagement international et ses domaines d’excellence, ainsi que sa capacité à intervenir, elle doit mettre en adéquation ses moyens avec ses besoins, madame la ministre.

M. le président. Je vais maintenant céder ma place à Mme Catherine Troendlé, qui va présider nos travaux pour la première fois aujourd'hui. Je ne doute pas que vous lui réserverez le meilleur accueil !
Applaudissements .
Mme Catherine Troendlé remplace M. Gérard Larcher au fauteuil de la présidence.

Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, la photo est émouvante : un militaire souriant porte dans ses bras une petite fille endormie. Nous sommes dans l’aérogare de Saint-Martin, l’île ravagée par l’ouragan Irma. Cet instantané, publié par l’envoyé spécial de Radio France, a déclenché une étonnante polémique sur les réseaux : on a parlé d’opération de propagande de l’armée française, de néo-colonialisme !
Il y a quelques jours, un faux sondage circulait par e-mail sur le mode : « saviez-vous que ? » Cette manœuvre visait à lister les prétendus avantages, aussi faux qu’astronomiques, dont bénéficieraient les sénateurs.
Je mesure les efforts entrepris pour nous protéger contre les cyberattaques et ceux qui sont annoncés pour doter nos armées de capacités de lutte informatique offensives, mais ces efforts seront incomplets si nous ne nous préoccupons pas des actions d’influence et de déstabilisation. La revue stratégique relève la perméabilité des sociétés européennes à la propagande djihadiste, laquelle « a fragilisé les sentiments d’appartenance, affectant ainsi la cohésion des sociétés ».
Nous sommes également l’objet d’actions conduites par des puissances étatiques de premier rang, dotées d’extraordinaires arsenaux d’influence et de déstabilisation, qui vont de la diffusion massive de fake news à la manipulation des processus électoraux, comme on l’a vu lors de la campagne présidentielle américaine.
L’instrumentalisation des réseaux sociaux est désormais considérée par le Pentagone comme la plus grande menace militaire des années à venir dans le domaine des guerres hybrides.
Je suis inquiet face à l’absence dans la revue stratégique d’exposé de stratégie de contre-influence et de promotion de nos valeurs démocratiques. Pouvez-vous nous indiquer, madame la ministre, les dispositifs d’ores et déjà mis en œuvre par le Gouvernement dans ce domaine. Quel est le service chargé de lutter contre la propagation de fausses nouvelles ?
Votre question, monsieur le sénateur, va bien au-delà du cas d’Irma que vous évoquez. Elle concerne toutes les propagandes.
Les réseaux sociaux sont le premier vecteur d’influence du terrorisme. L’espace numérique est un espace de combat banalisé, mais extrêmement puissant, qui imprègne notre société aujourd'hui.
Un certain nombre de moyens ont été mis en place, tels les moyens cyber du ministère des armées que j’ai évoqués tout à l’heure, lesquels sont en croissance, en termes d’effectifs et de savoir-faire, mais ils ne sont pas les seuls. Le service d’information du Gouvernement, je n’en doute pas, scrute de façon permanente les informations circulant sur les réseaux sociaux.
Enfin, une démarche a été entamée à l’échelon européen auprès d’un certain nombre de fournisseurs d’accès et de services pour obtenir la suppression sur les réseaux sociaux d’informations manifestement erronées ou mettant en cause des personnes.
J’avoue que je n’ai pas de réponse complète à votre question, monsieur le sénateur. Si nous en avions une, nous serions en mesure de contrer l’essentiel de ces attaques. Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, ce qui est important, c’est de pouvoir observer, …
… protéger et, éventuellement, intervenir. C’est ce que le ministère des armées s’efforce de faire dans son domaine.

Pour diriger une armée, « mieux vaut un mauvais général que deux bons », disait Napoléon. Face aux fake news, nous n’avons aucun général, et cela m’inquiète.

Madame la ministre, la « course » technologique internationale s’avère aujourd’hui particulièrement vive, et la revue stratégique souligne le risque de décrochage. Numérique, robotique, miniaturisation, intelligence artificielle sont autant de défis pour l’avenir de notre défense.
L’innovation, avec sa part de risques, doit être placée au cœur de la démarche du ministère des armées. En effet, nous devons considérer que les défaillances d’investissement d’aujourd’hui pourraient être les lacunes capacitaires de demain. La remarque vaut tout autant pour les armements que pour notre analyse stratégique. Or les perspectives que vous présentez font état d’un risque de « décrochage technologique dont notre pays pourrait être victime ».
Dans un environnement où le secteur civil produit de plus en plus de technologies d’intérêt militaire, le risque de « nivellement opérationnel » décrit dans votre document existe bien. Aujourd’hui, avec peu de moyens, des forces armées régulières ou irrégulières, voire des groupes terroristes, peuvent mettre en échec ou entraver l’action de nos forces conventionnelles. Cette problématique vitale doit être prise en compte pour le renouvellement de nos systèmes d’armes.
Dans ce cadre, le recours à une meilleure synergie entre la recherche civile et le monde militaire peut se révéler extrêmement bénéfique.
Madame la ministre, en plus des dispositifs existants, quelles nouvelles mesures prendrez-vous afin d’encourager une forme de symbiose dans le domaine de la recherche ? Quelle sera notre capacité d’investissement à cet effet ?
Par ailleurs, une base industrielle et technologique forte est indispensable. La revue stratégique met opportunément l’accent sur ce point. Or son renforcement passe aussi par des consolidations industrielles. En particulier, quel résultat donnera l’accord de principe trouvé à l’occasion du déblocage du dossier STX sur un partenariat structurant dans le secteur de la construction navale ? Peut-on croire à un Airbus des mers militaire, associant Naval Group et Fincantieri ?
Monsieur le sénateur, le ministère des armées, en particulier la DGA, dispose d’un certain nombre d’outils pour encourager et soutenir l’innovation. Ces outils incluent le financement de thèses et de travaux de recherche duale via le CNES et le CEA, au sein du programme 191 du ministère des armées ; le dispositif ASTRID, en partenariat avec l’ANR ; le soutien des pôles de compétitivité, un dispositif rapide en faveur de l’innovation des PME ; des contrats d’étude pour préparer les équipements futurs pour un montant de 700 millions d’euros par an ; une mission pour l’innovation participative finançant les projets des innovateurs au sein des services du ministère.
Pour ma part, je souhaite renforcer l’effort en faveur de l’innovation selon un certain nombre d’axes. Il s’agit ainsi d’améliorer la collaboration avec l’écosystème, en particulier avec les start-up, de prendre en compte de façon plus agile l’innovation civile, notamment numérique, au profit des équipements, des soutiens et du quotidien des militaires, mais aussi du fonctionnement du ministère, de développer des outils d’expérimentation et des tiers-lieux au sein du ministère, et enfin de favoriser l’innovation de rupture.
C’est pourquoi j’ai également annoncé que les crédits du programme 144, consacré à l’innovation et aux études, devraient être portés à 1 milliard d’euros par an dès 2022, contre 730 millions d’euros aujourd'hui.
Enfin, vous m’interrogez sur le projet de consolidation entre Naval Group et Fincantieri. Ce projet a été lancé sous forme d’études à conduire lors du précédent sommet franco-italien qui s’est déroulé à Lyon. En ce moment même, les équipes de Fincantieri et de Naval Group, accompagnées par le ministère des armées et le ministère de l’économie de chacun de nos deux pays, travaillent en vue de présenter un projet à la fin du premier semestre de 2018.

La revue stratégique fait un état des lieux des menaces pesant sur notre pays. Ne pensez-vous pas, madame la ministre, qu’il devrait être complété par un autre état des lieux, celui de la situation humaine, matérielle et financière du ministère des armées ?
Vous avez annoncé tout à l’heure la trajectoire budgétaire, par anticipation sur la loi de programmation militaire, ce qui réduit un peu l’exercice ou le contraint. Pensez-vous que cette trajectoire sera suffisante, compte tenu de l’état de nos armées et de la menace, pour répondre aux différents défis qui se présentent à nous ?
Monsieur le sénateur, j’ai en effet indiqué que, à partir de 2018, les moyens consacrés au ministère des armées remonteraient en puissance. Cette remontée en puissance était indispensable compte tenu, d’une part, du très fort taux d’utilisation de nos forces au cours des années précédentes et, d’autre part, de la nécessité de reconstituer notre potentiel pour faire face aux différentes menaces.
Nous devons aussi préparer le futur. La prochaine loi de programmation militaire devra trouver un juste équilibre entre ce qui est absolument indispensable, c'est-à-dire la reconstitution de notre potentiel d’action, avec les moyens existants, et la préparation de l’avenir. Les programmes d’équipements de défense, nous le voyons bien, sont des programmes au long cours. Nous touchons aujourd'hui les dividendes, si je puis dire, des décisions qui ont été prises par nos prédécesseurs il y a parfois trente ans. C’est à nous qu’il revient aujourd'hui d’assurer la préparation de l’avenir, c'est-à-dire de prendre des décisions qui n’auront d’effets visibles, dans certains cas, que dans trente ou quarante ans.
Oui, monsieur le sénateur, j’ai conscience des contraintes qui vont peser sur ce budget ! Le fait qu’il soit en progression ne signifie pas que nous ne devons pas être extrêmement vigilants sur la bonne utilisation de chaque euro investi.

Madame la ministre, je ne mets aucunement en doute votre volonté de bien faire et de faire plus. Vous parlez de « reconstruire le potentiel », mais quelle sera la fin de l’exécution budgétaire 2017 ? L’impasse serait potentiellement de l’ordre de 4 milliards d’euros, soit plus de 10 % du budget ! Comme l’a rappelé Christian Cambon tout à l’heure, des véhicules, des avions ont plus de trente ans !
Dans notre rapport, que vous avez bien voulu lire, nous estimons à 2, 5 milliards d’euros les investissements nécessaires dans le parc immobilier. Je crains que la vérité des chiffres nous conduise à penser que, compte tenu de la situation dont vous héritez et de la menace qui pèse sur notre pays, l’effort que vous prévoyez de consentir ne permette pas de satisfaire l’ensemble des besoins.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, permettez-moi d’aborder deux sujets indissociables.
J’évoquerai tout d’abord le rôle de la gendarmerie nationale dans la défense de notre pays, de ses intérêts et de nos ressortissants, tant sur le sol national qu’à des milliers de kilomètres, dans nos territoires ultramarins.
On ne peut envisager la doctrine de sécurité sans prendre conscience de la spécificité évidente de la gendarmerie : son ancrage territorial, ses capacités judiciaires, militaires, administratives, ses relations privilégiées avec nos concitoyens et les autres armées.
Dans le contexte de menace terroriste, nous ne pouvons ignorer l’aggravation de la porosité entre les activités criminelles et le financement d’organisations djihadistes transnationales. Que ce soit en matière de lutte contre le trafic d’armes en provenance des Balkans occidentaux ou de drogues en provenance de la bande sahélo-saharienne, la gendarmerie a une véritable expertise des filières et de leurs interactions.
Madame la ministre, alors que le risque d’attentat ne cesse de croître, dans quelle mesure les métiers de la gendarmerie, qui ont une réelle valeur ajoutée dans notre outil de sécurité nationale, peuvent-ils être optimisés et développés ?
Enfin, je ne saurais conclure sans évoquer un point capital de notre politique de défense : nos ressources humaines. Vous aurez beau « cybernétiser » ou moderniser, il n’est point de défense sans ressources humaines. Or nous savons tous que celles-ci sont véritablement épuisées. Ne pensez-vous pas que nos militaires, qui ne sont pas des fonctionnaires comme les autres, du fait même de leur condition militaire vingt-quatre heures sur vingt-quatre, mériteraient une réelle amélioration de leurs conditions de travail et de vie, au sens large du terme ? Il y va de la détermination de nos troupes à défendre nos valeurs.
Monsieur le sénateur, la gendarmerie est une force armée rattachée au ministère de l’intérieur, qui couvre et incarne l’État sur 95 % de son territoire, au profit de la moitié de la population. Elle constitue une force de continuité et de souveraineté, quelle que soit l’intensité des crises.
Les gendarmes ont de remarquables capacités à mener un certain nombre d’opérations en complément de celles des armées elles-mêmes. La gendarmerie apporte en effet des appuis quantitatifs et qualitatifs essentiels, d’abord par l’existence de gendarmeries spécialisées, ensuite grâce à des missions communes réalisées en métropole – c’est le cas dans le cadre de l’opération Sentinelle ou bien outre-mer, par exemple en Guyane, dans le cadre de l’opération Harpie –, enfin lors des opérations extérieures.
La gendarmerie fait en quelque sorte le lien entre les opérations intérieures et les opérations extérieures menées par nos armées. Elle est un acteur clé de l’anticipation dans le cadre de ses activités de renseignement ; elle est un acteur clé de la résilience de la Nation ; elle est enfin également un acteur clé de la dissuasion. L’interopérabilité et la complémentarité entre la gendarmerie et les armées sont des atouts majeurs pour notre pays.
Vous rappelez enfin que, sans les femmes et les hommes de la défense, nos armées ne seraient rien. C’est bien pour cette raison, monsieur le sénateur, que j’ai souhaité pouvoir proposer d’ici à quelques jours un plan en faveur des militaires et de leurs familles. Je considère que, sans famille heureuse, il n’y a pas de soldat efficace. C'est la raison pour laquelle un certain nombre de mesures, qui ont vocation à se traduire…
… de façon très concrète dès l’année 2018, seront proposées d’ici à quelques jours. Je suis sûre que nous aurons l’occasion d’y revenir ensemble.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ma question concerne le maintien en condition opérationnelle des matériels de nos armées, sujet déjà abordé par plusieurs de mes collègues, ce qui est le signe d’une inquiétude assez générale.
Le président Cambon nous a, non sans humour, parfaitement présenté la situation. La politique du toujours plus loin, toujours plus longtemps et avec toujours moins n’est plus tenable. Il y va de la sécurité même de nos soldats. La multiplication des OPEX sur des théâtres où les conditions sont difficiles, combinée aux besoins de nos forces de souveraineté, pèse sur l’ensemble de notre appareil de défense. Nos matériels sont plus qu’usés, nos soldats sont fatigués et ont des difficultés à maintenir les niveaux d’entraînement.
Certes, des efforts budgétaires ont été engagés pour prendre en compte cette problématique, mais il s’agit de développer une véritable politique en la matière : le volet « soutien » mérite d’être repensé.
Madame la ministre, quelles actions précises entendez-vous mettre en œuvre pour permettre une réelle amélioration de la situation ?
Monsieur le sénateur, le maintien en condition opérationnelle est une de mes préoccupations majeures – j’avoue, pour être tout à fait franche, qu’elle était aussi celle d’un certain nombre de mes prédécesseurs.
Que pouvons-nous faire à très court terme ?
Dans la mesure où les matériels sont fortement sollicités, il m’a tout d’abord semblé indispensable, dans le cadre des arbitrages budgétaires qu’il a fallu rendre au sein de l’enveloppe globale qui nous a été allouée pour 2018, d’assurer une progression des moyens consacrés au maintien en condition opérationnelle, toutes forces confondues. Le budget, d’un montant de 6 milliards d’euros, sera donc augmenté de 400 millions d’euros en 2018 par rapport à 2017. Il s’agit d’une première étape.
Seconde question, comment faire en sorte, au-delà des investissements que je viens de mentionner, que nos matériels soient plus disponibles, et le soient dans de meilleures conditions ? Aujourd’hui, les taux de disponibilité, comme l’a souligné le président Cambon, ne sont pas acceptables.
Permettez-moi toutefois d’apporter une nuance à votre propos, monsieur Cambon : le taux de disponibilité, lorsqu’il s’agit de matériels engagés dans les opérations, n’est évidemment pas du tout celui qui a été décrit. Mais vous le savez parfaitement…
Le niveau d’indisponibilité des matériels est notamment préoccupant dans le domaine aéronautique. C'est la raison pour laquelle j’ai demandé à M. Chabbert de bien vouloir réaliser un audit sur le maintien en condition opérationnelle dans ce domaine. Il me fera part de ses propositions d’ici à quelques semaines. Il ne suffit pas d’investir : encore faut-il pouvoir utiliser pleinement des matériels qui ont bénéficié des investissements de la Nation.

Je prends acte de vos remarques et de vos initiatives, madame la ministre.
Nous serons très attentifs, eu égard à l’importance du sujet, à la réalité de ce qui sera proposé pour 2018.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la revue stratégique de défense et de sécurité nationale affiche de très grandes ambitions dans de nombreux domaines.
Je voudrais saluer ce formidable travail, dont nous sommes nombreux à partager les ambitions, tout en nous interrogeant sur la capacité budgétaire à y répondre, même en tenant compte de la hausse annoncée.
Se pose aussi un problème d’articulation de la revue stratégique avec la loi de programmation militaire, articulation qui lui a valu d’être surnommée « la rotule » dans le milieu militaire.
Je m’inspire de ce surnom pour soulever un autre problème d’articulation, celui pouvant survenir entre les ambitions européennes – j’approuve d’ailleurs pleinement le renforcement des partenariats européens – et l’OTAN : comment les choses se passeront-elles si des pays européens non membres de l’OTAN intègrent l’IEI, l’initiative européenne d’intervention, ou si des militaires étrangers, venus de pays non membres de l’OTAN, intègrent, comme le souhaite le Président de la République, l’armée française ?
Monsieur le sénateur, l’initiative européenne d’intervention, appelée récemment de ses vœux par le Président de la République, sera ouverte à tous les États qui seront volontaires pour la rejoindre, unis autour de valeurs communes, partageant une même vision sécuritaire, tout en souhaitant faire les efforts nécessaires pour lancer des engagements communs de natures très diverses, car pouvant aller de l’évacuation de ressortissants à des opérations de très haute intensité, en passant par la lutte contre le terrorisme.
L’initiative européenne d’intervention a vocation à renforcer l’autonomie stratégique de l’Europe et donc l’ensemble des instruments de politique de sécurité et de défense commune. Les pays de l’Union européenne seront prioritairement associés à cette initiative, mais celle-ci ne se limitera cependant pas à l’Union européenne : elle sera tout à fait transposable à l’OTAN ou à des formats ad hoc.
Monsieur le sénateur, notre objectif est en effet bien de dépasser la question des cadres institutionnels pour favoriser, et c’est finalement la seule chose qui compte, la construction d’une culture stratégique commune entre Européens.

Nous en avons terminé avec le débat sur la revue stratégique de défense et de sécurité nationale.
Je vous remercie, madame la ministre, mes chers collègues, de votre participation à cette nouvelle forme d’échanges interactifs.

L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice (proposition n° 641, 2016-2017, texte de la commission n° 34, rapport n° 33) et de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice (proposition n° 640, 2016-2017, texte de la commission n° 35, rapport n° 33), présentées par M. Philippe Bas.
Il a été décidé que ces deux textes feraient l’objet d’une discussion générale commune.
Dans la discussion générale commune, la parole est à M. Philippe Bas, auteur de la proposition de loi et de la proposition de loi organique.

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, la justice va mal.
Les délais ne cessent de s’allonger. En dix ans, ils sont passés de sept mois et demi à près d’un an pour les tribunaux de grande instance. Dans le même temps, le stock d’affaires en attente a augmenté de plus d’un quart. Or le nombre de magistrats et de greffiers a diminué. Les vacances de postes sont devenues endémiques : actuellement, près de 500 postes de magistrats et 900 postes de greffiers ne sont pas pourvus.
Les juridictions sont proches de l’embolie. Chaque année, on compte plus de 2, 6 millions nouvelles affaires civiles et plus de 1, 2 million nouvelles affaires pénales.
Je veux ici rendre hommage à tous les magistrats, aux personnels judiciaires et pénitentiaires, aux avocats et aux auxiliaires de justice dont le dévouement quotidien, dans des conditions difficiles, voire dégradées, fait que la justice est encore rendue dans notre pays.
Des millions de Français sont concernés. Pour eux, la justice, ce sont d’abord les litiges relatifs aux loyers, aux crédits à la consommation, aux saisies sur salaire, à la propriété, à l’état civil, au droit du travail, au recouvrement de créances et, bien sûr, aux divorces, à la garde des enfants, aux pensions alimentaires…
À l’égard de tous nos concitoyens en demande de justice, les tribunaux doivent avant tout répondre à des impératifs de service public : qualité, facilité d’accès, simplicité de fonctionnement, rapidité et, bien évidemment, effectivité de l’exécution des jugements.
Il suffit d’énoncer toutes ces exigences pour mesurer le chemin qui reste à accomplir pour répondre aux attentes des Françaises et des Français.
En attestent aussi les lenteurs et les dysfonctionnements de l’aide juridictionnelle, ainsi que l’incroyable complexité du partage des compétences entre tribunaux d’instance et tribunaux de grande instance. Dans notre pays, le parcours de l’accès au droit demeure trop souvent labyrinthique.
Quant à la chaîne pénale, elle se caractérise par un phénomène de saturation qui prend deux formes : 100 000 condamnations à une peine de prison ferme en attente d’exécution ; 70 000 détenus pour 58 000 places en prison – chaque nuit, 1 800 détenus dorment sur un matelas posé à même le sol.
C’est dire l’ampleur des défis que doit relever la justice de notre pays pour sortir de la crise dans laquelle un long délaissement l’a plongée.
Pendant près d’un an, la mission pluraliste de la commission des lois a entendu au Sénat non loin de 300 personnalités du monde judiciaire et a accompli de nombreux déplacements à travers notre pays pour apprécier concrètement les conditions de fonctionnement de la justice.
La mission a rendu son rapport le 4 avril dernier. Nous sommes parvenus à faire émerger ensemble 127 propositions, dont 125 ont fait l’objet d’un accord entre nous. Il s’agit d’un consensus politique, mais aussi d’un large consensus judiciaire.
Au cours de notre plongée dans le monde de la justice, jamais ou presque la question du manque d’indépendance n’a spontanément été soulevée, sauf pour la nomination des magistrats du parquet. L’indépendance de la justice est profondément ancrée non seulement dans notre droit, mais aussi dans la culture et les pratiques des magistrats. Elle n’est en rien menacée.
C’est pourquoi nous avons concentré nos réflexions et nos propositions sur la question des moyens, de l’organisation et de la gestion des juridictions plutôt que sur la conception de réformes institutionnelles sans portée concrète qui nous auraient enfermés dans des débats idéologiques dépassés ayant trop souvent servi de prétexte à l’inertie.
Les propositions de loi qui vous sont présentées sont le fruit de ce travail.
Au cours des quinze dernières années, la demande de justice a progressé beaucoup plus vite que les moyens, même si, contrairement aux idées reçues, ceux-ci ont en réalité beaucoup augmenté, passant de 4, 5 milliards d’euros en 2002 à 8, 5 milliards d’euros en 2017.
Mais cet effort s’est révélé très insuffisant compte tenu de l’explosion du nombre des instances. En réalité, la justice a été négligée, sauf, peut-être, durant la période 2002-2007, au cours de laquelle le budget a augmenté de 37 %. Le rythme de la hausse a ensuite été inférieur de moitié.
Pourquoi ce ralentissement ? Parce que dès l’été 2002 avait été votée une loi de programmation des moyens de la justice, mise en œuvre cent jours après l’élection présidentielle. La sincérité de la priorité donnée à la justice avait alors été démontrée avec éclat…
La véritable épreuve de vérité permettant d’apprécier la volonté politique de redresser la justice est donc bien la capacité à adopter rapidement une loi de programmation liant le Gouvernement et le Parlement dans l’élaboration et l’exécution des lois de finances de tout le quinquennat.
La proposition qui vous est présentée vise à augmenter le budget de la justice de 28 % en cinq ans, avec la création de près de 14 000 postes et de 15 000 places de prison, pour atteindre un budget d’environ 11 milliards d’euros en 2022.
Cette augmentation est, certes, moindre que celle qui est intervenue entre 2002 et 2007, mais elle est déjà près de deux fois plus importante que celle qui a été enregistrée pendant le précédent quinquennat.
Pour atteindre ces objectifs matériels, la croissance du budget de la justice devra s’élever en moyenne à 5 % par an, c’est-à-dire être nettement supérieure à celle du budget 2017 et du projet de budget pour 2018, qui traduisent pourtant une évolution substantielle par rapport aux années précédentes.
Il faut, par ailleurs, mettre la justice à l’abri des mesures de mise en réserve et d’annulation de crédits qui provoquent, depuis si longtemps, une gestion erratique des budgets et une exécution chaotique des travaux programmés sans véritablement contribuer à la maîtrise des dépenses publiques. Des dispositions vous sont proposées en ce sens.
Madame la garde des sceaux, je suis heureux de voir que le Gouvernement, après tant et tant de rapports, a lancé le mois dernier une réflexion multiforme sur la réforme de la justice. Les cinq groupes de travail devront vous remettre leurs conclusions en janvier prochain. Je veux croire que l’inscription de nos deux propositions de loi à l’ordre du jour du Sénat n’est peut-être pas étrangère au lancement de cette nouvelle réflexion.
Mais, si le Gouvernement a posé de bonnes questions, nous espérons avoir déjà formulé les bonnes réponses ! Ce serait une perte de chance pour la justice que de ne pouvoir disposer d’une loi de programmation que dans le courant de l’année 2019, deux ans après l’élection présidentielle.
Si nous voulons œuvrer au redressement de la justice dans l’unité nationale nécessaire, il faut aller vite. C’est pourquoi il est essentiel que la réforme de la justice soit adoptée dès maintenant par le Sénat et qu’elle devienne ensuite, si vous le voulez bien, un instrument entre les mains du Gouvernement pour que l’Assemblée nationale se prononce à son tour rapidement, c’est-à-dire au début de l’année 2018, dès que le Gouvernement aura tiré les enseignements des travaux que vous venez de lancer et que j’ai évoqués.
Une loi quinquennale qui ne trouverait à s’appliquer que durant les trois dernières années du quinquennat constituerait, pour la justice, une occasion largement manquée.
Le montant des crédits de la justice n’est bien sûr pas seul en cause. Il faut également poser la question, soulevée à de nombreuses reprises par la Cour des comptes, de l’organisation, du fonctionnement et de la gestion des cours et tribunaux, ainsi que des prisons. Il serait vain, en effet, de déployer de nouveaux moyens sans une transformation profonde de la façon d’utiliser les moyens existants.
La réforme sera le corollaire de l’engagement financier de l’État et, en quelque sorte, sa contrepartie. C’est pourquoi les textes qui vous sont soumis proposent des changements profonds.
La création d’un tribunal de première instance permettra de créer une unité de gestion des juridictions de proximité en maintenant l’intégralité des implantations actuelles.
Le développement massif de la conciliation et de la médiation concentrera le juge sur son office et accélérera le traitement des litiges.
La réforme de l’aide juridictionnelle écartera du prétoire les recours manifestement irrecevables et financera l’accès au juge par le rétablissement d’un droit de timbre modique.
L’amélioration de la gestion des ressources humaines, en magistrats comme en greffiers, mettra fin aux vacances de poste endémiques qui paralysent tant de petites juridictions déshéritées.
Le renforcement de l’équipe du juge permettra aux magistrats de se consacrer pleinement à leurs tâches.
Je cite encore le renforcement des pouvoirs budgétaires des chefs de juridiction, l’accélération des processus de dématérialisation des procédures, l’exigence d’études d’impact dignes de ce nom et, enfin, la clarification du régime de l’aménagement des peines.
Cette dernière mesure est une nécessité pour rétablir la confiance dans la justice pénale. Il n’est compréhensible ni pour les victimes ni pour les condamnés eux-mêmes que des peines de prison ferme allant jusqu’à deux ans ne donnent lieu, en pratique, à aucune incarcération. Si les alternatives à l’emprisonnement, dont l’essor stagne depuis cinq ans, doivent être développées, il importe de sortir de l’ambiguïté actuelle : une peine de prison ferme est une peine de prison ferme ; elle doit être exécutée, ou alors il faut prononcer une autre peine !
Madame la garde des sceaux, mes chers collègues, l’ambition de ces deux propositions de loi montre l’attachement que le Sénat porte à notre état de droit. Elles reflètent les attentes profondes de tous les Français, et pas seulement celles des serviteurs de la justice.
Sur un marché du droit en pleine expansion, les tribunaux n’ont plus de monopole : nous assistons à l’essor de sites internet proposant un éventail de plus en plus large de services de règlement des litiges. Si la justice continuait à dépérir, si le sursaut était encore différé, une justice de substitution, qui risquerait d’être aussi une justice au rabais, pourrait prospérer.
Voilà pourquoi, mes chers collègues, il y a urgence à agir pour la sauvegarde et le redressement de notre justice.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

M. François-Noël Buffet, corapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Madame la présidente, madame la ministre, s’exprimer à cette tribune à ce stade est un exercice singulier puisque M. Bas, président de notre commission et auteur des deux propositions de loi, a, comme à son habitude, quasiment tout dit
Sourires.

Je voudrais tout de même rappeler que ces deux textes que nous examinons en première lecture sont la concrétisation d’un travail de fond réalisé en 2016 et au début de 2017. Quelques éléments démontrent à quel point il fut approfondi : nous avons mené 117 auditions au Sénat et effectué treize déplacements sur le terrain, à Brest, à Marseille, à Dijon, à Élancourt, à Viroflay, à Nancy, à Metz, à Riom, à Bordeaux, à la direction des services judiciaires, à Bobigny, à Saint-Lô, à Lille, à Marmande et à Agen.
Pourquoi cette énumération ? Pour montrer à quel point la commission a été au plus près de la justice de nos concitoyens afin de se rendre parfaitement compte de la situation.
Comme l’a rappelé le président Bas, nous avons formulé 127 propositions consensuelles dans le rapport que nous avons présenté devant la commission des lois le 4 avril dernier, propositions à l’ensemble desquelles, il faut y insister à cette tribune, un accueil favorable ou très favorable a été réservé. Notre rapport fait consensus ou quasi-consensus à tous les niveaux, même si, bien sûr, quelques points font, mais de façon modérée, discussion.
La proposition de loi d’orientation et de programmation comprend un volet de programmation des crédits budgétaires et des emplois sur la période quinquennale 2018-2022, des réformes d’organisation et de structures, ainsi qu’un rapport annexé précisant, sur la même période, l’ensemble des réformes à mener, qu’elles soient législatives ou réglementaires, concernant l’évolution de l’organisation et les pratiques administratives.
La proposition de loi organique concerne notamment la loi organique relative aux lois de finances et le statut de la magistrature.
La principale mesure proposée, qui se trouve à la base de l’ensemble des autres propositions, vise à sanctuariser les crédits de la justice dans la LOLF afin de la préserver de ce que l’on appelle le gel budgétaire, parfois même le « dégel », et des annulations de crédits en fin d’année. Il s’agit d’une mesure essentielle, parce qu’elle permet d’inscrire et d’engager la réforme dans la durée.
La progression des crédits de la mission « Justice » de 8, 7 milliards d’euros en 2018 à 10, 9 milliards en 2022 inclut la création de 15 000 places de prison, ainsi que la progression du nombre d’emplois, qui passe de 85 700 en 2018 à près de 97 000 en 2022, et du nombre de conciliateurs.
Un dispositif plus précis en matière d’open data judiciaire et d’encadrement des sites internet est proposé. Il s’agit d’une mesure très importante qui constitue un élément substantiel de modernisation de notre justice et de son accès. La protection de cet open data judiciaire est évidemment un enjeu majeur.
En matière budgétaire, nous proposons le retour à l’aide judiciaire et, en particulier, le rétablissement de la contribution pour l’aide juridique, à un niveau modique et modulable, de 20 à 50 euros, pour abonder le budget de l’aide juridictionnelle en maintenant l’exemption pour les personnes éligibles à celle-ci.
Autre élément tout à fait nouveau : la consultation préalable obligatoire d’un avocat, financée par le budget de l’aide juridictionnelle, avant toute demande. Il s’agit de s’assurer de façon effective de la pertinence de la demande du justiciable. C’est une question essentielle en termes d’efficacité et de gestion des flux. Disons les choses telles qu’elles sont : il y a de la quantité ; il faut lui adjoindre désormais de la qualité pour avoir de l’efficacité.
À côté de la création d’un tribunal départemental de première instance, dont Jacques Bigot parlera dans quelques instants, nous proposons de transformer les tribunaux de commerce actuels en tribunaux des affaires économiques et d’en élargir la compétence, de façon cependant volontairement limitée, aux procédures relatives aux difficultés des entreprises. Les nouveaux tribunaux se verraient confier les compétences qui sont actuellement celles des TGI pour le monde associatif et les professions libérales.
Telles sont les quelques avancées et précisions apportées par la commission.
Si la réinstauration d’un droit de timbre ne fait pas forcément l’unanimité au sein de la commission des lois et de notre assemblée, elle demeure un élément budgétaire essentiel puisqu’elle rapportera plus de 55 millions d’euros par an, ce qui n’est pas négligeable en période de disette, sans priver du bénéfice de l’aide juridictionnelle ceux qui en ont besoin pour faire valoir leurs droits.
Le tribunal des affaires économiques, quant à lui, aura l’occasion de montrer sa grande compétence dans des affaires extrêmement techniques.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, auteur de ces deux propositions de loin, mon cher collègue corapporteur, mes chers collègues, ce fut un plaisir pour moi d’accompagner le président de la commission des lois dans le cadre de la mission.
Nous avons effectué de nombreux déplacements et de nombreuses auditions.
Ce fut également un plaisir de constater que nous parvenions à un accord sur énormément de points, nous inspirant du travail déjà réalisé lors des états généraux portés par Mme Taubira, lorsqu’elle était garde des sceaux, et de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Enfin, je voudrais remercier François-Noël Buffet de la manière dont nous avons travaillé, alors que nous n’appartenons pas à la même famille politique, l’un étant de gauche, l’autre de droite. Nous avons ainsi montré, madame la ministre, que nous avons écouté, pour partie, le Président de la République.
Sourires.

Dans le cadre du travail sur le redressement de la justice, nous avons, pour l’essentiel, trouvé des accords – ils concernent notamment le financement et l’organisation –, mais aussi mis en lumière des points de discussion, qui relèvent toutefois du détail.
Notre souhait en tant que corapporteurs est de vous donner, madame la ministre, la possibilité de vous battre, au sein du Gouvernement, pour avoir les moyens de redresser la justice. Je le sais, tous les gardes des sceaux l’ont dit, c’est une tâche difficile ! Elle est néanmoins indispensable. Il suffit, comme vous le faites, d’écouter les magistrats et les personnels pour se rendre compte qu’ils sont au bord du burn-out. Il est urgent d’avoir de nouveau des magistrats et des greffiers en nombre, ainsi que des conditions d’incarcération conformes à celles d’un État de droit digne de ce nom.
Le financement évoqué par MM. Bas et Buffet doit faire l’objet d’une programmation pluriannuelle et être accompagné d’une réforme organisationnelle. Cette dernière ne relève pas, pour l’essentiel, de la loi, mais des domaines administratifs et réglementaires. L’ensemble des réformes nécessaires a été décrit dans le rapport et repris de manière synthétique dans l’annexe à la proposition de loi.
Si les dispositions prévues par les deux textes sont importantes, elles demeurent toutefois insuffisantes. S’agissant du numérique, l’évolution envisagée est relativement légère et plutôt protectrice, notamment à l’égard des officines qui pourraient se créer. Bien qu’importantes, ces dispositions n’amélioreront pas le fonctionnement, car vous le savez, mes chers collègues, si la justice est en retard pour ce qui concerne le numérique, les efforts à réaliser sont essentiellement organisationnels.
La création du tribunal de première instance apparaît à nos yeux comme une formule organisationnelle souhaitable. D’abord, il faut abolir les distinctions de compétences entre tribunal d’instance et tribunal de grande instance, les tribunaux d’instance ayant vu la compétence du tribunal de police transférée vers le tribunal de grande instance. Par ailleurs, le juge des tutelles est dorénavant le juge aux affaires familiales, lequel appartient lui-même au tribunal de grande instance. À un moment donné, il est plus simple, pour les justiciables, d’arriver à une organisation de type tribunal de première instance, comme cela se fait dans d’autres pays européens.
En revanche, les problèmes relatifs au nombre de tribunaux par département perdureront. Nous souhaitons qu’il y ait un tribunal de première instance par département, tout en conservant à l’esprit l’idée selon laquelle tous les lieux de justice n’ont pas besoin d’être regroupés. Au demeurant, ces questions relèvent plus de l’organisation que des principes.
Pour notre part, nous posons le principe, dans la loi, d’un tribunal de première instance, principe qui fait consensus.
S’agissant de la conciliation, il est important, dans le droit fil de la réforme de modernisation de la justice du XXIe siècle, ou J21, de poursuivre les évolutions.
Pour ce qui concerne la question pénale, nous avons été très étonnés, François-Noël Buffet et moi-même, de l’insuffisance des liens entre justice et administration pénitentiaire. Il n’est plus possible que des magistrats, dans des tribunaux correctionnels, prononcent des peines en se déchargeant – de par la loi ! – de la question de l’application de la peine sur le juge de l’application des peines, sans se préoccuper de savoir comment les maisons d’arrêt peuvent fonctionner. Les responsables des prisons doivent pouvoir dire qu’il est impossible, pour des raisons de sécurité, d’accepter davantage de détenus. Les articles 27 et 28 de la proposition de loi permettent d’ouvrir, sur cette question, un débat, à mes yeux urgent, qui sera approfondi par la discussion des amendements déposés sur ces articles.
Nous avons souhaité ajouter un article additionnel pour prévoir, madame la ministre, la rédaction d’un rapport par les chefs de juridiction sur la situation de l’exécution des peines au regard de celle des maisons d’arrêt du ressort.
S’agissant de la proposition de loi organique, nous avons été sensibles, au cours de nos visites, à la question du turn-over, trop fort dans certaines juridictions, des magistrats. Nous souhaitons que ceux-ci restent au moins trois ans, quatre ans si ce sont des juges spécialisés, en poste et au maximum dix ans. Nous savons que c’est une pratique du CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, mais nous pensons qu’il faut l’inscrire dans la loi organique.
En guise de conclusion, je rappelle que nous avons eu un vrai débat, qui demeure, sur la possibilité d’avoir des magistrats entourés et aidés qui ne statuent pas seuls. Tel est le sens d’une réforme qui a choqué la magistrature, mais pas le Sénat, puisqu’il y reviendra au cours de l’examen des amendements.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je me réjouis d’être aujourd’hui devant vous pour débattre des deux propositions de loi que viennent de présenter M. Bas, leur auteur, et les deux rapporteurs. Je me dois de saluer d’emblée le travail considérable qui a été mené sous l’égide de son président par votre commission des lois.
Permettez-moi d’évoquer une anecdote personnelle. Vous m’avez remis, cher Philippe Bas, le rapport de la mission d’information très exactement – je l’ai daté – cinq jours après ma nomination. §Il a constitué un élément puissant de mon acculturation avec le milieu de la justice, et de cela aussi je vous remercie.
Que ces textes soient inscrits à l’ordre du jour du Sénat témoigne, s’il en était besoin, de l’intérêt soutenu et constant porté par la Haute Assemblée à la justice. Ce faisant, vous vous inscrivez résolument dans la grande tradition sénatoriale.
Le rapport de la mission d’information de la commission des lois, présenté le 4 avril 2017, dont ces textes se veulent la traduction, constitue un socle important. Il montre que l’objectif d’améliorer le fonctionnement de la justice dépasse largement tous les clivages partisans. Le débat d’aujourd’hui donnera l’occasion à chacun des groupes qui constituent le Sénat de démontrer que l’on peut s’accorder sur des propositions consensuelles en la matière. J’y vois la confirmation que la transformation de la justice ne doit pas seulement relever d’un enjeu idéologique. C’est pour moi une conviction profonde.
Qu’on ne s’y trompe pas ! Cela ne signifie pas que je ne suis pas attentive aux impératifs de l’État de droit et que je ne mesure pas les exigences constitutionnelles ou conventionnelles de protection des libertés publiques et individuelles.
Je ne veux pas signifier que des débats de cette nature seraient illégitimes ou inutiles. Ce serait absurde et contraire à toute idée démocratique. Je pense simplement qu’en tant que responsables politiques, que nous soyons parlementaires ou membres de l’exécutif, nous devons aussi apporter à la justice des solutions concrètes, opérationnelles, qui améliorent vraiment les choses, et non pas des idées préconçues qui se grefferaient sur une réalité qui serait tout autre.
Je partage en grande partie les orientations mises en avant par la mission d’information et reprises dans le rapport annexé à la proposition de loi.
Je ne peux que souscrire à la volonté qui y est exprimée de « renforcer les capacités de pilotage du ministère de la justice », de « moderniser le service public de la justice en innovant et en maîtrisant la révolution numérique », de « rendre l’institution judiciaire plus proche des citoyens », d’« améliorer l’organisation et le fonctionnement des juridictions en première instance et en appel », d’« accroître la maîtrise des dépenses » ou, enfin, de « redonner un sens à la peine d’emprisonnement ».
Je partage bien entendu toutes ces ambitions et je tiens d’ailleurs à remercier M. le président de la commission des lois d’être venu m’en présenter l’économie et la portée.
Dans le rapport de la mission comme dans les deux propositions de loi, l’accent est tout d’abord mis sur les questions budgétaires. Vous avez raison sur ce point, et le Gouvernement sait qu’il est nécessaire de donner, sur la durée, des moyens supplémentaires à la justice.
C’est une volonté forte qui a été exprimée par le Président de la République et par le Premier ministre, qui en a fait l’un des points essentiels de son discours de politique générale en juillet dernier.
Les paroles se sont traduites en actes : le budget du ministère augmentera de près de 4 % en 2018 à périmètre constant. Dans le contexte contraint de nos finances publiques, une telle augmentation est assez significative. La progression sera encore plus rapide dans les années à venir, puisqu’elle devrait s’élever à 4, 3 % en 2019 et à 5, 1 % en 2020.
En trois ans, le budget de la justice augmentera ainsi de près de 900 millions d’euros. L’un de mes prédécesseurs avait fixé l’objectif d’un accroissement d’un milliard d’euros sur l’ensemble du quinquennat. Cet objectif sera donc quasiment atteint sur les trois premières années. Sans en tirer gloire, c’est évidemment un motif de satisfaction, car c’est l’assurance que nous pourrons avoir les moyens indispensables pour soutenir les évolutions profondes que nous souhaitons mettre en œuvre en faveur de la justice.
Mais je pense aussi, comme j’ai eu l’occasion de le dire à plusieurs reprises, que l’augmentation des moyens ne suffira pas à elle seule à transformer la justice. C’est d’ailleurs un constat partagé avec la commission des lois.
Depuis plusieurs années, les discours sur la justice portent essentiellement sur des questions de principe et sur des questions budgétaires. Évidemment, ces enjeux sont légitimes et importants. Mais il faut aussi s’interroger sur l’adéquation de l’organisation de la justice et de ses procédures avec les missions qui nous sont assignées. Je veux traiter ces questions, car les augmentations budgétaires ne seront efficaces que si nous nous lançons dans une transformation en profondeur de notre système.
Dès son discours de politique générale, le Premier ministre avait annoncé, je le rappelais à l’instant, un projet de loi de programmation pour la justice qui devrait être présenté au Parlement au printemps prochain.
Cher Philippe Bas, vous souhaiteriez que ce projet de loi de programmation s’appuie sur la proposition de loi dont nous discutons aujourd’hui. Permettez-moi d’avoir sur ce point une divergence de nature plus méthodologique que principielle.
L’article 34 de notre Constitution prévoit que les lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État. Même si rien ne fait naturellement obstacle à ce que le Parlement prenne des initiatives en ce domaine, il me semble logique, sur le plan institutionnel, que le Gouvernement, qui détermine et conduit la politique de la Nation en application de l’article 20 de la Constitution, soit à l’initiative d’une loi de programmation pour la justice, laquelle traduit une volonté politique et une action dans la continuité.
Comme vous, je souhaite aller vite, car la justice ne peut plus attendre, mais je veux aussi agir avec méthode et pragmatisme, deux valeurs que vous ne renierez pas.
Plus fondamentalement sans doute, je pense que l’excellente base de travail que constituent les travaux de la commission des lois doit être encore enrichie par les propositions venues des acteurs mêmes de notre justice. Je n’ignore pas que la mission d’information que vous avez conduite est allée à la rencontre d’un nombre important d’entre eux et les a auditionnés.
Cependant, j’ai souhaité aller plus loin dans la consultation de celles et ceux qui peuvent être porteurs d’idées nouvelles, efficaces et réalistes, car j’ai la conviction, après quelques mois passés place Vendôme, que ce sont les acteurs au quotidien de la justice qui détiennent les clés de sa transformation.
Sans eux, rien n’est possible. Ce sont eux qui peuvent nous apporter les solutions concrètes dont nous avons besoin pour engager les indispensables évolutions. Leur expérience, leur engagement, leur imagination doivent nous être utiles. J’ai rencontré des magistrats et des personnels qui prennent des initiatives, fourmillant d’idées pour améliorer le traitement des dossiers, aller plus vite, mieux accueillir les justiciables… C’est sur eux que je veux m’appuyer.
C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de lancer des chantiers de la justice articulés autour de cinq thèmes : la transformation numérique, la simplification de la procédure pénale, la simplification de la procédure civile, l’adaptation de l’organisation territoriale, le sens et l’efficacité des peines.
Chaque chantier est coordonné par deux chefs de file choisis pour leur expérience sur chacun des sujets. Chaque chantier sera mené selon une méthode spécifique, ajustée au mieux aux besoins de l’exercice.
Je suis persuadée que la transformation numérique est la première priorité. Le justiciable ne peut plus comprendre que la justice reste à l’écart de l’évolution numérique, qui facilite l’accessibilité et l’efficacité des services publics. Le numérique offre l’opportunité unique de rendre notre justice accessible à chacun très simplement, de rendre des décisions plus rapidement, de réduire les distances géographiques, d’introduire de la transparence sur l’avancée des procédures. Vous l’avez, cher Philippe Bas, très bien écrit.
Ce sujet irrigue en réalité tout le fonctionnement de la justice. Ainsi, il n’est pas normal que les justiciables ne puissent suivre l’état de leur procédure en ligne, comme cela se fait, toute comparaison gardée, devant la juridiction administrative depuis plusieurs années. Il n’est pas normal non plus que l’on ne puisse pas saisir les juridictions en ligne, notamment pour les petits litiges. Enfin, on ne peut accepter que les procédures pénales ne soient pas dématérialisées, de l’enquête jusqu’à l’audience, et que les magistrats et les greffes se trouvent noyés sous le papier. Le plan de transformation numérique doit être ambitieux. Les acteurs de terrain, par leurs exigences, nous aideront à fixer les bonnes priorités.
Cette réflexion autour de la numérisation doit aller de pair avec la réforme des procédures civile et pénale. C’est une question de cohérence, puisque le cœur du procès sera, dans un futur proche, je l’espère, constitué d’un dossier numérique.
C’est pourquoi nous avons lancé, avec le ministre de l’intérieur, mon collègue Gérard Collomb, un ambitieux chantier d’amélioration et de simplification de la procédure pénale. Nous souhaitons ensemble – j’insiste sur cette volonté commune, concernant notamment la phase de l’enquête – que l’on puisse alléger et rendre plus efficace et plus fluide le travail des enquêteurs, dans le respect des libertés individuelles. Il faudra également renforcer l’efficacité du travail des magistrats, en leur permettant de se concentrer sur le cœur de leur activité.
Je souhaite donc que le débat s’engage, pour évaluer l’ensemble des propositions et, surtout, celles qui sont issues des consultations effectuées auprès des professionnels de la justice, mais aussi, pour la partie qui les concerne, auprès des enquêteurs, qu’ils soient policiers ou gendarmes.
Il va de soi que ce chantier trouvera sa concrétisation et ses prolongements dans les textes que nous présenterons au printemps.
Il en ira de même pour le chantier sur le sens et l’efficacité de la peine. Notre ordre pénal républicain est fondé sur le principe de l’individualisation des peines. Cela doit demeurer ainsi. Mais la réflexion n’a pas encore suffisamment investi le champ de l’exécution des peines. Je suis pourtant convaincue que, ce qui garantit l’efficacité de la répression, c’est le caractère adapté de la peine, mais aussi sa certitude et sa promptitude.
Outre un plan de construction de 15 000 nouvelles places de prison, qui traduit un engagement présidentiel et permettra d’assurer la prise en charge des détenus dans des conditions tout à la fois de plus grande sécurité pour la société et de plus grande dignité pour eux, une réflexion doit être conduite sur le sens de la peine. Elle devra prendre en compte ses trois dimensions : sécuriser la société, punir le condamné et assurer la réinsertion sociale de ceux qui ont purgé leurs peines.
Nous travaillons sur la manière de donner aux magistrats les moyens de prononcer des peines réellement diversifiées, en ne faisant plus de la peine d’emprisonnement la seule peine de référence et en réinscrivant à son côté des peines autonomes, notamment les peines de travaux d’intérêt général et le bracelet électronique pour les courtes peines.
Dans le cadre de ce chantier sera évalué notre système d’aménagement et d’exécution des peines, devenu, vous l’avez rappelé, messieurs les rapporteurs, trop complexe. Il faut aussi nous pencher sur le parcours des détenus en détention et l’aménagement des fins de peine. C’est essentiel pour la prévention de la récidive et la réinsertion des condamnés. Tous ces points se traduiront par des modifications de notre législation.
La simplification que j’appelle de mes vœux portera aussi sur la procédure civile.
La réforme de la procédure en appel, qui vient d’entrer en vigueur, doit être pleinement assimilée par les acteurs, et il faut se donner le temps d’une première évaluation avant de la retoucher profondément. En revanche, nous pouvons aller plus loin, me semble-t-il, s’agissant de la procédure civile de première instance.
Dans le cadre de la dématérialisation, il faut simplifier les règles de saisine du juge et développer puissamment la conciliation et la médiation. Il nous faudra travailler sur la déjudiciarisation d’un certain nombre de procédures, dans le cadre de ce chantier.
Je souhaite, entre autres choses, que l’on puisse expertiser l’idée de deux « procédures cibles » – procédure avec avocat et procédure sans avocat –, au sein desquelles viendraient se fondre les particularismes qui distinguent aujourd’hui les contentieux.
Il faut aussi que l’on puisse s’interroger sur l’office du juge et le rôle des parties quant à l’objet du litige : faut-il davantage responsabiliser les parties sur la mise en état du dossier ? Faut-il instaurer une obligation pour le juge de soulever d’office un moyen de pur droit ? Un juge compétent pour soulever d’office les moyens de droit, c’est en effet une piste pour rétablir l’égalité des armes au profit du justiciable qui ne dispose pas des ressources nécessaires pour s’assurer une défense de qualité.
Je souhaiterais enfin que l’on puisse réfléchir à la revalorisation du rôle du juge de première instance : pour ce faire, faut-il revoir les cas d’ouverture de l’appel ou encore généraliser l’exécution provisoire ?
Toutes ces questions seront soumises à la réflexion ; nous ne devons omettre aucune piste et n’éluder aucune question pour apporter les bonnes réponses.
Enfin, il reste un dernier chantier, qui n’est pas le moindre, celui de l’adaptation de l’organisation judiciaire. La proposition de loi en discussion comporte un certain nombre de propositions très précises à cet égard.
Cette adaptation est une conséquence inéluctable des réformes profondes que je souhaite mener. La simplification et la numérisation des procédures ne peuvent rester sans incidence sur nos modes de fonctionnement et sur notre organisation. Les nouvelles perspectives numériques, notamment, changeront le rapport des justiciables à la justice, mais modifieront aussi profondément le travail de l’ensemble des professions du droit.
À mon sens, le statu quo n’est pas possible. On ne peut imaginer une transformation de nos procédures et de nos modes de fonctionnement sans une adaptation de notre organisation, avec une seule idée-force : rendre le meilleur service possible au justiciable, car c’est bien lui qui doit être notre préoccupation centrale.
Cela signifie en particulier que les exigences qui s’imposent à notre organisation doivent être fondées sur le respect des principes de proximité et d’efficacité.
Je le rappelais à l’instant, votre mission d’information a proposé des pistes dignes d’intérêt, et je me réjouis qu’elle soit entrée positivement dans ce débat. L’adaptation de notre organisation est toujours un sujet sensible, compliqué, où les intérêts des uns et des autres se chevauchent, se confrontent, se retrouvent ou divergent parfois profondément. Le point de vue du Sénat, assemblée de la proximité et des territoires, est en la matière tout à fait essentiel, et j’y serai très attentive.
J’ai souhaité que cette question soit étudiée dans le cadre des chantiers de la justice avec un regard neuf, en se fondant sur une ample concertation. C’est la raison pour laquelle j’ai demandé que soit menée une mission de concertation avec l’ensemble des parties prenantes – professionnels du droit, magistrats, fonctionnaires, parlementaires et élus locaux – sur les principes qui doivent sous-tendre notre organisation judiciaire, tels que les principes de proximité, de collégialité, de spécialisation et de mise en cohérence avec l’action de l’État. Des propositions me seront faites par les chefs de file de ces chantiers au tout début de l’année prochaine.
Je veux cependant d’ores et déjà l’indiquer, cette réforme doit se faire en conservant le maillage actuel de nos juridictions, en maintenant les implantations judiciaires existantes. Les adaptations ne se traduiront par la fermeture d’aucun lieu de justice.
Je ne m’appuie et ne m’appuierai sur aucune carte préétablie. Mon projet ne sera pas fondé sur un quelconque schéma arrêté de manière autoritaire et technocratique. L’adaptation de notre réseau ne résultera que de la réflexion qui a déjà été conduite et de la concertation aujourd’hui engagée.
Sur tous ces chantiers, j’ai fait le choix d’un calendrier de travail resserré. La restitution des concertations aura lieu dès le 15 janvier prochain, sous la forme de propositions concrètes, opérationnelles et déclinées selon un calendrier précis, de manière à ce que nous puissions être prêts à présenter au Parlement un projet de loi de programmation pour la justice, qui comprendra des dispositions pénales, dès le printemps prochain.
Je souhaite que les résultats de ces chantiers puissent être restitués dans un cadre législatif avec la plus grande cohérence, car, si j’ai fait le choix de lancer simultanément ces cinq chantiers, c’est parce que j’ai la conviction que la transformation de la justice ne pourra résulter que d’une action globale. C’est finalement à cette conclusion que votre commission des lois a également abouti.
Sur le fond, des points de convergence existent entre nous, et c’est heureux, que ce soit sur des objectifs généraux ou sur des mesures concrètes. Je pense notamment aux services de communication en ligne fournissant des prestations juridiques ou aux amendes civiles pour les appels abusifs.
Sur d’autres points, nous avons des divergences. Je pense au rétablissement en l’état de la contribution pour l’aide juridique ou aux dispositifs qui pourraient rigidifier excessivement la gestion des ressources humaines.
Enfin, nombre des questions que vous avez soulevées sont liées aux conclusions des chantiers de la justice que je viens d’engager. C’est le cas concernant les moyens et les effectifs programmés. Je vous l’ai dit, le Gouvernement présentera dans quelques mois sa propre programmation. La répartition des postes et des moyens dépendra notamment du rythme auquel nous pourrons créer les 15 000 places de prison en faveur desquelles nous avons pris un engagement.
Les sujets relevant de l’aménagement des peines, du suivi socio-judiciaire ou de l’organisation de la première instance sont aussi directement liés aux chantiers de la justice.
Vous l’aurez compris, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement est très ouvert et très attentif aux propositions de votre commission des lois et de votre assemblée. C’est une remarquable base de départ, qui alimentera notre réflexion, parallèlement aux consultations de terrain lancées dans le cadre des chantiers de la justice.
Si vous le souhaitez, je tiens à votre disposition les questionnaires qui ont été adressés aux acteurs de terrain dans ce cadre. Les contributions de chacun nous seront très utiles.
Par respect pour le travail accompli et conformément à son souci d’écoute, le Gouvernement a fait le choix de ne pas déposer d’amendements sur ce texte. Il s’en tiendra globalement, en l’état, à une position de sagesse, souvent positive, parfois interrogative, mais, soyez-en assurés, toujours attentive.
Applaudissements.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ces deux propositions de loi font suite aux travaux de la mission d’information de la commission des lois sur le redressement de la justice que présidait Philippe Bas.
Les travaux de cette mission, qui comportait un représentant de chaque groupe parlementaire, ont donné lieu à un rapport présenté le 4 avril dernier.
Ces deux textes partent du constat que la hausse des moyens dévolus à la justice, passés de 4, 5 milliards à 8, 5 milliards d’euros entre 2002 et 2017, n’a pas apporté d’améliorations significatives. Trop de réformes sont venues rendre toujours plus complexe le fonctionnement de la justice, tandis que, dans le même temps, l’activité juridictionnelle n’a cessé de croître.
Par ailleurs, notre système judiciaire apparaît bien moins classé que d’autres systèmes judiciaires européens.
En effet, depuis plusieurs années, la Commission européenne pour l’efficacité de la justice, instance du Conseil de l’Europe créée pour évaluer l’efficacité des systèmes judiciaires, fait le constat d’une relative modestie du budget de la justice française.
Selon son rapport, le montant annuel du budget par habitant affecté au système judiciaire est assez faible puisque la France n’y consacre que 64 euros en moyenne, ce qui la place assez loin du niveau de dépenses consenti par des pays dont les structures sont comparables, comme l’Autriche – 96 euros par habitant –, la Belgique – 85 euros – ou l’Italie – 73 euros.
Si l’on rapproche le niveau de dépenses pour la justice du produit intérieur brut par habitant, qui est un bon indicateur de comparaison en zone euro, à niveau de richesse comparable, les Pays-Bas réalisent un effort budgétaire presque deux fois plus important que la France en faveur de leur système judiciaire.
Outre le fait que le système judiciaire français est moins bien classé que ses homologues européens, les prisons françaises souffrent depuis de nombreuses années d’une situation chronique de surpopulation carcérale.
En tant que rapporteur pour avis sur les crédits du programme « Administration pénitentiaire », je souhaite aborder ce problème.
Au 1er mars 2017, le nombre de personnes écrouées détenues s’élevait à 69 430 contre 67 580 au 1er mars 2016, soit une augmentation de 2, 7 % en un an.
Cette augmentation de la population carcérale s’inscrit dans une tendance constante d’accroissement depuis 2000, qui peut s’expliquer par trois facteurs : la suppression des grâces présidentielles collectives, l’augmentation du nombre de condamnations à des peines de prison ferme et l’allongement de la durée des peines prononcées.
La surpopulation carcérale est un facteur aggravant des conditions de travail de l’administration pénitentiaire. Exacerbant les tensions, elle peut nourrir des actes de violence à l’encontre du personnel. En 2015, le personnel pénitentiaire a été victime de 4 070 agressions physiques et de 16 040 agressions verbales ; 8 425 agressions physiques entre codétenus et 113 suicides en détention sont également à déplorer la même année.
Aussi la situation actuelle de surpopulation dans les prisons françaises nécessite-t-elle une augmentation considérable et une diversification du nombre de places dans les établissements pour assurer aux détenus des conditions d’hébergement dignes et pour améliorer les conditions de travail des agents de l’administration pénitentiaire.
En effet, l’augmentation substantielle de la capacité du parc carcéral apparaît nécessaire pour garantir une réponse pénale plus crédible : il est inconcevable que l’exécution des peines soit retardée en raison de la saturation des établissements pour peine.
Il est tout aussi contestable que des prévenus, détenus « provisoires » qui bénéficient de la présomption d’innocence, soient incarcérés dans des conditions indignes en maison d’arrêt.
La prison doit jouer un double rôle de punition et de réinsertion. Il est donc nécessaire de disposer d’établissements pénitentiaires offrant des conditions matérielles propices à la prévention de la récidive, mais également d’établissements très sécurisés pour les détenus les plus dangereux, notamment ceux qui sont radicalisés.
Un autre problème auquel il faut remédier sans tarder est l’effectivité de la peine.
S’il est certes exagéré d’affirmer que les condamnations à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à deux ans ne sont pas du tout exécutées, force est de constater toutefois que si le condamné n’est pas déjà incarcéré aucune condamnation à une peine inférieure à deux ans d’emprisonnement ne sera réellement exécutée en établissement pénitentiaire pour toute la durée prononcée par la juridiction.
Le fait qu’une personne condamnée semble ne pas subir de sanction pose problème : cette situation jette un lourd discrédit sur notre justice et suscite l’incompréhension des citoyens.
C’est pourquoi il apparaît intéressant que le juge de l’application des peines dispose d’un éventail d’alternatives à l’emprisonnement, comme les travaux d’intérêt général.
Pour conclure, madame la ministre, notre institution judiciaire a besoin à la fois de crédits et de réformes, et il y a urgence ! Le Sénat, à travers ces deux textes, propose de bonnes mesures. Pour cette raison, le groupe République et Territoires/Les Indépendants votera en faveur de ces deux propositions de loi.
M. le président de la commission applaudit.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, les propositions de loi de M. Bas, éminent président de la commission des lois, ont pour premier mérite de remettre la justice au cœur des débats, une thématique trop largement éclipsée lors des récentes campagnes électorales. Elles me donnent en outre l’occasion, en tant que nouvelle sénatrice, de m’étonner du peu d’élus dans l’hémicycle aujourd'hui alors que la justice est un pilier du fonctionnement de notre République !
Depuis des décennies, une lente dégradation des conditions matérielles de l’exercice de la justice est à l’œuvre dans notre pays, produisant pourtant de rares élans de manifestation, probablement en raison de la retenue naturelle qui caractérise les hommes de robe. Il serait pourtant naïf de considérer que cette dégradation, au prétexte qu’elle serait tue, ne serait pas perçue par nos concitoyens.
Cependant, malgré leur lenteur et leur manque de moyens, nos juridictions bénéficient encore, heureusement, de la confiance des Français. Nos tribunaux exercent toujours cette fascination que décrivait Gide dans ses Souvenirs de la cour d’assises voilà plus de cent ans. Sans doute, beaucoup de justiciables ont été rassurés d’observer comme lui « la conscience avec laquelle chacun, tant juges qu’avocats et jurés, s’acquittait de ses fonctions ».
La vigueur du sentiment de justice de nos concitoyens dépend en effet essentiellement du grand professionnalisme et du dévouement de l’ensemble des corps du ministère de la justice, lesquels font fonctionner nos juridictions avec des moyens, il faut l’avouer, bien inférieurs à ceux de nos voisins européens.
C’est pourquoi nous souscrivons à la démarche du président Philippe Bas lorsque, au moment de réformer, il choisit de se placer à la hauteur des hommes qui rendent la justice, avec la ferme volonté de résoudre leurs difficultés concrètes. C’est le cas, par exemple, au travers de l’article 25 de la proposition de loi, qui vise à permettre à la cour d’assises, statuant en appel, de ne pas réexaminer l’intégralité de l’affaire à la demande du condamné ou du ministère public.
Nous croyons fondamental, comme lui, de stabiliser la nomination des magistrats dans une même juridiction au moins trois ans et, pour la préservation de l’expertise acquise, de maintenir dans une même fonction les juges pour la même durée de trois ans.
De la même manière, la réforme de l’aide juridictionnelle associant les avocats en amont de l’attribution de l’aide par le bureau d’aide juridictionnelle nous semble aller dans le bon sens. La maîtrise des frais de justice ne sera efficace que si elle repose sur une démarche inclusive, en associant tous les acteurs en présence.
Il est indéniable que la réforme passe également par la résolution des difficultés que rencontrent plusieurs avocats. Dans un climat concurrentiel aiguisé par l’augmentation du nombre de confrères, le risque de la tentation d’alimenter les contentieux n’est pas inexistant.
Aussi, en parallèle d’une réflexion sur l’établissement d’un numerus clausus à l’entrée dans la profession, cette dernière doit-elle également être protégée de la concurrence déloyale des sites d’information en ligne, qui sont en plein essor. Certaines dispositions de la proposition de loi nous permettront peut-être d’avancer dans ce sens.
Si les nouvelles technologies peuvent faciliter le suivi des dossiers et accélérer les délais d’instruction, nous considérons, en revanche, qu’aucune innovation ne pourra remplacer la vertu cathartique du procès. Plusieurs dispositifs du texte nous posent ainsi question.
En premier lieu, nous nous interrogeons sur le paradoxe qui consiste à vouloir redresser la justice en décourageant le justiciable d’accéder au prétoire du juge… N’est-ce pas le sens de l’établissement d’amendes extrêmement dissuasives en cas de requêtes abusives ?
Mais nous savons que l’abus est difficile à caractériser à l’aune du droit d’ester en justice, qui est une liberté fondamentale. Il sera donc difficile d’asseoir ce principe.
En second lieu, il peut paraître inéquitable d’établir un coût élevé pour le pourvoi en rendant l’assistance par un avocat aux conseils obligatoire ; mais saisir la plus haute juridiction, qui ne statue que sur l’application du droit, nécessite l’assistance d’un juriste confirmé pour éviter les saisines inutiles. Là aussi, nous savons que ce combat de surcoût est vain.
En outre, au regard de l’obsolescence des outils bureautiques et des moyens de communication internes aux juridictions, il serait incompréhensible d’accorder de si précieux crédits à la construction d’un nouveau site internet ou au développement d’outils de justice prédictive alors qu’il nous faut nous concentrer d’abord sur la justice effective !
La Convention européenne des droits de l’homme, dans le premier alinéa de son article 6, fait référence au droit qu’a toute personne « à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ». C’est le sens du droit au procès équitable.
Sur la conciliation, montrons-nous modernes ! Cela peut être vraiment efficace si nous lui donnons une force exécutoire qui engage les parties. La conciliation peut responsabiliser le citoyen tout en permettant d’instaurer un échange, de retisser du lien social et de promouvoir l’idée d’un « vivre ensemble », tout en garantissant la fin du litige. Il faut cependant assurer et rassurer le citoyen sur l’exécution effective de la solution obtenue par la conciliation. Si nous décidons de la rendre obligatoire, il faut engager une homologation judiciaire.
La création d’un tribunal de première instance unique par département est un point qui nous paraît secondaire compte tenu de la nécessaire proximité que les justiciables sont en droit d’attendre. Les tribunaux d’instance remplissent aujourd’hui avec brio leur rôle de juge de proximité et tous les acteurs contestent l’existence de sureffectifs perdus dans les méandres de la carte judiciaire.
Alors oui, qui trop embrasse mal étreint ! Selon nous, ces textes de programmation auraient gagné à se concentrer sur quelques objectifs prioritaires : l’exécution des peines, la justice familiale et les nécessaires réformes du conseil de prud'hommes et du tribunal de commerce. Cependant, l’exercice a le mérite d’exister et de faire référence.
En conclusion, nous sommes tous d’accord pour affirmer que l’humain demeure la matière première de la justice. Le groupe du RDSE espérait que l’augmentation des effectifs affectés aux juridictions serait plus importante. Comme depuis trop longtemps maintenant, l’administration pénitentiaire absorbe la plus grosse part des crédits…
Aussi la première véritable réforme ambitieuse de la justice serait-elle de désolidariser les budgets de l’autorité judiciaire et de l’institution pénitentiaire, ce qui permettrait de distinguer la crise juridictionnelle de la crise carcérale, ainsi que de la crise engendrée par le manque d’établissements psychiatriques, car trop souvent la prison pallie cette politique irresponsable de fermeture d’établissements de soins.

Mme Nathalie Delattre. Ce sujet non plus ne doit pas rester tabou, afin que la justice puisse remplir correctement son œuvre sociétale.
Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, nous examinons deux propositions de loi, l’une ordinaire et l’autre organique, pour le redressement de la justice, toutes deux présentées par le président de la commission des lois, M. Philippe Bas.
Ces deux textes sont la traduction législative de 42 des 127 propositions formulées par la mission d’information pluraliste de la commission des lois dans un rapport rendu le 4 avril 2017.
Pendant neuf mois, la mission que vous avez conduite, monsieur Bas, a abattu un travail considérable en effectuant de nombreux déplacements et en procédant à de multiples auditions.
Partant d’un constat alarmant, unanime et sans appel relevant combien la complexité et la lenteur de notre système judiciaire contribuent à rendre la justice illisible, vous soumettez à notre assemblée dans ces deux textes des propositions fort intéressantes.
Je pense, notamment, à l’amélioration de l’organisation juridictionnelle en première instance et en appel, ou encore à la révolution numérique.
Les objectifs affichés de maîtrise des délais, de qualité des décisions rendues, de proximité ou encore d’effectivité de l’exécution des peines sont éminemment importants.
Cependant, je m’interroge sur l’opportunité de voter ces textes à la veille de l’examen du projet de loi de finances et à l’orée de chantiers gouvernementaux sur la justice.
En effet, la proposition n° 126 du rapport d’information, qui a inspiré les deux propositions de loi, préconisait la présentation au début de la prochaine législature d’un projet de loi de programmation sur cinq ans pour le redressement des crédits et des effectifs, ainsi que des réformes d’organisation et de fonctionnement de la justice.
Le 4 juillet dernier, lors de sa déclaration de politique générale, le Premier ministre, M. Édouard Philippe, répondait, avant le dépôt deux semaines plus tard de ces deux propositions de loi, à cette demande en annonçant l’examen par le Parlement au premier trimestre 2018 d’une loi quinquennale de programmation des moyens de la justice, laquelle engagera notamment un vaste mouvement de dématérialisation, de simplification et de réorganisation de notre système judiciaire.
Le Gouvernement entendait ainsi démontrer sa volonté de faire de la justice une priorité.
C’est également la raison pour laquelle les crédits qui lui seront alloués dans le projet de loi de finances que nous nous apprêtons à discuter augmenteront de 3, 9 % en 2018 par rapport à l’année précédente, cela dans un contexte général de redressement des comptes publics.
Cette hausse budgétaire doit être considérée comme une première étape, puisque la future loi de programmation quinquennale, qui sera examinée début 2018, prévoira de nouvelles augmentations de 4, 3 % en 2019 et de 5, 1 % en 2020.
Par ailleurs, le 6 octobre dernier, vous engagiez, madame la garde des sceaux, un long et exhaustif travail de concertation avec les professionnels de la justice pour faire remonter les attentes et les initiatives innovantes des différents acteurs du monde de la justice, notamment autour des cinq chantiers que vous avez rappelés, à savoir : une transformation numérique de notre justice, qui permettra notamment de faciliter les procédures en ligne des justiciables ; l’amélioration et la simplification de la procédure pénale ; l’amélioration et la simplification de la procédure civile ; l’adaptation de l’organisation judiciaire ; enfin, le sens et l’efficacité des peines.
Les conclusions de ces travaux seront remises en janvier prochain ; elles seront intégrées dans ce projet de loi de programmation pour la justice et au sein des projets de loi de simplification civile et pénale qui nous seront présentés au premier semestre 2018.
Aussi me semble-t-il judicieux d’attendre, d’autant que le rétablissement dans la proposition de loi de la contribution pour l’aide juridique ou encore l’extension du suivi socio-judiciaire à tous les délits et les crimes font partie des points de divergence qui, à tout le moins, nécessitent de recueillir au préalable le fruit des consultations lancées début octobre.
Il ne fait aucun doute que nous avons tous ici conscience de la situation de quasi-misère dans laquelle se trouve l’institution judiciaire, et nous mesurons l’état d’épuisement des magistrats et des fonctionnaires. Notre volonté est évidemment d’œuvrer pour l’amélioration du fonctionnement de notre justice. Il y va de l’intérêt de tous, professionnels du droit et justiciables, de pouvoir bénéficier d’une justice de qualité. Cette préoccupation dépasse largement les clivages partisans.
Néanmoins, parce que je crois sincèrement que le texte de programmation à venir ira dans le sens d’un redressement de la justice, souhaité par tous, et malgré l’intérêt et la qualité des dispositions qui nous sont présentées, lesquelles, j’en suis certain, viendront nourrir le texte gouvernemental, le groupe La République En Marche s’abstiendra de voter ces propositions de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, bien évidemment, nous partageons le constat initial à l’origine de ces propositions de loi : il est nécessaire et urgent de redresser notre justice, et il va de soi qu’il est primordial de sanctuariser le budget de l’autorité judiciaire, comme le prévoit l’article 1er de la proposition de loi ordinaire.
Certes, les moyens de la justice connaissent une hausse régulière depuis 2002. Pour autant, selon nous, mais c’est aussi l’avis de nombre d’acteurs du secteur, le budget de la justice n’échappe pas aux logiques d’austérité. Globalement, les moyens qui sont alloués à cette mission, année après année, ne suffisent pas à permettre aux services de fonctionner convenablement.
Cependant une question que mon collègue Pierre-Yves Collombat a soulevée en commission des lois nous taraude : comment lire le débat d’aujourd’hui au regard de la Constitution et de son article 40 ?
L’idée que ces textes ne fixent que des cadres et ne sont donc pas contraignants ne nous convainc pas. Il me semble – dites-moi si je me trompe – que c’est là une première en la matière et que cela fera pour ainsi dire jurisprudence ; je saurais d’ailleurs m’en souvenir. Qu’en est-il exactement, messieurs les rapporteurs ?
Par ailleurs, sur le fond, si nous partageons l’objectif de redressement budgétaire pour la justice, nous sommes au regret de constater que l’augmentation des crédits proposée s’inscrit dans la même orientation que celle de ces dernières années : une progression de 5 % par an bénéficiera de manière très réduite aux services judiciaires, ou encore à l’accès à la justice, puisqu’elle sera en grande partie absorbée par le programme « Administration pénitentiaire ».
Dès lors, la problématique du sujet est jetée : redresser la justice oui, mais pour en faire quoi ?
Il n’est pas vrai que le texte a été adopté dans un « esprit consensuel », comme l’avance la commission des lois, tout simplement parce que ce texte est loin d’être consensuel et qu’il porte en lui une vision de la société qui n’est pas la nôtre.
Six minutes pour évoquer un sujet si important et des propositions si nombreuses sont bien dérisoires ; je me limiterai donc aux points les plus problématiques à mes yeux et à ceux de mes collègues du groupe CRCE.
D’abord, je note une grande contradiction dans les propositions avancées : monsieur Bas, vous invoquez plus de proximité et d’accessibilité pour les justiciables. Cependant, dans le même temps, vous souhaitez fermer des lieux de justice, avec la création des TPI, vous voulez faire contribuer les justiciables aux dépenses de la justice, avec le retour du droit de timbre, et vous désirez ajouter des obstacles à l’obtention de l’aide juridictionnelle pour les plus précaires, avec la consultation obligatoire d’un avocat avant toute demande !
La création des tribunaux uniques de première instance ainsi que des chambres détachées n’est pas une bonne chose. Créer des lieux de justice qui ne seraient pas en charge de tous les contentieux et qui n’accueilleraient pas tout le personnel portera atteinte à la fois aux principes d’inamovibilité et d’indépendance des magistrats, mais aussi à l’exigence de proximité pour les justiciables. La proximité ne doit pas s’arrêter à la première instance, au juge de proximité ou au conseil de prud’hommes, il faut aussi qu’elle demeure au deuxième degré de juridiction. Trouvez-vous satisfaisant pour notre justice qu’un justiciable puisse se retrouver à quatre heures de sa cour d’appel ?
En ce qui concerne l’aide juridictionnelle, le fait de prévoir que toute demande doit être précédée de la consultation d’un avocat ajoute un obstacle supplémentaire au parcours du justiciable qui souhaite saisir la justice et qui n’en a pas les moyens. De plus, il est inadmissible de confier aux avocats, qui sont des acteurs privés, une mission relevant de l’autorité de l’administration à seule fin de réaliser des économies.
Le rétablissement du droit de timbre va, hélas ! dans le même sens. Instaurée en 2011 et supprimée en 2014, cette taxe présentée comme devant aider au financement de l’aide juridictionnelle aura surtout eu pour conséquence de finir de décourager bien des justiciables aux revenus modestes. Pourquoi alors vouloir la rétablir ?
Comme ma collègue Cécile Cukierman l’indiquait dans sa contribution au rapport de la mission qui a précédé ce texte, s’attaquer à l’aide juridictionnelle, c’est s’attaquer à la fonction essentielle de la justice, qui est de rétablir l’égalité des armes entre les parties. L’aide juridictionnelle est le moyen précieux d’accéder à la même justice pour tous.
En matière de justice pénale, vos propositions nous inquiètent et témoignent de l’urgence qu’il y a à réfléchir sérieusement sur le sens de la peine. Je vous rappelle, mes chers collègues, que celle-ci a trois vocations : punir, protéger la société et réinsérer.
Avec ce texte, la réinsertion n’a aucune place ; au contraire, la peine n’est envisagée que sous l’angle de la punition. En outre, l’unique peine considérée comme possible, voire efficace, est la peine de prison. Comme s’il n’existait qu’elle !
Mon discours aux antipodes de vos propositions va vous sembler inconcevable. Pour autant, monsieur le président de la commission des lois, je me dois de signaler les effets délétères de l’emprisonnement sur les personnes condamnées et, à terme, sur la société dans son ensemble. C’est aussi ce que relève l’Observatoire international des prisons.
C’est pourquoi nous demanderons la suppression de l’article 27, car il est essentiel que le juge de l’application des peines intervienne dans tous les cas, le but étant que la peine soit la plus adaptée possible, et ainsi la plus efficace, avec des « projets de sortie » au cas par cas pour une réinsertion réussie. Nous avancerons nos propositions en ce sens lorsque sera examiné le projet du Gouvernement.
À cet égard, nous formons le vœu que les chantiers que vous lancez, madame la garde des sceaux, ou qui sont en cours aboutissent à un texte sous-tendu par une tout autre logique – les premières annonces nous laissent cependant un peu sceptiques… –, car il y a urgence à prôner et à ériger une justice plus sociale et humaine. Sans cela, toute tentative de redressement sera vaine.
La justice fait l’objet d’une politique publique bien particulière, car elle est essentielle à notre État de droit : si elle ne fonctionne pas bien, c’est toute la société qui s’effondre…
Pour toutes ces raisons, et également parce que la commission des lois n’a modifié leur texte qu’à la marge, sans rien changer à l’économie générale, nous voterons contre ces deux propositions de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante-cinq, est reprise à vingt-et-une heures trente, sous la présidence de M. Thani Mohamed Soilihi.