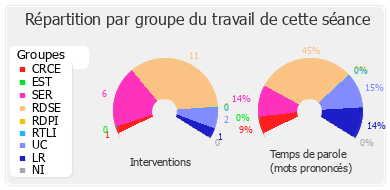Séance en hémicycle du 4 juin 2009 à 15h15
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à treize heures quinze, est reprise à quinze heures quinze.

La séance est reprise.
(Texte de la commission)


Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l’objet de cette proposition de loi est de doter nos collectivités et leurs groupements d’un nouvel outil d’intervention.
Ce nouvel instrument leur permettra de contracter avec une société publique locale en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes qui précise les conditions dans lesquelles une collectivité peut être dispensée d’appliquer les règles communautaires en ce qui concerne les marchés publics ; elle explicite en particulier la notion de in house, autrement dit, en français, les « prestations intégrées ».
L’arrêt Teckal du 18 novembre 1999 a posé deux conditions pour qu’un contrat puisse être qualifié de in house : que la collectivité exerce sur son cocontractant « un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services » et que ce cocontractant « réalise l’essentiel de son activité » avec la ou les collectivités qui le détiennent.
À cet égard, j’ai noté que le Gouvernement avait déposé un amendement visant à préciser le périmètre, que nous avions pourtant, me semble-t-il, bien défini. Cela étant, je ne vois pas d’inconvénient à ce que l’adverbe « exclusivement » soit ajouté.
Dans son arrêt Stadt Halle du 11 janvier 2005, la Cour a précisé que la participation, fût-elle minoritaire, d’une entreprise privée dans le capital d’une société à laquelle participe également le pouvoir adjudicateur en cause exclut que ce pouvoir adjudicateur puisse exercer sur cette société un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services.
Depuis l’arrêt ASEMFO du 19 avril 2007, le contexte du in house est clairement établi. Sous réserve du respect des deux conditions fixées par l’arrêt Teckal, les sociétés dont le capital est entièrement détenu par des collectivités sont, vis-à-vis de ces dernières, dans une situation de prestations intégrées.
Dans presque tous les pays de l’Union européenne, comme l’a d’ailleurs relevé de façon exhaustive notre rapporteur, de tels outils existent. Ils permettent de respecter pleinement le droit communautaire tout en préservant la liberté de la collectivité de travailler avec une société publique locale.
En France, compte tenu de la présence obligatoire d’au moins un actionnaire privé à leur capital, les sociétés d’économie mixte ne peuvent prétendre se trouver dans une relation in house avec leurs collectivités. Et pourtant, nombre de SEM travaillent essentiellement pour les collectivités actionnaires dans les domaines de la construction, des services, de l’aménagement, ainsi que dans ceux de la gestion de logements, d’équipements sportifs et culturels, sans oublier le domaine de l’eau et de son assainissement ni ceux du stationnement ou des transports.
La présente proposition de loi vise à doter les collectivités et leurs groupements d’un nouvel outil qui élargit la palette des moyens leur permettant d’exercer leurs compétences, tout en respectant le droit communautaire et le principe de libre-administration des collectivités territoriales, dans le cadre d’un statut sécurisé, y compris, pour ce qui concerne la responsabilité civile des administrateurs des SEM, ce qui n’est pas du tout négligeable.
Dans le même temps, cette procédure garantit une transparence et un contrôle stricts. C’est l’objet de l’article 1er, qui a été judicieusement modifié par notre rapporteur, en plein accord avec moi. Il s’agissait, en particulier, de prendre en compte la loi du 25 mars dernier. En effet, lorsque j’ai déposé la présente proposition de loi, le texte en question n’avait pas été voté, ce qui explique la nécessité d’actualiser l’article 1er.
Je reconnais que l’amendement du Gouvernement lève le doute juridique lié à la présence éventuelle d’établissements publics dans l’actionnariat, que prévoit le texte de la proposition de loi. Nous en reparlerons certainement lorsque nous examinerons l’article 1er.
L’article 2 prévoit de simplifier l’actionnariat des sociétés publiques locales d’aménagement, les SPLA, qui, créées par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, font l’objet de l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme. Cela correspond aux recommandations du Gouvernement quant à une simplification de nos règles en vue d’obtenir plus d’efficacité et de réactivité, en particulier dans le cadre des plans de relance.
Ce système d’actionnariat semble en effet trop complexe à certaines collectivités. Il a d’ailleurs limité le nombre de créations de SPLA. Par ailleurs, le champ d’application est trop limité pour couvrir certaines opérations d’aménagement, en particulier celles que conduisent des collectivités avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.
Pour tenir compte de la loi du 25 mars dernier, je vous présenterai donc, en accord avec le rapporteur – c’est ce qui s’appelle de la coproduction !
Sourires

Dois-je vous dire, monsieur le secrétaire d’État, à quel point je me réjouis que vous proposiez la suppression de l’article 3 ?
Sourires

On nous avait fait comprendre, à M. le rapporteur et à moi-même, qu’il valait mieux gager cette proposition de loi. Je ne parvenais d’ailleurs pas à comprendre pourquoi puisque l’objet même de ce texte était de diminuer les charges des collectivités en évitant notamment la publicité et les appels d’offres. Mais on nous avait dit que, faute de gage, il serait possible que nous soit brutalement opposé l’article 40. D’où cet article 3.
Je suis donc très sensible au fait que vous leviez le gage en proposant la suppression de cet article, si tant est que certains aient pu avoir l’idée de nous opposer brutalement l’article 40 !
Nouveaux sourires.

Les auditions, conduites aussi bien par moi-même que par notre rapporteur auprès de l’Association des maires de France, de l’Assemblée des départements de France, de l’Association des régions de France et de la fédération des SEM, nous confortent dans l’idée que ce nouvel outil procure un avantage indéniable à nos collectivités en termes d’efficacité, de réactivité et de sécurité juridique, que ce soit pour la société elle-même ou pour les administrateurs, notamment lorsqu’il s’agit d’élus.
Dans le contexte de crise économique que nous connaissons, et sachant que les collectivités sont les principaux investisseurs dans le domaine des équipements, il importait de leur fournir un nouvel outil.
Je vous propose donc, mes chers collègues, d’ajouter celui-ci à la panoplie d’instruments dont disposent nos collectivités pour leur permettre d’exercer leurs compétences.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC-SPG. – Mme Anne-Marie Escoffier et M. Jean-Léonce Dupont applaudissent également.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, les réflexions menées sur la nécessaire réforme des collectivités territoriales mettent en évidence que les lois de décentralisation ont profondément modifié le champ de compétences et le mode de fonctionnement de ces collectivités.
Quelles que soient les différences de point de vue, qui ne recoupent pas forcément les clivages traditionnels, il apparaît aujourd’hui clairement que la grande majorité des élus locaux souhaitent disposer d’outils de gestion assurant tout à la fois une simplification des procédures et une accélération du processus administratif, ainsi que la transparence et la sécurité juridique, au regard tant du droit interne que de la jurisprudence communautaire.
C’est dans cette perspective que notre collègue Daniel Raoul et le groupe socialiste ont déposé la présente proposition de loi sur la création des sociétés publiques locales, qui procède manifestement du même esprit que la proposition de loi dont notre collègue Jean Léonce Dupont, rejoint par un certain nombre de collègues, avait pris l’initiative.
M. Jean-Léonce Dupont acquiesce.

Ce dispositif est destiné à permettre aux collectivités, pour l’exercice de leurs compétences, d’intervenir dans le domaine concurrentiel, dans le respect des dispositions régissant ce champ. Il introduit dans notre arsenal législatif les instruments qui, dans les autres États membres de l’Union européenne, assurent aux collectivités publiques la liberté de contracter avec une société locale conformément aux exigences communautaires.
En effet, la jurisprudence dispense, sous certaines conditions, une collectivité de l’application des règles édictées en matière de marchés publics, selon le principe dit des « prestations intégrées ». Je fais d’ailleurs observer qu’il ne s’agit aucunement de contourner la jurisprudence européenne, mais bien au contraire d’être en harmonie avec elle.
C’est pourquoi les auteurs de la proposition de loi suggèrent d’adapter la loi française aux principes européens pour renforcer la capacité d’action des collectivités locales en leur permettant d’agir plus rapidement.
La proposition modifie par ailleurs le régime des sociétés publiques locales d’aménagement introduites par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.
Au fil des années, la Cour de justice des Communautés européennes a élaboré une jurisprudence dont on peut considérer qu’elle est aujourd'hui univoque.
Elle a fixé les conditions permettant à une personne morale qui dispose d’un pouvoir adjudicateur, au sens de la réglementation communautaire, de confier à un tiers la réalisation d’opérations qualifiées de « prestations intégrées », non soumises aux procédures de passation des marchés publics ; ces normes communautaires visent à garantir le jeu de la concurrence.
Pour écarter l’application des règles concurrentielles, la jurisprudence communautaire des « prestations intégrées » exige la réunion de deux conditions, qui ont été déterminées par l’arrêt Teckal du 18 novembre 1999 : l’autorité publique doit, d'une part, exercer sur la personne en cause un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services et, d'autre part, réaliser l’essentiel de son activité avec la ou les collectivités qui la détiennent.
Dans des décisions ultérieures, la Cour a précisé ces deux circonstances.
En ce qui concerne la réalité du contrôle analogue, celui-ci ne doit pas nécessairement être identique en tout point au contrôle exercé sur les services propres de l’autorité publique, comme le précise l’arrêt Coditel Brabant SA du 13 novembre 2008. Il doit permettre au pouvoir adjudicateur d’influencer les décisions sur son cocontractant, c’est-à-dire de disposer « d’une possibilité d’influence déterminante tant sur les objectifs stratégiques que sur les décisions importantes de cette société ».
En tout état de cause, le critère du contrôle analogue se trouve exclu si le capital de l’entité en cause est ouvert au privé, même pour une part infime, puisque, dans ce cas, la Cour considère que l’entreprise obéit « à des considérations propres aux intérêts privés et poursuit des objectifs de nature différente de ceux d’intérêt public ».
Nos sociétés d’économie mixte locales, nos SEML, sont donc clairement soumises aux procédures de mise en concurrence, puisqu’elles doivent comporter au moins un actionnaire privé ; d’où l’intérêt de créer et de développer des sociétés publiques locales. Pour le reste, les éléments de l’espèce sont déterminants.
Par ailleurs, s’il importe que le contrôle exercé sur l’entité soit effectif, il n’est pas indispensable qu’il soit individuel. En conséquence, ce contrôle peut être exercé conjointement par les autorités publiques. La procédure utilisée pour la prise de décision dans un organe collégial, notamment le recours à la majorité, est sans incidence.
Le second critère fixé par la Cour de justice est dit « de l’essentiel de l’activité ». Cette exigence, destinée à établir une harmonie avec les règles communautaires, impose à l’entité distincte de la collectivité – ou des collectivités – qui la détient de réaliser avec cette dernière l’essentiel de son activité.
Là encore, cette condition vise à préserver le jeu de la concurrence, dans le cas où une entreprise contrôlée par une ou plusieurs collectivités publiques exercerait une part importante de son activité économique avec d’autres opérateurs.
Cette notion résulte de la jurisprudence de la Cour de justice, qui, au fil de ses décisions, en a affiné les contours, prenant en compte « toutes les circonstances de l’espèce, tant qualitatives que quantitatives ».
L’activité de l’entreprise doit donc être consacrée principalement à la collectivité publique. Son volume, dans le cas d’une entité détenue par plusieurs collectivités publiques – une configuration que votre commission a souhaité favoriser – est évalué en prenant en compte les prestations réalisées au profit de l’ensemble des actionnaires.
La Cour vérifie le respect du second critère sans exiger que l’essentiel de l’activité soit réalisé avec telle ou telle de ces collectivités ; il importe, en revanche, de prendre en compte ces collectivités dans leur ensemble.
Je le répète, depuis la publication de l’arrêt Teckal, une série de décisions de la Cour de justice des Communautés européennes ont permis de dégager une jurisprudence que l’on peut considérer comme univoque et qui a été clairement confirmée par l’arrêt République italienne du 17 juillet 2008.
Par ailleurs, les sociétés publiques locales d’aménagement ont été créées par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, après de longs débats et plusieurs tentatives antérieures, avec notamment, au Sénat, la proposition de notre ancien collègue M. André Vézhinet et les interventions de MM. Jean-Jacques Hyest et Jean-Pierre Sueur.
En définitive, la loi a consacré cette initiative. Les SPLA constituées sous la forme de sociétés anonymes avec des actionnaires exclusivement publics – les collectivités territoriales et leurs groupements –, ont pour objet de réaliser des opérations d’aménagement.
Selon un premier bilan de ce dispositif dressé au 31 mars 2009, trente-neuf initiatives ont été engagées : sept sociétés publiques locales d’aménagement ont été créées et trente-deux autres sont en projet. Parmi les promoteurs des SPLA, on trouve tout à la fois une région, des départements, des communes et des intercommunalités.
Deux cas de figure se présentent : soit la création d’une SPLA ex nihilo, soit la transformation en une telle société d’une SEML existante.
La proposition de loi présentée par notre collègue Daniel Raoul prévoit, en premier lieu, d’offrir aux collectivités locales un nouvel outil d’intervention, en généralisant à l’ensemble des services publics locaux le dispositif des SPLA, et, en second lieu, d’amender le régime des SPLA au vu de l’expérience acquise depuis trois ans.
Les sociétés publiques locales, ou SPL, se définissent tout à la fois par leur objet, la qualité de leurs actionnaires et la spécificité des règles qui les régissent.
Aux termes de l’article 1er de la présente proposition de loi, ces sociétés seraient créées soit pour réaliser, en plus des activités déjà ouvertes aux SPLA, des opérations de construction, soit pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt général.
Pour les auteurs de ce texte, les SPL, dont l’objet social doit être déterminé par référence aux compétences reconnues par la loi aux collectivités territoriales, pourraient intervenir « dans tous les domaines de compétence actuellement ouverts aux SEM ». En effet, nombre de ces dernières, comme l’a constaté Daniel Raoul, « ne travaillent que pour leurs collectivités actionnaires ».
Mes chers collègues, précisons que ce dispositif provoquera la transformation de certaines SEML en EPL, c'est-à-dire en établissements publics locaux, mais concernera essentiellement des sociétés créées à l’initiative d’une collectivité pour ses besoins propres.
Ces SPL sont constituées sous la forme de sociétés anonymes régies par le code de commerce, sous réserve des dispositions spécifiques aux SEML qui sont prévues par le code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne le capital de la société, l’ensemble des actions est détenu par des personnes publiques, à savoir les collectivités territoriales et leurs groupements, associées éventuellement – j’insiste sur ce dernier terme, car nous trouverons, me semble-t-il, une solution permettant de supprimer cette disposition – à des établissements publics.
Par dérogation à l’article L. 225-1 du code de commerce, qui fixe à sept le nombre minimum des actionnaires, la proposition de loi abaisse ce seuil à un ; toutefois, nous serons amenés à examiner un amendement tendant à le relever à deux.
Afin de tirer les enseignements de l’expérimentation menée actuellement dans les sociétés publiques locales d’aménagement, l’article 2 de la proposition de loi en modifie le régime sur trois points : la composition de l’actionnariat, l’objet et la forme de ces sociétés.
En ce qui concerne l’allégement de l’actionnariat, la loi du 25 mars 2009 a abaissé à deux le nombre minimum d’actionnaires.
Par ailleurs, l’article 2 de la proposition de loi élargit l’objet des sociétés publiques locales d’aménagement, pour permettre à celles-ci de « devenir de réels outils d’aménagement et de rénovation urbaine ». Il tend à doter les SPLA des pouvoirs institués dans ce cadre au profit des collectivités locales, à savoir la réalisation d’études préalables, l’acquisition foncière ou immobilière, les opérations de construction et de réhabilitation immobilières, l’acquisition et la cession de baux commerciaux.
Ces sociétés pourraient également exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorité définis par le code de l’urbanisme, mais aussi agir par voie d’expropriation.
Enfin, l’article 2 de la proposition de loi prévoyait de diversifier le champ de la forme sociétale en permettant la constitution de SPLA en sociétés par actions simplifiées. Toutefois, après réflexion, nous sommes tous d'accord, me semble-t-il, pour supprimer une disposition qui emporterait plus de conséquences dommageables en matière de sécurité juridique qu’elle n’aurait d’avantages.
M. Daniel Raoul acquiesce.

Lors des auditions auxquelles nous avons procédé, nous avons pu constater que les collectivités locales étaient unanimement favorables aux dispositions de cette proposition de loi. Elles se sont exprimées par la voie de l’Association des régions de France, de l’Association des maires de France et de l’Assemblée des départements de France ; leurs représentants ont considéré que les sociétés publiques locales devaient constituer un outil complémentaire de la SEM, sans s’y substituer. Bien entendu, cette proposition de loi a aussi reçu un avis très favorable de la Fédération des entreprises publiques locales.
En revanche, les représentants de l’Union nationale des services publics industriels et commerciaux, l’UNSPIC, et de la Fédération professionnelle des entreprises de l’eau, la FP2E, se sont déclarés plus réservés sur cette initiative, qui, selon eux, pourrait susciter de multiples contentieux.
En réalité, les sociétés publiques locales existent déjà dans la plupart des pays européens ; on en compterait 16 000 au total dans les États constituant l’Union européenne.
Mes chers collègues, la position de votre commission des lois est d’approuver sur le principe la création de ces sociétés publiques locales tout en renforçant et en sécurisant leur régime juridique.
À l’évidence, ces sociétés publiques deviendront un outil indispensable au bon fonctionnement des collectivités locales, car elles apporteront à celles-ci une souplesse supplémentaire, ce qui leur permettra d’exercer leurs compétences avec plus d’efficacité et de rapidité, tout en respectant la réglementation communautaire.
Cette proposition de loi mettra également un terme à une situation paradoxale : dans l’état actuel du droit, une collectivité locale peut créer une SEML, qui lui sert de « bras armé », mais elle doit engager les procédures de mise en concurrence pour réaliser les opérations pour lesquelles cette SEML a pu être créée.
Nous adhérons donc à la démarche des auteurs de la proposition de loi.
Par ailleurs, notre commission a proposé un statut sécurisé qui encadre la création et le fonctionnement de ces nouvelles structures ; des procédures de contrôle seront indispensables pour leur permettre de fonctionner en toute transparence et dans un cadre strict.
J’approuve donc le choix de la forme de la société par actions. Il considère que celle-ci permettra une information transparente sur la réalité des coûts et des risques.
Complété par le régime spécifique des SEML, ce dispositif offrira une palette d’outils susceptibles de garantir pleinement l’information et le contrôle des collectivités actionnaires, ce qui est tout à fait indispensable.
Bien entendu, il importe que les règles posées par le législateur soient scrupuleusement respectées, tant dans la rédaction des statuts que dans la vie sociale, afin de ne pas enfreindre les normes communautaires édictées pour assurer le jeu de la concurrence.
De là des sûretés supplémentaires, qui ont fait l’objet d’amendements retenus par la commission des lois.
Ainsi, nous avons considéré que l’actionnariat unique pouvait présenter un risque de dérive et que, par conséquent, il était préférable, dans l’intérêt même des collectivités, de maintenir la présence obligatoire de deux actionnaires au moins. Il s'agit là d’un filtre supplémentaire pour assurer le respect de l’objectif assigné par le législateur, servir l’intérêt général et faciliter le contrôle démocratique.
De même, notre commission a estimé que la faculté, offerte par l’article 2 de la proposition de loi, d’opter pour la forme de la société par actions simplifiée, ou SAS, pour la constitution de SPLA n’était pas conforme à l’intérêt des collectivités, car les dispositions réglementant les SAS ne présentent pas la même protection que celles qui sont applicables aux sociétés anonymes. Aussi la commission recommande-t-elle l’abandon de la forme sociétale de la SAS pour la création des sociétés publiques locales d’aménagement.
Enfin, nous avons proposé de préciser que les sociétés publiques locales devaient impérativement réaliser leurs activités sur le territoire des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales actionnaires.
La commission des lois a donc adopté cette proposition de loi en modifiant l’article 1er et en s’en remettant à l’auteur de ce texte pour les modifications à apporter à l’article 2. D’où les deux amendements que présentera notre collègue Daniel Raoul, mais qui ont été rédigés en concertation avec lui et sur lesquels la commission des lois a émis un avis favorable.
En effet, tout en approuvant l’économie générale de cet article, la commission a estimé nécessaire de renforcer la protection des collectivités et de clarifier la rédaction du texte.
Le Gouvernement a, quant à lui, déposé quatre amendements.
L’amendement n° 4 visant à lever le gage, il a évidemment reçu un avis favorable de la commission et je ne doute qu’il recueillera l’unanimité de notre assemblée.
La commission est également favorable à l’amendement n° 6, qui tend à spécifier que les sociétés publiques locales travaillent exclusivement pour le compte de leurs actionnaires.
L’amendement n° 3, qui a pour objet de restreindre l’objet social des SPL aux opérations d’aménagement, de construction, de maintenance et d’exploitation des équipements construits, a reçu un avis défavorable de la commission, car une telle restriction équivaudrait à enlever tout intérêt à la création des SPL.
Enfin, le Gouvernement a déposé un amendement visant à supprimer la possibilité pour les établissements publics d’être actionnaire d’une SPL, afin de conforter le respect du critère de contrôle analogue. La commission a réservé son avis sur cet amendement, dans l’attente d’explications du Gouvernement. En tout cas, nous n’y sommes pas hostiles – je viens de m’en entretenir avec notre collègue Mme Troendle –, même si nous pensons qu’il eût été intéressant de retenir la notion d’établissement public administratif, écartant ainsi les établissements publics à caractère industriel et commercial ; il sera toujours possible d’y revenir ultérieurement.
Je dirai en conclusion que la commission a vu l’intérêt pour les collectivités locales, et donc pour nos concitoyens, de la création des sociétés publiques locales. Je considère que cette proposition de loi doit aussi s’inscrire dans un esprit de confiance vis-à-vis de nos collectivités territoriales – et de leurs élus –, car elles assument la plus grande part de l’investissement public, votent leur budget en équilibre et exercent leurs compétences avec la garantie de contrôles justifiés.
Par conséquent, faciliter et moderniser l’action des collectivités locales est un enjeu qui justifie l’avis favorable de la commission sur cette proposition de loi, assortie des modifications que nous suggérons et que ses auteurs ont bien voulu accepter.
Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG. – M. Jean-Léonce Dupont applaudit également.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi de M. Daniel Raoul relative au développement des sociétés publiques locales n’est pas la seule initiative parlementaire qui traite de ce sujet puisque votre collègue M. Jean-Léonce Dupont et M. Jean-Pierre Schosteck, député, ont également déposé des propositions de loi rédigées en termes comparables.
Cette convergence d’initiatives entre les deux assemblées et entre différents groupes politiques, appartenant à la majorité à l’opposition, démontre s’il en est besoin la volonté du Parlement de proposer des outils nouveaux aux collectivités locales. Le Gouvernement ne peut évidemment que s’en réjouir.
Les collectivités assurant plus des deux tiers de l’investissement public dans notre pays, elles jouent évidemment, particulièrement dans la période de crise que nous traversons, un rôle majeur. Il est donc essentiel de soutenir leur action et de leur permettre d’agir dans un cadre juridique sûr et efficace.
L’adoption de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a permis, à titre expérimental, pour une durée de cinq ans, aux collectivités territoriales et à leurs groupements de créer des sociétés publiques locales d’aménagement dont ils détiennent l’intégralité du capital.
Ces sociétés sont compétentes pour conduire des opérations d’aménagement, au sens du code de l’urbanisme. À ce jour, selon mes sources, six de ces sociétés ont été créées et une dizaine est en cours de constitution. J’ai bien entendu, monsieur le rapporteur, que vous faisiez état de sept SPLA créées : c’est sans doute que l’une de celles qui était en cours de constitution a été formée entre le moment où j’ai recueilli des informations et celui où vous vous avez établi votre rapport.
Les différentes initiatives parlementaires tendent à aller plus loin, d’une part, en pérennisant les sociétés publiques locales d’aménagement, et surtout, d’autre part, en créant des sociétés publiques locales, aux compétences élargies.
Dans cet esprit, le Gouvernement est favorable aux simplifications et allégements de procédures ainsi qu’au développement de l’économie mixte, mais il doit aussi – j’ai cru comprendre que tel était aussi le sentiment de l’auteur de cette proposition de loi – s’assurer de la fiabilité du cadre juridique proposé aux collectivités. C’est pourquoi, au nom du Gouvernement, je défendrai plusieurs amendements en ce sens.
Différents textes adoptés récemment tendent à alléger les procédures et à simplifier le cadre juridique dans lequel évoluent les collectivités locales.
Ainsi, la création des contrats de partenariat entre le public et le privé permet de faire émerger les projets des collectivités et de trouver les financements nécessaires à leur réalisation.
Les décrets du 19 décembre 2008 visant à relever les seuils des procédures formalisées pour les marchés de travaux ainsi que ceux qui sont relatifs aux dispenses de publicité et de mise en concurrence offrent plus de réactivité et de souplesse aux élus locaux, dans le respect des normes européennes.
Enfin, l’adoption de la loi du 17 février dernier sur l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés permet au conseil municipal, par exemple, d’accorder une délégation au maire concernant les marchés quel qu’en soit le montant.
Toutes ces mesures de simplification vont dans le bon sens.
Je ne veux pas dresser ici un catalogue exhaustif, mais personne ne peut nier que, dans bon nombre de domaines, le recours à des montages juridiques associant initiatives publiques et initiatives privées permet de réaliser des opérations de grande envergure. Je pourrais donner l’exemple, pour en être l’un des praticiens, de la rénovation urbaine, indispensable à nos villes et à leurs habitants, qui fait appel à des fonds publics, mais aussi à des interventions privées.
De la même manière, la réalisation et la gestion d’un nombre non négligeable de services publics à caractère industriel et commercial sont possibles grâce à l’intervention combinée des collectivités territoriales et de la sphère privée.
Il ne fait aucun doute que, demain, le recours à des systèmes mixtes sera très utile pour mettre en œuvre la grande ambition du Grenelle de l’environnement, qui doit amener un certain nombre de collectivités à prendre des décisions d’ampleur.
Il est important que les collectivités puissent recourir, selon leurs besoins et selon leurs moyens, à des procédures et à des opérateurs différents : délégation de service public, régie, société d’économie mixte, société publique locale d’aménagement et, demain, société publique locale. La palette doit être large, clarifiée et aussi simple que possible d’utilisation, pour permettre à chacun d’y trouver l’instrument dont il a besoin.
Nous devons évidemment offrir un cadre juridique fiable aux collectivités locales ; à défaut, ce sont leurs procédures qui risqueraient d’être annulées par le juge, avec toutes les conséquences tant financières qu’humaines qui en découlent.
Je ne voudrais pas être un oiseau de mauvais augure en refaisant l’historique du dossier concernant les concessions d’aménagement, mais il constitue une bonne illustration de ce qu’il convient désormais d’éviter. Tous, vous savez les fragilités juridiques de cette procédure. De nombreuses conventions antérieures à la loi du 30 juillet 2005 pourraient être requalifiées en marchés publics de travaux par le juge administratif à la suite de la question préjudicielle transmise à la Cour de justice des communautés européennes.
Le Gouvernement a donc déposé plusieurs amendements permettant d’éviter ces écueils, de simplifier les dispositifs et surtout de s’assurer de la compatibilité de la proposition de loi avec les exigences communautaires.
À l’instar des sociétés publiques locales d’aménagement, les futures SPL doivent bien entendu exercer leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires. Cela a été dit et est, semble-t-il, accepté par tous. Le Gouvernement a déposé un amendement de précision en ce sens.
Par ailleurs, ainsi que vous le savez, la jurisprudence communautaire exige que le contrôle opéré par l’autorité publique soit analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services. À défaut, le juge communautaire estime que le lien de type in house entre la personne publique et la société est rompu.
Je vous proposerai donc d’adopter un amendement qui vise à offrir la possibilité aux seules collectivités et à leurs groupements de créer des SPL mais à exclure la présence d’établissements publics parmi les actionnaires de la société. Je remercie M. le rapporteur de son ouverture sur cette question : cette attitude amènera sans doute le Gouvernement à faire preuve lui-même d’ouverture en ce qui concerne l’amendement n° 3, sur lequel nous divergeons. Pour que la coproduction soit parfaite, nous essaierons chacun de faire un pas vers l’autre, de manière que les souhaits de la commission et de l’auteur de la proposition de loi soient satisfaits.
Par ailleurs, je suis conduit à appeler l’attention de la Haute Assemblée sur une ouverture trop large du champ de compétences des SPL. La loi n’empêchera pas que des contentieux soient introduits par des sociétés privées aujourd’hui prestataires des collectivités territoriales après publicité et mise en concurrence. Il serait donc hasardeux de ne pas limiter le champ d’intervention des SPL, si ce n’est aux seules missions des services publics à caractère industriel et commercial et aux activités d’intérêt général.
L’absence de soumission aux règles de publicité et de concurrence, dans le cadre du in house, n’est jamais qu’une dérogation, et le juge administratif, s’il est saisi, devra se prononcer au cas par cas sur la qualité des actionnaires et le champ d’intervention de la société.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement partage votre ambition : aider nos collectivités territoriales à réaliser dans les meilleures conditions de rapidité, de simplicité et de transparence leurs projets, au bénéfice non seulement de leurs habitants, mais aussi de toute l’économie de notre pays. Le Gouvernement est donc soucieux de supprimer procédures et formalismes inutiles.
Toutefois, il nous appartient aussi de donner des repères et de nous assurer de la fiabilité du cadre juridique sur lequel seront fondés les projets locaux.
C’est ainsi que, j’en suis sûr, nous saurons concilier, au cours du débat qui va s’ouvrir, le dynamisme et l’innovation dont savent faire preuve les élus locaux, la confiance que nous avons dans nos collectivités territoriales, mais aussi la sécurité juridique que nous leur devons.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, grâce à la contribution brillante des orateurs précédents, chacun connaît désormais le contexte.
En premier lieu, la Commission européenne a remis en cause les conventions publiques d’aménagement, ce qui nous a conduits à adopter la loi du 20 juillet 2005 – dont j’ai d’ailleurs eu l’honneur d’être le rapporteur ici même – relative aux concessions d’aménagement organisant une procédure de mise en concurrence de ces contrats.
En second lieu, le fameux arrêt Stadt Halle du 11 janvier 2005, déjà cité, définit bien ce qu’est une entité in house.
Les sociétés d’économie mixte sont exclues du dispositif in house justement parce qu’elles ont des actionnaires privés ; d’où la nécessité d’apporter une réponse.
Une première réponse a été apportée avec la création, par la loi du 13 juillet 2006, des sociétés publiques locales d’aménagement, les SPLA.
Aujourd’hui, M. Daniel Raoul a l’excellente idée de nous proposer un nouvel outil, qui va s’ajouter aux SPLA, et nous tenons à l’en remercier.

Absolument !
Je lui ai demandé voilà un instant s’il n’aurait pas été possible de fusionner les deux outils. Il m’a répondu, à juste titre, qu’il était préférable, d’un point de vue pragmatique, de conserver les deux. En effet, les SPLA répondent à des besoins et plusieurs sont en cours de création. Le champ des SPLA va, par la présente proposition de loi, être élargi à tout ce qui concerne l’aménagement de manière exhaustive, y compris les acquisitions, de sorte qu’elles seront le « bras séculier », si je puis dire, des collectivités locales, un prolongement d’elles-mêmes, un outil qu’elles se sont donné à elles-mêmes dans le respect de leur identité.
On peut considérer que, avec ces dispositifs, nous offrons à nos collectivités des instruments diversifiés, souples et adaptés, conformément à leur attente.
Je veux maintenant dire en quelques mots notre profond attachement au principe de la concurrence.
Monsieur le secrétaire d’État, vous avez évoqué les partenariats public-privé. Vous le savez, en cette matière, nous avons toujours exercé une grande vigilance, non que nous soyons contre ces partenariats – nous pensons même qu’il est bon que cet outil existe –, mais parce que nous sommes très respectueux des décisions du Conseil constitutionnel. Et celles-ci s’appliquent à toutes les autorités publiques, aussi bien au Gouvernement, qu’au Parlement ou aux collectivités locales.
Le recours au partenariat public-privé doit avoir lieu dans des circonstances précises, exceptionnelles, liées à l’urgence ou la complexité d’un projet. Nous sommes donc opposés à sa généralisation, car, comme l’a d’ailleurs affirmé le Conseil constitutionnel, cela porterait atteinte à l’égal accès à la commande publique. On voit bien ce que ce principe emporte comme conséquences pour les PME, les artisans du bâtiment ou les entreprises de second œuvre de notre pays.

Si l’on veut qu’il y ait en France trois ou quatre grands groupes dominants et, à côté, de petites entreprises obligées de passer sous leurs fourches caudines, généralisons les PPP ! En revanche, si l’on veut respecter la concurrence, conservons la grande pluralité de nos procédures et les règles de passation des marchés publics, qui sont extrêmement précieuses.
Je tenais à apporter ces précisions pour montrer que, s’il est favorable à cette proposition de loi, notre groupe ne cherche pas pour autant à restreindre la concurrence. Celle-ci est nécessaire dans une société ouverte et démocratique, dans une société dynamique et innovante.
À cet égard, le rapport de M. Mézard est excellent et nous apprend beaucoup. La liste qu’il a établie permet de constater que la plupart des pays européens autorisent les collectivités locales à détenir en totalité des sociétés in house, ce qui leur permet d’agir sans concurrence. Dans ce contexte européen, refuser de se doter d’un outil de ce genre reviendrait à désavantager la France et nos entreprises.

Nous sommes donc favorables à la création de ces sociétés, à condition qu’elles exercent leur activité dans le strict prolongement de l’action des collectivités locales. Cela n’enlève donc rien au fait que nous restons attachés à une concurrence juste et équitable.

Enfin, je voudrais émettre un vœu.
Je souhaite ardemment que les deux outils offerts aux collectivités locales, en plus des SEM et des autres procédures existantes, apportent plus de souplesse et d’efficacité à ce qu’on appelle la politique de la ville, qui, pour nous, est indissociable de la politique du développement urbain.
On sait combien il est nécessaire de « refaire » des villes, de réhabiliter des quartiers, et on sait aussi à quel point c’est difficile. L’expérience nous montre que, si l’on veut mettre fin à la ville de la discrimination, à la ville marquée par les quartiers en difficulté, il faut rompre avec l’illusion selon laquelle on doit se contenter d’agir sur ces quartiers-là. C’est la ville dans son ensemble qu’il faut repenser, avec des opérations d’aménagement promouvant à la fois la mixité sociale et la mixité fonctionnelle.
Dans le même ordre d’idée, je voudrais évoquer un autre problème très délicat, celui des entrées de ville.
Toutes nos villes sont magnifiques. Or, si l’on cherchait jadis à magnifier les portes de la cité, pendant quatre ou cinq décennies, on a laissé faire n’importe quoi à l’orée des villes. Les routes nationales sont ainsi « agrémentées », dirai-je par dérision, de collections de pancartes et de parallélépipèdes, de blocs, de cubes mêlant tôles ondulées et plastiques aux couleurs criardes, et qui ont pour caractéristique d’être partout les mêmes, de Dunkerque à Perpignan, de Quimper à Strasbourg, en passant par Boulogne-Billancourt. Cette uniformité désolante, affligeante même, n’est bonne ni pour l’image de notre pays ni pour l’attachement que devraient éprouver ses habitants pour les paysages, tous les paysages qui les environnent.
Si nous voulons que cette situation change, nous devons y consacrer beaucoup de moyens et nous servir d’outils d’urbanisme adaptés à l’activité et au paysage. En fait, nous avons besoin que soient menées des opérations d’aménagement au sens plein et entier du terme.
J’émets donc le vœu que les SPL et les SPLA, enfin créées ou rénovées grâce à cette proposition de loi, nous permettent d’aller dans le sens d’un urbanisme plus conforme aux espoirs que nous plaçons en notre pays.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, historiquement, la réalisation d’infrastructures publiques dans le cadre d’un partenariat entre autorités publiques et personnes privées a eu cours dès l’Ancien régime. C’est ainsi, par exemple, que fut construit, au xviie siècle, le canal du Midi. Mais c’est au xxe siècle, notamment avec les lois de décentralisation, que la création de nouvelles formes de coopération entre les personnes publiques et les personnes privées connut un véritable essor.
Désormais, les partenariats public-privé recouvrent une gamme de solutions juridiques visant à faciliter cette coopération. Cependant, en raison de la raréfaction du crédit, mais également de la complexité juridique de ces montages, ceux-ci peinent à se développer.
Les sociétés d’économie mixte pourraient constituer un levier puissant de développement des PPP, puisque la loi fait obligation aux collectivités territoriales de s’associer en leur sein à des partenaires privés. Cependant, les conditions particulièrement restrictives qu’elle impose à cette coopération freinent leur lancement. Je reviendrai ultérieurement sur ce sujet en formulant une proposition pour lever ces freins.
Dans ce contexte, les collectivités locales, dont la libre administration et l’autonomie financière sont reconnues comme ayant valeur constitutionnelle, doivent disposer en contrepartie de tous les outils – je dis bien : « tous » les outils – adéquats à la réalisation de leurs missions pour leur permettre de faire face à leurs besoins toujours croissants.
C’est dans cet état d’esprit qu’un premier pas a été franchi en 2006 : le Parlement a prévu la création, à titre expérimental, des sociétés publiques locales d’aménagement, nouveau dispositif permettant de résoudre les difficultés liées à la jurisprudence communautaire quant aux limites du in house.
Une SPLA peut donc être constituée par les collectivités territoriales et leurs groupements, à titre expérimental, pour une durée de cinq ans, lesdites collectivités détenant la totalité du capital. Aujourd’hui, sept SPLA ont été créées et une quarantaine de projets sont étudiés ou en cours de constitution. Cependant, il semble que nos statistiques sur ce point ne soient pas toutes identiques, mes chers collègues. Mais on sait qu’il existe deux types de mensonges : les mensonges et les statistiques.
Sourires

Ces sociétés ne sont compétentes que pour réaliser des opérations d’aménagement. Il est évident que la gestion d’un service public sous la forme d’une société anonyme détenue par les collectivités territoriales offrirait à celles-ci des avantages indéniables en termes d’efficacité, de réactivité et de sécurité, avantages dont les solutions juridiques disponibles, établissement public ou association du type loi de 1901, sont dépourvues.
Or il est des domaines d’activités autres que l’aménagement où l’existence de sociétés à 100 % publiques présenterait le même intérêt que les SPLA. En effet, nombre de sociétés d’économie mixte ne travaillent que pour leurs collectivités actionnaires, pour le compte desquelles elles exploitent un service ou un équipement public. Il convient donc d’étendre ce dispositif à d’autres domaines d’activités que l’aménagement afin que les élus locaux puissent avoir à leur disposition, dans tous les domaines de compétence visés par la loi, l’outil leur permettant d’appliquer pleinement le droit communautaire ainsi que le principe de libre administration des collectivités territoriales.
Tel est l’objet de la proposition de loi dont nous discutons aujourd’hui, ainsi que de celle que j’avais déposée avec un certain nombre de mes collègues en décembre dernier, comme l’a rappelé M. le rapporteur. Voter ce texte constituera donc un second pas dans la diversification des moyens à la disposition des collectivités.
Dotées de compétences élargies et renforcées, les sociétés publiques locales ne viendront cependant pas se substituer aux sociétés d’économie mixte, dont le statut conservera toute son attractivité dès lors que des collectivités territoriales veulent s’associer à des partenaires privés pour entreprendre en commun des projets d’intérêt général.
Il convient de souligner que les sociétés publiques locales seront assujetties aux règles du code général des collectivités territoriales propres aux SEM, qu’il s’agisse des contrôles auxquelles celles-ci sont soumises – et ils sont nombreux : chambre régionale des comptes, commissariat aux comptes… – ou des dispositions visant à assurer la sécurité juridique des élus administrateurs de SEM, notamment au regard de leur responsabilité civile.
Je ne peux donc que vous inciter, mes chers collègues, à adopter cette proposition de loi, en espérant que l’Assemblée nationale fera de même dans les meilleurs délais.
Outre cette proposition de loi, que je considère comme une avancée certaine, je voudrais dès aujourd’hui soumettre à votre réflexion la possibilité de créer à terme des SEM à capitaux publics minoritaires.
En 1926, les décrets-lois Poincaré ont autorisé les collectivités territoriales à constituer des SEM, tout en limitant leur participation à 40 % dans le but de préserver l’épargne publique. Ce texte fondateur a donné naissance à des partenariats public-privé fructueux et durables en favorisant une implication réelle du partenaire privé dans le management des SEM.
Dans le sillage des premières lois de décentralisation, la loi du 7 juillet 1983, tout en alignant les SEM sur le droit des sociétés commerciales, a établi la prééminence des collectivités territoriales dans leur gestion en les obligeant à être majoritaires au capital des SEM nouvellement créées, la participation des autres actionnaires étant au minimum de 20 %. Mais cette répartition du capital ne répond à aucune justification économique.
Aujourd’hui, le contexte a profondément évolué. L’intégration européenne a mis en lumière, cher collègue Jean-Pierre Sueur, le fait que, dans la quasi-totalité des pays de l’Union européenne, la composition du capital des SEM n’est soumise à d’autres contraintes que celles du droit des sociétés. Dans toute l’Europe, le co-investissement public-privé apparaît comme un levier pour répondre à un large éventail de besoins collectifs.
La crise économique presse les acteurs publics et privés de rechercher des voies nouvelles et sûres, permettant de créer des partenariats de long terme au service de l’intérêt général.
Dès lors, il semble opportun de réfléchir à un assouplissement des règles de répartition du capital entre actionnaires publics et privés dans les SEM.
Une telle réforme devrait être mise en œuvre dans l’optique d’un retour aux sources de l’économie mixte et, par conséquent, à l’esprit de la loi de 1983, dont l’exposé des motifs, rappelons-le, posait un principe essentiel : « S’agissant de sociétés auxquelles les collectivités confient des tâches de leur compétence dans le respect de l’intérêt général, il est normal qu’elles soient à même d’exercer un contrôle de la gestion et qu’elles veillent au respect de l’objet initial. » Ce principe doit être sauvegardé.
Dans cet esprit, la proposition de loi que je compte déposer visera à maintenir la prééminence des collectivités territoriales, garantes de l’intérêt général, en leur assurant dans tous les cas, par la minorité de blocage, le contrôle effectif des décisions relevant de l’assemblée générale extraordinaire, en particulier toute modification de l’objet social.
Les SEM à capitaux publics minoritaires resteront naturellement soumises aux obligations de communication spécialement imposées aux SEM, de même qu’au double contrôle du préfet et de la chambre régionale des comptes.
Cette liberté d’action offerte, et non imposée – ce sont les acteurs territoriaux qui décideront –, aux collectivités territoriales permettra une accélération rapide et durable des programmes d’investissement locaux.
Un tel assouplissement, assorti de garanties de contrôle public, dotera les collectivités territoriales de moyens d’action renforcés pour développer les territoires.
D’abord, cela stimulera les co-investissements dans des domaines où des besoins collectifs ont émergé ces dernières années, comme les énergies renouvelables, la valorisation des déchets ou les infrastructures numériques.
Ensuite, cela facilitera les opérations d’aménagement et de renouvellement urbain, de réalisation d’équipements en mandat ou à l’aide de montages complexes – baux emphytéotiques administratifs, ou BEA, et contrats de partenariat – ou de construction d’immobilier d’entreprise.
Enfin, cela encouragera la participation des SEM immobilières à la relance de la production de logements sociaux et intermédiaires.
Je conclurai en rappelant un chiffre. En 2008, dans leur ensemble, les collectivités territoriales ont réalisé près de 73 % de l’investissement public. Aussi, dans le contexte de la crise économique, donner aux élus locaux les moyens d’accélérer leurs programmes d’investissement revêt une importance décisive. Toute mesure en ce sens est donc, me semble-t-il, à encourager.
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste, de l ’ UMP et du RDSE, ainsi que sur plusieurs travées du groupe socialiste.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui n’est pas la première tentative pour mettre nos pratiques d’aménagement en conformité avec la jurisprudence européenne.
Par le passé, nos collègues communistes et socialistes de l’Assemblée nationale ont déjà tenté de rétablir le droit pour les collectivités locales de bénéficier du régime « in house », qui prévalait autrefois dans les projets d’aménagement.
En effet, depuis le début des années 2000, la Commission européenne a remis en cause les contrats de mandat passés entre les personnes publiques et les sociétés d’économie mixte, en critiquant la loi du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée et en déclarant contraire aux directives communautaires certaines de ses dispositions. Selon la Commission, ces contrats de mandat devaient respecter une procédure préalable de publicité et de mise en concurrence, étant assimilés à des prestations de service de droit commun.
Toujours prompte à appliquer les sacro-saintes règles de la concurrence partout où elle le peut, la Commission européenne a, de fait, limité considérablement le champ des possibles pour les collectivités locales, désormais obligées de passer par les règles du marché et de l’appel d’offres, quand bien même elles disposeraient d’une SEM au sein de laquelle elles seraient supra-majoritaires et qui ne travaillerait que pour les collectivités actionnaires.
C’est donc pour se mettre en conformité avec la jurisprudence européenne qu’ont été créées les sociétés locales publiques d’aménagement, les SPLA, par loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement. Force est de le constater, trois ans plus tard, le résultat est plus que mitigé. Du fait de la complexité de leurs règles de création et de leur champ d’action très limité, ces SPLA n’ont pas su occuper la place laissée vacante par les SEM.
Désormais, les élus locaux souhaitent donc de nouveaux outils pour développer leurs territoires. En effet, il est des domaines d’activités autres que l’aménagement où l’existence de sociétés 100 % publiques présenterait le même intérêt que les SPLA. Nombre de sociétés d’économie mixte ne travaillent que pour leurs collectivités actionnaires, pour le compte desquelles elles exploitent un service ou un équipement publics. Il en va ainsi dans les domaines de la construction et de la gestion de logements, de l’eau et de l’assainissement, du stationnement ou des transports. Il convient de noter que le règlement du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route définit la notion d’« opérateur interne » de la manière suivante : « une entité juridiquement distincte sur laquelle l’autorité locale compétente ou, dans le cas d’un groupement d’autorités, au moins une autorité locale compétente, exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services ».
De nombreuses SEM agissant dans ces secteurs correspondent bien à une telle définition.
Il convient donc d’étendre le dispositif à d’autres domaines d’activités que l’aménagement, afin que les élus locaux puissent avoir à leur disposition, dans tous les domaines de compétence visés par la loi, l’outil leur permettant d’appliquer pleinement le droit communautaire et le principe de libre administration des collectivités territoriales.
À cela, il faut ajouter que la gestion d’un service public sous la forme d’une société anonyme détenue par les collectivités territoriales offrirait à celles-ci des avantages indéniables en termes d’efficacité, de réactivité et de sécurité, avantages dont les solutions juridiques disponibles, comme la création d’un établissement public ou d’une association loi 1901, sont dépourvues.
Enfin, le texte proposé tire les enseignements pratiques de l’expérimentation des sociétés publiques locales dans le domaine de l’aménagement, en permettant aux collectivités territoriales de déroger au code de commerce qui impose, s’agissant des sociétés anonymes, un minimum de sept actionnaires. Cette obligation peut se heurter à des difficultés réelles lorsque la société a pour objet la réalisation d’un projet ou la gestion d’un équipement intéressant un nombre inférieur de partenaires publics.
Cependant, même si elles sont dotées de compétences élargies et renforcées, les sociétés publiques locales ne viendront pas se substituer aux sociétés d’économie mixte, dont le statut conservera toute son attractivité dès lors que des collectivités territoriales voudront s’associer à des partenaires privés pour entreprendre en commun des projets d’intérêt général.
En somme, cette proposition de loi a pour objet d’adapter les SEM à la législation européenne pour qu’elles puissent continuer leur activité comme elles le faisaient auparavant. Cela permettra d’offrir à nouveau aux collectivités locales la possibilité de mener à bien leurs politiques d’aménagement.
Dès lors, nous ne pouvons qu’accorder notre crédit à cette proposition de loi. Nous avons donc décidé de voter en sa faveur.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la proposition de loi, déposée par notre collègue Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, qui nous est aujourd’hui soumise a pour principal objet d’introduire un nouvel outil juridique au service des collectivités locales.
Ce texte ouvre la possibilité pour les collectivités locales et leurs groupements de créer des sociétés publiques locales, sur le modèle de ce qui existe dans pratiquement tous les États membres de l’Union européenne.
Il s’agit de permettre aux entités décentralisées, pour l’exercice de leurs compétences, de confier à un tiers la réalisation d’opérations qualifiées de « prestations intégrées », non soumises aux procédures de passation des marchés publics.
Mes chers collègues, nous devons donc être particulièrement vigilants et veiller à ce que le dispositif mis en place par cette proposition de loi respecte bien la jurisprudence communautaire en la matière, afin d’éviter tout risque de contentieux.
Quel est le contexte communautaire ?
Les autres États membres de l’Union européenne se sont déjà dotés de la faculté de créer des sociétés détenues à 100 % par des autorités publiques.
Il existe aujourd’hui près de 16 000 entreprises publiques locales, présentes dans les vingt-cinq pays de l’Union européenne et employant 1 125 000 salariés.
À l’image des sociétés d’économie mixte, les SEM, de telles entreprises mettent en œuvre les politiques d’intérêt général des collectivités territoriales, notamment dans les domaines du développement urbain, des transports, de l’énergie, de l’environnement et de la culture.
Dans la plupart des cas, la loi ne définit pas de niveau de participation des collectivités dans le capital des entreprises publiques locales, les laissant ainsi totalement maîtresses de leurs choix.
Il en va ainsi notamment en Allemagne, en Autriche, en Espagne, aux Pays-Bas, en Pologne ou encore en République Tchèque.
Par ailleurs, à l’exception de la France, de l’Italie et du Royaume-Uni, tous les États admettent la détention de 100 % du capital d’une entreprise publique locale par une ou plusieurs collectivités publiques ou par des collectivités publiques avec d’autres entités publiques.
Aujourd’hui, 80 % des entreprises publiques locales européennes sont entièrement détenues par des actionnaires publics.
Examinons à présent la jurisprudence communautaire.
En principe, les SEM, comme toutes les entreprises publiques locales, sont soumises au droit communautaire de la concurrence.
Toutefois, la jurisprudence communautaire dispense, sous certaines conditions, une collectivité de l’application des règles édictées en matière de marchés publics, selon le principe du « in house » ou des « prestations intégrées ».
Conformément à l’arrêt Teckal du 18 novembre 1999, la Cour de justice des Communautés européennes exige la réunion de deux conditions pour écarter l’application des règles de la concurrence.
Première condition, la collectivité doit exercer sur l’entité un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services.
Seconde condition, l’entité doit réaliser l’essentiel de son activité pour la ou les personnes qui la détiennent.
Ainsi, le droit communautaire reconnaît l’existence d’un mode d’organisation du service public local et, par conséquent, le droit des collectivités locales d’attribuer directement des missions à des outils dont l’activité leur est exclusivement dédiée.
En l’état actuel de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, il apparaît que le concept de « in house » ou de « prestations intégrées » n’est pas applicable aux relations unissant les sociétés d’économie mixte locales à leurs collectivités actionnaires.
Dès lors, si les collectivités souhaitent recourir à leurs sociétés d’économie mixte locales, les SEML, pour assurer telle ou telle prestation, elles sont tenues de les mettre en concurrence, et ce alors même qu’elles les ont créées pour répondre à leurs propres besoins.
Vous le comprendrez, cette situation est quelque peu paradoxale. Voilà pourquoi elle reste aujourd’hui mal comprise par de nombreux élus.
Afin de remédier à cette difficulté, la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a créé les sociétés publiques locales d’aménagement, dont le capital est détenu à 100 % par des collectivités et leurs groupements.
Je vous rappelle que cette création a été décidée à titre expérimental, pour une durée de cinq ans.
Le caractère entièrement public de ces sociétés, sans la présence d’aucun actionnaire privé, permet ainsi de qualifier les relations entre lesdites sociétés et leurs collectivités actionnaires de « in house ».
La proposition de loi de M. Daniel Raoul vise donc à pérenniser le dispositif des SPLA et à créer des sociétés publiques locales aux compétences élargies.
Quelle est position du groupe UMP ?
Compte tenu de l’absence d’évolution de la jurisprudence communautaire dans le sens d’un élargissement de la notion de « prestations intégrées » et du maintien, par conséquent, de l’obligation pour les collectivités de mettre en concurrence leurs SEML lorsqu’elles entendent y faire appel, le groupe UMP estime cette proposition de loi particulièrement intéressante.
Ce texte présente le mérite incontestable d’offrir aux collectivités territoriales un élément de souplesse susceptible de leur permettre d’exercer leurs compétences avec une plus grande efficacité et rapidité.
Certes, de prime abord, nous aurions pu craindre que cette proposition de loi ne soit comprise comme une volonté d’échapper aux règles de publicité et de mise en concurrence pour les projets d’aménagement, alors que les possibilités d’intervention des collectivités territoriales dans ce domaine sont aujourd’hui très encadrées.
Nous estimons, en effet, que la création de sociétés publiques locales ne doit pas affranchir les collectivités de la totalité des procédures d’appel d’offres.
Le texte que nous propose la commission des lois semble répondre à la crainte qui était la nôtre, dans la mesure où les sociétés publiques locales sont dotées d’un statut juridique très sécurisé et renforcé.
La commission des lois, sur l’initiative de son rapporteur, M. Jacques Mézard, a adopté un dispositif qui vise à encadrer la création et le fonctionnement de nouvelles structures. À cette fin, les procédures de contrôle seront indispensables pour permettre à ces structures de fonctionner en toute transparence et dans un cadre strict. Nous nous en félicitons.
Nous nous réjouissons également du fait que la commission des lois ait précisé que ces sociétés doivent impérativement exercer leurs activités sur le territoire des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales actionnaires.
Mes chers collègues, cette disposition est importante, car elle répond à l’esprit de la jurisprudence communautaire selon laquelle l’activité des sociétés publiques locales doit être réalisée principalement avec la ou les collectivités actionnaires.
Les membres du groupe UMP approuvent aussi la présence obligatoire d’au moins deux actionnaires dans la composition du capital. Il s’agit d’une garantie supplémentaire posée dans l’intérêt même des collectivités, tant il est vrai que l’actionnariat unique prévu par la proposition de loi pouvait présenter un risque de dérive.
Nous souhaitons toutefois insister sur le fait que la société publique locale doit constituer un outil complémentaire de la société d’économie mixte locale, sans cependant venir concurrencer sérieusement cette dernière au point de s’y substituer.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, pour l’ensemble de ces raisons et sous réserve de ces observations, le groupe UMP votera le texte proposé par la commission des lois.
M. le rapporteur applaudit.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la proposition de loi pour le développement des sociétés publiques locales, déposée par le groupe socialiste et que nous examinons aujourd’hui, est particulièrement bienvenue pour tous ceux qui, sur le terrain, travaillent en faveur du développement de l’économie locale.
Dans cet hémicycle, nombreux sont ceux qui voient dans la proposition de loi un outil nouveau, dans la panoplie des instruments économiques existants, susceptible de répondre aux attentes des collectivités locales et d’améliorer leurs conditions et leur capacité d’intervention.
Du reste, la commission ne s’y est pas trompée, qui, par la voix toujours éloquente de notre collègue Jacques Mézard, a adopté ce texte consensuel.

L’objet de ce texte, au demeurant très court – il ne comporte que trois articles –, est d’ouvrir aux collectivités locales et à leurs groupements la possibilité de constituer des sociétés publiques locales susceptibles d’intervenir dans tous les domaines de leur champ de compétence, sans qu’il leur soit fait obligation de recourir aux procédures des marchés publics.
Si le texte de la proposition de loi, qui s’appuie au demeurant sur un dispositif déjà existant – les sociétés publiques locales d’aménagement –, est, en droit, incontestable, en opportunité, il vient – pardonnez l’expression – « chatouiller » les opérateurs privés, qui y voient une mauvaise manière qui leur serait faite en dérogeant, selon eux, au principe de l’appel à concurrence, une concurrence à laquelle les collectivités tiennent, une concurrence juste et équitable, comme l’a rappelé tout à l’heure notre excellent collègue Jean-Pierre Sueur.
Il est essentiel, sur ce point, de bien mesurer le fonctionnement de nos collectivités locales et de leurs groupements. Leur taille – grande, moyenne ou petite –, leur implication dans la vie communale ou intercommunale, la modestie de leur budget aujourd’hui, sont autant de raisons pour les collectivités locales et leurs groupements de vouloir disposer, dans des conditions de facilité – respectueuse du droit en tous points – d’un outil proche et efficace pour réaliser les opérations d’aménagement qui font partie de leur quotidien.
Le service public local d’aménagement, qui n’existe que depuis un peu plus de deux ans et demi, a donné la preuve de son intérêt. D’expérimental, il devient définitif. Amélioré dans le présent texte, il sert de modèle au nouveau service public local, dont le champ d’intervention est élargi.
Pour répondre aux préoccupations des opérateurs privés, le texte, judicieusement amendé par la commission des lois, s’est voulu sécurisé grâce aux dispositions suivantes : actionnariat exclusivement accordé à des personnes publiques, collectivités territoriales et leurs groupements ; limites géographiques fixées au territoire des collectivités actionnaires ; présence obligatoire de deux actionnaires au moins pour éviter tout effet potentiel de dérive si la règle avait été celle d’un seul actionnaire ; application du régime des sociétés d’économie mixte permettant d’assurer pleinement l’information et, surtout, le contrôle des collectivités concernées.
En outre, sur proposition du Gouvernement, le gage financier qui pesait sur les collectivités est levé, et on ne peut que s’en féliciter.
Au total, cette proposition de loi joue un rôle de facilitation pleinement opportune dans un contexte juridique et réglementaire singulièrement complexe, en particulier pour les petites collectivités.
Dès lors, on ne peut que s’étonner – sauf meilleure information – de l’amendement déposé par le Gouvernement et qui tendrait à limiter sensiblement la portée de ce nouveau dispositif, en ne retenant pas pour les sociétés publiques locales la possibilité d’exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou toute autre activité d’intérêt public. Ce serait – pardonnez cette image – comme vouloir fabriquer un marteau sans manche, le rendant de fait inopérant.
Le groupe RDSE ne peut qu’affirmer son intérêt pour le nouveau dispositif tel qu’il est proposé, sous réserve, bien entendu, que ce dernier ne soit pas vidé de son essence même.
Il remercie le rapporteur des enrichissements apportés au texte initial et votera la présente proposition de loi dans le seul souci de répondre aux besoins bien légitimes des collectivités locales, en particulier dans les circonstances économiques sensibles que nous connaissons actuellement.
Applaudissements sur les travées du RDSE et sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Après l'article L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une division additionnelle ainsi rédigée :
« Titre III
« Sociétés publiques locales
« Art. L. 1525-4. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.
« Ces sociétés peuvent également être créées avec des établissements publics. Dans ce cas, les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent la majorité du capital et des droits de vote.
« Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général.
« Ces sociétés exercent leurs activités pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres.
« Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et sont composées, par dérogation à l'article L. 225-1 du même code, d'au moins deux actionnaires.
« Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du livre V de la première partie du présent code. »

L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1525-4 du code général des collectivités territoriales.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Nous avons déjà évoqué, à l’instant, cet amendement, qui est un amendement de sécurisation juridique.
Je rappelle que les sociétés publiques locales d’aménagement ont été créées par la loi du 13 juillet 2006.
Comme je l’ai indiqué tout à l'heure, le Gouvernement est favorable à la présente proposition de loi, sous réserve de l’adoption de cet amendement qui vise à prendre en compte les éléments contenus dans la jurisprudence européenne et à faire en sorte que l’organisation et le tour de table des futures SPL soient sécurisés.
Cet amendement tend non pas à remettre en cause le fond de votre texte, monsieur le sénateur, mais à apporter des garanties pour l’avenir, en permettant d’éviter deux inconvénients majeurs, notamment celui de la qualification d’« opérateur intégré » dès lors que l’établissement ne poursuivrait que des intérêts industriels ou commerciaux. C’est l’un des éléments importants sur lequel il faut mettre cette barrière.
C’est pourquoi le Gouvernement tient à ce que nous puissions apporter cette garantie de sécurité juridique par le biais de cet amendement.

Après en avoir discuté avec l’auteur de la proposition de loi et ma collègue vice-présidente de la commission des lois, nous pourrions adopter cet amendement.
La notion d’établissement public est assez floue dans notre droit interne. J’ai d’ailleurs sous les yeux un article de doctrine indiquant que, même du point de vue de sa nature juridique, l’établissement public est un pavillon qui abrite des marchandises très diverses !
Sourires.

Certes, nous aurions pu aller plus avant dans l’analyse juridique et adopter une approche plus précise de cette notion, afin d’essayer d’intégrer les établissements publics administratifs. Nous aurions ainsi peut-être pu faire en sorte que les offices publics d’aménagement et les sociétés publiques d’HLM puissent être intégrés dans le tour de table.
Peut-être l’Assemblée nationale, si elle est saisie prochainement de ce texte, trouvera-t-elle un moyen de faire droit à cette demande, ce qui serait utile pour les collectivités locales.
Sous cette réserve, la commission est favorable à cet amendement, qui permet d’instaurer un équilibre et de parvenir à un consensus général.

J’ai été sensible au problème de l’insécurité juridique soulevé par le Gouvernement.
Monsieur le secrétaire d'État, permettez-moi une simple remarque de forme. Depuis la réforme constitutionnelle, le Gouvernement peut participer aux travaux en commission lors de l’examen des projets de loi. Si vous nous aviez soumis alors cet amendement, nous aurions eu la possibilité d’affiner, voire de peaufiner, l’analyse juridique qu’aurait pu faire notre rapporteur.
En tout état de cause, lors de l’élaboration du texte, nous visions évidemment les offices publics d’aménagement et les offices d’HLM qui se trouvent dans nos collectivités, mais en aucune façon les établissements publics à caractère industriel ou commercial. Je reconnais que la mention « établissement public » est ambiguë.
Je me rallie donc à cet amendement qui apporte une sécurité juridique.
L'amendement est adopté à l’unanimité.

L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1525-4 du code général des collectivités territoriales :
« Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, ainsi que des opérations de construction, de maintenance et d'exploitation des équipements construits.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Compte tenu de l’adoption par le Sénat de l’amendement n° 5 et conformément au souhait de l’auteur de la proposition de loi et de la commission, je retire le présent amendement.
MM. Daniel Raoul et Robert del Picchia applaudissent.

L’amendement n° 3 est retiré.
L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Au quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1525-4 du code général des collectivités territoriales,
après le mot :
activités
insérer le mot :
exclusivement
La parole est à M. le secrétaire d'État.
C’est un amendement de mise en cohérence. Il s’agit, en ajoutant l’adverbe « notamment », de préciser les activités exercées par les sociétés publiques locales, point qui a été évoqué par l’auteur de la proposition de loi.

La commission ne voit aucun inconvénient à l’adoption de cet amendement qui permet d’avoir une double sécurité. Elle émet donc un avis favorable.

M. Daniel Raoul. J’apprécie la modeste contribution de M. le secrétaire d’État à la rédaction de cette proposition de loi.
Sourires.
L'amendement est adopté.
L'article 1 er est adopté.

L'amendement n° 2, présenté par MM. Raoul, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme, les mots : « à titre expérimental, pour une durée de cinq ans, » sont supprimés.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Cet amendement s’inscrit dans la logique même de la présente proposition de loi, qui a pour objet de pérenniser les SPLA et d’accroître leurs prérogatives.
Jusqu’à récemment, les SPLA ne pouvaient pas compter moins de sept actionnaires, conformément à l’article L. 225-1 du code de commerce auquel renvoyait leur statut. Sept actionnaires, c’était beaucoup pour une société qui peut ne réunir que deux, voire trois acteurs locaux. C’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles l’opération n’a pas rencontré le succès escompté.
Les SPLA sont au nombre d’une dizaine aujourd’hui, mais, comme cela a été dit, d’autres sont en cours de création.
Depuis qu’un amendement proposé par le groupe socialiste lors de l’examen du texte qui est devenu la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion a modifié l’article du code de l’urbanisme, il est possible de créer une SPLA composée de deux actionnaires.
Plusieurs projets de SPLA devraient sortir de terre dans les prochains mois, accompagnant ainsi le lancement d’une série de projets de rénovation urbaine.
Dans ces conditions, il nous paraît être dans la logique du texte de supprimer le caractère expérimental des SPLA ainsi que la durée de cinq ans prévue lors de leur création.
Nous souhaitons clairement créer deux outils pérennes : les SPL et les SPLA.

La commission est favorable à cet amendement.
Il convient simplement de noter que le dispositif concernant les sociétés publiques locales, par lui-même, entraîne la pérennisation du dispositif des SPLA.

Par cohérence avec ce qui a été dit lors de l’examen des amendements précédents, il me semble logique de supprimer le caractère expérimental des SPLA.
L'amendement est adopté.

Je constate que cet amendement à été adopté à l’unanimité des présents.
Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l'article 2.
Les deux derniers alinéas de l'article L. 327- 1 du code de l'urbanisme sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ces sociétés sont compétentes pour réaliser, pour le compte exclusif d'un ou de plusieurs de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres toute action ou opération d'aménagement au sens du présent code.
« Elles sont également compétentes pour réaliser des études préalables, procéder à toute acquisition foncière ou immobilière en application des articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 300-1 du présent code ; procéder à toute opération de construction, de réhabilitation immobilière, en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 300-1 du présent code ou encore procéder à toute acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce, de fonds artisanaux, au sens de l'article 58 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Elles peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorité définis par le présent code, et agir par voie d'expropriation.
« Les sociétés publiques locales d'aménagement revêtent la forme de société anonyme ou de société par actions simplifiées régies par le livre II du code de commerce. Toutefois, par exception à la deuxième phrase de l'article L. 225-1 du même code, elles peuvent être composées d'un ou plusieurs actionnaires.
« Elles sont soumises aux dispositions du chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. »

L'amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Raoul, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Remplacer les deux premiers alinéas de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme est inséré un alinéa ainsi rédigé :
II. - Après les mots :
de fonds artisanaux,
rédiger comme suit la fin de la première phrase du troisième alinéa de cet article :
au sens du chapitre IV du livre II du présent code
III. - Compléter la seconde phrase du troisième alinéa de cet article par les mots :
dans le cadre des conventions conclues avec un de ses membres
IV. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article, supprimer les mots :
ou de sociétés par actions simplifiées
V. - À la fin de la seconde phrase du même alinéa, remplacer les mots :
d'un ou plusieurs actionnaires
par les mots :
de deux actionnaires ou plus
La parole est à M. Daniel Raoul.

Cet amendement, je l’ai dit dans la discussion générale, vise à introduire plusieurs précisions ayant pour objet d’améliorer le régime des SPLA.
D’abord, nous souhaitons préciser que les SPLA ne peuvent procéder par voie d’expropriation que dans le cadre des conventions qui les lient à leurs membres.
L’adverbe « exclusivement », qui a été évoqué tout à l’heure par le Gouvernement, s’applique également aux SPLA et explicite le périmètre d’activités visé dans la proposition de loi. Ce point nous paraissait évident, mais ça ira certainement mieux en le disant ou en l’écrivant !
Ensuite, nous souhaitons supprimer la possibilité de créer les SPLA sous forme de sociétés par actions simplifiées. Je me rends très volontiers aux arguments qui ont été développés par M. Mézard dans son rapport. Ce statut juridique était peut-être plus risqué pour la collectivité et, surtout, pour les élus.
Enfin, nous souhaitons préciser que les SPLA doivent comprendre deux actionnaires ou plus. Sur ce point également, je me suis rendu à l’argument selon lequel un seul actionnaire pourrait donner lieu à des dérives. La présence de deux actionnaires publics locaux accroîtra peut-être la transparence et permettra en tout cas un meilleur suivi des comptes et des appels d’offres ou des attributions à des délégataires.
Bien évidemment, cet amendement actualise la proposition initiale, qui avait été déposée en décembre dernier, en tenant compte de la loi du 25 mars 2009, c'est-à-dire en supprimant les deux alinéas qui sont satisfaits par cette loi.

La commission est favorable à cet amendement puisqu’il correspond à la concertation que nous avions eue avec l’auteur de la proposition de loi.
Cet amendement est relatif à l’expropriation et à l’impossibilité de recourir à la création de sociétés par actions simplifiées – ce qui nous paraissait beaucoup trop laxiste et était susceptible d’engendrer des dérives.
La disposition selon laquelle les SPLA doivent comprendre deux actionnaires ou plus répond également à un souci de sécurisation du système.
Je suggère simplement, dans un souci de cohérence avec la rédaction retenue à l’article 1er, de remplacer les mots « de deux actionnaires ou plus » par les mots « d’au moins deux actionnaires ».

Monsieur Raoul, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens souhaité par M. le rapporteur ?

M. Daniel Raoul. Oui, madame la présidente. Nous pourrions aussi écrire « de deux actionnaires au moins »
Sourires

Je suis donc saisie d’un amendement n° 1 rectifié bis, présenté par MM. Raoul, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :
I. - Remplacer les deux premiers alinéas de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme est inséré un alinéa ainsi rédigé :
II. - Après les mots :
de fonds artisanaux,
rédiger comme suit la fin de la première phrase du troisième alinéa de cet article :
au sens du chapitre IV du livre II du présent code
III. - Compléter la seconde phrase du troisième alinéa de cet article par les mots :
dans le cadre des conventions conclues avec un de ses membres
IV. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article, supprimer les mots :
ou de sociétés par actions simplifiées
V. - À la fin de la seconde phrase du même alinéa, remplacer les mots :
d'un ou plusieurs actionnaires
par les mots :
d'au moins deux actionnaires
Quel est l’avis du Gouvernement ?
L'amendement est adopté.
L'article 2 est adopté.
I. - Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.
II. - Les conséquences financières résultant pour l'État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
J’ai senti que la levée du gage ferait plaisir à l’ensemble de la Haute Assemblée. Cet amendement a donc pour objet d’apporter cette touche de bonheur en cette fin de discussion.

La commission est véritablement enthousiasmée par cet amendement et espère qu’il fera jurisprudence. À l’avenir, cet amendement sera certainement rappelé au Gouvernement à de multiples reprises.

Je salue cet amendement. J’espère qu’il fera jurisprudence, y compris dans notre assemblée. Mes chers collègues, lors de nos débats sur le texte tendant à modifier le règlement du Sénat, notre interprétation de l’article 40 de la Constitution a été différente de celle qu’en a faite l’Assemblée nationale. Je souhaite que l’amendement du Gouvernement fasse jurisprudence pour les deux assemblées. Quoi qu’il en soit, nous saurons le rappeler à bon escient !
L'amendement est adopté.

En conséquence, l'article 3 est supprimé.
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
La proposition de loi est adoptée.

M. Daniel Raoul. Je souhaite remercier mes collègues ainsi que le Gouvernement de la confiance qu’ils m’ont accordée pour cette proposition de loi qui a été adoptée à l’unanimité.
Applaudissements.

Mes chers collègues, l'ordre du jour de cet après-midi étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à seize heures cinquante-cinq, est reprise à vingt-et-une heures.