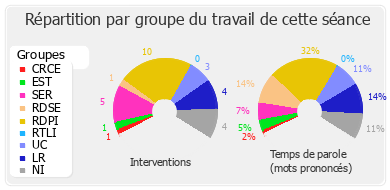Séance en hémicycle du 11 octobre 2011 à 15h00
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à onze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Jean-Pierre Bel.

La séance est reprise.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, le 25 septembre dernier, les grands électeurs nous ont adressé un message fort. Ce message, nous l’avons entendu. Un intérêt nouveau pour le Sénat est né dans le pays. À nous, en conséquence, de ne pas décevoir cette attente, de ne pas trahir cet espoir.
Nous devons faire vivre le changement au Sénat. Nous voulons un Sénat ancré dans son temps et tourné vers l’avenir. Un Sénat qui privilégie le débat sur l’affrontement, le dialogue sur le passage en force. Un Sénat qui n’est pas fermé sur lui-même mais ouvert sur la société et ses nouvelles aspirations. Un Sénat respecté dans son rôle de législateur et de contrôleur de l’action de l’exécutif.
La majorité assumera sa mission, et l’opposition sera respectée.
Je veux souligner, à ce propos, le caractère positif des contacts noués avec les présidents des groupes pour mettre en place la bonne gouvernance de notre assemblée.
Le dialogue entre le Gouvernement et le Parlement, mais aussi entre les deux assemblées, est un facteur décisif dans la recherche d’un bicamérisme assumé et équilibré. C’est un élément clé dans un contexte rendu difficile par la crise.
À cet égard, j’ai rencontré la semaine dernière le président de l’Assemblée nationale, Bernard Accoyer, pour un premier entretien constructif. Nous avons décidé de nous voir régulièrement, dans le même état d’esprit, pour permettre la bonne marche des assemblées parlementaires.
Mes chers collègues, je veux que notre assemblée soit confortée dans ses prérogatives, restaurée dans son rôle de représentant des élus locaux et des territoires, rénovée dans son mode de fonctionnement.
Je veux tout d’abord que le Sénat soit conforté dans ses prérogatives tant législatives que de contrôle. Le Sénat devra être particulièrement attentif à la qualité et à la nécessité de la loi. La loi nécessaire, ce n’est pas la loi « fait divers ».
Le Gouvernement ne dispose plus que de la moitié du temps parlementaire. Il doit en tirer toutes les conséquences et éviter de surcharger notre ordre du jour de projets de loi émotionnels ou de circonstance. Nos collectivités sont submergées de normes coûteuses, souvent inutiles, voire inapplicables. Il faut mettre un frein à cette évolution.
C’est pourquoi je propose que le Sénat débatte de propositions de lois de simplification, élaborées en concertation avec les associations d’élus locaux, pour alléger et stabiliser les normes qui pèsent sur les collectivités territoriales.

Ainsi la sécurité juridique sera-t-elle renforcée.
L’équilibre des institutions appelle en outre un usage parcimonieux de la procédure accélérée et du dernier mot à l’Assemblée nationale, que M. le ministre des relations avec le Parlement sera parfois tenté, sous l’amicale pression des députés de la majorité, de demander. Faire vivre la navette parlementaire et ne pas décider a priori d’entraver le dialogue bicaméral, c’est assumer le débat démocratique.
Dans le souci de mieux organiser notre travail et d’en améliorer la qualité, je demande au Gouvernement – et c’est une question de principe – de nous communiquer un calendrier prévisionnel semestriel.
Cet effort de programmation interne, il faudra bien évidemment nous l’appliquer à nous-mêmes. Je m’adresse particulièrement aux présidents de groupes et de commissions, qui connaissent bien ces contraintes.
Je souhaite ensuite que le Sénat se saisisse pleinement de ses pouvoirs d’investigation, de contrôle et d’évaluation. Le contrôle et l’évaluation des politiques publiques doivent être ambitieux, abrités des pressions des lobbys et des groupes d’intérêts. Les conflits d’intérêts sont en effet incompatibles avec une démocratie moderne. Ils sont le contraire d’une République exemplaire.
Dans le cadre des débats à venir sur le projet de loi relatif à la déontologie et à la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique, il me paraît indispensable que le conflit d’intérêt soit défini précisément.
De même, nos travaux devront conduire à étendre les préconisations du rapport de la commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts – n’est-ce pas, cher Jean-Léonce Dupont ? – dans la vie publique à tous les décideurs publics, y compris aux élus. Y compris à nous, parlementaires : nous devons d’abord nous appliquer à nous-mêmes ce que nous prônons pour nos concitoyens.
Le Sénat doit être à l’écoute des attentes de nos concitoyens, et en capacité de faire évoluer les administrations.

Il doit s’affirmer comme un contrôleur exigeant, protecteur des citoyens et des usagers. Cela s’inscrit pleinement dans sa tradition historique de défenseur des libertés publiques.
Enfin, le Sénat doit aussi s’adapter dans son organisation aux évolutions profondes de notre société, notamment en matière de développement durable.
L’urgence et la mutation écologiques s’imposent à nous : Paul Vergès nous l’a rappelé dans son beau discours, lors de notre séance d’installation. Nous devons aujourd’hui les prendre en compte dans nos travaux et dans nos propositions. Notre souci doit être l’adaptation permanente du Sénat aux défis de notre temps.
C’est dans cet esprit que je proposerai, après une large concertation, la création de deux nouvelles commissions, comme la Constitution le permet depuis la révision de 2008 et comme l’a déjà fait l’Assemblée nationale.
Je propose aussi, comme je l’ai indiqué ici-même, dès mon premier discours en tant que président du Sénat, la création d’une délégation à l’outre-mer. Ainsi les situations et défis spécifiques de l’outre-mer seront-ils davantage pris en compte, et leurs atouts pleinement valorisés.
Je souhaite ensuite un Sénat restauré dans son rôle de représentant des élus locaux.
Il est indispensable de rendre nos collectivités plus fortes dans une France plus efficace. Nous le savons tous, le Sénat est constitutionnellement le représentant des collectivités territoriales. Il doit être au cœur du dialogue, restauré, entre l’État et les collectivités locales.
La réforme territoriale doit être abrogée et entièrement repensée.
Une réforme est à l’évidence nécessaire, comme je l’ai entendu dire en bien des endroits. Mais celle-ci est allée, je le crois, dans le mauvais sens. Elle s’est accompagnée d’une révision générale des politiques publiques dont on a vu les effets dévastateurs dans nos territoires. Elle s’est traduite par une réforme des services de l’État inefficace, illisible pour nos concitoyens et préjudiciable pour les collectivités locales.
La recentralisation est une régression. La décentralisation doit reprendre sa marche en avant.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste–EELV et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE et de l’UCR.

J’ai d’ailleurs eu le sentiment en fin de semaine dernière que quelque chose avait changé en ce domaine. Lors de mon premier entretien avec le Premier ministre, je lui ai demandé de revoir le calendrier de la réforme de l’intercommunalité. François Fillon a indiqué que « la procédure ne sera menée à son terme que lorsqu’une majorité claire des élus concernés se dégagera ».
Le Gouvernement prend donc enfin conscience que l’on ne peut pas, sur cette question si sensible, passer en force. Cela imposera de corriger la loi. Mais il faut bien entendu aller plus loin.
Dès cet hiver, des états généraux des territoires pourraient être organisés par le Sénat. Ils réuniraient toutes les associations d’élus et les acteurs locaux. Majorité et opposition pourront, si elles le souhaitent, y prendre toute leur part. Il s’agira de dresser un constat de la situation et d’esquisser des perspectives d’avenir.
Ces états généraux permettront de définir les priorités d’une relance de la décentralisation pour renforcer les libertés et les solidarités locales. Ainsi, la nouvelle décentralisation pourra être rapidement engagée dès le début de la prochaine législature, sur l’initiative et avec les mots du Sénat.
Je souhaite que le Sénat réfléchisse dans ce cadre à un nouveau pacte financier entre l’État et les collectivités locales caractérisé par le retour au respect de l’autonomie fiscale, le financement national des allocations de solidarité et la création de dispositifs de péréquation adaptés.

Le Sénat doit enfin formuler des propositions novatrices sur la place des services publics, notamment en milieu rural et dans les territoires urbains en difficulté. Il doit proposer de s’engager sur la voie d’un aménagement équilibré du territoire.

L’objectif est de garantir un accès équitable des citoyens aux services publics et d’assurer la réduction des inégalités territoriales.
De même, il faut redéfinir les missions et l’organisation de l’État dans les territoires et conforter le soutien juridique et technique apporté aux communes en matière de conseil et d’ingénierie technique.
En bref, le Sénat devra être l’inspirateur et le garant de cette nouvelle gouvernance des territoires, de ce nouveau pacte de confiance entre l’État et les élus locaux.
Je souhaite enfin un Sénat rénové dans son mode de fonctionnement interne.
C’est le souhait de l’ensemble de la majorité dans sa diversité, composée de socialistes, de communistes, de radicaux de gauche et d’écologistes. Et c’est un souhait, je le crois, partagé sur toutes les travées de notre assemblée.
La nouvelle gouvernance mise en place par vos votes dans les commissions se caractérise par la volonté de donner sa juste place à chaque groupe, et d’abord par le respect de l’opposition.
C’est dans cet état d’esprit que nous avons souhaité que la commission des finances soit présidée par l’opposition. De même, pour respecter cette diversité à laquelle nous sommes tous attachés, je vous proposerai de fixer à dix le nombre de sénateurs nécessaires pour créer un groupe
Mouvements divers sur les travées de l ’ UMP.

La rénovation du Sénat doit être aussi visible. Nous connaissons le rôle qu’a joué à ce propos Public Sénat. Il nous faudra réfléchir ensemble aux moyens de mieux faire comprendre à nos concitoyens l’ensemble du processus d’élaboration de la loi et du travail parlementaire.
Enfin, l’image de notre institution reste, hélas, encore trop dégradée et le train de vie du Sénat trop souvent stigmatisé, notamment par la presse. Il est nécessaire d’aller vers un Sénat plus modeste. Et nous ne devons craindre aucun regard extérieur, notamment celui de la Cour des comptes, sous réserve naturellement que les principes inhérents à la séparation des pouvoirs soient respectés.
On ne « manage » pas une institution publique comme une entreprise. Pour autant, cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas une gestion rigoureuse, surtout en ces temps de crises et de contraintes financières.
Le bureau du Sénat avait envisagé, lors de sa dernière réunion, une augmentation du budget correspondant à l’inflation. Cela n’est plus possible aujourd’hui. Nos efforts doivent aller au-delà. Non seulement notre budget ne doit pas augmenter en valeur, mais je demande en outre pour l’an prochain qu’il soit réduit en volume.
Pour cela, je souhaite engager dès maintenant une révision complète du programme très important des travaux qui avaient été envisagés. Nous nous en tiendrons aux seuls travaux qui sont strictement nécessaires à l’entretien et à la préservation de notre magnifique patrimoine.
De même, nous avons à nous pencher sur les critiques qui ont été émises à l’égard de notre fonctionnement, mais aussi – et nous en avons tous entendu – à l’égard des sénateurs eux-mêmes.
Nous ne pouvons refuser d’aborder ce sujet. Un groupe de travail devra rapidement s’en saisir. Il devra s’exprimer certes sans tabou et sans frilosité, mais sans tomber non plus dans la démagogie ou dans je ne sais quel emballement, fût-il médiatique. Nous travaillerons dans la sérénité et sans céder à la pression.
Mes chers collègues, le Sénat a été au rendez-vous de l’alternance ; il se doit d’être au rendez-vous du changement.
Nous avons un intérêt commun à faire vivre nos débats, notre pluralisme et à assumer nos divergences dans le respect les uns des autres.
Cela concerne également nos rapports avec le Gouvernement, que je souhaite confiants, transparents et apaisés.
Au-delà de nos engagements respectifs, c’est le souci de l’intérêt général et du bien commun qui nous anime. La République est en droit d’attendre du Sénat et de chacun de ses membres qu’ils se retrouvent lorsque l’intérêt supérieur l’exige.
Être le président de tous les sénateurs, dans un Sénat conforté, rénové et respecté, c’est le rôle que je compte assumer, avec votre concours et votre aide.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste–EELV, du groupe CRC et du RDSE, ainsi que sur diverses travées de l’UCR et de l ’ UMP.

L’ordre du jour appelle le débat préalable au Conseil européen du 23 octobre 2011.
La parole est à M. le ministre.
rapporteure générale, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens d’abord, en vertu de l’esprit républicain qui nous anime tous, à féliciter le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, l’ensemble des sénateurs nouvellement élus, ainsi que ceux qui ont accédé à des responsabilités.
Les Conseils européens sont des rendez-vous majeurs pour la France et pour l’Europe. Ils permettent de définir les grandes orientations de la politique européenne et de prendre au plus haut niveau les décisions nécessaires, souvent courageuses, qui sont aujourd'hui indispensables.
Dans les temps bouleversés que nous vivons, le Conseil des 23 et 24 octobre prend un sens particulier. Nous le savons tous, l’Europe, comme le monde, est à un tournant de son histoire. Je vois dans ce qu’on appelle « la crise » la disparition d’un monde ancien. La période intermédiaire actuelle doit permettre de construire un monde nouveau : on peut y voir une source d’angoisse et de craintes pour l’avenir, mais aussi un motif d’espoirs et d’opportunités. L’Europe en sortira plus intégrée et plus forte grâce au nouvel équilibre que nous devons mettre en place entre la discipline budgétaire et l’indispensable solidarité, entre la gestion rigoureuse et la croissance.
Les débats du Conseil européen seront centrés sur trois thématiques : la gouvernance économique et la croissance de demain ; le G20, au sein duquel la France et l’Europe ont un message fort à envoyer au reste du monde ; le réchauffement climatique et la conférence de Durban.
En ce qui concerne la zone euro, la gouvernance économique et la croissance, les chefs d’État et de gouvernement ont pris, le 21 juillet dernier, des décisions importantes. Le Fonds européen de stabilité financière a été renforcé et assoupli : il peut désormais racheter de la dette sur les marchés secondaires et recapitaliser un certain nombre de banques. Cette situation permet une réactivité indispensable dans la période que nous connaissons. Nous sommes ainsi en train de créer un véritable Fonds monétaire européen.
La gouvernance économique a également progressé avec l’adoption le 28 septembre par le Parlement européen et le 4 octobre par le Conseil du paquet gouvernance économique, dénommé six pack en anglais. Cette avancée majeure ouvre la voie à un autre modèle de gouvernance économique qui doit permettre d’allier, d’un côté, vigilance et prévention et, de l’autre, correction des éventuelles anomalies macro-économiques. Le pacte de stabilité et de croissance a donc franchi une étape supplémentaire pour être l’un des outils essentiels de la gouvernance économique de demain.
Je vous le dis, parce que j’en suis convaincu, il faut aller encore plus vite et plus loin : nous devons renforcer le pilotage de la zone euro. Le président du Conseil fera connaître ses propositions dans les jours qui viennent. Pour leur part, la France et l’Allemagne ont rappelé ce dimanche qu’elles souhaitaient aller plus loin dans l’intégration économique de la zone euro. Elles avaient déjà demandé le 16 août que soit reconnu le rôle spécifique des chefs d’État et de gouvernement : ceux-ci devraient se réunir de façon régulière sous une présidence stable, qui pourrait être confiée à Herman Van Rompuy.
Il faudrait enfin accroître les moyens dont disposent les ministres des finances. Un renforcement des moyens du Comité économique et financier et de l’Euro working group doit donc être envisagé.
Devant vous, j’ose le mot : nous devons passer à un « fédéralisme » économique, sous peine de voir l’Europe se désintégrer sous les attaques des spéculateurs financiers.
Cette gouvernance économique n’aura de sens que si elle est associée à une politique de croissance forte. Celle-ci sera largement débattue lors du prochain Conseil.
Trois axes majeurs définissent aujourd’hui notre politique de soutien à la croissance au niveau européen : approfondir le marché intérieur, renforcer notre politique industrielle et imposer une concurrence mondiale loyale.
Nous disposons du plus grand marché du monde : 500 millions d’Européens, un PIB cumulé annuel de 12 000 milliards d’euros. L’Acte pour le marché unique, avec ses douze priorités, proposé par le commissaire Michel Barnier en avril dernier permettra de l’approfondir pour en tirer tout le potentiel. Nous soutenons ainsi le brevet unitaire et nous travaillons sur l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés, qui devrait permettre de réduire les « fragmentations » de l’économie de la zone euro.
La France se bat aussi pour obtenir une politique industrielle forte. La compétitivité doit être basée sur l’innovation et les infrastructures et être accompagnée de politiques sectorielles. La communication sur la politique industrielle d’octobre 2010 va dans ce sens. Nous devons nous concentrer sur les secteurs d’avenir : l’espace avec Galileo et le programme européen de surveillance de la terre, le GMES ; le numérique, où des grands champions européens doivent émerger dans un contexte de concurrence mondiale de plus en plus difficile ; et les technologies vertes.
Enfin, et c’est une revendication française, nous voulons imposer au reste du monde ce que nous appelons – le terme est peut-être impropre - le principe de réciprocité. Comment l’Europe peut-elle se donner des règlements si contraignants sur le plan écologique, social ou normatif si elle doit se retrouver en situation de concurrence déloyale avec d’autres pays qui pourraient pénétrer son marché sans esprit de réciprocité ? Il y va de la préservation de notre économie et de notre modèle.
Je vous le dis très clairement, il ne s’agit en aucune façon d’une forme de protectionnisme, mais au contraire d’un modèle incitatif que nous devons imposer au reste du monde. Cet instrument de réciprocité est indispensable. Prenons l’exemple des marchés publics : en 2009, ils représentaient 2 088 milliards d’euros en Europe, dont plus de 15 % étaient ouverts aux acteurs étrangers, contre seulement 3 % aux États-Unis, 0, 9 % au Canada et encore beaucoup moins en Chine.
Comment peut-on accepter que les entreprises chinoises, qui sont aidées par l’État et pratiquent un dumping social déplorable, emportent le marché de la construction d’autoroutes en Pologne au mépris de toute véritable concurrence ?
La France continuera donc à peser de tout son poids au Conseil pour que le principe de réciprocité soit mis en œuvre dans toutes nos politiques européennes.
S’agissant du G20, la France s’est fixé des objectifs ambitieux. La présidence française du G20 est une présidence européenne. Nos objectifs sont le retour de la croissance, le redressement de nos finances et la stabilité du système financier.
Le Conseil européen sera doublement décisif pour préparer le sommet de Cannes.
D’abord, si l’Europe n’a pas réglé d’ici au sommet de Cannes l’ensemble des problèmes de la zone euro et de l’Europe, le G20 sera celui de la dette de la zone euro et nous serons désignés comme les responsables de la récession et des difficultés que rencontre le reste du monde.
Les États européens devront donc définir, lors du Conseil, les positions de l’Union européenne sur un certain nombre de sujets.
Nous évoquerons ainsi la réforme du système monétaire international, sur lequel un certain nombre d’avancées ont déjà été obtenues, en particulier s’agissant de la gestion des flux financiers.
Nous aborderons également les progrès effectués en matière de régulation financière, en anticipant la mise en œuvre de l’accord dit « Bâle III », qui étend les règles prudentielles.
Il sera ensuite question de la dimension sociale de la mondialisation. Comment pourrait-on en effet considérer que l’Europe ne parlerait que d’économie et de finances sans avoir la capacité d’établir un socle indispensable de protection sociale envers les plus vulnérables, et en particulier envers la jeunesse ?
Nous définirons également les positions de l’Union européenne sur le domaine agricole, que la présidence française a marqué de son impulsion. En effet, il faut, d’une part, prévenir les crises agricoles et, d’autre part, obtenir une meilleure transparence sur l’ensemble des stocks afin justement d’éviter que ne surgissent de telles difficultés.
Enfin, la France souhaite que soit abordé le sujet du développement, et plus particulièrement la sécurité alimentaire et les infrastructures.
Je voudrais à ce propos évoquer très brièvement – nous y reviendrons ultérieurement si vous le souhaitez – le problème de la taxation des transactions financières.
On en parle depuis vingt ans ! §Il est temps de la mettre en œuvre et d’accepter que cette mise en œuvre puisse ne pas être universelle.
Il faudra bien avancer, éventuellement au niveau de la seule Europe si les Etats-Unis ne souhaitent pas y participer, voire au niveau de la seule zone euro si la Grande-Bretagne ne souhaite pas faire partie du groupe pionnier.
Qu’est-ce qu’un bon impôt ? C’est un impôt qui a une assiette très large et un taux très faible. On entend parler d’une taxation des transactions financières fondée sur un taux fixé à 0, 005 %. Croyez-vous franchement qu’à un tel taux la taxation entraînera un déplacement des opérations financières de Francfort à Hong Kong ou de Paris à Londres ?
Au demeurant, s’il faut avancer dans ce domaine, c’est aussi en vertu d’une certaine exigence morale. Considérer qu’il serait impossible de taxer les transactions financières, qui n’apportent rien à l’économie réelle et rien à l’humain, empêcher de la sorte que cette taxation vienne en aide au développement et à l’Europe me paraît tout à fait contestable. En tout cas, une telle conception est en totale contradiction avec nos convictions européennes.
C'est la raison pour laquelle le Président de la République et la Chancelière Angela Merkel ont souhaité que ce point soit mis à l’ordre du jour du G20. Il en sera donc ainsi.
Autre préoccupation française et européenne : le réchauffement climatique et la conférence de Durban. L’Europe a toujours assuré une politique volontariste dans ce domaine. L’action du Président de la République l’a montré : nous nous souvenons, sur le plan national, du Grenelle de l’environnement et, sur le plan européen, du paquet énergie-climat qui vise à réaliser, à l’horizon 2020, l’objectif « 20-20-20 » : passage à 20 % de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique européen ; réduction de 20 % des émissions de CO2 ; accroissement de 20 % de l’efficacité énergétique.
Cette réalisation peut toutefois n’être qu’un coup d’épée dans l’eau. L’Europe ne produit que 11 % des émissions : si nous nous engageons seuls dans cette action forte, nous pénaliserons nos entreprises sans obtenir de résultats sur le plan écologique à l’échelle internationale.
C'est la raison pour laquelle, dans la perspective de l’expiration du protocole de Kyoto en 2012, la conférence de Durban doit constituer un moment capital pour préparer l’« après-Kyoto ».
Il convient bien entendu de donner un contenu opérationnel aux accords de Cancun, et notamment au mécanisme de suivi des engagements et à la mise en place du fonds vert et des financements innovants. Il s’agit également, bien sûr, d’évoquer le futur système de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’obtenir une évolution vers un système clair, contraignant et universel.
Répondre à ce défi est vital. Il n’y va ni de l’économie générale, ni des équilibres sociaux et économiques ; il y va de l’avenir de la planète.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous le voyez, la situation est telle que l’Europe n’a pas d’autre choix que d’avancer. Elle n’a pas d’autre choix que de franchir une étape, une étape décisive qui nous permettra justement de valoriser et de prôner les valeurs européennes de solidarité, de liberté et de démocratie.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ UCR.

La parole est à M. le président de la commission des affaires européennes.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d’abord vous dire toute ma satisfaction que le premier débat du Sénat renouvelé soit un débat européen.
Je voudrais aussi dire toute ma satisfaction que ce débat ait lieu dans l’hémicycle, alors que le principe avait parfois pu en être contesté, et non pas dans le « petit hémicycle » ...

… et qu’il se tienne à une heure satisfaisante, non pas en fin de soirée, comme l’habitude en avait été prise.

L’ordre du jour théorique du prochain Conseil européen a été arrêté depuis plus d’un mois. Mais il ne fait aucun doute que le sujet principal en sera, une fois de plus, la crise financière, qui ne cesse de rebondir.
Personne ne reprochera au Conseil européen de donner priorité à cette question, qui domine l’actualité. Bien au contraire !
Mais cette situation montre que l’Europe ne parvient pas à être maîtresse de son destin. La crise financière est partie des États-Unis, elle s’est étendue à l’Europe, puis elle est devenue une crise des dettes souveraines dont l’Europe est l’épicentre.
L’Europe réagit plus vite qu’elle n’agit, elle pare au plus pressé et des décisions présentées comme suffisantes sont remises en question avant même d’être en vigueur.
Le plan adopté le 21 juillet dernier vient à peine d’être approuvé par tous les parlements concernés – l’un d’entre eux se prononce en ce moment même – qu’il est déjà question de nouvelles mesures pour soutenir les banques et transformer le rôle du Fonds européen de stabilité financière.
Il est clair que les décisions prises en commun ne parviennent pas à recréer durablement la confiance. Il manque à l’Europe une force d’entraînement, un centre politique clairement identifié qui donne le sentiment qu’on sait où l’on va et qu’il existe une cohérence entre ce qui est approuvé à Bruxelles et ce qui est mis en œuvre par les États.
Qui peut aujourd’hui véritablement parler au nom de la zone euro ? Pour M. Barroso, c’est la Commission, sous le contrôle du Parlement européen, qui doit être le véritable gouvernement économique de l’eurozone. Mais cette revendication se heurte au fait que la Commission et le Parlement représentent collectivement les vingt-sept pays membres, dont dix-sept seulement appartiennent à la zone euro. Il faudrait une capacité de décision propre à l’eurozone, outre celle de la BCE, aujourd’hui la seule qui existe.
Une autre solution possible serait celle qu’a préconisée l’accord franco-allemand du 16 août dernier, à savoir un gouvernement économique réunissant les chefs d’Etat et de gouvernement de la zone euro, avec la même présidence que le Conseil européen. Cette solution n’est peut-être pas idéale, mais elle a l’avantage d’être immédiatement réalisable et d’être adaptée à la situation spécifique de l’eurozone. Cependant, depuis le 16 août, on attend toujours qu’elle se confirme et se concrétise.
En fait, on ne parvient pas à suivre le fil conducteur des décisions prises.
Le 21 juillet, on nous expliquait que le secteur privé – c’est-à-dire les banques – devait participer au sauvetage de la Grèce, en acceptant une décote sur les titres de la dette grecque, mais aussi en achetant de nouveaux titres lorsque les titres actuels viendraient à échéance. Maintenant, on nous explique qu’il faut recapitaliser les banques européennes, notamment parce qu’elles sont fragilisées par la possession de titres de dette publique.
Il est difficile de trouver une cohérence entre ces priorités successives.
Mme la rapporteure générale approuve.

De même, les experts annonçaient à la fin du mois dernier qu’il y avait urgence, que la Grèce allait faire défaut début octobre ; maintenant, on nous annonce qu’on peut attendre encore avant d’accorder les fonds, alors même que la situation budgétaire de la Grèce continue à se détériorer.
Les rumeurs et les annonces se succèdent, donnant aux citoyens européens une impression de confusion et d’absence de perspectives, et conduisant à un pessimisme de plus en plus profond.
La seule décision claire de l’Union européenne a porté sur le durcissement du pacte de stabilité, avec notamment des sanctions plus automatiques qu’auparavant pour les États en déficit excessif.
Lorsque cette question a été abordée au sein de la commission des affaires européennes – je prends à témoin Jean Bizet, présent dans cet hémicycle –, nous avons été nombreux à être sceptiques sur ce renforcement du volet répressif. Face à une situation de surendettement, la priorité doit-elle être d’infliger des amendes ?
Le renforcement du volet préventif du pacte est un aspect plus intéressant, avec notamment l’idée qu’il vaut mieux coordonner les politiques budgétaires et corriger en temps utile les déséquilibres macroéconomiques.
Mais la véritable prévention, me semble-t-il, consisterait à redonner à l’Europe des perspectives de croissance, au lieu d’annoncer toujours plus d’austérité et de rigueur.
Monsieur le ministre, je sais que votre spécialité est la cardiologie, et non la psychanalyse. Je voudrais néanmoins vous rappeler une histoire que Freud raconte dans un petit ouvrage intitulé Malaise dans la civilisation. Il s’agit de l’histoire d’un paysan avare qui, chaque jour, donne un petit peu moins à manger à son âne. L’âne finit par mourir, et le paysan ne comprend pas cette fin brutale.
Il me semble que nous avons tendance à faire la même chose aujourd’hui. Nous prenons partout en Europe des mesures d’austérité. La croissance diminue, les recettes fiscales baissent et, pour arriver à tout de même réduire les déficits, nous prenons des mesures d’austérité supplémentaires. On ne voit pas le bout de cette spirale.
Pourtant, lorsque le pacte de stabilité avait été conclu en 1997, il avait été rebaptisé – à la demande notamment du gouvernement français de l’époque – « pacte de stabilité et de croissance ». Il semble que la seconde partie de sa dénomination soit aujourd’hui bien oubliée. Or, si rien n’est fait pour recréer des anticipations de croissance, il va être extraordinairement difficile de réduire les déficits accumulés. Il s’ensuivra des tensions de plus en plus fortes au sein de nos sociétés. Personne ne peut accepter la réclusion économique pour une génération. On ne peut pas construire un assainissement financier sur une interminable récession.
La crise est en train de mettre à l’épreuve la solidarité européenne. Les menaces qui pèsent sur le programme européen d’aide aux plus démunis en sont le triste exemple. Certes, nous savons qu’il faut prendre en compte une décision de la Cour de justice. Mais, franchement, que l’Europe tergiverse ainsi lorsqu’il s’agit d’aide alimentaire aux plus démunis, ce n’est pas seulement une faute sur le plan social, c’est un signal politique désastreux ! Nous avons exactement besoin du contraire.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste–EELV et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE, de l’UCR et de l’UMP.

Face à la crise, l’Europe a besoin de plus de solidarité.
Elle a besoin de plus de solidarité sociale à l’intérieur des États.
Elle a besoin de plus de solidarité entre les régions. C’est d'ailleurs la raison pour laquelle, monsieur le ministre, il est nécessaire que, dans le prochain cadre financier, la politique régionale dispose de moyens suffisants, notamment au profit de la nouvelle catégorie des « régions intermédiaires » dont le Sénat soutient la création.
Monsieur le ministre, je rappelle à cet égard que notre assemblée a voté à l’unanimité une proposition de résolution allant en ce sens.

Enfin, l’Europe a besoin de plus de solidarité entre les États car, si nous ne montrons pas que nous sommes déterminés à agir dans l’intérêt commun, nous verrons la spéculation traiter les États comme des dominos, et nous finirons par être tous perdants.
Après avoir commencé mon propos en citant un psychanalyste, et être passé par un cardiologue, je le conclurai par la formule du philosophe Karl Popper : « Les hommes n’ont pas besoin de certitudes, mais ils ont besoin d’espoir ». Aujourd’hui, les Européens ont besoin de regarder au-delà de la crise ; le Conseil européen ne peut pas leur donner des certitudes, mais il doit leur redonner des raisons d’espérer.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste–EELV et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE, de l’UCR et de l’UMP.

Avant de donner la parole à M. le président de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, je tiens à saluer tous ceux qui, comme lui et M. Sutour, vont s’exprimer aujourd’hui en leur qualité nouvelle.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le prochain Conseil européen doit aborder la politique économique extérieure commune, c’est-à-dire la question des relations commerciales, monétaires et financières que l’Union européenne entretient avec les pays tiers.
Sur le plan multilatéral, une conférence ministérielle est prévue au mois de décembre à Genève. Que peut-on en attendre ? Si, en début d’année, de faibles espoirs subsistaient encore concernant une possible conclusion du cycle de Doha en 2011, ils se sont évaporés.
Dans ce contexte, si elle se contente de constater le blocage des négociations et de répéter les incantations rituelles sur la nécessité de conclure rapidement le cycle de Doha, la conférence ministérielle de décembre risque de n’être qu’un nouveau sommet pour rien. Or je ne pense pas que l’on puisse se satisfaire de cette situation.
D’une part, en effet, le cycle de Doha est consacré prioritairement au développement, et son échec, s’il ne handicape que marginalement les grandes puissances commerciales, constitue en revanche un sujet d’inquiétude majeur pour les pays les moins développés. D’autre part, le blocage des négociations de Doha s’accompagne d’un essor des accords bi- ou plurilatéraux.
D’un point de vue pragmatique, cet essor des négociations bilatérales est nécessaire. En effet, dans l’attente d’une hypothétique conclusion du cycle de Doha, on ne peut pas indéfiniment remettre à demain les progrès concernant des questions centrales du commerce contemporain telles que l’accès aux marchés publics, la protection de la propriété intellectuelle ou la coopération réglementaire.

Cependant, il faut être conscient que, si les accords bilatéraux se développent en lieu et place des accords multilatéraux, cette tendance risque, sur le long terme, de saper la légitimité même de l’approche multilatérale du commerce international. Comment, en effet, l’Organisation mondiale du commerce, l’OMC, et son organe de règlement des différends peuvent-ils espérer continuer à réguler de manière crédible et efficace le commerce si les normes du droit commercial international, sur tous les sujets majeurs, sont désormais fixées en dehors du cadre multilatéral ?
Le développement des accords bilatéraux ne doit donc pas nous dissuader de présenter des propositions nouvelles pour conclure le cycle de Doha, et le prochain Conseil européen doit être l’occasion de réfléchir aux moyens d’avancer dans ce sens. En tout état de cause, l’Union européenne a déjà fait preuve de beaucoup de bonne volonté pour faciliter la conclusion du cycle. Selon moi, elle est allée à la limite de ce qu’elle pouvait concéder, notamment dans le domaine agricole. Mais des initiatives concernant les enjeux et la méthode des négociations restent sans doute encore envisageables.
En particulier, en ce qui concerne les enjeux du cycle en cours, les pourparlers se sont focalisés sur le triptyque « soutiens à l’agriculture, accès aux marchés agricoles, accès aux marchés pour les produits non agricoles ». La restriction du champ des discussions à ces thèmes était conçue comme un moyen de ne pas alourdir les négociations et de faciliter ainsi leur conclusion. Je me souviens que notre collègue Jean Bizet nous avait « vendu » cet argument à l’époque…

Cette solution semblait relever du bon sens : a priori, moins il y a de sujets sur la table, plus il est facile de trouver un consensus, du moins en théorie ! Avec le recul, on peut se demander cependant si tel est vraiment le cas et si ce choix n’a pas contribué, au contraire, à gripper la machine. En effet, dans le jeu complexe de « donnant-donnant » – ou win win – que constituent des négociations commerciales internationales, un gain dans un domaine se paie d’une concession dans un autre. Or il n’est pas certain qu’il y ait aujourd’hui suffisamment de « grain à moudre » dans le cadre du cycle de Doha pour rendre possible des concessions nouvelles mutuellement profitables à toutes les parties.
Comme je l’ai indiqué, les intérêts majeurs des grandes puissances commerciales développées ou émergentes portent aujourd’hui sur des thèmes situés en dehors du champ des négociations de Doha. Par conséquent, une concession sur un des sujets en discussion dans ce cadre ne peut pas être compensée par une avancée symétrique sur un autre thème, puisque tous les domaines où des avancées « intéressantes » pourraient être enregistrées ne relèvent plus du cycle de Doha. Il faut donc réfléchir aux moyens de débloquer le jeu.
J’en viens maintenant au deuxième volet de l’agenda commercial européen, à savoir le volet bilatéral. Vous le savez, le trimestre qui commence sera riche en rendez-vous importants : un sommet Union européenne-Chine se tiendra en novembre, suivi de sommets Union européenne-Ukraine, Union européenne-Russie et Union européenne-États-Unis en décembre. Avec tous ces acteurs importants du commerce mondial, qui sont aussi des concurrents redoutables pour nous, l’Union européenne est aujourd’hui engagée dans des négociations bilatérales. Or il faut que le respect du principe de réciprocité dans l’ouverture aux marchés soit l’objectif premier qui guide ces négociations.

Ce principe est certes affiché clairement dans la stratégie européenne définie en avril 2007 par la Commission européenne. On peut se féliciter que l’Union européenne ait enfin défini sa stratégie commerciale autour de la notion de réciprocité, même si on peut regretter le caractère un peu tardif de sa prise de conscience.
Cependant, il faut maintenant transformer l’objectif affiché en réalité, car il y va de la croissance et de l’emploi sur notre continent. Pour mémoire je rappellerai que, rien qu’avec la Chine, le déficit commercial de l’Union européenne avoisine annuellement cent soixante-dix milliards d’euros et, en l’occurrence, la situation de l’Allemagne n’est guère meilleure que celle de la France. Combien d’emplois perdus un tel déficit commercial représente-t-il ? Nous devons donc rééquilibrer les échanges dans le sens d’une plus grande équité dans les concessions mutuelles.
Je voudrais illustrer les enjeux que soulève cette question en prenant en exemple l’accès aux marchés publics. L’Union européenne a donné accès à 85 % de ses marchés publics aux entreprises des pays tiers, dans le cadre de l’accord sur les marchés publics de l’OMC, ou AMP. Or nos partenaires sont beaucoup plus restrictifs que nous.
Les États-Unis, tout en étant partie à cet accord, excluent certains marchés publics au niveau fédéral, notamment dans le domaine de la défense – vous avez tous en mémoire l’exemple d’un marché dans le domaine de l’aéronautique… Au niveau fédéré, treize États américains excluent complètement l’application de l’AMP et trente-sept autres l’appliquent en excluant des secteurs sensibles, comme l’acier de construction en Pennsylvanie.
Le Japon n’est pas plus vertueux, puisque seuls 25 milliards d’euros de marchés publics sur un total de 570 milliards d’euros sont ouverts aux concurrents étrangers avec, en particulier, une exclusion totale dans le domaine ferroviaire. On peut se demander pourquoi…
Quant à la Chine, elle n’est même pas partie à l’accord sur les marchés publics, son offre d’adhésion ayant été rejetée en raison du caractère extrêmement restrictif de l’ouverture concédée.
Bref, il existe un déséquilibre manifeste dans ce domaine entre l’Europe et ses partenaires. On arrive parfois à des situations totalement absurdes. C’est le cas de l’affaire COVEC, évoquée par M. le ministre : une entreprise publique chinoise a remporté, en Pologne, un marché de construction d’autoroute en présentant une offre tarifaire anormalement basse, alors même que ce projet était cofinancé par des fonds structurels européens. L’Union européenne n’est-elle pas un peu masochiste en la matière ?
Dans ces conditions, le prochain Conseil européen doit être l’occasion de réaffirmer clairement l’attachement de l’Union européenne et de la France à une ouverture équitable des marchés publics, que cette ouverture soit acquise dans le cadre de l’AMP ou d’accords bilatéraux. Il importe également, pour répondre aux déséquilibres les plus manifestes, que l’Union adopte rapidement un outil lui permettant de se défendre contre les mesures protectionnistes d’États tiers et de mettre un terme à ce désarmement unilatéral.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste–EELV.

La Commission européenne s’est engagée à proposer une mesure législative allant dans ce sens avant la fin de l’année : nous serons très attentifs au suivi de cette affaire et nous veillerons à ce que l’outil proposé soit ambitieux, afin que nous ne soyons pas les dindons de la farce de l’accord AMP !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste–EELV et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

La parole est à Mme la rapporteure générale de la commission des finances.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il est pour le moins étonnant de tenir aujourd’hui un débat censé préparer un sommet européen dont la date vient d’être reportée et dont on ne connaît plus vraiment l’ordre du jour, même si l’on s’en doute ; quoi qu’il en soit, je vais le préempter !
Il est vrai que, depuis trois ans, nous avons appris que, si le pire n’était pas toujours sûr, il était néanmoins possible. Si l’on a mauvais esprit, on se désolera que les dirigeants européens soient obligés de repousser les échéances pour tenter de se mettre d’accord. Mais, si l’on garde le cap sur l’optimisme, on espérera – comme vous tous, j’en suis sûre ! – que ce délai sera mis à profit pour élaborer un véritable plan de réponse global à la crise actuelle.
La crise de la zone euro est entrée dans sa phase la plus aiguë depuis que les premières craintes concernant la Grèce ont été émises, à la fin de l’année 2009. Je voudrais rappeler à notre assemblée ce que nous a coûté l’indécision politique qui a prévalu en mai 2010. Nous connaissons ces jours-ci une situation qui combine les caractéristiques de la crise de septembre-octobre 2008, lorsque le marché interbancaire a pratiquement cessé de fonctionner, et celles du printemps 2010, lorsque les conditions de financement des États de la zone euro ont commencé à diverger dangereusement.
Autrement dit, la crise de la zone euro, due essentiellement à l’indécision politique, a engendré deux risques potentiellement systémiques : une contagion à l’Espagne et l’Italie, contre laquelle les outils dont nous disposons aujourd’hui seraient insuffisants, et une crise bancaire qui menace et deviendrait inévitable si la contagion à l’Espagne et l’Italie se produisait.
Monsieur le ministre, je sais que vous n’aurez pas réponse à toutes les questions que je vais vous poser, …
M. Jean Leonetti, ministre. Ce serait trop simple !
Sourires

… mais je sais aussi que vous avez à cœur, comme vous venez de le faire dans votre intervention liminaire, de clarifier les enjeux devant le Sénat.
En ce qui concerne le sauvetage de la zone euro, pour que nous comprenions bien ce dont on parle, je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous puissiez nous expliquer ce que recouvre la notion d’« effet de levier », qui semble être la solution qui aurait la préférence du Président de la République et du Gouvernement dans leurs discussions avec notre partenaire allemand. Il est en effet envisagé de doter le Fonds européen de stabilité financière, le FESF, d’un « effet de levier ». Quel est le sens de cette formule ? Quel serait le mécanisme juridique mis en œuvre et quels seraient les montants en cause ? Jusqu’à présent, la commission des finances du Sénat n’a pas reçu de réponses à ces questions.
S’agissant de la recapitalisation des banques, quelles sont les options retenues ? Va-t-on vers une solution européenne – je pense qu’elle est souhaitable – ou bien fera-t-on en sorte que chaque État gère ses problèmes, comme en 2008 ? Pourquoi le recours au FESF pour recapitaliser les banques fait-il l’objet d’un débat alors que cette option figure dans l’accord du 21 juillet ? Cela laisse à penser que cet accord est déjà obsolète.
Il ne faut pas oublier que, cette fois-ci, les conséquences de la crise bancaire sont plus graves qu’en 2008, car les États n’ont plus guère de marges de manœuvre ; sans compter que – nous nous en souvenons tous ici – le soutien obtenu « à chaud » par les banques en 2008, sans contreparties véritables, ne pourra plus se renouveler dans les mêmes conditions politiques : nous voyons bien que les peuples grondent, et ils ont raison de le faire, devant l’irrésolution dont font preuve les décideurs politiques.
M. Roland Courteau approuve.

En tout état de cause, la méthode qui consiste à donner le sentiment d’aller à reculons vers la recapitalisation n’est-elle pas la pire, lorsque l’on voit les différents gouvernements finir par défendre les solutions qu’ils rejetaient la veille ? Cette attitude nuit au retour de la confiance. Et c’est bien d’une grave crise de confiance que souffrent nos pays.

En ce qui concerne l’organisation du débat entre Européens, je note que le sommet de Deauville, à l’occasion duquel Français et Allemands ont donné le sentiment de négliger leurs partenaires, a laissé des traces. Nous voyons bien que la Slovaquie hésite encore, au moment où je vous parle, à donner son accord au plan du 21 juillet : il ne faudrait pas que la démarche adoptée ce week-end par la Chancelière et le Président de la République, qui témoigne de la réalité du « tandem » franco-allemand, soit à nouveau mal perçue par nos partenaires.
À plus long terme, il est illusoire de penser que l’on sortira de la crise sans dégager un accord – ou au moins les voies d’une réflexion – sur la révision du fonctionnement institutionnel de l’Union monétaire.
Monsieur le ministre, je vous ai entendu tout à l’heure parler d’une « fédération économique ». Je ne sais pas ce que recouvre ce terme, mais il est sûr que la santé d’une économie est toujours sous-tendue par une trajectoire et une stratégie budgétaires. Si l’on s’engageait effectivement sur la voie d’une fédération budgétaire consentie et d’une mutualisation des dettes souveraines, on assisterait alors à un assouplissement des conditions de financement des États : le nœud de l’affaire est donc politique. Même si leur solution s’inscrit à un horizon lointain, ces problèmes doivent être posés. Je sais qu’il est difficile de le faire en France, mais il faut le faire, telle est ma conviction profonde !
Cette référence à une fédération budgétaire me conduit à évoquer, en passant, la question des ressources propres du budget communautaire, souvent soulevée dans cet hémicycle, et l’idée d’affecter à l’Union européenne le produit de la future taxe sur les transactions financières. Il faudra être très clair et très lisible quant à l’utilisation que l’on entend faire du produit de cette taxe, car beaucoup se souviennent qu’elle a été imaginée initialement pour financer l’aide au développement. Monsieur le ministre, vous avez dit que l’on parlait de cette taxe depuis vingt ans. Moi, j’ai le souvenir que l’Assemblée nationale, en 2001, a voté un texte tendant précisément à créer une taxation des mouvements financiers.
Il faudra évidemment débattre du taux et de l’assiette de cette taxe. Tant que ceux-ci ne sont pas connus, l’accord avec nos partenaires allemands reste tout de même largement virtuel. En l’état actuel, qui pourrait se satisfaire d’une taxe qui ne s’appliquerait pas à l’une des principales masses de transaction, les dérivés sur devises ? C’est un point essentiel.
S’agissant des politiques budgétaires, les gouvernements semblent être les seuls à ne pas se préoccuper des effets récessifs de la mise en œuvre simultanée de politiques d’austérité dans les États européens.
Le président de notre commission européenne, Simon Sutour, a clairement évoqué les ressorts de la croissance. Actuellement, les États qui pourraient agir ne le veulent pas et ceux qui le souhaiteraient ne le peuvent pas. Il faudra bien sortir de cette situation. Les marchés financiers ont bien des défauts, mais j’observe que les analystes craignent aujourd'hui davantage une nouvelle récession que les dettes souveraines, ces craintes se cumulant.
Pourquoi n’évoque-t-on jamais la politique monétaire lors des discussions entre Européens alors que l’on aborde le sujet dans le cadre du G20 ?
Le groupe de travail Assemblée nationale-Sénat sur la crise financière internationale, créé sur l’initiative conjointe de Gérard Larcher, alors président du Sénat, et du président de l’Assemblée nationale, s’est prononcé au mois de juin dernier en faveur de l’utilisation par le Conseil de sa faculté de « formuler les orientations générales de politique de change » à l’égard d’autres monnaies. Pourquoi n’en use-t-il pas ?
Ce week-end, lit-on dans la presse, Mme Merkel a souhaité que les traités soient modifiés pour forcer les États endettés à plus de discipline. Que signifie cette proposition alors que le Parlement et les États viennent péniblement de se mettre d’accord sur un « paquet gouvernance » qui comprend notamment une réforme du pacte de stabilité ?
Pour conclure, mes chers collègues, je veux croire encore que les Européens sauront se mettre d’accord pour opérer les choix politiques salutaires.
Le poids et l’influence de l’Europe dans le monde seraient durablement atteints si les Européens se montraient incapables d’être à la hauteur des enjeux. Que pèserait une Europe rappelée à l’ordre par les dirigeants américains ou par le FMI ?
Puissent les chefs d’État et de gouvernement qui se réuniront le 23 octobre prochain avoir cette exigence à l’esprit. Soyez-en assuré, monsieur le ministre, cette exigence est la nôtre et, je crois pouvoir le dire, celle du Sénat tout entier !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste–EELV, ainsi que sur certaines travées du RDSE et de l’UCR.

J’indique au Sénat que la conférence des présidents a décidé d’attribuer un temps de parole de huit minutes au porte-parole de chaque groupe politique et de cinq minutes à la réunion des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe.
Le Gouvernement répondra ensuite aux commissions et aux orateurs.
Dans la suite du débat, la parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Conseil européen qui se tiendra prochainement portera principalement sur la compétitivité économique de l’Union européenne au regard de ses partenaires et concurrents commerciaux dans le monde, ainsi que sur la définition de politiques de croissance pour l’ensemble de notre continent.
En dépit d’un ordre du jour tourné résolument vers l’avenir, la réunion des chefs d’État et de gouvernement ne pourra se permettre d’omettre le présent et abordera nécessairement ces questions pressée par l’incertitude du temps présent.
L’Europe est parvenue à créer un modèle qui a vocation à inspirer l’ensemble des nations. La crise a pourtant révélé à quel point le centre de gravité du monde tend aujourd'hui à basculer des rives de l’Atlantique vers celles du Pacifique.
À l’horizon de 2050, l’Europe ne représentera plus que 30 % de la richesse mondiale et 6 % de la population mondiale. Dans un quart de siècle, 80 % de la croissance mondiale sera tirée par les pays émergents. La compétition économique qui s’annonce nous oblige d’ores et déjà à doter l’Europe d’une vision stratégique d’ensemble, d’une marche vers la puissance, sans quoi nous serons soumis au condominium sino-américain.
Notre continent souffre principalement d’un double déficit à cet endroit : un déficit en matière d’investissement et de recherche ainsi qu’un déficit lié à la volatilité et à la surévaluation de notre taux de change. Cette situation révèle d’autant plus les failles initiales de la zone euro, que nous nous devons de combler au plus tôt.
Une zone monétaire optimale ne peut conjuguer à la fois la libre circulation des capitaux, la parité fixe de son taux de change et l’indépendance de sa banque centrale.
La variable d’ajustement de l’euro est sans aucun doute sa parité flexible. C’est pourtant celle-là même qui révèle les divergences de compétitivités entre les États membres.
En effet, depuis 2008, la parité moyenne de l’euro par rapport au dollar a été de 1, 45. Notre monnaie est structurellement appréciée au regard de nos partenaires commerciaux. Si un tel niveau nous protège relativement des hausses subites des prix des matières premières, notamment du pétrole, il nous rend tout simplement moins compétitifs que nos voisins qui bénéficient de parités mieux ajustées.
La flexibilité externe de l’euro est renforcée par le flou qui existe au cœur des traités européens. Si la répartition des compétences est claire pour les politiques monétaires et les politiques fiscales et budgétaires, la politique du change serait de la compétence partagée du Conseil et de la BCE. Or le Conseil n’a jamais pris une seule décision faisant émerger l’ébauche d’une véritable politique du change paneuropéenne.
Cette situation ne peut plus durer. Sans politique de change, c’est près du quart des réserves de devises mondiales qui sont laissées au bon vouloir des opportunités mercantilistes de nos partenaires commerciaux.
Dans un tel contexte, seuls l’Allemagne et les Pays-Bas parviennent à conserver une balance commerciale positive. D’après les analyses de l’Observatoire français des conjonctures économiques, l’OFCE, ce résultat est le fruit d’une spécialisation historique sur la production de machines outils au moyen d’une politique intensive de recrutement d’ingénieurs formés en Europe de l’Est, couplé avec une politique de modération salariale difficilement supportée par la population.
Contrairement à ces deux pays, nous observons inéluctablement, à l’échelle nationale, l’érosion de notre compétitivité. Notre balance commerciale est actuellement déficitaire de 75 milliards d’euros. C’est autant de croissance que nous ne parvenons pas à capter au profit de nos entreprises et de nos salariés. Le diagnostic est simple à établir : nous n’investissons plus assez, nous ne faisons plus assez de recherche, nos PME, d’envergure trop modeste en comparaison de leurs voisines allemandes, sont accablées par une fiscalité archaïque et antiéconomique. Enfin, le coût du travail est devenu trop cher du fait tant du poids impliqué par les trente-cinq heures que par celui des cotisations sociales patronales.
La comparaison se dessine en un chiffre. À elle seule, l’entreprise allemande Siemens dépose chaque année l’équivalent de 60 % du nombre de brevets déposés en France.
Cette situation est d’autant plus périlleuse que la crise de la dette souveraine que traversent de nombreux États de l’Union européenne, notamment de la zone euro, rend les marchés financiers et les agences de notations particulièrement sensibles à l’évolution à venir de nos performances économiques. La solution est connue ; c’est en renouant avec la croissance économique que nous stabiliserons durablement notre dépendance à l’égard des marchés extérieurs et des marchés financiers.
L’Europe, mes chers collègues, est à la croisée des chemins. Les centristes plaident pour un fédéralisme européen.

L’addition des intérêts particuliers des États membres ne suffira pas à relever les défis que l’avenir nous lance. Nous devons poser franchement la question d’une politique industrielle à l’échelle de l’Union afin de garantir des emplois et de la croissance à nos concitoyens. Un grand besoin d’Europe se fait donc sentir dans tous les domaines, y compris dans ceux de la formation et de la recherche.
Il nous faut créer le cadre d’une plus grande convergence interne de nos économies pour mieux faire face à la compétition mondiale. Nous ne pouvons plus nous satisfaire de réformes à la marge des défis qui sont désormais les nôtres. Nous avons réellement besoin d’un saut qualitatif institutionnel.
Nous devons progresser sur le chemin de l’intégration européenne. À cet égard, les propositions formulées par le Président de la République et la Chancelière allemande au mois d’août dernier vont dans le bon sens. Il nous faut décidément renouer avec l’esprit communautaire
L’initiative franco-allemande de création, dans le cadre du Conseil européen, d’un gouvernement économique de la zone euro est un jalon indispensable vers une coordination plus grande des politiques économiques des États membres de l’Union.

C’est une entreprise que nous, centristes, encourageons avec force.
La convergence de nos économies doit être également renforcée par la création d’un socle fiscal commun, tant au moyen de l’assiette consolidée de l’impôt sur les sociétés à l’échelle européenne que par la convergence annoncée des fiscalités française et allemande.
Enfin, les sénateurs du groupe de l’Union centriste et républicaine proposent que la France se fasse l’avocate de l’institution d’un trésor européen abondé par l’ensemble des États membres afin de financer des investissements d’avenir nécessaires.
Les mois à venir, mes chers collègues, seront donc déterminants pour l’avenir de l’entreprise européenne, mais aussi pour celui de notre pays. La crise est grave, mais c’est en l’affrontant courageusement, directement à ses racines, sans oublier les valeurs européennes qui sont les nôtres, que nous parviendrons à renouer avec la croissance.
Applaudissements sur les travées de l’UCR, ainsi que sur certaines travées du RDSE et de l’UMP.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le principal sujet du prochain Conseil européen doit porter sur les moyens de faire face à la profonde crise financière qui secoue la zone euro à la suite des attaques spéculatives des marchés contre les banques et les économies des États.
Cette discussion a été repoussée de quelques jours afin, semble-t-il, de disposer de nouvelles conclusions sur la situation de la Grèce et la recapitalisation des banques.
Monsieur le ministre, c’est donc à ces questions cruciales que je consacrerai mes huit minutes d’intervention pour vous faire part des remarques et des propositions du groupe communiste républicain et citoyen.
À l’évidence, la profonde crise financière que subissent les pays européens, avec des conséquences désastreuses sur leurs politiques économiques et sociales, sonne l’heure de vérité de la construction européenne.
Alors que la monnaie unique est gravement menacée, que la zone euro risque d’éclater, l’Union européenne est la seule zone économique qui ne se défende pas contre la spéculation des marchés sur la dette publique.
À travers les différentes réunions qu’ils ont tenues ces jours-ci, les gouvernements et les instances de l’Union européenne ont donné le triste spectacle, par absence de volonté politique, de leur impuissance à régler la crise de l’euro, à lutter contre la spéculation des marchés, à stopper une probable contagion en cascade à la plupart des pays.
Le dernier exemple en date est la rencontre entre le Président de la République et la Chancelière allemande qui devait trancher le différend franco-allemand sur les modalités de recapitalisation des banques européennes.
On se réunit pour décider de ne rien décider, ou plutôt pour trouver un compromis dont on ne connaît pas le détail, sans doute pour ne pas mettre nos partenaires devant le fait accompli, et dont les modalités ne seront précisées que lors du G20 de la fin du mois. Où sont la place et le rôle de l’Europe dans tout cela ?
Il serait pourtant urgent de régler la question de l’intervention publique face à l’aggravation continue de la crise qui frappe de plein fouet les banques de la zone euro.
Faut-il recapitaliser les banques et de quelle manière ? En faisant appel à leurs moyens propres, à ceux des États ou en utilisant les possibilités offertes par le Fonds européen de stabilité financière ? J’évoquerai, dans la conclusion de mon intervention, les propositions de mon groupe sur cette question.
Au lieu de décider clairement et de façon cohérente, l’Union européenne persiste à prendre dans le désordre des mesures qui aggravent encore la situation.
La façon de tenter de résoudre la crise grecque est à cet égard éclairante. Le plan dit « de sauvetage » du 21 juillet est déjà dépassé avant même d’avoir été adopté par tous les États membres : le parlement allemand l’a ratifié après de nombreuses incertitudes le 29 septembre et les Slovaques devraient être, aujourd’hui même, les derniers à le faire. Pourtant, l’Union européenne, le FMI et la BCE étranglent encore un peu plus ce pays en retardant et en conditionnant le versement de la sixième tranche du plan.
Ces instances, totalement sourdes aux colères populaires, exigent en outre que ce pays accélère son programme de privatisation des entreprises et des services publics, qu’il supprime 30 000 emplois de fonctionnaires, qu’il augmente les impôts pour les classes moyennes et qu’il révise à la baisse les conventions collectives du secteur privé… Rien que cela !
Ces mesures ont pour seul effet d’asphyxier la croissance en diminuant les salaires et en réduisant la consommation intérieure et les recettes fiscales. Du reste, de nombreux économistes ont constaté que la Grèce était déjà en récession et qu’elle n’était même plus en mesure d’imposer de nouvelles mesures d’hyper-austérité.
La récession grecque risque maintenant de contaminer plusieurs économies européennes.
La succession des plans d’austérité les plus drastiques n’a pourtant aucune incidence sur la défiance des marchés puisque, après avoir dégradé la note de la Grèce et celle de l’Espagne, les agences de notation Moody’s et Fitch viennent une nouvelle fois d’abaisser celle de l’Italie.
Notre pays est lui-même menacé à cause de l’exposition de ses banques, à travers des prêts hautement spéculatifs consentis à la Grèce.
Le démantèlement de la banque franco-belge Dexia, avec le renflouement de sa partie française grâce à l’argent public de la Caisse des dépôts et consignations et de la Banque postale, jette une lumière brutale sur une situation qui devient critique pour la France. Et votre gouvernement, monsieur le ministre, craint qu’un surcroît d’endettement ne nous prive du fameux triple A décerné par des agences de notation au service exclusif des marchés…
Non, décidément, face à la gravité de cette crise, il ne faut plus tergiverser. Il faut prendre des mesures radicales pour empêcher les marchés financiers de détruire les économies des pays européens, faire preuve de courage politique pour mettre fin au laxisme de l’Union européenne vis-à-vis des marchés.
À cet égard, le débat sur la recapitalisation des banques est fondamental.
Que l’hypothèse de la possibilité donnée au FESF d’emprunter directement à la BCE ne soit plus taboue montre à quel point il est urgent de changer le statut de celle-ci et de modifier les traités européens dans ce sens.
Pour renverser la situation et rendre possible une maîtrise politique des États sur des marchés financiers aveugles et égoïstes, il faut impérativement donner la possibilité aux États de recourir directement aux crédits très bon marché de la BCE. C’est la seule voie pour stimuler l’économie, car elle permettra aux États d’accroître leurs investissements productifs, utiles aux populations, dans les services publics, dans l’innovation et la recherche, ainsi que dans la formation.
C’est pourquoi nous préconisons de créer à l’échelle européenne un fonds de développement dont la logique différerait de celle que suit l’actuel FESF, et qui serait financé par la BCE, autorisée à prêter aux États à des taux d’intérêt très bas.
En outre, pour encadrer les initiatives purement spéculatives des marchés, il faudrait parvenir à un accord avec nos partenaires européens afin d’instituer une taxe réellement efficace sur les transactions financières.
Monsieur le ministre, je doute que, exception faite d’une convergence fiscale avec l’Allemagne – convergence favorable aux seules entreprises –, le Gouvernement ait l’intention – je ne parle même pas de volonté ! – de promouvoir ces mesures à l’échelon européen. Mais peut-être allez-vous me démentir tout à l’heure…
Sans attendre que le cadre européen change, vous pourriez déjà prendre quelques mesures à l’échelon national afin de lutter contre la toute-puissance des marchés financiers.
Je pense en particulier à l’interdiction permanente des ventes à découvert, à la taxation nationale des transactions financières – il faut bien commencer quelque part ! Pourquoi pas en France ? –, à la réglementation du droit de créer des produits dérivés, au rétablissement d’un « passeport » national pour les fonds spéculatifs, à l’abolition des privilèges d’auto-saisine des agences de notation, ou bien encore à l’arrêt de la cotation en continu des entreprises.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, telles sont les appréciations dont je souhaitais vous faire part au nom du groupe communiste, républicain et citoyen avant le prochain Conseil européen.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste–EELV, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à l’issue de la visite du Président de la République, Nicolas Sarkozy, à la Chancelière Angela Merkel, dimanche dernier, à Berlin, les deux dirigeants européens se sont prononcés en faveur d’une recapitalisation des banques européennes selon des critères communs.
Soulignant à plusieurs reprises leur unité de vue sur les différents aspects de la crise financière, ils ont cependant évité soigneusement toute annonce concrète : ils ont seulement évoqué, sans plus de détails, des « modifications importantes » aux traités européens allant dans le sens d’une plus grande « intégration de la zone euro ». Or, dans la situation que nous connaissons, ce sont justement les détails qui comptent ! Le temps des grandes déclarations et des effets d’annonce est dépassé.
Bien évidemment, chacun comprendra que l’entente affichée par le couple franco-allemand est nécessaire, notamment pour rassurer les marchés, très sensibles depuis plusieurs mois. Mais faut-il pour autant conclure que Paris et Berlin ont réellement réussi à surmonter leurs divergences, en particulier sur le modus operandi ? Une photo côte à côte ne suffit pas pour affirmer un réel volontarisme politique. Et n’en faut-il pas beaucoup, du volontarisme politique, pour surmonter cette crise ?
On sait bien que nos deux pays ne s’accordent pas véritablement sur le rôle que doit jouer le fameux Fonds européen de stabilité financière. Le vice-chancelier et ministre de l’économie allemand refuse même un soutien direct des banques par le FESF : il suffit de le lire ou de l’écouter !
Par ailleurs, la recapitalisation des banques pose question, pour dire les choses aimablement. En effet, en 2008, les banques ont bénéficié de sommes considérables d’argent public et certaines ont, depuis, réalisé d’énormes profits. Ainsi, en quelque sorte coupables de nombre de nos malheurs, elles seraient les premières blanchies ! Il y a quelques semaines, elles juraient même que tout allait bien et qu’elles avaient réussi les stress tests haut la main. Il est vrai que, depuis, le sort malheureux de Dexia a changé la donne…
Après des années d’abandon par les banques de toute règle prudentielle, des mesures fortes doivent désormais être prises de toute urgence concernant la régulation et la supervision financières, car des défaillances multiples à cet égard sont à l’origine de la crise actuelle.
Nous réclamons depuis longtemps la séparation des activités de dépôt et des activités spéculatives des banques. De même, nous appelons de nos vœux la taxation des transactions financières. La Commission européenne a présenté formellement, vous le savez mieux que quiconque, monsieur le ministre, une directive en ce sens. Certes, les taux annoncés sont réduits, mais, pour une fois, ne boudons pas notre plaisir !
Quant à la recapitalisation généralisée des banques, n’est-elle pas une manière d’organiser une faillite ordonnée de la Grèce ? À ce sujet, les dernières réunions de l’Eurogroupe laissent vraiment planer le doute. Alors qu’ils sont dans un paquebot au milieu d’une tempête, les dix-sept ministres semblent se livrer à de petits calculs personnels, démontrant une fois de plus que la coordination des politiques économiques en Europe n’est toujours pas d’actualité. Pourtant, nous le savons, c’est la seule solution car, sans elle, nous ne parviendrons pas à sortir durablement la zone euro de la crise qu’elle traverse. C’est d’ailleurs ce qu’ont rappelé hier les deux nouveaux prix Nobel d’économie, deux Américains pourtant chantres du libéralisme.
Depuis longtemps, mes chers collègues, l’Union européenne a malheureusement donné le sentiment d’hésiter, de douter, voire de renâcler à décider. Les mesures adoptées l’ont été sous la pression des circonstances plutôt que dans l’enthousiasme de l’adhésion à un projet tourné vers l’avenir ; bref, sans aucune vision commune.
Il est temps d’ouvrir les yeux. Cette crise n’est pas seulement financière et économique, avec des conséquences sociales. Il s’agit bel et bien d’une « crise de confiance politique », d’une crise d’absence de volonté politique, dont l’issue ne peut donc être que politique.
Certes, je reconnais que des avancées ont été obtenues. Le FESF en est une, mais pour nécessaire qu’il soit, l’accord du 21 juillet apparaît comme insuffisant, limité et, disons-le franchement, déjà dépassé.
La crise d’hier n’est plus celle d’aujourd’hui. Et finalement, tout le problème est là : nous ne cessons d’être en retard d’une ou plusieurs batailles. Le décalage est total entre la violence des attaques spéculatives et les réponses des institutions économiques et politiques, faute de gouvernance commune. Seule une gouvernance économique et budgétaire commune, faisant pendant à notre monnaie commune, peut permettre à l’Europe et à la France de sortir de cette crise. Il est d’ailleurs unique au monde qu’une zone économique commune n’ait pas de gouvernance économique et budgétaire commune.
Les Radicaux sont convaincus que la seule solution qui permettrait à l’Europe de combattre la spéculation est de mutualiser les dettes souveraines et de recourir aux bons européens. Je regrette donc que la rencontre franco-allemande du mois d’août n’ait pas permis d’ouvrir une telle perspective. Plus exactement, elle l’a entrouverte, mais ce fut pour la refermer aussitôt.
L’adoption, désormais actée, des six textes renforçant la gouvernance économique est, c’est vrai, une avancée. Je me réjouis de ces initiatives. Je souligne que les Radicaux appelaient d’ailleurs depuis longtemps de leurs vœux un tel renforcement, mais il est naturellement très insuffisant.
Nous avons le sentiment que cette gouvernance s’inspire surtout d’une vision allemande a minima, c’est-à-dire réduite à la question du déficit. Finalement, le nouveau pacte de stabilité et de croissance est déséquilibré : il ressemble à une table branlante dont un pied serait plus court que les autres. C’est en réalité un pacte d’austérité, qui mettra inévitablement la croissance et l’emploi en berne.
S’il faut évidemment veiller à la bonne gestion des comptes publics, prenons garde, monsieur le ministre, à ce que la sortie de crise ne se fasse pas au détriment des plus fragiles.
L’Europe ne doit pas seulement surveiller et sanctionner ; elle doit surtout penser et organiser la relance. Or elle ne parvient pas à dégager une gouvernance européenne claire et efficace. Après l’échec de la stratégie de Lisbonne, la nouvelle stratégie Europe 2020 propose des objectifs communs, recentrés et clairement évalués. Mais tout cela ressemble davantage à un catalogue de bonnes intentions qu’à une volonté politique commune.
Quant à la question capitale des financements, elle est éludée.
Enfin, le discours sur l’état de l’Union récemment prononcé par le président Barroso est certes porteur d’une certaine vision stratégique et constitue une feuille de route dont se dégagent plusieurs orientations. Mais, au-delà de telle ou telle proposition, nous regrettons que cette stratégie d’ensemble arrive beaucoup trop tardivement.
Cette crise en forme de défi pour toute une génération de décideurs peut aussi permettre d’ouvrir la voie à un « renouveau européen », à une relance européenne, fondés sur des réponses adaptées aux problèmes les plus urgents, sur la mise en œuvre d’orientations audacieuses et sur la consolidation des fondements de la construction européenne.
Nous plaidons donc, monsieur le ministre, pour un véritable gouvernement économique, pour une harmonisation fiscale, pour un budget de l’Union à la hauteur des enjeux, pour une capacité d’emprunt et pour une approche volontariste dans le domaine social.
Il reste donc à espérer que les chefs d’État et de gouvernement voudront enfin prendre des initiatives, démontrer cette volonté. Le Conseil européen du 23 octobre prochain peut leur en fournir une bonne occasion.
Je le répète en conclusion : seule une volonté politique clairement affirmée nous permettra de faire face à la toute-puissance des marchés financiers. Les pères fondateurs de l’Europe, avec leur courage et leur détermination, nous ont donné l’exemple.
C’est dans les situations de crise que les responsables doivent faire preuve de courage afin de permettre l’émergence de nouveaux modèles économiques. Il n’y aura pas d’Europe forte et puissante sans une ferme volonté de tous, la vôtre, monsieur le ministre, mais aussi celle de l’ensemble des dirigeants français et européens, quels que soient leurs engagements et leur orientation politique. Oui, chacun d’entre nous doit, en toute responsabilité, prendre sa part de cette volonté et de ce courage.
Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe socialiste–EELV, ainsi que sur plusieurs travées du groupe CRC.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des affaires européennes, mes chers collègues, j’ai entrepris depuis un an une série de déplacements au sein des pays en crise de la zone euro, afin de présenter devant les membres de la commission des affaires européennes un état des lieux aussi précis que possible de la situation difficile qu’affrontent sur place gouvernements et populations.
De Dublin à Athènes, en passant par Lisbonne et Madrid, j’ai pu observer un scepticisme croissant à l’égard du projet monétaire européen, désormais synonyme de moins-disant social et de rigueur accrue.
J’ai également pu mesurer un décalage entre le temps politique et le temps des marchés. Les programmes d’austérité mis au point ici et là ne peuvent être appliqués aussi rapidement qu’un ordre est passé en Bourse. Cela signifie que nous ne saurions, nous, parlementaires, sous-estimer le temps d’adaptation des populations à une nouvelle donne économique et sociale.
Je comprends le désarroi de nos amis allemands, finlandais ou slovaques face au laxisme budgétaire et fiscal érigé en politique économique par les gouvernements grecs successifs pendant des années. Mais je ne peux mésestimer les peurs et les crispations que ces programmes d’austérité engendrent au sein d’une population qui voit son modèle social bouleversé de fond en comble, des droits ou des montants qu’elle pouvait estimer acquis se trouvant directement affectés.
Je garde en mémoire ce qu’un de nos interlocuteurs – et ce n’était pas un exalté – nous a asséné à Athènes, lorsque je m’y trouvais en compagnie de Simon Sutour : face à la pression qu’exerce l’Union européenne, les Grecs auront bientôt le choix entre l’Europe et la démocratie. Il nous appartient de veiller à ce que cette alternative ne puisse jamais voir le jour.
Si nous nous attardons d’ailleurs quelques instants sur la Grèce, qu’y observons-nous, sinon l’absence d’une réelle tradition administrative ? Il appartient au gouvernement grec de rattraper ce retard à marche forcée. Pour autant, peut-on attendre qu’il y parvienne totalement en dix-huit mois ? Un programme d’austérité, pour être appliqué, doit avant tout emporter la conviction. Or la pédagogie prend du temps et, il faut bien le reconnaître, ce temps n’est pas celui des marchés.
Devons-nous, de fait, céder à la tentation de l’urgence, sans laisser le temps aux gouvernements des pays en difficulté de tenter de concilier pédagogie et efficacité politique ?
Je regrette à ce titre que le message européen soit brouillé, pour ne pas dire parasité, par les déclarations des uns et des autres, au risque de lui faire perdre sa cohérence et surtout de renforcer la pression des marchés sur les pays en difficulté. Jacques Delors dit régulièrement qu’il manque une jambe à l’Union économique et monétaire. Je regrette de constater qu’une voix semble également lui faire défaut : une voix qui tienne un discours tout à la fois apaisant et exigeant, qui soit capable, notamment, de faire cesser ces débats absurdes, et aux relents populistes, sur d’hypothétiques sorties de la zone euro.
Répétons-le, martelons-le, la crise de la dette souveraine n’est pas une crise de la monnaie unique : elle est avant tout une crise de l’endettement public, étendue à l’ensemble de la planète. Elle nous invite à nous réformer. Et si elle offre aussi l’occasion de repenser les contours de la gouvernance de la monnaie unique, elle ne doit en aucun cas se traduire par une ou des exclusions.
Sortons la Grèce de la zone euro et, demain, ce sont Lisbonne, Madrid ou Rome qui subiront un peu plus la rigueur des marchés, c’est l’ensemble du système bancaire européen et, au-delà, nos économies qui en seront affectées, label AAA ou pas !
Nous tentons depuis des mois de proposer, en matière de gouvernance économique, mais aussi au travers des instruments de gestion de crise mis en place, des réponses destinées à éviter ce que les économistes appellent un « effet auto-réalisateur ». Je constate malheureusement que la cacophonie au sein du Conseil européen ou de l’Eurogroupe relativise grandement un tel travail, au point que l’on ne sait plus si ce sont les errements des marchés qui engendrent un discours politique apocalyptique ou s’il s’agit de l’inverse.
Je ne sous-estime pas, pour autant, l’effet boule de neige qui affecte la dette grecque et qui oblige à une prompte prise de décision. Je souhaite à cet égard que le processus de ratification du deuxième plan d’aide défini le 21 juillet dernier arrive le plus rapidement possible à son terme, afin de montrer aux marchés l’unité dont l’Eurogroupe sait faire preuve face aux menaces. Il appartiendra ensuite à nos gouvernements d’affiner ce plan, en ce qui concerne notamment la participation des banques. Il faut en effet que les modalités de celle-ci soient rapidement précisées. Tout effort supplémentaire au-delà des 21 % de décote annoncés doit cependant être précédé de mesures de consolidation du secteur à l’échelle européenne. N’ajoutons pas une crise bancaire aux crises financières locales !
Le renforcement du rôle du Fonds européen de stabilité financière fait également figure de priorité. Les nouveaux pouvoirs dont il dispose – rachat de titres sur le marché secondaire, aide à la recapitalisation des banques, intervention préventive dans les pays ne bénéficiant pas encore d’un programme d’assistance financière – contrastent avec la relative modestie de ses moyens : 440 milliards d’euros sont clairement insuffisants, étant entendu que 140 milliards d’euros environ sont d’ores et déjà dédiés aux plans grec, irlandais et portugais.
Le Fonds, réformé le 11 mars, puis le 21 juillet, est à l’heure actuelle un instrument qui n’a pas les moyens de ses ambitions. J’espère que le Conseil européen permettra d’avancer sur ce point et de proposer des solutions innovantes en vue d’accroître sensiblement sa capacité d’action. Il ne s’agit pas d’augmenter le montant des garanties déposées par les États, mais d’utiliser un effet de levier. Le Fonds pourrait de la sorte se muer en banque ou en assureur.
Ainsi restructuré, le Fonds serait en mesure de répondre aux défis actuels sans attendre la mise en place, forcément lointaine et complexe, de véritables euro-obligations. Il pourrait, de la sorte, être associé à un nouveau programme pour la Grèce.
Loin de moi de prétendre que le plan du 21 juillet est insuffisant. Comme je viens de l’indiquer, il demeure néanmoins imprécis sur certains points et foncièrement optimiste sur d’autres. Je pense notamment aux privatisations. La « troïka » exige d’Athènes qu’elle accélère le programme de vente de ses actifs. Si cette demande est légitime – le gouvernement grec a d’ailleurs lui-même indiqué qu’il espérait en obtenir 50 milliards d’euros d’ici à 2015 –, il convient cependant d’être raisonnable : quel investisseur pourrait aujourd’hui parier sur des actifs grecs ?
Prenant appui sur l’exemple de la réunification allemande, le cabinet Roland Berger préconise le cantonnement de l’ensemble des actifs grecs, puis le rachat de ceux-ci par une structure européenne dédiée. Cela m’apparaît comme une option judicieuse. Le produit de cette vente, estimé à 125 milliards d’euros, offrirait à la Grèce la possibilité de racheter une partie de sa dette. Les investissements réalisés sur ces actifs par la structure européenne en vue d’une prochaine revente permettraient, quant à eux, de relancer l’activité au sein du pays et d’amorcer, enfin, un cercle vertueux.
Le plan du 21 juillet comporte déjà des mesures destinées à la relance de l’activité en Grèce, via notamment la mobilisation des fonds structurels. Il nous appartient sans doute d’aller encore plus loin.
Il n’existe pas de solution miracle pour la Grèce, non plus que pour les autres pays concernés. La base reste la même : discipline budgétaire et adaptation du format de l’État aux exigences financières du temps. Toute réforme sera néanmoins incomplète si elle ne s’appuie pas sur des mesures en faveur de la croissance, sous peine que les malades ne meurent guéris.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ UCR.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, si je ne suis pas anti-européen, je suis en revanche très circonspect devant tous ceux qui voudraient soudainement, au vu des difficultés que traverse l’Europe, étendre son rôle et ses attributions, renforcer ses pouvoirs.
De même, si je ne suis pas un farouche opposant à la mondialisation, je crois qu’il faut rester très prudent face à celle-ci. D’ailleurs, si l’on avait été par le passé plus prudent sur cette question, nous n’en serions peut-être pas là où nous en sommes aujourd'hui !
Je déplore que, dans l’effervescence des avis formulés à droite comme à gauche, on persiste à expliquer que l’idéal réside toujours dans la mondialisation et dans encore plus d’Europe. Il me semble que ceux qui ne partagent pas tout à fait cette analyse ont une vision tout aussi respectable, et qu’ils n’ont pas nécessairement à être taxés de populisme !
Je dois d’ailleurs vous dire, monsieur le ministre, que dans « populisme » on retrouve la même racine que dans « populaire » ! À tous ceux qui ricanent et se moquent de la prudence d’élus qui, comme moi, souhaitent agir avec beaucoup de circonspection quand il s’agit d’Europe et de mondialisation, je donne rendez-vous à l’élection présidentielle de l’année prochaine. Il sera alors intéressant d’additionner, d’un côté, les voix obtenues par les candidats – plutôt que par les partis, qui seront peu nombreux –, de droite comme de gauche, à fond « pro-européens » et « pro-mondialisation » et, de l’autre, les voix de ceux qui sont, au contraire, plus réservés sur ces deux domaines. Il n’est d’ailleurs pas exclu qu’au second tour de l’élection présidentielle nous ayons à choisir, non pas entre un « pro-européen » farouche et un « pro-européen » jusqu’au-boutiste, mais plutôt entre un candidat qui désire continuer comme si de rien n’était, sans se rendre compte que tout ce qui a été fait jusqu’à présent n’est pas la bonne solution, et un autre qui considère qu’il est temps de songer à des solutions nouvelles.
Pour ma part, je ne crois pas possible de dire que, quand tout va bien, c’est grâce à l’euro, et que, quand tout va mal, c’est la faute à personne !

Le problème est beaucoup plus complexe que cela. En la matière, les réponses à apporter ne peuvent arbitrairement présenter comme obligatoire une direction et comme impossibles toutes les autres ! Il est nécessaire, me semble-t-il, de réfléchir plus avant.
Ce n’est pas à l’insuffisance du pouvoir européen de porter la responsabilité des difficultés actuelles, mais plutôt aux fautes commises par les différents États membres. Il faut tout de même être clair : qui est responsable de la situation grecque, sinon d’abord les Grecs eux-mêmes, qui ont trafiqué leurs comptes et sont allés dans le mur tout en sachant très bien qu’ils y allaient ?
Au lieu de nous dire qu’il faut plus d’Europe pour que cela aille mieux, je pense donc qu’il faut d’abord mettre chacun face à ses responsabilités.
En la matière, la stratégie de l’Allemagne est beaucoup plus pertinente que celle de la France. On ne peut pas laisser les États faire n’importe quoi ! Cela vaut pour la Grèce, mais, à bien y réfléchir, on pourrait également l’appliquer à la manière dont la France a été gérée au cours des cinq dernières années, notamment par comparaison avec l’Allemagne.
La situation économique de notre voisin d’outre-Rhin et l’état de ses comptes publics le placent à l’abri de toute dégradation de sa note souveraine et en font un pôle de solidité, un roc, au sein de l’Union européenne.
Si la France ne se trouve pas vraiment dans une situation catastrophique, on ne peut tout de même pas dire qu’elle se porte bien ! Nous sommes, nous aussi, confrontés à une crise de la dette souveraine qui soulève de vives inquiétudes. Et cette situation résulte probablement de la politique qui a été menée au cours des cinq dernières années : si je devais comparer le budget de l’État à une baignoire, je dirais qu’on a fermé le robinet d’arrivée d’eau tout en augmentant le débit de la vidange !
Comme à son habitude, le Président de la République a fait très fort et, comme à son habitude, il essaie à présent de s’en tirer par des gesticulations… Ce sera vraisemblablement encore le cas lors du prochain Conseil européen !
Personnellement, je pense que les réponses relèvent avant tout de la responsabilité des États ! Ainsi, je le répète, c’est d’abord aux Grecs d’assumer les conséquences de la situation calamiteuse de leur pays !

Mais nous devrions sans doute nous interroger nous-mêmes et chercher à améliorer la gestion de notre pays !

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais d’abord formuler deux observations.
Premièrement, c’est lundi ou vendredi prochains que nous aurions dû avoir ce débat. En effet, nous sommes aujourd'hui invités à prendre part à un débat préalable au Conseil européen sans connaître les propositions qui seront inscrites à l’ordre du jour : nous avons simplement été informés des grands thèmes qui seront abordés. Vous n’y êtes certes pour rien, monsieur le ministre, mais voilà tout de même une bien curieuse manière de travailler !

Deuxièmement, notre feuille de route, aujourd'hui, c’est pour l’essentiel l’accord qui a été conclu entre les États le 21 juillet. Or cet accord est en grande partie dépassé : nombre d’événements sont intervenus depuis. Il faudrait donc le réviser.
En outre, nous ne sommes même pas certains qu’il entre un jour en vigueur. La Slovaquie, paraît-il, traîne des pieds pour l’adopter. Qu’adviendra-t-il si elle ne le vote pas ? Existe-t-il un « plan B », pour reprendre une formule désormais consacrée, face à la crise économique et financière, notamment en Grèce ?
Toujours à propos de l’accord du 21 juillet, je souhaite vous poser deux questions, monsieur le ministre.
D’une part, vous avez parlé de gouvernance économique européenne, et je m’en réjouis ; vous avez même employé l’expression de « fédéralisme économique », pourtant désormais bannie du vocabulaire : plus personne n’ose aujourd'hui utiliser le mot « fédéralisme », sauf à risquer d’être condamné à la déportation !
Sourires

Mais, dans les faits, en quoi consistera cette gouvernance économique européenne ? Si j’ai bien compris, les chefs d’État se réuniront deux fois par an pour débattre des questions économiques, sous la direction de M. Van Rompuy. C’est une bonne initiative. Mais quels pouvoirs auront-ils concrètement ?
En d’autres termes, quelle sera la nature du fédéralisme que vous appelez de vos vœux, ce en quoi je vous rejoins ? Il faudrait de nouveaux transferts de souveraineté en matière économique et financière, afin de permettre une prise effective de décisions et de ne plus tergiverser, comme c’est le cas actuellement. Nous voyons bien que le calendrier, les modes de fonctionnement, les procédures et, plus généralement, les institutions en vigueur ne sont pas efficaces. Nous ne pouvons plus nous permettre d’attendre le bon vouloir du parlement slovaque pour agir alors qu’il y a le feu dans la maison !
Pourriez-vous donc nous donner quelques éclaircissements sur la gouvernance économique ?
D’autre part, j’aimerais que vous nous apportiez également des précisions supplémentaires concernant la taxe sur les transactions financières. Nous nous réjouissions que vous ayez avancé cette idée. Nous l’avons nous-mêmes portée pendant de nombreuses années. Que n’avons-nous entendu lorsque nous plaidions pour la taxe Tobin ! On nous traitait alors de « doux rêveurs »… À présent, tout le monde défend cette proposition. Tant mieux ! Mais comment comptez-vous la mettre en œuvre ? Vous avez raison de dire que l’Europe devrait instituer une telle taxe même si elle était la seule à le faire. Mais quelle en sera l’assiette ? Quel en sera le taux ? Vous avez avancé le chiffre de 0, 005 %. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Beaucoup a été dit sur les banques. Je me réjouis du rapprochement des points de vue entre l’Allemagne et notre pays, ce qui n’était pas du tout acquis voilà encore une semaine. La France traînait les pieds, affirmant qu’il n’était pas nécessaire de recapitaliser nos banques. Apparemment, les positions ont évolué. Je ne sais pas s’il faut y voir un « effet Dexia », mais j’observe que la France est aujourd'hui prête à une action forte en matière de recapitalisation.
À mon sens, c’est d’abord sur le bilan des banques qu’il faut agir. Je suis un partisan de la séparation des banques commerciales et des banques d’affaires. Je sais bien qu’une telle idée ne fait pas l’unanimité, mais je pense qu’elle offre beaucoup d’avantages. D’ailleurs, les Britanniques, qui ne sont tout de même pas des enfants en matière de finance, l’ont eux-mêmes retenue. Je crois que nous devrions en faire autant. J’ajoute que, s’il faut faire baisser le bilan des banques, cela doit porter non pas sur le volet « prêts aux entreprises », mais plutôt sur le volet « spéculation et outils dérivés ».
Il faut également accélérer la mise en œuvre – je crois qu’elle est en cours – des normes de Bâle III sur les ratios de solvabilité des banques. Les banques doivent être encouragées à réinjecter leurs bénéfices dans leur capital au lieu de les distribuer très largement. On peut comprendre qu’elles en redistribuent un peu, mais elles doivent prioritairement renforcer leur capital, et peut-être aussi appeler leurs actionnaires à souscrire. Ensuite, et ensuite seulement, on pourra envisager un appel à la puissance publique.
À cet égard, nous défendons – c’est ce que vous avez esquissé – une démarche européenne coordonnée, en vue d’une politique similaire dans les différents pays. Au besoin, cela pourrait passer par le Fonds européen de soutien financier, même si les Allemands ne veulent pas en entendre parler pour l’instant. D’aucuns avancent les chiffres de 200 milliards d’euros ou 300 milliards d’euros ; je pense qu’il faudrait être plus précis.
Par ailleurs, sur la situation économique générale, je suis tout de même assez pessimiste. Il faut avoir bien conscience que nous sommes au bord de la récession. Notre croissance a été nulle au troisième trimestre et sera de 0, 2 % au quatrième trimestre !
Et c’est pareil en Allemagne ! On érige souvent les Allemands en modèles. Il est vrai qu’ils ont beaucoup de vertus, malgré quelques menus défauts.
Sourires

Et il n’y a pas lieu de s’en réjouir, car cela signifie que c’est l’ensemble du moteur économique européen qui est en panne !
Le fameux système allemand, fondé sur les exportations de l’Allemagne vers le reste de l’Union européenne, est en fait en train de se gripper. Inutile de dire que, avec cinq points de croissance en moins chaque année, les Grecs n’achèteront plus guère de produits allemands ! Pas besoin de sortir de Polytechnique pour comprendre ça !
Par conséquent, monsieur le ministre, je vous le redis, nous plaidons pour une politique de relance maîtrisée. Certes, et nous en sommes bien conscients, il faut agir sur les déficits, mais il faut aussi relancer la machine économique. D’autant que l’inflation rôde ! Heureusement, la Banque centrale européenne veille. Mais, pour cette année, la prévision d’inflation est de 2, 3 %. En clair, avec un taux de croissance de 1, 4 % ou de 1, 5 %, nous sommes en réalité en croissance négative ! Il faut donc agir.
S’agissant de la Grèce, nous avons beaucoup tardé à prendre des mesures ; d’ailleurs, il faut reconnaître que ce n’est pas essentiellement la faute de la France. En vérité, nous faisons trop peu et trop tard, et c’est bien pourquoi la situation ne fait qu’empirer. Car il faut tout de même imaginer ce que vivent les Grecs ! On peut évidemment les critiquer, mais n’oublions pas la gravité de leur situation et ce qui en résulte sur leurs conditions de vie !
À mon sens, il faut demander aux banques de prendre leur part du fardeau. Le Conseil européen avait négocié un accord autour de 20 % pour la prise en charge de la dette grecque. Si vous me demandez mon avis, monsieur le ministre, je vous dirai qu’il faudrait sans doute porter ce chiffre à 50 %.
Sourires

En outre, il faut envisager que le Fonds européen puisse aussi servir pour la Grèce, même si cela implique sans doute quelques changements. Certains évoquaient tout à l’heure la possibilité de l’utiliser comme banque ; mais, comme ce n’est pas une banque, il faudra probablement modifier ses statuts. D’autres solutions existent, mais je n’entrerai pas dans les détails. Je dirai simplement qu’il est urgent d’agir !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste–EELV et sur quelques travées du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi de souligner, et ce n’est pas une clause de style, que nous venons d’assister à un débat de grande qualité, riche et approfondi. Il est de bon augure pour l’action de la France que les parlementaires soient aussi intéressés par le débat européen et qu’ils s’expriment avec autant de compétence sur les dispositifs à mettre en place !
Je sais que nous allons avoir un débat interactif et spontané, et j’ai cru comprendre que nombre d’entre vous avaient l’intention d’y prendre part : ma réponse pourra donc être relativement brève. Néanmoins, je voudrais insister sur quelques points, même si certains ont déjà été soulignés.
D’abord, ce qui est en cause, ce n’est pas l’euro en tant que monnaie, non plus que l’Europe en tant que construction politique ; ce qui est en cause, c’est la crise de la dette souveraine d’un certain nombre de pays de la zone euro.
Depuis ma jeunesse – donc depuis un certain temps
Sourires
Pour lutter contre un tel phénomène, nombre de démocraties – je serais tenté de dire « de vieilles démocraties » – ont cherché à alimenter la croissance par la dette, dans une démarche relavant de la fuite en avant. Aujourd'hui, cette dette n’est plus soutenable. À l’origine, la crise était essentiellement bancaire ; à présent, nous sommes face à la menace de faillite d’État.
En outre, et plusieurs d’entre vous l’ont relevé, le temps de la finance n’est pas celui de la politique. Le temps de la spéculation se mesure en secondes. Le temps de la politique, c’est le temps du débat public, le temps du choix du peuple souverain et le temps de la discussion parlementaire. En plus, comme le système démocratique est « morcelé » – il y a plusieurs États –, il est logique que la réponse démocratique tarde parfois à venir.
Par ailleurs, de toute évidence, le couple franco-allemand, qui n’est pas illégitime historiquement et est légitime économiquement puisqu’il représente 55 % du PIB de la zone euro, est à même d’apporter une réponse coordonnée à la situation actuelle. D’ailleurs, lorsque ce couple ne se réunit pas, on le lui reproche, et quand il le fait on lui demande pourquoi il n’a pas convoqué les vingt-cinq autres pays de l’Union européenne pour prendre leur avis !
Vos interventions l’ont souligné, nous nous trouvons à la croisée des chemins. Nous n’avons pas le droit de reculer : l’histoire ne « se rembobine » pas. Nous n’avons pas non plus le droit de rester immobiles. Nous sommes obligés d’avancer. Le tout est de savoir dans quelle direction, en franchissant quelles étapes et en nous fixant quels objectifs.
Mme Morin-Desailly a évoqué le déficit de la balance commerciale française et les problèmes de change. Le déficit commercial n’est pas une fatalité en soi : il dépend de notre compétitivité.
Nous nous rendons bien compte que la Chine, en vingt ans, a déséquilibré la balance commerciale de la zone euro de 2 500 milliards d’euros. Et comment accepter un système – c’est là l’autre erreur – qui prévoit la mise en place d’une monnaie unique sans prévoir le pilotage économique de celle-ci ?
M. Jean Leonetti, ministre. Nous pouvons toujours battre notre coulpe et regretter nos fautes, mais nous pouvons aussi chercher à corriger nos erreurs. Oui, l’Europe doit cesser d’être naïve et devenir plus réaliste. Oui, l’Europe à la monnaie unique doit se doter d’un outil qui pilote cette monnaie. Oui, l’équilibre est l’élément essentiel. Le juste milieu – je ne le dis pas en raison de mon positionnement politique
Sourires
En n’alliant pas la discipline à la solidarité, on manque l’objectif et on aboutit à la misère pour les peuples.
La solidarité sans la discipline conduit à la faillite des États.
Il est donc indispensable de garder à l’esprit un double objectif : à la fois un objectif de croissance – vous avez raison, madame, la croissance doit être obligatoire – et un objectif de rigueur. Comment organiser un « paquet » qui efface l’impression d’indécision politique et de retard permanent qu’un certain nombre d’entre vous ont justement dénoncée ? Comment éviter que l’action menée ne soit immédiatement détruite ou que la décision pourtant prise à l’unanimité ne devienne obsolète ? Effectivement, la Slovaquie ne s’est pas encore décidée et se prononcera aujourd’hui.
Permettez-moi d’être un brin optimiste : en l’espace de quelques semaines, nous sommes parvenus à parler de gouvernement économique européen. Nous sommes arrivés de façon presque consensuelle à évoquer la taxation des transactions financières. Nous avons pu, sans risquer le goulag, parler de fédéralisme économique.
Sourires
Bref, la construction européenne avance et un certain nombre d’idées ont acquis droit de cité, même si elles ne font pas toujours l’unanimité. S’il y a ici et là du populisme, il n’est pas nécessairement populaire, et s’il y a beaucoup d’euroscepticisme, chaque citoyen a bien compris que soit nous avançons vers une organisation économique européenne, soit nous serons détruits par les marchés.
Qui est le plus souverain aujourd’hui ? La France, avec un triple A, qui cherche à mettre en place un gouvernement économique européen, ou la Grèce, qui se trouve obligée de prendre des mesures sans passer par un débat démocratique ? La Grèce n’a pas le choix, comme je l’ai entendu dire, entre la démocratie ou l’Europe. Elle a le choix entre l’Europe et la misère ! Ne vous y trompez pas, si la Grèce sortait demain de la zone euro, sa monnaie serait dévaluée de 40 % et le niveau de vie des Grecs s’affaisserait jusqu’à les réduire à la misère.
Il y va de notre devoir de solidarité d’aider la Grèce, mais il y va aussi de notre intérêt : si nous n’aidons pas ce pays à rester dans la zone euro, si nous le laissons sur le bord du chemin, la crise pourrait, par effet de domino, gagner progressivement l’Espagne, le Portugal et peut-être même la France…
… ou l’Allemagne, qui ne sont pas non plus à l’abri de ce genre de péril.
M. Jean Leonetti, ministre. Après cette réponse globale, je vais avoir quelques difficultés à vous répondre individuellement.
Sourires
J’ai entendu parler du problème du « levier », mais je ne sais pas ce qu’est, en l’occurrence, un levier ! S’agit-il de la possibilité de créer, avec 440 milliards d’euros, un fonds supplémentaire grâce aux marchés annexes privés ou à un mécanisme particulier qui assimilerait le Fonds européen de stabilité financière à une institution bancaire ?
On nous reproche d’aller lentement et de céder à la complexité. Ne pouvons-nous pas essayer de trouver des solutions dans le cadre du traité de Lisbonne et de la décision qui a été prise le 21 juillet dernier, puis ratifiée par tous les parlements, même si ce fut parfois au prix de quelques difficultés ? Voyez les complications qu’il y a eu au Bundestag. Trouvez-vous logique de revenir sur ce qui vient d’être décidé si péniblement par l’ensemble des Vingt-sept au motif que le dispositif serait incomplet ?
Dans la période que nous traversons, nous devons faire preuve de beaucoup de sang-froid et nous montrer réactifs. Le sang-froid, cela consiste à dire : oui, nous voulons aller vers une intégration plus forte, oui, nous voulons trouver des mécanismes de solidarité qui ne soient pas mis en péril par une banque ni à plus forte raison par un État, même si les dirigeants de celui-ci ont commis des erreurs, car ce qui est en jeu, c’est l’épargne européenne et la stabilité monétaire européenne.
Rappelez-vous Lehman Brothers. Parce que cette banque a fauté, le gouvernement américain a estimé qu’il fallait la laisser couler, pour l’exemple. Puis la contamination a gagné le monde. Si vous avez aimé Lehman Brothers, vous allez adorer l’abandon de la Grèce ! Cet abandon sera celui de tous les pays de la zone euro, puis l’abandon de l’Europe, puis la livraison au marché spéculatif de tous les États démunis. C’est pourquoi nous devons faire preuve de rigueur et de solidarité.
J’approuve l’idée d’accélérer le mouvement : nous devons aller plus vite et plus loin. Il ne faut pas plus d’Europe, il faut une Europe qui fonctionne mieux. L’Europe s’est élargie lorsque sont tombés les totalitarismes marxistes et fascistes. Lorsque la Grèce, le Portugal et l’Espagne ont pris le chemin de la démocratie, nous avons pensé qu’il suffisait que ces pays entrent dans l’Europe pour qu’ils connaissent la croissance. Idem pour les pays de l’Est. Comment aurions-nous pu envisager de leur dire : « Vous avez subi le totalitarisme pendant des années ; maintenant vous allez attendre aux portes de l’Europe à la fois la démocratie et la croissance, car vous n’êtes pas prêts » ?
Aujourd’hui, nous devons assumer nos choix, car ils se résument au choix de la démocratie. Il convient néanmoins d’apporter quelques modifications pour que la zone euro soit un véritable pendant de la zone dollar, que l’euro soit un pendant du yuan et que l’Europe puisse avoir une politique économique spécifique. L’Europe n’a pas à donner aux autres un modèle à copier, mais elle n’a pas non plus à renier le modèle de solidarité et de liberté qu’elle a construit. Nous avons choisi un capitalisme d’entrepreneurs et non un capitalisme de spéculateurs.
Nous devons donc trouver les outils pour corriger nos erreurs : il y va non seulement de l’avenir de l’Europe, mais également des valeurs auxquelles nous sommes attachés. C’est la raison pour laquelle nous devons effectivement, monsieur Humbert, défendre la Grèce autant avec le cœur qu’avec la raison.
M. Baylet a évoqué les eurobonds. Lorsque la situation sera stabilisée, il sera légitime de faire converger l’ensemble des économies et des fiscalités. Si nos économies et nos fiscalités convergent, si nous nous dotons d’un pacte de stabilité et d’un outil comme le Fonds européen de stabilité financière, et si nous instaurons un pilotage, alors oui, à ce moment-là, nous pourrons sans crainte envisager les eurobonds puisqu’ils ne pourront pas susceptibles d’entraîner la dégradation de la note des pays les plus forts. Aujourd’hui, de toute évidence, proposer de mutualiser une dette qui n’est pas stabilisée, c’est mettre la charrue devant les bœufs. Cependant, dès que la dette sera stabilisée, on pourra passer à l’étape suivante.
Monsieur Masson, vous avez tenu à préciser que vous n’étiez pas anti-européen. Ça tombe bien, moi non plus ! Mais le choix ne peut pas être entre le populisme, de droite ou de gauche, et ceux selon qui il faudrait toujours aller vers plus d’Europe. En réalité, nous avons besoin d’outils européens plus performants et qui aient du sens. L’Europe doit se construire sur la stabilité économique parce que c’est elle qui garantit la pérennité de nos valeurs.
M. Yung a évoqué le fédéralisme. Je serai probablement déporté avec lui !
Sourires
Cela étant, nous serons en bonne compagnie puisque Jacques Chirac a également, un jour, me semble-t-il, évoqué cette idée, tout comme l’actuel Président de la République, Nicolas Sarkozy. Nous pourrons donc discuter ensemble, dans des terres lointaines et isolées, du fédéralisme économique…
Nouveaux sourires.
Quoi qu’il en soit, la situation actuelle peut être l’occasion de réfléchir à des outils.
S’agissant de la taxation sur les transactions financières, ne me demandez pas de me prononcer sur un taux, car je ne veux pas qu’on dise un peu partout que le ministre chargé des affaires européennes a affirmé que le taux serait de tant. Vous ne me ferez pas non plus me prononcer sur l’assiette de cette taxe. Je dirai seulement que nous ne sommes pas restreints. En dehors des règles européennes qui empêchent le passage des liquidités, aucune restriction ne vient limiter l’assiette de la taxation sur les transactions financières.
Cela dit, si la France seule décidait d’instaurer une telle taxe, non seulement elle se trouverait isolée, par définition, mais cela entamerait l’idée que nous nous faisons de l’Europe. Je ne doute pas que la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et un certain nombre de pays soient capables de s’entendre en fixant un taux suffisamment bas pour éviter les déplacements de nos marchés financiers.
Je veux dire un mot de la réforme institutionnelle. Comment mettre en place le fédéralisme économique ? En organisant deux fois par an des rencontres entre chefs d’État et de gouvernement, mais c’est insuffisant. En donnant plus de pouvoir à Écofin ; c’est déjà mieux. En instaurant un pilotage du Fonds européen de stabilité financière qui, en coordination avec la BCE, soit capable d’intervenir plus rapidement et indépendamment des décisions de chaque État ; ce serait une étape supplémentaire. À terme, bien sûr, il faudrait que cette organisation puisse agir de façon autonome à partir de directives politiques tracées de manière consensuelle par l’ensemble des chefs d’État et de gouvernement de la zone euro.
Tels sont les éléments de réponse, bien modestes, que je peux apporter aux questions que vous m’avez posées.
Vous m’avez dit, madame, que je n’avais pas réponse à tout. En effet, et j’oserai dire que c’est heureux ! Mais j’ai l’intime conviction que l’Europe est en train de franchir une étape décisive.
On peut imaginer le chaos : une destruction générale, nos économies à terre et, de propagation en contamination, la chute dans la récession.
On peut aussi imaginer que de ces difficultés naîtra quelque chose de nouveau, une autre Europe, une Europe avec des frontières, une Europe qui arrête de s’étendre et qui s’approfondit, une Europe qui retrouve ses valeurs et son sens, une Europe qui décide de ce qu’est son économie : non pas seulement des marchés financiers, mais aussi un socle de solidarité et une croissance au service de l’emploi.
Je suis persuadé que la plupart d’entre vous, sur l’ensemble des travées, partagez ma conviction.
Le Conseil européen va se réunir le 23 octobre : je ne doute pas qu’il ait l’ardente obligation de décider. C’est cette obligation de décider qui a toujours fait avancer l’Europe.
On dit souvent que l’Europe avance étape par étape, presque de crise en crise. Avec la crise que nous avons subie et que nous subissons encore, nous pouvons franchir une grande étape. Et nous pouvons peut-être la franchir ensemble.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ UCR.
M. Jean-Léonce Dupont remplace M. Jean-Pierre Bel au fauteuil de la présidence.

Nous allons maintenant procéder au débat interactif et spontané, dont la durée a été fixée à une heure par la conférence des présidents.
Chaque sénateur peut intervenir pour deux minutes au maximum. S’ils sont sollicités, le Gouvernement ou la commission des affaires européennes pourront répondre.
La parole est à M. Yannick Vaugrenard.

Monsieur le président, mes chers collègues, j’ai écouté les propos de M. le ministre avec beaucoup d’attention. Je ne vois pas comment nous pourrions être en désaccord avec un certain nombre d’entre eux.
C’est notamment le cas lorsque vous dites, monsieur le ministre, que l’Europe et le monde sont à un tournant de leur histoire, qu’il est nécessaire d’avoir une discipline budgétaire et qu’une solidarité est tout autant indispensable. C’est aussi le cas lorsque vous parlez d’une croissance forte.
Là où le bât blesse, c’est lorsqu’il m’apparaît que votre discours européen, dont on peut comprendre certains aspects, est en décalage total avec la politique aujourd’hui menée dans notre pays. Dès lors, la crédibilité de la parole française me semble mise en cause.

Je veux en prendre quelques exemples.
Lorsque vous choisissez de taxer seulement les revenus supérieurs à 500 000 euros à hauteur de 3 % – vous avouerez que ce n’est pas grand-chose –, vous demandez peu à ceux qui ont beaucoup et beaucoup à ceux qui ont peu !
Comparons avec d’autres pays : au Royaume-Uni, les hauts revenus sont taxés de manière spécifique à partir de 175 000 euros ; en Allemagne, Angela Merkel a instauré une tranche supplémentaire d’impôt sur le revenu au taux de 45 %, au lieu de 42 %. Il est clair que, dans ces pays, s’instaure une solidarité humaine indispensable : on ne peut pas demander une solidarité entre les pays européens sans demander une solidarité à l’intérieur de chaque pays, y compris le nôtre, entre ceux qui ont beaucoup et ceux qui ont très peu.
Vous avez aussi parlé de croissance forte. Comment est-ce possible lorsqu’on vient d’imposer aux mutuelles, et donc à leurs adhérents, une taxation supplémentaire qui rapportera un milliard d’euros à l’État et dont il résultera une diminution de la consommation intérieure, donc de la croissance ? Là encore, il y a un décalage entre ce qui est dit au niveau européen et la réalité de la politique pratiquée dans notre pays.

M. Yannick Vaugrenard. C’est la raison pour laquelle, si nous ne changeons pas de politique en France, si nous n’instaurons pas une plus grande solidarité humaine et territoriale, les propos que nous tiendrons au niveau européen n’auront pas de crédibilité !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste–EELV et du groupe CRC.
M. Jean Leonetti, ministre. J’ai bien compris, monsieur Vaugrenard, la tactique à laquelle obéit votre question : pour me faire répondre sur le plan européen, vous m’attirez, si j’ose dire, sur le « marché intérieur ».
Sourires
Pour essayer de vous répondre, je veux d’abord vous dire qu’il est très difficile de faire des comparaisons entre pays européens, qu’ils appartiennent ou non à la zone euro. Par exemple, il est difficile de comparer les systèmes de retraite respectifs de l’Allemagne et de la France. De même, il est difficile de comparer les taux de la taxe sur la valeur ajoutée en Grande-Bretagne et en France. On peut aussi rappeler qu’il existe chez nous un impôt de solidarité quand d’autres pays ont fait le choix de ne pas en instaurer un.
Autrement dit, une comparaison entre les pays européens nécessite une étude beaucoup plus approfondie que celle sur laquelle votre propos repose.
Ainsi, s’agissant des mutuelles, à lire le rapport qui leur a été consacré, on se rend compte que beaucoup d’entre elles – pas toutes, mais beaucoup – ont des marges de manœuvre très importantes, et que la solidarité pourrait aussi consister pour elles, plutôt qu’à accumuler du capital, à pratiquer une redistribution.
Quant à savoir qui sont les riches, je ne me risquerai pas à proposer ici un seuil. Un jour, un candidat potentiel avait dit qu’on était riche à partir de 4 000 euros par mois : une polémique inextinguible s’était ensuivie…
Soyons donc prudents lorsque nous voulons comparer des pays du point de vue de leur système social et de solidarité. La France consacre à la solidarité trois points de PIB de plus que tous les pays de la zone euro. Au sein de l’Union, elle se situe même devant la Suède ! Son système de solidarité interne n’a donc rien à envier à celui de ses partenaires.
Par conséquent, comparons ce qui est comparable et, si vous le voulez bien, revenons au débat européen sur la solidarité et la rigueur.
Lorsque, en France, nous créons de la croissance grâce à des dépenses d’avenir combinées à une rigueur budgétaire, nous obtenons le fameux triple A et nous ouvrons des perspectives pour la recherche et l’emploi. Lorsque nous tenons effectivement l’objectif fixé d’un déficit à 5, 7 % du PIB, et que, dans ce but, pour trouver un milliard d’euros supplémentaires, nous faisons supporter l’effort à 87 % par les entreprises et les personnes les plus favorisées, c’est aussi une forme de solidarité que nous mettons en œuvre.
Ne m’entraînez donc pas dans un débat qui m’obligerait à vous répondre de manière très incomplète et avec beaucoup moins de compétence que François Baroin !
Sur l’ensemble des sujets européens, gardons à l’esprit l’exigence d’équilibre entre la rigueur budgétaire et la solidarité, la croissance et la stabilité.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant de poser trois questions, je veux revenir brièvement sur le programme d’aide aux plus démunis.
Nous nous étions permis, au sein de la commission des affaires européennes, d’interpeller le président Barroso en juin dernier. Il ne nous a toujours pas répondu ; ce n’est pas convenable puisque le traité de Lisbonne lui donne trois mois pour nous répondre : il serait donc temps qu’il le fasse !
Je connais votre engagement, monsieur le ministre, ainsi que celui du ministre de l’agriculture. J’aimerais savoir où vous en êtes concernant le programme européen d’aide aux plus démunis et si vous avez convaincu les six États membres qui constituaient la minorité de blocage.
Ma deuxième question a trait à la protection des épargnants et à l’encadrement des activités dites « à risque ». Je me réjouis que la réglementation européenne ait enregistré des avancées en ce qui concerne le secteur bancaire. Au-delà de l’indispensable stabilisation financière, il s’agit aussi de faire bénéficier les épargnants d’une forme de protection face aux activités considérées comme risquées, notamment les activités de trading. Où donc en êtes-vous, monsieur le ministre, au sujet de la séparation nette – qui a été réalisée dans certains pays anglo-saxons – entre les activités de trading pour compte propre et les autres activités ?
Ma dernière question porte sur le principe de réciprocité ; elle me permet de prolonger les propos de notre collègue Daniel Raoul, que je remercie et félicite d’avoir cité certains extraits du rapport de la commission des affaires économiques sur l’OMC.
Je rappelle que la commission des affaires européennes avait, à plusieurs reprises, préparé un rapport sur la préférence communautaire, en considérant que, depuis le traité de Rome de 1957, celle-ci n’était plus qu’un principe incantatoire, pour ainsi dire supplanté par les règles de l’OMC applicables au commerce international.
Je me réjouis que nous puissions enfin mettre tout cela en musique. Nous avons seulement à assembler les éléments du puzzle : clauses de sauvegarde, accord de l’OMC sur les normes phytosanitaires, dit SPS, passerelles avec l’Organisation internationale du travail.
Je pense que cette réponse est la bonne. Je la crois bien plus pertinente que les théories sur la « démondialisation » : à mon avis, ceux qui prônent la démondialisation méconnaissent profondément le sujet – ce qui est pardonnable –, ou bien cèdent à des tentations de populisme – ce qui est plutôt méprisable.
Je voudrais donc savoir où en sont vos négociations avec M. Pascal Lamy, directeur général de l’OMC. Pour ma part, je dis très clairement que je ne suis pas du tout favorable à une conclusion du cycle de Doha : 2001, c’était il y a très longtemps et nous sommes allés beaucoup trop loin – je rejoins sur ce point Daniel Raoul – dans les concessions faites en matière agricole.
M. Jean Leonetti, ministre. M. Bizet me pardonnera, mais l’ayant souvent rencontré dans sa fonction de président de la commission des affaires européennes, en quelque sorte au-dessus de la mêlée, je m’étonne de le retrouver aujourd'hui presque perdu dans l’hémicycle !
Sourires. – Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s’exclame.
Nouveaux sourires.
À propos du programme européen d’aide aux plus démunis, ou PEAD, vous savez que la campagne hivernale de 2011 est assurée.
Vous savez aussi que ce sont les surplus de la PAC qui servaient à l’alimentation du fonds destiné aux plus démunis. Lorsque ces surplus ont cessé d’exister, une décision de justice nous a interdit de continuer à en acheter – ce que faisait l’Europe.
Il se trouve que, plus qu’un problème financier et économique, il s’agit pour l’Europe d’un problème d’image. Même si ce n’est pas tout à fait vrai, le grand public dira : « Comment, on peut donner des milliards à des banques et on ne peut pas donner quelques millions aux plus pauvres d’entre nous ? »
Cette situation est intolérable.
Le Président de la République et le Premier ministre ont confié à Bruno Le Maire et à moi-même la mission de trouver des solutions.
Je reviens du Luxembourg, où j’ai revu ce matin mes homologues tchèque, allemand et danois. Comme vous le savez, les Danois ont changé de majorité : peut-être nous trouverons-nous, de ce fait, dans une situation plus favorable.
Vous savez aussi que le dernier Conseil des ministres de l’agriculture a essayé de trouver une solution en créant deux lignes budgétaires distinctes : l’une consacrée à la solidarité, l’autre à l’agriculture. Mais devant l’échec probable de cette tentative, Bruno Le Maire a préféré reporter l’examen de cette question au 20 octobre.
Sachez, monsieur le sénateur, que nous sommes déterminés à trouver une solution. Nous ne laisserons pas les plus démunis d’entre nous sans aide européenne. C’est encore un sujet que j’ai évoqué ce matin devant le président Van Rompuy. Je suis sûr que nous arriverons finalement à trouver d’abord une solution permettant d’assurer la continuité pour les deux prochaines années, puis à définir des mécanismes différents.
S’agissant de la séparation entre banques d’affaires et banques commerciales, je veux vous dire que, lorsque Lehman Brothers tombe, Northern Rock tombe en même temps. Or Northern Rock est uniquement une banque de prêt. Être uniquement une banque d’affaires ou uniquement une banque de crédit n’offre donc pas la garantie d’une situation plus stable.
Cela dit, le débat existe et nous pouvons y réfléchir. Mais ne croyons pas que la mise en place d’une telle séparation nous mettrait nécessairement à l’abri.
En ce qui concerne la réciprocité, j’ai déjà dit qu’il fallait un commerce loyal. Je rappelle qu’il existe une façon de rendre le commerce loyal : imposer une taxe carbone aux frontières. Car il n’est pas normal de contraindre l’ensemble de l’industrie européenne à une démarche vertueuse tout en important des produits dont la fabrication n’a pas supposé le respect des mêmes règles.
Enfin, pour ce qui est de la démondialisation, je vous avoue franchement que je ne saurais pas très bien comment faire pour y parvenir… Mais j'ai cru comprendre que cette question permettrait au moins d’arbitrer entre deux candidats socialistes !
Sourires

J'ignorais que notre collègue aborderait le sujet sur lequel j’ai prévu de m'exprimer, mais, compte tenu de la gravité de la situation et du nombre de personnes concernées, et ce à quelques semaines de l'hiver, il me semble utile de vous interroger de manière plus précise, monsieur le ministre.
Nous sommes maintenant à quelques jours du 20 octobre, date à laquelle le ministre de l’agriculture rencontrera ses homologues européens.
Le contexte européen, évoqué longuement cet après-midi, est bien sûr marqué par une crise économique et financière très sévère qui plonge des millions d’Européens dans les affres de la pauvreté. Cette situation pourrait encore s’aggraver à la suite de la décision de six pays de l’Union européenne de réduire de plus de 70 % l’aide alimentaire européenne distribuée aux plus démunis.
En ce qui concerne notre pays, le Secours populaire français estime que 4, 8 millions de repas risquent de ne pas être distribués à partir de 2012 si le PEAD fait défaut : sur les 700 tonnes de denrées récupérées chaque mois, 21 % proviennent du PEAD.
Cette décision inacceptable, si elle s’appliquait, reviendrait en quelque sorte à imposer une double peine à nos concitoyens, qui subissent déjà les effets de la crise, que la « concurrence libre et non faussée » gravée au cœur des traités européens ne fait qu’amplifier.
Monsieur le ministre, quelles mesures concrètes et précises comptez-vous prendre pour que, à quelques semaines de l’hiver, les plus démunis de nos concitoyens puissent continuer de bénéficier de l’aide alimentaire de l’Union européenne ?
Monsieur le sénateur, je vais m’efforcer de vous apporter des éléments d’information supplémentaires.
Le PEAD représente 400 000 tonnes de denrées alimentaires, qui sont distribuées à 18 millions de personnes, ce qui n'est pas rien ! Le montant de l’enveloppe financière consacrée à ce programme fondé sur l’utilisation des surplus de la PAC est passé de 500 millions d’euros environ à 113 millions d'euros, ce qui correspond à un déficit majeur de près de 400 millions d’euros.
Pour la France, ce changement se révélera relativement neutre dans la mesure où notre pays récupère ce qu'il donne, à savoir entre 60 et 70 millions d’euros. La solution la plus simple – et la plus simpliste ! – consisterait à « nationaliser » l’aide aux plus démunis.
Cela étant, les arguments avancés par nos voisins allemands, qui ont formé le recours devant le tribunal, ne sont pas totalement infondés sur le plan juridique. Dans ce pays, l'aide aux plus démunis relève de la responsabilité des Länder et non de l’État fédéral. De fait, l’importance de cette redistribution est très différente selon les Länder.
Néanmoins, nous avons me semble-t-il réussi à convaincre l'ensemble de nos partenaires européens de la possibilité de trouver une solution équilibrée consistant en une ligne budgétaire relativement réduite au titre de la PAC et une autre au titre de la solidarité.
Ce matin, lors de la réunion qui s’est tenue à Luxembourg, nous avons évoqué la possibilité d’inclure le PEAD dans les fonds de cohésion. Si cette voie devait être suivie, il resterait alors à lever les obstacles juridiques et à surmonter l’opposition d'un certain nombre d'États qui disposent d’une minorité de blocage. Dans cette perspective, nous espérons pouvoir infléchir la position de nos amis tchèques ou danois. Mais, à l’issue de cette réunion, je dois avouer que je fonde de plus grands espoirs sur nos amis danois.

Monsieur le ministre, vous avez évoqué tout à l'heure la volatilité des prix agricoles. Voilà trois mois et demi, j'étais le rapporteur d'une proposition de résolution sur cette question, qui a été adoptée à l'unanimité et que je vous invite à relire. Mais tel n’est pas l’objet de mon intervention, car je souhaite aborder avec vous la position de l’Europe face au changement climatique.
La prochaine conférence internationale sur les changements climatiques se tiendra à Durban à la fin du mois de novembre. Cette conférence s'inscrit dans la continuité de celle qui a eu lieu à Copenhague en 2009, qui avait consacré une rupture dans la logique de construction des négociations internationales sur le changement climatique, et de celle de Cancún, qui s’est tenue l’an dernier et qui n'avait pas pris position sur le prolongement du mécanisme de Kyoto.
La France, sous l'impulsion de l'Union européenne, a mené une politique particulièrement ambitieuse en la matière. De fait, en 2008, dans notre pays, le niveau des gaz à effet de serre était inférieur de 6, 4 % à ce qu’il était en 1990.
Dans ces conditions, il faut que les grandes économies mondiales se mobilisent plus fortement à Durban. Le protocole de Kyoto est le seul outil juridique contraignant. Or les nouvelles puissances économiques que l'on appelle les BRIC – Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud – ont aussi estimé que le prolongement du protocole de Kyoto au-delà de 2012 serait la priorité numéro un de la conférence de Durban. Est-ce aussi votre opinion, monsieur le ministre ?
Le conseil européen des ministres de l'environnement a proposé une position commune sur le prolongement du protocole, mais il semble bien qu'il existe des divergences au sein de l'Union européenne. Ainsi, l’Italie, la Hongrie et les États membres de l'Europe centrale et orientale ont adopté des positions différentes s'agissant notamment du traitement du surplus des unités de quantité attribuées. Pourtant, quand bien même nous respecterions les objectifs fixés à Cancún, nous en resterions à 60 % des efforts nécessaires à accomplir pour que la température du globe n’augmente pas à terme de plus de deux degrés.
Monsieur le ministre, je souhaite vous poser deux questions.
Premièrement, si les engagements actuels sont insuffisants au regard du but à atteindre, est-il possible que l'Europe défende un objectif plus ambitieux de diminution des gaz à effet de serre que celui qui a été fixé à Kyoto ?
Deuxièmement, à l'heure où de nouvelles puissances pointent du doigt certaines mesures de l'Union européenne, telle la proposition que nous avons faite d’introduire l’aviation dans le système des quotas, celle-ci, traversant une crise économique majeure, est-elle aujourd’hui en mesure d'imposer sa politique unilatérale de lutte contre le réchauffement climatique à la Chine et aux États-Unis d'Amérique ?
Monsieur le sénateur, vous avez raison d’affirmer que nous nous trouvons actuellement dans une situation difficile.
Premièrement, le protocole de Kyoto arrive à échéance, alors même qu’il ne portait que sur 16 % des émissions de gaz à effet de serre, l’Union européenne ne représentant, quant à elle, que 11 % de l'ensemble des efforts qui ont été accomplis. Dans ce contexte, essayons d'abord d'intégrer ce qui a été prévu à Cancún en faisant en sorte que soient concrétisées à Durban les ébauches de décision qui ont été prises quant au Fonds vert et au contrôle des émissions de gaz à effet de serre.
Deuxièmement, au moment où le protocole de Kyoto arrivera à échéance en 2012, il faudra éviter tout hiatus en veillant à ce que de nouvelles décisions contraignantes, admises par tous, soient adoptées.
Troisièmement – et vous avez eu raison, monsieur le sénateur, d’évoquer ce point –, si les surplus des unités de quantité attribuées étaient entièrement reportés, l'intégrité de la seconde période s’en trouverait bien évidemment menacée.
La France a pour ambition de parvenir à la conclusion d’un Kyoto II, c'est-à-dire de ménager une période de transition avant l'élaboration d'un système contraignant et universel, et ce sans transiger avec les décisions qui ont été prises à Kyoto.
Vous le savez, de nombreux pays, parmi lesquels l’Inde, le Canada, le Japon, la Russie et les États-Unis, n’ont malheureusement pas fait leurs ces principes. Nous devons donc encore fournir beaucoup d'efforts, mais nous restons intimement persuadés qu’il est vital pour notre planète que la température globale n’augmente pas de plus de deux degrés.

Monsieur le ministre, je souhaite vous interroger sur les petites et moyennes entreprises.
Il est question cet après-midi de l'Europe, mais je considère, pour ma part, que, nous, les Français, nous devons être beaucoup plus solidaires à l’égard de nos 2, 9 millions de PME, qui sont les véritables créateurs d'emplois dans ce pays.
Si l’on établit une comparaison entre notre pays et l’Allemagne, on s'aperçoit que, chez nos voisins, les entreprises de taille intermédiaire, les ETI, et les PME sont quatre fois plus importantes qu’elles ne le sont en France et que leur capacité d'autofinancement est, en moyenne, de deux à trois fois supérieure. Nous devons nous interroger sur cette disproportion.
Sur le plan des rémunérations, les salaires moyens horaires sont à peu près identiques, de l’ordre de 33 euros. En revanche, s’agissant des charges sociales, le différentiel est important, puisque celles-ci sont de 29 % en Allemagne, contre 43 % en France. Il y a là un vrai problème d'équité, qui pose la question de l’harmonisation de la fiscalité au niveau européen.
Par ailleurs, je souhaite attirer votre attention, monsieur le ministre, sur la question de l’information relative à la réglementation communautaire.
En la matière, toutes les propositions émanent de nos collègues allemands et italiens. Les hauts fonctionnaires qui sont chargés de nous défendre et de nous représenter à Bruxelles n’ont aucune volonté d'évoquer ces sujets avec les syndicats professionnels de branche. C'est une erreur manifeste. Les Allemands et les Italiens ont, quant à eux – nous le constatons – un contact presque permanent avec leurs représentants.
Je prendrai un exemple concret, que vous connaissez bien, monsieur le ministre, puisque vous avez fermement défendu ce dossier, ce dont je vous remercie : une réglementation applicable aux entreprises a été récemment adoptée. Les Français en ont été informés voilà seulement un mois, cependant que les Allemands l’avaient été depuis dix-huit mois. Il faut vraiment que cette disparité de traitement disparaisse. C’est la raison pour laquelle il faut demander à ceux qui sont chargés de représenter la France à Bruxelles d'être plus au fait de ces questions et, surtout, d’évoquer ces dernières avec les syndicats de branche.
Alors que j’étais moi-même président d'un syndicat de branche agroalimentaire, je me rappelle avoir eu toutes les peines du monde, dans le cadre de l’IDACE, l’organisation communautaire, à rencontrer nos homologues. Aussi, je souhaite que nos entreprises puissent bénéficier d’un véritable suivi.
Enfin, j’aborderai la question de l'accompagnement au niveau international.
On parle d'exportation, mais j’incline à penser qu’il vaut mieux parler d'internationalisation des activités. Du reste, les Allemands nous en apportent la preuve. Au sein de nos ambassades, nous devons pouvoir trouver des jeunes sachant véritablement insuffler une volonté de compétitivité et d’intégration aux entreprises qu'ils sont censés devoir défendre.

Nous devons faire un effort important pour accompagner des jeunes en contrat d'alternance tout en leur permettant d’intégrer le tissu actif, en défendant l'image de nos entreprises internationales.

Mes chers collègues, je rappelle que chaque orateur dispose de deux minutes pour s'exprimer.
La parole est à M. le ministre.
J'ai rencontré récemment Yvon Jacob, ambassadeur de l’industrie française, avec lequel j'ai eu des échanges sur les sujets que vous avez abordés, monsieur le sénateur.
Assurant deux tiers des emplois et 60 % du chiffre d'affaires total de l'Union européenne, les PME sont effectivement la force économique de l'Europe. C'est dire si nous devons être très attentifs à leur environnement économique et administratif, et analyser, comme vous nous y engagez, monsieur le sénateur, les différences existant entre les capacités exportatrices de notre industrie et celles de nos voisins allemands, différences qui ne sont pas sans incidence sur l'équilibre de notre balance commerciale.
Vous le savez, le Small Business Act, qui a été adopté en 2008 sous la présidence française de l'Union européenne, a permis de mettre en place des mécanismes tendant à faciliter l'accès aux financements et aux marchés et à avoir une meilleure connaissance de l’environnement réglementaire.
Dans le cadre de l’Acte pour le marché unique, sur lequel travaille Michel Barnier, nous devons mettre en place un certain nombre de protections et adopter des mesures d'incitation.
D'abord, il convient de réduire les contraintes administratives. Vous avez été chef d'entreprise dans le secteur de l’agroalimentaire, monsieur le sénateur, et vous avez pu mesurer à quel point l'Europe peut parfois être pointilleuse, voire tatillonne, en édictant des réglementations n’ayant rien à voir avec la défense du consommateur.
Ensuite, il est nécessaire de réviser les directives relatives aux marchés publics, afin que les PME aient un meilleur accès à ces contrats.
Enfin, vous le savez, il est très important d’assouplir les règles communautaires applicables aux PME. C’est pourquoi nous essayons d'infléchir les directives dans le domaine du marché intérieur, pour permettre notamment aux PME d’accéder plus facilement aux fonds européens, pour protéger leurs intérêts commerciaux de la concurrence déloyale que nous avons évoquée tout à l'heure et pour leur garantir plus de souplesse dans l’accès aux petits marchés publics.
Comme vous l’avez indiqué à juste raison, nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir pour faciliter la vie de nos petites et moyennes entreprises et les inciter à devenir exportatrices, en dépit de volumes de production souvent insuffisants.
Par ailleurs, nous devons aussi consentir un effort en matière d’information. Lors de l’élaboration des directives, l’ensemble des acteurs économiques devraient être sollicités en amont, et non pas quinze jours avant que celles-ci ne soient définies, c’est-à-dire lorsque le lobbying auprès des responsables politiques que nous sommes devient quelque peu inefficace.

L’objet de ma question a déjà été abordé, mais, compte tenu de son importance, permettez-moi d’y revenir.
Le programme européen d’aide aux plus démunis permettait jusqu’à cette année d’apporter une aide alimentaire à 13 millions de citoyens des États membres. En France, cette aide se répartit principalement entre quatre grandes associations chargées de l’aide alimentaire : les Restos du Cœur, la Banque alimentaire, le Secours populaire et la Croix-Rouge.
Pour chaque association, on ne le dira jamais assez, ce programme représente un apport crucial en ce qu’il constitue jusqu’à 35 % des denrées alimentaires distribuées. Les aides de ce programme sont donc essentielles à l’action des associations françaises.
Plus largement, et en tant que composante incontournable de l’aide alimentaire en France, le PEAD est aussi l’un des premiers supports de nature à promouvoir l’insertion des publics en situation de précarité.
Sans revenir sur l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a déjà été évoqué, qu’il me soit simplement permis de rappeler que les associations demandent instamment au Gouvernement de soutenir et de faire aboutir rapidement une réforme du PEAD, en prévoyant la création d’un dispositif renouvelé et pérenne, qui inscrirait durablement l’objectif de sécurité alimentaire des populations européennes.
Monsieur le ministre, je sais que vous avez déjà répondu aux interrogations de plusieurs de mes collègues sur ce sujet, mais je tiens à mon tour à vous demander d’être particulièrement vigilant sur la suite à donner à cette question.
Monsieur le sénateur, je ne peux que vous répondre que je suis en mission avec Bruno Le Maire pour faire aboutir ce dossier. Le Président de la République s’est également impliqué au plus haut niveau auprès des autorités allemandes.
J’ai déjà eu l’occasion d’expliquer les difficultés que pose la comparaison entre l’aide aux plus démunis en Allemagne et en France. Je vous rappelle que le tribunal de première instance de l’Union européenne a condamné, en avril dernier, le fait que la distribution des denrées dans le cadre du PEAD se fasse à partir de stocks achetés et non pas des surplus de la PAC. De ce fait, le budget de ce programme chutera en 2012 de 500 millions d’euros à 113 millions d'euros.
La campagne de 2011 est, je le répète, totalement assurée. Les négociations et les efforts que nous avons entrepris avec Bruno Le Maire pour lever les minorités de blocage portent sur la campagne de 2012.
Je le rappelle, lors du dernier conseil des ministres européens de l’emploi et des affaires sociales, la Commission européenne a proposé une révision du règlement du PEAD, ce qui est probablement, à mes yeux, la solution.
Ce règlement s’appuierait désormais sur une double base juridique : la première est celle de la PAC – article 43, paragraphe 2 – et la seconde est le renforcement de la cohésion sociale de l’Union européenne – article 175, paragraphe 3.
En naviguant entre ces deux pendants, nous devrions pouvoir trouver le passage juridique qui nous permettrait de ne pas acheter de stocks supplémentaires, mais d’utiliser le peu de surplus de la PAC et de le compléter en recourant à la cohésion sociale et à la solidarité. Je ne doute pas que nous arrivions à trouver une solution avec nos partenaires.
De toute façon, je n’imagine pas que nous soyons obligés de dire à la Croix-Rouge, au Secours populaire et aux autres associations que nous n’avons pas les moyens d’assumer la campagne de 2012.
Pour 2011, c’est fait ! Nous travaillons pour 2012.
Je suis trop européen pour ne pas considérer comme une extrémité le fait que cette aide soit renationalisée.
Je n’imagine pas davantage que le Président de la République et le Premier ministre prennent une autre décision que celle que vous évoquez si M. Bruno Le Maire et moi-même devions échouer.

Monsieur le ministre, pour vous permettre d’affiner votre réponse sur le sujet que nous venons d’aborder, il me semble souhaitable, pour la qualité et la véracité de notre débat, que vous nous apportiez des précisions sur deux autres sujets. Le premier porte sur la taxe sur les transactions financières.
L’attitude qui consiste à en rester à des généralités, certes vertueuses, mais quelque peu brumeuses, alors que huit jours nous séparent du Conseil européen, me paraît pour le moins perfectible.
Tout à l’heure, à titre d’illustration, vous avez évoqué le taux de 0, 005 %. Compte tenu du changement intervenu au Danemark sur l’autre dossier, la famille politique à laquelle j’appartiens pourrait vous aider à soutenir le taux qu’elle préconise, à savoir 0, 05 %. Ce qui est en jeu, vous le savez fort bien, c’est le caractère dissuasif ou non de cette taxe sur les mouvements spéculatifs.
La faisabilité et l’impact économique de ce projet ont été vérifiés de longue date et un rapport conclusif a été présenté au Conseil européen voilà maintenant quinze mois.
Il serait me semble-t-il judicieux que le Gouvernement indique la démarche qu’il entend suivre pour parvenir à un résultat et nous apporte des réponses précises aux questions suivantes, qu’il ne peut ignorer : quel groupe de pays constitue-t-il la cible ? Quels pays sont encore réticents devant ce projet ? Quelle sera l’assiette retenue ?
L’utilisation du produit de cette taxe, qui est un vrai choix politique et sur laquelle le Gouvernement a nécessairement une position, devrait également être abordée. Les ressources dégagées seraient d’ailleurs plus significatives si l’on adoptait notre proposition. Dans la situation de faible croissance que nous connaissons aujourd'hui, vouloir faire du produit de cette taxe une ressource de substitution par rapport aux recettes actuelles de l’Union européenne, au lieu de l’utiliser pour soutenir la croissance européenne, notamment la croissance verte, est un choix politique que l’on ne peut que qualifier d’insuffisant.
Le temps de parole qui me reste m’interdit d’aborder l’autre question que je souhaitais vous poser sur les titres de dette. Je dirai simplement que le refus commun des eurobonds, voilà quelques semaines, par Mme Merkel et par le Président de la République est une position d’étape fortement inspirée, si j’ose me permettre cette évocation, par des considérations bilatérales de politique intérieure. Il faudra donc, à mon avis, revoir cette question.
Enfin, vous avez parlé de « fédéralisme », mais de façon un peu audacieuse, me semble-t-il, puisque vous vous êtes référé en fait à un mécanisme « unanimitaire ». Avant d’arriver au fédéralisme, il faut s’efforcer de fédérer. Lorsque l’on veut construire un accord, il faut, au-delà de l’entente franco-allemande, traiter les autres partenaires européens de manière positive et attentive.
Puisque vous voulez des chiffres, monsieur le sénateur, je vais vous en donner, d’autant que certains d’entre eux sont connus. Ainsi, la Commission européenne propose un taux de 0, 1 % sur les actions obligataires et de 0, 01 % sur les produits dérivés.
Je voulais simplement illustrer tout à l’heure mon propos en disant que le bon impôt est celui qui a l’assiette la plus large et le taux le plus bas, parce qu’il est indolore et productif.
Monsieur le sénateur, quelle assiette pouvons-nous espérer ? Est-il raisonnable de croire que les États-Unis accepteront demain une taxe sur les transactions financières, qu’ils ont déjà maintes fois refusé d’envisager par le passé ?
J’ai été amené à évoquer cette taxe à trois reprises pas plus tard que ce matin : une fois avec M. Van Rompuy, une autre fois lors d’une discussion sur les perspectives financières et une dernière fois dans le cadre de la préparation du G20. Mon homologue britannique, David Lidington s’est finalement déclaré défavorable à cette taxe, ce que nous savions.
Il me semble donc que le champ d’application de la taxe ne pourra qu’être européen, et peut-être même devra-t-il se limiter à la zone euro.
Vous m’excuserez de ne pas vous apporter une réponse précise sur la nature de l’objectif recherché, mais je puis le faire dans l’immédiat.
Si la taxe est d’application mondiale, elle aura un objet mondial, et il sera alors inconcevable qu’elle alimente le seul budget de l’Europe. Si elle s’applique dans l’Europe des Vingt-Sept, on peut imaginer qu’elle financera une partie du budget européen. En revanche, si son application se limite aux pays de la zone euro, son objet sera forcément plus réduit.
En fonction du taux, de l’assiette et du volume qui seront retenus, le rendement de la taxe oscillera entre 20 milliards d'euros et 250 milliards d'euros. D’aucuns font même état d’un produit de 400 milliards d'euros, mais ce serait dans le meilleur des mondes possibles !
L’esprit de la taxe est non pas de pénaliser les transactions financières, mais bien plutôt d’effectuer un prélèvement indolore, afin d’éviter les fuites d’une place bancaire vers une autre.
Je vais vous dire le fond de ma pensée. Au début, il faut opter pour un taux faible pour pouvoir franchir l’étape la plus difficile, c’est-à-dire obtenir l’adhésion du plus grand nombre possible d’États à ce dispositif. Cette question fait l’objet de débats depuis maintenant vingt ans. Mieux vaut ne pas placer la barre trop haut et parvenir à un accord même si, dans un premier temps, celui-ci concernera un plus petit nombre de pays que ce que l’on espérait. Lorsque la taxe existera, il sera toujours possible de la faire évoluer.
Je suis, pour ma part, persuadé – et je suis convaincu que vous partagez mon avis – qu’un taux faible n’entraînera pas de déplacement des places boursières.
Les eurobonds ont fait l’objet d’une décision d’étape. Cela signifie simplement que ce n’est pas le moment de trancher sur ce sujet, mais cela ne présage pas de l’avenir.

Monsieur le ministre, je considère, comme vous, que le plus important est de « mettre un pied », si je puis m’exprimer ainsi, dans la taxe sur les transactions financières. Rien n’interdira ensuite d’en changer les modalités d’application. Dans ce domaine, le mieux est très clairement l’ennemi du bien.
Ma question a trait à la politique agricole commune. Alors que nos préoccupations immédiates portent sur la crise grecque et sur la question des dettes souveraines, demain matin, le commissaire européen à l’agriculture Dacian Ciolos doit dévoiler les intentions de la Commission européenne sur la PAC de l’après-2013.
À l’heure où l’on s’interroge sur les conséquences de la mondialisation, n’oublions pas que l’agriculture représente 9 milliards d’euros d’excédent commercial pour notre pays.
Par ailleurs, si l’on continue de voir les agriculteurs uniquement comme des adversaires de la lutte contre le changement climatique, on reculera par rapport aux objectifs que nous devons être capables d’atteindre. La question de l’alimentation de la planète se pose d’une manière toujours plus aiguë, avec une augmentation constante de la population terrestre et une surface agricole utile en diminution.
L’agriculture n’est pas une nostalgie, c’est un avenir ! Quand on voit que les Chinois achètent 3, 8 millions d’hectares de terres en Afrique, on mesure le caractère fondamental de questions telles que la souveraineté alimentaire ou la qualité sanitaire des aliments.
En outre, si l’on tient compte du rôle de l’agriculture en termes d’aménagement du territoire, avec toutes les conséquences économiques et sociales qui en découlent – je rappelle que, peu ou prou, 2 millions de personnes vivent ou travaillent dans le domaine de l’agriculture, de la sylviculture et de l’agroalimentaire –, on mesure combien la décision qui sera annoncée demain est importante.
Elle est importante si l’on veut une PAC ambitieuse, qui ne relègue pas à une sous-politique cette politique agricole commune sur laquelle l’Europe s’est construite. Elle est importante aussi, car elle aura des répercussions entre autres sur l’emploi agricole. Sans doute faudra-t-il privilégier des dotations à l’hectare dégressives plutôt que proposer un système tourné uniquement vers les gros agriculteurs, qui risquerait de détruire une partie de la haute intensité humaine de l’agriculture française.
Monsieur le ministre, ma question est simple : dans quel état d’esprit le Gouvernement se trouve-t-il à la veille de cette annonce et jusqu’où est-il prêt à aller pour défendre nos agriculteurs ?
Monsieur le sénateur, l’état d’esprit du Gouvernement est déterminé, comme nous l’avons répété lors de tous les débats relatifs aux perspectives financières.
Tout d’abord, il s’agit d’une politique non pas française, mais européenne ; je dirai même que c’est l’une des rares politiques communautarisées.
Ensuite, si nous voulons être indépendants au niveau alimentaire, éviter la volatilité des marchés du secteur agroalimentaire et ses dérivés et avoir une veille sanitaire efficace, nous devons conserver une politique agricole commune. Fort heureusement, nous ne sommes pas les seuls à défendre cette position : un certain nombre de pays comme la Pologne soutiennent avec nous à la fois la politique agricole commune et les deux piliers.
J’ajoute que cette politique a été évaluée à quatre reprises, ce qui n’est pas le cas en matière de recherche, de développement ou de cohésion. Il est donc logique de considérer que la politique qui a été jugée pertinente doit être stabilisée, alors que celle qui n’a pas encore été passée au crible de l’expertise peut éventuellement évoluer.
Prenons l’exemple de la politique de cohésion territoriale.
Un grand nombre de pays européens, notamment l’Allemagne et l’Espagne – et même la France –, sont sortis des objectifs de cohésion. Ne doit-on pas réfléchir à la façon dont il faudrait redistribuer ces moyens plutôt que de les pérenniser : dès lors qu’un territoire a bénéficié une fois de cette aide, doit-il en profiter de toute éternité même s’il est devenu – et c’est tant mieux ! – plus prospère ?
La réponse du Gouvernement est toujours la même : la France n’acceptera aucun projet financier, aucune perspective financière qui ne soit pas de nature à assurer la stabilité de la politique agricole commune.

Monsieur le ministre, j’avais moi aussi prévu de vous poser une question relative au programme européen d’aide aux plus démunis. Mais le propre d’un débat interactif et spontané est de ne pas connaître par avance les questions de nos collègues, ni la teneur exacte des réponses qui nous sont apportées.
Au sujet du PEAD, vous avez évoqué quelques solutions. Ne serait-il pas envisageable de prévoir un nouveau règlement de ce programme, qui confirmerait sa place dans la politique agricole commune, tout en ne le limitant pas aux stocks d’intervention ?
D’ailleurs, la position actuelle de la Commission européenne est bien d’ancrer, en 2014, le PEAD dans le Fonds social européen.
Tout à l’heure, vous avez répondu à notre collègue Roland Courteau que l’aide était assurée pour 2011. Or nous arrivons au terme de l’année. Pouvez-vous nous confirmer que l’État français prendra le relais et viendra au secours des personnes les plus démunies ?
Par ailleurs, vous avez aimablement invité les membres du Conseil de l’Europe à venir vous rencontrer. Vous avez entendu nos observations et nos remarques, notamment quant aux difficultés de communication avec les commissions des affaires européennes du Sénat et de l’Assemblée nationale.
Nous avons émis le souhait, d’une part, d’une meilleure articulation du travail entre le Conseil de l’Europe et les commissions des affaires européennes des deux assemblées et, d’autre part, d’une plus grande reconnaissance du travail réalisé au sein du Conseil de l’Europe par les 47 membres de ce dernier, travail axé sur la démocratie, les droits de l’homme, l’État de droit.
Monsieur le ministre, comment concevez-vous cette meilleure articulation du travail entre le Conseil de l’Europe et les deux commissions parlementaires ?
Madame la sénatrice, j’ai longtemps été parlementaire, et lorsqu’un ministre me donnait un conseil sur l’organisation de nos travaux, j’avais vraiment l’impression qu’il se mêlait de ce qui ne le regardait pas ! Aussi me garderai-je bien d’exprimer une opinion sur ce sujet.
M. le président du Sénat et M. le président de l’Assemblée nationale mettront probablement en œuvre tous les moyens nécessaires pour faire en sorte que les travaux du Conseil de l’Europe, qui, regroupe, comme vous l’avez souligné, 47 pays, et traite de sujets qui sont l’essence même de la construction européenne – les droits de l’homme ou encore la démocratie –, puissent mieux s’articuler avec ceux du Parlement français et avoir une meilleure visibilité.
Madame la sénatrice, comme vous m’y avez aimablement invité, j’irai au Conseil de l’Europe, qui est, à mes yeux, un haut lieu de la démocratie où se dévoile un message européen qui va au-delà de la politique purement financière, voire fiscale, que nous avons l’habitude d’évoquer.
S’agissant du PEAD, vous m’avez plus spécifiquement interrogé sur la perspective de 2014. Mais, entre 2011 et 2014, il y a forcément 2012 et 2013 ! Or, c’est précisément pour cette période que nous essayons de faire adopter, en tentant de lever la minorité de blocage, un dispositif transitoire, qui s’appuierait sur deux lignes budgétaires différentes et équilibrées.
Nous ne pouvons malheureusement pas, comme vous l’avez suggéré, réintégrer le PEAD dans la PAC, car son objet n’est pas communautaire. Il s’agit d’un surplus utilisé à des fins de solidarité et, à l’inverse, on ne peut pas créer, au sein de la PAC, un élément de solidarité.
Pour me résumer, l’aide aux plus démunie est garantie pour l’année 2011. En 2014, le PEAD sera intégré au Fonds de solidarité ou à la politique de cohésion économique et sociale. Pour les années 2012 et 2013, la solution consiste à surmonter la minorité de blocage et à trouver deux lignes budgétaires pour faire la jonction entre les deux dispositifs.
Je ne suis pas Premier ministre
M. Jean-Jacques Mirassou s’exclame.

Monsieur le ministre, je voudrais revenir sur le système bancaire, en évoquant les capitaux propres des banques et leur liquidité.
Nous ne pouvons que recommander aux banques au moins d’augmenter leurs capitaux propres. En effet, on considérait jusqu’alors qu’un taux de 8 % des ressources propres des banques par rapport à leurs engagements était satisfaisant. Mais on observe que les créances des banques se sont dégradées ; pis, des titres souverains, considérés jusqu’à maintenant comme de la quasi-monnaie, se sont aussi dégradés. De ce fait, le ratio entre les ressources propres des banques et leurs engagements a quelque peu changé. Il faut donc provisionner les ressources propres et s’orienter vers une recapitalisation des banques, afin que le ratio de 8 % de Bâle II soit supérieur à 9 % ou à 10 %.
Cette nécessité est d’autant plus impérieuse que, avec la crise des dettes qui se poursuit, les titres souverains dans les bilans des banques vont être de moins en moins certains.
J’en viens maintenant au problème actuel, qui est lié au précédent, celui de la liquidité des banques.
Le système bancaire est ainsi fait que les banques « se tiennent par la barbichette » en empruntant et en prêtant. Dans ce système dynamique et vivant, les uns dépendent des autres ; dès lors qu’il y a un blocage, on assiste à un phénomène de digues.
À cet égard, je me réjouis que des solutions aient pu être trouvées pour Dexia, ce qui redonnera un peu d’aisance au système qui était quelque peu encombré. Mais les banques continuent de souffrir d’un manque de liquidités. Pour pallier ce manque, elles s’adressent à la Banque centrale européenne et lui remettent des titres souverains contre de la monnaie. Toutefois, la BCE ne pourra pas servir très longtemps d’une sorte de station d’épuration qui donne de la bonne monnaie contre de la mauvaise dette ou des mauvais titres. Cette situation ne peut pas durer.

Par conséquent, il faut trouver le moyen de faire en sorte que les liquidités puissent circuler entre les banques. Pour ce faire, il importe de restaurer la confiance et de mettre à contribution les organismes européens et français.
Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour que la liquidité circule entre les banques et pour restaurer la confiance entre les banques elles-mêmes ?
Monsieur le sénateur, vous avez parfaitement expliqué les mécanismes de la liquidité et de la solvabilité : ce sont les deux piliers sur lesquels se fondent la fiabilité d’une banque et la confiance qu’elle inspire.
Une banque ne vit pas isolée, elle évolue dans un réseau. Si une banque ne prête pas à une autre banque, si une banque a des difficultés pour s’approvisionner en dollars, elle se retrouve effectivement dans une situation de faiblesse. Le ratio de 8 % qui avait été antérieurement envisagé doit aujourd’hui être augmenté puisque nous sommes dans une situation non pas de « stress tests » mais de stress réel, et à un niveau que l’on n’imaginait même pas lorsque les « stress tests » ont été réalisés.
Néanmoins, rappelons que les fonds propres des banques françaises ont augmenté de 50 milliards d’euros au cours du premier semestre, ce qui veut dire qu’elles ont déjà anticipé le Bâle II, et même le Bâle III.
Rappelons également que l’exposition des banques françaises à la dette grecque n’est jamais que de 10 milliards d’euros – je ne devrais pas dire des choses pareilles ! – : elle est de 10 milliards d’euros. Cela signifie que les banques françaises sont solides.
Dexia est, vous le savez, un cas très particulier, car cela fait vingt ans qu’elle fonctionne avec un système de liquidités à très court terme : elle emprunte à très court terme à des taux très bas et elle prête à très long terme à des taux très élevés. En période de croissance, le système fonctionne, mais le jour où se pose un problème de crédits ou de dettes souveraines, il s’enraye.
Pour autant, ce que font les États belges, luxembourgeois et français pour sauver Dexia, ce n’est pas de l’argent perdu ! Il s’agit de créer un système transitoire par le biais duquel on nettoie une dette « pourrie » à moyen et à long terme pour sauver, d’une part, un certain nombre de collectivités territoriales en France et, d’autre part, les épargnants en Belgique.
À ce propos, lorsque l’État français a prêté de l’argent aux banques en 2008, il a eu très rapidement 2, 8 milliards d’euros en retour. Le prêt octroyé par l’État français à Dexia a notamment rapporté à la France 500 millions d’euros.
Ne croyons pas que l’on est en train de jeter l’argent par les fenêtres ! Il faut obliger les banques, vous venez de le dire, à augmenter leur solvabilité et leur liquidité. Tel est d’ailleurs l’objet des mesures qui vont être prises pour rétablir la stabilité et restaurer la confiance. C’est ainsi que l’argent pourra circuler entre les banques et être disponible.
Le vrai problème aujourd’hui, c’est effectivement que les banques se prêtent moins entre elles et qu’elles prêtent moins aux entreprises et aux collectivités. Or, si une entreprise qui fonctionne bien n’a pas la solvabilité nécessaire pour s’engager dans un projet sain et rentable, il y a risque de récession.
La recapitalisation des banques, principalement à partir de leurs fonds propres, est donc un objectif indispensable, surtout si l’on considère qu’elles pourront de nouveau être sollicitées, alors même que les prêts qu’elles ont accordés à la Grèce ont été restructurés avec une décote pour elles de 21, 5 %. Cette situation créera un stress supplémentaire, et les banques auront tout intérêt à avoir une solvabilité et une liquidité plus fortes.

Vous l’avez rappelé, monsieur le ministre, le Conseil européen évoquera les négociations de Durban, car la crise climatique reste extrêmement grave.
En effet, même si la crise financière est aujourd’hui au centre des débats, n’oublions pas que les conséquences de la crise climatique seront, dans les prochaines décennies, aussi importantes, voire plus graves encore que celles de la crise financière que nous connaissons.
Je ne reviendrai pas sur la réunion du conseil des ministres de l’environnement de l’Union européenne qui a eu lieu hier, sinon pour m’inquiéter des divergences de vues qui apparaissent aujourd’hui entre les États européens, lesquelles fragilisent le rôle de leader que joue l’Europe en la matière sur la scène internationale.
Je fais miens les propos tenus tout à l'heure par l’un de nos collègues : ne soyons pas trop optimistes sur les résultats européens obtenus en termes d’émission de gaz à effet de serre. Les chiffres de l’année dernière révèlent en effet une nouvelle augmentation des émissions de ces gaz en Europe, ce qui est inquiétant.
Pour animer depuis plusieurs années, notamment comme porte-parole, des réseaux mondiaux de collectivités locales dans cette négociation internationale, je mesure toute la difficulté et la complexité de ce problème. Ce qui va se jouer à Durban, c’est d’abord la capacité de restaurer la confiance entre les pays du Sud et les pays du Nord après l’échec de Copenhague.
Dans ce cadre, la question du financement du Fonds vert dont la création, décidée à Copenhague, a été confirmée à Cancún, et qui doit aider les pays en développement à agir dans les domaines de l’adaptation et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, sera un point clé. Les pays africains seront extrêmement attentifs à cette question.
Je lierai ma question au débat qui a eu lieu sur la taxation des transactions financières, non pas par opportunisme, mais parce que nous trouverons, me semble-t-il, la solution dans notre capacité à faire preuve de cohérence pour réguler de manière globale les crises internationales.
Depuis plusieurs années, nous, écologistes, défendons l’idée d’une taxation des transactions financières, et nous sommes heureux que, au-delà de nos alertes, nos réponses soient aujourd’hui au cœur du débat public. Or, monsieur le ministre, ne pensez-vous pas que le Fonds vert pourrait être abondé par une partie de cette taxe ?
C’est une proposition que l’Union européenne pourrait porter, et que la France pourrait défendre lors du G 20, car elle permettrait peut-être de nouer d’autres alliances à l’échelle mondiale et de recréer une dynamique dans la négociation internationale. Cette possibilité correspond d’ailleurs à ce qu’a dit Mme la rapporteure générale sur l’idée de départ de cette mesure. Il serait dommage que nous nous en privions.
Enfin, monsieur le ministre, je vous poserai une question annexe : si le Fonds vert n’est pas financé par le biais de cette taxe, comment l’Europe pourra-t-elle être demain en capacité d’alimenter une partie de ce fonds, qui devra atteindre, je le rappelle, environ 100 millions de dollars à l’échéance de 2020 ?
Applaudissements sur certaines travées du groupe socialiste–EELV.
Monsieur le sénateur, rêvons au meilleur des mondes…
Dans le meilleur des mondes, le bon exemple est suivi au lieu d’être pénalisé.
Dans le meilleur des mondes, l’Europe, qui fait des efforts importants pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, est plus récompensée que la Chine ou les États-Unis, qui refusent d’entrer dans un quelconque protocole.
Dans le meilleur des mondes, lorsqu’une production industrielle se développe dans de nouveaux pays avec une productivité telle qu’elle met en danger notre compétitivité, on adopte des schémas doublement innovants : d’une part, on cherche à produire l’énergie de demain en protégeant la planète et, d’autre part, on crée des mécanismes de recherche et d’innovation susceptibles, ensuite, de s’exporter et de produire de nouvelles richesses.
Dans le meilleur des mondes, lorsqu’un problème mondial se pose, on crée une taxe mondiale pour le résoudre et on n’a pas recours à une suite de contributions nationales. Il est évident que, demain, des impôts seront perçus au niveau international.
La taxe sur les billets d’avion qui a été créée n’a pas empêché les voyageurs d’emprunter ce moyen de transport ! Elle a permis de soigner de nombreux malades du sida, qui étaient totalement démunis : aucun pays, y compris en Europe, n’avait la capacité de mobiliser suffisamment de fonds pour lutter efficacement contre ce fléau.
Quittons à présent le meilleur des mondes pour revenir dans celui où nous vivons, ici et maintenant.
Le véritable danger – Nathalie Kosciusko-Morizet l’a très clairement souligné – serait de dire : il y a eu Kyoto, Kyoto s’arrête ; un jour, il y aura Durban et un Kyoto II ; d’ici là, oublions Cancún et laissons tomber Kyoto ! Cela reviendrait à adresser aux États pollueurs et aux pays émergents un message désastreux, et cela poserait un vrai problème.
À Durban, il faut à la fois tenir les engagements pris antérieurement, qui feront d’ailleurs oublier l’échec de Copenhague, et poser les bases de règles plus contraignantes et plus efficaces.
Enfin, comme nous ne sommes pas dans le meilleur des mondes, il faudra, à un moment donné, que l’Europe prenne ses responsabilités. Au lieu d’annoncer la bonne nouvelle, elle devra imposer une mesure vertueuse, à savoir le MIC, le mécanisme d’inclusion carbone, plus communément appelé « la taxation carbone aux frontières ». Cela n’a rien à voir avec la réciprocité ou avec la loyauté des échanges commerciaux. Si l’on impose à son industrie et à son économie une contrainte vertueuse, il faut aussi, à l’intérieur de l’espace que l’on veut vertueux, imposer aux pays importateurs les mêmes règles de vertu.

Monsieur le ministre, je souhaitais vous poser une question au sujet du PEAD, mais je vous en fais grâce, car vous y avez déjà largement répondu.
Cela étant, je prends acte de votre engagement à trouver des solutions. En effet, sur le terrain, les associations caritatives sont extrêmement inquiètes. Depuis des mois, elles demandent à être rassurées : le nombre de personnes bénéficiaires du PEAD a déjà augmenté de manière considérable dans les années passées, et elles savent que ce mouvement risque malheureusement de se poursuivre du fait de la situation économique et sociale.
J’espère donc que l’Europe trouvera l’équivalent d’un euro par Européen, ce qui correspond aux 500 millions d’euros destinés à aider les plus démunis d’entre nous.
Permettez-moi d’évoquer le secteur de l’agriculture. Notre collègue Christophe Béchu ayant très justement mis en perspective les enjeux des propositions que fera demain M. Ciolos – et nous aurons sans doute l’occasion d’en reparler ! –, je me bornerai à vous poser, monsieur le ministre, une question plus pointue, que M. Raoul n’a pas traitée dans son intervention liminaire, celle des négociations bilatérales qui pourraient aboutir à un accord avec le Mercosur.
Je suis une élue du Massif central, une région où l’élevage bovin est essentiel pour la viande, en termes non seulement de qualité de la production, mais aussi d’aménagement du territoire. Aussi souhaiterais-je savoir où en est la négociation des accords du Mercosur ?
Applaudissements sur certaines travées du groupe socialiste -EELV.
Madame la sénatrice, vous avez évoqué un certain nombre d’accords de libre-échange qui posent problème.
L’accord avec le Japon est refusé, car il déséquilibrerait considérablement les marchés européens.
Avec le Mercosur, le déséquilibre est spécifiquement agricole : les négociations ou renégociations sont en cours, mais, très clairement, la situation est bloquée.
Ma réponse est une réponse d’attente, mais brève et déterminée : en l’état actuel, eu égard au déséquilibre qu’il créerait au sein de la filière bovine, nous ne pouvons pas signer un tel accord.

M. Jean-Jacques Mirassou. Monsieur le ministre, voilà maintenant plus d’une année que nos concitoyennes et nos concitoyens entendent parler de la note AAA, de l’effondrement des marchés et des banques, de pays qui vacillent. Or, pour couronner le tout, il faut des mois et des mois de négociations – vous en êtes la preuve vivante !
Sourires

Ce faisant, réalisez-vous, monsieur le ministre, que la rupture entre l’opinion publique française et l’ambition européenne, qui garde, malgré tout, toute sa noblesse, est en train d’être consommée ?
Sans vouloir nier les difficultés existant à l’échelon européen, y compris celles auxquelles le Gouvernement est confronté, quand allons-nous entendre parler d’une vraie réhabilitation du tandem franco-allemand ? Du primat du politique et de l’économique sur le monétaire ? Ou encore d’une initiative européenne de croissance, qui pourrait passer par de grands projets, à l’image de ceux qui existent déjà ? Je fais notamment allusion au partenariat entre EADS et Airbus, dont la réussite pourrait constituer un exemple.
Pour autant, vous avez évoqué tout à l'heure, monsieur le ministre, le divorce entre la Banque centrale européenne et le Conseil européen, issu de leur incapacité commune à « faire le ménage » sur les taux de change. Savez-vous ce que ne cesse de répéter M. Gallois ? Chaque fois que l’euro gagne dix centimes sur le dollar, il manque 1 milliard de plus dans l’exercice comptable d’EADS en fin d’année.
Pourrons-nous, oui ou non, donner quelques espoirs…
Sourires

... aux Garonnais bien sûr, mais aussi à tous ceux qui, dans l’Hexagone et en Europe, œuvrent au quotidien à la concrétisation d’un projet industriel fort et performant, que j’appelle de mes vœux !
M. Jean Leonetti, ministre.Last but not least ! Votre parole était ferme et claire, monsieur le sénateur. Aussi vais-je m’employer à adopter le même ton.
Sourires
Vous me demandez si je me rends compte de la situation. Oui, et d’ailleurs le Président de la République a employé les mêmes termes que vous ! Il a indiqué qu’il n’accepterait pas que les plus démunis soient abandonnés par l’Union européenne, dont l’image serait ternie d’une manière désastreuse. Je n’ai de cesse de le répéter ici : nous sommes déterminés à trouver des solutions, et je n’imagine pas une seconde que l’on puisse abandonner les plus démunis en 2012 et en 2013.
Vous me demandez également quand le politique reprendra la main sur l’économique et le financier. Mais tel a déjà été le cas le 21 juillet dernier.
Quand le couple franco-allemand se rapproche, on critique son initiative, arguant du fait que les États membres devraient se réunir à vingt-sept ! Dans le cas contraire, on lui reproche de ne pas agir ! Quand il énonce des décisions fortes, on se demande pourquoi il ne les a pas prises plus tôt ! Et quand il prend des décisions rapides, on s’écrie : comment ces dirigeants peuvent-ils mépriser les parlements au point de ne pas les écouter ?
Monsieur le sénateur, je suis certain que, en bon parlementaire, vous vous offusqueriez – légitimement ! – si les décisions n’étaient pas soumises au Parlement...
C’est dire si l’Europe est complexe : elle est composée de démocraties, dont les majorités sont quelquefois formées de coalitions. Le couple franco-allemand a toujours su trouver le consensus nécessaire, surtout en période de crise : il l’a trouvé le 21 juillet, le 16 août et dimanche dernier encore, en nous permettant de franchir une étape supplémentaire. Je suis convaincu que le politique gagnera sur l’économique et le financier.
Je crois profondément que le pouvoir politique, parce qu’il procède du peuple, et qu’il est, à ce titre, légitime pour déterminer les droits et les devoirs de celui-ci, l’emportera sur les pouvoirs économique et financier. Je ne doute pas une seule seconde que les décisions politiques qui ont été prises seront rapidement mises en œuvre et que les marchés financiers s’y plieront, car c’est le propre de toute démocratie. Toutefois, le processus de décision est toujours un peu plus lent dans les régimes démocratiques que dans les dictatures !
Dans ces conditions, il n’est pas donc illégitime d’attendre que le débat ait lieu au Sénat et à l’Assemblée nationale, afin que chacun puisse donner son avis, comme vous avez eu la possibilité de le faire aujourd’hui, mesdames, messieurs les sénateurs. J’espère d’ailleurs que mes réponses ne vous ont pas trop déçus…

Deux de nos collègues doivent encore prendre la parole, monsieur le ministre…
Je conclurai en quelques mots, monsieur le président.
ITER, GMS Galileo, les énergies renouvelables : les grands projets sont là. Ils constitueront demain les moteurs de la croissance et de l’innovation et, dans quelque temps, nous en serons fiers au même titre qu’Airbus, par exemple. Ces projets existent d’ores et déjà, mais n’oublions pas qu’ils sont soumis à la concurrence internationale. Il s’agit de défendre une certaine idée de l’Europe, celle qui innove, celle qui avance. Il n’y a pas qu’une Europe qui protège ; il y a aussi une Europe qui projette !

Mme Fabienne Keller. Je souhaiterais évoquer la taxe sur les transactions financières, un sujet qui a déjà été longuement évoqué, et le rôle européen de Strasbourg – nous n’en avons pas encore parlé ; il est grand temps de le faire !
Sourires

En ce qui concerne la taxe sur les transactions financières, je voudrais à mon tour plaider en sa faveur, en reprenant vos arguments, monsieur le ministre : nous allons répondre à la dictature des marchés financiers par la démocratie volontariste.
Les marchés tanguent, les banques sont en souffrance, l’euro est menacé. Si nous n’instaurons pas maintenant la taxe sur les transactions financières, nous ne le ferons jamais !
S’agissant des recettes de cette taxe, tout le monde en profitera ! Bien sûr, il ne faudra pas oublier l’Europe. D’ailleurs, la Commission européenne a formulé des propositions en ce sens, ce qui était franchement inespéré voilà un an, mais elle est aujourd’hui consciente qu’elle a besoin d’une ressource si elle veut élaborer un projet. De leur côté, les États membres seront bien contents de percevoir une partie du produit de cette taxe pour combler leurs déficits.
Enfin, il ne faudra pas oublier le défi climatique et la transition énergétique, en pensant tout particulièrement aux pays situés près de l’Équateur, qui seront les premières victimes innocentes du réchauffement de la planète.
L’affectation des recettes ne posera donc pas de difficultés majeures. Mais l’enjeu de la création d’une telle taxe est aussi moral : il est légitime de faire payer les marchés financiers qui sont à l’origine de la crise.
Permettez-moi maintenant de plaider en faveur de Strasbourg, la capitale européenne de la France, autrement appelée « l’autre capitale », qui doit toutefois partager cette mission avec Bruxelles et Luxembourg.
Si la liaison avec Luxembourg, améliorée par la deuxième phase du TGV Est, est de bonne qualité, celle avec Bruxelles reste un maillon faible.
C’est pourquoi je plaide auprès de vous, monsieur le ministre, en faveur de la mise en place d’une liaison ferroviaire régulière Bruxelles-Roissy-Strasbourg. Pour ce faire, il suffit de faire circuler des trains sur les lignes rapides existantes, comme ce fut le cas, avec succès, durant la présidence française de l’Union européenne. Avec de la volonté et un peu de souplesse de la part de la SNCF, nous pourrons relier les deux grandes capitales européennes !
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
M. Jean Leonetti, ministre. Je m’étonnais que vous ne soyez pas intervenue dans ce débat, madame la sénatrice, et, plus encore, que vous n’ayez pas encore défendu la cause de Strasbourg, connaissant votre attachement à cette ville…
Sourires
En ce qui concerne la taxation des transactions financières, vous avez pleinement raison : il serait à la fois logique et opportun de l’instaurer maintenant. Les crises créent aussi des opportunités, et il me semble que le moment est venu de franchir cette étape.
En ce qui concerne Strasbourg, les traités reconnaissent son rôle. Mais, au-delà du droit, cette ville constitue aussi un symbole fort. C’est en effet là, entre Forêt noire et forêt vosgienne, qu’ont surgi les plus fortes tensions, que se sont noués les plus grands drames, mais aussi qu’a eu lieu la plus grande réconciliation. Si l’on ne comprend pas cela, on ne comprend pas l’Europe ! En même temps, comme vous l’avez rappelé, l’Europe est multiple, et elle a aussi pour capitales Francfort, Luxembourg et Bruxelles.
Vous le savez, nous nous sommes opposés à ce que l’on condense les réunions strasbourgeoises en une session unique, ce qui aurait, à mon sens, pour conséquence d’altérer le travail des députés européens, le but ultime de l’opération étant de démontrer qu’il est impossible de siéger à Strasbourg.
Vous avez ensuite évoqué, madame la sénatrice, une liaison ferroviaire Strasbourg-Bruxelles. Celle-ci a en effet été utilisée et mérite donc d’être étudiée. Mais d’autres solutions sont également à l’étude pour améliorer la desserte de Strasbourg, notamment via l’aéroport de Bâle, avec la possibilité d’une connexion à Francfort. Le but est de placer Strasbourg, capitale européenne, à une heure de trajet des autres capitales nationales et européennes.

Initialement symbole d’une construction européenne qui avançait et d’une Union économique et monétaire qui annonçait une plus grande intégration politique, l’euro est aujourd’hui en crise.
Cette crise ne concerne pas seulement la zone euro, mais toute l’Union européenne, par l’impact qu’elle est susceptible d’avoir sur l’ensemble de la construction européenne.
Les euro-obligations apparaissent aujourd’hui comme une solution puissante pour répondre aux difficultés actuelles. Elles sont aussi une solution conforme à l’esprit de la construction européenne, par la communautarisation des moyens et la solidarité qu’elles impliquent.
Toutefois, la mise en place d’euro-obligations, comme d’ailleurs la mise en place d’une mutualisation des efforts ou d’un gouvernement économique, ne peut faire l’économie de préalables politiques.
Les dettes qui, aujourd’hui, sont imposées aux États pour sauver les banques ou pour répondre aux défaillances de tel ou tel État européen devront être payées par les citoyens européens.
Pourtant, cet argent prêté, qui témoigne d’une solidarité, doit correspondre à une responsabilité politique partagée et à un contrôle démocratique.
Le remboursement de cette dette devra donc être effectué selon un principe d’égalité entre les citoyens et les entreprises des différents pays de l’Union européenne, par un fédéralisme fiscal, obligatoire dans ce cas-là, par un fédéralisme économique et social, bref, par un fédéralisme politique.
Tous les pays de l’Union européenne doivent être impliqués dans les décisions prises. Aujourd’hui, la réaction slovaque est logique, car nous devons veiller à laisser en permanence une marge de manœuvre à tous nos partenaires pour ne pas imposer les décisions du couple franco-allemand.
Veillons aujourd’hui à ne pas pratiquer une fuite en avant dans la recherche d’outils économiques et financiers, dictée par l’urgence, sans assumer politiquement ce que cela doit signifier en termes d’intégration politique, de gouvernance et de démocratie, c'est-à-dire de fédéralisme européen pour l’ensemble de l’Union européenne.
Si nous ne le faisons pas aujourd’hui, si nous n’assumons pas ce choix, nous échouerons demain et, après-demain, nous creuserons encore plus le fossé entre, d’une part, les opinions publiques européennes – j’allais même dire l’opinion publique européenne – et la construction européenne.
M. Jean Leonetti, ministre. Monsieur le sénateur, vous avez prononcé quatre fois le mot « fédéralisme ». Eu égard à ce qui a été dit tout à l'heure, voilà qui fait de vous un candidat à la déportation !
Sourires

M. Jean-Yves Leconte. Vous vous adressez à un Français de l’étranger originaire d’Europe centrale et orientale, monsieur le ministre !
Nouveaux sourires.
Vous avez abordé, monsieur le sénateur, un vrai sujet.
La création d’euro-obligations nécessite de mutualiser la dette. Or l’hétérogénéité des dettes des différents pays de la zone euro est aujourd’hui telle qu’il est impossible de mutualiser la dette de la Grèce et celle de l’Allemagne, sauf à franchir préalablement les étapes successives d’harmonisation économique, fiscale et financière que vous avez évoquées. C’est pour cette raison que j’ai parlé tout à l’heure d’une certaine forme de fédéralisme économique.
En effet, comment les Allemands – mais les Français auraient sans doute la même réaction ! – pourraient-ils accepter de voir leurs taux d’intérêt augmenter à la suite de cette mutualisation et de se retrouver pénalisés lors de leurs achats, et ce au nom de la solidarité ? Certes, ils ne diraient sans doute pas non à la solidarité, mais ils exigeraient en contrepartie une certaine discipline. Vous voyez donc que des règles contraignantes sont indispensables.
De même, comment faire accepter aux Français que le taux de l’impôt sur les sociétés ne soit que de 12 % en Irlande, contre 34 % en France ? Une fois la crise passée, nous devrons encourager les Irlandais à relever leur taux. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Président de la République française et la Chancelière allemande ont choisi de faire converger les taux français et allemand de l’impôt sur les sociétés, car il ne saurait y avoir de solidarité sans convergence.
Nous avons une monnaie unique ; il nous faut une économie unifiée et harmonisée, ainsi que des fiscalités qui convergent progressivement, afin que les peuples – et non les marchés ! – comprennent que l’effort est justement et équitablement réparti. Une fois ces conditions réunies, nous pourrons envisager de créer des euro-obligations, lesquelles constitueraient alors l’aboutissement d’un processus de mutualisation des efforts et de la croissance. Mais, aujourd’hui, leur création ne ferait que ruiner les efforts des États les plus vertueux et les conduirait à la situation difficile que connaissent actuellement certains pays.
Je partage votre avis, monsieur le sénateur, mais pas dans le temps. J’espère qu’un jour viendra où les euro-obligations s’imposeront à nous, parce que la dette grecque ne posera plus de problèmes à la zone euro, que l’euro sera resté une monnaie forte et que l’Europe aura su trouver cet équilibre, indispensable dans toute gestion, qu’il s’agisse d’une ville, d’un État ou de l’espace européen, entre discipline et solidarité.

Nous en avons terminé avec le débat préalable au Conseil européen du 23 octobre 2011.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 12 octobre 2011, à quatorze heures trente :
1. Débat sur la réforme portuaire ;
2. Débat sur la couverture numérique du territoire.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à dix-huit heures quarante-cinq.