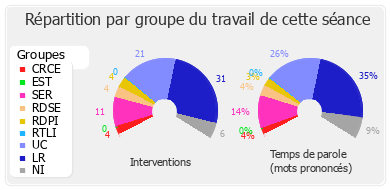Séance en hémicycle du 22 janvier 2019 à 9h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Questions orales (voir le dossier)
- Dotation de solidarité en faveur des collectivités territoriales touchées par des événements climatiques (voir le dossier)
- Absence de suivi médical post-professionnel des anciens salariés de la saft–arts energy (voir le dossier)
- Conséquences du changement de statut de l'école française andré-malraux de saint-pétersbourg (voir le dossier)
- Suppression du régime social des indépendants et conséquences pour les indépendants (voir le dossier)
- Temps de travail autorisé dans l'état de résidence pour les travailleurs transfrontaliers (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 17 janvier 2019 a été publié sur le site internet du Sénat.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté.

La parole est à M. Édouard Courtial, auteur de la question n° 349, transmise à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, alors que le Président de la République a souhaité échanger très directement, par deux fois ces derniers jours, avec les maires, chacun de ceux-ci a lancé, avec ses mots, un véritable cri d’alarme en faveur des territoires ruraux.
Au sein de cette convergence de vues et d’expériences de ces hussards de la République, traits d’union indispensables à notre démocratie, figure en bonne place le maintien des services publics de proximité. Il est indéniable qu’un bureau de poste, malgré l’ère numérique dans laquelle nous vivons, compte parmi ceux que l’État doit garantir aux Français, où qu’ils habitent sur le territoire national, d’autant que les communes ont souvent consenti de lourds investissements pour maintenir le bureau de poste communal. En effet, les maires comme les habitants ont pleinement conscience de ce qu’est un bureau de poste dans un village, parfois le dernier rempart d’une désertification administrative qui s’accélère.
Pourtant, suivant une logique comptable, le groupe La Poste réduit peu à peu les amplitudes horaires – c’est le cas, par exemple, à Bury, à Rieux ou encore à La Neuville-en-Hez, dans l’Oise, qui sont loin d’être des cas isolés –, voire ferme certains relais. La continuité du service public est donc sacrifiée au profit de la rentabilité financière, à l’inverse de l’appel lancé par les élus de terrain et par ceux qui, chaque semaine, demandent plus d’État là où celui-ci se retire peu à peu, et à l’inverse aussi des engagements présidentiels pris, à plusieurs reprises, sur le maintien des services publics.
Or le grand débat national ne répondra pas à cette question, puisqu’elle n’a pas à être posée, faisant l’unanimité en sa faveur.
Ainsi, je vous appelle, madame la ministre, à davantage de cohérence entre les promesses et votre politique, afin de faire de l’égalité devant l’accès au service public une réalité.

Monsieur le sénateur Édouard Courtial, votre question est effectivement d’actualité ; au fond, elle pose la question de ce qu’est un service public et elle pose celle de ses éventuelles adaptations aux évolutions.
La Poste, au travers de sa contribution à la mission d’aménagement du territoire, en est un très bon exemple. La loi du 2 juillet 1990 fixe ses obligations en matière de présence sur le territoire. La Poste doit ainsi maintenir au moins 17 000 points de contact et faire en sorte que, dans chaque département, 90 % de la population se trouve à moins de cinq kilomètres ou à moins de vingt minutes d’un point de contact postal. Les communes de plus de 10 000 habitants doivent disposer d’au moins un point de contact par tranche de 20 000 habitants. Telle est la loi, qui est toujours en application.
Dans le département de l’Oise, grâce, vous le savez très bien, à des partenariats avec les mairies – de nombreuses agences postales communales ont été ouvertes – et avec les commerçants – les relais Poste –, La Poste a maintenu un maillage dense de 213 points de contact, pour une population de 825 000 habitants. Toutefois, comme sur l’ensemble du territoire, le réseau de La Poste a dû s’adapter, du fait de la baisse considérable du volume du courrier et de la fréquentation des guichets, en raison du développement du numérique et du changement des habitudes de consommation.
Je signale toutefois que le colis postal, lui, se développe grâce à, ou à cause de – selon que l’on est pour ou contre –, l’achat sur internet ; La Poste retrouve ainsi une activité dans ce nouveau domaine, même si elle a des concurrents nationaux et internationaux.
Dans ces conditions, La Poste a envisagé des modifications des horaires de ses bureaux de Bury, Rieux et La Neuville-en-Hez. Cela n’entre pas en contradiction avec sa mission d’aménagement du territoire : le contrat d’entreprise entre l’État et La Poste pour 2018-2022 confirme les orientations du contrat de présence postale territoriale de 2017-2019 signé par l’État, l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité et La Poste.
L’État veille à ce que les évolutions du statut des points de contact tiennent compte des besoins des usagers, dans le cadre d’une concertation préalable approfondie avec les élus. Ainsi, un aménagement des horaires d’ouverture fait systématiquement l’objet d’un dialogue préalable avec le maire de la commune.
Par ailleurs, l’État s’investit dans le déploiement des maisons de services au public, les MSAP. Un certain nombre de ces maisons sont ouvertes par La Poste pour maintenir les services publics de proximité.

L’État porte donc la plus grande attention au maintien de la présence postale.

Madame la ministre, j’entends bien vos arguments, qui se veulent rassurants, mais, aujourd’hui plus que jamais, compte tenu des tensions actuelles que notre pays traverse, je vous appelle à la plus grande vigilance sur ce sujet, afin d’enrayer, sur le terrain, cette spirale : moins d’État, plus de colère.

La parole est à M. Jean-Pierre Moga, auteur de la question n° 569, adressée à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, alors qu’ils recouvrent la notion du domaine public, nos chemins ruraux sont classés par la loi dans le domaine privé.
La proposition de loi, présentée par mon prédécesseur Henri Tandonnet, visant à renforcer la protection de ces chemins est une réponse au problème de leur disparition, car ils sont soumis à la prescription acquisitive.
Depuis longtemps, ils ont fait l’objet de multiples appropriations par des particuliers : souvent, ils gênent les exploitations et, avec l’agrandissement de celles-ci, ils ont été labourés, clôturés et donc soumis à une prescription acquisitive.
Aussi, la mise en place d’un dispositif incitant les communes à procéder à l’inventaire de leurs chemins et à délibérer sur leur avenir est nécessaire.
Cette proposition de loi prévoit, d’une part, la suspension pendant deux ans du délai de prescription pour l’acquisition des parcelles comportant ces chemins et, d’autre part, une procédure permettant à une commune engagée dans une démarche d’inventaire d’interrompre ce délai. Enfin, elle prévoit la possibilité de procéder à des échanges de parcelles avec des chemins ruraux pour en adapter le tracé – cela permet de réaménager les parcelles agricoles sans passer par un remembrement et d’éviter des conflits.
Le 12 mars 2015, cette proposition de loi a été adoptée en première lecture par le Sénat, puis transmise à l’Assemblée nationale. Un nouveau texte a été transmis à l’Assemblée nationale le 6 juillet 2017, mais il n’a toujours pas été inscrit à son ordre du jour.
Madame la ministre, je vous demande que cette proposition de loi puisse suivre toutes les étapes de la discussion en séance publique, afin qu’elle soit soumise au vote des parlementaires des deux assemblées ; elle présente un réel intérêt pour le monde rural.

Monsieur le sénateur Jean-Pierre Moga, le Gouvernement est particulièrement sensible à la problématique que vous soulevez.
Dans le cadre de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, examinée au printemps 2016, le Gouvernement avait souhaité prendre en compte la nécessité de protéger les chemins ruraux en reprenant des dispositions issues de la proposition de loi que vous évoquez ; je me souviens bien de cette discussion et du texte présenté par Henri Tandonnet, puisque j’étais moi-même sénateur à l’époque.

Si les dispositions adoptées à cette occasion ne reprenaient pas intégralement celles de la proposition de loi, elles visaient néanmoins à renforcer la protection des chemins ruraux, qui constituent à l’évidence un patrimoine et une richesse à protéger, ce dont les élus locaux, en particulier les maires, ont tout à fait conscience.
Néanmoins, le Conseil constitutionnel a censuré, dans sa décision du 4 août 2016, les dispositions relatives aux chemins ruraux introduites dans le projet de loi précité, considérant qu’elles étaient sans lien avec son objet initial.
Le Gouvernement est bien entendu ouvert à la reprise de la discussion parlementaire sur ce sujet, dans un véhicule législatif qu’il conviendra d’identifier. Je suis à votre disposition pour en discuter.

Je vous remercie de votre réponse, madame la ministre ; je travaillerai avec vous pour reprendre ce texte.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, auteur de la question n° 508, adressée à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Madame la ministre, vous le savez, aux termes de la loi du 3 août 2018, les communes membres d’une communauté de communes n’exerçant pas, à cette date, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de même que les communes membres d’une communauté de communes exerçant, à titre facultatif, uniquement la compétence assainissement non collectif, peuvent s’opposer au transfert immédiat, à la communauté de communes, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, si, avant le 1er juillet 2019, une minorité qualifiée le demande. En ce cas, le transfert de compétences est reporté au 1er janvier 2026.
Ce texte semblait ne poser aucun problème de compréhension jusqu’à la publication de la circulaire d’application du 28 août 2018, précisant que cette faculté de retarder la mise en œuvre du transfert obligatoire s’applique « exclusivement » aux communes n’exerçant pas, « y compris partiellement, à l’exception du [service public d’assainissement non collectif, ou] SPANC », ces compétences ni à titre optionnel ni à titre facultatif.
Ainsi, une loi présentée comme une liberté nouvelle pour toutes les communes d’une communauté – vous êtes bien placée pour le savoir, madame la ministre – se trouve avoir un champ d’application réduit, un nombre important de communes ayant, par exemple, transféré la production de la ressource en eau tout en conservant le reste de la gestion.
Doit-on penser qu’il s’agit d’une interprétation abusive de la loi ou d’une opération visant à reprendre d’une main une liberté de mise en œuvre qu’on avait accordée de l’autre ?
M. François Bonhomme applaudit.

Monsieur le sénateur Pierre-Yves Collombat, vous revenez sur un sujet que, les uns et les autres, nous connaissons bien. Vous avez rappelé le contenu de la loi, donc je ne le ferai pas.
L’article 1er de ce texte introduit la minorité de blocage. Le premier alinéa de cet article est sans équivoque : la minorité de blocage concerne les « communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement ». En clair, cela signifie que seules les communautés de communes qui n’exercent pas du tout la compétence relative à l’eau ou à l’assainissement peuvent bénéficier de cette faculté de report à 2026.
Par conséquent, l’emploi des termes « y compris partiellement » dans l’instruction ministérielle du 28 août 2018 est parfaitement conforme à la loi. Aucune modification de l’instruction n’est donc prévue par le Gouvernement.
Pour vous le dire franchement, je ne comprends pas bien où est le problème.

On n’a pas repris d’une main ce qu’on a accordé de l’autre. On a publié une circulaire conforme au texte de loi.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour répondre à Mme la ministre.

Madame la ministre, moi aussi, j’ai eu du mal à comprendre ce qui se passait, mais cela m’est remonté du terrain. Des collègues croyaient naïvement – comme moi d’ailleurs, lors de la discussion du texte, dont vous vous flattiez à l’époque – que, n’ayant pas transféré la compétence – le problème le plus courant se pose lorsque la commune n’a plus la compétence de production de l’eau mais en conserve la gestion –, ils pouvaient bénéficier de ces dispositions paraissant au départ tout à fait libérales – pour des libéraux, c’est d’ailleurs très bien. Mais non ! C’est un grand classique de la gestion, depuis des années : on raconte une chose et on en applique une autre !

Je vous propose que l’on en reparle après la séance, monsieur le sénateur.

La parole est à Mme Nathalie Delattre, auteur de la question n° 592, adressée à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, vous le savez, la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU, consacre le plan local d’urbanisme, le PLU, comme le principal document de planification et d’urbanisme à l’échelle communale. Véritable projet de ville, le PLU organise le développement d’une commune entière, en définissant ses règles d’urbanisme et en intégrant les exigences environnementales. Il s’agit de trouver le juste équilibre entre développement d’installations urbaines, en réponse aux besoins des habitants, et préservation des espaces naturels.
C’est donc sur le fondement du PLU en vigueur, approuvé par l’État, que toute demande de permis de construire et d’autorisation d’urbanisme est évaluée. Un contrôle de légalité est ensuite assuré par la préfecture, afin d’assurer que chaque autorisation d’urbanisme accordée par le maire est légale et qu’elle respecte bien le PLU de la commune. Normalement, l’approbation tacite a priori, par l’autorité préfectorale, du plan local d’urbanisme devrait se traduire, a posteriori, par l’approbation de projets d’urbanisme conformes à l’esprit et à la lettre du PLU.
Malheureusement, ce n’est pas forcément le cas et cela défie toute logique.
En Gironde, les situations inextricables se multiplient. À titre d’exemple, dans la commune du Porge, un terrain familial hérité, déclaré constructible voilà dix ans au titre du PLU, a vu l’un des deux héritiers autorisé à construire une habitation principale. Comment expliquer que le deuxième héritier, détenant l’autre partie du terrain et qui s’est acquitté des droits de mutation, se soit vu refuser cette autorisation, quelques années plus tard, par les autorités ? Cette situation n’est malheureusement pas un cas isolé.
À Saint-Symphorien, le PLU encadre le développement urbanistique tout en préservant le patrimoine forestier de la commune. Dès lors, comment expliquer que la direction départementale des territoires et de la mer, la DDTM, demande systématiquement un arrêté de défrichement et une étude au cas par cas pour autoriser tout projet de développement urbain contenu dans le document de planification et d’urbanisme ?
De nombreux projets d’aménagement territorial, cruciaux en termes d’emplois, d’équipements et des services, sont ainsi freinés. Ces blocages, néfastes pour le dynamisme économique territorial de nos communes, ont notamment eu un impact négatif sur le prix du foncier et, donc, sur la mixité sociale au sein de ces communes.
Madame la ministre, pour remédier à cette situation, quelles précisions pouvez-vous nous apporter sur les directives reçues par les services de l’État chargés des dossiers d’urbanisme ?

Madame la sénatrice Nathalie Delattre, en application de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, lorsque la commune est dotée d’un plan local d’urbanisme, « l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est […] le maire, au nom de la commune ». La compétence en matière d’application du droit des sols est donc, par principe, décentralisée.
Ainsi, la commune du Porge étant couverte par un PLU, les services de l’État n’ont pas compétence pour traiter les demandes d’autorisation d’urbanisme autres que certaines exceptions, limitativement énumérées par le code de l’urbanisme et dont ne relèvent pas les exemples que vous citez.
Le refus d’une autorisation d’urbanisme en application des règles du PLU peut être motivé par plusieurs raisons. Ainsi, le PLU a pu être révisé entre les deux périodes que vous mentionnez, au cours des dix dernières années, aboutissant à la définition de nouvelles dispositions limitant les possibilités de construire sur le terrain ; cela arrive souvent. Autre raison possible, le zonage ou une sectorisation opérée par le PLU peut aboutir à définir des droits à construire différents sur une même parcelle, ou échelonnés dans le temps ; c’est également fréquent.
En outre, la commune du Porge est soumise à la loi Littoral et peut, pour cette raison, se voir appliquer des règles limitant la constructibilité, indépendamment de celles qui sont prévues par le PLU. C’est cette hypothèse qui semble applicable au cas d’espèce. En effet, le PLU de la commune du Porge a été approuvé le 30 janvier 2018. Or l’État a indiqué au maire, au titre de son contrôle de légalité, que des zones définies comme constructibles par le PLU étaient en fait inconstructibles au regard de la loi Littoral. Depuis lors, la commune a engagé une modification de son PLU, à l’issue de laquelle elle doit adopter la délimitation d’un nouveau zonage conforme à la loi Littoral.

La parole est à Mme Laure Darcos, auteur de la question n° 540, adressée à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Madame la ministre, je vous pose d’emblée la question : connaissez-vous, aujourd’hui, un maire qui ne soit pas soucieux ? Pour ma part, je côtoie, dans mon département, des maires admirables de courage et de dévouement, sincèrement attentifs à servir leurs concitoyens, mais malheureux de voir les conditions d’exercice de leur mandat se dégrader chaque jour davantage.
Le malaise des élus locaux ne date pas d’hier. Les maux sont anciens et profonds, et le Sénat a produit, ces dernières années, d’excellentes propositions sur les moyens d’y remédier, dont aucun gouvernement ne s’est, hélas, emparé.
J’ose espérer qu’il en ira différemment du rapport remarquable que vient de rendre public notre délégation aux collectivités territoriales, car la démission récente d’un certain nombre de maires, notamment en Essonne, et le souhait exprimé par la moitié des autres de ne pas se représenter en 2020 sont très préoccupants.
La crise des « gilets jaunes » met en lumière, une fois encore, la nécessité de ces médiateurs compétents que sont les élus locaux dans notre vie démocratique, implantés au cœur des territoires. Ils sont les garants de la République, solides, disponibles, rigoureux et, surtout, à l’écoute de leurs concitoyens.
Je vous pose donc, madame la ministre, la question suivante : quand le Gouvernement prendra-t-il enfin toute la mesure de la détresse des élus locaux et mettra-t-il en débat les questions essentielles ? Vous êtes bien satisfaits de pouvoir compter sur eux pour faciliter le grand débat national ; il sera judicieux de ne pas les oublier à l’issue de cette consultation.
Le chantier de la rénovation est en effet immense. Vous aurez à repenser l’organisation territoriale, source de complexité, les compétences des collectivités et leur enchevêtrement, le régime indemnitaire des élus locaux, démantelé par le précédent gouvernement, la protection sociale, largement perfectible, la formation tout au long du mandat et la reconversion des élus au terme de celui-ci et, enfin, la question de la responsabilité pénale, qui paralyse l’action publique en suscitant la crainte d’une mise en cause personnelle.
Nos élus attendent des réponses précises, des moyens d’agir, mais aussi de la considération. Notre démocratie a besoin de respirer et ceux qui la servent de retrouver espoir.
M. Édouard Courtial applaudit.

Madame la sénatrice Laure Darcos, d’abord, sachez-le, je n’ai pas attendu d’être ministre pour avoir de la considération pour les élus locaux ; je l’ai été pendant de très longues années et ma considération pour eux est réelle.
Par ailleurs, je ne suis pas « satisfaite », comme vous dites, de les retrouver pour le grand débat ; je trouve très légitime que les élus y soient associés et qu’ils y prennent toute leur place, puisqu’ils représentent la démocratie locale.
Vous parlez de la « détresse » des maires. Je me permets de vous le signaler, si certains maires sont, effectivement, en détresse, il faut aussi éviter de dramatiser les choses, afin de protéger la démocratie représentative ; il convient toujours d’équilibrer ses propos quand on parle des élus locaux, de ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain, sans quoi on s’oriente vers des crises que plus personne ne pourra maîtriser.
Considérez ce qui a été fait dans le passé ; bien des lois et des réglementations ont été adoptées pour accompagner les élus locaux dans l’exercice de leur mandat ; ici même, au Sénat, sous les précédents gouvernements, quels qu’ils soient, il y a eu des avancées ; j’y ai moi-même participé.
Sans doute, il y a encore des choses à faire et, dans le cadre du grand chantier de la Conférence nationale des territoires sur le statut des élus locaux, la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales, présidée par Jean-Marie Bockel, a conduit une étude approfondie sur les conditions d’exercice des mandats. Ses conclusions ont été présentées à la fin de septembre 2018 ; la délégation y fait notamment le constat de l’amélioration continue de l’exercice des mandats locaux, mais elle estime nécessaire d’en rajouter – clarifications, complément et adaptation de leur régime social, ou autres.
Depuis la remise de ce rapport, je poursuis les travaux de réflexion afin d’agir par la voie législative ou réglementaire, car tout ne se règle pas par la loi.
Toutefois, je veux rappeler certaines mesures d’ores et déjà prises en faveur de l’amélioration du régime social : les élus locaux bénéficieront d’un formulaire d’affiliation au régime général de la sécurité sociale spécifique, d’une rubrique dédiée aux élus locaux sur le site ameli.fr, d’une information donnée à leur médecin pour les autoriser, lorsque c’est possible, à exercer leur mandat durant leur congé maladie – cela était réclamé avec insistance –, d’une clarification des modalités d’assujettissement des cotisations des collectivités aux régimes de retraite facultatifs par rente des élus, ou encore d’une application simplifiée des dispositions en matière de retraite complémentaire.
Je n’oublie pas non plus ce qui a été adopté, ici, au Sénat, au travers de la loi de finances, à propos de l’imposition des revenus des élus, sur la partie représentative des frais de mandat ; cela allégera la fiscalité des élus.

Beaucoup de choses ont été faites et d’autres suivront peut-être ; on ne peut donc pas dire que nous ne faisons rien.

Madame la ministre, je ne remets nullement en cause le fait que vous soyez proche des élus, et je suis d’ailleurs ravie que ce soit vous qui me répondiez. Néanmoins, sans vouloir dramatiser, je vous assure que le malaise est beaucoup plus profond qu’on ne le dit, et je ne voudrais pas que cela soit oublié lors de ce grand débat.
Le président Larcher le soulignait très justement hier matin, lors de ses vœux aux grandes associations d’élus, réunies au Sénat sous la bannière des Territoires unis, il faut restaurer un serment de confiance avec les élus. Les collectivités doivent être de vrais partenaires et non simplement des services de l’État. Il est urgent de réaffirmer les énergies des territoires en consolidant la légitimité des élus.

La parole est à Mme Maryse Carrère, auteur de la question n° 572, adressée à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en juin 2018, le département des Hautes-Pyrénées a été une nouvelle fois touché par une vague d’intempéries, occasionnant d’importantes crues et des dégâts matériels majeurs pour les collectivités locales.
Je tiens d’ailleurs à saluer l’ensemble des maires et des équipes techniques mobilisées lors de ces intempéries, qui ont travaillé sans relâche pour remettre leurs communes en état ; l’inspecteur du Conseil général de l’environnement et du développement durable, présent la semaine dernière sur mon territoire, a pu le constater.
Pour faire face à ces dégâts, nombre de collectivités de mon département ont demandé à bénéficier de la dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales prévue à l’article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales.
Si le fonctionnement de ce dispositif a été amélioré en 2016, des difficultés subsistent. Entre l’évaluation des dégâts, l’estimation du coût des travaux, la première décision sur les financements ou les arrêtés attributifs de subventions et le versement de cette dotation, il s’écoule généralement plus d’un an. Pour les collectivités les plus fragiles, ce délai est, hélas, beaucoup trop long. Cette situation les laisse dans l’embarras.
En effet, nombre d’entre elles n’ont pas une trésorerie suffisante et doivent avancer le financement de travaux, lesquels ne peuvent attendre pour des raisons de sécurité.
La commune de Bourg-de-Bigorre, par exemple, dans les Hautes-Pyrénées, a dû avancer près de 180 000 euros de travaux, alors même que son budget moyen annuel est largement inférieur à cette somme.
Madame la ministre, quand les dotations de solidarité pour les intempéries de juin 2018 seront-elles versées ? Et surtout, comment le dispositif d’octroi de cette dotation de solidarité pourrait-il être simplifié ? Au-delà de cette question, c’est à une invitation à la discussion, à la mise en place d’une réflexion que je vous invite, pour répondre à la détresse de territoires qui doivent faire face, en plus d’être frappés par des crues, à des conditions financières insoutenables.

Madame la sénatrice Maryse Carrère, nous savons que le département des Hautes-Pyrénées a subi en 2018, comme d’autres départements, des intempéries d’une violence exceptionnelle.
La récurrence de ces événements depuis 2013 a fragilisé les milieux, ouvrages et infrastructures, et pèse sur les collectivités et sur les populations soumises à rude épreuve.
Comme vous le savez, l’État s’est fortement mobilisé pour trouver des solutions opérationnelles. Et ce d’autant plus que ces intempéries ont frappé des communes rurales dont les budgets, comme vous l’avez souligné, ne leur permettent pas de faire face aux dégâts subis sur leurs biens.
La solidarité nationale, au travers du fonds de solidarité, a donc un rôle très important. Le montant débloqué cette année a atteint 40 millions d’euros, compte non tenu du plan spécifique en faveur de l’Aude.
Ainsi, pour les biens non assurables des collectivités, des subventions peuvent être versées en soutien. Le taux de subventionnement varie de 30 % à 80 % selon la charge que les dégâts font peser sur le budget de la collectivité.
Toutefois, ce dispositif nécessite une évaluation précise des dommages à réparer, réalisée obligatoirement par le Conseil général de l’environnement et du développement durable, le CGEDD, lorsque les dégâts dépassent le million d’euros. Cette expertise est indispensable.
Sur le fondement de cette évaluation, le montant de l’aide est ensuite arrêté par mes services, avant d’être versé aux collectivités.
Dans le cas précis qui vous intéresse, la mission du CGEDD s’est rendue sur place la semaine dernière. Elle travaille en ce moment même à l’évaluation des dégâts éligibles à un soutien de l’État.
Dès que ses conclusions seront connues, nous pourrons très rapidement prendre une décision afin d’arrêter le taux de concours adéquat. Je veillerai avec la plus grande attention à ce que les montants attribués puissent être versés aux collectivités concernées dans les meilleurs délais.
Enfin, je tenais à porter à votre attention le fait que la préfecture du département, consciente des délais d’instruction que je viens d’évoquer, a déjà mobilisé en cours d’année les moyens « classiques » à sa disposition : un peu plus de 374 000 euros au titre de la DETR – dotation d’équipement des territoires ruraux – ont ainsi été débloqués pour aider 23 des collectivités impactées par des intempéries graves, couvrant ainsi 42 % des premiers travaux à réaliser en urgence.

Je vous remercie de votre réponse, madame la ministre.
Plus que sur les moyens mis en œuvre systématiquement par l’État au nom de la solidarité nationale, c’est sur la lenteur des procédures que je souhaite insister : devoir attendre un an est compliqué.
Faire confiance à l’État « local », au travers des préfectures, pourrait peut-être constituer une avancée.

Ce sont d’ailleurs les services des préfectures qui font les premières évaluations sur le terrain, car ils sont les plus à même de les faire.
Comme vous l’avez vous-même souligné, le fait que l’État soit tenu d’apporter une compensation via la DETR est bien la preuve que ce système est complexe et doit encore être amélioré.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, auteur de la question n° 534, adressée à M. le ministre de l’intérieur.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, une circulaire prise par les ministères de l’intérieur et de l’Europe et des affaires étrangères, le 24 mai 2018, vient de donner un cadre à l’action extérieure des collectivités territoriales françaises.
Selon une de ses dispositions, « les collectivités ne peuvent se lier, par convention ou non, sous quelque forme que ce soit, à des autorités locales étrangères établies dans un cadre institutionnel non reconnu par la France ».
Monsieur le ministre, je souhaiterais savoir dans quelles conditions votre ministère pourrait mettre en œuvre cette interdiction en ce qui concerne les chartes d’amitié signées par les collectivités territoriales de la France et de l’Artsakh.
Sauf meilleure appréciation juridique – que je suis prêt à entendre –, il me semble que ces chartes d’amitié constituent non pas des actes juridiques susceptibles d’être soumis à un contrôle de légalité, mais, en quelque sorte, des déclarations d’ordre politique par lesquelles ces collectivités proclament leur attachement à l’amitié entre les peuples et aux droits de ces derniers à disposer d’eux-mêmes.
Elles agissent ainsi dans le strict respect des engagements de la France et du droit international, qui reconnaît à chaque peuple le choix libre et souverain de déterminer la forme de son régime politique.
Je pense donc, pour conclure, qu’il est discutable d’assimiler toutes les déclarations d’une collectivité, même sans aucune portée juridique, et donc ces chartes d’amitié, à des actes contractuels engageant la collectivité.
Aussi, je souhaiterais vivement que cette disposition très restrictive de votre circulaire soit appliquée sur le terrain avec discernement et circonspection.
Monsieur le sénateur, cette question aurait aussi pu être posée à Jacqueline Gourault, au regard des attributions de son ministère.
Toujours est-il que ni elle ni moi ne pouvons vous donner une réponse juridique précise sur votre analyse, que je ne conteste pas.
L’action extérieure des collectivités territoriales est régie par les articles L. 1115-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Il s’agit, tout d’abord, de permettre au ministère de l’Europe et des affaires étrangères d’organiser une politique internationale – notamment en ce qui concerne la reconnaissance de pays étrangers – au nom de la République française et, ensuite, de laisser les collectivités locales faire vivre ces coopérations, ces actions diverses, parfois au travers de documents pouvant emporter, selon l’interprétation qui en est faite, engagement juridique.
Sur ce dernier point, je ne suis, hélas, pas en mesure de répondre en termes d’analyse juridique. Je peux toutefois vous faire part de l’état d’esprit qui nous anime.
Cette circulaire, portée par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, dans ce cadre d’organisation de la coopération décentralisée, précise que les collectivités territoriales ne peuvent se lier, sous quelque forme que ce soit, à des autorités locales étrangères établies dans un cadre institutionnel non reconnu par la France, ce qui est le cas de la république autoproclamée du Haut-Karabagh, dite aussi république d’Artsakh, qui n’est ainsi reconnue ni par la France ni par aucun autre État.
Tout acte présentant un caractère d’engagement juridique pris par une collectivité locale fait ainsi l’objet dans un premier temps, dans le cadre du contrôle de légalité des préfets, d’un recours gracieux. Si cet acte n’est pas retiré, il est alors soumis au contrôle du juge.
Vous nous demandez si une charte d’amitié constitue un acte juridique pouvant faire l’objet d’un recours devant le tribunal au titre de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités locales.
Il s’agit aujourd’hui d’un problème d’interprétation juridique. Les préfets, en application de cette circulaire, procèdent à des recours gracieux. Si jamais la collectivité concernée ne souhaitait pas donner suite, elle pourrait saisir le juge administratif, sur le fondement de l’article que je viens d’évoquer.
Aujourd’hui, nous ne disposons pas d’une jurisprudence sur cette question. Je ne suis donc pas en mesure de vous dire le droit. En l’espèce, cette compétence relève du juge administratif. Je ne puis que vous faire part des instructions données aux préfets pour appliquer cette circulaire. Seule une jurisprudence pourrait nous éclairer davantage.

Vous vous en doutez, monsieur le ministre, je ne suis pas entièrement satisfait par votre réponse.
Vous reportez votre responsabilité sur une jurisprudence à venir. J’ai senti, dans la première partie de votre propos, une forme de mansuétude à l’égard de ces actes qui constituent plutôt des déclarations d’amitié.
J’aimerais simplement que les préfets, sur le terrain, regardent ces déclarations comme des actes qui n’engagent absolument pas la France. Je respecte, tout à fait, sur ce point précis, les engagements internationaux de la France.
J’aimerais donc que les préfets fassent preuve d’une certaine mansuétude, d’une certaine ouverture par rapport à des actes relevant de la tradition française – liberté et droit des peuples à décider d’eux-mêmes –, que nous portons depuis la Révolution de 1848.

La parole est à Mme Françoise Cartron, auteur de la question n° 583, adressée à M. le ministre de l’intérieur.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d’abord rendre hommage et saluer la mémoire des deux pompiers qui ont trouvé la mort en intervention, voilà un peu plus d’une semaine, rue de Trévise, à Paris.
Monsieur le ministre, je souhaiterais appeler votre attention sur la préservation de notre modèle français, à la fois singulier et reconnu pour son efficacité, qui allie sapeurs-pompiers volontaires et professionnels au service de la sécurité de tous nos concitoyens.
Ce modèle repose sur la complémentarité des actions de ces deux corps. Or la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France s’inquiète d’un texte qui viendrait transposer en droit interne une directive européenne relative à l’aménagement du temps de travail.
Je me suis entretenue, voilà quelques jours, avec le président de l’Union départementale des sapeurs-pompiers de Gironde, lequel m’a relayé un certain nombre d’inquiétudes.
Ainsi, toute assimilation des sapeurs-pompiers volontaires à des travailleurs pourrait, semble-t-il, altérer profondément le cadre juridique qui les concerne en intervention, passant d’une logique de disponibilité à une logique de cumul d’emplois, ce qui occasionnerait de multiples difficultés tant pour les sapeurs-pompiers volontaires que pour leurs employeurs.
À terme, ils s’inquiètent de la diminution, voire du tarissement, du recrutement des pompiers volontaires, pourtant indispensables. Pour cette raison, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France demande aux pouvoirs publics de solutionner directement cette question en menant une initiative auprès de l’Union européenne, pour permettre à notre modèle de secours de bénéficier d’un cadre plus sécurisant et de voir sa pérennité garantie.
Merci, madame la sénatrice, d’avoir cette pensée pour les deux pompiers décédés voilà une dizaine de jours, dans l’explosion d’un immeuble, situé 6 rue de Trévise, et qui ont sauvé, avec leurs camarades, une vingtaine de vies.
Simon Cartannaz et Nathanaël Josselin ont été salués par un hommage national, puis local. Je voudrais aussi évoquer la mobilisation touchante des habitants de Paris qui se sont retrouvés spontanément, dimanche après-midi, devant la caserne Château-d’Eau pour saluer leur mémoire et saluer l’ensemble des hommes et des femmes sapeurs-pompiers, quel que soit leur statut, militaires, professionnels ou volontaires.
Votre question porte sur la jurisprudence dite « Matzak », qui assimile le volontariat à des conditions de travail et qui fait appliquer la directive Temps de travail aux pompiers.
Il s’agit d’une bonne directive en ce qu’elle permet d’encadrer les conditions et le temps de travail de l’ensemble des salariés et des professionnels. Toutefois, c’est vrai, elle menace l’équilibre même de notre protection civile dans la mesure où elle assimile le volontariat à du temps de travail. Son application fragiliserait la totalité de l’édifice sur lequel notre modèle, assez unique, est construit.
Je suis élu d’un département rural dont 1 % de la population est engagée dans le volontariat. J’étais le maire d’une sous-préfecture, troisième centre du département, avec un seul professionnel : la totalité des engagements y est assurée, comme dans beaucoup des territoires que vous représentez, mesdames, messieurs les sénateurs, par le volontariat.
Il s’agit donc d’une préoccupation majeure. Nous allons agir sur deux niveaux : d’une part, en travaillant avec la Commission européenne pour faire entendre le caractère spécifique de l’activité de sapeur-pompier volontaire sans avoir nécessairement besoin de modifier la directive, ce qui serait un combat extrêmement long ; d’autre part, en nous appuyant notamment sur les articles 17 et 22 de la directive, qui visent toute une série de dérogations possibles, lesquelles, exploitées au maximum, devraient nous permettre, nous avons bon espoir, d’aboutir.
Il n’existe pas aujourd’hui de sanction possible ou de mise en cause de la France. Nous avons le temps. Je tiens ici à rassurer l’ensemble des sapeurs-pompiers volontaires de ce pays : il n’y a pas de menace sur leur engagement aujourd’hui et nous veillerons à ce qu’il n’y en ait pas demain.

Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre. Il y a une réelle inquiétude.
En Gironde, les pompiers volontaires jouent un rôle extrêmement important et sont très mobilisés. Je salue la démarche citoyenne de jeunes de moins de 16 ans qui se mobilisent, qui se dévouent, pour apprendre à devenir pompiers volontaires.
Il me semble donc très important de les rassurer et de leur dire de continuer leur engagement avec la même force.

La parole est à M. Rémy Pointereau, auteur de la question n° 529, adressée à M. le ministre de l’intérieur.

Monsieur le ministre, ma question porte sur un sujet qui agace un certain nombre de nos concitoyens, à savoir la délivrance du permis de conduire.

Depuis le 6 novembre 2017, les démarches concernant la délivrance du permis de conduire se font uniquement en ligne.
L’idée était d’étendre la procédure dématérialisée au permis de conduire pour, selon le communiqué de presse émis par les services de votre prédécesseur à l’époque, « un gain de temps très significatif pour les usagers ».
Malheureusement, en pratique, ce « gain » s’est transformé en perte de temps très significative, notamment en raison des dysfonctionnements du site de l’Agence nationale des titres sécurisés, l’ANTS, point de passage obligé pour obtenir son permis de conduire : bugs à répétition, messages d’erreurs, pages bloquées, disparitions de documents, pertes de e-photos dans la nature, demandes de justificatifs qui n’existent pas, voici un florilège des difficultés auxquelles sont confrontés nos concitoyens et qui apportent leur lot de temps perdu.
Une personne qui avait perdu son permis de conduire et qui avait fait une demande en novembre 2017 a dû attendre dix mois pour l’obtenir. Il y a de quoi s’arracher les cheveux !
Les réseaux sociaux sont devenus le défouloir des propriétaires de voitures ou des nouveaux conducteurs qui perdent patience. Certains assument publiquement prendre le risque d’encourir une amende délictuelle en circulant sans carte grise ou sans permis, parce que leur feuillet de permis temporaire n’est plus valable.
Malgré tout, certains conservent un brin d’humour. J’ai ainsi pu lire sur Twitter que le plus difficile n’est plus de passer le code ou la conduite, mais de réussir la demande en ligne !
Sourires.

Ma question est simple : comment faciliter la vie de nos concitoyens ? Ne serait-il pas pertinent de conserver un service en préfecture a minima pour ce type de problèmes ?
Monsieur le sénateur, l’usage des téléprocédures, c’est génial… quand ça marche !
Les mises en œuvre montrent souvent de grandes difficultés. Devant les décalages entre la théorie et le vécu que vous évoquez, et dont je ne doute pas – les sénateurs, qui sont les élus des territoires, se trouvent confrontés suffisamment souvent à ces récriminations –, il est nécessaire d’assurer une vraie fluidité.
Le premier problème posé par les téléprocédures est celui de la rupture numérique. Plusieurs de nos concitoyens n’ont pas accès au numérique. Pour y remédier, nous avons procédé à l’ouverture d’un grand nombre de centres – 300 dans toute la France –, qui doivent permettre à chacun de se connecter. Nous allons étendre ce dispositif aux maisons de services au public, bien réparties sur l’ensemble du territoire et souvent portées par des collectivités locales ou des EPCI, des établissements publics de coopération intercommunale. Cela nous permettra d’améliorer encore le système.
Se pose aussi la question de l’accessibilité numérique par rapport à l’outil et à sa complexité.
En ce qui concerne les bugs, il faut savoir que près de 4 millions de demandes en ligne ont été instruites – et plutôt bien instruites – depuis le 6 novembre 2017. Toutefois, il y a aussi eu de très nombreux dysfonctionnements.
Le ministère de l’intérieur – sur l’initiative d’un autre que moi, je n’en tire donc aucune gloire – a mis en place un certain nombre de procédures d’urgence pour résoudre ces difficultés et doter l’ANTS des moyens d’avancer sur cette question.
Nous avons ainsi ouvert un numéro d’appel spécifique. De même, le fait de pouvoir s’adosser à un mandat « papier » signé de l’élève permet à son école de conduite de valider les démarches en son nom.
Par ailleurs, la validation par l’usager de la création de son compte ANTS a été portée de vingt-quatre heures à sept jours.
En ce qui concerne les amendes délictuelles, des consignes très strictes ont été données pour que tous ceux qui ont effectué les démarches et qui peuvent l’établir ne soient pas inquiétés. Il serait anormal de les sanctionner pour un dysfonctionnement dont ils ne sont pas responsables.
Enfin, en 2018, de nombreux outils et de nouveaux moyens ont été développés. Il ressort, au-delà d’anomalies ponctuelles qui peuvent encore survenir, que le traitement médian d’une inscription au permis de conduire est aujourd’hui de 1 jour et celui d’une demande de titre de 2, 7 jours.
Il peut encore exister des anomalies. Si les sous-préfets et les préfets doivent en faciliter le traitement, n’hésitez pas non plus à les faire remonter. La téléprocédure doit encore s’améliorer et toutes les alertes que vous pourrez nous faire parvenir nous permettront de perfectionner le dispositif.

Merci de votre réponse, monsieur le ministre, qui me semble aller dans mon sens.
Vous reconnaissez en effet qu’un certain nombre de problèmes se posent. Il en va de même également des cartes grises.
Rien ne vaut le contact physique quand les choses se compliquent. Comme vous, je considère que la dématérialisation peut être utile dans certains domaines – je pense, par exemple, aux bulletins de salaire. Mais encore faut-il que les usagers soient égaux face au numérique. Or nombre de territoires ne sont pas alimentés par la fibre et ne disposent pas d’un débit suffisant.
Il me semblerait judicieux de conserver des services physiques, de faire en sorte qu’il y ait au moins un référent par département pour ces problèmes spécifiques.

La parole est à Mme Catherine Procaccia, auteur de la question n° 451, adressée à Mme la ministre du travail.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaitais attirer l’attention de Mme la ministre du travail sur l’application des dispositions de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi sur les contrats à temps partiel des étudiants.
Tous les contrats de travail à temps partiel conclus depuis le 1er juillet 2014 doivent prévoir une durée minimale d’activité d’au moins vingt-quatre heures par semaine.
Toutefois, une dérogation spécifique pour les étudiants âgés de moins de 26 ans qui poursuivent leurs études avait été votée, afin de leur permettre de bénéficier d’une durée de travail inférieure à ces vingt-quatre heures – qui représentent tout de même trois jours et demi de travail –, plus compatible avec la poursuite de leurs études, et selon une application très souple en cours de semaine.
Il s’agissait d’améliorer le niveau de vie des étudiants tout en leur permettant de poursuivre leurs études.
Cependant, certaines entreprises ou collectivités ont décidé d’aligner le temps minimal pour embaucher un étudiant sur la durée d’un mi-temps dérogatoire, soit dix-sept heures trente.
Cette durée impose à l’étudiant de travailler deux jours et demi par semaine, ce qui paraît difficilement compatible avec une scolarité sereine. Or il ne me semble pas que tel était l’esprit de la loi que nous avons votée.
Je souhaiterais donc savoir si la fixation d’une durée minimale excédant une journée ou deux jours de travail est conforme à la loi.
Madame la sénatrice, vous avez tout dit de la réalité, notamment de l’engagement d’un étudiant à la fois dans ses études et dans le monde professionnel.
L’obligation qu’ont certains étudiants de travailler est une première inégalité avec ceux qui n’ont pas besoin de le faire. Il s’agit non pas de les opposer, mais de constater cette inégalité dont témoigne l’analyse des résultats universitaires entre ceux qui se consacrent entièrement à leurs études et aux loisirs et ceux qui doivent travailler deux jours et demi ou trois par semaine pour financer leurs études. Il s’agit d’une injustice de fait.
Le texte que vous avez évoqué prévoit une règle, celle de la discussion par branche pour définir la durée minimale de travail des emplois à temps partiel. C’est aux partenaires sociaux qu’il revient de définir cette durée minimale applicable, qui peut se révéler très variable d’une branche à l’autre : la réalité peut être très différente dans une activité commerciale par rapport à une activité de services à la personne, par exemple.
S’il n’y a pas d’accord de branche, la loi prévoit l’application de la règle des vingt-quatre heures. Une dérogation de principe – que vous avez rappelée – est prévue pour les étudiants.
Ainsi, l’article L.3123-7 du code du travail prévoit qu’une durée de travail inférieure à la durée minimale applicable compatible avec ses études est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études.
Pour faire simple, il suffit d’un accord conventionnel entre l’employeur et l’étudiant pour considérer que neuf ou douze heures, par exemple, est un bon temps de travail.
Les entreprises ou collectivités qui appliquent la règle des dix-sept heures trente comme une règle à laquelle elles refusent de déroger ne respectent pas la dimension conventionnelle de la discussion qui doit exister entre l’employeur et le salarié.
Ces employeurs peuvent avoir un schéma d’organisation qui leur est propre, considérer que la durée de travail minimale normale est de dix-sept heures trente et exclure ceux qui veulent travailler moins. Mais il ne s’agit en aucun cas d’une obligation.
Les entreprises et collectivités concernées ont une totale liberté. Je veux être très clair : la liberté repose dans la discussion entre l’employeur et le salarié étudiant. Le régime horaire peut être différent de ces dix-sept heures trente.
Votre question et la réponse que j’y apporte au nom de Muriel Pénicaud pourront permettre d’opposer ce principe de liberté conventionnelle pour les étudiants de moins de 26 ans.

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour répondre à M. le ministre.

Je vous remercie de cette réponse claire, monsieur le ministre.
La plupart du temps, il n’y a effectivement pas d’accord. Un certain nombre d’entreprises imposent de travailler dix-sept heures trente ou quinze heures.
J’ai contacté différentes directions des ressources humaines et j’ai pu constater que les durées minimales de travail pouvaient être très variables, même en cas d’accord de branche. Certains employeurs acceptent une durée minimale de douze heures, par exemple, ce qui est déjà bien par rapport à d’autres.
Cette réponse, qui sera publiée au Journal officiel, pourra servir aux entreprises et aux collectivités.

La parole est à M. Yannick Vaugrenard, auteur de la question n° 150, adressée à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, en mai 2016, l’Union française des orthoprothésistes a lancé une mission d’audit sur le système réglementaire du grand appareillage orthopédique, le GAO.
Les conclusions de cet audit, paru en juin 2017, présentent le GAO comme un secteur à part dans les dispositifs médicaux pour la prise en charge du handicap lourd.
Le GAO offre en effet un large spectre de fonctions pour une pluralité de pathologies, avec des parcours de soins pluridisciplinaires. Il est également fortement encadré, puisque la prise en charge relève quasi exclusivement de la liste des produits et prestations remboursables par l’assurance maladie, avec l’obligation d’une entente préalable à l’obtention de l’appareillage.
Dans ce contexte, l’audit relève que le système réglementaire encadrant le GAO est parvenu à ses limites. Il est devenu obsolète pour les professionnels et pour les projets de vie des patients. Ce système de prise en charge ne permet plus de répondre aux besoins de l’ensemble des parties prenantes. Le constat a été unanimement confirmé en juin 2017, lors du congrès annuel de l’Union française des orthoprothésistes.
Une refonte de la nomenclature est donc indispensable, afin de mettre en place un outil de prise en charge médicalisé et évolutif, qui comprendrait à la fois la prescription médicale, la méthodologie tarifaire et le processus d’inscription.
Les professionnels ont approuvé la proposition de réaliser la refonte de la nomenclature en quatre étapes. Il s’agit, tout d’abord, de la redéfinir pour créer un guide à la prescription, en fonction du projet de vie du patient. Il convient, ensuite, de fixer une nouvelle grille tarifaire, puis de définir un modèle dynamique de réactualisation des lignes, afin de pérenniser l’équité de la nomenclature et, enfin, de redéfinir le processus d’inscription des innovations, pour l’adapter aux caractéristiques du GAO et aux besoins de compensation du handicap.
Je souhaiterais donc savoir, madame la secrétaire d’État, si le Gouvernement envisage la refonte de la nomenclature des appareils orthopédiques. Le cas échéant, pouvez-vous préciser le calendrier et les modalités envisagées, notamment concernant la prise en charge des patients ?
Monsieur le sénateur, les nomenclatures régissant la prise en charge des dispositifs médicaux sont particulièrement importantes : elles définissent les produits qui peuvent être pris en charge, les conditions de prescription et les modalités de délivrance.
Bien définir ces nomenclatures permet des soins de qualité et favorise la pertinence des prises en charge. Il s’agit donc d’une étape essentielle.
Dans le cadre du plan Ma santé 2022, le Gouvernement a demandé que les nomenclatures de la liste des produits et prestations fassent toutes l’objet d’une revue d’ici à 2022, pour vérifier, pour chacune d’entre elles, si elles étaient toujours à jour ou si, au contraire, des évolutions étaient nécessaires.
L’année 2018 a été marquée par la révision de deux nomenclatures importantes, relatives à l’optique et aux aides auditives, dans le cadre des travaux du 100 % santé permettant de disposer d’éléments de qualité sans reste à charge.
En 2019, plusieurs nomenclatures ont déjà fait l’objet d’un engagement de travaux : celle qui est relative aux perruques devrait aboutir dans les prochaines semaines, mais nous travaillons également à des révisions importantes concernant les implants du rachis, les dispositifs de l’incontinence urinaire et fécale, ou encore les implants d’embolisation.
S’agissant du grand appareillage orthopédique, l’enjeu principal à court terme est de disposer d’informations plus précises sur les produits faisant actuellement l’objet d’un remboursement.
Ce champ est en effet l’un des derniers secteurs de la liste des produits et prestations pour lequel on ne dispose pas d’un codage numérique, ce qui ne permet pas d’avoir un suivi fin de la dépense.
Nous allons donc mettre en place un codage numérique dans les semaines à venir pour le grand appareillage orthopédique. Lorsque nous aurons à disposition des données plus fines de remboursement, nous pourrons mieux analyser les conditions de prise en charge actuelles, et voir si elles doivent évoluer.

La parole est à M. Yannick Vaugrenard, pour répondre à Mme la secrétaire d’État.

J’espère, madame la secrétaire d’État, que votre réponse donnera satisfaction à l’Union française des orthoprothésistes et que le codage numérique que vous venez d’évoquer permettra une évolution rapide.
Vous l’avez indiqué, l’horizon retenu est celui de 2022. Souhaitons que ce délai soit raccourci, dans la mesure où la demande semble assez forte.

La parole est à M. Philippe Mouiller, auteur de la question n° 533, adressée à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, ma question porte sur la situation du centre hospitalier de Niort.
Cet établissement sort d’un long conflit social dû au manque de moyens et de personnels, notamment au sein de son service de psychiatrie.
Ce service connaît une situation très difficile sur le plan humain, mais également pour ce qui concerne les locaux d’hospitalisation, qui accueillent les patients les plus fragiles.
L’efficacité des projets qui y sont développés est aujourd’hui compromise, alors même que la psychiatrie et la santé mentale sont élevées au rang de priorité dans le cadre du plan national Ma santé 2022.
Les difficultés rencontrées par l’hôpital de Niort témoignent de l’inégalité constatée entre les territoires, dans la mesure où cet établissement dispose comparativement de moins de moyens financiers pour son bon fonctionnement.
Face à cette situation, de nombreux acteurs se sont mobilisés, que ce soient Jérôme Baloge, le maire de Niort, qui est aussi le président du conseil de surveillance, la direction, les élus locaux et, bien entendu, le personnel de l’établissement.
Des annonces récentes viennent d’être faites concernant de nouveaux moyens alloués. Ainsi, fin 2018, une enveloppe de 759 000 euros a été restituée, au titre des crédits dégelés.
Or, même si on peut saluer un tel apport en trésorerie, celui-ci n’a aucune incidence comptable. En effet, il s’agit non pas de moyens nouveaux, mais de la restitution du budget préempté, comme les années précédentes, au début de l’année 2018, qui représente 0, 7 % des tarifs de la tarification à l’activité, la T2A. Pouvez-vous me confirmer ce point, madame la secrétaire d’État ?
Par ailleurs, concernant plus précisément la psychiatrie, le Gouvernement a décidé d’attribuer une enveloppe nationale de 50 millions d’euros. Ainsi, 91 000 euros ont été alloués à l’hôpital de Niort en nouveaux fonds pérennes annuels, sur les 2, 4 millions d’euros destinés aux établissements de la région.
Cette somme, même si elle a le mérite d’exister, semble ne pas être à la hauteur des besoins nécessaires au bon fonctionnement de ce service. Comment imaginer l’avenir dans de telles conditions ?
Monsieur le sénateur, vous avez souhaité appeler l’attention du Gouvernement sur le centre hospitalier de Niort, et plus particulièrement sur son service de psychiatrie.
Vous avez raison, la situation de la démographie médicale et soignante dans le département des Deux-Sèvres a été compliquée, mais le conflit social au centre hospitalier, que vous évoquez, est aujourd’hui en phase d’extinction, grâce à un dialogue social de qualité conduit par la direction de l’établissement depuis le mois de septembre 2018.
Ce dialogue a permis d’aboutir à la signature d’un protocole de fin de conflit, approuvé par trois organisations syndicales sur quatre. L’accord global permet de renforcer les équipes, en accélérant notamment les recrutements infirmiers, de convenir des modalités de remplacement favorisant la qualité de vie au travail et de faciliter les passages en CDI pour le personnel paramédical.
S’agissant des moyens alloués au centre hospitalier de Niort, je vous confirme que l’établissement bénéficiera de 759 000 euros supplémentaires par rapport aux dotations attribuées en cours d’année 2018, au titre du dégel des crédits annoncé en décembre dernier.
Concernant enfin la situation générale de la psychiatrie, vous connaissez notre engagement en faveur de ce secteur, qui s’est traduit, dès la fin de l’année 2018, par l’octroi de moyens financiers pérennes supplémentaires à hauteur de 50 millions d’euros, dont 91 000 euros pour le centre hospitalier de Niort.
Notre feuille de route sur la santé mentale et la psychiatrie vise l’amélioration des conditions de vie, l’inclusion sociale et l’amélioration de l’accès aux soins et aux accompagnements. Nous favorisons une approche transversale de la politique de santé mentale, territorialisée, dans une dynamique d’« aller vers » et de renforcement du pouvoir d’agir des patients.
Le centre hospitaliser de Niort dispose d’atouts importants pour s’approprier pleinement ces orientations et y contribuer par ses actions.

La parole est à M. Philippe Mouiller, pour répondre à Mme la secrétaire d’État.

Vous venez, madame la secrétaire d’État, de confirmer les chiffres que j’ai moi-même avancés. Mes informations étaient donc justes.
Toutefois, s’agissant de la psychiatrie à Niort, le problème reste entier. Je salue la direction de l’hôpital, qui a effectué un vrai travail de concertation avec les différents acteurs pour sortir du conflit local. Mais les réponses apportées sont de court terme. Aujourd’hui, à l’hôpital de Niort, les moyens ne sont pas à la hauteur des besoins.
Le problème est d’ailleurs général. Je le rappelle, partout en France, les professionnels de santé relevant du secteur psychiatrique sont dans la rue, pour alerter le Gouvernement sur le manque de moyens et le décalage entre les discours, qui considèrent la psychiatrie comme un domaine prioritaire, et les moyens alloués. Il faut donc revoir la copie, à Niort, mais aussi sur l’ensemble du territoire national.

La parole est à M. Bernard Delcros, auteur de la question n° 536, adressée à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Madame la secrétaire d’État, ma question concerne le plan Ma santé 2022. Élu du Cantal, je mesure de manière très concrète la réalité du décrochage de certains territoires en matière d’offre de soins, pour l’accès tant à un médecin généraliste qu’à des spécialistes, dont les délais de rendez-vous atteignent régulièrement six mois, voire huit mois, un an, et parfois davantage.
Je tiens à saluer le plan gouvernemental Ma santé 2022, qui peut, selon moi, apporter un certain nombre de réponses. Toutefois, nous le savons, plusieurs des mesures proposées ne porteront leurs fruits que progressivement. Par exemple, il faudra une décennie pour mesurer les effets concrets, sur le terrain, de la suppression du numerus clausus.
Or certains territoires sont confrontés à des situations d’urgence, qui appellent des réponses d’urgence.
C’est pourquoi j’aimerais revenir sur deux dispositions annoncées dans le cadre de ce plan, lesquelles, selon moi, pourraient améliorer rapidement la situation, à savoir la création de 4 000 postes d’assistants médicaux et le déploiement de 400 médecins généralistes salariés dans les territoires prioritaires.
Ces professionnels salariés pourront-ils exercer dans les maisons pluriprofessionnelles de santé ? L’État est-il prêt à assurer le financement de ces postes dans de telles structures, notamment dans les territoires ruraux, au regard des faibles moyens des collectivités ? Il faut en effet éviter que ces territoires ne soient soumis au régime de la double peine : une offre de soins réduite et la nécessité, pour la conserver, de financer des emplois de professionnels de santé salariés.
Enfin, madame la secrétaire d’État, pouvez-vous nous apporter davantage de précisions quant au calendrier de mise en œuvre de ces mesures, tout particulièrement dans le Cantal, où plusieurs territoires, aujourd’hui confrontés à la désertification médicale, atteignent un point de rupture ?
Monsieur le sénateur, le Gouvernement partage votre analyse de la situation.
Les difficultés d’accès aux soins que connaissent trop de Français sont une préoccupation majeure, et c’est tout l’enjeu auquel doit répondre la stratégie de transformation du système de santé.
Dans votre département, le nouveau zonage en date du 26 avril 2018 classe l’ensemble du Cantal en zone d’intervention prioritaire. Des actions complémentaires doivent permettre de mobiliser l’ensemble des dispositifs incitatifs individuels et collectifs aujourd’hui disponibles.
Des mesures volontaristes sont menées sur le département afin de contribuer au maintien de l’offre de soins, au travers notamment des contrats locaux de santé, les CLS.
Le contrat signé le 24 avril 2018 entre l’agence régionale de santé et les communautés de communes Hautes Terres Communauté et Saint-Flour Communauté est l’illustration des démarches partenariales nécessaires pour améliorer l’attractivité des territoires.
Le projet de loi que nous présenterons dans quelques semaines sera la première pierre de la restructuration des soins de proximité et de la constitution d’un collectif de soins.
Des ponts et des outils de coopération seront facilités entre hôpital, ville et secteur médico-social.
L’exercice coordonné a vocation à se développer, la gradation des soins à être clarifiée et assumée, pour fluidifier le parcours des patients et améliorer la qualité, la sécurité et la pertinence des soins dispensés.
Concernant vos interrogations sur le projet de 400 médecins généralistes à exercice partagé entre la ville et l’hôpital en zone sous-dense, l’objectif général est de concrétiser l’engagement présidentiel par le biais de deux dispositifs distincts. Le premier volet concerne le déploiement de postes d’assistants à temps partagé entre la ville et l’hôpital en médecine générale. Quant au deuxième volet, il vise à soutenir la création de postes salariés dans les zones sous-denses, dont le département du Cantal fait partie.
Des actions d’information à l’attention des établissements de santé ont d’ores et déjà été réalisées, afin de recueillir des candidatures potentielles.

La parole est à M. Bernard Delcros, pour répondre à Mme la secrétaire d’État.

Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, de votre réponse, qui va dans le bon sens.
Je souhaite toutefois insister sur l’urgence qu’il y a à apporter des réponses dans certains territoires. En effet, si l’offre de soins est le premier critère d’attractivité d’un territoire, elle peut devenir, demain, le premier critère d’abandon. Nous aurons l’occasion de revenir sur cet aspect, mais je pourrais vous citer des territoires qui sont vraiment au bord de la rupture en matière d’offre de soins. Il est nécessaire d’apporter très rapidement des réponses concrètes à ces territoires prioritaires.

La parole est à M. Dominique Théophile, auteur de la question n° 587, adressée à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Madame la secrétaire d’État, lors de sa visite aux Antilles à la fin du mois de septembre dernier, le Président de la République a reconnu la pollution des sols de Martinique et de Guadeloupe par la chlordécone comme un « scandale environnemental », pour lequel l’État doit assumer sa part de responsabilité.
Comme vous le savez, la chlordécone n’a été interdite en France que tardivement, soit quinze ans après les alertes de l’OMS, l’Organisation mondiale de la santé, et alors que des centaines de tonnes de cette substance avaient été déversées sur les bananeraies de Guadeloupe et de Martinique. Les travailleurs de ces bananeraies ont été surexposés à la molécule et, par la consommation de produits maraîchers, un grand nombre de la population a été contaminé. La chlordécone fait donc peser un risque sanitaire grave sur les citoyens d’outre-mer pour plusieurs centaines d’années.
Le 27 septembre 2018, le Président de la République a annoncé l’ouverture d’une procédure de reconnaissance de l’exposition à la chlordécone comme maladie professionnelle. Nous saluons cette initiative. Cependant, la question du cancer de la prostate demeure.
En effet, je tiens à le rappeler, les Antilles françaises détiennent un triste record en la matière, le taux d’incidence annuel de ce cancer en Martinique étant de 227 cas sur 100 000 hommes. En Guadeloupe, la situation est quasiment identique. Or les études sur le lien entre la chlordécone et le cancer de la prostate sont encore trop peu nombreuses, bien qu’elles soient indispensables pour ne pas exclure ce phénomène massif et dramatique de la démarche présidentielle.
J’en viens à ma question. L’étude confiée à l’INSERM, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, et à l’ANSES, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, sur le lien entre l’exposition à la chlordécone et les pathologies constatées, qui sera la base de leur reconnaissance comme maladies professionnelles, concernera-t-elle le cancer de la prostate ?
Dans le cas contraire, le Gouvernement compte-t-il lancer un appel à projets pour qu’une étude soit menée sur ce record malheureux ?
Monsieur le sénateur, le ministère chargé de la santé copilote, avec le ministère des outre-mer et en liaison avec les ministères concernés, à savoir les ministères de l’agriculture, de l’environnement, de l’économie et de la recherche, le plan Chlordécone III.
Dans ce cadre, le ministère chargé de la santé a contribué au financement d’une étude sur le cancer de la prostate réalisée par l’INSERM au cours de la période 2004-2007 en Guadeloupe.
Cette étude était destinée à identifier les facteurs de risques environnementaux et génétiques de survenue du cancer de la prostate. Il s’agissait également d’étudier le lien éventuel entre l’exposition à la chlordécone et le risque de survenue de ce cancer.
Ses conclusions, publiées dès 2010, ont montré que, chez les hommes dont la concentration en chlordécone dans le sang est la plus forte, le risque de survenue du cancer de la prostate est plus élevé. Cette probabilité est influencée par l’âge, le patrimoine génétique, les habitudes alimentaires et les habitudes de vie des hommes exposés.
Une autre étude – l’étude de cohorte KP Caraïbes –, également cofinancée par le ministère chargé de la santé, est actuellement menée par l’INSERM afin d’évaluer en Guadeloupe, et si possible en Martinique, l’impact des expositions à la chlordécone dans l’évolution du cancer de la prostate en fonction des parcours thérapeutiques.
En outre, l’Institut national du cancer a été saisi par le ministère chargé de la santé en avril 2018, en vue d’explorer la possibilité de mettre en place une étude pour répondre à la question du lien entre exposition à la chlordécone et survenue d’un cancer de la prostate, et d’organiser le lancement d’un appel à projets.
Cet institut a, dans ce cadre, réuni un comité d’experts internationaux sur la question. Il a rendu ses propositions au ministère en décembre 2018 sur la construction d’un programme de recherche interdisciplinaire sur le sujet, incluant une étude cas-témoins.
La proposition est en cours d’analyse avec le ministère chargé de la recherche. Un appel à projets sera donc lancé au cours du premier semestre 2019.
S’agissant des travaux sur la reconnaissance des maladies professionnelles en lien avec le cancer de la prostate et l’exposition aux pesticides, en particulier à la chlordécone, le ministère chargé de la santé a effectivement saisi l’INSERM et l’ANSES, respectivement le 24 avril 2018, avec un addendum le 28 septembre 2018 priorisant les travaux sur la chlordécone, et le 26 novembre 2018.
Ces travaux d’expertise, qui doivent être rendus dans le courant du premier semestre 2019, seront versés à l’instruction des commissions chargées de la création des tableaux de maladies.
À l’issue des travaux menés dans le cadre de ces instances, tout nouveau tableau de maladie professionnelle doit faire l’objet d’un décret du ministère chargé de la santé pour le régime général et d’un décret du ministère chargé de l’agriculture pour le régime agricole. Aussi, il sera nécessaire d’attendre la fin du second semestre 2019 pour voir aboutir la procédure en cours.

La parole est à M. Dominique Théophile, pour répondre à Mme la secrétaire d’État.

Madame la secrétaire d’État, je constate que les choses sont lancées. Nous attendons avec beaucoup d’intérêt les conclusions des différentes actions menées.

La parole est à Mme Martine Filleul, auteur de la question n° 570, adressée à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Madame la secrétaire d’État, je souhaite évoquer une conséquence souvent ignorée des déserts médicaux et des zones médicales tendues, où le nombre de praticiens est insuffisant par rapport à la population.
Ainsi, dans certains départements comme celui du Nord, à la perte d’un proche, des familles doivent parfois attendre de longues heures avant qu’un médecin n’arrive au domicile pour établir le certificat de décès, faute de médecins disponibles.
Ce certificat, qui ne peut être délivré que par des médecins, est un document indispensable pour pouvoir confier le corps aux pompes funèbres. Autrefois, son établissement incombait au médecin d’état civil. Mais avec la disparition de cette profession au début des années 2000, elle a été transférée aux libéraux.
Or, aujourd’hui, sur ces territoires, les médecins généralistes qui acceptent d’assurer cette mission se font rares, car, de moins en moins nombreux, ils sont souvent débordés. Sans rémunération en dehors des heures de permanence de soins ni indemnisation des frais de déplacement, et sans obligation de se déplacer, cette mission repose alors souvent sur la générosité et le bon vouloir des médecins traitants.
Dans certains cas, pour pallier ce manque, les services de police n’ont d’autre choix que de réquisitionner des médecins pendant leurs consultations.
Cette situation ubuesque inflige aux familles des défunts une double peine, celle de la perte d’un être cher, à laquelle vient s’ajouter celle de circonstances inhumaines, voire traumatisantes.
Aussi, madame la secrétaire d’État, quelles mesures le Gouvernement compte-t-il mettre en œuvre pour remédier à cet état de fait ?
Madame la sénatrice, le certificat de décès est un document médical. Le médecin doit indiquer les maladies ou affections morbides ayant directement provoqué le décès ainsi que les autres états morbides, facteurs ou états physiologiques ayant contribué au décès. Il peut aussi demander des investigations en cas de mort suspecte.
Ainsi, la certification du décès est un processus légal par lequel sont attestés par écrit le fait, la cause et les circonstances du décès d’une personne.
C’est pourquoi il n’est pas prévu de déléguer cet acte à d’autres professionnels de santé non médicaux, tels les infirmières et les infirmiers. Toutefois, pour faire face aux difficultés rencontrées, d’autres solutions ont été recherchées pour faire établir un certificat de décès à domicile en zones sous-dotées en médecins.
Une mesure de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 permet ainsi de valoriser la prise en charge de l’examen médical nécessaire à l’établissement du certificat de décès.
L’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès au domicile du patient réalisé par le médecin est ainsi rémunéré par un forfait de 100 euros lorsqu’il est réalisé en période de faible disponibilité médicale, à savoir la nuit, le week-end ou les jours fériés. Cette rémunération de 100 euros s’applique tous les jours et à toute heure dans les zones sous-dotées.
Plus largement, cette mesure financière s’inscrit dans un contexte d’amélioration de l’accès aux soins, et notamment de l’accès à un médecin.
L’objectif du Gouvernement est d’augmenter la ressource en médecine générale de ville, contribuant ainsi à une meilleure prise en charge des parcours, ce qui permet d’assurer la continuité et la permanence des soins. Ces plans permettront également de renforcer la capacité des médecins à répondre aux demandes des familles visant à l’établissement d’un certificat dans le contexte douloureux du décès d’un proche.

La parole est à Mme Martine Filleul, pour répondre à Mme la secrétaire d’État.

Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, de votre réponse. Les mesures que vous évoquez semblent susceptibles de faire avancer favorablement la situation.
Toutefois, ne serait-il pas opportun d’étudier la question d’une obligation déontologique et éthique des médecins pour ce qui concerne cette mission ?

La parole est à M. Jean-Luc Fichet, auteur de la question n° 558, adressée à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, l’exposition aux sons dans le cadre des concerts et des festivals représente un enjeu extrêmement important en matière de santé publique. Mme la ministre des solidarités et de la santé a récemment souhaité contribuer à répondre à cet enjeu légitime en cosignant le décret 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés.
Ce décret a considérablement bouleversé la réglementation sonore applicable aux concerts et festivals ainsi qu’aux établissements diffusant de la musique amplifiée.
Vous le savez, le Finistère et la Bretagne sont une terre de festivals, une terre de concerts et d’animations musicales rassemblant chaque année des milliers de personnes, particulièrement des jeunes.
Tous les professionnels concernés ont fait part de leurs profondes inquiétudes. Ils attendaient que des éclaircissements et des aides leur soient apportés avant la date butoir du 1er octobre 2018, date à laquelle devait être pris l’arrêté d’application.
À ce jour, l’arrêté n’a pas encore été publié et de nombreuses questions demeurent sur la baisse du niveau sonore et le plafond des basses fréquences associé à un point de mesure du son effectué en tout lieu accessible au public, sur l’obligation d’un repos auditif, sur l’étude d’impact des nuisances sonores étendues au plein air, et enfin sur la mise à disposition du public de protections auditives adaptées.
L’ensemble de ces nouvelles dispositions demande des évolutions techniques et technologiques, et implique la formation des personnels.
Concernant l’aspect financier de la nouvelle réglementation, l’impact est considérable pour un secteur dont l’économie est déjà fragile.
Enfin, certains points de la nouvelle réglementation semblent encore trop flous et sujets à interprétation lors de leur application.
C’est la raison pour laquelle, madame la secrétaire d’État, je souhaiterais que vous puissiez m’indiquer si une nouvelle concertation est envisageable. Elle permettrait non seulement de rendre plus précises, et donc plus facilement applicables et adaptées, toutes les mesures du texte, mais aussi d’accorder un délai supplémentaire à tous les acteurs du secteur avant l’arrêté d’application.
Monsieur le sénateur, en 2015, l’Organisation mondiale de la santé a lancé une alerte de santé publique concernant l’exposition des 12-35 ans à des niveaux sonores dangereux dans des lieux de loisirs tels que les bars, les discothèques ou les salles de concert.
La prévention des risques auditifs est ainsi inscrite dans la stratégie nationale de santé. Le décret du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés inscrit dans le droit les recommandations formulées par le Haut Conseil de la santé publique dans son avis de 2013. Il s’agit notamment de l’abaissement des niveaux sonores à ne pas dépasser et du renforcement de l’information et de la prévention du public dans les lieux de diffusion de sons amplifiés.
Ce décret prévoit que des arrêtés des ministres chargés de la santé, de l’environnement et de la culture précisent les conditions de mise en œuvre de la protection de l’audition du public, les indicateurs complémentaires à prendre en compte dans le cadre des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à un niveau sonore élevé pour préserver l’environnement et les conditions de réalisation de l’étude de l’impact des nuisances sonores pour les lieux et les activités concernés.
Depuis le 1er octobre 2018, le décret s’applique.
Afin d’accompagner les différents acteurs concernés par sa mise en œuvre, un projet d’arrêté unique a été élaboré et a fait l’objet de larges consultations, ainsi que de réflexions, pour déterminer les moyens techniques nécessaires à mettre en œuvre par les professionnels du secteur des spectacles vivants.
Le décret s’applique en l’état, même en l’absence de précisions particulières apportées par arrêté pour la mise en œuvre de la protection de l’audition du public.
À ce stade, en l’absence d’arrêté, les services des agences régionales de santé et les autres agents chargés des contrôles sont appelés à tenir compte de ce que les professionnels ont nécessairement besoin de temps pour s’adapter et mettre en œuvre certaines dispositions. En revanche, les professionnels sont d’ores et déjà censés respecter les niveaux sonores à ne pas dépasser définis par le décret.
Un colloque a été organisé le 5 décembre dernier par les ministères concernés pour accompagner les professionnels et les agents chargés des contrôles.
L’arrêté sera ainsi complété par une instruction et un guide de réalisation des études de l’impact des nuisances sonores, qui révisera le guide existant datant de 1998.

La parole est à M. Jean-Luc Fichet, pour répondre à Mme la secrétaire d’État.

Madame la secrétaire d’État, nul ne conteste la nécessité, en matière de santé publique, de prendre des dispositions relatives aux nuisances sonores.
Toutefois, pour ce qui concerne les festivals, le flou est tel qu’il rend l’exercice difficile pour les organisateurs. On pourrait d’ailleurs élargir ces difficultés aux problèmes posés par la sécurité et l’encadrement. Il sera donc nécessaire de leur adresser des documents très précis, afin qu’ils puissent prendre les dispositions nécessaires, qu’ils ne contestent évidemment pas.

La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, auteur de la question n° 559, adressée à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Madame la secrétaire d’État, ma question porte sur l’avenir du centre hospitalier universitaire Pasteur de Nice.
En septembre 2018, les médecins des services d’orthopédie et de traumatologie ont cessé temporairement leur activité compte tenu de risques pour la santé des patients, à la suite d’une dégradation des conditions de travail, qui se manifestait principalement par un manque d’anesthésistes, d’infirmiers et d’infirmières, mais aussi de brancardiers, et par un défaut de stérilisation avec un manque flagrant de matériel.
Lors du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, un amendement du Gouvernement a été adopté afin de dégeler 415 millions d’euros destinés aux établissements de santé, dont devrait bénéficier le CHU Pasteur de Nice.
En actionnant ce levier financier, le Gouvernement a donc souhaité faire bénéficier tous les hôpitaux de l’intégralité du fonds de financement qui leur est destiné, en amont des besoins, pour éviter le découragement des personnels hospitaliers face aux restrictions budgétaires.
Outre ce budget national, la métropole Nice-Côte d’Azur a adopté à l’unanimité une motion visant « à soutenir le CHU et à proposer à la ministre de la santé d’engager un dialogue conjoint avec la métropole et l’agence régionale de santé, pour établir une feuille de route qui permettra aux équipes du CHU de Nice de retrouver, sans tarder, un niveau de soins plus optimal pour tous les patients ».
Madame la secrétaire d’État, quels ont été les montants exacts fléchés vers le CHU Pasteur de Nice à la suite du dégel de 415 millions d’euros voté dans le cadre du vote du PLFSS pour 2019 ? Quelle a été la réponse du Gouvernement à la motion présentée par la métropole Nice-Côte d’Azur, qui propose qu’un dialogue soit rapidement engagé, afin d’établir une feuille de route destinée aux professionnels de santé, lesquels attendent un apaisement de la situation, mais surtout une stabilité de leurs conditions de travail ?
Madame la sénatrice, le directeur général du CHU de Nice a engagé un audit sur l’ensemble des axes de fonctionnement des blocs opératoires de tous les sites du CHU de Nice.
Par ailleurs, une mission d’analyse du fonctionnement médical a été confiée à un praticien de l’établissement, afin de définir au mieux une nouvelle organisation des activités anesthésiques.
Devant l’importance des tensions et la répétition d’annonces de reports d’interventions chirurgicales, l’ARS PACA, l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, a conduit de son côté une mission qui a confirmé la réalité de difficultés importantes en matière d’organisation et d’équilibre des ressources entre les blocs opératoires.
Le CHU de Nice est engagé dans un plan de modernisation et l’ARS PACA soutient financièrement l’accompagnement technique d’un cabinet spécialisé.
Le CHU de Nice, deuxième établissement de la région, est pour l’ARS PACA un établissement socle de l’organisation régionale des soins et de leur enseignement.
Le soutien apporté par le ministère et par l’ARS PACA a été à ce titre de 143 031 940 euros au cours de l’année 2018, permettant notamment le financement des missions d’intérêt général, activités spécifiques, SSR – soins de suite et de réadaptation – et psychiatrie.
Il est à noter que 5, 8 millions d’euros ont été alloués sur marge régionale pour des opérations d’investissements et de transformations hospitalières.
Le centre hospitalier universitaire de Nice a bénéficié du dégel intégral des crédits, soit 1 694 278 euros.
Pour prendre en compte au mieux l’engagement des médecins, des équipes soignantes et, plus largement, des agents de l’établissement, le choix a été fait de donner au CHU une dotation proportionnelle au volume de l’activité qu’il développe.

La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, pour répondre à Mme la secrétaire d’État.

Je vous remercie, madame la secrétaire d’État. Il était important, après la crise de septembre 2018, que nous ayons la confirmation par le Gouvernement du dégel des crédits à la hauteur que vous avez indiquée, et qui correspond au chiffre que j’avais – mais cela va mieux en l’entendant de la bouche d’un membre du Gouvernement.
Comme vous l’avez souligné, le CHU Pasteur de Nice est une référence hospitalière dans un certain nombre d’activités chirurgicales ; il importe que cette excellence puisse être maintenue. Il s’agit en outre d’un pôle économique et social important pour l’ensemble de notre bassin d’emploi et d’habitat.
Nous serons donc, en la matière, particulièrement vigilants. Il est primordial, en effet, que les patients puissent retrouver une offre de soins optimale et que toutes les équipes médicales puissent travailler dans de meilleures conditions – mais je sais aussi qu’un dialogue plus constructif s’est engagé avec la direction depuis la crise de septembre 2018.

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, auteur de la question n° 588, adressée à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Madame la secrétaire d’État, je souhaite attirer votre attention et celle de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les difficultés que rencontrent les anciens salariés, qui sont donc aujourd’hui retraités, de l’usine Saft–Arts Energy de Nersac, en Charente, pour obtenir de la caisse primaire d’assurance maladie un suivi post-professionnel de leur état de santé.
Ces salariés ont été exposés, voire surexposés, pendant de nombreuses années, dans le cadre de leur profession, au cadmium et à ses composés.
Comme vous le savez, le cadmium est considéré comme cancérogène certain pour l’homme par le centre international de recherche sur le cancer. Les cancers associés sont ceux des voies respiratoires, notamment du poumon. Le cadmium est également suspecté d’être à l’origine de cancers de la prostate et du rein.
On imagine donc combien le suivi de ces travailleurs actifs mais aussi retraités est important : important pour prévenir les maladies et assurer leur prise en charge médicale, sachant qu’une véritable épée de Damoclès pèse sur ces travailleurs, qui voient certains de leurs collègues mourir en silence de cancers du poumon ; important également pour la recherche médicale et pour l’actualisation des tableaux des maladies professionnelles ; important aussi pour faciliter, si besoin, la recherche en responsabilité.
Je ne comprends donc pas, madame la secrétaire d’État – les travailleurs retraités ne le comprennent pas non plus, et ils sont venus me le dire –, qu’aucun suivi post-professionnel ne soit organisé et réalisé.
Ma question est donc simple : est-ce normal ? Pourquoi un suivi post-professionnel n’est-il pas systématiquement réalisé pour les travailleurs qui ont été exposés à des matières si dangereuses pendant parfois plus de trente ans de leur vie ?
Madame la sénatrice, les anciens salariés de l’usine Saft–Arts Energy de Nersac en Charente qui ont été exposés au cadmium au cours de leur carrière professionnelle peuvent, sur simple demande de leur part auprès de leur caisse primaire d’assurance maladie, bénéficier d’un suivi médical post-professionnel.
D’après les données fournies par la Caisse nationale d’assurance maladie, seuls deux anciens salariés de cette entreprise spécialisée dans la conception d’accumulateurs et de systèmes de stockage d’énergie ont sollicité la mise en place de ce suivi médical en 2018.
Depuis 1995, les anciens salariés du régime général ayant été exposés à des substances ou procédés cancérogènes pendant leur vie professionnelle peuvent, sur leur demande, bénéficier d’un suivi médical post-professionnel, pris en charge par la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
Ce suivi est accordé par la caisse primaire d’assurance maladie sur production par l’intéressé d’une attestation d’exposition remplie par l’employeur et le médecin du travail. Dans le cas où l’assuré est dans l’impossibilité de fournir cette attestation, notamment parce que l’entreprise a disparu, c’est l’assurance maladie qui se charge de vérifier l’effectivité de l’exposition avant de proposer à l’assuré le suivi médical adapté.
Dans le cas spécifique du cadmium, le protocole national prévoit que le médecin traitant reçoit une information sur les maladies professionnelles provoquées par cette substance. Il est ensuite invité à se rapprocher du médecin du travail afin d’harmoniser le suivi post-professionnel avec celui qui a été réalisé au cours de l’activité professionnelle. Il lui est également conseillé d’adresser son patient en consultation de pathologie professionnelle en cas de problème respiratoire ou rénal.
Selon ce protocole national, le suivi post-professionnel réalisé par le médecin traitant comprend un examen clinique bisannuel ; les organes cibles sont le foie et les reins, où le cadmium s’accumule surtout. Dans les deux derniers cas de suivi post-professionnel octroyés à des anciens salariés de l’usine Saft–Arts Energy en 2018, le médecin conseil de l’assurance maladie a en outre accordé des tests urinaires, des scanners et des radios des os.
Sur la période 2013-2017, cinq cancers broncho-pulmonaires provoqués par l’inhalation de poussières ou fumées renfermant du cadmium ont été reconnus et pris en charge par l’assurance maladie. Sur la même période, 8 896 cancers professionnels ont été indemnisés.

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, pour répondre à Mme la secrétaire d’État.

Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, de rappeler ce qui est possible. Le problème est que, dans la réalité, les choses ne se passent pas ainsi – c’était la raison de ma question.
Des travailleurs retraités de la Saft sont venus me voir ; je citerai le témoignage de l’un d’entre eux en particulier, retraité de la Saft depuis quatre ans lorsque je l’ai rencontré : le médecin du travail avait demandé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente un suivi post-professionnel, car le taux de cadmium mesuré dans son sang est de trois fois supérieur à la normale ; il n’a jamais obtenu ce suivi. C’est moi qui suis intervenue auprès de la CPAM pour qu’il l’obtienne, et, lorsqu’il a été reçu, le médecin ne connaissait pas le dossier médical et ne savait pas ce qu’il devait faire.
Il n’y a donc pas de lien entre la médecine du travail et la caisse primaire d’assurance maladie, et je peux vous assurer que, s’agissant de cette entreprise, le suivi post-professionnel n’est pas assuré, alors que, eu égard à la dangerosité du cadmium, il devrait l’être. Je demande donc au ministère de la santé de rendre effectif, pour ces retraités, ce suivi dont vous avez indiqué qu’il était possible.

La parole est à M. Roland Courteau, auteur de la question n° 593, transmise à M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.

Je souhaite attirer l’attention du Gouvernement sur le cataclysme qui, en octobre dernier, a frappé le département de l’Aude, de terribles inondations endeuillant la population audoise et plongeant de nombreuses communes dans une sorte de chaos.
Nombre d’habitations privées, de bâtiments et d’équipements publics ont été détruits, dévastés, arrachés à notre terre.
Le ministre de l’intérieur a pu constater sur place l’ampleur des dégâts ; il m’a fait part, ici même, devant le Sénat, de sa volonté, « là où le malheur passe, de reconstruire ».
Nombre de maisons d’habitation, justement, sont à reconstruire. Nombre de bâtiments et d’équipements publics le sont aussi : EHPAD, ou établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, écoles, piscines, campings, etc. Certains de ces bâtiments privés ou publics, situés dans des zones très exposées, devront être reconstruits dans d’autres secteurs.
C’est dans ce genre de cas que le fonds Barnier a vocation à être mis en œuvre pour les acquisitions de biens immobiliers, soit parce que ces biens sont sinistrés, soit parce qu’ils sont gravement exposés.
Vous comprendrez donc, madame la ministre, que les maires et les élus des communes sinistrées souhaitent vivement que les procédures de démolition et de reconstruction soient très rapidement engagées dans le cadre de ce fonds.
Une évaluation a d’ores et déjà été largement engagée par une mission de la DDTM, la direction départementale des territoires et de la mer, de la préfecture. D’où ma question : pouvez-vous assurer aux élus des communes concernées que l’enveloppe dédiée de ce fonds permettra, par son montant et par la volonté d’agir vite, de faire en sorte que les opérations de démolition et de reconstruction soient engagées très rapidement ?
Monsieur le sénateur Courteau, vous avez interrogé M. Christophe Castaner, ministre de l’intérieur, afin de savoir si l’enveloppe du fonds de prévention des risques naturels majeurs, le fonds Barnier, permettra, par le montant de son enveloppe dédiée, d’engager les opérations de démolition et de reconstruction des biens touchés par les inondations qu’a connues le département de l’Aude en octobre 2018. Il m’a chargée de vous répondre.
Tout d’abord, vous me permettrez de saluer l’ensemble des maires concernés et des services publics qui ont été mobilisés et qui le sont toujours pour aider les sinistrés et faire en sorte que l’ensemble des activités puissent redémarrer.
Les services de l’État, sous le pilotage du préfet de l’Aude, sont pleinement mobilisés pour accompagner les collectivités et les sinistrés. Après le temps du relogement d’urgence, pour lequel les collectivités bénéficient d’aides du fonds d’aide au relogement d’urgence, se posera la question du relogement définitif. Ce dossier est pris en charge par le préfet de l’Aude, qui, accompagné dans cette mission par la direction départementale des territoires et de la mer, lui prête une attention toute particulière.
Comme vous le soulignez, le territoire a été profondément et dramatiquement touché ; or – nous le savons – de telles précipitations peuvent se reproduire ; il est collectivement de notre devoir qu’elles n’engendrent pas les mêmes conséquences. L’occupation du territoire doit donc être repensée, ce qui signifie que certains sinistrés ne pourront pas retrouver leurs biens.
Je vous confirme que, pour accompagner ces sinistrés, le fonds de prévention des risques naturels majeurs pourra être mobilisé au titre des opérations d’acquisition amiable des biens qui constituent une menace grave pour leurs occupants ou qui ont été sinistrés à plus de 50 %. Si cela se révélait nécessaire, le financement d’expropriations est également possible – le fonds ne finance pas directement les travaux de reconstruction des biens.
Je tiens également à vous préciser que les mesures d’acquisition amiable et la mesure d’expropriation sont assujetties non pas à des plafonds de dépenses annuelles, mais à la seule trésorerie globale du fonds Barnier. Son état ne constitue donc pas un obstacle à la mobilisation que je viens d’évoquer.
Les services de l’État, dans l’Aude, sont ainsi d’ores et déjà à pied d’œuvre pour déterminer les biens qui répondent aux règles de mobilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs et permettre le plus rapidement possible le relogement définitif des sinistrés.

Nous savons que le préfet, les services de l’État, le conseil départemental, la région, les communes, les associations et les différents organismes compétents sont en effet fortement mobilisés. Chacun, à sa place, fait ce qu’il faut. L’association Aude Solidarité, en liaison avec le conseil départemental, s’emploie ainsi à faire face à des situations de grande détresse sociale.
Nous attendons donc impatiemment, désormais, la phase tout aussi essentielle, avec le fonds Barnier, de démolition et de reconstruction, en espérant ne plus revivre un tel cauchemar. Je vous remercie, madame la ministre.

La parole est à M. Philippe Madrelle, auteur de la question n° 237, adressée à M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.

En 2011 et en 2013, j’intervenais à cette même tribune sur ce problème de la nécessité d’une réglementation et d’un contrôle très stricts des opérations de désamiantage, qu’elles soient effectuées dans un cadre privé ou professionnel.
Je pense important de rappeler les chiffres terrifiants relatifs à ce désastre sanitaire : bien qu’interdite depuis 1997, l’amiante est responsable de 3 000 à 5 000 décès, soit 100 décès par an ! Avec ses fibres mortelles, l’amiante continue de représenter un danger pour tous ceux qui y sont exposés.
Vous me permettrez de saluer le travail courageux et le combat inlassable menés par les responsables des associations des victimes de l’amiante pour alerter les pouvoirs publics sur les risques de contamination professionnelle ou environnementale. Dans notre pays, 20 millions de tonnes d’amiante subsistent encore et 100 000 décès sont prévus d’ici à 2050 pour les 2 millions de salariés potentiellement exposés aux risques de l’amiante.
Il s’agit de prévoir et de protéger les générations futures ; d’où l’obligation d’établir une législation stricte concernant le transport, le traitement, la gestion et le stockage des déchets lors des opérations de désamiantage. On constate trop souvent que, dans les chantiers de désamiantage, les impératifs de rentabilité passent avant les objectifs de sécurité environnementale.
Vous le savez, madame la ministre, deux filières sont autorisées en France pour l’élimination de l’amiante : la mise en décharge, par ailleurs condamnée par l’Union européenne, et la vitrification. Même si ces deux filières font l’objet de contrôles, ne pensez-vous pas qu’un pôle public d’éradication de l’amiante porté par une structure administrative et juridique indépendante, regroupant et listant l’ensemble de la réglementation et des normes, s’inscrivant dans un projet de développement respectueux des populations, de l’environnement et de la biodiversité, permettrait de limiter les risques de contamination, d’une part, et d’assurer l’information et la protection des générations futures, d’autre part ?
Monsieur le sénateur Madrelle, vous avez appelé l’attention de M. François de Rugy, ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la création d’un pôle public d’éradication de l’amiante. Ne pouvant être présent, il m’a chargée de vous répondre.
Dans son rapport d’information n° 668 de juillet 2014, la commission des affaires sociales du Sénat avait évoqué la nécessité d’assurer la coordination des actions dans le domaine de l’amiante et avait préconisé la mise en place « d’une structure interministérielle, dotée d’un véritable pouvoir décisionnel ».
Compte tenu des enjeux, notamment sanitaires, un plan d’actions interministériel pour améliorer la prévention des risques liés à l’amiante, le PAIA, a été mis en place sur l’initiative du Premier ministre, en décembre 2015, pour une durée de trois ans. Ce plan implique les ministères chargés du travail, de la santé, du logement et de l’environnement, et décline l’action de l’État dans le domaine de l’amiante en cinq axes visant principalement à renforcer et à adapter la communication et la diffusion de l’information à tous les acteurs concernés par ce sujet, à améliorer et à accélérer la professionnalisation, à faciliter et à accompagner la mise en œuvre de la réglementation, à soutenir les démarches de recherche et développement sur l’amiante et à se doter d’outils de connaissances, de suivi et d’évaluation.
Le PAIA permet ainsi d’amplifier les initiatives de tous les acteurs concernés sur des objectifs stratégiques communs et de dégager des priorités au regard des moyens mobilisables.
Ce plan, axé principalement sur le secteur du bâtiment, est destiné à améliorer la prévention des risques à destination de la population en général et des travailleurs en particulier, en facilitant la mise en œuvre de la réglementation, en accompagnant la montée en compétence des acteurs dans les différents domaines d’activité concernés et en soutenant les démarches de recherche et développement.
La durée limitée dans le temps de ce plan a conduit à solliciter une mission conjointe de l’Inspection générale des affaires sociales, du Conseil général de l’environnement et du développement durable et de l’Inspection générale de l’administration pour évaluer les travaux mis en œuvre dans le cadre de ce plan sur la période 2015-2018 et formuler des recommandations sur la poursuite des actions de ce plan. Cette mission devrait rendre ses conclusions au cours de l’année 2019.

Je vous remercie, madame la ministre, de votre réponse. Ma réplique sera très brève : il faut que vous sachiez que ce pôle est très attendu par les associations des victimes de l’amiante.

La parole est à M. François Calvet, auteur de la question n° 547, adressée à M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.

Madame la ministre, ma question concerne l’arrêt en date du 14 septembre 2018 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté les recours déposés par le ministère de l’environnement et par la société La Provençale contre l’annulation de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation de la carrière de marbre blanc de Tautavel et de Vingrau.
Pourtant, conformément aux dispositions du c du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, l’arrêté précité répondait parfaitement, d’une part, aux exigences environnementales, impact paysager, mesures compensatoires – en octobre 2003, d’ailleurs, une étude d’impact sur l’environnement avait été déclarée recevable par la DREAL, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement –, et, d’autre part, à l’existence d’un intérêt public majeur : création et développement d’emplois, besoins industriels auxquels répond ce gisement.
De plus, le juge relève que l’association FRENE 66 s’est bornée, dans son recours en annulation, à déclarer que la raison impérative d’intérêt public majeur n’était pas fondée, sans donner aucun argument et sans détailler en quoi l’exploitation de ladite carrière ne répondait pas aux critères de dérogations susvisés.
De même, l’association précitée ne détaille en rien quelles seraient les espèces impactées par l’exploitation de la carrière.
Or la particularité de cette carrière n’est plus à démontrer ; la qualité exceptionnelle de son marbre blanc, très pur, nécessite notamment un savoir-faire spécifique.
Surtout, l’importance économique de l’usine d’Espira-de-l’Agly, portée par la société familiale La Provençale, a permis de développer plus de 80 emplois stables dans un département fortement affecté par le chômage et le manque d’activité industrielle.
La cessation de l’exploitation de cette carrière constituerait un mauvais signal et aggraverait la précarité économique de cette région.
En conséquence, le ministre de la transition écologique et solidaire est-il prêt à poursuivre devant le Conseil d’État la défense de l’exploitation de la carrière de Vingrau, comme l’avait fait en 2016 son prédécesseur, Mme Ségolène Royal, qui avait défendu l’activité de ladite carrière par l’application de la loi susvisée, confortant ainsi, en l’espèce, l’existence réelle et impérative d’un intérêt public majeur ?
Monsieur le sénateur Calvet, vous avez interrogé M. François de Rugy, ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire. Ne pouvant être présent, il m’a chargée de vous répondre.
Par un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 25 mars 2014, la société Provençale SA a été autorisée à reprendre et à étendre l’exploitation d’une carrière à ciel ouvert de roches massives, située sur les territoires communaux de Tautavel et de Vingrau.
Les travaux d’exploitation de cette carrière ayant pour conséquence l’atteinte à des habitats ou à des spécimens d’espèces protégées ou leur destruction, une demande de dérogation a donc été déposée par la société Provençale SA.
Cet arrêté a fait l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier, qui l’a annulé par un jugement du 3 mai 2016.
Par un arrêt rendu le 14 septembre 2018, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel que le ministre d’État avait interjeté contre ce jugement.
La cour a jugé que la dérogation accordée ne pouvait être regardée comme justifiée par l’un des motifs énoncés à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, à savoir celui qui est relatif à l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur.
L’examen de la condition liée à l’existence d’une « raison impérative d’intérêt public majeur » doit se fonder sur une « mise en balance » entre l’intérêt public du projet considéré et l’objectif de conservation des habitats naturels et de la faune sauvage, visé par la directive Habitats.
Le ministère considère que l’exploitation de la carrière répond bien à un intérêt public majeur.
En effet, en premier lieu, ce projet répond à la nécessité de favoriser l’approvisionnement durable en matières premières en provenance de sources européennes et à des impératifs socio-économiques liés au maintien et à la création d’emplois.
En second lieu, l’arrêté accordant la dérogation impose des mesures compensatoires ambitieuses, dont le contenu garantit le maintien dans un bon état de conservation des espèces concernées.
La dérogation autorisée par arrêté préfectoral me semble donc bien justifiée par une raison impérative d’intérêt public majeur.
C’est la raison pour laquelle le ministre d’État a décidé de former, à l’encontre de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille, un pourvoi en cassation – je vous le confirme.

La parole est à M. Marc-Philippe Daubresse, auteur de la question n° 562, adressée à Mme la secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la métropole européenne de Lille s’est fortement engagée dans la préservation de son environnement. Dans ce cadre, j’ai coordonné l’élaboration du SCOT, le schéma de cohérence territoriale, de l’arrondissement de Lille, qui compte 1, 2 million d’habitants – ce schéma a d’ailleurs été voté à l’unanimité. Au premier rang de nos préoccupations, bien sûr, figurent la protection de l’environnement et de la biodiversité et la prévention des risques d’inondations concernant notamment la rivière frontalière franco-belge de la Lys.
Beaucoup de temps et d’argent ont été consacrés à cette mission.
Pourtant, le maire de Deûlémont, commune située sur les bords de cette rivière, est venu me trouver voilà quelques mois, affolé par les projets prévus sur la rive belge.
Sur la commune de Comines-Warneton, nos voisins belges ont prévu de construire une plateforme portuaire démesurée, dont l’autorisation dépend de la région wallonne – la situation est un peu complexe : on est là dans une enclave wallonne en zone flamande –, qui viendrait détruire tous les aménagements français destinés à protéger la biodiversité et l’environnement.
Parallèlement, l’entreprise agroalimentaire Clarebout, qui produit de l’huile de palme, installée à quelques mètres de la rive sur le sol belge et connue pour ses rejets de déchets polluants dans la nature, souhaite construire un deuxième congélateur pour son usine.
Si ces projets et leurs permis de construire étaient avalisés par les autorités belges, les fonds structurels européens du FEDER, le Fonds européen de développement régional, financeraient simultanément la protection de l’environnement et la prévention des inondations par des prairies humides, côté français, et la création, côté belge, d’une plateforme portuaire totalement incompatible avec lesdites protection et prévention.
De très nombreuses concertations ont déjà eu lieu avec les autorités belges compétentes, sans succès jusqu’ici. Vous comprenez donc mon inquiétude et celle des élus frontaliers français, de Deûlémont en particulier.
Le 30 octobre 2018, le préfet du Nord, qui soutient notre position, a émis un avis défavorable sur ce projet, en suivant les conclusions de la commissaire enquêtrice française.
Ma question est donc simple, madame la ministre : pouvez-vous faire quelque chose ? Avez-vous l’intention de prendre contact avec le gouvernement belge ? Pouvez-vous mettre un coup d’arrêt à ce projet ubuesque, qui pourrait réduire à néant des années de coopération transfrontalière en matière de protection de l’environnement et rendre inefficace l’ensemble du plan de prévention des inondations de Lille Métropole qui est en train d’être mis en place ?
Monsieur le sénateur Daubresse, vous avez interrogé Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique et solidaire. Ne pouvant être présente, elle m’a chargée de vous répondre.
Le ministère de la transition écologique et solidaire et les services de l’État dans la région Hauts-de-France sont pleinement mobilisés sur le dossier de la construction d’une plateforme multimodale sur la Lys, sur la commune belge de Comines-Warneton. Il s’agit d’un sujet d’impact environnemental transfrontalier qui fait, depuis 2016, l’objet d’échanges réguliers avec l’administration belge.
Notre ambassade en Belgique a alerté les autorités belges concernées sur les préoccupations du versant français, clairement manifestées dans le cadre d’une enquête publique, s’agissant des inconvénients de la construction de cette plateforme à proximité directe d’une zone humide. Les discussions sont menées dans un contexte particulier marqué par une concertation difficile entre les communes concernées de part et d’autre de la Lys, par des réglementations nationales différentes et par une asymétrie dans l’organisation des procédures de consultation transfrontalière environnementale entre les différentes administrations concernées des deux pays.
Au regard de la sensibilité du sujet, une enquête publique transfrontalière a été organisée sur le territoire des communes françaises de Frelinghien, Comines, Deûlémont et Warneton entre le 27 août et le 27 septembre 2018. En outre, le préfet du Nord a sollicité l’avis de la direction départementale des territoires et de la mer du Nord, de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France et de Voies navigables de France.
Au vu de la forte opposition citoyenne, les avis défavorables des quatre conseils municipaux concernés par l’enquête publique, les dangers liés aux risques d’inondations, l’impact sur la faune et la flore et les conséquences globales du projet sur la qualité de l’eau de la Lys, la France a émis sur ce projet, le 30 octobre 2018, un avis défavorable qui a été transmis aux autorités belges.
Nous restons attentifs aux suites qui seront données à ce projet, à la lumière de cet avis, par nos interlocuteurs belges.
Par ailleurs, les services de l’État élaborent actuellement un guide de procédure de consultation transfrontière destiné à faciliter les échanges entre toutes les administrations intéressées.

La parole est à M. Marc-Philippe Daubresse, pour répondre à Mme la ministre.

Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse et de la réaffirmation de la position de la France, qui est évidemment importante pour nous.
Je vous informe que nous disposons d’un district européen transfrontalier, outil de concertation créé sur l’initiative de Pierre Mauroy, lorsqu’il était sénateur, qui existe dans toute une série de zones transfrontalières, et qui permet, en l’espèce, de réunir les autorités belges et françaises, et notamment les régions concernées. Il pourrait être opportun que Mme la secrétaire d’État puisse assister à l’une de ces réunions, qui sont présidées par Mme Aubry, et y réaffirmer de manière plus solennelle, peut-être, la position de la France – cela pourrait nous aider.
Merci, en tout cas, de votre soutien.

La parole est à M. Stéphane Piednoir, auteur de la question n° 580, adressée à M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.

Madame la ministre, je souhaite attirer votre attention, et même vous alerter, sur les retards de remboursement des primes à la conversion et autres bonus écologiques qui sont accordés pour faciliter l’achat de véhicules vertueux en termes de pollution atmosphérique, et sur les conséquences de ces retards pour l’ensemble de la filière automobile.
Ces incitations financières constituent – vous en conviendrez – un axe fort de la politique du Gouvernement en faveur de la transition écologique, en particulier à destination des ménages modestes.
Mais, souvent, ces aides financières sont directement avancées par les concessionnaires eux-mêmes, et j’ai été alerté, dans mon département de Maine-et-Loire, sur les délais importants de remboursement de ces primes par l’État.
À ce jour, à l’échelle nationale, ces retards de paiement représentent environ 80 millions d’euros. Ces sommes, qui ne sont pas remboursées, concernent quatre-vingt-cinq groupes de concessions recensés.
Selon moi, il n’est pas normal que certaines entreprises aillent jusqu’à mobiliser 10 millions d’euros d’avances de trésorerie sur l’État, ce parfois pendant plusieurs mois. Il s’agit là d’un réel dysfonctionnement du dispositif.
De plus, dans le cadre de cette transition, les centres agréés de destruction des véhicules hors d’usage et de remplacement des véhicules polluants souffrent de congestion, ce qui est problématique : le certificat de destruction du véhicule est indispensable pour engager la démarche de remboursement des primes par l’État.
On le voit bien, nous sommes face à un système qui tourne en rond. D’ailleurs, vous avez récemment annoncé une hausse de ces primes pour l’an prochain : en toute logique, vous vous attendez donc à une augmentation des demandes. Je rappelle simplement que, l’an dernier, 200 000 demandes d’aide ont été enregistrées, alors que le Gouvernement n’en prévoyait que 100 000. Vous comprenez bien que, si l’on veut accélérer le processus, l’on risque d’accumuler des retards importants de la part de l’Agence des services de paiement, l’ASP.
Madame la ministre, en résumé, et compte tenu de cette situation extrêmement tendue, quelles solutions pouvez-vous envisager pour accélérer le remboursement de ces primes, de ces bonus ? Il convient de ne pas mettre en péril l’activité du secteur automobile, qui, on le sait, est particulièrement fragile.
Monsieur le sénateur Stéphane Piednoir, vous avez interrogé M. François de Rugy, ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire. Ne pouvant être présent, il m’a chargée de vous répondre.
Tout d’abord, je vous confirme que la prime à la conversion est un levier important de la politique du Gouvernement pour accompagner les Français vers des véhicules qui consomment moins et qui polluent moins. Au reste, en 2019, le Gouvernement a doublé cette prime pour les ménages les plus modestes et pour les ménages non imposables qui font chaque jour plus de trente kilomètres entre leur domicile et le lieu de leur travail.
Un allongement des délais de paiement par l’ASP a été observé à l’automne 2018. Il est dû au succès exceptionnel de la prime à la conversion l’année dernière. Près de 300 000 demandes ont été déposées en 2018, ce qui est en effet nettement supérieur à l’objectif initial de 100 000 primes.
Le Gouvernement est attentif aux difficultés de trésorerie que ces retards de remboursement engendrent pour de nombreux professionnels de l’automobile. Les services du ministère de la transition écologique et solidaire, en relation avec la direction du budget, mettent tout en œuvre pour maintenir des délais de paiement acceptables. Ainsi, 70 000 dossiers ont été payés au mois de décembre 2018, et le délai de paiement a pu être ramené à un mois et demi à la fin de décembre dernier. Nous veillerons à maintenir une situation satisfaisante en 2019.
En outre, je tiens à vous rassurer : la filière de déconstruction automobile ne fait pas face, aujourd’hui, à des problèmes de capacité. Les 1 700 centres de traitement agréés pour les véhicules hors d’usage sont, potentiellement, à même de prendre en charge un nombre plus élevé de véhicules que les 1, 1 million enregistrés en 2017.
Si certains centres agréés peuvent connaître des difficultés, ces situations restent le plus souvent localisées. Elles peuvent s’expliquer par le délai nécessaire pour que les centres agréés réalisent les opérations obligatoires de dépollution des véhicules et le démontage de leurs pièces, ainsi que le recyclage de leurs matières.
Il revient aux constructeurs automobiles, dans le cadre de leur responsabilité élargie, d’examiner les possibilités de réorganisation afin d’alléger les zones qui connaissent des tensions aujourd’hui. Les services du ministère de la transition écologique et solidaire assurent un suivi attentif de la situation, pour que les acteurs de la filière de déconstruction gèrent de manière satisfaisante, en 2019, cet afflux de véhicules hors d’usage.

La parole est à M. Stéphane Piednoir, pour répondre à Mme la ministre, en cinq secondes.

Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse. Je vous invite évidemment à travailler le plus étroitement possible avec les professionnels de la filière. Pour ce qui concerne les centres de déconstruction et de destruction des véhicules, l’on pourrait envisager de donner davantage d’agréments, même localement ; il pourrait s’agir d’une solution, en concertation avec les acteurs locaux.

La parole est à Mme Viviane Artigalas, auteur de la question n° 299, adressée à Mme la ministre auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports.

Madame la ministre, 86 % des Français estiment que les difficultés de transports constituent un frein à l’emploi, et la majorité d’entre eux n’a pas d’autre choix que d’utiliser un véhicule, au détriment du train ou des transports en commun. Il devient donc urgent de développer les nouvelles mobilités, et notamment le réseau ferroviaire.
Le rapport du 15 février 2018 avait suscité beaucoup d’inquiétudes dans de nombreux territoires, notamment en Occitanie, sur l’avenir des petites lignes TER et du développement du TGV.
Paradoxalement, la région Occitanie est, d’une part, l’une des plus dynamiques et, d’autre part, l’une des plus fragiles et des plus enclavées, en raison de l’inachèvement des projets de LGV, lignes à grande vitesse. Or raccorder la quatrième ville de France au réseau TGV permettrait déjà de déployer de nouveaux trains dans les zones saturées et de maintenir des trains du quotidien dans les zones plus rurales.
Alors que ces petites lignes sont un instrument de désenclavement certain, le rapport ne mentionnait aucune des créations de ligne réclamées depuis des décennies par plusieurs régions, notamment par la région Occitanie.
Pourtant, il s’agit de rendre la vie de nos concitoyens plus simple et de rétablir l’égalité entre les territoires. À cette fin, il faut mener une politique ambitieuse d’entretien des réseaux et assurer l’aboutissement des projets de grandes infrastructures encore manquantes.
Afin de développer les transports collectifs, le covoiturage et des innovations dans le domaine des transports, les finances publiques doivent mieux soutenir l’action des régions et des départements, qui assurent l’organisation du maillage territorial et la modernisation des routes secondaires.
De plus, il n’est pas possible d’imposer une fiscalité verte à nos concitoyens sans une politique d’accompagnement juste et logique. Il est donc nécessaire de réorganiser les possibilités de transports et les réseaux de circulation, en décentralisant davantage les compétences, en concertation directe avec les territoires.
La prochaine loi d’orientation sur les mobilités devra mettre en place un véritable plan d’action, qui permettra à nos territoires de sortir de l’enclavement et à nos concitoyens de circuler plus facilement au quotidien.
Quelle réponse pouvez-vous m’apporter quant à ces enjeux ? Pouvez-vous me confirmer, dans la région Occitanie, la poursuite des projets d’infrastructures essentiels au développement économique du territoire ?
Madame la sénatrice Viviane Artigalas, vous me faites part des fortes attentes des territoires de la région Occitanie quant à sa desserte ferroviaire, sur les deux volets que constituent les « petites lignes », même si ce terme est impropre, et les projets de lignes à grande vitesse.
Sur le premier point, je tiens une nouvelle fois à clarifier la position du Gouvernement : il n’est en aucun cas dans notre intention d’abandonner les lignes qui font le maillage de notre territoire et sont nécessaires au transport du quotidien de nombreux Français. L’État tiendra ses engagements et demeurera au côté des collectivités territoriales pour préserver ces lignes de desserte fine, dans le cadre des contrats de plan État-région, les CPER.
À cet égard, je viens de confier à M. le préfet Philizot une mission visant à établir et partager avec les parties prenantes un état des lieux de la situation aux niveaux national et régional, à identifier les différentes solutions techniques, organisationnelles, financières et contractuelles pour assurer la pérennité des lignes de desserte fine des territoires, puis à décliner à l’échelle régionale les solutions ainsi identifiées.
Sur le second point, à savoir les projets de lignes à grande vitesse desservant l’Occitanie, les lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et Montpellier-Béziers représentent un montant total d’investissement considérable, qui atteint plusieurs milliards d’euros. Ces deux projets sont bien pris en compte dans la programmation des grandes infrastructures de transport, figurant dans le projet de loi d’orientation des mobilités : le débat aura lieu au Parlement.
Il s’agit là de projets de grande ampleur. Leur réalisation sera donc nécessairement phasée, en commençant par la désaturation des nœuds ferroviaires de Bordeaux et Toulouse : il s’agit là d’un préalable indispensable. La situation des dernières semaines nous rappelle l’urgence de développer les transports ferroviaires du quotidien autour des métropoles régionales.
Ainsi, ces lignes figurent bien dans la programmation, mais leur réalisation sera phasée, et l’on commencera par la désaturation des nœuds ferroviaires, au profit des transports du quotidien.

La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour répondre à Mme la ministre.

Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse. Je constate que nous avons les mêmes préoccupations. D’ailleurs, les mouvements sociaux actuels nous montrent bien que les transports sont une préoccupation quotidienne de nos concitoyens ; il s’agit même de leur principale inquiétude.
Nous devons donc, ensemble, donner une réponse d’ampleur pour ces transports du quotidien : il faut mener à bien la désaturation de nos grandes villes, afin de les rendre accessibles à tous.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, auteur de la question n° 538, adressée à M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaite attirer l’attention du Gouvernement sur les conséquences qu’aura, pour l’école André-Malraux de Saint-Pétersbourg et ses élèves, le transfert de propriété effectué en 2018 par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, l’AEFE.
En effet, lors du conseil d’administration du 28 juin 2018, les membres de l’AEFE se sont vu signifier, en réponse à une question d’un administrateur, une décision administrative de transfert de propriété de l’activité scolaire exercée par l’AEFE à Saint-Pétersbourg.
Alors que cette école appartenait à l’établissement en gestion directe de Moscou, la transmission à un opérateur privé, menée sans la moindre transparence, est contestable : l’on n’a lancé ni appel à manifestation d’intérêt ni procédure d’appel d’offres pour la recherche d’un repreneur, et aucune garantie n’a été offerte aux familles.
Ces dernières années, la situation financière de l’école a été progressivement dégradée par une gestion et une stratégie de communication inadaptées. Présentée ensuite comme coûteuse, l’école a été cédée à un opérateur privé, avec une partie de ses recrutés locaux. Cette décision étant prise, l’AEFE a continué à assumer les coûts de fonctionnement sur son budget durant l’été 2018, et peut-être au-delà pour le bail et les garanties offertes au propriétaire.
Cette manière de procéder impose de formuler les remarques et les questions suivantes.
Premièrement, la société de droit russe à qui bénéficie le transfert de cette activité est détenue par une autre personne que celle qui fut indiquée aux parents d’élèves par le conseiller culturel : elle est présentée comme un prête-nom, ce qui serait justifié par notre ambassade comme une pratique courante en Russie.
Deuxièmement, les licences demandées par cette société aux autorités russes pour continuer l’activité de l’école ne correspondent pas au programme d’enseignement présenté aux parents d’élèves.
Troisièmement, la base sur laquelle les détachements de titulaires de l’éducation nationale ont été mis en place dans la nouvelle structure pose des problèmes quant à la capacité de la nouvelle SARL russe d’offrir un statut légal répondant aux exigences du droit russe pour ses personnels français.
Quatrièmement, pourquoi, pour l’AEFE, n’y a-t-il pas eu officiellement de transmission d’une école publique à une structure privée, mais simplement la cession de quelques actifs mobiliers préalablement dévalorisés ?
Cinquièmement et enfin, si ce point de vue est retenu, c’est-à-dire le simple transfert de quelques actifs mobiliers, comment peut-on maintenir l’homologation ? Pourquoi cette dernière est-elle restée valable, sans contrôle, et comment a-t-on pu autoriser le détachement de titulaires de l’éducation nationale ?
Étant donné les tracas administratifs que des entités étrangères comme Business France ont vécus ces derniers mois en Russie, oublier de prendre certaines précautions au regard du droit russe peut engendrer des difficultés. Celles-ci pourraient peser non seulement sur l’école de Saint-Pétersbourg, mais aussi sur l’avenir, le statut et les charges financières de notre établissement de Moscou.
Aussi, il semblerait plus raisonnable de constater que les décisions prises dans des conditions litigieuses ne méritent pas d’être confirmées, et de donner au nouveau proviseur de l’établissement de Moscou, en poste depuis septembre 2018, un mandat clair pour trouver la solution permettant le développement de nos écoles dans le respect des droits français et russe.
Monsieur le sénateur Jean-Yves Leconte, vous avez interrogé Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Ne pouvant être présent, il m’a chargée de vous répondre.
Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères est attaché au maintien d’une école française à Saint-Pétersbourg, au service non seulement de notre communauté expatriée dans la région, mais aussi de notre influence.
Cette présence était compromise : le nombre d’élèves déclinait, le budget de cet établissement était structurellement déficitaire et grevait le budget du lycée Alexandre-Dumas de Moscou, dont il dépendait. La décision de changement de statut de l’établissement et de sa reprise par une structure privée ayant fait ses preuves dans le domaine de l’enseignement français à l’étranger est une réponse assumée face à l’échec des différentes tentatives pour rétablir la viabilité de l’établissement.
C’est dans ce cadre que le changement de statut a été réalisé, en concertation étroite avec l’ensemble des acteurs impliqués, dont les partenaires de l’établissement.
La rentrée scolaire démontre la pertinence de ce choix : les élèves sont au rendez-vous, leur nombre est passé de cinquante-huit à soixante-treize en septembre 2018, signe de la confiance que les familles accordent à la nouvelle structure.
La qualité de l’enseignement est garantie par le maintien de l’homologation par le ministère de l’éducation nationale et par le recrutement d’une nouvelle équipe pédagogique composée de trois professeurs titulaires de ce ministère.
D’un point de vue financier, depuis le 1er septembre 2018, ni l’établissement en gestion directe de Moscou ni l’AEFE ne supportent plus les coûts de fonctionnement de l’école André-Malraux.
Ce transfert a été réalisé en respectant toutes les règles de droit, tant français que russe.
Seule la délivrance de la licence d’enseignement par les autorités russes a pris du retard. Ce retard s’explique par le blocage administratif lié au transfert du bail au nouveau propriétaire et par les interventions répétées de quelques compatriotes hostiles au projet qui ont pu créer un climat de suspicion auprès des autorités russes. Sans ces interventions, la licence d’enseignement aurait déjà été délivrée.
Monsieur le sénateur, soyez assuré de la vigilance constante de notre ambassade en Russie, de l’opérateur AEFE et des services du ministère des affaires étrangères.

La parole est à Mme Nadia Sollogoub, auteur de la question n° 422, adressée à M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

Monsieur le ministre, je me permets d’attirer votre attention sur le délicat sujet de l’indemnisation des vétérinaires ayant participé, dans le cadre d’un mandat sanitaire, à l’éradication des grandes épizooties entre les années 1955 et 1990.
Ces professionnels de santé animale ont effectué, à la demande de l’État, des prophylaxies collectives permettant de protéger le cheptel français. À l’époque, l’État a omis de verser les cotisations sociales correspondant aux salaires concernés, qui leur auraient ouvert des droits au titre de la protection sociale et de la retraite.
Par sa décision du 14 novembre 2011, le Conseil d’État a enjoint à l’État de régulariser cette situation. Environ 1 600 demandes d’indemnisation ont alors été recensées, et une procédure harmonisée de traitement a été instaurée.
À la date du 9 avril 2018, environ 1 000 vétérinaires auraient été indemnisés ; mais, pour les dossiers restants, on a invoqué un « dépôt tardif » et un délai de prescription, qui les a écartés du processus de régularisation.
Les vétérinaires sanitaires concernés, « hors délais », désormais constitués en association, vivent très mal cette situation particulièrement injuste. C’est donc pour pouvoir obtenir le traitement rapide, conformément au principe d’égalité, des derniers dossiers de ces praticiens désormais âgés que je me tourne vers vous.
À l’heure où la profession agricole va mal, et alors que l’aide des vétérinaires pourrait de nouveau être précieuse pour éviter la propagation d’éventuelles pathologies, la régularisation de ce dossier serait un signe fort.
Aussi, monsieur le ministre, pourriez-vous m’indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre pour résoudre définitivement cette question, dans des conditions tout simplement équitables ?

Madame la sénatrice Nadia Sollogoub, je vous remercie de votre question très précise, qui concerne une profession dont je sais qu’elle vous tient à cœur, et qui porte sur les demandes d’indemnisation formulées par des vétérinaires sanitaires à la suite du défaut d’affiliation au régime de sécurité sociale dont ils ont fait l’objet au titre des activités exercées avant 1990 dans le cadre du mandat sanitaire.
Tout d’abord, je tiens à souligner les efforts consentis au cours de l’année écoulée : comme vous le savez, l’ensemble des dossiers éligibles des conjoints survivants et autres ayants droit de vétérinaires sanitaires se sont vu proposer une transaction amiable. De même, la quasi-totalité des dossiers de vétérinaires retraités ont été résolus.
À ce jour, le ministère a procédé à la régularisation de 1 063 dossiers. L’année 2018 a permis la résolution de 246 d’entre eux. L’immense majorité des demandes introduites avant le 1er janvier 2018 a ainsi été traitée.
Les dernières demandes, déposées notamment en réaction à l’annonce officielle de l’imminence de la clôture du processus transactionnel, survenue au premier trimestre de 2018, sont présentement en cours d’instruction. Elles aboutiront dans les tout prochains mois ; les crédits nécessaires ont d’ores et déjà été inscrits en loi de finances initiale pour 2019.
Madame la sénatrice, comme vous l’avez évoqué, certains dossiers présentent des difficultés d’éligibilité. L’article 1er de la loi n° 68–1250 de décembre 1968 dispose que « sont prescrites au profit de l’État […] toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. »
Dans ses décisions n° 388198 et 388199 du 27 juillet 2016, le Conseil d’État a procédé à la déclinaison de la disposition législative précitée, dans le cas de figure tout à fait spécifique des vétérinaires sanitaires ayant subi un défaut d’affiliation au régime de sécurité sociale au titre des activités sanitaires – je vous accorde qu’il s’agit là d’un sujet très technique.
La Haute juridiction a jugé que les vétérinaires ne pouvaient plus être regardés comme ignorants de leurs créances à l’État au moment de la liquidation de leurs droits à pension et que, dès lors, le délai quadriennal avait pleinement vocation à courir.
En conformité avec l’esprit de la loi, seuls les vétérinaires qui relèveraient de difficultés financières d’une singulière sévérité pourraient prétendre au bénéfice d’un relèvement exceptionnel de la prescription ; il y va de l’égalité de chacun devant la loi.
Au-delà de ces difficultés, je puis vous assurer de la totale mobilisation de mes services pour la résolution des tout derniers dossiers d’ici à la fin de l’année 2019.

Monsieur le ministre, merci beaucoup de votre réponse. Je sais que vous êtes vous-même très engagé sur le terrain et que vous connaissez ce dossier très précisément.

L’enjeu, c’est bien le caractère éligible des derniers dossiers qui restent : on oppose aux derniers vétérinaires concernés le fait qu’ils n’étaient pas ignorants de la situation au moment où ils ont liquidé leur retraite. Or c’est bien l’élément qui pose problème.
J’ai moi-même rencontré des vétérinaires retraités qui ont assumé pleinement leur mission sans se demander dans quel cadre elle entrait. Certains ont même produit des feuilles d’indemnités intitulées, à tort, « note d’honoraires » : de toute évidence, ils ignoraient parfois qu’il s’agissait de salaires, étant donné que les conditions d’exercice étaient formulées de manière assez peu claire. Certains, en prenant leur retraite, ont d’ailleurs détruit de nombreux documents, car ils n’imaginaient pas en avoir besoin ultérieurement.
À mon sens, des mesures dérogatoires sont parfaitement indiquées.

La parole est à Mme Christine Bonfanti-Dossat, auteur de la question n° 595, adressée à M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

Monsieur le ministre, voilà maintenant plus de vingt ans que notre territoire évoque régulièrement le projet de création d’un lac artificiel à Caussade.
Ce lac artificiel doit permettre de stocker de l’eau pour irriguer les cultures et, bien sûr, pour réalimenter le Tolzac. Certains mettent en doute son utilité, invoquent la biodiversité. D’autres défendent son intérêt pour faire vivre les activités agricoles.
Dans un département voisin du Tarn et de Sivens, vous imaginez combien les tensions sont vives, et pour cause : le 29 juin 2018, le projet est autorisé par un arrêté préfectoral. Il est l’aboutissement d’un travail de fond mené avec tous les acteurs locaux : chambre d’agriculture, conseil départemental, association des maires, syndicats d’agriculteurs et services de l’État.
Après vingt ans d’atermoiements, ce projet, qui permet de soutenir près de trente exploitations et de maintenir le débit d’une rivière en période de sécheresse, allait enfin voir le jour. C’était oublier un mal qui ronge notre pays : les décisions aveugles prises depuis la capitale ; le sentiment que l’on sait mieux dire ce qui est bon en décidant depuis un ministère parisien plutôt qu’en écoutant les acteurs locaux.
En septembre dernier, le projet est annulé par un nouvel arrêté préfectoral, obtenu par des associations écologistes militantes. Des susceptibilités entre préfets de région et de département auraient-elles joué ? Je ne sais pas. Toutefois, les travaux ont commencé dans l’illégalité, et ils se poursuivent aujourd’hui. La semaine passée, le préfet de région a décidé, par arrêté, de faire apposer des scellés sur le site. Les appels à manifestation se multiplient.
Monsieur le ministre, comme le disait Nougaro : « Chez nous, même les mémés aiment la castagne ! »
Sourires.
Nouveaux sourires.

Alors, avant que la situation ne se dégrade, je vous invite, vous qui n’êtes pas un produit du sérail, à venir sur place vous rendre compte de l’intérêt réel de ce projet.
Ma question est simple : allez-vous répondre à mon invitation ? Quelles sont vos intentions pour assurer l’avenir de ces exploitations agricoles ?

Madame la sénatrice Christine Bonfanti-Dossat, votre question porte sur le lac de Caussade ; c’est un sujet que j’ai découvert lors de mon arrivée au ministère. Depuis, je l’ai beaucoup travaillé, et je le connais bien.
Les difficultés actuelles s’expliquent par des raisons juridiques.
En réponse au référé de l’association France nature environnement, le tribunal de grande instance d’Agen a demandé, mardi dernier, que la préfecture fasse cesser ces travaux. Vous l’avez dit vous-même : ces derniers continuent depuis des semaines, alors même que le projet est aujourd’hui non autorisé.
Vous m’interrogez quant à la stratégie de l’État pour éviter une montée des tensions face au projet, lequel est attendu très localement.
Sur un plan strictement administratif et juridique, en application de la décision en référé du tribunal de grande instance d’Agen, mon collègue François de Rugy a dû demander un constat de justice de l’illégalité des travaux. À ce titre, des astreintes financières sont possibles. J’ai lu certains appels à manifestation : je ne sais pas si les mémés aiment la castagne, …

… mais je sais que, dans ce territoire, on a le sang chaud !
Cette situation va nécessairement provoquer des tensions – j’en ai conscience –, d’autant que certains agriculteurs sont engagés dans la réalisation du chantier. Toutefois, vous le savez, l’État ne peut pas, en responsabilité, laisser ces travaux se poursuivre, alors même qu’ils ne sont pas autorisés : c’est la règle, et aucun gouvernement ne peut y déroger.
Madame la sénatrice, je suis engagé dans les assises de l’eau. Je vous le dis très sincèrement, comme je l’ai déjà dit au Sénat : dans le contexte du réchauffement climatique, l’agriculture française a besoin d’eau pour se développer. Mais les retenues d’eau doivent être aménagées dans le consensus territorial, sur la base de plans territoriaux.
Aussi, je vous lance un appel : je viendrai sûrement un jour dans le Lot-et-Garonne, même si je ne m’y rendrai pas dans l’immédiat – cela ne servirait à rien, en pleine situation de crise. J’ai d’ores et déjà rencontré tous les députés et les sénateurs de ce territoire, notamment M. Moga il y a quelques instants : j’observe que les parlementaires sont unanimement favorables au projet !
Alors, aidez-nous à apaiser les tensions. Il faut que le monde agricole nous y aide aussi. Dans ce qui a été fait, certains points sont juridiquement discutables. Pour ce qui me concerne, je ne pars pas des bureaux parisiens pour décider ce qui doit se passer sur le terrain : je veux connaître la véracité et la réalité du problème. Cette retenue d’eau correspond-elle réellement aux besoins ?
J’y insiste, il faut absolument nous aider à apaiser le débat, afin qu’une solution positive puisse en sortir dans les prochaines semaines.

La parole est à Mme Christine Bonfanti-Dossat, pour répondre à M. le ministre.

Monsieur le ministre, pour vérifier la véracité des faits, je vous assure qu’il faut venir sur place !
Le pire n’est jamais certain, je vous l’accorde… Toutefois, je vous aurai averti ; pour ma part, je considère sincèrement que le principe de précaution doit l’emporter sur toute autre considération.

La parole est à M. Daniel Laurent, auteur de la question n° 566, adressée à M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, ma question porte sur la réglementation européenne encadrant la protection des appellations d’origine viticoles, et plus précisément les conditions de repli entre appellations d’origine protégée, ou AOP.
Le repli entre appellations est une stratégie qualitative déterminante pour le renforcement qualitatif des produits et la création, dans le secteur vinicole, de marques fortes reconnues par les consommateurs. Il constitue donc un levier essentiel dans la construction de ces marques, qui participent à la structuration de l’offre, en particulier à l’international.
Chaque année, ce sont plus de 200 000 hectolitres qui font l’objet de replis. Or une interprétation des services du ministère de l’agriculture et de l’Institut national de l’origine et de la qualité, l’INAO, a conduit à remettre en cause cette pratique, pourtant codifiée par la voie législative et encadrée par la voie réglementaire.
La réglementation communautaire indique un certain nombre d’éléments devant impérativement figurer dans le cahier des charges d’une appellation. Elle laisse la possibilité d’y inclure d’autres dispositions prévues par la législation de l’État membre où est située l’appellation, comme c’est le cas pour le repli en France. Mais elle n’établit pas que le respect des règles des AOP signifie la compatibilité de 100 % des règles des cahiers des charges d’une appellation repliable et d’une appellation de repli.
Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer si vous considérez ce régime incompatible avec le droit communautaire ? Et, si tel est le cas, quelles démarches comptez-vous mettre en œuvre pour sécuriser cet usage local, le cas échéant à l’occasion de la réforme en cours de l’organisation commune des marchés, l’OCM, afin d’adapter les dispositions du règlement européen ?
Je vous remercie de votre réponse, attendue par toute la profession viticole.
M. le ministre de l ’ agriculture et de l ’ alimentation rit.

M. Didier Guillaume, ministre de l ’ agriculture et de l ’ alimentation. Monsieur le sénateur, cher Daniel Laurent, je sais qu’elle est attendue par toute la représentation nationale, évidemment !
Sourires.

Vous avez appelé mon attention sur les conditions réglementaires européennes encadrant le repli entre appellations d’origine protégée, et vous avez eu tout à fait raison de poser cette question.
Vous le savez : le repli, qui consiste à commercialiser un vin sous le nom d’une appellation autre que celle initialement revendiquée, est une pratique nationale antérieure à l’entrée en vigueur de la réglementation européenne relative aux indications géographiques de la filière viticole.
Le repli consiste à mettre en marché un vin sous le nom d’une appellation d’origine autre que celle revendiquée initialement. Ainsi, un vin élaboré, contrôlé et déclaré selon les règles d’un cahier des charges d’une appellation sera in fine commercialisé sous le nom d’une autre appellation.
Cette pratique – vous l’avez dit – est liée au principe de hiérarchisation des appellations d’origine, qui, dans certaines régions, s’emboîtent de manière pyramidale à partir d’une appellation régionale socle – je ne citerai personne –, puis sur des appellations sous-régionales, communales et le cas échéant sous-communales, le cahier des charges imposant des conditions de production de plus en plus restrictives.
Dans cette optique, le vin élaboré selon le cahier des charges d’une appellation hiérarchiquement supérieure répondrait de facto aux exigences de l’appellation régionale, dont les conditions de production sont moins contraignantes.
La réglementation européenne entrée en vigueur en 2009 ne prévoit ni la hiérarchisation des appellations ni le repli. Chaque appellation est indépendante et repose sur la démonstration d’un lien entre les qualités et les caractéristiques essentielles du vin et le milieu géographique dont il est issu, tel que défini par l’article 93 du règlement communautaire n° 1308 de 2013.
Un cahier des charges est attaché à chaque appellation et les opérateurs doivent respecter l’intégralité des conditions prescrites. Toutefois, afin de sécuriser la pratique du repli, les services de l’État, que j’ai sollicités, en lien avec l’INAO, examinent les conditions dans lesquelles celles-ci pourraient être adaptées au contexte réglementaire européen. Pour cela, une concertation à l’échelle de chaque région viticole sera menée dans les prochaines semaines afin d’étudier l’adaptation des cahiers des charges pour lesquels le repli est envisagé.
Voilà la réponse que je peux vous faire. J’ai déjà été interpellé à ce sujet sur le terrain. Je pense que c’est grâce à la concertation dans chaque région viticole et avec ce que la filière et les parlementaires feront remonter que nous pourrons argumenter à l’échelle européenne pour essayer de trouver une issue à cette importante question.

Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre. Cette concertation est utile, et elle doit être rapide, efficace et concrète. Vous l’avez compris, il s’agit d’un levier essentiel pour la viticulture dans la construction de ses marques, mais aussi pour l’exportation de notre vin à l’international.

La parole est à M. Gilbert Bouchet, auteur de la question n° 551, adressée à M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

Monsieur le ministre, en tant que Drômois, je m’adresse à vous afin de sauver la production rosée de la Clairette de Die. Vous connaissez ce dossier aussi bien que moi, dossier délicat marqué en 2018 par deux décisions juridiques.
La première du Conseil d’État, qui a annulé le décret autorisant les producteurs de la Clairette de Die à vinifier un pétillant rosé au sein de l’appellation, qui a été un gros coup dur pour 300 vignerons du Diois
La seconde, en fin d’année 2018, à la suite de la saisine du Conseil constitutionnel relative à la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite ÉGALIM, qui a été censurée au motif de cavaliers budgétaires, y compris l’amendement d’abrogation de la loi de décembre 1957 adopté en termes identiques par les deux assemblées.
J’ai depuis repris cet amendement sous la forme d’une proposition de loi afin d’attirer votre attention et celle de l’ensemble de mes collègues sur la situation dramatique pour cette partie de notre territoire. Je vous demande d’aider les vignerons du Diois à écouler leur production de vins rosés et je souhaite un peu de compréhension de la part des professionnels de régions viticoles françaises.
En ce début d’année, je formule le vœu de plus de solidarité nationale, car, je le rappelle, la concurrence existe, elle est européenne, et de plus grande ampleur que la petite production de qualité de la Clairette de Die.
Aussi, ma question est la suivante : monsieur le ministre, pouvons-nous compter sur votre soutien afin de trouver une solution pragmatique à ce problème de la production de pétillant rosé dans le Diois ?

Monsieur le sénateur, cher Gilbert Bouchet, vous êtes Drômois comme moi et vous connaissez bien cette situation, comme d’ailleurs votre collègue Bernard Buis, sénateur de la Drôme et sénateur du Diois, et donc sénateur de la Clairette de Die.
Votre question porte sur les difficultés rencontrées par les producteurs de vin d’appellation Clairette de Die et Crémant de Die du département de la Drôme pour commercialiser notamment le rosé. J’ai beaucoup travaillé sur le sujet lorsque je présidais le conseil départemental. Comme vous le savez, la loi de 1957 régissant la question aurait dû être abrogée sans un recours de nos amis du Cerdon, du département de l’Ain, qui ne voulaient pas être concurrencés. Nous en avons d’ailleurs beaucoup parlé avec les sénateurs de l’Ain, mais cela n’a pas abouti. Or les producteurs de cette région souhaitent élargir leur gamme avec des vins effervescents rosés, appréciés tout particulièrement par les femmes notamment pour l’apéritif – à consommer avec modération et en faisant attention à l’addiction, évidemment.
Un amendement de la députée Célia de Lavergne, que je remercie, adopté dans la loi ÉGALIM aurait dû régler le problème. Malheureusement, le Conseil constitutionnel a été saisi – recours que vous avez signé, monsieur le sénateur – et a retoqué un certain nombre de sujets considérés comme des cavaliers, dont celui qui nous occupe.
La filière et l’ensemble de l’appellation Clairette de Die se trouvent donc en situation d’insécurité économique malgré tout le travail accompli. Après l’invalidation par le Conseil constitutionnel, qui est la juridiction suprême, l’on ne peut rien faire d’autre sinon remettre l’ouvrage sur le métier Je sais que Célia de Lavergne a déjà mis en place des groupes de travail en relation avec la filière, de même que Bernard Buis avec les vignerons du secteur. Nous allons chercher un nouveau vecteur, éventuellement législatif, maintenant que les relations sont apaisées entre les différents territoires de notre pays, afin de booster cette filière qui marche très bien, mais qui doit élargir sa gamme avec la possibilité de produire un vin effervescent rosé. Je ne doute pas que tous les sénateurs et les députés de la Drôme se serreront les coudes pour y arriver !

Les sénateurs et les députés du département de la Drôme apporteront, je l’espère, leur contribution, puisque nous sommes tous sénateurs d’un département et donc sénateurs de la Clairette de Die, bien évidemment.
Monsieur le ministre, je veux juste souligner que le recours n’a pas été déposé contre la Clairette de Die, bien au contraire, puisque les deux assemblées avaient voté la disposition. La proposition de loi que je m’apprête à déposer sera un levier pour que la Clairette de Die rosée puisse se trouver sur le marché.

La parole est à M. Jean-François Longeot, auteur de la question n° 552, adressée à M. le ministre de l’économie et des finances.

Monsieur le secrétaire d’État, je me permets d’attirer votre attention sur la suppression du régime social des indépendants, le RSI, au 1er janvier 2018 et ses conséquences pour les indépendants. La suppression du RSI devait permettre d’améliorer les choses, mais ce n’est pas tout à fait le cas sur le terrain. Depuis cette date, la gestion sociale des travailleurs non salariés a été transférée au régime général des salariés. Or de nombreux indépendants ont rencontré cette année des difficultés, des appels à cotisations élevés et erronés ayant été demandés par les services des URSSAF, ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes et provoquer des mises en faillite de sociétés.
Concernant le recouvrement des cotisations, il apparaît clairement d’importantes difficultés avec le système d’information mis en place. Par conséquent, je vous demande de bien vouloir me préciser si ces problèmes de recouvrement des cotisations par les URSSAF seront résolus rapidement afin de répondre aux préoccupations des travailleurs indépendants qui comptaient beaucoup sur la réforme du RSI pour apporter une certaine souplesse et de la justesse s’agissant des appels à cotisations.
Monsieur le sénateur Jean-François Longeot, vous nous interrogez sur la suppression du régime social des indépendants au 1er janvier 2018 et ses conséquences pour lesdits indépendants.
Le recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, réalisé par les URSSAF, se déroule de manière globalement satisfaisante depuis maintenant plusieurs années, avant même que la décision concernant le RSI ait été prise. Il fait l’objet d’un suivi spécifique par une structure de pilotage dédiée, qui intègre les équipes informatiques et les organismes régionaux.
Cette organisation a démontré son efficacité globale, avec une amélioration continue de la performance du recouvrement, de la maîtrise des risques et de la qualité de service. Dans ce dernier domaine, des mesures majeures de modernisation et de simplification ont été conduites courant 2018, en accompagnement de l’adossement du régime social des indépendants au régime général.
Je pense en particulier à la simplification et à la modernisation des démarches, avec notamment une refonte de l’offre de services digitale : mise à disposition en avril 2018 d’une application mobile, refonte du site internet à destination des auto-entrepreneurs ou encore dématérialisation des actions de recouvrement et des moyens de paiement.
Il convient également de citer l’accompagnement et la prévention des difficultés des cotisants, en s’adaptant à leurs situations. Nous veillons ainsi à la refonte du cadencement des parcours de recouvrement pour privilégier la relation amiable avant le passage en recouvrement forcé, à des actions préventives, à la modulation des échéanciers notamment avec des délais de paiement par anticipation et des remises de majoration de retard lorsque cela s’avère nécessaire.
J’ajoute que, dans le contexte que nous connaissons, lié notamment au mouvement social dit des « gilets jaunes », nous avons donné consigne aux URSSAF de faire preuve d’une bienveillance particulière depuis le début du mois de décembre 2018 jusqu’à la fin du mois de mars 2019, en souhaitant que cela soit une durée suffisante.
Nous allons aussi expérimenter en région la création d’une relation personnalisée pour les créateurs d’entreprises, afin de simplifier leurs démarches. Par ailleurs, la loi pour un État au service d’une société de confiance, dite loi ESSOC, a prévu la généralisation du système de médiateur.
En 2019, et cela répondra certainement à une partie des difficultés que vous avez évoquées, un nouveau service de modulation en temps réel des cotisations sera expérimenté pour offrir au travailleur indépendant la possibilité d’ajuster au mois le mois le niveau de ses acomptes de cotisations à son revenu réellement perçu.
La stratégie de surveillance et de pilotage intégré des différents projets informatiques reste en tout état de cause essentielle pour la mise en œuvre de l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 qui emporte la suppression du régime social des indépendants ; nous y travaillons aussi.
Je voudrais terminer en vous invitant à nous signaler si des appels à cotisations erronés étaient constatés pour certains cotisants, en nous précisant leur situation de manière nominale, ainsi que leur catégorie de travailleur indépendant, pour que nous puissions régler ces difficultés au cas par cas.

La parole est à M. Jean-François Longeot, pour répondre à M. le secrétaire d’État.

Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie de votre réponse rassurante. Si j’ai déposé cette question, c’est parce que j’ai été sollicité par des travailleurs indépendants appelés à régler des sommes fabuleuses qui se sont révélées erronées après examen attentif par les URSSAF. Je n’hésiterai pas à vous saisir si d’autres cas se présentent.

La parole est à M. Jean-Marie Mizzon, auteur de la question n° 571, adressée à Mme la secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le 17 décembre 2018, le Sénat a examiné le projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôt sur le revenu et la fortune. Cette convention fiscale, régulièrement réactualisée depuis sa signature le 1er avril 1958, a été modifiée à quatre reprises.
Dans cette nouvelle convention, signée le 20 mars 2018, l’article 14 retient plus particulièrement l’attention des Mosellans. Il y est en effet bien pris en compte la situation spécifique des travailleurs frontaliers qui résident en France et exercent leur activité au Luxembourg.
De fait, une règle permet, pour des raisons de simplification administrative, que ces travailleurs demeurent soumis à l’impôt dans l’État d’exercice de leur activité lorsqu’ils travaillent au maximum vingt-neuf jours depuis leur État de résidence. Ce seuil est exclusivement fiscal. Aussi les travailleurs frontaliers pourront-ils télétravailler plus de vingt-neuf jours par an depuis leur État de résidence. Néanmoins, dans ce cas, les rémunérations reçues à ce titre ne seront imposables que dans cet État. La règle introduite dans cette nouvelle convention fiscale constituerait donc un équilibre entre la nécessité de faciliter la mobilité transfrontalière et la préservation des intérêts du Trésor français.
Pour autant, la question de la mobilité transfrontalière est loin d’être réglée. Il faut souvent deux heures et plus de trajets pour rejoindre le Luxembourg. Or, depuis la Moselle, les autoroutes comme les transports en commun sont sursaturés par plus de 70 000 personnes qui traversent chaque jour la frontière pour rejoindre leur lieu de travail. Cela participe du mécontentement de ces travailleurs, qui va grandissant et qu’il conviendrait d’entendre.
Le télétravail n’est certes pas la panacée, monsieur le secrétaire d’État, mais ne pourrait-on pas doubler cette durée de vingt-neuf jours et la porter, par exemple, à cinquante-huit jours par an ? Cela relève du simple bon sens, répondrait à des considérations sociales, environnementales, économiques et donnerait satisfaction à nombre de nos concitoyens, épuisés par tant de temps perdu dans les embouteillages.
Monsieur le sénateur Jean-Marie Mizzon, voici les précisions que je peux vous apporter sur la question du temps de travail autorisé dans l’État de résidence pour les travailleurs transfrontaliers.
La nouvelle convention fiscale franco-luxembourgeoise signée le 20 mars 2018, mais non entrée en vigueur, tient compte de la situation spécifique des travailleurs frontaliers qui résident en France et exercent leur activité au Luxembourg, en introduisant une règle permettant, pour des raisons de simplification administrative, qu’ils demeurent soumis à l’impôt dans l’État d’exercice de leur activité lorsqu’ils travaillent au maximum vingt-neuf jours par an depuis leur État de résidence.
Cette règle s’applique notamment aux résidents français employés au Luxembourg et télétravaillant depuis la France. C’est l’exemple que vous avez cité dans votre question. Ce seuil étant exclusivement fiscal, les travailleurs frontaliers pourront, s’ils le souhaitent et s’ils le peuvent en accord avec leur employeur, télétravailler plus de vingt-neuf jours par an depuis leur État de résidence, mais dans ce cas, les rémunérations reçues à ce titre ne seront imposables que dans cet État. La règle introduite dans la nouvelle convention fiscale franco-luxembourgeoise constitue à nos yeux un équilibre entre la nécessité de faciliter la mobilité transfrontalière et la préservation des intérêts du Trésor.
En effet, la pratique internationale reconnue par l’OCDE et reprise dans la convention franco-luxembourgeoise de 1958 réserve le droit d’imposer les revenus d’emploi à l’État où celui-ci est exercé. Par ailleurs, à titre de comparaison, le Luxembourg dispose d’accords de ce type avec l’Allemagne et la Belgique, les seuils avec ces États étant respectivement fixés à vingt jours et à vingt-quatre jours. Le seuil de vingt-neuf jours qui sera applicable aux travailleurs français est donc le plus élevé qui existe à ce jour pour les frontaliers travaillant au Luxembourg.
Enfin, la question de la mobilité transfrontalière passe plutôt, à nos yeux, par une coopération accrue entre la France et le Luxembourg en ce qui concerne le développement économique de la zone frontalière. Ces questions ont notamment été abordées à l’occasion de la visite d’État du Grand-Duc du Luxembourg en France, du 19 au 21 mars 2018, et ont abouti à la signature le 20 mars 2018 d’un protocole d’accord relatif au renforcement de ladite coopération en matière de transports transfrontaliers.
La France et le Luxembourg sont par ailleurs convenus de poursuivre leurs discussions sur le codéveloppement des territoires par des réflexions sur les secteurs prioritaires, les questions de gouvernance et le renforcement de l’attractivité économique du Nord lorrain. Gageons que ces mesures permettent aussi de répondre à certaines des inquiétudes que vous avez exprimées.

La parole est à M. Alain Cazabonne, auteur de la question n° 574, adressée à M. le ministre de l’action et des comptes publics.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, ma question provient d’une suggestion de l’un des responsables des services fiscaux de la cité administrative de Bordeaux.
Cette année, ne recevant pas mon avis d’impôt foncier, je téléphone au numéro inscrit sur l’appel de l’an dernier et tombe sur un répondeur, ce qui est toujours agréable pour les personnes sans accès à internet, me conseillant de me rendre sur le site « impots.gouv.fr », où je n’ai jamais réussi à entrer le numéro fiscal de l’année qui m’était demandé, n’ayant pas reçu l’avis d’imposition mentionnant ledit numéro ! L’informaticien de la ville n’y est pas non plus parvenu. Je me suis donc rendu à la cité administrative où, après une longue attente en compagnie de plusieurs centaines de personnes, le responsable à qui j’expliquais mon cas a pu sortir en quelques secondes une copie de l’avis fiscal de l’année à l’aide de mon identifiant fiscal personnel. Il m’a conseillé de faire remonter le problème, car il recevait des centaines de personnes, en particulier la dernière semaine, ne parvenant pas à obtenir une copie de leur numéro fiscal de l’appel de l’année. Cela m’a paru assez anormal, alors que n’importe quel site d’achat vous permet de retrouver votre mot de passe oublié. Ce fut impossible pour les impôts, sauf à se rendre à la cité administrative.
Monsieur le sénateur Alain Cazabonne, je dois avouer que votre retour d’expérience nous a un peu surpris, pour les raisons que je vais essayer d’expliquer. Vous avez attiré notre attention sur la question de la récupération de l’identifiant fiscal par les contribuables qui n’ont pas leur avis d’impôt sur eux. Vous indiquez que les agents des centres « impôts service » n’étaient pas en capacité de transmettre cette information par téléphone. Or les règles de délivrance des identifiants sont des règles stables depuis 2014, et elles permettent aux services fiscaux de fournir le numéro fiscal aux usagers qui en font la demande, par tout canal, y compris téléphonique, sur simple identification de la personne. Cette identification est fondée sur quelques questions, relatives notamment à l’état civil, pour garantir l’identification du correspondant au bout du fil.
Les agents des centres « impôts service », et donc des plateformes téléphoniques, comme ceux des autres plateformes d’accueil à distance actuellement mobilisées derrière le numéro spécifique pour le prélèvement à la source, et à l’instar des services locaux accueillant physiquement le public, sont donc habilités à délivrer son identifiant fiscal à un usager qui les sollicite par téléphone, dès lors que l’identification par le questionnement est concluante.
Au vu de votre retour d’expérience, dont je vous remercie, nous allons toutefois rappeler les instructions en vigueur aux agents des plateformes téléphoniques, afin que ce service soit effectivement rendu.
Par ailleurs, les contribuables disposant d’un espace particulier sur le site impots.gouv.fr, à la condition que vous avez évoquée de disposer d’une connexion et d’une compétence en matière d’internet, peuvent se faire renvoyer leur identifiant automatiquement par courriel en cliquant sur un lien dédié à cela, sans plus d’identification que celle qui est nécessaire à la connexion à leur espace individuel.
Nous allons rappeler ces instructions, mais en l’occurrence, en fonction des règles de délivrance des identifiants, qui, je le répète, sont stables depuis 2014, les agents répondant aux plateformes téléphoniques auraient dû délivrer ce numéro d’identifiant.

La parole est à M. Alain Cazabonne, pour répondre à M. le secrétaire d’État.

Je voudrais m’assurer que nous parlons bien de la même chose. Il ne s’agit pas du numéro fiscal inscrit sur les avis d’imposition et qui reste inchangé, mais bien de l’identifiant figurant sur l’avis de l’année 2018, qui diffère de celui de l’année 2017 ou 2016. Il y a peut-être un malentendu entre ma question et vos réponses.

La parole est à M. Cédric Perrin, auteur de la question n° 565, adressée à M. le ministre de la culture.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, ma question s’adressait à M. le ministre de la culture parce qu’elle concerne les festivals, les festivals de musique en général et celui des Eurockéennes de Belfort en particulier.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’une circulaire datée du 15 mai 2018 vient réglementer de manière drastique la mise à disposition des forces de l’ordre dans les manifestations. Dans l’ensemble des festivals en France, cette circulaire entraîne une augmentation considérable des frais de sécurité et met le festival des Eurockéennes en grand danger.
Nous avions réussi à le sauver l’an dernier après quelques discussions, mais l’exercice 2019 est en préparation et nous sommes extrêmement inquiets. J’ai sollicité le Gouvernement à l’occasion d’une question au Gouvernement le 11 juillet dernier et par des questions écrites et de nombreux courriers ces derniers temps. La situation est très urgente et nous sommes en attente d’une réponse, monsieur le secrétaire d’État. Comment permettre au festival des Eurockéennes de perdurer en maîtrisant les coûts de sécurité ?
Le grand problème, c’est évidemment la modification du caractère du festival, devenu « à but lucratif » après vingt-neuf ans d’existence en tant que festival à but non lucratif ! La préfecture du Territoire de Belfort, par une récente décision unilatérale, vient de décider, comme par enchantement, que celui-ci devenait lucratif, l’excluant du bénéfice du bouclier tarifaire qui pourrait lui être octroyé en vertu de la circulaire Collomb du 15 mai 2018.
Monsieur le secrétaire d’État, quelle solution envisagez-vous ?
Monsieur le sénateur Cédric Perrin, M. Franck Riester, ministre de la culture, étant retenu ce jour, il m’a demandé de vous transmettre ces éléments de réponse. Vous l’avez interrogé sur l’alourdissement des charges pesant sur les festivals, au point, dites-vous, d’en menacer l’existence pour certains d’entre eux.
L’indemnisation des services d’ordre est prévue à l’article L. 211–11 du code de la sécurité intérieure et concerne les missions ne pouvant être rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l’ordre. La circulaire du 15 mai 2018 en précise les modalités d’application.
Le 6 juillet dernier, dans un communiqué de presse, les ministres de la culture et de l’intérieur invitaient les préfets, et ce compte tenu de l’obligation légale de facturation, à faire preuve de discernement en veillant à la compatibilité du montant facturé avec l’équilibre économique des festivals et à la discussion nécessaire avec l’organisateur en amont de l’événement. Ils évoquaient également l’établissement d’un bilan d’étape à l’automne, afin de préciser cette doctrine et l’application de la loi.
L’application de la circulaire du 15 mai 2018 relative à l’indemnisation des services d’ordre a par conséquent fait l’objet d’une évaluation de la part des services du ministère de l’intérieur sur la base des informations remontées des préfectures et de celles qui ont été centralisées par les directions générales de la police et de la gendarmerie nationales.
Par ailleurs, deux députés, Mme Brigitte Kuster et M. Bertrand Bouyx, se sont vus confier à l’Assemblée nationale une mission flash sur les nouvelles charges en matière de sécurité pour les salles de spectacle et les festivals et ont procédé à ce titre à l’automne à un certain nombre d’auditions, notamment d’acteurs du ministère de la culture. Les principales organisations professionnelles ont également été sollicitées pour participer à ces travaux.
Le rapport final rédigé par le ministère de l’intérieur devrait prochainement être remis afin de proposer une méthodologie d’application de la circulaire du mois de mai 2018 pour limiter la différence d’appréciation d’un territoire à l’autre et rappeler les instructions qui avaient été données en matière de qualification et d’ajustement de l’application de la loi aux facultés et aux équilibres économiques des événements que vous avez cités.
Soyez assuré de la forte attention portée par les ministères de la culture et de l’intérieur sur ce sujet, ainsi que de la volonté d’aboutir rapidement afin de répondre à l’urgence que vous évoquez, notamment pour que les organisateurs puissent connaître précisément et en amont les règles qui leur sont imposées, en vue de sécuriser l’organisation des événements que vous avez mentionnés.

La parole est à M. Cédric Perrin, pour répondre à M. le secrétaire d’État.

Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie de votre réponse. Vous l’avez rappelé, il a été demandé au préfet du Territoire de Belfort, comme à tous les autres préfets, le 6 juillet dernier, de faire preuve de discernement. Or faire preuve de discernement, cela signifie aussi faire preuve de bon sens et de pragmatisme. Comment peut-on considérer qu’un festival à but non lucratif depuis vingt-neuf ans devienne comme par enchantement du jour au lendemain à but lucratif, ne pouvant de fait plus bénéficier des bouclier tarifaire et autres possibilités de voir ses frais de sécurité plafonnés ?
Aujourd’hui, la situation est extrêmement urgente. On m’annonce, depuis le mois de juillet, des résultats rapides. Monsieur le secrétaire d’État, j’espère sincèrement que nous allons trouver rapidement une solution, que le pragmatisme va l’emporter et que nous reviendrons à une situation normale. Si tel n’était pas le cas, c’est l’existence même d’un certain nombre de festivals qui serait en jeu, dont celui des Eurockéennes, avec ses 135 000 festivaliers par an, sa renommée internationale et ses retombées économiques de plus de 13 millions d’euros pour notre département.

La parole est à Mme Jocelyne Guidez, auteur de la question n° 225, adressée à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

Madame la garde des sceaux, je souhaite attirer votre attention sur les jeunes engagés dans un service militaire volontaire – SMV – et en particulier sur leur casier judiciaire.
À ce jour, la France comporte six structures accordant la possibilité à ces citoyens peu ou pas diplômés de se construire un nouvel avenir personnel et de s’insérer dans la société et la vie active. En effet, ces derniers peuvent obtenir à la fois une formation certifiée, une remise à niveau sur le plan scolaire, un accès à la mobilité par le permis de conduire, un accompagnement psychologique, mais aussi une prise en charge financière symbolique. À titre d’illustration, le taux d’insertion professionnelle en Île-de-France est de 72 % environ.
Ainsi, ces centres offrent à ces enfants de la République la possibilité de donner corps à son idéal et leur procurent les moyens de les aider à surmonter les injustices de la naissance, donnant alors vie à son objectif d’égalité des chances. La nature de cet encadrement leur permet de renouer directement avec le respect de l’ordre et de la discipline, ainsi qu’avec le sens du dévouement envers le bien public.
En outre, parmi les jeunes les plus éloignés d’un avenir professionnel et social décent, se trouvent ceux qui ont un passé dans la délinquance. Aussi, conformément à l’article 770 du code de procédure pénale, l’effacement facultatif d’une décision prise à l’égard d’un mineur de dix-huit ans ou d’une personne âgée de dix-huit à vingt et un ans peut être demandé après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de ladite décision.
Même si des démarches ont déjà été engagées entre les encadrants militaires et les procureurs de la République, celles-ci ne sont pas systématiques et peuvent être décourageantes. En somme, le casier judiciaire est un élément important de la sélection professionnelle et laisse parfois en marge le jeune souhaitant prendre un nouveau départ.
Au mois d’octobre dernier, j’avais proposé par voie d’amendement la possibilité de procéder à un effacement après la réalisation d’un service militaire volontaire de douze mois ou d’un service militaire adapté de huit mois minimum, pour des faits relevant bien sûr de la petite délinquance. Cet amendement était d’ailleurs inspiré par les services des armées prenant en charge ces jeunes déscolarisés. Une telle mesure permettrait de leur accorder non pas une réponse laxiste, mais bien une seconde chance.
Surtout, si la question de la sécurité peut être soulevée, et elle est tout à fait légitime, je veux insister sur le fait que ce dispositif est de nature à responsabiliser les jeunes délinquants en quête de réhabilitation du fait de la nature volontaire d’une inscription à ces types de service militaire.
Par conséquent, madame la garde des sceaux, la réussite d’un parcours au sein d’un centre du SMV ne pourrait-elle pas devenir le moyen d’effacer ces mentions ? Comment la justice pourrait-elle faciliter ces procédures ?
Par là même, à l’heure où la représentation nationale a consacré le droit à l’erreur, il s’agirait de consacrer un droit à l’oubli pour des jeunes ne demandant qu’à se reconstruire une vie digne et honorable. Je travaille bénévolement auprès de ce public et je sais qu’il est important de leur faire de nouveau confiance.
Madame la présidente, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Jocelyne Guidez, le service militaire volontaire, SMV, qui a été institué par l’article 22 de la loi du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019, vise « à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes ».
Aujourd’hui, l’exercice de nombreuses professions nécessite, afin de s’assurer de la bonne moralité du candidat, que son casier judiciaire ne comporte pas certains types de condamnations.
Le bulletin n° 1 du casier judiciaire, auquel fait référence l’article 770 du code de procédure pénale que vous citez et sur lequel figurent pendant une durée de quarante ans toutes les condamnations prononcées, est réservé uniquement aux autorités judiciaires.
Ainsi, les vérifications professionnelles évoquées sont exercées sur la seule base du bulletin n° 2 du casier judiciaire, sur lequel seules certaines condamnations figurent, et ce pendant une durée restreinte conformément aux dispositions de l’article 775 du code de procédure pénale.
À titre d’illustration, aucune des condamnations prononcées pendant la minorité d’une personne ne figure au bulletin n° 2, dans un objectif clairement poursuivi par le législateur de favoriser la réinsertion des mineurs et jeunes majeurs.
De la même façon, en application de l’article 775–1 du code de procédure pénale, le juge peut décider, dans sa décision de condamnation ou dans une décision postérieure, de ne pas faire figurer celle-ci au bulletin n° 2 de l’intéressé, dans la majorité des cas en raison d’un projet professionnel construit et des efforts de réinsertion engagés. Dans ce cadre, l’engagement réussi d’un jeune dans un service militaire volontaire est assurément pris en compte.
Cependant, cette réussite, aussi honorable soit-elle, ne doit pas dispenser d’un regard individualisé et personnalisé d’un magistrat sur chaque requête sollicitant l’effacement des mentions figurant au casier judiciaire et liées à des condamnations pénales. Cette procédure me semble à même de prévenir tout abus.
Sans porter atteinte à la nécessaire appréciation individuelle des situations, je demanderai aux procureurs de la République d’être attentifs aux demandes qui seront formulées par ces jeunes, qui sont engagés dans le cadre du service militaire volontaire.

La parole est à Mme Pascale Bories, auteur de la question n° 549, adressée à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

Madame la garde des sceaux, je souhaite attirer votre attention sur le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance de Nîmes, qui ont trois postes non pourvus, alors que le nombre de postes dédiés à leurs juridictions n’est déjà pas suffisant.
Face à ces difficultés, ils se retrouvent dans une situation de blocage, dans laquelle les dossiers ne peuvent pas être traités dans des délais raisonnables et les délibérés ne peuvent pas être rendus en temps et en heure.
Le projet de loi de finances pour l’année 2019 prévoit une hausse des moyens alloués à la justice, dont la création de 1 300 postes supplémentaires. Cependant, le Gouvernement a choisi de mettre l’accent sur l’administration pénitentiaire, qui mobilise à elle seule 75 % de la totalité des emplois qu’il compte créer dans le secteur de la justice cette même année.
Le Gouvernement semble néanmoins avoir essayé de répondre aux revendications des magistrats et des greffiers, puisqu’il a budgétisé une hausse des moyens des juridictions françaises. En attendant ces mesures et les premiers effets du plan de transformation numérique et de simplification des procédures, la situation dans mon département demeure préoccupante et réclame une solution d’urgence, notamment pour permettre le remplacement des personnes qui sont en arrêt maladie – ce sont des postes comptés comme pourvus, mais pas occupés dans les faits.
Je tiens à aborder un autre problème : le maillage territorial des lieux de justice est de plus en plus menacé. Vous avez affirmé ne pas vouloir départementaliser les tribunaux de grande instance. Or la nouvelle lecture du projet de loi adopté à l’Assemblée nationale confirme l’extension du concept de spécialisation aux tribunaux limitrophes, même s’ils ne font pas partie du même département. Cela contribue à la départementalisation des tribunaux de grande instance. De plus, l’encadrement du périmètre des spécialisations des tribunaux de grande instance me semble particulièrement illusoire.
La situation de mon département est préoccupante. Je voudrais avoir des réponses concrètes quant aux difficultés de fonctionnement de ses tribunaux, difficultés qui concernent plusieurs communes. Comment venir en aide à des tribunaux locaux qui n’arrivent pas à pourvoir leurs postes vacants ou ceux qui sont non occupés en raison d’arrêts maladie ? Le traitement des dossiers et la lourdeur des tâches administratives nécessitent que tous les postes soient pourvus. Enfin, comment comptez-vous assurer une justice de proximité tout en spécialisant les tribunaux ?
Madame la sénatrice Pascale Bories, je voudrais souligner en premier lieu que les moyens mobilisés pour la justice, tels qu’ils sont inscrits dans le projet de loi de programmation 2018–2022 que je reviendrai défendre devant vous prochainement, sont tout à fait considérables.
Pour l’année 2018, le budget de la justice est en augmentation de 3, 9 %, ce qui est une première étape de la programmation que je mentionnais à l’instant qui prévoit une progression de près de 25 % de ce budget sur la période considérée.
Je rappelle en outre que, en 2019, le budget de la justice judiciaire représente 38 % du budget global et l’administration pénitentiaire, 39 %. L’écart que vous indiquez n’existe donc pas.
En 2018, 148 créations de postes dans les services judiciaires, dont 100 postes de magistrats, sont venues compléter les vacances de postes en juridiction et développer les équipes autour du magistrat. Cet effort se poursuit en 2019 avec la création de 192 emplois dans les juridictions.
S’agissant du tribunal de grande instance de Nîmes, seuls deux postes sont actuellement vacants, et non pas trois, en tout cas par rapport à la clef. Il y a peut-être des arrêts maladie, mais nous ne les connaissons pas au niveau national et il appartient alors à la Cour d’appel de répondre à cette situation par des postes placés.
Le projet de loi de programmation pour la justice renforce également l’implantation judiciaire existante. Je l’ai dit à plusieurs reprises, nous ne fermerons aucun tribunal.
La spécialisation, que vous évoquez et qui ne peut provenir que d’un projet territorial, ne concernera en aucun cas les contentieux de masse, qui sont traités par l’ensemble des juridictions et qui le demeureront. Elle ne pourra concerner que des contentieux très techniques, hautement spécialisés et de faible volume, comme cela est écrit dans le projet de loi en discussion. Cette spécialisation devra être organisée de manière équilibrée sur l’ensemble des tribunaux d’un même département.
En ce qui concerne la spécialisation interdépartementale que vous mentionnez, elle a été introduite dans le projet de loi pour répondre, à titre exceptionnel, à des demandes précises qui émanent de certains tribunaux – je pense notamment à ceux de Belfort et de Montbéliard. Il s’agit donc, je le répète, de cas tout à fait exceptionnels, qui ne visent pas tous les départements.
Soyez assurée, madame la sénatrice, que je n’ai qu’une ambition : conforter l’ensemble des tribunaux existants. Les dispositions inscrites dans le projet de loi y pourvoient.

La parole est à Mme Pascale Bories, pour répondre à Mme la garde des sceaux.

Je vous remercie des réponses que vous m’avez apportées, madame la garde des sceaux. Il est vrai que, lorsque j’ai préparé cette question orale, trois postes étaient non pourvus et qu’ils sont aujourd’hui au nombre de deux. Je rappelle toutefois que ce problème est aggravé par les arrêts maladie, car les postes concernés sont de facto vacants.
Je crois qu’il est important de rassurer les magistrats et la population, en particulier dans les départements ruraux, où la problématique de la proximité est essentielle. Une attention particulière doit être portée sur ce sujet.

La parole est à M. Olivier Paccaud, auteur de la question n° 556, adressée à M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.

Madame la présidente, ma question s’adresse effectivement au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, qui n’est pas présent ce matin.
Pour définir la carte des réseaux d’éducation prioritaire, REP et REP+, tous les 4 ans, la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l’éducation nationale utilise « l’indice social ». Cet indice se fonde sur plusieurs critères, parmi lesquels le pourcentage d’élèves issus des catégories sociales les plus défavorisées, le taux de boursiers, le pourcentage d’élèves issus de zones urbaines sensibles et le pourcentage d’élèves en retard à l’entrée en classe de sixième.
Or la limitation géographique aux zones urbaines sensibles peut s’avérer un critère injustement discriminatoire, puisqu’il restreint un soutien scolaire aussi indispensable en milieu rural.
En effet, la ruralité connaît aussi des problèmes sociaux et économiques, difficultés accrues par l’éloignement, l’enclavement et la moindre présence d’infrastructures culturelles, d’équipements sportifs, de services publics.
Est-il ainsi juste que, sur les 1 097 collèges situés aujourd’hui en zone d’éducation prioritaire, seuls 9 – je dis bien 9 ! –, c’est-à-dire 0, 8 %, soient ancrés dans des territoires ruraux ?
Pour ne prendre que l’exemple de mon département, l’Oise, le réseau d’éducation prioritaire comptait jusqu’en 2014 deux collèges situés en zone plus ou moins rurale, ceux de Crèvecœur-le-Grand et Mouy. Ils ont alors été sortis du réseau pour y être remplacés par deux établissements purement urbains.
Cette décision, dont les motivations en matière d’efficacité pédagogique s’avéraient incompréhensibles, fut très mal vécue par toutes les parties concernées – parents d’élèves, enseignants, élus… –, ce qui a notamment donné lieu à des manifestations et à des occupations de locaux.
L’actualité récente nous a démontré que les fractures territoriales ne sont plus acceptées par nos concitoyens. À juste titre ! La République, c’est l’égalité des droits et l’égalité des chances, partout sur le territoire. Faisons donc en sorte que notre idéal républicain devienne, ou plutôt redevienne, une réalité dans les faits !
Aussi, alors que la carte de l’éducation prioritaire doit être prochainement réexaminée, j’espère très sincèrement que les zones rurales fragiles – Dieu sait qu’elles sont malheureusement nombreuses – pourront y être intégrées. Merci de m’éclairer et peut-être de me rassurer à ce sujet.
Madame la présidente, monsieur le sénateur Olivier Paccaud, je vous prie d’excuser mon collègue ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer, qui accompagne aujourd’hui le Président de la République en Allemagne et qui m’a chargé de vous apporter la réponse suivante.
La politique d’éducation prioritaire est centrée sur les structures scolaires, écoles et collèges, qui concentrent un pourcentage important d’élèves issus des milieux sociaux les plus défavorisés. Elle s’appuie sur le constat que l’absence de mixité scolaire et sociale aggrave les difficultés que ces élèves rencontrent pour réussir.
Lors de la révision de sa géographie en 2015, la politique d’éducation prioritaire n’a pas exclu les écoles ou collèges ruraux. Les critères retenus lors de cette révision, à savoir le pourcentage d’élèves boursiers ou appartenant à des catégories sociales défavorisées, font davantage prévaloir l’origine sociale que l’origine géographique des élèves.
M. Blanquer n’a pas les mêmes chiffres que vous, puisque, à la rentrée 2018, 25 collèges de l’éducation prioritaire sont situés en zone rurale et 108 en ville isolée, ce qui représente 12 % des collèges de l’éducation prioritaire.
M. Olivier Paccaud fait un signe de dénégation.
Si la politique d’éducation prioritaire est centrale pour lutter contre les inégalités scolaires liées aux origines sociales, elle n’est pas la seule réponse aux difficultés de différentes natures que rencontrent les territoires dans leur diversité.
D’autres stratégies sont déjà mises en œuvre et sont appelées à se développer, comme l’allocation progressive des moyens adaptés au profil de chaque école et établissement dans le premier comme dans le second degré.
Par ailleurs, certains obstacles que rencontrent les élèves – vous en avez parlé – ne sont pas directement liés à leurs origines sociales. Certains tiennent, notamment dans les secteurs les plus ruraux, à d’autres facteurs, tels que l’éloignement des établissements d’enseignement supérieur pour poursuivre sa scolarité ou encore l’éloignement ou l’absence de structures culturelles à proximité.
C’est pour cette raison qu’une mission « Politiques éducatives et territoires » a été confiée à Ariane Azéma, inspectrice générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, et à Pierre Mathiot, professeur des universités. Cette mission travaille avec les services du ministère à la redéfinition des politiques territoriales de l’éducation nationale dans un double objectif d’élévation générale du niveau des élèves et de justice sociale. Elle proposera un cadrage national capable de s’adapter à des situations locales très diverses à l’été 2020.

Nous en avons terminé avec les réponses à des questions orales.
Mes chers collègues, l’ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures quarante-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.