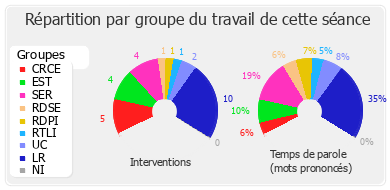Séance en hémicycle du 1er février 2023 à 22h20
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à vingt heures cinquante, est reprise à vingt-deux heures vingt, sous la présidence de Mme Laurence Rossignol.

La séance est reprise.

Lors du scrutin public n° 117, mon collègue Fabien Genet souhaitait s’abstenir.

Acte est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

L’ordre du jour appelle, à la demande du groupe Les Républicains, la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à calculer la retraite de base des non-salariés agricoles en fonction des vingt-cinq années d’assurance les plus avantageuses (proposition n° 166, texte de la commission n° 277, rapport n° 276).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis très heureux d’être devant vous ce soir pour l’examen de la proposition de loi relative au régime de retraite des non-salariés agricoles, déposée à l’Assemblée nationale par le député Julien Dive.
Nous avons su, grâce à la discussion, poser les bases d’un consensus républicain avec les différents groupes de l’Assemblée nationale, ainsi qu’avec l’auteur de ce texte, ce qui a conduit à son adoption à l’unanimité par vos collègues députés le 1er décembre dernier.
L’adoption conforme de la proposition de loi par votre commission des affaires sociales le 23 janvier dernier permet de prolonger et de renforcer ce consensus, qui nous amène à aborder le débat d’aujourd’hui – et je ne peux évidemment y voir qu’un bon présage pour l’adoption définitive de ce texte.
Je tiens à souligner que les attentes en matière de retraites agricoles sont nombreuses et légitimes. Elles répondent à la volonté de voir nos agriculteurs et nos agricultrices vivre dignement à la retraite, après des années de labeur consacrées à nourrir les autres.
C’est la raison pour laquelle, au-delà du texte qui nous réunit, j’ai pris la question des retraites agricoles à bras-le-corps tout au long de la concertation que nous avons menée lors de la préparation de la réforme des retraites, dont vous connaissez maintenant les résultats. Ainsi, outre les partenaires sociaux interprofessionnels, j’ai associé la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) à l’ensemble des discussions, et nous avons naturellement échangé sur ce sujet des vingt-cinq meilleures années d’assurance.
Je connais également l’attention que porte le ministre de l’agriculture à cette question et je suis convaincu que, si la réforme est juste, c’est aussi grâce à une meilleure prise en compte des spécificités agricoles.
Avant d’entrer dans le détail de la proposition de loi, je souhaiterais replacer cette initiative dans son contexte.
L’attention portée aux retraites agricoles ne date évidemment pas de cette législature. Depuis vingt ans, les réformes et les propositions se sont succédé pour améliorer la situation des retraités agricoles et revaloriser les petites pensions.
L’objectif a toujours été le même : concilier prise en compte des spécificités agricoles et convergence vers les autres régimes.
L’équation n’a pas changé, mais nous avons, à chaque fois, su la résoudre collectivement : il y a près de vingt ans, en créant la retraite complémentaire des exploitants agricoles ; il y a bientôt dix ans, en créant la garantie de retraite minimale pour les chefs d’exploitation, dans le cadre de la réforme alors défendue par Marisol Touraine ; et, plus récemment encore, grâce aux deux lois Chassaigne, qui portent le nom de leur auteur et qui ont permis de revaloriser de manière inédite les pensions des chefs d’exploitation agricole et de leurs conjoints, c’est-à-dire, la plupart du temps, de leurs conjointes.
Ces conquêtes agricoles nous ont rappelé que le consensus ne se décrète pas, mais qu’il se construit. Beaucoup d’entre vous étaient déjà présents sur les bancs du Parlement lors de l’examen des futures lois Chassaigne. Ils se souviennent que les dernières avancées ont été longuement mûries à partir de 2016, faisant l’objet d’une concertation avec l’ensemble des syndicats agricoles ainsi que de discussions avec les représentants des retraités – je pense notamment à l’Association nationale des retraités agricoles de France (Anraf) – et d’un long travail avec les opérateurs, en premier lieu le réseau des mutualités sociales agricoles (MSA) et les services de l’État.
Pas à pas, nous avons su collectivement préparer et financer ces mesures de revalorisation, qui ont finalement été votées par l’ensemble des groupes parlementaires, avec le soutien de la majorité et du Gouvernement.
Ces revalorisations ont produit des effets concrets. Au total, les deux lois les plus récentes, adoptées durant le précédent quinquennat, ont permis de revaloriser les pensions de plus de 330 000 anciens agriculteurs, soit 30 % des retraités de droit direct du régime. Le gain est significatif, puisque les pensions ont augmenté en moyenne d’environ 100 euros par mois, ce dont nous pouvons tous nous féliciter.
Cela signifie-t-il pour autant que la totalité du chemin a été parcourue ? Je ne le crois pas.
Le régime de retraite des non-salariés agricoles est devenu profondément complexe, additionnant les strates de pension et multipliant les paramètres. La sédimentation du régime agricole nuit aujourd’hui à la lisibilité du système, donc à la confiance qu’il doit inspirer, notamment aux jeunes générations d’agriculteurs. Quelle que soit notre appartenance politique, nous le constatons tous dans nos circonscriptions, dans nos départements.
C’est dans ce contexte qu’intervient l’examen de cette proposition de loi. Porter le principe d’un calcul des retraites agricoles en fonction des vingt-cinq meilleures années est en apparence consensuel. Toutefois, comme souvent, je l’ai souligné à l’Assemblée nationale et je le redis ici, le diable est dans les détails.
Les débats en commission des affaires sociales, sous l’autorité de Mme la présidente Deroche, ont permis de soulever un certain nombre de questions, dont celle de la meilleure manière de concilier un calcul sur le fondement des vingt-cinq meilleures années et la protection d’un système devenu très redistributif depuis les lois Chassaigne 1 et 2, celle des solutions à envisager pour permettre l’application d’un système par annuités dans le cadre d’un régime par points ou encore celle de l’entrée en vigueur de la mesure, dernier point qui a suscité de nombreux débats.
Je suis satisfait que les indications de la MSA aient été prises en compte, en particulier le renvoi de la mise en œuvre de ce texte à 2026 plutôt qu’en 2024. Ce délai reste très ambitieux : il faudra une mobilisation collective pour avancer de manière concrète et efficace.
Je souhaite désormais – j’espère que le Parlement partage ce vœu – que nous puissions apporter des réponses à ces nombreuses questions. C’est tout le sens du texte soumis à l’examen de votre assemblée aujourd’hui.
La mission qui verra le jour, si cette proposition de loi est définitivement adoptée à l’issue de nos débats, devra définir dans un délai, lui aussi ambitieux, de trois mois les scénarios permettant d’atteindre l’objectif de transformation du système.
Nous devrons veiller collectivement à ne pas remettre en cause les droits acquis et à ne pas fragiliser des carrières linéaires qui ne bénéficieraient pas de cette mesure.
Aussi, au moment d’engager la discussion, je veux poser, avec l’appui de Mme le rapporteur et des différents groupes du Sénat et, au-delà, avec l’ensemble des parlementaires, les bases d’un consensus que je souhaite le plus large possible.
Nos agriculteurs et nos agricultrices, plus largement les Français et les Françaises, nous attendent sur cet horizon de justice sociale.
Marche après marche, réforme après réforme, nous trouvons ensemble les chemins d’un compromis républicain, qui a su si bien s’illustrer par le passé en matière de retraites agricoles et qui s’illustrera de nouveau ce soir. J’espère que nous franchirons un nouveau pas pour davantage d’égalité et de reconnaissance des agriculteurs.
Appl audissements sur les travées du RDPI et du RDSE. – Mme Kristina Pluchet, M M. Alain Duffourg, Marc Laménie et Jean-Claude Tissot applaudissent également.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, voilà deux ans, notre assemblée adoptait la loi Chassaigne 2, qui a permis de fixer la pension minimale de base des conjoints collaborateurs et des aides familiaux d’agriculteurs au même niveau que celle des chefs d’exploitation.
Un an plus tôt, nous avions déjà voté la loi Chassaigne 1, qui relevait de 75 % à 85 % du Smic la garantie de pension des chefs d’exploitation justifiant d’une carrière complète accomplie en cette qualité.
La présente proposition de loi, déposée par le groupe Les Républicains et votée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er décembre dernier, constitue donc la troisième pierre que la Nation doit apporter à l’édifice de sa reconnaissance envers un monde agricole en grande souffrance et pourtant si essentiel à la grandeur de la France.
Le mode de calcul des pensions de nos agriculteurs, il faut bien le dire, est particulièrement illisible. À une pension forfaitaire de 312 euros par mois pour une carrière complète s’ajoute une pension proportionnelle calculée dans le cadre d’un système hybride fonctionnant par points, mais intégrant nombre de paramètres des régimes par annuités, notamment en matière d’âge d’ouverture des droits, de durée d’assurance, de surcote et de décote et de revalorisation des pensions.
La pension de base des assurés ayant atteint le taux plein est ensuite portée, au travers de la pension majorée de référence (PMR), à un montant minimum de 748 euros par mois, soit le montant du minimum contributif majoré des régimes alignés.
Vient ensuite la pension de retraite complémentaire, également exprimée en points. Les seuls chefs d’exploitation justifiant de la durée de cotisation requise pour l’obtention d’une pension à taux plein, dont au moins dix-sept années et demie au régime des non-salariés agricoles, bénéficient d’un complément différentiel, le CDRCO (complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire), qui porte le montant global de la pension de l’assuré jusqu’à 85 % pour une carrière complète accomplie en qualité de chef d’exploitation. J’espère que vous suivez !
Sourires.

Malgré l’accumulation des dispositifs de pension minimale, force est de constater que la plupart des agriculteurs perçoivent encore des pensions très faibles, en moyenne inférieures de 700 euros par mois à celles de l’ensemble des retraités de droit direct. Les polypensionnés, qui représentent plus de 80 % des assurés du régime, perçoivent des pensions généralement supérieures à celles des monopensionnés.
Comment cette situation s’explique-t-elle ? Assez logiquement, elle résulte de la faiblesse des revenus professionnels des agriculteurs. Je rappelle à cet égard que près des deux tiers d’entre eux ne parviennent pas à atteindre le niveau du Smic annuel. Leur effort contributif s’en trouve donc nécessairement amenuisé par rapport à celui des salariés ou des artisans et commerçants, dont les taux de cotisation sont supérieurs.
Dans ce contexte, il convient de s’interroger sur l’opportunité de maintenir une des spécificités du régime des non-salariés agricoles en matière de calcul des pensions, à savoir son fonctionnement par points, qui fait reposer le montant de la pension sur l’ensemble de la carrière, tandis que celle des ressortissants des régimes alignés, qui résulte d’un système par annuités, est calculée sur le fondement des seules vingt-cinq meilleures années de la carrière.
En effet, il s’agit, avec le régime des professionnels libéraux, dont les affiliés ne connaissent généralement pas les mêmes difficultés financières, du seul régime de base à fonctionner de la sorte.
Fort heureusement, l’inspection générale des affaires sociales (Igas) s’est déjà penchée sur le sujet voilà plus de dix ans. Son rapport, bien que devenu en partie obsolète compte tenu, entre autres, des multiples revalorisations des minima de pension intervenues depuis sa publication, nous éclaire suffisamment sur ce scénario.
Il ressort de ces travaux que l’instauration d’un régime par annuités favoriserait les retraités les moins modestes au détriment des plus fragiles.
En effet, la bascule impliquerait l’abandon du barème d’attribution des points actuellement en vigueur au profit d’un mode de calcul fondé sur l’application d’un taux au revenu annuel moyen des vingt-cinq meilleures années. Or ce barème est particulièrement redistributif et très protecteur pour les assurés situés en bas de l’échelle des revenus.
À moins qu’ils ne bénéficient de la PMR, qui leur assure un taux de remplacement supérieur à 50 %, les assurés aux revenus inférieurs à 12 500 euros par an verraient leurs droits diminuer, tandis que les agriculteurs aux revenus plus élevés bénéficieraient d’un taux de remplacement supérieur au taux plein de 50 % appliqué dans les régimes alignés.
De plus, les conjoints collaborateurs et les aides familiaux ne seraient plus en mesure de valider quatre trimestres par an, comme le leur permet leur assiette de cotisation actuelle, si les règles de validation des trimestres des régimes alignés leur étaient appliquées. Il en résulterait une diminution de leur durée de cotisation et, dans certains cas, la perte du bénéfice de la PMR. Ce n’est pas le sens que nous voulons donner à cette réforme.
Nous préconisons donc de retenir la solution identifiée par l’Igas comme la mieux à même de limiter le nombre de perdants, à savoir l’application de la règle des vingt-cinq meilleures années, tout en conservant un fonctionnement par points. Concrètement, il s’agirait de calculer la moyenne annuelle des points acquis au cours des vingt-cinq meilleures années et de l’appliquer à chaque année de la carrière, comme si l’assuré avait obtenu ce même nombre de points chaque année du début à la fin de son activité.
Sous réserve d’une réactualisation nécessaire des travaux réalisés voilà dix ans, les retraités du régime agricole pourraient voir leur pension augmenter de près de cinquante euros par mois en moyenne. Le coût de la réforme pourrait atteindre jusqu’à 470 millions d’euros à l’horizon 2030, mais sans doute bien moins en réalité du fait des différentes réformes des minima de pension des retraités agricoles menées en 2014, en 2020 et en 2021, qui ont absorbé une partie du coût évalué en 2012.
Quoi qu’il en soit, le régime a les moyens d’assumer une telle charge : en maintenant la part de ses ressources, actuellement supportée par la solidarité nationale, son excédent devrait approcher les 800 millions d’euros en 2026.
L’année 2026 est précisément l’horizon auquel le texte, tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale, fixe l’objectif de mise en œuvre d’un mode de calcul des pensions de retraite des non-salariés agricoles en fonction des vingt-cinq meilleures années. De fait, la MSA n’était techniquement pas en mesure de mettre en œuvre un tel changement avant cette date.
Aux termes de la proposition de loi, il reviendrait au Gouvernement de déterminer par décret les paramètres exacts du nouveau mode de calcul des pensions.
Il devra, à cet effet, remettre au Parlement, dans un délai de trois mois, un rapport présentant les options possibles et celle qu’il envisage de retenir, tout en indiquant les dispositions législatives et réglementaires qu’il conviendra de modifier pour permettre son application, en évaluant ses conséquences sur le montant des cotisations et des pensions et sur l’équilibre financier du régime, et en proposant des mesures de redistribution et de simplification.
Il serait opportun, dans ce cadre, de choisir une montée en charge progressive, de façon à éviter de léser les assurés partis à la retraite juste avant l’entrée en vigueur de la réforme.
En outre, le rehaussement de l’effort contributif des assurés, notamment des conjoints collaborateurs, aux fins d’assurer la validation de quatre trimestres par an, mais également des exploitants les moins modestes, doit être envisagé. Les organisations syndicales en ont pleinement conscience et se disent prêtes à y réfléchir.
Nous souhaitons également que le mode de calcul de la PMR, notamment en ce qui concerne la prise en compte des pensions de réversion, ainsi que le plafond de revenus qui lui est applicable soient alignés sur ceux du minimum contributif, dans une logique d’équité. Nous y serons attentifs.
Mes chers collègues, le texte qui vous est soumis est-il parfait ? Bien évidemment, non : j’estime qu’il n’encadre pas de façon pleinement satisfaisante le rôle confié au Gouvernement de définir les paramètres exacts de la réforme. En outre, le délai de trois mois prévu pour la réalisation d’un travail d’évaluation et la formulation de propositions aussi complexes est largement insuffisant. J’ajoute qu’il n’est pas optimal de se prononcer sans évaluation récente et précise des effets et du coût d’une réforme de cette ampleur.
La commission aurait aimé vous proposer des amendements contribuant à remédier à ces lacunes. Cela aurait toutefois entraîné le renvoi du texte à l’Assemblée nationale, sans garantie d’un nouvel examen ni d’une adoption définitive.
Pleinement consciente de l’importance symbolique de cette grande marque de soutien national à ces femmes et à ces hommes auxquels nous sommes tous redevables, la commission a donc jugé préférable de sécuriser les avancées acquises de haute lutte et vous invite à adopter la proposition de loi dans les mêmes termes que l’Assemblée nationale.
Tous les écoliers de France connaissent par cœur le trop célèbre mot de Sully : « le labourage et le pâturage sont les deux mamelles dont la France est alimentée. »
Marques de satisfaction sur les travées du groupe Les Républicains.

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Pour que l’agriculture demeure à jamais la fierté des Français, adressons aujourd’hui à ceux qui nous nourrissent l’hommage de notre gratitude et de notre considération.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et RDSE. – Mme Cécile Cukierman applaudit également.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, au lendemain d’une forte mobilisation contre la réforme des retraites, permettez-moi tout d’abord – comment pourrait-il en être autrement ? – d’avoir une pensée pour les agricultrices et les agriculteurs de notre pays qui travaillent si dur chaque jour pour des pensions souvent très faibles encore.

La proposition de loi de nos collègues du groupe Les Républicains nous rappelle les difficultés actuelles du monde agricole, confronté aux lois du marché et à des distributeurs qui ne permettent pas toujours aux agriculteurs de vivre correctement de leur travail.
Comme vous venez de le rappeler, monsieur le ministre, plusieurs avancées ont été enregistrées ces dernières années, sous l’impulsion, en particulier, de notre collègue député – mon ami – André Chassaigne.
Ainsi, en 2021, la pension minimale des agriculteurs est passée de 75 % à 85 % du Smic, ce qui a permis une augmentation de 120 euros net par mois pour une carrière agricole complète.
En 2022, comme l’a souligné Mme la rapporteure, une seconde loi a permis d’étendre aux conjoints agricoles le bénéfice de cette mesure. Or 97 % de ces conjoints sont des femmes, dont la pension moyenne était de 600 euros par mois. Désormais, les aides familiaux et les conjoints collaborateurs touchent la même retraite minimale que les exploitants agricoles.
La présente proposition de loi permettrait d’ajouter une strate supplémentaire de protection pour les agriculteurs, en prenant en compte les seules vingt-cinq meilleures années d’assurance.
Le régime de retraite agricole s’est établi sur la base de taux de cotisations bas, souvent justifiés par l’accumulation d’un capital professionnel et d’un patrimoine qui permettaient, pour une part, de garantir un niveau de vie décent. Malheureusement, ce système ne fonctionne plus notamment en raison de la survenance d’aléas climatiques, des variations des cours des produits alimentaires et des crises sectorielles dont souffre l’agriculture.
D’autant que ce système paraît injuste vis-à-vis des autres professions, comme les travailleurs indépendants, par exemple, dont le régime se fonde sur la prise en considération des vingt-cinq meilleures années.
L’adaptation du mode de calcul des retraites des non-salariés agricoles soulève donc un enjeu de justice et d’équité.
La proposition de loi reprend à ce titre une revendication portée depuis des années par les organisations syndicales agricoles.
Lors de la réforme des retraites de 2010, l’inspection générale des affaires sociales avait été saisie pour envisager les conséquences de l’adoption d’un mode de calcul des pensions en fonction des vingt-cinq meilleures années. C’était il y a treize ans…
Le rapport de l’Igas était nuancé, dans la mesure où il concluait qu’une telle réforme améliorerait certes le niveau des pensions des non-salariés agricoles, mais essentiellement les plus élevées d’entre elles, comme l’a souligné Mme la rapporteure.
Par conséquent, garantir à nos agriculteurs de meilleures conditions de vie et de retraite exigerait in fine une remise à plat de l’ensemble du système de retraite agricole.
Aux termes du présent texte, monsieur le ministre, nous laissons certes la main au Gouvernement pour modifier les paramètres de calcul des retraites agricoles, mais nous resterons vigilants. Il faut veiller à ce que l’objectif initial des auteurs de la proposition de loi soit bien satisfait.
En définitive, le groupe communiste républicain citoyen et écologiste votera ce texte malgré les réserves que je viens d’émettre : il s’agit d’envoyer un signal positif de justice et de reconnaissance à nos agricultrices et à nos agriculteurs.
Permettez-moi d’ajouter, monsieur le ministre, avec une pointe d’espièglerie tout amicale, après vous avoir entendu présenter la recette miracle ayant permis d’avancer sur le sujet des retraites agricoles, c’est-à-dire, selon vous, le fait de savoir prendre du temps, de travailler collectivement et d’associer les uns et les autres à chaque étape de la rédaction d’un texte pour parvenir à un vote unanime, que cette belle recette devrait figurer dans nos livres de cuisine…
M. Olivier Dussopt, ministre. Vous comptez voter notre réforme ?
Sourires.

Mme Cécile Cukierman. … et que vous devriez en tirer des enseignements dans les jours et les semaines à venir !
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.
M. Olivier Dussopt, ministre. Merci de votre soutien, madame la sénatrice !
Nouveaux sourires.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le sujet des retraites agricoles a toujours été extrêmement sensible et revient, depuis plusieurs années, au cœur de nos débats.
En effet, la faiblesse des revenus des agriculteurs retraités, chefs d’exploitation ou conjoints collaborateurs, pour des carrières que nous savons tous particulièrement dures, exigeantes et pénibles, est choquante.
À l’heure où la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations dans le milieu agricole sont devenus des enjeux nationaux de tout premier ordre, il n’est plus acceptable que les non-salariés agricoles perçoivent une pension moyenne inférieure de 700 euros par mois à celle de l’ensemble des retraités.
Leur pension de retraite est actuellement établie selon un schéma spécifique, somme d’un empilement de pensions qui se sont ajoutées les unes aux autres au fil des évolutions législatives tentant de remédier à cette criante injustice.
Comme souvent dans notre pays, le résultat est d’une complexité inégalée et presque inutile, puisque ces retraités ne perçoivent toujours pas des pensions dignes de leur carrière professionnelle.
Il nous est proposé aujourd’hui de faire converger le mode de calcul des retraites des agriculteurs et celui des salariés et des indépendants, en le faisant reposer sur les vingt-cinq meilleures années d’assurance.
Cette disposition semble d’autant plus pertinente que les exploitants sont soumis, plus encore que d’autres professionnels, aux aléas de la nature. Elle est logique à condition de ne pénaliser aucun cotisant et donc sous la réserve d’en mesurer les effets en amont. À ces conditions, elle emporte l’adhésion des sénateurs centristes, dont mon collègue Alain Duffourg et moi-même portons la voix.
Ce texte est bienvenu. Il s’inscrit dans la suite de la loi Chassaigne de 2021, qui constituait une belle avancée, mais qui avait aussi fait l’objet d’une récupération politique assez discutable : le Gouvernement affirmait haut et fort avoir revalorisé les retraites agricoles, ce qui était faux.
Les retraites agricoles n’ont pas augmenté. Depuis l’adoption de ce texte, aucun retraité agricole, chef d’exploitation, ne devrait percevoir moins de 85 % du Smic. Or nombre d’entre eux sont polypensionnés, car ils ont dû mener plusieurs activités simultanément pour gagner leur vie. Et si le montant de l’ensemble de leurs pensions atteint le seuil de 85 % du Smic, la retraite agricole n’est pas éligible au complément différentiel de points de retraite complémentaire – en clair, elle ne varie pas d’un centime !
Tout cela a engendré une immense confusion chez les retraités de l’agriculture, beaucoup de frustration et un sentiment d’abandon, alors qu’il fallait au contraire redonner de l’attractivité aux carrières agricoles.
Celles-ci doivent désormais être pensées d’un point de vue structurel. S’il a fallu, par le passé, compenser des défauts de cotisations, il faut maintenant un système juste et adapté afin d’éviter que les aléas, inhérents au travail avec le vivant, ne pénalisent la sortie d’activité.
Nous sommes à la croisée des chemins, entre les calculs en points et les calculs en trimestres, pour des travailleurs qui relèvent souvent simultanément de plusieurs régimes et qui se perdent dans ces méandres mathématiques.
Nous atteignons les limites du système en constatant que les retraités de l’agriculture ayant obtenu une retraite complète pour pénibilité ou handicap, donc des points supplémentaires liés à leur situation de santé, ne sont pas éligibles aux dispositions de la loi Chassaigne, qui exigent une carrière complète calculée en trimestres.
Monsieur le ministre, je me permets donc d’attirer votre attention sur la situation de ces exploitants. Il y a un besoin urgent de réforme et nous sommes à votre disposition pour y travailler ensemble, notamment lors de l’examen du prochain projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale.
Je vous confirme notre plein et entier soutien au vote conforme d’un texte qui permet tout simplement de prouver à nos agriculteurs que nous les considérons comme des chefs d’entreprise comme les autres. Ce n’est que justice et il est grand temps !
Applaudissements sur le s travées du groupe UC et sur des travées du groupe Les Républicains – M. Bernard Buis applaudit également.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, onze ans ! Voilà onze ans que la profession attend un signe fort, à savoir le passage aux vingt-cinq meilleures années pour le calcul des retraites des non-salariés agricoles.
La présente proposition de loi n’est donc que la réparation d’une injustice que la profession dénonce depuis des décennies. À ce titre, elle est essentielle.
Alors que le régime général s’applique à l’ensemble des salariés et des indépendants, les agriculteurs non-salariés, c’est-à-dire les chefs d’exploitation, les collaborateurs d’exploitation, leurs conjoints ou les aides familiaux, se voient appliquer un calcul portant sur l’intégralité de leur carrière.
C’est la dernière profession en France dans ce cas et c’est une double peine quand on connaît la rudesse du métier : mesdames, messieurs les sénateurs, je peux vous le confirmer, la terre est basse !
Depuis la publication, en mars 2012, d’un rapport destiné à identifier les conséquences et les préalables d’un passage au calcul des retraites sur les vingt-cinq meilleures années, et malgré l’engagement réitéré de la profession, « le sujet a […] été laissé en friche et sa mise en œuvre n’a cessé d’être repoussée de réforme des retraites en réforme des retraites », comme le souligne le député Julien Dive, rapporteur à l’Assemblée nationale sur cette proposition de loi, que je tiens à remercier.
Le régime de retraite des non-salariés agricoles s’est historiquement construit en marge du régime général de la sécurité sociale et il nous faut collectivement réparer ce désavantage. Car oui, il y a bien désavantage, puisque ce mode de calcul engendre une différence flagrante d’indemnités : 1 150 euros brut en moyenne pour les non-salariés agricoles contre 1 500 euros brut en moyenne pour l’ensemble des retraités, soit 350 euros d’injustice ! On ne le répétera jamais assez !
Les nombreux témoignages que Françoise Férat et moi-même avons recueillis dans le cadre de notre rapport d’information sur les suicides en agriculture illustrent combien le fait de ne pouvoir bénéficier d’une pension suffisante alimente un désarroi profond. Les agriculteurs « ont besoin d’un minimum retraite, pour que leur travail, leur passion, qui n’est pas toujours rémunératrice, ait une finalité qui ne soit pas dramatique ».
Le député André Chassaigne, qu’il en soit remercié, a récemment fait évoluer les retraites agricoles. La loi du 3 juillet 2020 a ainsi porté la pension agricole minimale à 85 % du Smic, avant que la loi du 17 décembre 2021 n’étende le bénéfice de cette mesure aux retraites des conjoints collaborateurs et des aidants familiaux.
Toutefois, au-delà du revenu des agriculteurs, de nombreux autres enjeux méritent d’être envisagés, à commencer par l’attractivité du métier.
Alors que la taille des exploitations a augmenté en France depuis quarante ans, la part des agriculteurs exploitants dans l’emploi a fortement diminué, passant de 7, 1 % en 1982 à 1, 5 % en 2019. Quand on sait que près des trois quarts des agriculteurs exploitants n’employaient aucun salarié en 2019, le constat est grave. D’autant que l’agriculture est au centre de nombreux autres enjeux essentiels – souveraineté alimentaire, santé publique, maintien des paysages, emplois non délocalisables…
Comment inciter les jeunes à choisir ce métier aux revenus faibles, soumis à des aléas climatiques, sanitaires et économiques et ouvrant droit à une retraite injuste ? N’oublions pas que plus de la moitié de nos agriculteurs ont plus de 50 ans.
En séance publique, à l’Assemblée nationale, le député Julien Dive a déposé un amendement visant à proposer une nouvelle rédaction de l’article 1er, estimant que la version initiale aurait pu conduire à aligner le régime des non-salariés agricoles sur le régime général par la suppression du régime à points.
L’entrée en vigueur du dispositif a été reportée à 2026 pour permettre à la MSA d’adapter son système d’information.
Adopté à l’unanimité à l’Assemblée nationale en décembre dernier, je suis persuadé que ce texte fera également l’unanimité au Sénat. Nous devons envoyer un signal fort de solidarité envers la profession et communiquer enfin sur un point positif. C’est la raison pour laquelle l’ensemble des sénateurs de mon groupe voteront cette proposition de loi.
Même si notre discussion est peu audible dans un contexte de réforme des retraites, les agriculteurs attendent que ce dernier rempart tombe. Il y va, vous l’avez compris, de l’avenir de notre agriculture, bien au-delà du seul aspect social intéressant nos paysans retraités.
Applaudissements sur les travées du RDSE, du RDPI et sur quelques travées du groupe UC. – M. Serge Mérillou applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, j’associe à mon intervention mon collègue de Haute-Loire, Laurent Duplomb, qui ne peut prendre la parole ce soir en raison d’un malheureux contretemps.
Produits laitiers, fruits et légumes, viande, céréales et légumineuses, voilà quelques produits de première nécessité que chaque Français trouve chaque jour sur sa table grâce à nos agriculteurs, qui travaillent dur pour nous procurer la nourriture made in France que nous consommons toute l’année.
Ces produits de qualité, nous les devons entre autres au travail de Jacky, éleveur laitier, ou de Régis, éleveur de porcs, qui, à raison de soixante-dix heures à cent cinq heures de travail par semaine, sept jours sur sept, touchent aujourd’hui respectivement 1 027 euros et 926 euros mensuels de retraite.
Tous ces travailleurs sans relâche, que je connais personnellement, ont nourri les Français bien souvent 365 jours par an, avec des congés quasi inexistants. Le service rendu, vous en conviendrez, mes chers collègues, au-delà de la richesse produite, est inestimable. En sommes-nous suffisamment conscients et reconnaissants ?
À l’heure où notre souveraineté alimentaire donne des signes d’inquiétude, où il nous faut encourager ceux qui consacrent leur vie à ce métier fondamental, quel sort notre société réserve-t-elle aux travailleurs de la terre ? Au regard des montants de retraite que je viens de citer, il n’est pas glorieux !
Certes, le système de retraite des non-salariés agricoles est un montage complexe, fruit de compromis historiques successifs reposant sur des bases de calcul qui ont évolué au cours du temps. Cependant, comment faire perdurer un décompte aussi obsolète ?
Comment justifier la prise en compte de l’intégralité de leur carrière, alors qu’ils sont les premiers confrontés à des aléas climatiques et sanitaires, à un début de carrière en tant qu’aide familial comptabilisé comme un revenu zéro et à une première année d’installation blanche ? Et cela alors que la majorité des Français bénéficient de la prise en compte des vingt-cinq meilleures années. Mettre fin à cette inégalité de traitement nous honorerait, mes chers collègues.
Si le principe de cette réforme ne saurait trouver d’opposants parmi nous, sa mise en œuvre n’est en revanche pas si simple et requiert prudence, finesse juridique et délais d’évaluation.
Prudence, car il convient de bien peser les conséquences de cette réforme pour qu’elle ne puisse en aucun cas se révéler défavorable aux agriculteurs.
Finesse juridique, car il s’agit d’une articulation subtile entre la loi, qui détermine l’architecture duale du système de retraite de base des agriculteurs, et le règlement, qui prévoit son mode de calcul et son fonctionnement à points.
Délais d’évaluation enfin, car cette réforme mettra fortement à contribution les services de la MSA pour retracer toutes les carrières et nécessitera une analyse rigoureuse des situations ainsi que des conditions exigibles en fonction des différents statuts, afin d’aboutir, je l’espère, à un nouveau mode de calcul pertinent.
Voilà l’objet du consensus qui s’est dégagé de la rédaction votée à l’Assemblée nationale. Il s’agit d’une position sage, que nous devons tenir, malgré nos tentations d’améliorer le texte, si nous voulons aider les agriculteurs et mettre fin dans un avenir proche à ce mode de calcul dépassé de leur pension.
Ne pouvant juger de l’issue de la future réforme des retraites, il convient d’aller au bout de cette proposition de loi et de tenir notre cap, afin de réparer l’injustice faite depuis trop longtemps aux agriculteurs. Aussi, mes chers collègues, dans un esprit de responsabilité, parce qu’ils nous nourrissent et qu’ils méritent toute notre reconnaissance, je voterai bien évidemment ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées des groupes UC, SER et CRCE. – M. Bernard Buis applaudit également.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, par les temps qui courent, un texte comprenant le mot « retraite » dans son intitulé, mais permettant de débattre dans le calme, dans un climat de consensus et même d’unanimité, à l’Assemblée nationale, cela ne va pas forcément de soi.
Si cela a été rendu possible, c’est parce que cette proposition de loi s’inscrit dans un travail de fond, un travail collectif, conduit par le député Julien Dive et par Mme le rapporteur Pascale Gruny, et parce que le groupe Les Républicains a décidé d’inscrire à l’ordre du jour cette proposition de loi, sur son temps réservé, dans des délais très courts.
Ce texte s’inscrit dans la suite des lois Chassaigne 1 et 2, qui ont amélioré les petites retraites des agriculteurs puis celles des conjoints collaborateurs et des aidants familiaux.
Cette proposition de loi vise à une meilleure prise en compte de la retraite des agriculteurs. Il s’agit d’une mesure d’équité, d’une reconnaissance méritée, qui reflète la réalité du métier d’agriculteur.
Celui qui vous parle est fils d’agriculteurs et sait qu’il existe autant de formes d’agriculture que d’agriculteurs. Elles varient selon la taille de la ferme, selon le type d’exploitation – céréales ou élevage –, selon l’organisation familiale, selon l’appartenance ou non à un groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec)…
Ce métier est également soumis à de nombreux aléas : sécheresses, gelées, inondations, parfois les trois la même année, avec des conséquences fortes sur les rendements et donc sur les revenus. Les agriculteurs sont ensuite exposés aux variations quotidiennes et importantes des cours des marchés. Beaucoup disent qu’ils sont confrontés à la mondialisation. Prenons l’exemple du blé : depuis trois ans, le cours de vente s’inscrit dans un rapport de un à trois ! Pour acheter des semences, des produits alimentaires pour le bétail, la situation est identique : les agriculteurs sont confrontés aux mêmes variations et se retrouvent pris entre deux feux.
Tous les ans, vous produisez le même travail, avec la même passion et la même envie de bien faire, et vos revenus varient sous l’effet de tous ces facteurs. C’est la raison pour laquelle la prise en compte des vingt-cinq meilleures années dans le calcul de la retraite correspond à la réalité du métier.
Aux aléas impossibles à maîtriser, s’ajoutent le cadre et l’organisation du métier, c’est-à-dire ce qui relève de la politique. C’est ce dont nous parlons ce soir.
Si vous le permettez, je ferai un parallèle avec le nucléaire. Voilà une quinzaine d’années, nous étions les meilleurs, en avance sur tout le monde, avec la production la plus sûre et la plus propre. §Si nous n’avions pas fait de mauvais choix politiques, nous serions autosuffisants, exportateurs et nous produirions à un meilleur coût. S’agissant de l’agriculture, nous sommes peut-être en train de prendre le même chemin depuis quelques années.
Nous sommes toujours la première puissance agricole européenne et l’une des plus grandes puissances agricoles mondiales, certainement la plus sûre en termes de sécurité alimentaire et la plus vertueuse en termes écologiques. Mais si nous continuons à vouloir laver plus blanc que blanc, sans demander les mêmes efforts aux autres, nous produirons moins et importerons plus, y compris des produits utilisant des intrants que nous interdisons chez nous. Voilà quel risque nous faisons courir à notre agriculture !
Ces dernières années, les crises que nous avons traversées nous ont enseigné que la souveraineté et l’indépendance pharmaceutique, militaire, énergétique et bien évidemment alimentaire sont des enjeux de société.
Cette proposition de loi constitue une mesure concrète de soutien en faveur des agriculteurs et de l’avenir de ce métier, raison pour laquelle tous les élus de mon groupe la voteront.
Applaudissements sur les travées du groupe GEST.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, dans un contexte de mobilisation inédite contre la réforme des retraites, cette proposition de loi nous rappelle, à l’inverse, les nombreux chantiers menés pour améliorer les régimes, en l’occurrence celui des non-salariés agricoles.
Améliorée par les lois Chassaigne, même si des effets de seuil et des situations d’exclusion des dispositifs persistent, la situation générale demeure difficile pour une grande partie des retraités du régime.
Selon la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), le régime des non-salariés agricoles verse les retraites les plus faibles de France : la pension moyenne de droit direct du secteur, hors réversion, s’élève à 800 euros contre 1 509 euros en moyenne pour l’ensemble des Français.
Selon le rapport de l’Assemblée nationale, un agriculteur ayant validé l’ensemble de ses droits ne touchait, fin 2020, qu’une retraite de 880 euros par mois, quand un retraité du régime général bénéficiait d’une retraite de 1 810 euros.
Toutefois, ces deux systèmes étant difficilement comparables, nous préférons nous référer aux régimes de retraite des indépendants, comme le soulignait très justement l’inspection générale des affaires sociales en 2012.
Dès lors, si l’on compare la situation des monopensionnés de droit direct à carrière complète du régime MSA à celle des retraités de la sécurité sociale des indépendants (SSI) – qui concerne notamment les artisans – à carrière complète, l’écart s’amenuise, mais continue d’exister : la pension moyenne versée par la SSI s’élevait ainsi à 1 320 euros en 2019 selon la Drees.
Longtemps, cette situation relative était tolérée au prétexte, ou par la promesse, d’une compensation par la valorisation de l’exploitation lors de sa transmission. Ce système comportait des biais, dont celui de contraindre les nouveaux exploitants à s’endetter dans un contexte de crise moins propice à toute compensation et protection.
En effet, le système de subventionnement de la politique agricole commune (PAC) incite constamment à l’agrandissement et à s’équiper toujours davantage, dans le cadre d’un modèle productiviste et d’un calcul de court terme de réduction de l’assiette de revenus et des cotisations afférentes, tout en subissant la baisse tendancielle des prix du marché ainsi que l’accaparement de la valeur ajoutée par les transformateurs et la grande distribution. Les agriculteurs ont ainsi vu croître leurs difficultés, leur taux d’endettement atteignant 41 % en 2019, selon le ministère de l’agriculture.
Le remboursement d’emprunts représente parfois, comme pour les éleveurs de bovins, la moitié du solde de l’exploitant, ce qui explique en partie la faiblesse des revenus d’un grand nombre d’agriculteurs, étranglés et piégés par ce modèle agricole promu par la filière.
S’y ajoutent la multiplication et la gravité des aléas climatiques : selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), les pertes de récoltes liées aux sécheresses et aux canicules ont triplé ces cinquante dernières années en Europe. La situation ne peut que s’aggraver, d’autant que le modèle n’est absolument pas remis en question. Dans cette fuite en avant, nous continuons de prôner des solutions de court terme qui ne font que reporter une partie des problèmes – je pense, par exemple, aux mégabassines !
Protestation s sur les travées du groupe Les Républicains.

Selon un rapport du ministère de l’agriculture, « en trente ans, le revenu net de la branche agricole a baissé de près de 40 % en France en euros constants ». Dans ces conditions, il est urgent d’améliorer le système de retraite.
Le changement de calcul des pensions sur les vingt-cinq meilleures années constitue une avancée. Pour autant, nous devons mener une étude sur les potentiels effets de bord pour les plus petites retraites, comme l’avait déjà souligné l’Igas en 2012.
Avec ce nouveau calcul, le régime, qui serait déficitaire sans la solidarité des autres régimes du fait du déséquilibre démographique, de la faiblesse des revenus et des stratégies d’évitement de cotisations déjà évoquées, aura besoin de nouveaux financements.
Il est probable que le calcul sur les vingt-cinq meilleures années favorise, de façon très différenciée, les plus hauts revenus par rapport aux paysans qui ont eu une carrière plate et qui ont cotisé au niveau de l’assiette minimale. Pour ceux-là, une augmentation de l’effort contributif sans amélioration des droits n’en ferait pas seulement des « non-gagnants », mais peut-être même, à terme, des perdants.
Aussi, il convient de s’assurer que le rapport prévu à l’article 1er de la proposition de loi étudiera les paramètres et le mode de calcul permettant d’améliorer sensiblement les pensions des non-salariés agricoles aux revenus les plus faibles et aux carrières parfois incomplètes.
Notre vote en faveur de cette proposition de loi s’accompagne de cette vigilance, afin que les transformations législatives ou réglementaires qui s’ensuivront profitent à tous et que le système gagne enfin en lisibilité, en justice et en solidarité pour renouer avec l’attractivité des métiers agricoles.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, le calcul de la retraite des non-salariés agricoles est un sujet qui préoccupe les acteurs de la filière depuis plusieurs mois. Ils nous ont alertés à diverses reprises, avec le sentiment de faire face à une injustice depuis de trop nombreuses années.
Selon la MSA, 48 % des actifs agricoles pourront faire valoir leurs droits à la retraite d’ici à dix ans. Face à ce défi démographique sans précédent pour l’agriculture française, il était temps d’apporter une réponse à cette injustice.
Créé en 1952, le régime de retraite des non-salariés agricoles s’est historiquement construit en marge du régime général de la sécurité sociale. À ce jour, il reste le seul régime à ne pas avoir été aligné sur le mode de calcul de la moyenne des vingt-cinq années de carrière les plus rémunératrices depuis l’intégration des artisans et des commerçants dans le régime général de la sécurité sociale en 1973. Comment un agriculteur peut-il se satisfaire d’une telle situation ?
En 2016, la France comptait 1, 3 million d’anciens agriculteurs non-salariés, dont 56 % de femmes, pour une retraite moyenne de 900 euros brut par mois.
Alors que la pension moyenne de l’ensemble des retraités s’établissait à 1 430 euros brut mensuels sur cette même période, celle des anciens exploitants agricoles apparaît très nettement insuffisante, loin de la moyenne des retraités.
Par ailleurs, le faible montant des retraites agricoles renforce les inégalités territoriales en engendrant davantage de pauvreté dans les espaces ruraux, où un retraité sur quatre était un ancien agriculteur en 2017.
Mes chers collègues, vous le savez tous, être chef d’exploitation agricole exige une capacité de travail hors normes, une abnégation sans pareille pour se lever à n’importe quelle heure et une pugnacité remarquable face aux aléas et caprices climatiques.
La demande des agriculteurs est donc parfaitement audible. C’est la raison pour laquelle mes collègues Bernard Buis, Patricia Schillinger, Jean-Baptiste Lemoyne et moi-même avons souhaité présenter un amendement en ce sens, lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, à l’automne dernier, jugé à l’époque irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.
Je me réjouis donc que nous examinions cette proposition de loi, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er décembre dernier.
L’objectif de ce texte est clair : faire converger le régime de retraite des agriculteurs et ceux des salariés et des indépendants au travers du calcul de la pension sur les vingt-cinq années civiles d’assurance les plus avantageuses.
Toutefois, pourquoi ne pas prendre en compte les vingt-cinq meilleures années de revenus ?
Comme vous l’avez souligné, madame la rapporteure, le système d’information de la MSA conserve l’historique des assiettes de cotisations pendant huit ans au maximum. Or reconstituer le revenu moyen des années antérieures sur la base des points attribués reviendrait à mettre en place une nouvelle injustice.
Comme vous l’indiquez dans votre rapport, madame Gruny, trente points sont accordés indistinctement à des assurés dont les revenus diffèrent de plus de 7 000 euros par an. Autrement dit, un revenu de 14 000 euros procurerait autant de points qu’un revenu de 7 000 euros.
Par ailleurs, un rapport de l’Igas démontrait déjà, en 2012, que le passage d’un régime par points à un régime par annuités favoriserait les pensions les plus élevées au détriment des plus modestes. Un tel régime ne permettrait donc pas d’apporter une réponse juste et convenable.
Dans le cadre d’un système par points, appliquer la règle des vingt-cinq meilleures années reviendrait à identifier les vingt-cinq années d’assurance les plus avantageuses. Comment y parvenir ? En calculant le nombre annuel moyen de points obtenus au cours de ces années et en l’appliquant à chaque année de la carrière de l’assuré, dans la limite de la durée d’assurance requise pour une pension à taux plein.
En résumé, le montant de la pension correspondra donc au produit d’un nombre total de points, calculé selon une méthode basée sur la valeur du point.
Un accord a été trouvé sur une réécriture de l’article 1er et un mode de calcul qui tienne compte des vingt-cinq années civiles d’assurance les plus avantageuses et non plus des vingt-cinq meilleures années de revenu, avec un alignement sur le régime général à compter du 1er janvier 2026, délai nécessaire pour assurer la mise en œuvre du nouveau dispositif.
En adoptant les lois Chassaigne, le Parlement a permis de revaloriser les petites pensions agricoles de plus de 100 euros par mois en moyenne pour 340 000 retraités. Il est temps désormais de voter en faveur d’une nouvelle méthode de calcul pour que l’ensemble des salariés non agricoles puissent percevoir une retraite plus juste.
Dans le contexte politique actuel, que chacune et chacun connaît, je pense que le vote de notre assemblée enverra un signal plus que positif.
Le groupe RDPI votera donc pour cette proposition de loi, symbole d’une reconnaissance attendue par toute une profession, qui fait la fierté de notre pays.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.
Mme Gisèle Jourda applaudit.

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, nous ne pouvons qu’être favorables à la présente proposition de loi relative à la mise en place du calcul de la retraite de base des non-salariés agricoles sur les vingt-cinq meilleures années, dès 2026. Chacun connaît en effet leur situation, bien détaillée par les précédents orateurs ; je n’y reviendrai donc pas.
Si les auteurs de ce texte veulent légitimement mettre fin à cette injustice, cette proposition de loi relève cependant d’un exercice paradoxal : l’objectif est limpide et nécessaire, mais les voies à emprunter pour l’atteindre sont tortueuses et susceptibles d’ajouter de la complexité à un régime de retraite déjà peu lisible.
Notre collègue Raymonde Poncet Monge a d’ailleurs évoqué, lors de nos travaux, un rapport de l’Igas de 2012 qui illustre le défi que se donne la présente proposition de loi. Ses auteurs y soulignent que « l’on ne peut considérer de façon isolée une règle d’un régime de retraite sans examiner l’ensemble des règles de ce régime : un alignement limité à une règle n’est pas une garantie d’équité et peut, au contraire, être inéquitable si certaines règles sont introduites sans d’autres qui constituent leur contrepartie. Si le régime des non-salariés agricoles doit être réformé, cette réforme ne devrait donc pas porter sur la seule règle du calcul sur les vingt-cinq meilleures années, mais sur la globalité du régime ».
Notre projet de changer la règle de calcul des pensions agricoles porte donc en creux une très grande ambition.
Le régime des non-salariés agricoles est en effet une machine complexe, qui a pour caractéristiques, d’une part, de reposer sur un système de points, d’autre part, de se composer d’une retraite de base ainsi que d’une ou de plusieurs retraites complémentaires, à leur tour éventuellement complétées d’une épargne retraite collective ou individuelle.
Cette complexité a une histoire. Éric Rance rappelait en 2002, dans son article La protection sociale des exploitants agricoles en mutation, que c’était la loi du 10 juillet 1952 qui avait instauré un véritable régime d’assurance vieillesse pour les agriculteurs. Il y soulignait toutefois que « le système n’a[vait] été conçu que dans un objectif de protection sociale minimale pour éviter autant que possible le prélèvement sur les revenus agricoles. »
À cette époque, le système en question ne comportait « qu’une seule prestation, l’allocation de vieillesse agricole, d’un montant uniforme, et égal à la moitié de l’allocation aux vieux travailleurs salariés ».
Nous parlons donc d’un régime social agricole en proie, dès ses origines, à une tension entre assurance privée et assurance sociale.
Nous travaillons aujourd’hui à résoudre cette tension : les professions agricoles sont des parties prenantes actives et indispensables à l’aménagement de leur régime de retraite, de manière à ce qu’il évolue vers les mêmes principes que le régime général.
Malgré l’objectif partagé par les parlementaires et les retraités, actuels et futurs, du monde agricole, beaucoup reste à faire pour que la situation nous semble satisfaisante. Si les lois Chassaigne nous ont permis d’avancer en ce sens, c’est leur acquis que le présent texte veut encore améliorer.
L’apport de ces lois est effectivement considérable pour ce qu’elles ont permis d’inscrire coup sur coup dans le marbre.
En 2020, la première loi Chassaigne revalorise le complément différentiel de retraite complémentaire des chefs d’exploitation à hauteur de 85 % du Smic net agricole. Elle concerne les anciens chefs d’exploitation ayant une carrière complète.
En 2021, la deuxième loi Chassaigne porte revalorisation de 100 euros en moyenne par mois des plus petites retraites agricoles, des retraites des conjoints collaborateurs et des aidants familiaux.
Toutefois, ces textes ont perdu de leur portée avec l’écrêtement introduit par amendement gouvernemental lors des débats de 2020 et par les décrets d’application.
L’histoire avait certes mal débuté. Dès mai 2018, le Gouvernement refusait de voter l’amendement d’André Chassaigne visant à faire passer la retraite agricole minimale à 85 % du Smic, au prétexte que cela devait être traité dans la réforme globale des retraites. Ce fut le premier des nombreux actes d’obstruction de l’exécutif sur cette réforme.
L’amendement du Gouvernement à la première loi Chassaigne de 2020 disposait que « les retraités qui touchent déjà au moins 85 % du Smic ne puissent pas prétendre à un tel complément ». Son adoption a eu pour conséquence de subordonner le complément prévu au fait d’avoir demandé l’ensemble de ses droits à retraite, avec un écrêtement opéré en fonction du montant de retraite, tous régimes cumulés.
Le résultat ne s’est pas fait attendre : partout en France, nos retraités agricoles ont reçu de la MSA des relevés de pension, dont certains ont parfois suscité des déceptions.
J’ai moi-même été saisie par un ancien exploitant agricole. Il m’a indiqué ne bénéficier que d’une augmentation très modeste, car le calcul prend en compte ses bonifications pour enfant. Après avoir espéré atteindre une pension de retraite enfin digne, il a acté qu’il ne recevrait pas plus de 940 euros net de pension par mois. Pour lui, la plus-value de la réforme s’est limitée à un gain de 7, 44 euros !
Ces multiples problématiques posées par le régime des retraites agricoles se manifestent aussi pour les polypensionnés. Michaël Zemmour souligne, dans son livre sur la protection sociale, que leur situation « est souvent désavantageuse (parfois fortement) car elle conduit à prendre en compte dans le calcul d’une partie de la retraite – celle du premier régime auquel on a été affilié – des années de début de carrière, relativement mal payées, et qui auraient été exclues du calcul si les personnes avaient passé toute leur carrière dans le même régime ».
Au vu de ces complexités, nous nous inquiétons pour la définition des modalités de calcul des pensions de retraite agricole sur la base des vingt-cinq meilleures années que prévoit la présente proposition de loi.
L’adoption, à l’Assemblée nationale, d’un amendement disposant qu’un rapport serait remis dans un délai de trois mois au Parlement permettra peut-être d’y voir plus clair et de surmonter l’obstacle technique et législatif, même si, comme notre rapporteure l’a souligné, les délais paraissent courts pour un dossier aussi complexe.
Ce rapport présentera, par exemple, les scenarii envisagés, les dispositions législatives et réglementaires à modifier, les conséquences sur le montant des cotisations et des pensions et sur l’équilibre financier du régime…
Creusant ce sillon, l’amendement par lequel notre collègue Raymonde Poncet Monge nous propose une amélioration dudit rapport va dans le bon sens. Il s’agit d’y intégrer des critères visant à favoriser la correction d’une partie des défauts du régime des retraites agricoles, mais aussi de parer les effets pervers que pourrait avoir le calcul des retraites sur les vingt-cinq meilleures années porté par le présent texte.
Évaluant en 2012 les modalités d’une réforme semblable à celle-ci, l’Igas signalait notamment ses potentiels effets anti-redistributifs : les retraités les plus aisés risquaient ainsi de bénéficier de la solidarité des moins bien lotis, lesquels, eux, cotiseraient en vain.
Associer un rapport au passage à la méthode de calcul sur la base des vingt-cinq meilleures années est une réponse intéressante pour éviter de tels écueils.
Nous voterons cette proposition de loi, en espérant que les travaux complémentaires attendus permettront une application juste.
Applaudissements sur les travées des g roupes SER, GEST et RDPI.
M. Michel Canévet applaudit.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, pour la première fois, l’intitulé du portefeuille de l’agriculture s’accompagne de la notion de « souveraineté alimentaire ». Que la Nation se montre reconnaissante envers ses agriculteurs, qui la nourrissent depuis plusieurs années tout en percevant des revenus insuffisants et de maigres retraites, revêt une importance particulière.
Il a fallu attendre les lois Chassaigne pour que la retraite des exploitants agricoles soit portée à 85 % du Smic et que celle des conjoints collaborateurs et des aides familiaux soit rehaussée.
La présente proposition de loi, issue de l’Assemblée nationale, tend à établir un calcul de la retraite en fonction des vingt-cinq années d’assurance les plus avantageuses, ce qui me paraît tout à fait justifié, d’autant que les agriculteurs attendent cette réforme depuis une dizaine d’années.
Il y a effectivement lieu de compenser la baisse des revenus et des retraites, eu égard à leur situation. Dans mon département du Gers, département agricole, comme chacun le sait, les agriculteurs ont subi au cours des années récentes de nombreux dommages : influenza aviaire, dépeuplement des élevages, gel, sécheresse, grêle… Tous ces aléas ont fortement perturbé leur pouvoir d’achat.
Il faut savoir aussi que la main-d’œuvre totale a baissé de 22 % en dix ans et le nombre de chefs d’exploitation de 13 %. À cela s’ajoutent d’importants défis climatiques et énergétiques ainsi que des difficultés en matière de transmission des exploitations.
Alors que la pension moyenne des Français s’élève à 1 500 euros, les agriculteurs arrivent à peine à 800 euros, soit en dessous du seuil de pauvreté ! Ces derniers travaillent pourtant cinquante-quatre heures par semaine en moyenne, et 90 % d’entre eux le week-end. À ce jour, il faut payer les retraites de 1, 3 million d’anciens agriculteurs.
Mon groupe soutient bien évidemment cette réforme, qui s’appliquera à compter du 1er janvier 2026, pour répondre à la demande de la MSA, et votera cette proposition de loi.
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe UC et sur des travées du groupe Les Républicains. – Mme le rapporteur applaudit également .
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les retraites agricoles sont une problématique importante, dont nous discutons depuis de nombreuses années déjà.
Pour mémoire, le régime de retraite des non-salariés agricoles s’est construit en marge du régime général de la sécurité sociale.
Créé en 1952, le régime de base comporte deux niveaux : un dispositif forfaitaire – l’assurance vieillesse individuelle – et un dispositif proportionnel – l’assurance vieillesse agricole. Cette pension de retraite proportionnelle fonctionne sur un principe d’acquisition de points cotisés, dont le mécanisme diffère selon le statut de l’assuré.
Je vous perds ?… C’est normal ! Le régime agricole est incompréhensible, en total décalage avec la réalité et d’une grande complexité, qui n’est en rien justifiée par les spécificités du monde agricole.
Les agriculteurs sont désormais les derniers à voir leur retraite calculée sur l’intégralité de la carrière. Ce mode de calcul est une double peine pour celui qui ne peut faire autrement que subir les aléas climatiques et sanitaires et qui subit, en sus, les conséquences de ces aléas dans le calcul de sa retraite.
Rappelons que la retraite des indépendants se calcule sur les vingt-cinq meilleures années et celle des fonctionnaires sur leurs six derniers mois d’activité.
Les gouvernements successifs n’ont eu de cesse de repousser la demande légitime des agriculteurs de voir le calcul de leur retraite fondé sur les seules vingt-cinq meilleures années de leur carrière. En 2021, au salon de l’agriculture, le Président de la République estimait impossible de revaloriser ces pensions de retraite.
Non, les agriculteurs ne sont pas des actifs de seconde zone !
La première loi Chassaigne prévoyait la revalorisation des pensions de retraite agricole à hauteur de 85 % du Smic agricole, soit 1 045 euros net. La seconde effectuait un pas supplémentaire afin de revaloriser les pensions de retraite des conjoints et aides familiaux – frères, sœurs et enfants – des exploitants agricoles.
Aujourd’hui, permettons aux jeunes agriculteurs qui s’installent d’avoir des perspectives meilleures ! Faisons cesser cette injustice qui veut qu’une disposition bénéficiant à la quasi-totalité des retraités de notre pays soit refusée aux agriculteurs, alors même que ceux-ci cumulent déjà des difficultés tout au long de leur carrière.
Pour mémoire, les agriculteurs sont les actifs travaillant le plus, avec cinquante-quatre heures de travail par semaine en moyenne ; neuf sur dix travaillent le week-end et les deux tiers d’entre eux ne partent pas plus de trois jours consécutifs par an en vacances. Cherchez l’erreur !
Cherchons encore l’erreur, quand on sait que cette même injustice induit une différence de 930 euros entre les retraites des agriculteurs et celles des retraités du régime général : 1 810 euros brut de pension pour les seconds, dès lors qu’ils ont travaillé toute leur vie et validé l’ensemble de leurs droits ; 880 euros brut pour les premiers, dans la même situation.
Les agriculteurs se retrouvent donc sous le seuil de pauvreté, après une carrière complète passée à nous nourrir.
Alors que 50 % des actifs agricoles prendront leur retraite dans les dix ans, sachons rendre ce secteur plus attractif. La question du renouvellement des générations en agriculture est en effet essentielle.
Nos collègues Laurent Duplomb, Pierre Louault et Serge Mérillou, dans leur remarquable rapport d’information sur la compétitivité de la ferme France, dressent un constat terrible sur la lente érosion de notre agriculture. Certes, la balance commerciale est encore excédentaire de 8 milliards d’euros en 2021, mais pour combien de temps ?…
En vingt ans, la France est passée du deuxième au cinquième rang des exportateurs mondiaux de produits agricoles. Nous sommes l’un des seuls grands pays agricoles dont les parts de marché reculent. Plus inquiétant, en trente ans, plus de 57 % des exploitations ont disparu. Les surfaces agricoles utiles se réduisent et les investissements sont en berne, sans compter les difficultés liées à la transmission des terres et des exploitations.
Il nous faut rendre attractifs les métiers de l’agriculture. Ce soir, nous en avons rappelé les difficultés ; reconnaissons aussi que ce sont des métiers indispensables, merveilleux, porteurs de sens et d’avenir.
Oui, ces métiers demandent des efforts, mais ils sont passionnants et nos agriculteurs font notre alimentation, en nous vendant des produits de très grande qualité.
La guerre en Ukraine nous le rappelle tous les jours depuis bientôt un an : nous avons besoin d’une souveraineté alimentaire solide et effective, laquelle passe notamment par une politique de protection de ceux qui nous nourrissent, par la revalorisation de leur métier et de leur retraite. Ce soir, sachons protéger les sortants et donnons des garanties aux entrants !
Applaudissement s sur les travées du groupe Les Républicains et s ur quelques travées des groupes UC et SER. – Mme Cécile Cukierman applaudit également.
Je voudrais tout d’abord remercier l’ensemble des intervenants et me féliciter de l’unanimité qui, à l’écoute de chacun d’entre eux, semble se dégager.
Elle nous permettra d’avancer et d’affronter les difficultés techniques évoquées par beaucoup. Ces difficultés existent bel et bien, nous les connaissons. Nous aurons beaucoup à faire dans les prochains mois, à la fois pour rendre le rapport qui sera dû au Parlement et pour mettre en œuvre le dispositif arrêté.
Mme la sénatrice Nadia Sollogoub m’a interpellé sur un des aspects des lois Chassaigne : effectivement, pour bénéficier de la garantie prévue, les agriculteurs doivent disposer d’une carrière complète. Or il arrive malheureusement que certains d’entre eux soient contraints d’interrompre leur carrière et de partir à la retraite plus tôt, du fait d’une inaptitude physique ou d’une incapacité constatée par un praticien médical.
Dans le cadre du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale portant réforme des retraites, et que je pense avoir l’occasion de vous présenter dans quelques semaines, nous prévoyons de réparer cette difficulté en considérant comme complète la carrière des exploitants agricoles contraints de l’interrompre quelque temps avant son terme du fait d’une incapacité ou d’une inaptitude physique. Cela permettra d’élargir le bénéfice de la loi à 45 000 exploitants supplémentaires, contraints d’arrêter plus tôt leur carrière pour raisons de santé.

La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
(Non modifié)
I. – Après l’article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732 -24 -1. – I. – La Nation se fixe pour objectif de déterminer, à compter du 1er janvier 2026, le montant de la pension de base des non-salariés des professions agricoles en fonction des vingt-cinq années civiles d’assurance les plus avantageuses.
« II. – Les modalités d’application du I sont définies par décret en Conseil d’État. »
II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les modalités de mise en œuvre de l’article L. 732-24-1 du code rural et de la pêche maritime dans le respect des spécificités du régime d’assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles et de la garantie du niveau des pensions et des droits acquis.
Le rapport prévu au premier alinéa du présent II présente notamment :
1° Le détail des scénarios envisagés et des paramètres retenus pour l’application de l’article L. 732-24-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que, le cas échéant, les dispositions législatives et réglementaires qu’il convient de modifier ;
2° Les conséquences sur les cotisations dues par les assurés du régime d’assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles, sur le montant des pensions dont ils bénéficient ainsi que sur l’équilibre financier du régime et les modalités de son financement, en évaluant l’opportunité d’une entrée en vigueur progressive de la réforme ainsi que la possibilité d’un rapprochement des taux des cotisations d’assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles de ceux du régime général ;
3° Les mesures permettant de renforcer les dispositifs de redistribution ;
4° Les mesures permettant d’améliorer la lisibilité du régime d’assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles.

Je m’exprime avec beaucoup d’émotion, tant fut longue la marche qui nous conduit aujourd’hui à réparer une injustice.
Nos collègues ont développé tous les argumentaires techniques – je n’y reviendrai pas. Je veux toutefois insister sur le fond : certes, le système mis en place pour l’agriculture n’a pas été aligné sur le système général, mais pourquoi en avoir freiné la remise à plat pendant des décennies, toujours avec les mêmes arguments ? Sénatrice depuis 2014, j’ai déjà assisté à des discussions sur ce sujet, dans ce même hémicycle, en 2018, en 2020… Nous sommes en 2023 !
Le climat de travail semble enfin propice pour faire avancer les choses. J’y insiste, il ne s’agit que de réparer une injustice, de corriger une iniquité. Or j’entends que ce pas positif serait freiné par des difficultés techniques. Je peux comprendre que la MSA en rencontre, mais on évoque une mise en œuvre en 2026 d’un texte dont nous discutons en février 2023 : trois ans, c’est bien long !
Eu égard à la volonté parlementaire qui s’exprime aujourd’hui, dans le sillon de la volonté transcrite dans les deux lois Chassaigne, peut-être faudrait-il donner le coup de collier nécessaire pour soulager les agriculteurs qui attendent. En effet, il y a les futurs retraités agricoles, ceux des années à venir, mais il y a aussi les agriculteurs qui vont déposer leur dossier de demande de retraite demain ou dans les mois prochains. Pour eux, rien ne va changer !
Par conséquent, autant je salue la démarche que nous menons et je suis heureuse de contribuer positivement à ce vote, autant je suis extrêmement dubitative sur la volonté de différer cette réforme et d’attendre trois ans pour la mettre en application.

Je salue l’initiative de nos collègues députés du groupe Les Républicains pour cette proposition de loi adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale, ainsi que le travail de la commission des affaires sociales, de sa rapporteure et de l’ensemble des collègues, sous l’autorité de la présidente Catherine Deroche.
Les orateurs ont tous rappelé la faiblesse des pensions de retraite agricoles et la complexité du dispositif. Ce texte est surtout un message de reconnaissance adressé aux agriculteurs pour leur engagement : même si ce sont des passionnés, leur métier est très difficile et soumis à beaucoup de contraintes et d’aléas climatiques, sanitaires et économiques. À cet égard, je citerai cet extrait du rapport indiquant que « les non-salariés agricoles perçoivent une pension moyenne inférieure de 700 euros par mois à celle de l’ensemble des retraités ».
Cette réforme visant à calculer la retraite de base des travailleurs non-salariés agricoles sur la base des vingt-cinq meilleures années de revenu était attendue par le monde agricole, dans la lignée des deux lois Chassaigne de 2020 et 2021. C’est un soutien important apporté au monde rural, aux exploitants, à leurs épouses et à leurs familles.
Je tiens également à souligner le travail commun mené avec la MSA et l’ensemble des partenaires.
Équité, justice et, de nouveau, message de respect et de reconnaissance adressé au monde agricole : pour ces raisons, je voterai naturellement cet article unique et la proposition de loi.

Il s’agit du troisième texte portant sur les retraites agricoles que nous examinons depuis 2020.
Il faut bien évidemment se féliciter des avancées obtenues – relèvement des retraites des anciens chefs d’exploitation agricole et hausse des petites retraites des conjoints collaborateurs d’agriculteurs. J’ai d’ailleurs une pensée particulière pour l’ensemble du travail réalisé par notre collègue député André Chassaigne.
Toutefois, il faut aussi s’interroger sur le rythme particulièrement lent de ces évolutions.
Alors que l’écart du niveau de retraite entre un agriculteur et un retraité du régime général atteint 930 euros pour des carrières complètes, ce passage à un calcul sur les vingt-cinq meilleures années pour les retraites des non-salariés agricoles est une bonne chose. Mais n’oublions pas pour autant qu’un rapport de l’inspection générale des affaires sociales sur ce passage était prêt depuis mars 2012 et qu’il a totalement été laissé de côté !
Comme l’a souligné Gisèle Jourda, la date d’entrée en vigueur de cette réforme, fixée au 1er janvier 2026, pose aussi question. Le Gouvernement et les administrations agissent un peu plus rapidement lorsqu’il s’agit de supprimer l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ou la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) !
Bien évidemment, comme l’a rappelé ma collègue Monique Lubin, nous soutiendrons ce texte, qui va dans le bon sens. Nous serons vigilants quant à son application, particulièrement en ce qui concerne les potentiels effets pervers d’une telle réforme sur les petits revenus et sur les personnes ne bénéficiant pas des minima de pension agricole – carrière incomplète ou polypensionnés. La remise d’un rapport par le Gouvernement, prévu à l’article 1er, sera le bienvenu pour mener ce travail.

La France compte aujourd’hui 1, 3 million de retraités anciens non-salariés agricoles, lesquels bénéficient d’une retraite moyenne de 1 150 euros brut, soit environ 800 euros net, montant bien inférieur à la pension moyenne des autres assurés, qui s’élève à 1 500 euros brut environ.
Cette proposition de loi a pour ambition de faire cesser l’injuste mode de calcul de la retraite de base des non-salariés agricoles. Exploitants agricoles, aides familiaux, collaborateurs, tous voient leur retraite calculée sur la totalité de leur carrière : une situation bien singulière, qui ne concerne qu’eux.
Les lois Chassaigne ont été gages de progrès significatifs, avec la garantie d’un niveau minimum de pension de 1 035 euros, soit 85 % du Smic net agricole. Si j’osais, je dirais que c’est le bon sens paysan qui dictait ces mesures ! Ce même bon sens paysan doit nous mener aujourd’hui à aligner le mode de calcul des retraites des non-salariés agricoles sur le régime de base, en prenant en compte les vingt-cinq meilleures années de leur carrière.
À l’heure où le débat sur les retraites occupe la totalité de l’espace médiatique, il est un sujet connexe que l’on ne peut passer sous silence : les non-salariés agricoles œuvrant chaque jour pour nourrir nos compatriotes, dont la pénibilité du travail est incontestable, pâtissent de revenus trop bas. Sans une augmentation significative de leurs revenus d’activité, leurs pensions de retraite resteront beaucoup trop faibles.
Ce texte n’est pas exhaustif. Il est donc imparfait, nous en convenons. Il doit toutefois être un vecteur de progrès social pour le monde paysan, raison pour laquelle il récoltera nos suffrages.
Deux questions d’importance subsistent.
La première concerne la date d’entrée en vigueur, déjà évoquée par certains de mes collègues. Le délai de trois ans est beaucoup trop long, notamment pour ceux qui déposent aujourd’hui des dossiers de retraite.
La seconde porte sur les pensions des compagnes d’agriculteurs déjà à la retraite qui, elles, ne peuvent justifier de vingt-cinq années de cotisations ou qui n’ont quasiment pas du tout cotisé. Nous devrons remettre l’ouvrage sur le métier pour ces femmes.
Cette réforme est attendue de longue date, mais nous serons vigilants sur sa mise en œuvre, qui devra préserver les retraites des plus faibles. Nous y comptons !

L’amendement n° 3, présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Salmon, Parigi, Labbé, Gontard, Fernique et Dossus, Mme de Marco et M. Dantec, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
1° Remplacer le mot :
trois
par le mot :
six
2° Après le mot :
loi,
insérer les mots :
après consultation de l’ensemble des parties prenantes,
II. – Alinéa 5 :
Après les mots :
présent II
insérer les mots :
étudie les paramètres choisis pour l’application du même article L. 732-24-1 en considérant particulièrement les scénarios qui permettent à une large majorité d’assurés de voir leur pension revalorisée et permettent une revalorisation significative des pensions les plus faibles. À ce titre, il
III. – Alinéa 6 :
Après le mot :
retenus
insérer les mots :
, précisés par des simulations chiffrées pour les différentes catégories d’assurées,
IV. – Alinéa 8 :
Compléter cet alinéa par les mots :
, notamment afin de revaloriser les pensions agricoles les plus faibles : des non-salariés des professions agricoles aux revenus les plus faibles, des non-salariés des professions agricoles ayant exercé sous un statut autre que chef d’exploitation, que ce soit en tant que conjoint collaborateur, ou aide familial, des non-salariés des professions agricoles ne bénéficiant pas d’une carrière complète, des non-salariés des professions agricoles concernés par les dispositifs d’écrêtement à 85 % du Smic, qui les prive de différents mécanismes de bonification, et des non-salariés des professions agricoles polypensionnés. Les mesures proposées prendront spécifiquement en compte l’amélioration des droits des assurés qui ne bénéficient pas des minima de pensions ;
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Cet amendement vise à s’assurer que seront examinées, dans le rapport remis par le Gouvernement, l’ensemble des situations des pensionnés, et ce afin de mesurer l’effet redistributif de la loi et de ne pas laisser les inégalités se creuser par une progression des hautes pensions sans bénéfice pour les plus petites, voire les moyennes.
Un rapport de l’Igas a effectivement montré que cette réforme pouvait favoriser les plus hauts revenus, sans améliorer les petites et moyennes retraites agricoles, même après les lois Chassaigne.
Selon les paramètres et le financement retenus, elle pourrait aboutir à une dégradation de la solidarité du régime au détriment des paysans ayant de faibles revenus, notamment via une augmentation de cotisations, un accroissement peut-être nécessaire de l’effort contributif, mais sans amélioration de certaines pensions.
Le fonctionnement des retraites agricoles étant complexe, la modification d’un paramètre isolé ne va pas sans poser de problèmes, comme indiqué dans le rapport de l’Igas, et n’apporte aucune garantie sur son résultat ni sur son impact différencié.
Nous devons au monde agricole la certitude que cette réforme ne pénalisera personne et qu’elle permettra de corriger un certain nombre de dysfonctionnements. Je pense notamment aux femmes qui n’ont pas de carrière complète ou qui ne bénéficient pas toujours de la majoration pour enfants, aux paysans qui doivent transmettre leur exploitation avant d’avoir obtenu tous leurs trimestres ou encore aux polypensionnés.
Cette proposition de loi doit apporter davantage de garanties, en particulier à travers des simulations chiffrées montrant son impact en termes de solidarité et d’effet redistributif. En ce sens, le délai de remise du rapport devrait être porté à six mois, afin de garantir, en plus d’une analyse précise des modifications à conduire, la consultation approfondie de l’ensemble des parties prenantes lors de l’élaboration de cette étude.

Cet amendement tend à compléter les dispositions relatives au rapport d’évaluation de la présente réforme qui devra être remis au Parlement par le Gouvernement.
Il vise ainsi à doubler le délai de trois mois accordé au Gouvernement pour réaliser ce travail d’analyse et de prospective et à instaurer le principe d’une consultation de l’ensemble des parties prenantes.
Je conviens – je l’ai d’ailleurs signalé, et nous l’avions constaté ensemble en commission – que le délai de trois mois est un peu court.
Cet amendement vise également à appeler l’attention du Gouvernement lors de l’élaboration du rapport susvisé sur les pensions agricoles les plus faibles, notamment sur celles des assurés ne bénéficiant pas de minima de pension.
Je rappelle que la préservation des acquis issus de l’examen du texte à l’Assemblée nationale exige un vote conforme de notre assemblée.
De plus, bien que la proposition de loi n’encadre pas suffisamment la compétence confiée au Gouvernement pour ce qui concerne la détermination des modalités de son application, le texte précise d’ores et déjà que le Gouvernement devra proposer des mesures permettant de renforcer la redistribution en faveur des plus fragiles au sein du régime de retraite de base des non-salariés agricoles – ce que souhaitent les auteurs de cet amendement.
Enfin, dans le cadre du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, le Gouvernement propose plusieurs mesures susceptibles d’améliorer la situation des retraités dont la carrière est incomplète, telles que l’assouplissement des critères d’éligibilité au CDRCO, l’attribution de points de retraite complémentaire gratuits pour les assurés ayant validé des trimestres au régime de base des non-salariés agricoles avant la création du régime complémentaire ou son extension à leur catégorie professionnelle, ou encore le relèvement de 39 000 à 100 000 euros du seuil de récupération sur succession des sommes versées au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa). Je note à ce propos que, depuis 2011, le capital agricole est exclu de cette récupération sur succession.
Monsieur le ministre, par son amendement, notre collègue invite le Gouvernement à se concentrer sur les points soulevés dans le rapport qu’il élaborera. Pour les raisons que j’ai indiquées, je demande toutefois son retrait ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Quel beau métier que le vôtre, monsieur le ministre ! Vous devrez en trois mois vous efforcer de gommer la complexité d’un régime qui a été bâti au fil des ans et qui se compose d’une partie forfaitaire professionnelle, d’un PMR, d’un CDRCO… Un intéressant travail vous attend !
Notre collègue Raymonde Poncet Monge a mis le doigt sur un certain nombre de difficultés. Il faut s’assurer qu’il n’y ait pas de perdants, même si le régime de retraite des non-salariés agricoles met déjà en œuvre, par l’attribution de trente points aux plus modestes, une véritable solidarité.
Or, s’il n’y a pas de perdants, il n’y aura donc que des gagnants. Autrement dit, il faudra trouver des recettes nouvelles pour financer des charges nouvelles.
J’estime que le calcul de l’assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) des agriculteurs doit être aligné sur celui des salariés. La diminution de ces prélèvements compensera ainsi la hausse des cotisations, ces dernières présentant par ailleurs l’avantage d’ouvrir des droits.
En tout état de cause, il convient d’estimer dans un délai relativement contraint l’ampleur de l’effort de solidarité nationale qui sera nécessaire. Je vous souhaite bon courage, monsieur le ministre.
Je note par ailleurs que, voilà cinq ans, vous nous vendiez un système universel par points en disant tout le mal que vous pensiez des annuités. Or vous êtes aujourd’hui en accord avec un texte qui prévoit de transformer des points en annuités ! Je tenais à souligner cette évolution…
Sourires et applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.

Comme vous l’avez indiqué, madame la rapporteure, cet amendement avait pour objet de concentrer l’attention du Gouvernement sur les situations que j’ai pointées, afin que les non-gagnants de cette réforme n’en soient pas les perdants du fait de l’effort contributif qu’elle emportera.
En ce qui concerne le relèvement à 100 000 euros du seuil de récupération sur succession des sommes versées au titre de l’Aspa, j’espère que la réforme sera retirée, ce qui permettra d’éviter les écueils d’une telle disposition.
Madame Poncet Monge, je partage votre préoccupation pour la préservation des acquis et le renforcement du caractère redistributif du régime de retraite des non-salariés agricoles.
J’ai eu l’occasion de l’indiquer à l’Assemblée nationale, et si je n’ai pas insisté sur ce point ce soir, soyez assurée que nous tiendrons compte des éléments que vous avez pointés, y compris si votre amendement n’est pas adopté.
Par ailleurs, monsieur Savary, pour vous retourner votre clin d’œil, il se trouve que mon plan de charge est assez léger pour les trois mois qui viennent. J’aurai donc le temps d’avancer dans l’élaboration de ce rapport.
Sourires.
L ’ article 1 er est adopté.

L’amendement n° 1, présenté par M. Lahellec, Mmes Cukierman, Apourceau-Poly, Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au présent I pour lesquelles il est reconnu une incapacité permanente au sens de l’article L. 732-18-3 bénéficient d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, dès lors qu’elles remplissent les conditions leur permettant de prétendre à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles et qu’elles justifient d’une période minimale d’assurance accomplie en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, à titre exclusif ou principal. »
La parole est à M. Gérard Lahellec.

Il s’agit d’un amendement de justice sociale. Depuis les lois Chassaigne, des personnes mises à la retraite à 60 ans pour cause d’accident, de handicap ou d’invalidité sont exclues des dispositifs de revalorisation.
Nous considérons que ces personnes doivent être traitées comme des retraités de plein droit et qu’elles ne doivent donc pas être exclues de ces dispositifs.
Avant de décider de l’éventuel retrait de cet amendement, je souhaite connaître les avis de la commission et du Gouvernement.

Cet amendement vise à assouplir les critères d’éligibilité au complément différentiel de points de retraite complémentaire des non-salariés agricoles en remplaçant la condition de durée d’assurance par une condition de liquidation à taux plein.
Dans la mesure où le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 comporte une disposition de même nature, je vous propose, mon cher collègue, d’examiner cette question dans le cadre de la réforme des retraites à venir et d’adopter le présent texte sans modification.
Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
Comme je l’ai indiqué à Mme la sénatrice Sollogoub, cette disposition est prévue dans le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale.
Je suis conscient, monsieur le sénateur, que vous préféreriez que nous retirions ce dernier texte et que nous intégrions cette disposition à la présente proposition de loi.
Sourires.
Soyez toutefois assuré que si vous souteniez cette même disposition lors de l’examen du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, je n’en tirerais aucune conclusion quant à votre position sur l’intégralité du texte.
Nouveaux sourires.

Notre souci d’un vote conforme me conduit à retirer cet amendement.
Nous saurons toutefois apprécier, le moment venu – je tiens à vous rassurer, monsieur le ministre
Sourires.
(Suppression maintenue)

Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l’ensemble de la proposition de loi visant à calculer la retraite de base des non-salariés agricoles en fonction des vingt-cinq années d’assurance les plus avantageuses.
La proposition de loi est adoptée défini ti vement .

Je souhaite remercier l’ensemble de mes collègues. Par ce texte, nous envoyons un message fort à nos agriculteurs, qui attendaient cette réforme.
Monsieur le ministre, je vous souhaite bon courage pour l’élaboration du rapport que nous attendons dans trois mois, afin de rendre ces avancées effectives.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Didier Rambaud applaudit également.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, jeudi 2 février 2023 :
De dix heures trente à treize heures et de quatorze heures trente à seize heures :
Ordre du jour réservé au GEST

Proposition de loi visant à renforcer l’action des collectivités territoriales en matière de politique du logement, présentée par M. Ronan Dantec et plusieurs de ses collègues (texte n° 217, 2022-2023) ;
Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à réhabiliter les militaires « fusillés pour l’exemple » durant la Première Guerre mondiale (texte n° 356, 2021-2022)
À l’issue de l’espace réservé au GEST et, éventuellement, le soir :
Suite de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à protéger les logements contre l’occupation illicite (texte de la commission n° 279, 2022-2023).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures cinquante.
Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai d ’ une heure prévu par l ’ article 8 du règlement, les listes des candidatures préalablement publiées sont ratifiées.
M. Jean Bacci, Mme Florence Blatrix Contat, MM. Michel Bonnus, Daniel Breuiller, Alain Cadec, Thierry Cozic, Mathieu Darnaud, Louis-Jean de Nicolaÿ, Hervé Gillé, Éric Gold, Ludovic Haye, Mme Anne-Catherine Loisier, MM. Jean-François Longeot, Pierre Médevielle, Mme Sylviane Noël, M. Cyril Pellevat, Mmes Évelyne Perrot, Kristina Pluchet, M. Rémy Pointereau, Mmes Sylvie Robert, Marie-Claude Varaillas.
M. Jean-Baptiste Blanc, Mmes Céline Boulay-Espéronnier, Toine Bourrat, M. Max Brisson, Mmes Céline Brulin, Marie Arlette Carlotti, M. Yan Chantrel, Mme Véronique Del Fabro, MM. Gilbert Favreau, Bernard Fialaire, Jacques Grosperrin, Mmes Jocelyne Guidez, Nadège Havet, Christine Herzog, M. Xavier Iacovelli, Mme Else Joseph, M. Jean-Yves Leconte, Mmes Monique de Marco, Colette Mélot, M. Jean-Marie Mizzon, Mme Marie-Pierre Monier, M. Jean Paul Prince, Mme Anne Ventalon.
Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai d ’ une heure prévu par l ’ article 8 du règlement, les listes des candidatures préalablement publiées sont ratifiées.
MM. Jean Bacci, Bruno Belin, Mme Florence Blatrix Contat, MM. Hussein Bourgi, Bernard Buis, Laurent Burgoa, Alain Cazabonne, Mme Marta de Cidrac, M. Olivier Cigolotti, Mmes Nathalie Delattre, Patricia Demas, Brigitte Devésa, Françoise Dumont, MM. Jean-Luc Fichet, Fabien Gay, Hervé Gillé, Daniel Gremillet, André Guiol, Mmes Laurence Harribey, Nadège Havet, Else Joseph, Gisèle Jourda, Florence Lassarade, M. Jacques Le Nay, Mmes Anne-Catherine Loisier, Monique de Marco, M. Pascal Martin, Mmes Laurence Muller-Bronn, Vanina Paoli-Gagin, Kristina Pluchet, Angèle Préville, Marie Pierre Richer, M. Olivier Rietmann, Mmes Patricia Schillinger, Anne Ventalon, Marie-Claude Varaillas et M. Jean Pierre Vogel.
M. Jean-Claude Anglars, Mme Viviane Artigalas, MM. Philippe Bas, Joël Bigot, Jean-Baptiste Blanc, François Bonhomme, Jean Marc Boyer, Emmanuel Capus, Mme Cécile Cukierman, MM. Michel Dagbert, Ronan Dantec, Mmes Frédérique Espagnac, Françoise Gatel, MM. Fabien Genet, Éric Gold, Daniel Gueret, Joël Guerriau, Jean-Raymond Hugonet, Patrice Joly, Éric Kerrouche, Mme Sonia de La Provôté, M. Stéphane Le Rudulier, Mmes Valérie Létard, Anne-Catherine Loisier, MM. Jean-François Longeot, Frédéric Marchand, Olivier Paccaud, Philippe Pemezec, Mmes Angèle Préville, Daphné Ract-Madoux, MM. Didier Rambaud, Christian Redon-Sarrazy, Bruno Rojouan, Stéphane Sautarel, Mmes Elsa Schalck, Marie-Claude Varaillas et M. Cédric Vial.
Le groupe Les Républicains a présenté une candidature pour la mission d ’ information sur le thème « Le développement d ’ une filière de biocarburants, carburants synthétiques durables et hydrogène vert ».
Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai d ’ une heure prévu par l ’ article 8 du règlement, cette candidature est ratifiée : M. Vincent Segouin est proclamé membre de la mission d ’ information sur le thème « Le développement d ’ une filière de biocarburants, carburants synthétiques durables et hydrogène vert », en remplacement de Mme Laurence Muller-Bronn, démissionnaire.