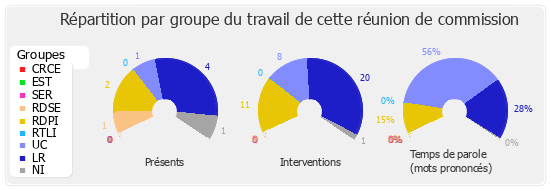Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation
Réunion du 25 mai 2010 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion
La commission entend une communication de M. Philippe Marini, rapporteur général, sur les projets de conventions élaborées dans le cadre de la mise en oeuvre de l'emprunt national.

Nous sommes invités à nous prononcer sur des projets de conventions élaborés par le Gouvernement pour mettre en oeuvre l'emprunt national : c'est une première. Le Parlement a un devoir de vigilance : il doit exercer son pouvoir de contrôle presque en temps réel, pour ne pas nuire à l'efficacité des actions projetées.

En application de l'article 8 de la loi de finances rectificative du 9 mars 2010, le Premier ministre a transmis les 11 et 14 mai derniers aux commissions compétentes du Sénat dix projets de conventions relatives aux actions financées par l'emprunt national. Nous sommes appelés à formuler à leur sujet des observations adressées au Premier ministre, version édulcorée de l'avis de la commission que nous proposions lors de l'examen de la loi de finances relative à l'emprunt national. J'ai rédigé un projet de lettre qui pourrait être considéré comme l'avis de la commission.
Les dix projets portent sur un montant de 6,85 milliards d'euros, soit environ 20 % du total de l'emprunt national. Deux d'entre eux, qui concernent respectivement les équipements d'excellence et le secteur de la santé et des biotechnologies, prévoient l'affectation de capitaux non consomptibles, déposés au Trésor public et dont seuls les intérêts pourront être dépensés.
Le cahier des charges fixé par la loi est globalement respecté : les actions seront financées à hauteur des sommes annoncées, un échéancier pour l'engagement des crédits a été établi et les conditions de rémunération des capitaux non consomptibles précisées ; les textes décrivent l'organisation comptable et les modalités du suivi comptable et prévoient la restitution à l'Etat des fonds non consomptibles. Sur ce dernier point, nous demanderons des éclaircissements : il faut distinguer entre les capitaux servant à financer des projets régulièrement remis en concurrence et renouvelés et ceux qui financeront des projets uniques, one shot, comme les « initiatives d'excellence » ou les « campus technologiques innovants » : dans le premier cas, la restitution serait « possible » à l'issue de l'investissement, dans le second cas les structures bénéficiaires seraient dotées de manière pérenne.
Je me félicite également de voir que la procédure de redéploiement des fonds a été clarifiée et l'évaluation des investissements organisée. Enfin, il est fait référence aux réglementations communautaires, notamment dans les projets de convention relevant de la mission « Économie », ce qui évitera de voir se reproduire les déboires de l'ancienne Agence de l'innovation industrielle.
Cependant, j'assortirai ce jugement d'ensemble de plusieurs réserves. L'impact de l'emprunt national sur la croissance potentielle de notre pays dépend du choix des actions financées. Or les projets de conventions multiplient les structures de proposition et de décision : comités de pilotage, de sélection, d'engagement, de suivi, commission des aides, commission nationale des investissements d'avenir, etc. Cette sorte de polysynodie nuira, je le crains, à l'efficacité de l'ensemble.
La transparence du processus de sélection est, en outre, loin d'être parfaite. La sélection effectuée par les jurys d'experts pourra être modifiée par le comité de pilotage, puis par le commissaire général à l'investissement, et finalement par le Premier ministre. L'expérience des pôles de compétitivité doit nous alerter : je ne suis pas sûr que ce processus complexe soit le meilleur moyen de garantir le respect des critères de sélection, au premier rang desquels la plus-value pour l'économie nationale. En tout état de cause, il serait souhaitable que toute modification apportée par un échelon supérieur soit motivée par écrit, afin que les commissions parlementaires puissent exercer efficacement leur pouvoir de contrôle sur pièces et sur place.
Il faudrait également porter une attention plus soutenue aux coûts de gestion de l'emprunt national, qui a un effet inflationniste sur les dépenses courantes des opérateurs : l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) bénéficie ainsi d'un nouveau relèvement de 25 équivalents temps plein de son plafond d'emplois pour 2010, alors qu'elle s'est déjà vu accorder 50 emplois supplémentaires et 45 redéploiements pour mettre en oeuvre les mesures du Grenelle de l'environnement, soit au total 120 emplois. En ce qui concerne l'Agence nationale de la recherche (ANR), premier délégataire des fonds de l'emprunt national, le détail de ses moyens doit faire l'objet d'une convention financière spécifique, qui n'a pas encore été rédigée.
Pour réussir, l'emprunt national doit exercer un effet de levier, estimé pour l'ensemble des dix conventions à 13,6 milliards d'euros. Mais si chaque projet comprend une évaluation de l'effet attendu, on ne sait sur quoi celle-ci se fonde. Les projections qui figurent dans la convention pour la rénovation thermique des logements privés paraissent très optimistes : souvenons-nous de ce que disait M. René Ricol. Pour ce qui est des aides à la réindustrialisation, la commission relève une contradiction entre l'exigence d'un cofinancement privé représentant au moins 25 % de l'aide, soit un minimum de 50 millions d'euros par rapport aux fonds de l'emprunt, et l'estimation de l'effet de levier à 200 millions d'euros, soit une participation privée égale à celle du public mais quatre fois supérieure à l'exigence minimale. Enfin, on attend sans doute trop des collectivités locales, dont les marges de manoeuvre sont très réduites.
Je finirai par quelques remarques plus ponctuelles. En ce qui concerne les projets relevant de la mission « Économie », je me félicite des modalités de rémunération des gestionnaires du fonds d'amorçage pour les entreprises innovantes, mais je m'interroge sur la portée des engagements demandés aux entreprises qui bénéficient des aides à la réindustrialisation. Que se passera-t-il si l'entreprise aidée ne maintient pas ses emplois dans les cinq années qui suivent la fin de l'investissement ? Quant aux projets relatifs aux démonstrateurs écologiques, aux équipements d'excellence et à la santé et aux biotechnologies, il est inacceptable que l'intéressement financier de l'Etat soit une simple possibilité, et non un élément central du dispositif.

Merci de cette contribution : il nous faut être vigilant sur l'usage de ces crédits qui sont en fait des instruments de débudgétisation.

Ces premières conventions portent sur 6,8 milliards d'euros, mais il faudrait en préciser le contenu pour les membres de la commission.

Les dix conventions concernent respectivement la santé et les biotechnologies, les équipements d'excellence, le réacteur Jules Horowitz du CEA, les démonstrateurs pour les énergies renouvelables et la chimie verte, le financement d'entreprises innovantes, l'aide à la réindustrialisation, le fonds national d'amorçage, le financement de l'économie sociale et solidaire, le prêt aux petites et moyennes entreprises et la rénovation thermique des logements privés. Vous trouverez plus de détails dans le texte des conventions.

Nous avons là l'illustration de ce que nous annoncions lors du débat budgétaire : le Gouvernement cherche à échapper aux foudres de la Commission européenne, puisque le grand emprunt ne s'ajoutera pas à la dette au sens du traité de Maastricht, ainsi qu'à la vigilance des parlementaires. J'ai moi-même examiné de près les projets de conventions relatifs à l'aide aux PME et à la réindustrialisation, et je partage le point de vue de M. le rapporteur général. Les processus décisionnels sont trop complexes et trop peu transparents. Les projets de réacteur du CEA et de démonstrateurs pour les énergies renouvelables et la chimie verte n'ont été sélectionnés par aucun jury et sont tirés des fonds de tiroir !

Comme l'a suggéré M. Marini, les collectivités territoriales sont exsangues et n'ont pas les moyens de contribuer aux investissements. J'ai d'ailleurs relevé une formule que seul un technocrate pouvait inventer : le projet de convention sur l'aide à la réindustrialisation prévoit, parmi les critères d'éligibilité, la participation financière de « l'ensemble de l'écosystème », c'est-à-dire en réalité des collectivités territoriales !

Dans ma lettre, j'inviterai le Premier ministre à ne pas surestimer les capacités contributives des collectivités.

J'approuve donc le projet de lettre rédigé par M. le rapporteur général, à ceci près qu'il est possible que l'Ademe ait besoin d'effectifs supplémentaires. M. Marini disait très justement lors de la CMP qu'une fois l'emprunt voté, nous ne reverrions pas passer le train !

Je souscris aux remarques de M. Marini, à qui je demande des éclaircissements sur deux points. Où sont comptabilisés les intérêts des capitaux non consomptibles versés aux opérateurs : dans un compte spécial, dans le budget général ? Seront-ils financés par le Trésor ? Une des conventions avec Oseo prévoit des bonifications : les conditions en sont-elles fixées à l'avance, ou Oseo sera-t-il maître des décisions ?

La rémunération des capitaux non consomptibles déposés au Trésor est assurée à partir des crédits de la mission dont vous êtes spécialement chargé, cher collègue. Les modalités de cette rémunération sont prévues par les projets de convention. Quant aux conditions des bonifications que vous évoquées, elles sont également fixées dans les projets de convention.

Je vous confirme que les crédits destinés à la rémunération des fonds non consomptibles sont inscrits au budget. Dans le dernier collectif budgétaire, le coût de l'emprunt a été gagé par l'annulation d'un certain nombre de crédits votés en loi de finances initiale.

L'Etat emprunte, mais pour quelle durée et à quel taux ? Il faudra un jour rembourser nos dettes. D'ailleurs, je m'interroge sur les finalités de l'emprunt. Au lieu d'aider des entreprises qui souhaitent développer des activités nouvelles, on finance des opérations qui ne contribueront en rien à la croissance, donc à l'augmentation des recettes de l'Etat. Plutôt que de dépenser à fonds perdus pour développer le plateau de Saclay, on ferait mieux de soutenir les PME de l'Essonne et d'ailleurs !

Voici donc la procédure que nous suivrons dorénavant : dès que la commission recevra du Gouvernement des projets de convention, elle fera parvenir aux rapporteurs spéciaux les textes qui les concernent et les tiendra à la disposition de chacun d'entre vous, tandis que le rapporteur général préparera les observations de la commission sur l'ensemble. Les projets dont nous sommes saisis sont assez généraux : il faudra veiller à la bonne utilisation des crédits. La commission m'autorise-t-elle à faire part en son nom au Premier ministre des observations du rapporteur général ?
La commission adopte les observations de M. le rapporteur général qui seront adressées, sous forme de lettre signée par M. le Président, à M. le Premier ministre.

Je vais vous présenter une évaluation de la politique du crédit d'impôt recherche (CIR) et un bilan de la réforme de 2008, qui s'appuient sur des entretiens conduits au cours des douze derniers mois avec des industriels, des représentants d'organisations professionnelles, des membres de l'administration fiscale, ainsi que sur des études qualitatives menées par les ministères de la recherche et de l'économie. En outre, je dispose depuis une semaine des chiffres relatifs au CIR pour l'année 2009, portant sur les dépenses de recherche et développement réalisées par les entreprises en 2008.
Les dépenses de recherche et développement sont nécessaires à la croissance économique d'un pays à moyen et long terme : sans vous citer les travaux des économistes, je vous renvoie à mon rapport écrit ainsi qu'au rapport d'information sur les incidences économiques d'une augmentation des dépenses de recherche en Europe rédigé par Joël Bourdin en juin 2004. Elles sont indispensables à la souveraineté économique, comme l'ont montré les travaux de la mission commune d'information sur les centres de décision économique. Plusieurs intervenants ont alors expliqué que la présence sur le territoire d'un pays de centres de recherche lui permet de conserver la maîtrise du processus industriel : comme le disait Alain Juillet, alors haut responsable chargé de l'intelligence économique, « dès lors que les brevets sont déposés à l'étranger, toute la substance vive de l'entreprise y est transférée, ce qui implique qu'à terme cette entreprise ne sera plus française. (...) Une entreprise qui se contente d'être une industrie de main-d'oeuvre n'est plus une entreprise nationale. » Ces dépenses permettent enfin de maintenir sur notre sol des activités de production, car les entreprises apprécient la proximité entre centres de recherche et de production.
Or les entreprises n'investissent pas spontanément autant qu'il est nécessaire pour la société, d'une part parce que les résultats de la recherche sont incertains, d'autre part parce qu'en cas de succès, il est fréquent que les bénéfices de ces travaux ne reviennent pas au seul investisseur. Voilà pourquoi les aides publiques sont légitimes. La France, comme d'autres pays, associe des aides directes à l'investissement, notamment par le biais d'Oseo, et une aide fiscale, le CIR. Une aide non sectorielle de ce type est généralement efficace dans les pays où le taux de l'impôt sur les sociétés est élevé.
Or, parmi les grands pays industriels, la France se situe dans le « ventre mou » en termes d'investissements en recherche et développement : nous y consacrons 2,04 % du PIB, dont 1,29 % seulement pour le secteur privé, ce qui nous place un peu en-dessous de la moyenne de l'OCDE. Cette part a décliné au cours de la dernière décennie, ce qui est en contradiction avec les objectifs fixés au Conseil européen de Barcelone en 2002 et dangereux pour l'avenir de notre économie. Certes, dans un secteur donné, les entreprises françaises n'investissent pas moins que les autres, mais nous avons du mal à faire émerger et croître des entreprises actives dans les secteurs de demain. Le CIR n'est qu'un outil parmi d'autres, mais le président de l'Agence française pour les investissements internationaux souligne son caractère fortement attractif vu de l'étranger.
Le CIR, créé par la loi de finances pour 1983, s'appliquait alors à l'excédent des dépenses de recherche et développement consenties au cours d'une année par rapport à l'année précédente. Il était en outre plafonné à 450 000 euros. Les réformes successives ont modifié radicalement sa physionomie. La loi de finances pour 2004 a introduit une part « en volume» au taux de 5 %, en plus de la part « en accroissement » qui passait au taux de 45 %. La loi de finances de 2006 a renforcé cette tendance en portant le taux de la part en volume à 10% et celui de la part en accroissement à 40 %. La loi de finances pour 2008 a achevé ce tournant en triplant la part « en volume », dont le taux de droit commun est désormais de 30 %. Toutefois, ce taux est de 50 % la première année et de 40 % la deuxième année, et certaines dépenses, comme les salaires des jeunes docteurs ou les recherches confiées aux structures publiques de recherche, entrent dans l'assiette pour le double de leur montant. La part en accroissement a été supprimée ainsi que le plafond de 16 millions d'euros de crédit d'impôt. Enfin, au-delà de 100 millions d'euros de recherche et développement, le taux n'est plus que de 5 %.
Le CIR a ainsi changé de nature : d'une « niche» ou d'un coup de pouce ponctuel aux entreprises l'année où elles font un effort particulier, ce dispositif est devenu structurant. En outre, une mesure exceptionnelle de remboursement immédiat du CIR s'applique en 2009 et 2010 du fait du plan de relance, alors qu'en temps ordinaire le crédit d'impôt est imputable sur les trois années suivant les dépenses auxquelles il s'applique - sauf exception pour les jeunes entreprises innovantes.
On peut aujourd'hui constater les premiers effets de la réforme de 2008, mais les chiffres dont je dispose sont issus de données fiscales, non de l'enquête annuelle sur les dépenses de recherche et développement ; ils ne montrent que l'évolution des déclarations des entreprises qui ont souhaité bénéficier du CIR pour tout ou partie de leurs dépenses, sans prétendre à l'exhaustivité. Depuis la réforme de 2004, le nombre d'entreprises déclarantes et le montant du CIR n'ont cessé de croître. En 2008, le nombre de déclarants a connu une forte augmentation de 34 % pour atteindre 12 949, au lieu de 9 653. Près de 90% des « nouveaux déclarants » sont des PME et près des deux tiers des PME indépendantes au sens fiscal : le CIR, loin de bénéficier aux seules grandes entreprises, a su séduire un nouveau public.
Comme l'avait prévu M. Marini, le coût de cette mesure a bondi : en un an, les créances sont passées de 1,682 à 4,155 milliards d'euros, soit une hausse de 147 %. Cette évolution est bien due à la modification du régime fiscal et non à un changement significatif de l'assiette du crédit d'impôt : en 2008, les dépenses déclarées par les entreprises ont atteint 15 426,7 millions d'euros, en progression de 0,9 % par rapport à 2007. Ce chiffre est difficile à interpréter puisqu'il résulte d'effets contradictoires : les sociétés qui n'avaient pas recours à ce dispositif ont été incitées à se manifester, et les grandes entreprises à déclarer l'ensemble de leurs dépenses du fait du déplafonnement du CIR ; mais, d'après le ministère de la recherche, les grands groupes sont plus précautionneux dans leurs déclarations car le déplafonnement implique que toutes les dépenses déclarées soient éligibles, et donc puissent être contrôlées. Il serait donc plus prudent d'attendre les chiffres rendant compte de la dépense intérieure de recherche et développement (DIRD) en 2008. Une augmentation de l'ordre de 1 % serait un signe encourageant au vu de la dégradation de la conjoncture économique à l'automne 2008.
La répartition du crédit d'impôt recherche par taille d'entreprises ne fait pas apparaître de bouleversement majeur par rapport à 2008. Les PME recueillent 43,9 % du total du CIR en 2009, contre 35,2 % seulement en 2008.
Les entreprises de plus de 5 000 salariés progressent également, de 6,3 % à 8,4 %, très probablement sous l'effet du déplafonnement : même au taux de 5 %, le crédit d'impôt recherche a rapporté davantage aux plus grands investisseurs. Vingt sociétés ont ainsi bénéficié de près de 1,2 milliards d'euros de remboursements, soit un coût de la part à 5 % qui s'établit à 588 millions d'euros.
Ces chiffres sont cependant à nuancer, tant du fait de la présence de la ligne « non renseignés », qui concerne 13,7 % des entreprises déclarantes, que du fait de la délicate prise en compte des sociétés non indépendantes d'un point de vue fiscal - plus des deux tiers des sommes perçues - sans que l'on puisse préjuger de la taille des groupes concernés. Il semble toutefois que le crédit d'impôt recherche n'ait pas été orienté massivement vers les plus grandes entreprises après l'entrée en vigueur de la réforme.
La répartition sectorielle mérite elle aussi quelques commentaires. Les industries manufacturières et les holdings, regroupés dans les chiffres du ministère, ont perçu ensemble 65,2 % du CIR en 2009, dont 33 % pour les holdings.
Je m'étais plaint, en novembre dernier, de l'impossibilité de différencier ces holdings selon leur secteur, d'où certains rapprochements un peu hâtifs, tant de la part de l'Assemblée nationale que du Conseil des prélèvements obligatoires, entre ces holdings et le secteur bancaire. Je me réjouis donc que le ministère ait entrepris ce tri, qui laisse d'ores et déjà apparaître que plus de 70 % du crédit d'impôt recherche perçu par les holdings entrent dans la catégorie des industries manufacturières, tandis que la part du secteur bancaire ne se trouve pas augmentée : c'est propager une idée fausse que de prétendre que le crédit d'impôt recherche favorise, avant tout, l'innovation financière.
L'outil statistique reste perfectible : la montée en puissance de la catégorie des « autres services » appelle des distinctions plus fines. Selon les éléments qui m'ont été transmis, on trouve principalement des sociétés d'ingénierie, des cabinets d'architecture ou de création de logiciels.
La diminution des dépenses déclarées par les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique ne traduit pas forcément une réduction des dépenses de recherche et développement par les entreprises concernées, mais reflète peut-être une plus grande prudence dans les déclarations, la disparition du plafond ayant cette conséquence que toute somme peut désormais être contrôlée. Le maintien global de l'assiette du crédit d'impôt n'en est que plus remarquable.
La nature des dépenses déclarées n'a pas non plus évolué de façon très significative en 2008.
Les dépenses de personnel restent, avec les frais de fonctionnement, qui leur sont corrélées, le premier poste de dépense.
Les évolutions ne laissent pas apparaître de dérive. Il n'est pas juste de dire qu'ont été massivement pris en compte - on a parfois parlé de 900 millions d'euros - les investissements de mise en conformité de l'outil informatique à l'espace monétaire européen. Les amortissements sont ainsi passés de 6 % à 5 % du crédit d'impôt recherche entre 2007 et 2008. En tout état de cause, ces dépenses entraîneraient des redressements par les services fiscaux.
En revanche, on note une progression de la recherche externalisée, tant auprès des entreprises que des institutions publiques, ainsi que des dépenses relatives aux jeunes chercheurs, qui restent cependant assez modiques.
La répartition géographique fait apparaître une nette progression de l'Île-de-France et une baisse notable, en proportion, de certaines régions. Les chiffres sont difficiles à interpréter pour l'instant. L'Île-de-France bénéficie sans doute d'un effet de « siège » pour les dépenses déplafonnées : un tiers de ses bénéficiaires recueille les deux tiers du crédit d'impôt recherche.
La plupart des autres régions accusent une baisse, généralement légère, mais parfois significative, comme pour la région Midi-Pyrénées, qui subit sans doute l'effet de l'évolution des dépenses déclarées par le secteur aéronautique.
Au plan qualitatif, les enquêtes conduites par le ministère, par le Medef, ainsi que les entretiens que j'ai menés pendant mon contrôle, convergent sur quelques points essentiels. Les entreprises, quels que soient leur taille et leur secteur d'activité, sont satisfaites de la réforme de 2008. Elles considèrent le crédit d'impôt recherche comme un outil puissant et beaucoup plus compréhensible que lorsqu'il existait une part en accroissement ; 58 % des 700 entreprises ayant répondu à l'enquête du ministère, soit un nombre significatif d'entre elles, ont été incitées par la réforme à augmenter leurs dépenses de recherche et développement en France. Au cours de mes travaux, j'ai reçu plusieurs témoignages concrets en ce sens. Des messages très convergents m'ont également été adressés par de nombreux entrepreneurs et représentants d'organisations patronales, qui estiment utile de conserver les grands équilibres du crédit d'impôt recherche sur plusieurs années ; de nombreuses petites entreprises restent toutefois circonspectes, car elles rencontrent des difficultés à cerner le périmètre des dépenses éligibles et craignent, à tort, que le bénéfice du crédit d'impôt recherche ne leur vaille un contrôle fiscal.
Au terme de cette enquête, je souhaiterais vous adresser quelques préconisations.
La première est un appel à la stabilité, par où je rejoins l'analyse du rapporteur général qui, dès l'examen du projet de loi de finances pour 2008, estimait qu'il était temps de stabiliser ce crédit d'impôt, « les efforts entrepris pour favoriser son caractère incitatif étant contrebalancés, notamment pour les PME, par sa complexité et sa révision continuelle ».
Outre que les premiers résultats du crédit d'impôt recherche rénové sont, ainsi que je vous l'ai exposé, encourageants et que les entrepreneurs eux-mêmes aspirent à une telle stabilité, les dépenses de recherche et développement, s'engageant sur le long terme, exigent un régime prévisible.
Sans doute les résultats restent-ils difficiles à interpréter, pour les raisons que j'ai évoquées, de manière brute, et seule l'évolution comparée sur plusieurs années permettra de trancher. Mais rien ne permet de dire, pour l'heure, que nous faisons fausse route ou que le crédit d'impôt recherche entraîne des abus manifestes. L'expérience mérite donc d'être poursuivie.
C'est un problème de crédibilité fiscale : quand nous faisons des choix forts et structurants, visibles tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nos frontières, nous devons les assumer sans céder à la tentation permanente de les défaire aussitôt adoptés.
Pour toutes ces raisons, j'estime qu'il nous revient d'envoyer un message clair quant à la nécessité de stabiliser le crédit d'impôt recherche dans son architecture actuelle pendant au moins trois ans.
Cela n'interdit pas quelques améliorations à la marge. Le crédit d'impôt recherche gagnerait à financer véritablement la recherche et le développement expérimental : son assiette devrait se focaliser sur cet objet. Ainsi, si un jour un dispositif fiscal spécifique devait soutenir des dépenses d'innovation, certaines dépenses actuellement dans l'assiette du crédit d'impôt recherche devraient rejoindre ce véhicule. De même, le crédit d'impôt création devrait faire l'objet d'un article distinct au sein du code général des impôts.
A titre personnel, j'estime que la collaboration entre entreprises ou entre entreprises et organismes publics de recherche ou universités mériterait un coup de pouce supplémentaire, grâce à une augmentation du plafond des dépenses pouvant être sous-traitées. J'admets qu'il faudra cependant vérifier avec précision que ces dépenses ne sont pas sous-traitées hors de France.
Quant aux mesures de trésorerie, je rappelle qu'elles ne coûtent, au bout du compte, rien à l'Etat, qui ne fait qu'anticiper le paiement de sa dette envers l'entreprise. Je plaide en faveur de la pérennisation du remboursement immédiat du crédit d'impôt recherche pour les PME, ainsi que de la prise en compte des avances remboursables dans l'assiette du crédit d'impôt recherche. Ce débat a déjà eu lieu lors du collectif budgétaire sur le « grand emprunt ». Même si je reconnais que la pérennisation du remboursement immédiat du crédit d'impôt recherche aux PME résoudrait sans doute largement le problème des entreprises concernées, je reste, personnellement, partisan de cette mesure.
Il convient de rassurer les entreprises, en particulier celles qui n'ont pas en leur sein un service juridique et fiscal et qui, soit ne sont pas soutenues, soit reversent jusqu'à un tiers de leur crédit à un cabinet spécialisé - il n'est pas rare que 30 % du montant soit ainsi absorbé. Cette démarche pourrait passer par une plus grande formalisation des dépenses éligibles, avec une clarification au niveau réglementaire. Il ne suffit pas de s'appuyer sur le Manuel de Frascati : il faudra beaucoup de pédagogie envers les conseils naturels de ces entreprises L'excellent Guide du CIR produit par le ministère devrait être largement diffusé dans ces cercles et des séances de formation devraient être systématisées. Je le ferai d'ailleurs figurer en annexe de mon rapport écrit. Il faudra aussi un travail de proximité auprès des petites entreprises, pour lever la crainte du contrôle fiscal.
Enfin, nous devons nous doter d'une véritable stratégie d'évaluation de cette dépense fiscale de plus de 4 milliards. Le rapport annuel adressé au Parlement, qui ne doit pas nous dispenser de mener nos propres investigations, devra être focalisé sur la performance : quel est le véritable entraînement du crédit d'impôt recherche, de telle ou telle de ses tranches ? Faut-il réorienter telle somme vers un autre segment de la recherche et développement ou mieux prendre en compte les différences de taille des entreprises ? Telles sont les questions auxquelles il devra répondre.
L'exemple pour moi le plus éloquent concerne la tranche de 5 % au-delà de 100 millions. Le risque d'effet d'aubaine m'y semble le plus fort car quelle est la véritable capacité d'entraînement d'un crédit d'impôt de 5 % ? J'ai donc un vrai doute sur cette question, un doute à 600 millions - 588 millions en loi de finances pour 2009. Ce n'est pas rien compte tenu de l'état de nos finances publiques... C'est pourquoi nous devrions, à mon sens, dès la prochaine session budgétaire, engager avec le Gouvernement, sur cette question, un vrai débat, dont un amendement pourrait constituer le support.

Je remercie notre rapporteur spécial de sa communication sur cet important sujet, qui engage des dépenses d'avenir. L'effort de l'État, supérieur à 4 milliards, est considérable. Il faut croire que vos travaux, monsieur le rapporteur spécial, ont suscité quelques inquiétudes puisque le Gouvernement s'est engagé avec nous dans une course de vitesse pour s'assurer la primeur de la diffusion des chiffres...
Ce type de rapport d'étape pourrait se conclure par l'esquisse d'amendements, préfiguration de ceux qui pourraient intervenir en loi de finances. Vous en proposez d'ailleurs un, qui pourrait produire une économie de 600 millions d'euros. Je me pose une question au sujet de ce seuil de 100 millions : s'apprécie-t-il entreprise par entreprise ou au niveau du groupe ?

Je me joins aux compliments adressés par le président Arthuis. Les tableaux d'ensemble que vous nous avez communiqués sont très précieux. Ils montrent l'ampleur de la réforme conduite en 2004 et 2008. Il s'agit d'une réforme structurante et très coûteuse, d'une réforme de compétitivité dans un des rares domaines où l'État puisse intervenir sans enfreindre les règles communautaires.
Je rebondis sur la question du président Arthuis : notre droit fiscal actuel connaît-il la notion de groupe ? Quand une société fait partie d'un groupe, et se trouve donc contrôlée par une société, ou une chaîne d'autres sociétés, ses droits au crédit d'impôt recherche sont-ils calculés comme si elle était indépendante ou le sont-ils au niveau du groupe ?

Le fait que le nombre de bénéficiaires soit inférieur au nombre de déclarants indique que les groupes fiscalement intégrés cumulent le crédit d'impôt recherche de leurs filiales.

Vous faites ici référence aux sociétés détenues à plus de 95 %, mais quid des sociétés simplement contrôlées ? Le seuil des 100 millions peut-il avoir une influence sur la stratégie de répartition au sein des filiales ?

Les chiffres que vous nous avez communiqués quant à la répartition par taille d'entreprise m'inclinent à cette interprétation. Vous avez relevé que plus des deux tiers des sommes perçues le sont par des entreprises non indépendantes. Moyennant quoi il serait logique que le seuil de 100 millions soit apprécié à l'échelle du groupe, et donc calculé sur une base consolidée.

De la différence entre consolidation fiscale et consolidation comptable...

Vous nous avez indiqué que le nombre de déclarations est en augmentation, mais qu'il faudra attendre pour mesurer l'effet de levier du dispositif sur les dépenses de recherche et développement. Mais sur la période 2003-2008, où les dépenses ont été multipliées par trois, dispose-t-on de telles mesures ?
Mon autre question porte sur l'information des entreprises. J'ai rencontré ce week-end un patron de PME, très investi dans le développement et l'innovation - même s'il fait, hélas !, fabriquer en Chine... - qui ignorait pouvoir bénéficier du crédit d'impôt recherche.

C'est qu'il n'en avait pas besoin... Quelle aubaine pour lui que cette découverte !

Il serait bon que les chambres consulaires fassent mieux passer l'information.

J'ai dit que, parmi les 3 000 entreprises déclarantes supplémentaires, 90 % étaient des PME, mais les grands groupes aussi bénéficient de l'évolution du crédit d'impôt recherche. Il est difficile de mesurer l'effet de levier sur les dépenses de recherche et développement. Dès lors qu'il s'agit d'investissements à moyen et long terme, on ne pourra en faire l'analyse que dans quelques années.

Le but du dispositif est bien d'inciter les entreprises à réaliser de la recherche et développement en France. Son effet est assez rapidement mesurable. Y a-t-il eu, sur la période 2003-2007, augmentation des dépenses en recherche et développement ?

J'ai dit que l'on observe, en France, une baisse régulière, de 2003 à 2008, des dépenses en recherche et développement. On constate un réamorçage depuis 2008, qui, eu égard au contexte économique, mérite d'être relevé.

Peut-être des éléments qui n'étaient pas comptabilisés en recherche et développement le sont-ils aujourd'hui : on les fait apparaître pour récupérer 30 % ...

Cette opération est très appréciée des entreprises. Elle leur permet d'investir. Mais il faut qu'elles soient informées. A qui le chef d'entreprise doit-il s'adresser ?

L'ensemble du réseau de ses conseils habituels est compétent pour l'informer : chambres consulaires, experts comptables...

Je préconise, dans mes conclusions, une sensibilisation accrue des entreprises, dont certaines, je l'ai dit, craignent que l'entrée dans le dispositif n'accroisse les risques de contrôle fiscal...

Je remercie M. Gaudin de cet excellent travail. La communication express de Mme Pécresse sur les chiffres de 2008 trahit les inquiétudes qu'il a suscitées...Parmi les chiffres qu'elle a cités, j'ai retenu que les holdings captent 33 % de l'avantage alors qu'elles n'assurent que 2,3 % des dépenses de recherche. De fait, parmi les huit premiers bénéficiaires, on retrouve les entreprises du CAC 40, Renault, Total, Orange...
J'estime qu'il faudrait instituer un élément de conditionnalité, afin que les grands groupes accompagnent les PME, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce sont actuellement les PME qui seules font les efforts de recherche et développement, et dès qu'elles atteignent un certain seuil, elles sont phagocytées par les grands groupes...

y compris étrangers, et je ne pense pas seulement aux fonds de pension américains : nos partenaires allemands ne sont pas les derniers à l'affût...
Ma deuxième remarque porte sur le seuil des 100 millions : certains groupes n'augmentent pas leurs dépenses pour ne pas le franchir et capter l'avantage à plein.
Quant à l'impact sur le taux de croissance des dépenses de recherche et développement, sur lequel il est juste, monsieur le rapporteur spécial, de s'interroger, j'ai souvenance qu'avant la réforme, le ratio entre dépense publique et investissement privé était de 1 à 2,14. Si l'on en croit les chiffres publiés aujourd'hui dans la presse, il serait passé à 3,6.
Ma dernière remarque concerne le suivi de la réforme. Comment concilier un dispositif par définition transversal, le crédit d'impôt recherche, avec une politique qui semble vouloir être de filières ? Comment circonscrire ce qui est stratégique pour la recherche ? Vous recommandez la stabilité du système. Dès lors qu'il est déclaratif, rien n'empêche de circonscrire un échantillon représentatif des entreprises, pour assurer un suivi ad hoc. A l'heure actuelle, on ne sait pas si le dispositif fait revenir nos chercheurs, s'il attire des chercheurs étrangers, s'il contribue à la croissance, s'il participe au développement des PME innovantes.

Mme Bricq a soulevé beaucoup des questions que je me posais. Le tableau que vous nous avez présenté sur les dépenses intérieures de recherche et développement au sein de l'OCDE est plein d'intérêt. Peut-on savoir comment ont respectivement évolué les parts de l'investissement privé et de l'investissement public ? L'intervention publique a-t-elle incité les entreprises à plus d'efforts ? Autre question : quels effets sur la création d'emploi sur le territoire national dans les secteurs d'activité qui ont bénéficié du crédit d'impôt recherche ?

Je remercie le rapporteur spécial pour les précieuses informations qu'il a portées à notre connaissance. J'ai toujours été sceptique sur la réforme de 2008, qui a augmenté une niche fiscale de plus de 2,5 milliards, dont il est important aujourd'hui de mesurer précisément l'utilité.
Si l'on observe le tableau qu'a évoqué Mme Beaufils, on constate que, dans certains pays, comme la Suède ou la Finlande, la fiscalité n'influe pas sur la stratégie des entreprises. Pouvez-vous nous dire quel a été chez nous l'effet mécanique de la réforme de 2008 ? Elle n'a que peu influé, si l'on en croit le tableau relatif à la taille des entreprises concernées, sur la répartition des bénéficiaires. On ne voit guère de différence sur les PME. Ce qui conduit à s'interroger sur l'effet d'aubaine qu'a pu entraîner la réforme : ce sont ceux qui font un effort important en volume qui ont été récompensés, mais pas les plus vertueux. J'ai d'ailleurs moi aussi entendu dire que les PME étaient mal informées : il y a sans nul doute une marge de progression en matière d'information.

Il m'intéresserait, monsieur le rapporteur spécial, que la suite de vos travaux vous conduise à établir une répartition par région et par type d'entreprises, car certains éléments dans la liste que vous nous avez donnée me surprennent.

Les chiffres de 2009 sont relatifs à l'année 2008 : le processus lié à la réforme n'est donc pas complètement enclenché. Des investigations complémentaires seront donc nécessaires. Il faudra voir ce qui se passe à l'intérieur des groupes, pour tenter de prévenir une optimisation qui ne servirait pas la cause de la recherche. Il faudra voir aussi si une part de la dépense n'a pas tendance à passer en Europe centrale... J'ai entendu quelques témoignages concernant l'année 2009 qui laissent à penser que le processus s'amplifie... Dernière observation enfin : il ne suffit pas de s'assurer que la recherche est implantée sur le territoire national ; il faudra être sûr, lors du passage à l'application industrielle, que les créations d'emploi se font bien sur notre territoire...
Ce rapport d'étape méritera donc d'être complété, pour étayer nos convictions, lors de la loi de finances.

Il est vrai, madame Bricq, que les chiffres annoncés ce matin trahissent une incohérence : 33 % du crédit d'impôt ne produisent que 2,4 % des dépenses en recherche et développement. J'ai dit tout l'intérêt qu'il y aurait à faire accompagner les petites entreprises par les grandes. Les pôles de compétitivité sont idoines pour mettre en relation le monde de l'entreprise et celui de la recherche. Les grandes entreprises ont intérêt à accompagner les petites pour faciliter la sous-traitance et les petites entreprises ont tout intérêt à entrer dans une culture de l'innovation.
En ce qui concerne l'effet multiplicateur du dispositif, les chiffres méritent d'être nuancés pour retenir un ratio. Il ne suffit pas de rapporter 4,2 milliards d'incitation à 15,5 milliards d'investissements : certaines entreprises sont à 50 %, d'autres, la plupart, à 30 %, mais il en est aussi à 60 %, celles qui passent convention avec un laboratoire public. Il est donc difficile d'établir un ratio général.

Quant à la question du contrôle, j'ai dit que la stabilité devait avoir pour corollaire une stratégie d'évaluation prenant en compte la taille des entreprises et les secteurs.
J'ai dit, madame Beaufils, que la participation privée à la recherche et développement a chuté entre 2003 et 2007. Elle s'est redressée depuis 2008 et il n'est pas douteux que la réforme du crédit d'impôt recherche ait « boosté » l'investissement. D'autant qu'il faut prendre en compte le contexte difficile que nous traversons : sans dispositif de soutien, il est probable que la tendance à la baisse se serait poursuivie.
Les effets du crédit d'impôt recherche sur la création d'emplois ? Le président Arthuis l'a rappelé, les chiffres dont nous disposons concernent l'année 2008 et la phase déclaratoire courait jusqu'au 15 avril 2010 : il faudra prolonger l'observation pour tirer des conclusions. Nous savons cependant que 29 % de l'emploi des cadres sont liés à la recherche et développement.
Vous qualifiez le dispositif voté en 2008, monsieur Marc, de niche fiscale. Les modifications alors apportées étaient destinées à soutenir les entreprises dans leur effort sur le long terme. La part du crédit en accroissement des dépenses était complexe à gérer : même les entreprises innovantes sont satisfaites des évolutions apportées.
Le rapport fournira des éléments sur la question de la répartition au sein des holdings. J'ai également noté la demande de M. Gouteyron, à laquelle il sera répondu ultérieurement.

En 2007-2008, les entreprises ont dépensé 143 millions de plus pour la recherche et encaissé 2,5 milliards de CIR supplémentaire ! Je regrette que ces données nous aient été communiquées si tardivement. Toutefois, nous pouvons déjà esquisser des projets d'amendement, d'une part pour supprimer le taux de 5% pour les dépenses qui dépassent le plafond de 100 millions - ce qui fait réaliser une économie de 600 millions -, d'autre part pour éviter l'optimisation au sein des groupes qui ont le contrôle de leurs filiales sans être consolidés à 95 % et qui peuvent être tentés de répartir le CIR sur ces sociétés qui dépendent d'eux.

Pour un même investissement en recherche et développement, la typologie des entreprises varie. L'essentiel est d'éviter les détournements de procédure.

Il faudra interroger la ministre. Nous ouvrirons le débat avec ces deux propositions d'amendement.
La commission donne acte à M. Christian Gaudin de sa communication et en autorise la publication, sous la forme d'un rapport d'information.
Puis la commission procède à l'examen du rapport pour avis de M. Éric Doligé, rapporteur pour avis, sur le projet de loi n° 427 (2009-2010), adopté par l'Assemblée nationale, relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services.
Examen du rapport

Ce projet de loi réforme les réseaux des chambres de commerce et d'industrie (CCI) et des chambres de métiers et de l'artisanat, dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, afin d'améliorer le service rendu, de rationaliser les structures, de mutualiser les fonctions supports et de réduire les charges de 15 % en trois ans. Les réseaux ont eu le temps de la réflexion : si les chambres de métiers et de l'artisanat ont proposé un projet consensuel, approuvé à 94 %, par l'Assemblée permanente des chambres des métiers, la réforme est bien plus conflictuelle pour les CCI.
Le projet de loi adopté en Conseil des ministres le 29 juillet 2009 régionalise l'organisation et la collecte fiscale dans les deux réseaux : la ressource fiscale sera attribuée au niveau régional, qui la redistribuera ensuite vers le niveau départemental ou territorial. L'échelon régional des chambres de commerce et d'industrie se verra en outre affecter, à compter du 1er janvier 2013, les agents de droit public, soit cinq sixièmes du personnel des CCI. Cet échelon regroupera, dans les deux réseaux, les fonctions supports, définira la stratégie et assurera l'homogénéisation des politiques et des services. Les services de proximité seront maintenus au sein des chambres départementales ou territoriales.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat s'est accordé dès la fin 2008 sur une architecture commune, avec un objectif de fusion régionale. Deux options sont soumises au vote des chambres : le maintien des niveaux régionaux et départementaux autonomes avec une nouvelle répartition des compétences, ou la création d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région, établissement public unique résultant de la fusion des chambres départementales. Le niveau régional définirait la politique de formation, collecterait la taxe et mutualiserait les fonctions supports.
Les CCI en revanche restent autonomes mais deviennent des CCI territoriales (CCIT), établissements publics rattachés à une CCI régionale (CCIR). Les ressources fiscales sont affectées par la CCIR, qui recrute et gère les personnels sous statut et mutualise les moyens. Aux termes de l'article 7 ter du projet de loi, les 22 CCIR percevront une recette d'environ 1,2 milliard d'euros, composée pour 40 % d'une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, dont le taux sera régional, donc variable, et pour 60 % d'une taxe additionnelle sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), dont le taux sera national. Les chambres régionales conserveront une partie de la recette pour financer les services mutualisés, et redistribueront le reste aux 148 chambres territoriales. Il est prévu une réfaction progressive de la quote-part CVAE. Sachant que seuls 27 % des ressources des CCI sont issues de la taxe additionnelle - le reste provenant, pour 48 %, des prestations, pour 11 %, des subventions, et pour 14 %, de produits divers, notamment financiers - le texte ne touche en réalité qu'un tiers des recettes globales du réseau qui s'élèvent à 4,2 milliards d'euros.

Les écarts sont effectivement importants.
L'article 7 ter maintient une ressource fiscale autonome et pérenne pour le réseau des CCI, mais remet en cause certains principes inscrits dans la loi de finances pour 2010 à l'initiative de notre rapporteur général. Je propose de les réintroduire par voie d'amendements : la taxe ne doit financer que des missions régaliennes, et ne peut être utilisée pour baisser le prix des services ; dans le respect de la LOLF, il faut justifier d'une gestion plus rigoureuse des recettes fiscales.
La réforme du financement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat ne pose pas, quant à elle, de problème particulier. Pour éviter de revenir systématiquement devant le Parlement, le droit fixe sera indexé sur le plafond de la sécurité sociale, conformément aux recommandations formulées par notre collègue André Ferrand, rapporteur spécial de la mission « Economie ».
J'en viens à la question du financement des charges de personnel. Vingt cinq mille des trente mille agents des CCI sont des agents de droit public : les charges de personnel représentent au total 1,7 milliard d'euros, soit 128% du montant de la taxe collectée. Les chambres régionales devant payer les salaires des personnels sous statut dont le montant est évalué à 1,4 milliard d'euros, elles devront demander aux chambres territoriales de faire « remonter » les moyens nécessaires !

L'Assemblée nationale et le ministre n'ont manifestement pas perçu le problème. Il nous faut donc amender le texte pour permettre aux CCIR de payer les personnels.
Autre problème que j'ai découvert au cours de mes auditions, la grille des salaires théoriquement applicable dans les CCI n'est pas uniformément appliquée dans les faits.

Si l'on gère tout le monde au niveau régional, les salaires seront alignés par le haut !

Je comprends mieux l'ébullition dans mon département, où nous avons deux chambres, Pays basque et Béarn. Il faudra prévoir des réunions d'information, car cela chauffe dans les campagnes !

La réforme est très compliquée. Un tiers des acteurs y est hostile, et cette proportion va croissant. C'est aussi dû à une mauvaise compréhension : seul le back-office relèvera du niveau régional, les actions économiques de terrain resteront au niveau territorial.

Les chambres régionales s'attribueront environ un quart de la ressource fiscale pour financer les fonctions supports ; le reste redescendra.

Nous raisonnons à masse constante. Il s'agit de redécouper les missions et les compétences, d'effectuer des rapprochements pour réaliser des économies. Les chambres se font peur inutilement !

L'Essonne et la Seine-et-Marne sont opposées à cette réorganisation, qui menace la politique de proximité des chambres.

L'Île-de-France est un cas particulier. La chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) regroupe quatre départements, avec un système de délégations qui fonctionne très bien. Sur les quatre autres départements, deux sont d'accord pour intégrer le système, deux sont contre. Il faudra y revenir au cours du débat.

Les budgets seront votés par une majorité des deux tiers. Comment les mandats seront-ils répartis ? Mes CCI du Finistère se plaignent de n'avoir que 25 % des droits de vote alors que leur poids dans l'activité de la région est proportionnellement plus élevé... Comment aboutir à une répartition du financement qui sera jugée honorable par chaque chambre territoriale ? Il faudra lever cette ambigüité.

Cette question relève de la commission de l'économie. Quel que soit son poids, la principale CCI ne pourra avoir plus de 45% des droits de vote. De même, avec une majorité des deux tiers, la minorité de blocage est plus facile à atteindre pour les petites chambres. Lors des auditions, cette solution est apparue comme la meilleure. En dernier recours, le préfet mettra tout le monde d'accord !

Les chambres de métiers et de l'artisanat auront le choix entre deux options, mais, pour les CCI, tout est réglé d'avance. Est-ce le résultat du combat mené par les présidents de chambres de métiers et de l'artisanat ? En tout cas, cette réforme préfigure ce qui nous attend en 2015 ou 2016 pour les conseils généraux et régionaux.

Le Gouvernement a demandé aux deux réseaux consulaires d'élaborer un projet. Les chambres de métiers et de l'artisanat ont proposé un texte qui fonctionne, largement consensuel. Je n'en doute pas, dans les deux ans, les fusions prévues se réaliseront au niveau régional ; le Nord-Pas-de-Calais et la Bourgogne en ont déjà décidé ainsi. Les CCI, en revanche, se sont longuement « chamaillées » avant de proposer un texte majoritaire. Or, cette majorité se délite, et le combat se poursuit. Il faut dire que, contrairement aux chambres de métiers et de l'artisanat, la population des CCI n'est pas homogène.

L'Île-de-France est sans doute un cas particulier. Aucun texte n'était présenté au Parlement pour cause de désaccord entre la chambre de commerce et d'industrie de Paris et l'assemblée permanente des CCI, ou plutôt entre leurs deux dirigeants. Mais l'Elysée a sommé tout le monde de se mettre d'accord, sur fond de RGPP.
En loi de finances, à l'initiative du rapporteur général, la répartition entre contribution foncière et contribution sur la valeur ajoutée avait été fixée à 40/60. Un amendement de Charles-Amédée de Courson à l'Assemblée nationale portant cette proportion à 30/70 a été repoussé par le rapporteur, Catherine Vautrin, au motif qu'il désavantagerait les PME, car ce sont les grandes entreprises qui ont le plus de foncier. A-t-on évalué l'impact de ces différentes répartitions ? Je n'attends pas une réponse aujourd'hui, mais il faudra que Bercy nous éclaire avant le débat en séance.

Il s'agit d'un mode de calcul indépendant du montant de CVAE effectivement payé par chaque entreprise prise individuellement : un coefficient décidé au niveau national est appliqué à la masse de CVAE du département. C'est donc une forme de dotation indexée sur une base fiscale territoriale.

Il sera intéressant de savoir si les différents taux apparaîtront bien sur l'avis de mise en recouvrement, en distinguant s'il s'agit du taux national de CVAE ou du taux local applicable aux entreprises exonérées de CVAE.

Ne pourrait-on envisager de territorialiser le pouvoir de voter le taux de cotisation foncière des entreprises, confié par le projet de loi aux chambres régionales ? Il en va de l'autonomie des chambres territoriales, qui risquent de perdre leur marge de manoeuvre, comme les collectivités locales!

Une répartition interne sera assurée. Sur la part CFE de la taxe additionnelle, soit 40 %, le taux régional pourra être augmenté d'1% par an à compter de 2013. Sur les 60 % de part CVAE, comme le taux est national, un fonds de péréquation viendra compenser les écarts entre régions.

La part CVAE subira une réfaction progressive, jusqu'à 15 % en 2013 : la recette fiscale diminuera donc.

Aujourd'hui, les chambres régionales sont des coquilles vides. Cette réforme risque in fine de coûter plus cher que le système actuel.

Il faudra doter les chambres régionales et l'on ne pourra pas réduire les ressources des chambres territoriales !
En Île-de-France, le système de délégations pour les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne fonctionne très bien : nous n'avons nullement l'impression d'être sous tutelle. De là à appliquer ce système à la France entière... Il conviendrait de s'inspirer de la formule proposée pour les chambres de métiers et de l'artisanat. Mais, outre les résistances, cela entraînerait des surcoûts. La rémunération des agents des chambres consulaires est très supérieure à celle des agents des collectivités locales !

Les Yvelines et le Val d'Oise sont d'accord pour rejoindre le système des délégations, les autres départements non. Il faudrait à mon sens prévoir un délai d'au moins cinq ans.

Les outils existants fonctionnent. Pourquoi bâtir cette usine à gaz ? Ce n'est pas en éloignant les lieux de décision du terrain que l'on gagnera en efficacité. Votre rapport ne fait que renforcer mon opinion négative !

Merci de me soutenir ! Cette réforme ne devrait pas entraîner de surcoût pour l'Etat, puisque le réseau ne bénéficie pas de dotation budgétaire, mais on ne peut pas vraiment dire qu'elle clarifie et simplifie les choses.

Le texte qui nous est présenté pour les CCI est refusé par un tiers d'entre elles et de nombreux désaccords persistent.

Nous examinons un texte qui résulte d'une concertation sans doute incomplète. La proposition est loin d'être consensuelle. Plus on creuse, plus on trouve de raison de s'étonner : les ressources parafiscales ne couvrent pas les dépenses de personnel ! Les agents sont rattachés à un échelon régional qui ne produit pas de services, mais ne fait que percevoir une ressource parafiscale qui ne lui est attribuée que pour partie ! Il faudra pour équilibrer tout cela imaginer des conventions spécifiques avec chaque chambre territoriale... Nous sommes loin d'en avoir fini !

Sur le plan financier, on arrive, non sans mal, à bâtir un système, même s'il aurait été plus simple de raisonner en partant de la base, c'est-à-dire à partir d'un vote des chambres territoriales sur le montant à attribuer à l'échelon régional afin de pourvoir aux charges des services mutualisés. Le problème, c'est la gouvernance ! Mais il relève de la commission de l'économie.

Le rapport de Gilles Carrez démontre que plus les communes ont d'argent, plus elles dépensent ! Il suffirait de réduire leurs ressources pour pousser les chambres consulaires à réduire leurs coûts. La régionalisation entraînera un nivellement des salaires par le haut, donc des dépenses supplémentaires. Il serait tentant de refuser d'amender un texte dont les finalités sont aussi peu compréhensibles...

Ne peut-on suggérer aux CCI de suivre l'exemple des chambres de métiers et de l'artisanat ?

Nous voterions la partie chambres de métiers et de l'artisanat et rejetterions la partie CCI.

Je doute que cela soit techniquement possible. En outre, la réforme des chambres de métiers et de l'artisanat ne peut plus être repoussée. Je rappelle que les élections consulaires ont déjà été reportées de novembre 2009 à novembre 2010. Il y a donc urgence à adopter un texte.

Nous pouvons dire qu'un texte aussi « tordu » n'est pas amendable ! Si nous ne légiférons pas avec conviction, comment justifier l'existence d'un Parlement ? Ceci étant, notre commission n'est pas saisie au fond ; nous sommes là pour éclairer le débat.

Je propose de réintroduire des éléments votés en loi de finances. Surtout, il faut un amendement permettant de « remonter » la masse financière des chambres territoriales aux chambres régionales, pour payer les salaires ! Le dispositif fiscal a été complexifié par l'Assemblée nationale. En outre, nous ne disposons d'aucune simulation. J'ai tenté de rendre le texte opérationnel. Reste le problème de la gouvernance, car les chambres ne sont pas d'accord entre elles.

La commission de l'économie nous a laissé le soin d'analyser les dispositions financières. Nous pourrions donc présenter nos amendements, tout en exprimant nos réserves sur l'opportunité de voter aujourd'hui un texte qui est un foyer de crispations.

Il serait plus clair de donner notre avis global sur la réforme. Pour ma part, j'estime que ce texte n'est pas mûr et n'apporte pas de réel progrès. Si cette position est partagée, qu'elle soit actée. Ensuite, nous proposons des amendements techniques pour le cas où nous ne serions pas suivis par la commission saisie au fond. Les CCI ne pourront rien nous reprocher !

Je suggère à la commission d'émettre un avis défavorable de principe et, s'il n'est pas partagé par la commission de l'économie, d'adopter les amendements techniques que nous propose notre rapporteur pour avis.

Il nous faut adopter les amendements du rapporteur pour les transmettre à la commission de l'économie. Dès ce soir, nous pourrons publier un communiqué pour exprimer les réserves de la commission des finances sur cette réforme bien trop confuse.

Il faut bien discuter du cas des chambres de métiers et de l'artisanat.

Ce qui vient d'être proposé me convient, car la partie sur les chambres de métiers et de l'artisanat est intéressante et peut servir d'exemple - c'est une solution à méditer pour les chambres de commerce et d'industrie de Paris et d'Ile-de-France -. L'objectif était bon, mais en rester à la moitié du chemin, en ce qui concerne les CCI, est pire que la situation actuelle. En revanche, donnons sa chance à la réforme des chambres de métiers.

La logique initiale était très claire : diminuer les frais de gestion, appliquer la RGPP et compenser les économies sur la ressource publique par l'augmentation du prix des prestations de services.

Il y a dans les chambres consulaires des cadres qui ont des salaires plus élevés que ceux des collectivités territoriales.

Voilà deux ans, l'idée était d'avoir des chambres régionales et des délégations départementales qui n'étaient pas des établissements publics. Or, demain, l'argent ira aux chambres régionales qui sont des coquilles vides et les chambres territoriales resteront des établissements publics. Je suis donc partisan d'adopter le système des chambres des métiers et de dire qu'il faut s'en inspirer pour la réforme des CCI.

La réfaction progressive de 15 % sur la part CVAE peut-elle se concilier avec un fonds de péréquation et celui-ci ne risque-t-il pas d'être alimenté par un prélèvement sur la part CVAE des collectivités territoriales ?

Non, il n'y a pas de risque. Le fonds sera abondé par la taxe additionnelle sur la CVAE affectée aux CCIR.

On nous dit que la masse salariale figurera au budget des chambres régionales, lesquelles seront l'employeur au sens juridique des personnels de droit public. Cependant, les services resteront rendus par les chambres territoriales, qui auront un président et un directeur général. Cette étrange construction souffre d'un déséquilibre entre la réalité des services et le pouvoir financier, pour partie régionalisé, ainsi que le pouvoir sur le personnel, qui le sera complètement. Cela n'est pas logique : on peut parfaire la technique, mais l'architecture n'est pas bonne. En revanche, il y a bien une option fusion pour les chambres des métiers et cette faculté peut déboucher sur une simplification.

La commission va donc suggérer d'ajourner la discussion sur les chambres de commerce et d'industrie toute en s'en remettant, bien sûr, à la décision de la commission de l'économie.

Alors je propose que nous examinions les amendements au cas où notre suggestion ne serait pas retenue par la commission saisie au fond.
Examen des articles
Article 2

Je supplée désormais le rapporteur pour avis pour vous présenter les amendements. La comptabilité analytique prévue par l'amendement n° 1 permettra de veiller au respect des règles de concurrence. Cela doit figurer dans la loi. L'Assemblée nationale a dénaturé l'article 79 que nous avions voté dans la loi de finances initiale pour 2010, qui avait pour but de distinguer les charges de service public, financées par une ressource fiscale plafonnée et définie de la même façon dans tous les territoires, et les dépenses supplémentaires, liées aux services d'utilité collective de chaque territoire, qui seraient financées par une redevance librement fixée, sans plafond, par les chefs d'entreprise. Nous avions ajouté des conditions équitables de majorité. L'Assemblée nationale est revenue à quelque chose de beaucoup plus administratif et encadré.
J'avais envisagé de reprendre le débat sur le financement du réseau, mais les chambres de commerce n'ont pas saisi la perche que je leur ai tendue. Elles se sont montrées très hésitantes, expliquant ne pas savoir où passait exactement la frontière entre les missions de service public et les autres activités. D'où cette « réponse du berger à la bergère » que je formule : le milieu veut-il vraiment une réforme et laquelle ?

En effet, l'exercice est virtuel. Tout le monde est défavorable au texte et, pour le diviser, il faudrait adopter des amendements de suppression de la partie relative aux chambres de commerce et d'industrie.

Le Gouvernement n'est pas sérieux : deux personnes se réunissent un soir à l'Elysée et décident d'un texte pour fusionner toutes les chambres de commerce et d'industrie d'Ile de France !

Je suis favorable à ce qui a été fait pour les chambres de métiers et de l'artisanat.
L'amendement n° 1 est adopté.
Article 4

L'amendement n° 2 rappelle ce qui devrait être une évidence : lorsque des agents d'une chambre régionale sont mis à disposition d'une chambre territoriale, la dépense est obligatoire pour celle-ci.

Cet amendement est la réponse au constat présenté par notre collègue Eric Doligé tout à l'heure.

C'est un amendement de cohérence, même si cela n'a aucun sens que le salarié, devenu régional, soit immédiatement mis à disposition de l'échelon territorial.

Le dispositif manque en effet de cohérence !
L'amendement n° 2 est adopté.
Article 6

L'amendement n° 3, relatif à la publicité et à la transmission à la tutelle des documents comptables, est de cohérence.
L'amendement n° 3 est adopté.
Article 7 ter

L'amendement n° 4 clarifie l'utilisation de la ressource fiscale, en précisant qu'elle doit être mobilisée dans le cadre des missions du réseau, suivant les règles de concurrence nationales et communautaires, et à l'exclusion du financement des activités marchandes.

Provenant du projet de loi de finances pour 2010, l'amendement n° 5 vise à conditionner le droit, ouvert à partir de 2013, de majorer de 1 % le taux appliqué à la part foncière de la taxe additionnelle à la conclusion d'une convention d'objectifs et de moyens entre les chambres régionales et l'Etat.
L'amendement n° 5 est adopté.
L'amendement n° 6 complète le rapport demandé au Gouvernement par un bilan de l'activité du fonds de financement des CCIR.
L'amendement n° 6 est adopté.
L'amendement n° 7 dispose que le « jaune PME » donnera, comme l'avait souhaité notre collègue Eric Doligé lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2008, une présentation détaillée des organismes consulaires, des centres techniques industriels et des comités professionnels de développement économique.
L'amendement n° 7 est adopté.
Article 10
L'amendement de cohérence n° 8 est adopté.
Article 10 bis

L'amendement n° 9 est le symétrique pour les chambres de métiers et de l'artisanat de l'amendement n° 4 pour les chambres de commerce et d'industrie.
L'amendement n° 9 est adopté.
L'amendement n° 10 procède de la même logique.
L'amendement n° 10 est adopté.
Article 18

L'amendement n° 11 est de coordination avec l'amendement n° 2.
L'amendement n° 11 est adopté.
Article 19

L'amendement n° 12 est de précision.
L'amendement n° 12 est adopté.
A l'issue de ce débat, la commission émet un avis très réservé sur les dispositions du projet de loi relatives au réseau des chambres de commerce et d'industrie (articles 1er A à 7 quater et 18) et favorable aux dispositions concernant les chambres de métiers et de l'artisanat (articles 8 à 10 sexies et 19). Elle s'en remet à la décision de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, saisie au fond, et lui soumet les amendements portant sur les aspects fiscaux et financiers qu'elle a adoptés.

Notre collègue Charles Guené est prêt à rapporter la proposition de loi de M. Yvon Collin et des membres du groupe du RDSE. relative à la taxation de certaines transactions financières.
M. Charles Guené est désigné comme rapporteur de la proposition de loi n° 285 (2009-2010) de M. Yvon Collin et les membres du groupe du Rassemblement démocratique et social européen relative à la taxation de certaines transactions financières.