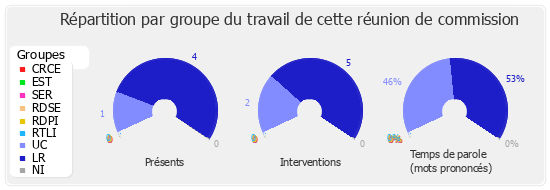Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale
Réunion du 27 novembre 2012 : 1ère réunion
Sommaire
- Loi de finances pour 2013
- Mission « direction de l'action du gouvernement » programme « coordination du travail gouvernemental et budget annexe « publications officielles et information administrative » - examen du rapport pour avis (voir le dossier)
- Mission « direction de l'action du gouvernement » programme « protection des droits et libertés » - examen du rapport pour avis (voir le dossier)
La réunion
La commission examine tout d'abord le rapport pour avis de M. Alain Anziani sur le projet de loi de finances pour 2013, mission « Direction de l'action du Gouvernement », programme « Coordination du travail gouvernemental », et budget annexe « Publications officielles et information administrative ».

La réunion d'aujourd'hui et celle de demain sont consacrées à l'examen de dix avis budgétaires. Je vous propose de consacrer environ quarante cinq minutes à chaque rapport afin que nous terminions notre réunion d'aujourd'hui à dix-huit heures trente au plus tard.

Mon avis porte sur le programme « Coordination du travail gouvernemental » de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » et sur le budget annexe « Publications officielles et information administrative » au sein du projet de loi de finances pour 2013. Pour mémoire, cette mission est constituée de trois programmes : celui qui fait l'objet de mon rapport, le programme « Protection des droits et libertés » dont notre collègue Virginie Klès est rapporteur et le programme « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées ».
Les crédits affectés à la mission, après le vote de l'Assemblée nationale, sont en hausse de 14,43 % en autorisations d'engagement et de 6,77 % en crédits de paiement. Au sein de la mission « Direction de l'action du Gouvernement », il y a deux grandes masses, le programme « Coordination du travail gouvernemental » et le programme « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées », qui représentent chacun environ 46 % des crédits, et le programme « Protection des droits et libertés » qui ne représente que 7 % des crédits.
Huit actions composent le programme « Coordination du travail gouvernemental ». Parmi elles, trois actions regroupent 70 % des crédits : celle relative au secrétariat général des affaires européennes, celle relative au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et, enfin, celle relative aux moyens des services du Premier ministre : le secrétariat général du Gouvernement, le service d'information du Gouvernement, les cabinets du Premier ministre, du ministre des relations avec le Parlement et du ministre porte-parole du Gouvernement ainsi que divers autres organismes. Ces trois actions connaissent une augmentation de leurs crédits tandis les cinq autres sont globalement en baisse, à l'exception de celle concernant l'ordre de la Légion d'honneur.
En 2012, on a assisté à une rationalisation du programme dont on peut se féliciter. Son périmètre a en effet été modifié : d'une part, les crédits affectés aux emplois déconcentrés sont déplacés au sein du programme « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées » et, d'autre part, le programme intègre, à partir de 2013, les crédits affectés à l'ancienne direction générale de la modernisation de l'Etat. En effet, par décret du 30 octobre 2012, la DGME a été intégrée dans le nouveau secrétariat général pour la modernisation de l'action publique placé auprès du Premier ministre. En d'autres termes, tout ce qui est lié à la modernisation de l'Etat ne dépend plus de Bercy mais directement du Premier ministre.
Je souhaiterais maintenant aborder un sujet plus parlant : la volonté de sobriété annoncée par le Gouvernement et qui trouve ici sa traduction budgétaire. D'abord la baisse de 30 % de la rémunération du Président de la République et des membres du Gouvernement. Cette décision a fait l'objet d'une polémique : cette diminution, adoptée dans la loi de finances rectificative de juillet 2012, a été censurée par le Conseil constitutionnel le 19 juillet 2012. Les sages ont estimé que cette disposition portait atteinte à la séparation des pouvoirs, le législateur n'étant pas compétent pour adopter ces dispositions qui relèvent du pouvoir exécutif. Cette décision a été à l'origine d'un mouvement d'humeur sur Internet, beaucoup de citoyens ayant eu le sentiment d'avoir été trompés. Or, cette règle a été immédiatement appliquée au Président de la République et aux membres du Gouvernement dès le mois de mai et un décret rétroactif a été publié à la suite de la décision du Conseil constitutionnel, ce qui montre bien que l'engagement du Président de la République a été tenu sans attendre.
Le souhait de sobriété s'étend aux cabinets ministériels, dans le souci de limiter le nombre de leurs membres. Le Premier ministre a fixé à quinze l'effectif maximum des cabinets pour les ministres de plein exercice contre vingt auparavant et à dix pour les ministres délégués contre douze dans l'ancienne législature. Cette règle a conduit à une diminution de l'effectif des cabinets ministériels de 12 % par rapport à la moyenne de la période 2007-2011. L'annexe budgétaire consacrée à l'effectif des cabinets ministériels est désormais rétrospective et plus détaillée.
Le plafonnement de l'effectif est complété par le plafonnement de la rémunération des membres des cabinets, qui est contrôlé par le secrétariat général du Gouvernement, et par une réduction de 10 % des crédits de fonctionnement des cabinets ministériels.
On constate également un souci de déontologie. Les membres du Gouvernement ont signé une charte de déontologie le 17 mai 2012, par laquelle ils s'engagent notamment à renoncer à leurs mandats exécutifs locaux, à ne pas intervenir en faveur d'un proche et à ne pas accepter d'invitation à un voyage privé émanant d'une personne en relation avec le ministère. Aucune obligation juridique n'est attachée à cette charte, il s'agit d'une régulation d'ordre politique. Cette vision déontologique a été élargie aux membres des cabinets qui doivent signer une déclaration d'intérêts, respecter un devoir de réserve et se déporter des dossiers dans lesquels ils sont impliqués.
J'en viens enfin à un point délicat, la communication gouvernementale. En 2011, le rapport de la Cour des comptes consacré aux dépenses de communication du Gouvernement a suscité beaucoup de polémiques. A la demande du nouveau Premier ministre, la Cour des comptes a rendu un nouveau rapport sur cette question en septembre 2012 dans lequel elle réitère ses propositions. Ainsi, la Cour préconise le renforcement du processus d'achat, avec plus de transparence des procédures. Par ailleurs, elle propose une plus grande mutualisation des dépenses de communication sous l'égide du service d'information du Gouvernement. C'est effectivement souhaitable mais tout ne peut pas être centralisé en la matière. Une marge de manoeuvre doit être laissée à chaque ministère pour mettre en place sa politique de communication. Dans la loi de finances pour 2012, les crédits de communication du service d'information du Gouvernement s'élevaient à 19 millions d'euros, montant revu à 16 millions d'euros en cours d'année. Dans le projet de loi de finances pour 2013, ces crédits s'élèvent à 15 millions d'euros.
Enfin, le travail de codification se poursuit, avec notamment la création de nouveaux codes nécessaires pour l'accès des citoyens au droit.
Au vu de ces observations, je vous propose de donner un avis favorable à ces crédits.

Je me félicite de l'effort de tous les échelons de l'Etat pour parvenir à une gestion modeste, raisonnable et transparente des deniers publics. Il faut toutefois résister à toute forme de démagogie : ce n'est pas en diminuant les rémunérations que les droits des citoyens seront mieux garantis.
Quels sont les moyens financiers alloués aux anciens Premiers ministres ? Ces derniers bénéficient en effet de véhicules et de services de sécurité qui sont permanents. Lorsque j'étais député, la commission des finances de l'Assemblée nationale m'avait répondu que la diffusion d'informations sur ces moyens pouvait mettre en danger ces personnes. Je me permets d'en douter ! Je m'interroge sur l'opportunité de conserver ces règles, au moins de façon permanente.

A l'époque de l'ancien Gouvernement, une direction chargée de la RGPP relevait de M. Baroin...

Qu'en est-il de la modernisation et de l'optimisation de l'action publique ?

Sur l'action du Gouvernement relative à la codification, je n'émettrai aucune réserve car il s'agit d'un excellent projet.
Toutefois, il ne faut pas tomber dans l'inflation des codes afin d'éviter tout chevauchement de ces derniers. Notre Etat de droit sera renforcé le jour où l'ensemble des dispositions réglementaire et législatives seront codifiées.

Pour répondre à Gaëtan Gorce, je ne dispose d'aucun élément de réponse sur les moyens éventuellement affectés aux anciens Premiers ministres mais ils peuvent effectivement relever de ce programme. C'est une question que je peux aborder dans le prochain avis budgétaire.
S'agissant des crédits de l'ancienne DGME, je rappelle que les crédits qui lui étaient affectés ont rejoint le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique. Alors que la DGME était rattachée à Bercy, le nouveau secrétariat général créé par un décret du 30 octobre 2012 est placé auprès du Premier ministre, avec un comité interministériel à la modernisation de l'action publique. Nous ne disposons pas du recul suffisant pour établir un premier bilan de l'action de cette nouvelle structure.
Neuf nouveaux codes devraient être prochainement créés ou refondus à droit constant, notamment le code de la consommation, celui de l'éducation ou encore le code général de la fonction publique.
La commission émet un avis favorable à l'adoption des crédits consacrés au programme « Coordination du travail gouvernemental » de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » et des crédits du budget annexe « Publications officielles et information administrative » du projet de loi de finances pour 2013.
Puis la commission examine le rapport pour avis de Mme Virginie Klès sur le projet de loi de finances pour 2013, mission « Direction de l'action du Gouvernement », programme « Protection des droits et libertés ».

Je rappelle que ce programme correspond au budget des autorités administratives indépendantes (AAI). Je ne ferai pas de remarque particulière sur le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), la fusion de cette AAI avec l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) étant en débat, pour me concentrer sur les budgets des autres AAI en charge des libertés publiques. Je tiens à souligner la qualité des réponses et des échanges tant avec les AAI qu'avec les services du Premier ministre.
Les AAI présentent une grande diversité de missions et de moyens humains et matériels. La plupart des crédits (90 % environ) sont alloués au CSA, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et au Défenseur des droits. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) bénéficie de la majeure partie des 10% restants. La ventilation des crédits entre les actions du programme est stable par rapport à la LFI 2012.
La création d'un programme budgétaire spécifique pour le Défenseur des droits, parfois évoquée, ne m'apparaît plus nécessaire aujourd'hui. Elle n'est pas non plus souhaitée par le Défenseur lui-même, car elle aurait pour conséquence un transfert de certaines missions du secrétariat général du Gouvernement, actuel responsable de programme, vers le Défenseur.
Les objectifs et indicateurs de la mission pourraient être améliorés. Ainsi, pour la commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH), le sous-indicateur qui prend en compte le nombre d'avis rendus n'a pas beaucoup de sens dans la mesure où la CNCDH rend l'essentiel de ses avis par autosaisine et non à la suite d'une saisine par le Gouvernement.
L'indépendance des AAI, préoccupation particulièrement forte en ce qui concerne le Défenseur des droits, ne fait pas l'objet de remises en cause. La nouvelle charte budgétaire organisant le dialogue de gestion entre le SGG et les AAI garantit d'ailleurs cette indépendance.
Les crédits attribués sont en diminution de 1,76 % pour les autorisations d'engagement et de 1,88 % pour les crédits de paiement. Il n'y a là rien de choquant, les AAI étant soumises à la même contrainte que l'ensemble des pouvoirs publics. En revanche, certaines AAI doivent faire plus d'efforts que d'autres car l'augmentation des moyens est ciblée sur elles.
Les plafonds d'emplois n'évoluent pas sensiblement, sauf pour la CNIL qui bénéficie de 10 ETPT supplémentaires cette année sur les 40 qu'elle avait demandés sur trois ans pour faire face à ses nouvelles missions. Il conviendra de faire le bilan de cette augmentation en 2013 et d'en tirer les conséquences qui s'imposent, soit en termes d'effectifs, soit en termes d'étendue des missions.
Le CGLPL doit, quant à lui, bénéficier d'un poste de secrétariat supplémentaire, qui viendra fort légitimement s'ajouter à l'unique poste existant. Cette AAI connaît une forte baisse de ses crédits de fonctionnement : - 4%, soit 170 000 euros environ, ce qui nous semble inacceptable compte tenu des déplacements que le Contrôleur général doit pouvoir continuer à faire, notamment outre-mer, ainsi que dans les hôpitaux psychiatriques. Je tenais à souligner que la gestion du CGLPL est remarquable, en particulier par son choix de localisation immobilière. Je vous proposerai donc un amendement pour relever le montant des crédits au niveau de 2012 en les prélevant, avec son accord, sur le programme « Coordination du travail gouvernemental » que vient de nous présenter notre collègue Alain Anziani.
Au niveau global, les statuts des personnels des AAI revêtent une grande diversité entre AAI et en leur sein même : contractuels, fonctionnaires mis à disposition, fonctionnaires de catégorie A+ ou A... Cette diversité des statuts fait écho à celle des missions.
En matière de gestion immobilière, la situation est très disparate. Il est question de regrouper l'ensemble des AAI sur le site de Ségur-Fontenoy. La partie Ségur accueillerait ainsi les services du Premier ministre et le site de Fontenoy ceux des AAI, avec des contrôles de sécurité de niveau différent mais la possibilité de circuler d'une partie à l'autre. Ce regroupement est, en particulier, une demande forte du Défenseur des droits, dont les services sont actuellement dispersés. Il permettrait également à de petites AAI de libérer des immeubles domaniaux en vue d'une autre affectation ou d'une cession. Par ailleurs, nous avons attiré l'attention de la direction des services administratifs et financiers (DSAF) sur la nécessité de responsabiliser chaque AAI sur ses consommations d'énergie et de s'assurer que le regroupement débouche bien sur des économies réelles.
Dernier point noir que je souhaitais évoquer : la livraison du projet Ségur-Fontenoy est annoncée pour 2016, ce qui me semble irréaliste, au vu de l'état actuel des lieux que j'ai visités et des délais prévisibles de procédure.
Le regroupement aura pour avantage de favoriser la formation d'une culture commune au sein du Défenseur des droits, alors que les pratiques des AAI préexistantes étaient parfois divergentes : ainsi, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) portait volontiers les affaires en justice tandis que le Médiateur de la République favorisait les règlements amiables...
L'instauration des 400 délégués territoriaux mutualisés du Défenseur des droits, sur l'ensemble du territoire national, constitue également un aspect positif.
Une question a été soulevée lors des auditions : faut-il donner au Défenseur la personnalité juridique ? Je ne le pense pas car ce ne serait pas forcément à son avantage.
Pour améliorer le fonctionnement des services du Défenseur, il faudrait garantir la confidentialité des documents d'instruction nécessaires au traitement, par le Défenseur des droits, des réclamations. Il conviendrait également de renforcer le pouvoir en équité. Ces suggestions pourraient être examinées lors d'un véhicule législatif approprié.

Toutes ces AAI sont implantées à Paris. N'a-t-il jamais été envisagé de délocaliser ces AAI à Roubaix, Bourges, Orléans ou encore Poitiers, où elle serait tout aussi indépendante ? C'est aussi une question d'aménagement du territoire.

C'est une réflexion qu'il faut avoir. Il faudrait cependant que les loyers moins élevés compensent les désavantages de l'éclatement et des coûts de transport par exemple.
Comme annoncé, mon amendement tend à récupérer, pour le présent programme et au bénéfice du CGLPL, un montant de 164 117 euros du programme « Coordination du travail gouvernemental », sur l'action qui porte le même nom.

En ma qualité de rapporteur pour avis du programme « Coordination du travail gouvernemental », j'y suis favorable.
La commission émet un avis favorable à l'adoption des crédits consacrés au programme « Protection des droits et libertés » de la mission « Direction de l'action du Gouvernement », et adopte l'amendement proposé par Mme Virginie Klès, rapporteur.
Puis la commission examine le rapport pour avis de M. André Reichardt sur le projet de loi de finances pour 2013, mission « Conseil et contrôle de l'Etat», programme « Cour des comptes et autres juridictions financières».

Pour la deuxième année, les crédits du programme 164, « Cour des comptes et autres juridictions financières », de la mission « Conseil et contrôle de l'État » font l'objet d'un rapport pour avis de la commission des lois.
Cette année, je tiens à relever la nouvelle structuration du programme en sept actions (contre quatre précédemment) et la refonte importante des objectifs et indicateurs de performance, qui permettront, pour l'avenir, de mieux refléter la réalité de l'activité des juridictions financières. Cette modification tient compte des observations que j'avais formulées à destination de la Cour des comptes dans mon rapport de l'an dernier.
Ce budget est marqué par une continuité et une stabilité puisqu'il n'affiche qu'une progression limitée de 2,6 % en autorisations d'engagement et 2,1 % en crédits de paiement. Il s'inscrit, en effet, dans le cadre de la programmation triennale 2011-2013, qui impose aux juridictions financières d'assumer leurs missions avec une enveloppe budgétaire globale constante.
Les crédits du programme 164 présentent la particularité d'une forte concentration en dépenses de personnel. Elles représentent 87 % du total des dépenses, ce qui ne laisse que peu de marges de manoeuvre pour le reste...
Quant au plafond d'emplois, il reste stable, à 1 840 ETPT.
J'ai pu constater en rencontrant les représentants de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes que le montant de ces crédits permet aux juridictions financières d'assumer leurs missions actuelles dans des conditions globalement satisfaisantes.
J'avais eu l'occasion de le dire l'an dernier, je le redis cette année, cette situation est fragile, et pourrait se trouver altérée par la multiplication des missions confiées aux juridictions financières.
C'est pourquoi, des gains d'efficience ont d'ores et déjà été recherchés, pour leur permettre de faire face à ces évolutions.
Après l'échec de la réforme globale portée par l'ancien premier président de la Cour des comptes, Philippe Séguin, en 2009, un certain nombre de dispositions touchant aux juridictions financières ont été introduites dans différents textes, en particulier dans la récente loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allégement de certaines procédures juridictionnelles, qui était en discussion l'an dernier à la même époque.
Cette loi a notamment prévu le regroupement des chambres régionales des comptes. Leur nombre, que nous ne connaissions pas l'an dernier, a été fixé à vingt pour la métropole et les régions d'outre-mer (contre vingt-sept par le passé).
Selon M. Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes, entendu par la commission des lois le 17 octobre 2012, ces regroupements étaient rendus nécessaires pour permettre à chaque chambre régionale des comptes (CRC) d'atteindre une taille critique, en magistrats et en personnel de contrôle, pour être le plus efficace et le plus opérationnel possible dans l'exercice de ses missions.
Comme cela avait été prévu, les regroupements ont été réalisés à moyens constants en personnels et en crédits. Ils s'achèveront dans le courant de l'année 2013 et ont été évalués par la Cour des comptes à 12 millions d'euros au total (6 millions pour les dépenses de personnel et 6 millions pour les autres dépenses, principalement immobilières).
Il convient de relever, voire de regretter, le choix par décret des implantations des chambres régionales des comptes regroupées. Il soulève parfois quelques interrogations...
Que penser par exemple du choix d'Épinal, ville excentrée dans le ressort, comme siège de la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine ?
Quant aux nouveaux ressorts définis, ils sont parfois très étendus. Par exemple, pour la chambre régionale des comptes Auvergne, Rhône-Alpes, la distance à parcourir en partant de Lyon pour rejoindre Aurillac (à l'ouest) représente 288 km (soit 4 h de trajet) et pour aller à Thonon-les-Bains (à l'est), 194 km (2 h 22) de trajet.
Cet éloignement des chambres régionales est aussi le fait du relèvement du seuil de l'apurement administratif, qui les décharge de 67 % des comptes qu'elles avaient à contrôler sur les services de la DGFiP, même si elles resteront compétentes, comme auparavant, pour contrôler 80 % de la masse financière.
Lors de l'audition de M. Didier Migaud, le 17 octobre dernier, vous aviez d'ailleurs été nombreux à vous inquiéter de cet éloignement des chambres régionales des comptes, qui risquait de faire disparaitre « le dialogue vertueux » qui s'était mis en place, au fil des années, entre les collectivités territoriales et les juridictions financières.
M. Didier Migaud, a tenté de dissiper ces craintes. Cette réforme permet aux CRC de se recentrer sur les enjeux les plus lourds. Il a rappelé qu'elles garderont la possibilité d'appeler le compte d'une petite commune soumise à l'apurement administratif, pour qu'aucune collectivité locale, ni aucun établissement public ne puisse se sentir hors du champ de contrôle des juridictions.
Quant au contrôle de gestion, il demeurera assuré par les CRC, quelle que soit la taille de la collectivité, puisque les comptes seront toujours transmis à la CRC, seule compétente pour décider la mise en débet.
Pour les années à venir, il conviendra d'étudier avec attention les effets de cette réforme sur les plus petites collectivités, qui ne seront plus contrôlées par les CRC, mais aussi l'impact de ces transferts importants sur l'activité des CRC et sur l'activité des directions régionales des finances publiques (DRFiP), alors même qu'elles font l'objet de profondes restructurations.
Enfin, toujours dans le cadre du renforcement de l'efficacité des juridictions financières, la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 a modifié le régime de responsabilité du comptable public.
Désormais, lorsque la méconnaissance des obligations du comptable n'aura causé aucun préjudice à l'organisme public, le juge des comptes pourra le condamner au versement d'une somme dont le ministre ne pourra plus faire remise. En cas de préjudice causé, le comptable sera, comme précédemment, constitué en débet et le ministre ne pourra plus consentir une remise gracieuse intégrale. La remise devra se traduire par un « laissé à charge » qui ne pourra être inférieur à un montant plancher, déterminé par décret.
Or, un an après l'entrée en vigueur de la loi, aucun bilan de l'efficacité de cette réforme ne peut être dressé, car les textes d'application n'ont pas été pris. Votre rapporteur souhaiterait avoir l'explication de ce retard de calendrier.
Quant à la responsabilité des ordonnateurs, la réforme est en suspens. Je m'interroge concernant l'avancement de ce chantier, tout aussi important que la réforme de la responsabilité des comptables publics.
Pour l'avenir, il faut craindre que l'extension continue des compétences des juridictions financières pose la question de l'insuffisance de leurs moyens.
Dans le discours qu'il a prononcé le 7 septembre 2012, à l'occasion d'une séance solennelle à la Cour des comptes, le Président de la République a fait part de son intérêt pour une démarche d'expérimentation, sur la base du volontariat, de la certification des comptes des collectivités territoriales.
La Cour des comptes s'est dite prête à expérimenter un tel dispositif, pour les collectivités faisant appel à la souscription publique. Elle ne voit pas l'intérêt de le généraliser à l'ensemble des collectivités territoriales.
Les personnes que j'ai rencontrées sur le terrain, comme M. Pierre Rocca, président de la CRC d'Orléans, ont attiré mon attention sur le fait que la certification est « gourmande » en ressources humaines.
Si elle était confiée aux CRC, elles craignent que les personnels n'aient pas les moyens suffisants pour assurer cette nouvelle mission et qu'elle soit réalisée au détriment des autres compétences des juridictions.
Je souhaiterais demander au Premier ministre de bien vouloir dresser un état des lieux de ce projet d'expérimentation, et de procéder à une évaluation des effectifs nécessaires à sa mise en oeuvre, pour s'assurer qu'elle n'empiétera pas sur les missions « traditionnelles » des juridictions.
À cela s'ajoute le renforcement des missions d'assistance de la Cour des comptes au Parlement et au Gouvernement, extrêmement chronophages...
En conclusion, au bénéfice de l'ensemble de ces observations, et après les quelques réserves que je viens d'exprimer, je vous propose, comme l'an dernier, de donner un avis favorable à l'adoption des crédits du présent programme.

Les réserves qu'a pu susciter le regroupement des juridictions financières ne sont pas levées : la réduction du contrôle des chambres régionales des comptes est insuffisamment compensée par celui confié aux directions des finances publiques qui l'exercent peu ou mal. Je rappelle que le Sénat s'est opposé à cette réforme.
La commission émet un avis favorable à l'adoption des crédits consacrés au programme « Cour des comptes et autres juridictions financières » de la mission «Conseil et contrôle de l'État».
La commission examine ensuite le rapport pour avis de M. Michel Delebarre sur le projet de loi de finances pour 2013, mission « Pouvoirs publics».

Les dotations des pouvoirs publics ont pour point commun de participer à l'effort de maîtrise de la dépense. En effet, à l'exception des moyens financiers destinés à la Cour de justice de la République, les autres dotations sont soit diminuées, soit reconduites en euros courants.
Les crédits de la présidence de la République se caractérisent par une volonté d'exemplarité. L'effort de transparence et de rigueur déjà engagé sous la mandature précédente marque un nouveau progrès avec l'accès de M. François Hollande à la présidence de la République. Depuis 2009, il convient de le rappeler, les comptes et la gestion de la présidence de la République font l'objet d'un contrôle annuel par la Cour des comptes. Les dépenses de fonctionnement baissent de 7,39 % par rapport à 2012, évolution qui résulte de la conjonction de trois facteurs :
- d'abord la diminution des charges liées aux approvisionnements, en raison notamment de la baisse de 20 % de la flotte de véhicules de la présidence ;
- la baisse du montant des prestations extérieures grâce aux économies obtenues sur divers contrats de maintenance ;
- enfin, la réduction des dépenses liées aux « autres services extérieurs » avec des mesures d'économies portant sur les cadeaux diplomatiques, les dépenses d'affranchissement ainsi que la suppression de la dotation consacrée aux conseils, études et sondages.
Les déplacements présidentiels sont caractérisés par la réduction de l'effectif des délégations et des économies de transport. L'A330 est moins systématiquement utilisé, le Président de la République utilisant le train lorsque ce mode de transport est plus adapté. Les charges de personnels se contractent grâce à une baisse des rémunérations, car le traitement du Président de la République est diminué de 30 % et constitue un plafond à partir duquel a été élaborée une grille dégressive pour les membres du cabinet, soit une économie de 1 million d'euros en année pleine.
J'en viens au budget des assemblées parlementaires dont l'effort de rigueur s'inscrit dans la durée. En effet, les deux assemblées ont reconduit leur demande de crédits en euros courants votée l'an prochain et consolidé ainsi la diminution de 3 % des crédits décidée en 2012 à la suite du vote à l'Assemblée nationale et au Sénat d'un amendement concernant leur budget respectif.
S'agissant de l'Assemblée nationale, la dotation demandée, soit 517,8 millions d'euros, ne couvre pas la totalité des dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissement rendant nécessaire un prélèvement sur les disponibilités de l'Assemblée évalué à 16,1 millions d'euros. Les charges parlementaires baissent globalement de 5,21 %, deux postes de dépenses augmentant néanmoins, à savoir les coûts pour frais de voyages et déplacements en raison de l'accroissement du nombre de députés et les charges de représentation de l'Assemblée nationale compte tenu de la reprise de l'activité parlementaire.
La dotation destinée au Sénat dans le projet de loi de finances pour 2013 s'élève à 311,5 millions d'euros, soit un gel en euros courants. A ce montant s'ajoute un montant sur ressources propres de 12,4 millions d'euros. Je ne reviens pas sur le gel en euros courants des indemnités parlementaires, de l'indemnité de résidence et des indemnités de fonction. J'indique seulement ici qu'en matière d'investissement trois priorités ont été définies concernant la poursuite des opérations de modernisation technique et de mise aux normes ainsi que le réexamen d'aménagements des immeubles du 77 rue Bonaparte et du 64 boulevard Saint-Michel.
Un mot sur les chaînes parlementaires pour relever que les crédits de « La chaîne parlementaire - Assemblée nationale » baissent de 3,1 % tandis que ceux réservés à la chaîne Public Sénat sont reconduits.
La dotation du Conseil constitutionnel s'élève en 2013 à 10,8 millions d'euros, soit une diminution de 1 % par rapport à 2012. Les dépenses de fonctionnement se caractérisent par le gel du traitement des membres du Conseil et la stabilité des effectifs. Les dépenses de travaux sont, quant à elles, liées à la poursuite du chantier de rénovation des locaux et des équipements du Conseil constitutionnel : la restauration de la salle des délibérés et la remise aux normes de l'entresol.
Je conclurai par la présentation de la dotation réservée à la Cour de justice de la République qui intègre le coût lié à la tenue éventuelle d'un procès, ce qui ne préjuge cependant en rien de l'issue de l'une ou l'autre des deux affaires en cours d'instruction. Comme l'an passé, j'observe que le loyer de la Cour de justice -485 000 euros en 2012- continue de peser de manière excessive sur le budget de cette institution. Dans l'attente de son installation, à l'horizon 2017, dans les locaux laissés vacants par le tribunal de grande instance de Paris, la Cour de justice de la République se trouve dans une situation immobilière précaire. En effet, le bail du 15 mars 2004 est arrivé à échéance le 29 février 2012. A ce jour la procédure de renouvellement est toujours en cours.
Au bénéfice de ces observations, je vous invite à donner un avis favorable aux crédits de la mission « Pouvoirs publics ».

Je vous indique que pour la première fois, la Cour de justice de la République sera présidée par une femme, Mme Martine Ract-Madoux.

On ne peut que se féliciter des économies annoncées. Je m'interroge toutefois sur le complexe républicain qui inspire certaines mesures à la portée toute symbolique comme la limitation aux secondes classes pour les déplacements. S'agissant des voyages en train du Président de la République, le coût est-il toujours maîtrisé lorsqu'un avion doit être affrété simultanément ?

A l'issue de votre rapport, on ne peut douter de l'utilité d'examiner les crédits des pouvoirs publics -dont le gel, s'agissant des sommets de l'Etat, ne doit pas étonner !
En revanche, je doute que le travail d'une institution s'améliore lorsqu'on réduit les moyens dont disposent ses collaborateurs. La modestie budgétaire se suffit à elle-même et n'a nul besoin d'être ostentatoire.
Pouvez-vous nous rappeler la rémunération des membres du Conseil constitutionnel ?

Nombre des mesures que vous nous avez annoncées, du contrôle de la cour des comptes au gel des crédits, ont été engagées sous la précédente législature.
Une précision. La rémunération du Président de la République constitue-t-elle un plafond pour tous les fonctionnaires affectés à l'Elysée ?
Inclut-on dans le coût des déplacements en train du Président de la République celui de la sécurisation de toutes les intersections jalonnant le parcours emprunté ?

La limitation des déplacements en seconde classe n'est qu'une mesure symbolique. L'affrètement d'un avion simultanément à un déplacement en train du Président de la République n'a rien de systématique et dépend avant tout de la longueur du trajet.
Le Conseil constitutionnel s'est engagé, sous l'impulsion de son président, dans un programme de réduction de ses moyens. Les rémunérations versées à l'ensemble des membres de la Haute instance s'élèvent à 1,248 million d'euros.
Seuls les collaborateurs du Président de la République sont soumis au plafonnement de leurs rémunérations en fonction du salaire qui lui est versé.
La commission émet un avis favorable à l'adoption des crédits consacrés à la mission « Pouvoirs publics ».
Enfin, la commission examine le rapport pour avis de M. Yves Détraigne sur le projet de loi de finances pour 2013, mission « Conseil et contrôle de l'Etat », programme « Conseil d'Etat et autres juridictions administratives ».

Le présent avis porte sur les crédits du programme 165 « Conseil d'État et autres juridictions administratives », de la mission « Conseil et contrôle de l'État ».
Le périmètre de ce programme comprend les moyens affectés au Conseil d'État, aux huit cours administratives d'appel, aux quarante-deux tribunaux administratifs et, depuis le 1er janvier 2009, à la Cour nationale du droit d'asile.
Dans un contexte budgétaire contraint, pour permettre le redressement des finances publiques, alors que les dépenses de l'État sont globalement stabilisées en valeur, ce programme voit ses crédits progresser de 6 % en un an, avec 369,6 millions en crédits de paiement, et ses autorisations d'engagement augmenter de plus de 15 %, principalement en raison du renouvellement du bail des locaux de la Cour nationale du droit d'asile, pour un montant de 33 millions d'euros. Parallèlement, les effectifs augmentent de quarante emplois.
La sanctuarisation des moyens dont bénéficient les juridictions administratives tend à ne pas casser les efforts efficaces des dernières années de réduction des délais de traitement des affaires et du nombre de dossiers en stock.
Cependant, les juridictions administratives seront confrontées, dans les prochains mois au dynamisme confirmé des contentieux traditionnels (+ 6 % en chaque année depuis près de quarante ans), à la poursuite de la montée en puissance des contentieux particuliers (droit au logement opposable ou droit des étrangers), au volume élevé des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC). En effet, en 2011, les tribunaux administratifs ont examiné 554 QPC, les cours administratives d'appel 146 et le Conseil d'État 201.
En dépit des efforts consentis par le Gouvernement, les moyens accordés aux juridictions administratives ne suffiront sans doute pas à absorber la pression contentieuse.
Le vice-président du Conseil d'État, M. Jean-Marc Sauvé l'a exprimé clairement lors de son audition devant notre commission : la création de quarante emplois ne permettra aux juridictions d'absorber que 3 % de hausse du contentieux. Or, nous sommes régulièrement au dessus.
Dès lors, il semble nécessaire de chercher des réponses complémentaires à la réponse budgétaire, pour éviter une dégradation de la situation de la justice administrative.
La première réponse que nous pouvons envisager est une réponse procédurale.
Depuis quelques années, sous l'impulsion du vice-président, M. Jean-Marc Sauvé, un certain nombre de réformes ont été engagées, visant à proportionner le traitement des affaires aux difficultés qu'elles présentent.
Je pense par exemple à la possibilité pour le rapporteur public d'être dispensé, à sa demande, par le président de la formation de jugement d'exposer publiquement ses conclusions à l'audience, en considération de la nature des questions à juger (affaires simples, répétitives...).
Je pense ensuite au jugement de certains litiges par un juge unique, plutôt que par une formation collégiale. Si cet outil a constitué l'un des éléments importants mis en place pour permettre aux juridictions de faire face à l'inflation du contentieux, il semble avoir atteint ses limites. En effet, en 2010 et 2011, le nombre d'ordonnances a connu une baisse sensible et le nombre d'affaires réglées par juge unique, une stabilisation.
Se dessinent alors de nouvelles perspectives fondées sur une limitation de l'intervention du juge aux cas qui le justifient pleinement.
Lors des déplacements que j'ai effectués, dans trois tribunaux administratifs, une cour administrative d'appel et au Conseil d'État, et au cours des auditions que j'ai réalisées, j'ai pu constater, un sentiment d'impuissance des magistrats s'agissant du droit au logement opposable (DALO), pour lequel, le juge ne peut qu'enjoindre l'État, éventuellement sous astreinte, de trouver un logement à la personne déclarée prioritaire. Le juge ne tranche ici aucune question de droit. Il ne règle pas non plus la situation du justiciable, puisqu'il n'est évidemment pas en mesure de lui attribuer un logement. Ce problème se manifeste principalement en Île-de-France, où il y a une véritable pénurie de logements. Il est moins prégnant ailleurs.
Ce sentiment d'impuissance du juge administratif est également présent en matière de droit des étrangers, où le juge peut être saisi de cinq séries de recours pour une même affaire (la contestation du principe même de l'éloignement, l'absence de délai de retour volontaire qui lui est laissé, le choix du pays de sa destination, le bien fondé de son placement en rétention et le prononcé d'une interdiction de retour...). Lorsqu'il annule par exemple, une décision de refus de titre du préfet, cela n'implique pas que l'étranger doive recevoir un titre de séjour, mais que son dossier doit être réexaminé.
Il me semble qu'une réflexion devrait s'engager pour rendre ces procédures plus simples et plus efficaces.
La deuxième réponse réside dans un renforcement de la productivité des juridictions.
L'image, pas toujours très positive, que nous avions des juridictions administratives a radicalement évolué au cours des deux décennies passées. Ces dernières années, des résultats très encourageants ont été obtenus grâce, notamment, à une très forte mobilisation des magistrats et des personnels des juridictions. Cependant, cette productivité semble avoir atteint un seuil qu'il sera difficile de dépasser à l'avenir. Le nombre de dossiers traités par magistrat ou par agent de greffe tend à se stabiliser.
Dès lors, le renforcement de la productivité des juridictions doit passer par d'autres canaux.
Le premier, réside dans la poursuite des efforts engagés par le Conseil d'État en matière de gestion optimale des moyens accordés.
J'ai été vraiment intéressé par les outils de pilotage des juridictions administratives utilisés par le Conseil d'État, notamment la diffusion de tableaux de bords mensuels. Elle permet le suivi de l'activité en temps réel, sur le terrain, par les chefs de juridiction et, au niveau central, par le secrétariat général du Conseil d'État. Ce processus n'est absolument pas vécu comme une contrainte par les juridictions. Il permet de surveiller les flux contentieux, et d'ajuster les moyens en fonction des besoins.
Ce pilotage se caractérise aussi par un dialogue permanent, dans les deux sens, entre le Conseil et les autres juridictions administratives, à travers des « Conférences de gestion » annuelles et des déplacements sur le terrain du vice-président dans chaque juridiction (tous les quatre ans), de la section du contentieux (sur des questions juridiques particulières), du secrétaire général du Conseil d'État...
Enfin, les juridictions administratives ont mis en place une véritable administration électronique.
Les méthodes de travail des magistrats, tout d'abord, en ont été profondément bouleversées. Les outils informatiques ont permis, pour le traitement des contentieux de masse, par exemple, l'utilisation de modèles de décision et d'une banque de paragraphes, une centralisation des jurisprudences, ainsi que l'accès aux ressources documentaires, par la mise en place d'un intranet performant. Cela améliore considérablement la productivité des magistrats.
De plus, la juridiction administrative se livre à une vaste expérimentation de la dématérialisation du poste de travail des magistrats, avec le « travail juridictionnel collaboratif ». Les magistrats utilisent quasi-exclusivement leurs ordinateurs, portables notamment. Tous les magistrats, sans distinction de génération, s'y sont mis. Ce système engendre des économies de papier considérables.
Quant à l'activité juridictionnelle, l'objectif est, à terme, de dématérialiser le cycle complet de traitement d'un dossier du contentieux administratif, de l'enregistrement des recours à la notification des décisions et à l'archivage des dossiers.
Cet effort important de modernisation entrepris par les juridictions administratives, moyennant un investissement technologique initial élevé, devrait générer, à terme, des économies substantielles, en particulier en matière de frais d'affranchissement, d'utilisation de papier et des gains de productivité substantiels.
Cependant, la dématérialisation de la procédure doit demeurer une option, car les justiciables ne sont pas tous égaux en équipement et dans la maîtrise de l'outil informatique. Il faut traiter de la même manière toutes les requêtes.
Voilà les quelques éléments d'information que je voulais vous communiquer.
Pour conclure, le budget « sanctuarisé » proposé pour les juridictions administratives me semble aller dans le bon sens. Je vous propose, par conséquent, que notre commission donne un avis favorable à l'adoption de ces crédits.

Une part de l'inflation du contentieux de l'urbanisme résulte des recours dilatoires, déposés uniquement pour renchérir la valeur des terrains concernés. Ne pourrait-on envisager de les sanctionner ? Des propositions de loi prochainement examinées nous donneraient l'occasion d'y travailler.

Rien n'interdit d'y réfléchir. Des freins aux recours dilatoires existent déjà : le Conseil d'État impose que les associations requérantes en matière d'urbanisme soient constituées depuis au moins un an avant le contentieux.

Cette jurisprudence est insuffisamment appliquée par les tribunaux administratifs.

Quel progrès pour le budget de la justice administrative depuis le temps où le Conseil d'État était rattaché au ministère de la justice, les juridictions administratives à celui de l'Intérieur, et où l'étanchéité était totale entre le premier et les secondes ! On doit saluer le travail accompli à cet égard par l'actuel vice-président du Conseil d'État, M. Jean-Marc Sauvé.
La commission émet un avis favorable à l'adoption des crédits consacrés au programme « Conseil d'État et autres juridictions administratives » de la mission «Conseil et contrôle de l'État ».