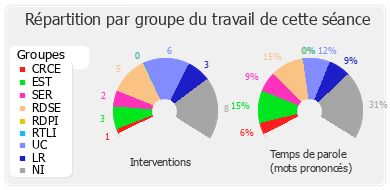Séance en hémicycle du 3 avril 2013 à 14h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement (voir le dossier)
- Adoption définitive en deuxième lecture d'une proposition de loi dans le texte de la commission (voir le dossier)
- Candidatures à un organisme extraparlementaire
- Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi organique et d'un projet de loi
- Droits sanitaires et sociaux des détenus (voir le dossier)
- Nomination de membres d'une commission mixte paritaire (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à quatorze heures trente-cinq.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

L’ordre du jour appelle, à la demande du groupe écologiste, la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte (proposition n° 329, texte de la commission n° 452, rapport n° 451).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.
Madame la présidente, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, nous sommes parvenus à une étape importante de la procédure parlementaire de cette proposition de loi.
À l’automne dernier, lors des débats au Sénat, la nécessité de garantir l’expertise scientifique et de mettre en place des outils adaptés à la gestion des risques émergents avait été reconnue par tous.
La gestion de ces risques est une préoccupation quotidienne des Français.
Le travail des deux chambres sur ce texte a été exemplaire. Je tiens à remercier Marie-Christine Blandin et le rapporteur Ronan Dantec, à saluer l’initiative du groupe écologiste du Sénat et à rendre hommage au travail accompli par l’ensemble des parlementaires qui ont pris part aux débats.
Grâce à vos échanges, la procédure parlementaire a permis d’approfondir le sujet et de résoudre les difficultés faisant obstacle à l’adoption de cette proposition de loi, à savoir la nature et les modalités de fonctionnement de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement, d’une part, l’organisation de l’exercice du droit d’alerte dans l’entreprise, d’autre part.
Un important travail a, en effet, été accompli par le Sénat et l’Assemblée nationale. Loin de dénaturer la proposition de loi et ses objectifs, ce travail a donné au texte un impact plus important grâce à l’adoption d’une approche opérationnelle et pragmatique.
Dorénavant, l’alerte est affirmée, d’emblée, en préambule du texte, comme un droit : c’est un signal important. Les droits des lanceurs d’alerte sont posés. Ces derniers font l’objet d’une véritable protection juridique, aux termes de laquelle nul ne doit pouvoir être inquiété parce qu’il aurait révélé un danger sanitaire ou environnemental.
Le dispositif issu de la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé est étendu à l’ensemble du champ de la santé et de l’environnement.
Les personnes qui sont victimes de discrimination parce qu’elles ont relaté des faits relatifs à des atteintes à la santé publique ou à l’environnement pourront saisir le Défenseur des droits.
La charge de la preuve est également modifiée puisqu’elle incombera désormais à la personne accusée d’avoir pris une mesure discriminatoire, et non au lanceur d’alerte.
Dans le même temps, les devoirs des lanceurs d’alerte sont également fixés. L’information que l’alerte rend publique ou qu’elle diffuse doit exclure tout caractère diffamatoire ou injurieux. Si le lanceur d’alerte est de mauvaise foi ou a l’intention de nuire, il peut être poursuivi pénalement.
Ces limites à l’exercice du droit d’alerte lui donnent toute sa force et sa légitimité.
Par ailleurs, en réponse à certaines inquiétudes formulées au Sénat et à l’Assemblée nationale, les règles relatives à la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement ont aussi été améliorées.
Vous aviez, mesdames, messieurs les sénateurs, pris le parti, en première lecture, d’orienter le texte sur cette formule plutôt que sur celle d’une haute autorité. Le Gouvernement a totalement approuvé cette approche. Cette commission ne sera donc pas une nouvelle entité se substituant aux agences ou aux organismes existants ; elle servira de dispositif d’appui à l’ensemble des acteurs, sera à même de travailler avec eux et de leur apporter rapidement des contributions.
L’exigence initiale d’une indépendance par rapport aux ministères est restée intacte. Cette indépendance sera assurée, d’une part, par la composition de cette instance, laquelle comprendra des représentants de l’État, des parlementaires, des membres du Conseil économique, social et environnemental et des experts, et, d’autre part, par sa possible saisine au-delà des seuls membres du Gouvernement.
La Commission nationale aura pour rôle de généraliser les bonnes pratiques et le « compagnonnage » entre les organismes existants, comme l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES, ou l’Institut national de l’environnement industriel et des risques, l’INERIS.
La volonté a été nettement exprimée de ne pas imposer une nouvelle réglementation, tout en permettant rapidement aux organismes qui sont les moins avancés en matière de déontologie et de qualité de l’expertise de bénéficier de l’expérience de ceux qui sont déjà largement engagés dans ce mouvement.
Cette commission diffusera également les bonnes pratiques d’ouverture à la société civile des organismes publics. C’est un élément clé pour la bonne compréhension de la recherche et de l’expertise, plus nécessaire encore pour les risques émergents et les questions soulevées par les alertes.
Consolider le dialogue entre la société, les chercheurs et les experts aide à l’appropriation par nos citoyens des travaux scientifiques. L’ANSES, l’INERIS et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l’IRSN, ont déjà beaucoup œuvré en ce sens.
La Commission nationale de la déontologie et des alertes se voit aussi confier un rôle général de suivi des alertes. En amont, elle informera les établissements sur les éléments à porter dans les registres des alertes. Sur ce point particulier, la proposition de loi indique bien que ces registres sont du ressort des établissements.
La proposition de loi met en place un dispositif de traçabilité visant à éviter que des alertes ne soient perdues ou ignorées. La Commission nationale transmettra les alertes aux ministères compétents, complétant les dispositifs de prise en compte dans les établissements et sur le terrain.
Les organismes indiqueront dans les registres des alertes les suites qui y sont données, y compris en renvoyant vers des études en cours ou des initiatives déjà prises. De la même façon, les ministres feront connaître les éléments en lien avec les alertes que la Commission nationale peut leur transmettre.
Dans son rapport au Parlement et au Gouvernement, la Commission nationale informera de la mise en œuvre des procédures d’enregistrement des alertes par les organismes. Cela permettra au pouvoir législatif d’avoir une vision globale.
Elle aura une structure légère, comme l’est celle du Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, le HCTISN, sans administration propre, et elle s’appuiera sur une instance déjà existante.
Je propose que cette instance soit le Comité de la prévention et de la précaution, qui agit dans les domaines de l’environnement et de la santé et traite déjà des aspects relatifs tant à l’alerte qu’à la pratique de l’expertise. Créé par un arrêté du 30 juillet 1996, il fait partie de la liste des commissions administratives du ministère prorogées pour une durée de cinq ans par un décret du 6 juin 2009.
Composé à ce jour d’une vingtaine de personnalités scientifiques reconnues pour leurs compétences sur les questions touchant à l’environnement et à la santé, il assure une fonction de veille, d’alerte et d’expertise sur les problèmes sanitaires liés aux perturbations de l’environnement. Il éclaire, par ses avis, les politiques du ministère au regard des principes de prévention et de précaution.
Positionné dans des champs proches de ceux de la nouvelle commission, créé par voie réglementaire, présidé par une personnalité ne représentant pas une structure de l’État, le comité semble donc offrir une première base pertinente.
L’évolution du Comité de la prévention et de la précaution nécessitera, bien sûr, des aménagements réglementaires qui seront mis en œuvre dans les meilleurs délais après l’adoption de la proposition de loi. À l’heure actuelle, les missions confiées ne sont pas les mêmes, les règles de saisine diffèrent, et la composition n’est pas celle qui a été retenue pour la commission. Nous procéderons à ces évolutions par la voie réglementaire.
Par ailleurs, pour assurer le secrétariat de la Commission nationale, je propose l’aide des services existants de mon administration. Je souhaite que cette instance puisse également s’appuyer pour des missions régulières sur les inspections générales concernées par ses sujets.
Le deuxième point principal sur lequel le texte a profondément évolué est le droit d’alerte au sein de l’entreprise.
Lors des débats au Sénat, j’avais indiqué que des négociations sociales portant sur les prérogatives des institutions représentatives du personnel étaient en cours et que cette échéance devait être prise en compte dans les discussions sur la proposition de loi.
Les débats à l’Assemblée nationale sont intervenus peu de temps après l’accord du 11 janvier 2013, obtenu à la suite de ces importantes négociations sur la sécurisation de l’emploi.
Le titre II de la proposition de loi a ainsi pu être complété en toute connaissance de cause. Il est prévu que le droit d’alerte sera reconnu à tout travailleur de toute entreprise, et à chaque représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT, ainsi que, dans les conditions fixées par le code du travail, aux délégués du personnel.
Ce point est important, car, en complément des mesures de protection prévues par le titre III de la proposition de loi, le représentant du personnel bénéficie d’une protection spéciale en cas de licenciement.
Ce droit d’alerte s’exercera en cas de risque grave, et non pour des risques anodins, en cohérence avec les dispositions du code du travail sur la santé au travail.
Une procédure est organisée pour répondre à l’alerte et, surtout, un retour pour information est prévu devant le CHSCT. Ce dispositif améliore de manière significative la transparence du suivi de l’alerte. Il laisse aussi la possibilité, en cas de divergence sur le bien-fondé de l’alerte ou en l’absence de suite de la part de l’employeur, de saisir le représentant de l’État.
Le Gouvernement soutient également l’extension de l’obligation d’information des salariés à la santé publique et à l’environnement, sur un même plan que la santé au travail.
Il est important de rappeler que les missions et attributions des CHSCT n’ont pas été étendues à la santé publique et environnementale. La compétence du CHSCT, c’est bien la santé au travail, la protection de la santé des travailleurs et l’amélioration des conditions de travail. L’étendre à la santé publique et à l’environnement aurait constitué une réforme importante du CHSCT.
Une telle évolution aurait nécessité une modification de ses moyens d’action et n’aurait pu se faire sans que les partenaires sociaux en aient débattu. Or, le Gouvernement considère que c’est à ces derniers de prendre l’initiative de faire évoluer le CHSCT en ayant une vision globale de cette instance. C’est la voie et la méthode que nous avons choisies dans le cadre de la grande conférence sociale de juillet 2012. Il y aura une prochaine étape en juillet 2013, qui sera l’occasion d’examiner la question de la suite à donner à l’évolution du CHSCT.
Vous le voyez, cette proposition de loi est maintenant complète, et de grande qualité. Ce texte constituera un jalon marquant dans le rétablissement de la confiance de nos concitoyens dans les autorités et les procédures d’évaluation des risques.
Il viendra compléter les différents travaux en cours sur la prévention des risques sanitaires environnementaux. Vous le savez, c’est une priorité du Gouvernement, fixée lors de la conférence environnementale.
La France est en pointe sur ce sujet dans le monde et dispose d’une compétence scientifique reconnue, notamment en ce qui concerne les perturbateurs endocriniens.
Vous avez, d’ailleurs, récemment adopté la proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, de l’importation, de l’exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A.
L’élaboration d’une stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens est aussi en cours. Le groupe de travail en charge de sa rédaction réunit de nombreux élus, dont la sénatrice Chantal Jouanno, des représentants des ministères, des agences publiques, des associations, des syndicats de salariés et des fédérations d’entreprises, ainsi que des personnalités qualifiées.
Ce travail aboutira en juin à la présentation d’un plan d’action et de propositions pour avancer sur la définition et l’identification des perturbateurs endocriniens, sur la recherche des risques liés, sur les actions de réduction de ces risques et sur l’information et la sensibilisation du grand public.
Sur le plan européen, je rencontrerai demain le commissaire européen à l’environnement, M. Janez Potočnik, pour lui demander que l’Agence européenne des produits chimiques transmette aux autorités françaises la liste des substances pour lesquelles le dossier d’enregistrement REACH mentionne explicitement une utilisation dans les jouets et articles de puériculture.
La France soutient fermement la position selon laquelle le critère d’activité, qui renvoie à une notion de seuil sans effet, ne peut pas être pris en compte dans la définition des perturbateurs endocriniens.
Le souhait du Gouvernement est donc que cette stratégie nationale puisse incarner une approche française volontariste sur la scène européenne. Cette proposition de loi s’inscrit pleinement dans cette dynamique. Il s’agit maintenant d’entériner la démarche dont vous avez pris l’initiative, mesdames, messieurs les sénateurs. Nous nous engagerons, ensemble, à mettre pleinement en œuvre le progrès qu’incarne cette proposition de loi, pour la prise en compte effective des signaux faibles d’alerte environnementale et sanitaire. §

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, nous voici à nouveau réunis pour examiner, cette fois-ci en deuxième lecture, la proposition de loi relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte, votée par l’Assemblée nationale en première lecture le 31 janvier dernier.
Les députés ont poursuivi le travail de fond que nous avions engagé ici sur ce texte, je le rappelle, d’initiative parlementaire. En reprenant la concertation avec les partenaires sociaux, les différents groupes politiques, les ministères et Matignon, l’Assemblée nationale a abouti à une rédaction qui reflète à la fois un souci d’efficacité et un équilibre politique. C’est pourquoi je n’ai pas jugé utile de déposer de nouveaux amendements. Je formule le souhait, et la commission du développement durable avec moi, que nous adoptions cette proposition de loi dans les mêmes termes que nos collègues députés.
Le travail effectué par les députés répond tout d’abord à un souci de restructuration du texte et de clarification juridique.
En première lecture, nous n’avions pas pu adopter de texte en commission, ce qui ne nous avait pas permis de procéder à tous les aménagements techniques que le texte aurait nécessités. C’est chose faite avec la rédaction qui nous revient de l’Assemblée nationale : la quasi-totalité des articles qui sont encore en discussion le sont du fait de l’adoption d’un nombre important d’amendements de nature rédactionnelle et de ré-ordonnancement du texte.
Les députés ont tout d’abord créé un titre Ier A consacré au droit d’alerte en matière sanitaire et environnementale. Ils y ont placé l’ancien article 8, devenu article 1erA, qui précise les droits et obligations du lanceur d’alerte. Cet article est désormais placé en exergue du texte. Cela lui confère une meilleure lisibilité et marque une volonté politique forte de répondre aux enjeux du repérage et de la protection des lanceurs d’alerte, ce qui était bien la motivation initiale de l’auteur du texte.
Dans le titre Ier, consacré à la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement, les députés ont apporté quelques modifications de forme. Cette commission est maintenant chargée de définir les critères qui fondent la recevabilité d’une alerte. C’est un point important, que nous avons évoqué ce matin en commission, et le texte, dans son nouvel ordonnancement, est dorénavant plus clair.
L’article 1er créé un cadre, mais il reste encore beaucoup de choses à préciser. La Commission nationale aura à faire cet important travail de précision. Par ailleurs, notons que l’Assemblée nationale a prévu, c’est une amélioration majeure, un alinéa aux termes duquel les décisions des ministres compétents concernant la suite donnée aux alertes doivent être dûment motivées et transmises à la commission.
Sur la composition de la commission, les députés ont intégré au texte une obligation de parité – reconnaissons que le Sénat aurait pu y penser. Ils ont également prévu la possibilité de saisine de la commission par les organes nationaux de l’ordre des professions relevant de la santé ou de l’environnement. Voilà encore une amélioration résultant du travail parlementaire.
Enfin, l’Assemblée nationale a complété l’article 5, en précisant les règles applicables en matière de conflits d’intérêts et de secret professionnel, notamment en ce qui concerne les exigences de déclaration publique d’intérêts et la pratique du déport.
Le travail effectué par les députés se situe, vous le voyez, dans le prolongement du nôtre, et complète utilement les dispositions prévues pour l’exercice des missions de la commission de déontologie.
En première lecture, divers orateurs avaient craint la création d’un « machin » supplémentaire. En séance, j’avais indiqué que cette commission serait créée à moyens constants. Madame la ministre, c’est un point important pour la commission, et je prends acte des précisions que vous avez apportées sur ce sujet. Nous partons d’une structure existante, le Comité de la prévention et de la précaution, et je note tout particulièrement vos propos quant à l’évolution de ce comité. Rien ne s’oppose plus à ce que nous avancions maintenant assez rapidement, et nous allons le faire à moyens constants, sans création de structure supplémentaire.
C’est dans le titre II, relatif à l’exercice du droit d’alerte en entreprise, que se trouvent les modifications les plus substantielles au texte que nous avions adopté. La question de l’alerte en entreprise nous avait beaucoup mobilisés, et avait suscité diverses oppositions et discussions. Certains partenaires sociaux s’en étaient émus. La commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a mené de nouvelles concertations, avec les partenaires sociaux et le ministère du travail.
Je vous avais proposé de remplacer les cellules d’alerte initialement prévues par la proposition de loi par une extension des missions des CHSCT, déjà compétents en matière d’alerte interne aux entreprises. Cette solution semblait en effet plus opportune. Elle avait été portée par les syndicats lors des auditions que ma collègue Aline Archimbaud avait menées au nom de la commission des affaires sociales.
Les députés ont conservé ce principe et la même architecture générale pour le titre II. Ils ont cependant allégé l’extension des missions du CHSCT. Il est apparu en effet au rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, après avoir entendu les arguments des partenaires sociaux – syndicats et patronat –, ainsi que ceux du ministère du travail, qu’il était difficile de maintenir l’ensemble du dispositif tel que nous l’avions adopté, notamment du fait des négociations en cours sur la question des institutions représentatives du personnel.
Il est également apparu qu’en l’absence de moyens nouveaux dévolus aux CHSCT, en termes de formation comme de crédits d’heures, il leur serait difficile d’exercer pleinement ces nouvelles prérogatives.
Forte de cette analyse, la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, saisie au fond, alors que c’est la commission du développement durable qui l’est au Sénat, a créé un chapitre spécifique au sein du code du travail pour traiter de la question des alertes en matière de santé publique et d’environnement. L’article 9 regroupe désormais les diverses dispositions relatives au rôle des CHSCT.
L’Assemblée nationale n’a pas souhaité étendre les prérogatives de ce comité pour en faire le gestionnaire de l’alerte dans l’entreprise. Toutefois, je le souligne, elle a conservé une dimension collective à la prise en charge de l’alerte. Un droit d’alerte est ainsi accordé au représentant du personnel dans le CHSCT, et ce dernier doit être informé spécifiquement des alertes lancées et des suites qui leur sont données. Ce nouveau chapitre du code du travail reprend en outre les dispositions essentielles de protection des lanceurs d’alerte contre les discriminations. Il s’agit là encore d’une avancée majeure de ce texte.
Comme nous l’avions voulu, l’alerte conservera donc une dimension collective. Cela va dans le sens d’une nouvelle culture collective du risque, qui est l’une des garanties nécessaires à la mise en œuvre du droit d’alerte.
Les députés ont par ailleurs proposé qu’en cas de litige sur le bien-fondé ou la suite donnée à l’alerte par l’employeur, le travailleur comme le représentant du personnel au CHSCT pourront saisir le préfet. Une culture de l’alerte est bien créée dans l’entreprise, mais la gestion de l’alerte n’est pas gérée en son sein. Si l’entreprise ne réagit pas, le salarié pourra alerter le préfet, et il sera protégé. Si, à son tour, le préfet ne réagit pas, la Commission nationale pourra être saisie par une organisation syndicale et elle interrogera le ministère concerné. Ce dispositif sera moins lourd pour le CHSCT. C’est un compromis constructif qui s’inscrit dans un ensemble cohérent.
Peu de modifications ont été apportées par l’Assemblée nationale sur le troisième et dernier titre, regroupant les mesures encadrant le droit d’alerte, tant pour la protection des lanceurs d’alerte que pour la limitation des éventuels excès.
La protection des lanceurs d’alerte est codifiée à l’article L. 1350-1 du code de la santé publique, en reprenant la protection très large existant dans le domaine des produits de santé depuis la loi dite « Mediator » de décembre 2011. A contrario, les abus seront sanctionnés pénalement, conformément aux règles existantes en matière de dénonciation calomnieuse.
Les députés ont choisi de supprimer la disposition que nous avions introduite à l’article 16 A, concernant la possibilité, pour les institutions représentatives du personnel, de présenter leur avis sur les démarches de responsabilité sociale, environnementale et sociétale de l’entreprise dans le cadre de son rapport de gestion. Certains estimaient qu’il s’agissait d’un cavalier. Le Gouvernement a indiqué son souhait de ne pas voir cette question traitée dans le cadre de cette proposition de loi. Il a rappelé qu’une mission tripartite est chargée de préciser d’ici à juillet 2013 les modalités de développement de cette responsabilité en France. Nous resterons très attentifs à cette question.
La navette parlementaire aura ainsi permis de préciser et d’enrichir le texte initial. Ce travail est d’une actualité brûlante. Voilà quelques jours à peine, les juges en charge de l’instruction de l’affaire du Mediator ont mis en examen l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour homicides et blessures involontaires. Il lui est reproché « d’avoir contribué à créer la situation qui a engendré le dommage des victimes et de n’avoir pas pris les mesures permettant de l’éviter ».
Il est donc plus que jamais nécessaire d’assurer la transparence de l’expertise et de garantir sa déontologie, afin de sécuriser le travail des agences et rétablir la confiance des citoyens.
Lors des auditions que j’ai réalisées dans le cadre de la préparation de mon rapport, les agences ne se disaient pas opposées à la présente proposition de loi. Elles étaient certes soucieuses d’éviter des lourdeurs administratives supplémentaires, mais également parfaitement conscientes que l’existence à leurs côtés d’une commission capable de valider leurs propres règles de déontologie contribuait à les sécuriser.
En offrant un regard extérieur aux divers organismes sanitaires et environnementaux, la Commission nationale les confortera. Elle pourra soutenir et guider les agences en identifiant les bonnes pratiques tant en Europe qu’en France.
Ce texte protégera aussi les lanceurs d’alerte non institutionnels. Même si le risque zéro n’existe pas, les conditions de leur protection seront mieux réunies, et telle était notre responsabilité en présentant cette proposition de loi, pour que les signaux faibles soient repérés à un stade suffisamment précoce et éviter ainsi des catastrophes sanitaires comme celles que nous avons malheureusement connues régulièrement ces dernières décennies.
Par ce travail parlementaire collectif – je tiens, à cet égard, à remercier l’ensemble des parlementaires, de sensibilités politiques très différentes, qui y ont participé –, nous montrons l’importance de notre capacité d’initiative parlementaire. Nous avons fait œuvre utile et participé de la modernisation de la décision publique, qui passe par l’indépendance de l’expertise.
Il y a sur ce texte, je le crois, place pour un consensus. Je vous propose donc de l’adopter par un vote conforme.
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, du groupe socialiste et du groupe CRC.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi est inspirée, à l’évidence, par de bons sentiments. Comme je l’ai dit en première lecture, il faut reconnaître ce mérite au rapporteur. Mes compliments s’arrêteront là.

En effet, le texte n’apporte que des réponses fragmentaires à des questions de grande ampleur et tend à faire de l’entreprise le cœur du problème – et non le problème, comme certains pourraient le penser.
Je commencerai par l’indépendance de l’expertise.
Je pèse mes mots, il n’existe pas d’expertise indépendante en soi, ni de certitudes de l’expertise, derrière laquelle les décideurs politiques pourraient s’abriter, comme l’a démontré une nouvelle fois le débat suscité par les travaux du professeur Séralini sur le maïs OGM NK603, auxquels je me suis intéressé. Le Haut Conseil des biotechnologies avait estimé que la toxicité de ce type de maïs n’était pas démontrée par cette étude.
La meilleure garantie d’indépendance, c’est le recours à l’expertise pluraliste, pluridisciplinaire, contradictoire et transparente. À chacun son rôle : aux scientifiques celui de donner leur avis et d’alerter, aux politiques celui de décider et d’appliquer, ou pas, le principe de précaution, selon une lecture qui ne doit surtout pas se résumer au seul article 5 de la Charte de l’environnement. Nous aboutirions sinon à faire du principe de précaution un principe d’inaction, ce que je dénonce, ayant été le rapporteur du texte à l’époque, car il n’est surtout pas cela.
Il ne faut pas oublier les articles 8 et 9 de cette charte, et e pense en particulier à l’innovation. Autrement, l’innovation se fera ailleurs, ce qui signifie que les brevets seront détenus par d’autres. Au terme de vingt ans d’efforts pour mettre au point le brevet européen, je suis excessivement sourcilleux sur ce point.
J’évoquerai ensuite la création de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement.
Même si ce qui devait être une agence dans le texte initial a été transformé en commission par l’Assemblée nationale, nous considérons que nous n’avons pas besoin de créer une structure de plus, dont les compétences ne sont pas bien clarifiées par rapport à celles des agences existantes. Je ne pense pas me tromper beaucoup en disant qu’avec ce texte le Gouvernement a souhaité faire plaisir au groupe écologiste, mais que, parallèlement, il trouble et perturbe les chefs d’entreprise.
Le rapport de l’Inspection générale des finances de mars 2012 intitulé L’État et ses agences énumère déjà 1 244 agences de l’État. Le développement des autorités administratives indépendantes et autres établissements publics est un phénomène déjà ancien, qui s’est développé de façon inflationniste au fil des ans en termes de moyens humains et financiers. Ce phénomène ne s’est pourtant pas accompagné d’un renforcement suffisant de la tutelle de l’État.
En matière de santé, en particulier, près de dix agences existent déjà, dont l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, créée à la suite de l’affaire du Mediator en décembre 2011, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, mise en place en janvier 2010, l’Institut de veille sanitaire et l’Institut de radioprotection et de sureté nucléaire.
Par ailleurs, près de quatorze agences rattachées au ministère de l’écologie traitent de problèmes environnementaux.
La multiplicité des agences d’expertise est un véritable sujet d’interrogation. Elle pose, compte tenu des exigences budgétaires, la question de la rationalisation des missions respectives, ainsi que la nécessité de regrouper un certain nombre d’entre elles dont les missions et les domaines d’intervention sont redondants.
Je sais les efforts consentis lors de l’examen de ce texte à l’Assemblée nationale, mais j’estime que tout cela créera indiscutablement de nouvelles charges et des tracasseries administratives supplémentaires pour nos entreprises, qui n’en ont pas besoin.
On parle de « choc de compétitivité », et vous répondez par davantage de complexité.
On parle d’allégements de charges, et vous répondez par la création d’une commission nationale !
Le Gouvernement annonce un « choc de simplification », qui doit débuter par un gel de la production de normes, et vous répondez par des contraintes supplémentaires.
On annonce même la mise en place d’un « test PME », qui doit mesurer l’impact des nouvelles réglementations sur les entreprises. Je serais curieux de voir comment les dispositions de cette proposition de loi passeront ce test !
J’imagine également que les instances communautaires ne verront pas sans un certain effroi le comportement du gouvernement français en la matière. À l’heure où, plus que jamais, nous devons parler convergence avec notre principal partenaire, l’Allemagne, nous en « rajoutons » en termes de spécificité et de complexité française. Croyez-moi, nous n’avons vraiment pas besoin de complexifier davantage la vie des entreprises de notre pays !
J’en viens à l’exercice du droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement dans l’entreprise et à la protection des lanceurs d’alerte.
La création d’une procédure d’alerte sanitaire et environnementale dans les entreprises de plus de onze salariés et celle d’un statut spécifique pour une catégorie de salariés relèvent du champ de la négociation paritaire et des partenaires sociaux. Ces derniers n’ont pas manifesté jusqu’à présent la volonté d’inclure ce sujet dans le champ des négociations.
Par ailleurs, cette procédure serait créée par extension des missions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail présent dans toutes les entreprises de plus de cinquante salariés.
Que se passera-t-il pour les plus petites entreprises ?
Ce dispositif entraînera, à mon sens, un alourdissement considérable des obligations liées aux institutions représentatives du personnel, notamment pour les entreprises de moins de cinquante salariés, alors qu’elles demandent avant tout un allègement et une rationalisation des obligations existantes, notamment par la fusion des trois instances représentatives existantes – le délégué du personnel, le comité d’entreprise et le CHSCT – en un seul comité des salariés et des conditions de travail.
Cette proposition de loi crée une nouvelle catégorie de salariés, avec un statut particulier, celui de lanceur d’alerte, qui pourrait déboucher sur des incertitudes juridiques, des abus, voire une inégalité entre les salariés.
De plus, cela pourrait avoir des conséquences dramatiques pour certaines petites entreprises qui ne disposent pas des moyens de communication nécessaires pour réagir efficacement, en cas d’alertes lancées à tort ou par malveillance.
Je voudrais donc appeler votre attention, mes chers collègues, sur les risques qui peuvent découler de la médiatisation de fausses alertes, susceptible d’affecter durablement la réputation d’une entreprise.
Je peux paraître un peu sévère aux yeux de certains, mais, en tant qu’élu de Normandie, je suis bien placé pour savoir que ces fausses alertes ont contribué voilà quelques années, dans mon département, au discrédit de certaines entreprises, voire à leur disparition pure et simple, …

… tout simplement parce que des alertes précoces, médiatiquement incontrôlées, ont été lancées dans la nature et se sont avérées infondées, les germes incriminés n’étant pas au rendez-vous. Vous l’aurez deviné, il s’agissait d’une laiterie fabriquant du camembert de Normandie…
Je vous renvoie également à la fameuse crise du « concombre espagnol », causée en fait par la bactérie escherichia coli émanant d’une graine germée qui n’était pas d’origine espagnole. Cette affaire, qui a malheureusement entraîné un certain nombre de décès, a provoqué une destruction importante, pendant plusieurs mois, de la production légumière espagnole, fragilisant l’ensemble de la filière.
Nous sommes bien évidemment favorables, dans le domaine public, à une redéfinition des procédures d’expertise face aux risques émergents, car celles qui sont en place ne sont plus adaptées, et à une harmonisation des pratiques en matière d’expertise et d’exigences des comités déontologiques des différentes agences, pour qu’ils définissent en commun ce que pourrait être une future charte de l’expertise.
De plus, nous le savons bien, nos entreprises ont besoin de davantage de lisibilité sur les obligations qui incombent aux employeurs en matière de procédures d’alerte et de veille, ainsi que d’une hiérarchisation des priorités en matière de santé publique et d’une meilleure exploitation des données provenant des nombreux réseaux sentinelles existants.
Nous souhaitons également rationaliser le fonctionnement des agences d’expertise existantes en évaluant leur action et en réfléchissant au regroupement des agences sanitaires actuelles en fonction de l’évolution de nos connaissances.
Je terminerai mon propos, que j’ai voulu le plus objectif possible, en posant une question qui me semble légitime : la création d’une nouvelle entité nous permet-t-elle d’avoir meilleure conscience face à l’opinion publique ? On est en droit de se poser la question. Comme je l’ai dit lors de l’examen de la proposition de loi en première lecture, « les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires ».
Monsieur le rapporteur, vous avez évoqué la culture de l’alerte. C’est votre choix. Pour ma part, je préfère la culture de l’entreprise, mais j’ai le sentiment que nous n’en prenons pas le chemin.
Pour toutes ces raisons, le groupe UMP ne votera pas cette proposition de loi. §
Nouveaux sourires.

… par le Sénat, l’Assemblée nationale, le Gouvernement et les acteurs associatifs.
En effet, le présent texte est le fruit d’un travail collectif visant à pallier les lacunes actuelles de notre système d’alerte et d’expertise.
Il aura fallu convaincre pour aboutir à cette nouvelle lecture et, je l’espère, à un vote conforme à celui de l’Assemblée nationale. De fait, les résistances à la transparence sont nombreuses, non tant au sein de cet hémicycle qu’à l’extérieur. Quoi qu’il en soit, la transparence est un enjeu démocratique, et, en tant que parlementaires, nous avons le devoir d’en garantir l’effectivité. À ce titre, nous ne pouvons que saluer ce texte, qui opère une réelle avancée démocratique.
Nos concitoyens sont lucides face aux risques émergents qui menacent leur santé, qu’il s’agisse de l’impact des ondes ou des produits chimiques, de la qualité de leur alimentation, de l’eau ou de l’air, sujets qui constituent autant de préoccupations quotidiennes. De plus, ils s’inquiètent de la source de ces risques et de la réactivité des autorités de contrôle, qui peut parfois sembler trop tardive.
L’amiante, le Mediator, les pilules de troisième et quatrième générations fournissent autant d’exemples à fort retentissement médiatique. Ces affaires, qui ne sont pas pour nous rassurer, soulèvent de nombreuses interrogations et mettent parfois au jour un échec de l’action publique.
Les craintes de nos concitoyens sont légitimes, quand bien même elles se révéleraient infondées.
C’est précisément parce que le danger est multiforme que nous nous sommes engagés sur le front de la modernisation de la gestion du risque et que nous avons pris le parti de considérer toutes les alertes. En protégeant les lanceurs d’alerte et en garantissant l’indépendance de l’expertise, cette proposition de loi contribue à mieux répondre aux risques émergents.
Assumer de manière transparente la gestion du risque, c’est résorber la peur que de nouveaux scandales aient lieu. Il nous faut tout à la fois prendre en compte les risques rationnels et la peur irrationnelle qu’ils engendrent.
À l’heure où les lobbies s’activent pour faire ratifier leurs choix par les politiques, le fait de rediscuter de l’expertise scientifique était avant tout un acte démocratique.
Une enquête réalisée en 2011 par un institut de sondages souligne que, s’ils font globalement confiance à la « Science », les Français expriment beaucoup de méfiance vis-à-vis des scientifiques dans des domaines sensibles comme le nucléaire, les nanotechnologies ou les OGM. Plus largement, une très large majorité d’entre eux estime être insuffisamment informée concernant les débats et les enjeux de la recherche. Bref, en dépit d’une large communication, les résultats obtenus sont, somme toute, plutôt mitigés.
Cela étant, débattre de l’expertise scientifique pourrait presque passer pour un oxymore : les mots « expert » et « scientifique » sont si souvent invoqués, précisément, pour clore le débat ! Cependant, chacun d’entre nous garde en mémoire des dossiers au sujet desquels l’expertise s’est tout d’abord montrée très arrogante, avant de se révéler très défaillante.
Nous – législateur et Gouvernement – sommes de plus en plus souvent sommés d’arbitrer des débats d’une grande technicité. Ces discussions nous laissent souvent fort perplexes et nous soumettent à une simple alternative entre, d’une part, l’aveuglement – la foi du charbonnier – et, de l’autre, l’obscurantisme.
Dans ce cadre, le principe de précaution est régulièrement mis en cause : ce dernier est très injustement soupçonné de freiner soit le développement scientifique et technologique, soit l’utilisation même des avancées qu’il permet.
Pourtant, à nos yeux, les avantages du principe de précaution l’emportent sur les conséquences, parfois néfastes, de l’enthousiasme débridé de ces cinquante dernières années en faveur de toute forme de progrès scientifique et technologique. En effet, avec les premiers retours d’expérience, on constate que la vigilance est essentielle, car, sur certains dossiers, le doute l’emportera encore longtemps sur les certitudes.
Par présomption, l’expertise serait nécessairement scientifique, donc objective, et la critique de cette dernière serait idéologique, donc subjective. Pour arbitrer conformément à l’intérêt général, nous nous tournons dès lors vers des experts et nous nous demandons souvent, durant les processus de réflexion, si l’expertise menée par ceux-ci est aussi indépendante qu’il est confortable de le croire.
Malheureusement, comme l’ont illustré plusieurs drames sanitaires et environnementaux, l’expertise scientifique souffre parfois d’un déficit d’indépendance et de pluralisme. De plus, les experts scientifiques ont, eux aussi, des convictions – c’est bien leur droit – et des partis-pris idéologiques.
Voilà pourquoi l’expertise doit également être contradictoire, dans la mesure où elle constitue rarement une activité neutre. Une expertise au service de l’intérêt général nécessite une vigilance soutenue, en amont comme en aval, et ce à tous les niveaux institutionnels.
Nous avons eu maintes fois l’occasion de découvrir que tel scientifique ou tel expert n’était pas sans liens tantôt avec l’industrie agroalimentaire, tantôt avec celle du pétrole, tantôt avec celle du tabac. La qualité d’expert scientifique ne suffit donc pas à prévenir tout conflit d’intérêts économiques.
Mes chers collègues, sur ce point, je me contenterai de citer le cas bien connu de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, dont la présidente a dû démissionner en raison de sa proximité avec l’entreprise Monsanto.
A contrario – l’anecdote est amusante –, c’est un simple étudiant, expert en rien, sinon en recherches obsessionnelles dans les bibliothèques, qui a permis de dévoiler le poids réel des lobbies dans la législation européenne : ce jeune homme a recensé des pans entiers de cette législation qui étaient tout simplement des copier-coller de rapports transmis par les lobbies !
Pour conserver ses propriétés éthiques, scientifiques et démocratiques, l’expertise doit être multidisciplinaire et pluraliste, et par conséquent composée de scientifiques issus d’horizons différents, ainsi que de représentants de la société civile. C’est ce que prévoit la proposition de loi, et je m’en réjouis.
La parcellisation des connaissances, la spécialisation des pratiques et la professionnalisation des disciplines ont disqualifié la compétence des simples « profanes » en hiérarchisant les savoirs. Toutefois, les citoyens ont un rôle essentiel à jouer dans le champ des controverses et des incertitudes.
Les lanceurs d’alerte ne sont pas des gêneurs ; ce sont des vigies que la complexité et la technicité de notre monde rendent indispensables. Ils peuvent se tromper, nous objectera-t-on ; sans doute, mais il en est de même des experts ! Or, parmi ces derniers, certains se sont trompés, rétractés, trompés de nouveau, ont parfois été discrédités avant d’être, en définitive, réhabilités.
Mme Évelyne Didier acquiesce.

Les lanceurs d’alerte sont utiles et leur expertise, qui n’est pas toujours sanctionnée par des diplômes universitaires mais qui est souvent le fruit de leur observation, doit pouvoir être recueillie. S’ils avaient eu, par le passé, la place que leur garantit le présent texte, nous aurions sans doute gagné du temps sur certains dossiers et peut-être même épargné des vies.
Grâce au présent texte, nous donnons une réelle légitimité aux lanceurs d’alerte et nous leur garantissons la protection de l’État.
Aucune procédure ou institution ne nous placera totalement et durablement à l’abri des expertises erronées ou biaisées. Toutefois, nous avons la possibilité d’organiser l’expertise pour éviter qu’une décision ne soit prise dans l’ignorance ou en dissimulant d’autres points de vue.
À ce titre, je me permets de répondre à Jean Bizet.
Cher collègue, chacun d’entre nous éprouve les inquiétudes que vous avez évoquées il y a quelques instants : comment contrecarrer et étouffer des rumeurs dont l’impact économique pourrait se révéler désastreux ?
Néanmoins, à mon sens, la confiance nouvelle que nous sollicitons de nos concitoyens en faveur d’une expertise pluraliste et contradictoire doit précisément nous prémunir contre les rumeurs. L’origine de ces dernières est quelquefois incertaine ; il arrive même qu’elle provienne du monde économique lui-même !
Sans prétendre vous inviter à réviser votre vote, je souligne que le présent texte fait justement le pari de l’intelligence collective et de la lutte contre l’irrationnel. Il ne s’agit donc pas, comme vous semblez le suggérer, de laisser le pouvoir aux obscurantistes.
Avec cette proposition de loi, nous posons les jalons d’une belle évolution au service de la démocratie et du progrès scientifique, et nous permettons ainsi que se forgent, hors de la sphère marchande, des avancées scientifiques au service de tous. §

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes appelés à examiner aujourd’hui, pour la seconde fois, une proposition de loi dont l’examen a débuté ici même, il y a un peu plus de six mois. Ce texte utile a été déposé sur l’initiative de notre collègue Marie-Christine Blandin, et nous l’en remercions.
Bien entendu, nous n’avons pas changé d’avis depuis la première lecture. C’est pourquoi nous réaffirmons la nécessité de garantir l’indépendance, la transparence et la traçabilité de l’alerte en matière sanitaire ou environnementale. Parallèlement, nous réitérons le soutien des sénateurs du groupe CRC au présent texte.
À ce stade, la seule véritable question qui subsiste est la suivante : l’objectif affiché pourra-t-il être atteint ? En effet, la présente proposition de loi traduisait à l’origine une ambition forte, qui se trouve sensiblement amoindrie après son examen par l’Assemblée nationale, même si notre rapporteur, comme à son habitude, voit toujours les choses de manière positive. §
Tout d’abord, disons-le, grâce à ce texte, les lanceurs d’alerte disposeront enfin d’un statut juridiquement reconnu et protecteur, comme le prévoyait l’article 52 de la loi dite « Grenelle 1 », adoptée en 2009. C’est pourquoi je m’attendais à ce que la Haute Assemblée vote cette proposition de loi de manière unanime !
Toutefois, le mode de traitement de l’alerte au sein des entreprises a été sensiblement modifié au cours de la navette parlementaire.
Ainsi, plutôt que de créer une instance spécifique au sein des entreprises, destinée à gérer et à instruire les alertes prévues dans la version initiale de la proposition de loi, le Sénat avait préféré confier ces compétences aux CHSCT. À la réflexion, cette modification nous satisfaisait pleinement.
La rédaction adoptée par l’Assemblée nationale a remis en cause ce choix, en renvoyant la gestion de l’alerte à l’entreprise ou, à défaut, au représentant de l’État au sein du département. Dans ce dispositif, le CHSCT est simplement destinataire des informations. Cette modification n’est pas anodine.
La réécriture accomplie par l’Assemblée nationale a été justifiée par la faiblesse des moyens des CHSCT, qui ne leur permettrait pas de faire face à de nouvelles missions. À cet égard, je rappelle que nous avions déjà soulevé ce problème au sein de cet hémicycle, en appelant précisément à un renforcement de ces moyens.
Par ailleurs, il a été souligné que la responsabilité de la gestion de l’alerte devait avant tout incomber à l’entreprise et, le cas échéant, au représentant de l’État dans le département. Sur ce sujet, Mme la ministre a fait remarquer à juste raison qu’une telle mission revient d’ores et déjà aux préfets de département. §
À ma connaissance, cette disposition n’a pas permis de prévenir le moindre scandale environnemental lié à l’activité d’une entreprise.
De telles mesures, qui se révèlent redondantes par rapport au droit actuel, ne sont pas satisfaisantes. C’est pourquoi nous restons dubitatifs. Nous regrettons que le CHSCT ne dispose pas de moyens d’intervention directe, notamment du droit d’enquête ou de la faculté de recourir officiellement à un expert en cas d’alerte dans le cadre d’une mission bien identifiée.
À nos yeux, le fait de confier ces nouvelles missions au CHSCT permettait a contrario à cette instance de bénéficier d’une vision plus globale des activités de l’entreprise, sous l’angle non seulement social et économique, mais aussi environnemental et sanitaire.
Qui plus est, une telle démarche répondait parfaitement à la notion de développement durable, qui induit cet impératif : ne pas remplacer la problématique sociale par la problématique environnementale, mais bel et bien appréhender ces deux questions dans un même mouvement pour élaborer des réponses réellement performantes.
Au total, la nouvelle rédaction de ce texte prévoit la création d’une Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement. Il s’agit de garantir, tout au long du traitement de l’alerte, d’une part, le bon déroulement de la procédure et la bonne coordination des acteurs et, de l’autre, sa traçabilité. Nous attendons désormais de voir quels moyens seront accordés à cette instance, en ces temps de réduction des dépenses.
En conséquence, nous prenons la présente proposition de loi comme un premier pas engageant, qui permet de remettre l’intérêt général au centre de l’expertise scientifique en matière environnementale et sanitaire.
Néanmoins, il nous faudra tôt ou tard aller plus loin. Comme nous l’avions dit en première lecture, nous devons nous poser collectivement la question du financement de la recherche. Nous souhaitons que soit réhabilitée l’idée même de recherche publique et donc de financement public. §Dire que certains secteurs d’activités ne relèvent pas du marché, c’est poser la question de l’intérêt général dans un domaine essentiel.
Parallèlement, comme nous l’avions également demandé, nous souhaitons voir redéfinis les contours du secret industriel, qui, pour l’heure, limite la transparence des expertises et entrave les pouvoirs de contrôle des instances concernées comme des citoyens.
Enfin, cette alerte citoyenne, codifiée et encadrée, testée dans les domaines sanitaire et environnemental, pourra le cas échéant être utilement étendue à d’autres secteurs. Promouvoir l’alerte citoyenne comme une des garanties de la transparence, c’est sans doute une piste intéressante pour élaborer les instruments démocratiques d’aujourd’hui et de demain.
Vous l’aurez compris, nous voterons en faveur de ce texte, qui tend à garantir un statut protecteur aux lanceurs d’alerte. À cet égard, je précise que je crains bien plus l’activité des lobbies un peu partout, notamment au niveau européen, que l’action de quelques citoyens alertés par une situation qui leur semble anormale.
Mme Corinne Bouchoux acquiesce.

Parallèlement, cette proposition de loi présente l’intérêt de garantir la traçabilité des alertes sanitaires et environnementales. Nous n’en avons pas moins conscience que, passé une première phase d’expérimentation et d’évaluation, nous devrons nous remettre à la tâche pour obtenir un dispositif pleinement efficace et satisfaisant. §

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, depuis notre dernière discussion, le contexte a malheureusement assez peu changé. En revanche, les sollicitations sont de plus en plus nombreuses pour mettre en place une protection des lanceurs d’alerte et aller vers une harmonisation les protocoles d’expertise. De fait, l’absence d’accord sur les protocoles d’expertise alimente aujourd’hui de nombreux débats.
À ce sujet, je souhaiterais évoquer le rapport de la mission commune d’information du Sénat sur les pesticides, présidée par Sophie Primas et dont le rapporteur était Nicole Bonnefoy. Il y est clairement indiqué qu’il est nécessaire de mettre en place une procédure de protection des lanceurs d’alerte.
Dans un rapport paru très récemment, l’Agence européenne de l’environnement insiste sur la nécessité de détecter rapidement les signaux précoces. Avec vingt nouvelles études de cas concernant l’empoisonnement au mercure industriel ou les problèmes de fertilité causés par les pesticides, il montre bien que notre incapacité à détecter les signaux précoces a été, et sera encore à l’avenir, à l’origine de graves problèmes de santé publique.
Le texte s’inscrit donc dans le droit fil de ce qui a été acté lors du Grenelle de l’environnement. Madame Didier, la loi votée alors à la quasi-unanimité, en effet, prévoyait l’élaboration d’un rapport sur cette question. Finalement, ce rapport n’a pas été fait – mea culpa –, mais la loi ne prévoyait que cela.
La haute autorité envisagée a donc laissé place à une commission nationale, à la suite d’un travail parlementaire intéressant, marqué – il faut le reconnaître – par la volonté de rechercher autant que possible le consensus, loin de certaines déclarations très polémiques, que j’estime parfaitement inutiles.
Aujourd’hui, il est de notre devoir de parlementaires de donner un cadre éthique au progrès ― et, pour cela, de fuir comme la peste ceux qui ne l’envisagent que comme un facteur de suspicion ―, de créer les conditions de détection des signaux faibles et de nous accorder sur la question de l’expertise.
Cette proposition de loi est donc importante. Elle a fait l’objet d’un important travail de réécriture à l’Assemblée nationale. À cet égard, j’ai même entendu que, maintenant qu’elle était « limitée », on pouvait l’adopter… Il s’agit pourtant d’un problème central de santé publique. S’agissant des grandes épidémies auxquelles la France est confrontée – le diabète de type 1, l’obésité, le cancer, notamment les cancers infantiles, et les maladies neuro-dégénératives –, les facteurs environnementaux, dont les perturbateurs endocriniens sont l’un des éléments centraux, sont suspectés dans la plupart des cas relevant. Nous sommes aujourd’hui incapables, avec notre propre expertise, de croiser ces données et de détecter ces facteurs. Quant aux études de cohorte, elles sont malheureusement très longues et n’interviennent que bien après la détection desdits facteurs.
Telle est bien la question centrale. Je le dis en toute amitié à mes collègues, j’espère que la réécriture de ce texte par l’Assemblée nationale ne l’a pas vidé de son ambition.

Je ferai, de façon schématique et sommaire, un bilan des points négatifs et positifs de cette proposition de loi.
En ce qui concerne les points négatifs, je commencerai par soulever de nouveau une question que j’ai déjà posée : ce texte nous permettra-t-il de nous accorder à l’avenir sur des lignes directrices concernant l’expertise ?

C’est là, monsieur Bizet, la question centrale s’agissant des OGM. Nous ne sommes pas d’accord sur les lignes directrices de l’expertise, et c’est ce qui crée la polémique.
De plus, serons-nous réellement capables, demain, de détecter les signaux faibles ?
Ensuite, et vous êtes là directement concernée, madame la ministre, vous vous étiez engagée lors de la première lecture – notre groupe a une bonne mémoire ! – à nous expliciter précisément les mesures de rationalisation que vous alliez prendre pour que la création de cette nouvelle commission ne se traduise pas par une inflation du nombre d’instances et, surtout, par de nouvelles demandes budgétaires. Vous deviez nous apporter des réponses en deuxième lecture : nous y voilà !

Enfin, l’Assemblée nationale a supprimé du texte l’engagement de confidentialité des alertes, au motif que cela serait incohérent avec la publicité de l’alerte.
Il s’agissait pourtant – et je m’adresse à vous, monsieur le rapporteur, car vous aviez utilisé cet argument en première lecture – d’un point fort de la proposition de loi.

Cela devait contribuer à éviter les lancements abusifs d’alerte. En effet, même si des dispositions relatives à la diffamation ou à l’exigence de bonne foi ont été prévues, le laps de temps qui peut s’écouler entre le lancement d’une alerte et l’engagement éventuel d’une procédure judiciaire peut être extrêmement préjudiciable à certains acteurs, notamment économiques.
Pour autant, ce texte contient plus d’aspects positifs que négatifs.
D’abord, il apportera un progrès global, car la mise en place des registres d’alerte, auxquels les agences sont très favorables, et le croisement de ces registres permettront sans doute de détecter des failles dans notre système et certains signaux faibles.
Par ailleurs, ce texte permettra de supprimer la confusion entre l’alerte et l’expertise, que nous avions signalée en première lecture, et de clarifier le rôle des CHSCT, limité à l’environnement et à la santé, ce qui peut faire débat.
Pour finir, si la nouvelle organisation qu’il met en place fonctionne bien, ce texte apportera des précisions utiles quant aux règles de déontologie et d’indépendance de l’expertise.
Par conséquent, la grande majorité du groupe UDI-UC s’abstiendra avec bienveillance, tandis qu’un certain nombre d’entre nous, dont Vincent Capo-Canellas, Henri Tandonnet et Nathalie Goulet, voteront ce texte. §

Ce texte a donné lieu à de nombreuses discussions au sein de tous les groupes, notamment du nôtre. Aujourd'hui, il nous revient bien remanié par l’Assemblée nationale. Globalement, ses apports sont positifs ; quant aux quelques points encore peu clairs, le temps nous aidera à les préciser. En tout cas, ce texte répond maintenant à presque à toutes les attentes du RDSE.
Des risques émergents pour la santé publique comme pour notre environnement, de plus en plus nombreux, nécessitent toute notre vigilance. Plus la science avance et plus nous connaissons l’existence de ces risques. Notre responsabilité politique est donc plus que jamais de prendre les décisions qui s’imposent pour protéger nos concitoyens.
Le groupe du RDSE est fier de rappeler qu’il a déposé le premier, le 27 juillet 2009, une proposition de loi dont l’adoption en 2010 a eu pour effet la suspension de la commercialisation des biberons à base de bisphénol A.
En ce qui concerne le texte que nous examinons en deuxième lecture, nous sommes tous d’accord ici pour dire que l’alerte doit être protégée. Nous constatons les effets néfastes des médicaments, comme les pilules contraceptives de troisième et de quatrième générations lorsque le suivi de la patiente n’est pas assuré, ou encore des procédés du secteur de l’agro-alimentaire, peu soucieux de la santé des consommateurs, voire de l’utilisation par l’industrie de différents composants chimiques dangereux dans la fabrication de produits en tout genre.
Scandale après scandale, la profusion d’informations contradictoires plonge nos concitoyens dans le flou le plus absolu et laisse libre cours à la rumeur.
La création de la nouvelle Commission nationale de la déontologie et de l’alerte, associée au travail de nos agences sanitaires et environnementales, permettra une remise en ordre de ce paysage confus, afin que les alertes sérieuses puissent être traitées à temps. Le politique reprendra alors son rôle. À l’écoute des experts et de leurs arguments, au constat des faits qui s’imposent, il lui revient, en effet, de prendre la décision de réglementer l’usage de certains produits, d’en interdire d’autres. L’État doit enfin prendre ses responsabilités !
L’adoption de mesures législatives en la matière peut mettre un terme à une excessive culture du secret, défavorable à l’exercice de la démocratie. Il ne s’agit pas de favoriser une psychose collective, mais de diffuser des informations pertinentes à nos concitoyens, en toute transparence, pour qu’ils en saisissent les enjeux.
J’en profite pour dire à notre excellent collègue Jean Bizet que nous avons nous aussi la culture de l’entreprise, ce qui ne signifie pas avoir la culture de la rumeur ! On peut avoir la culture de l’entreprise et considérer que les entreprises peuvent elles aussi reconnaître les problèmes. Si elles n’en sont pas capables, il est tout de même normal que des acteurs extérieurs, des scientifiques ou des membres des CHSCT mettent en garde contre la fabrication de produits dangereux. Tout cela n’est pas incompatible. Je connais d’ailleurs des patrons qui sont à la tête d’entreprises citoyennes et qui ont un véritable sens des responsabilités. J’ai parfaitement entendu vos propos, monsieur Bizet, mais ce texte ne me semble pas incompatible avec la culture d’entreprise !

Je n’ai pas à le faire, il est naturel chez moi !
La vérité scientifique n’est pas unique. Il convient d’apporter les éléments d’information indispensables pour nourrir le débat, tout en évitant la culture du scandale sanitaire, souvent favorisée par la pseudo-expertise des médias ou des non-spécialistes.
Ce texte constitue ainsi une avancée dans la prévention des scandales sanitaires et environnementaux. Il est en outre débarrassé des freins potentiels à la recherche, au progrès et à l’innovation que contenait sa première mouture, avec laquelle nous étions, en partie seulement, en désaccord.
Le traitement des alertes accordé au départ à la Haute Autorité de l’expertise écartait le pouvoir politique de la décision. Le groupe du RDSE ne pouvait accepter qu’un rôle aussi important soit accordé à une énième entité dont les compétences recoupaient celles de nos agences sanitaires et environnementales, ni que le pouvoir de l’État soit délégué à un organisme composé d’experts et d’autres spécialistes.
Ne confondons pas le traitement de l’alerte et la constatation des faits, l’action et la détection ! L’un revient au politique quand l’autre revient au scientifique. Chacun a un rôle, chacun prend ses responsabilités.
Je tiens à saluer le travail de nos experts et à me féliciter de la poursuite de leurs recherches en matière de risques. Sans ces recherches, les maladies et les accidents se développeraient sans que l’on puisse en déterminer la cause. N’oublions pas que nos experts sont également des lanceurs d’alerte potentiels.
Désormais, la structure proposée recueillera les alertes et les transmettra aux agences compétentes dont nous reconnaissons la qualité de l’expertise et qui rédigent déjà de nombreux rapports sur les risques pouvant peser sur la santé et l’environnement. En outre, la création de la Commission nationale de la déontologie et des alertes devrait être réalisée à moyens constants. Sur ce point, nous attendons votre réponse, madame la ministre, puisque vous aviez pris l’engagement de nous apporter des précisions en première lecture.

Pardonnez-moi alors, j’avais sans doute l’oreille un peu distraite !
Un filtre à la diffamation est mis en place par l’encadrement législatif de la saisine de la commission, réservée entre autres au Gouvernement, aux parlementaires, aux associations agréées de protection de l’environnement, de protection des consommateurs et aux représentants des ordres professionnels.
La proposition de loi consacre dans notre droit l’existence des lanceurs d’alerte, toutes ces personnes qui, soucieuses de l’intérêt général, sont parfois prêtes à risquer leur emploi et leur carrière professionnelle. J’avais évoqué en première lecture le cas de plusieurs personnes dans cette situation. Nous devons leur conférer un véritable statut pour préserver les alertes en prohibant dans la loi toutes les mesures discriminatoires qui pourraient être appliquées à leur encontre, notamment dans le milieu professionnel. Le renversement de la charge de la preuve en faveur du lanceur d’alerte constitue donc une réelle avancée. Nous étions tous d’accord sur ce principe retenu par nos deux assemblées.
Néanmoins, pour créer un véritable statut du lanceur d’alerte, il me semble important de rappeler dans la loi que les victimes des discriminations pourront saisir le Défenseur des droits pour obtenir un véritable accompagnement. C’est pourquoi nous avons décidé de présenter un amendement en ce sens. Madame la ministre, j’attends que vous nous indiquiez si le Défenseur des droits figure toujours dans le dispositif. C’est la seule réponse que nous attendons.
Il faut également se féliciter de la reconnaissance du droit d’alerte en milieu professionnel.
Certains considèrent légitimement que ce texte peut introduire une certaine méfiance à l’égard des experts. Cependant, rassurons-les, ce sont bien plus la diffusion par les médias d’études dont la méthodologie n’est pas précisée et l’absence de prise de décision au niveau de l’État qui nourrissent la méfiance de nos concitoyens. C’est également l’impression que les pouvoirs publics ont connaissance des risques et ne réagissent pas face aux alertes. C’est pourquoi il convient de réformer rapidement notre système de traitement de l’alerte.
Lors de l’examen en première lecture, j’avais émis des doutes sur l’indépendance de la Haute Autorité de l’expertise. Grâce aux travaux de l’Assemblée nationale, la déclaration publique d’intérêts comportera les activités exercées par les membres de la Commission nationale au cours des cinq dernières années. Ceux dont les activités pourraient entraîner un conflit d’intérêts dans l’examen de certains dossiers seront exclus des travaux. Voilà des dispositions qui, à nos yeux, permettront de garantir l’indépendance de ses membres.
Toutefois, la question de l’efficacité de la nouvelle Commission nationale de déontologie reste en suspens. C’est la réaction des pouvoirs publics et la prévention des conflits d’intérêts qui conditionneront son efficacité et donc son utilité. Le dispositif prévu par ce texte devra, à n’en pas douter, être amélioré et renforcé avec le temps.
Sous les réserves que je vous ai indiquées précédemment, madame la ministre, le groupe du RDSE émettra le même vote qu’en première lecture. §

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, chacun sait la nécessité de disposer d’une expertise indépendante, la dernière décennie ayant montré combien le fait de négliger, voire d’intimider, les lanceurs d’alerte peut avoir un coût sanitaire, humain et financier considérable.
De l’amiante au Mediator, nous tirons les leçons. D’ailleurs, sur tous les scandales sanitaires, par ses rapports émanant des missions d’information et des commissions d’enquête, le Sénat a été exemplaire, exigeant et consensuel. Les constats ainsi établis ont motivé la proposition de loi relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte que j’avais eu l’honneur de vous proposer en octobre dernier, mes chers collègues. Avec la deuxième lecture de ce texte, nous sommes aujourd'hui conduits à concrétiser les préconisations issues de ces travaux.
Nous avions déjà écouté les arguments avancés par les personnes initialement réticentes et apporté quelques modifications au texte, sous la plume du rapporteur Ronan Dantec et sous la houlette du président de la commission du développement durable, que je remercie tous deux. L’Assemblée nationale en a fait de même grâce au travail des députés Marie-Line Reynaud et Jean-Louis Roumegas, pour parvenir à un texte qui me semble équilibré et cohérent.
En dépit du consensus qui nous a réunis sur les fondements mêmes de la proposition de loi, nous avons dû lever de nombreux obstacles : crainte de dépenses supplémentaires, spectre de l’usine à gaz, confusion entre instance de déontologie et officine de contre-expertise, difficultés pour les entreprises. Les explications ne furent pas superflues, et chacun a pu, me semble-t-il, trouver réponse à ses objections.
Par ailleurs, nous avons été confrontés à une autre difficulté. L’initiative parlementaire, que nous appelons tous de nos vœux, peut vite devenir un chemin semé d’embûches si le texte relève des domaines de compétences de plusieurs ministres. Ce fut le cas avec cette proposition de loi, qui concerne, entre autres, la recherche, la santé, le travail et l’environnement. Le Gouvernement a fini par répondre d’une seule voix, et je vous remercie tout particulièrement, madame la ministre, ainsi que votre collègue Michel Sapin, d’avoir su écouter et comprendre les demandes des parlementaires.
Hormis les avancées qu’il permet d’enregistrer en matière de santé et d’environnement, ce texte est, me semble-t-il, l’aboutissement du bon fonctionnement de notre démocratie.
Parmi les progrès apportés par l’Assemblée nationale, je me félicite de voir placé en exergue de la proposition de loi l’article 1er A, qui définit l’alerte et les lanceurs d’alerte.
Par ailleurs, l’Assemblée nationale a souhaité que la future Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement puisse être saisie par un ordre professionnel. Le Sénat n’y avait pas songé, et il me semble que cette source est un plus pour le bon fonctionnement de cette commission qui, comme l’a souligné Mme la ministre dans son intervention liminaire, œuvrera à moyens constants dans le cadre du Comité de la prévention et de la précaution élargi, avec l’appui des inspecteurs généraux.
Au demeurant, les députés ont souhaité distinguer le droit d’alerte en matière sanitaire et environnementale du droit d’alerte accordé aux salariés dans les entreprises, droits qui ne peuvent s’exercer de la même manière et dans les mêmes conditions. Cette clarification, qui ne bouleverse pas nos intentions initiales, devrait être de nature à rassurer notre collègue Jean Bizet.

Quel dommage !
Ce texte permet de tirer les leçons des scandales sanitaires passés, en donnant une écoute à l’expertise d’usage des victimes ou des professionnels, dont la vigilance au plus près du terrain est salutaire pour les chercheurs.
Loin d’opposer société civile et agences de sécurité sanitaire, ce dispositif permet à l’une de faire valoir les dysfonctionnements ou les faibles signaux et aux autres de procéder plus tôt à des expertises. La défiance grandissante qui touche notre appareil de recherche, la seule recherche du scandale médiatique ne sont pas des outils démocratiques apaisés.
À l’émotion et au procès d’intention, nous préférons la science et la raison. C’est un protocole rationnel que nous appelons de nos vœux, en inscrivant dans la loi le principe d’indépendance ainsi que la protection des messages extérieurs et des auteurs de bonne foi.
Mes chers collègues, la crise rend difficile l’action publique : nombre de nos aspirations sont étouffées par le manque de moyens. Cette modeste proposition – j’emploie cet adjectif dans la mesure où elle a été modérée, « déradicalisée » – peut être gage de démocratie, de santé et d’environnement mieux protégés, de souffrances évitées et d’économies. À cet égard, je vous rappelle que 2 milliards d’euros ont été versés par le FIVA, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, et que 2 milliards d’euros ont aussi été dépensés pour le Mediator.
Aussi, je compte sur vous, mes chers collègues, pour donner aujourd'hui votre accord définitif sur ce texte. §
Je souhaite apporter deux précisions.
Tout d’abord, j’indique que le rapport que le Gouvernement devait remettre au Parlement sur l’opportunité de créer une instance propre à assurer la protection de l’alerte et de l’expertise afin de garantir la transparence, la méthodologie et la déontologie des expertises, en vertu de l’article 52 de la loi Grenelle 1, et qui n’avait pas été rendu public, a été envoyé à tous les parlementaires à l’issue de la discussion en première lecture. Les conclusions de ce rapport vont précisément dans le sens de cette proposition de loi.
Ensuite, pour répéter un point que j’ai déjà précisé dans mon intervention liminaire, il ne sera pas créé d’instance nouvelle. D’ailleurs, lors du comité interministériel pour la modernisation de l’action publique qui s’est tenu hier, nous avons supprimé une centaine de comités divers et de commissions. La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement sera une refonte du Comité de la prévention et de la précaution, ce qui nécessitera de procéder à des modifications réglementaires. Son fonctionnement se fera à moyens constants, et le secrétariat sera assuré par le Commissariat général au développement durable.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles du texte de la commission.
Je rappelle que, aux termes de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets et propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.
TITRE IER a
DROIT D’ALERTE EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE ET D’ENVIRONNEMENT
(Non modifié)
Toute personne physique ou morale a le droit de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou sur l’environnement.
L’information qu’elle rend publique ou diffuse doit s’abstenir de toute imputation diffamatoire ou injurieuse.
L'article 1 er A est adopté.

TITRE IER
LA COMMISSION NATIONALE DE LA DÉONTOLOGIE ET DES ALERTES EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE ET D’ENVIRONNEMENT
(Non modifié)
Il est institué une Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement chargée de veiller aux règles déontologiques s’appliquant à l’expertise scientifique et technique et aux procédures d’enregistrement des alertes en matière de santé publique et d’environnement.
À cette fin, elle :
1° Émet des recommandations générales sur les principes déontologiques propres à l’expertise scientifique et technique dans les domaines de la santé et de l’environnement, et procède à leur diffusion ;
2° Est consultée sur les codes de déontologie mis en place dans les établissements et organismes publics ayant une activité d’expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l’environnement dont la liste est fixée dans les conditions prévues à l’article 1er bis. Lorsqu’un comité de déontologie est mis en place dans ces établissements ou organismes, elle est rendue destinataire de son rapport annuel ;
3° Définit les critères qui fondent la recevabilité d’une alerte ainsi que les éléments portés aux registres tenus par les établissements et organismes publics mentionnés au 2° ;
4° Transmet les alertes dont elle est saisie aux ministres compétents, qui informent la commission de la suite qu’ils réservent aux alertes transmises et des éventuelles saisines des agences sanitaires et environnementales placées sous leur autorité résultant de ces alertes. Les décisions des ministres compétents concernant la suite donnée aux alertes et les saisines éventuelles des agences sont transmises à la commission, dûment motivées. La commission tient la personne ou l’organisme à l’origine de la saisine informé de ces décisions ;
5° et 6°
Suppressions maintenues
6° bis Identifie les bonnes pratiques, en France et à l’étranger, et émet des recommandations concernant les dispositifs de dialogue entre les organismes scientifiques et la société civile sur les procédures d’expertise scientifique et les règles de déontologie qui s’y rapportent ;
7° Établit chaque année un rapport adressé au Parlement et au Gouvernement qui évalue les suites données à ses recommandations et aux alertes dont elle a été saisie ainsi que la mise en œuvre des procédures d’enregistrement des alertes par les établissements et organismes publics mentionnés au 2°. Ce rapport comporte, en tant que de besoin, des recommandations sur les réformes qu’il conviendrait d’engager pour améliorer le fonctionnement de l’expertise scientifique et technique et la gestion des alertes. Il est rendu public et est accessible par internet. –
Adopté.
(Non modifié)
Les établissements et organismes publics ayant une activité d’expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l’environnement tiennent un registre des alertes qui leur sont transmises et des suites qui y ont été données.
Un décret en Conseil d’État précise la liste de ces établissements ou organismes ainsi que les modalités selon lesquelles sont tenus les registres.
Ces registres sont accessibles aux corps de contrôle des ministères exerçant la tutelle des établissements et organismes chargés de les tenir ainsi qu’à la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement. –
Adopté.
(Non modifié)
La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement peut se saisir d’office ou être saisie par :
1° Un membre du Gouvernement, un député ou un sénateur ;
2°
Suppression maintenue
3° Une association de défense des consommateurs agréée en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation ;
4° Une association de protection de l’environnement agréée en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ;
5° Une association ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréée en application de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
6° Une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national ou une organisation interprofessionnelle d’employeurs ;
6° bis L’organe national de l’ordre d’une profession relevant des secteurs de la santé ou de l’environnement ;
7° Un établissement ou un organisme public ayant une activité d’expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l’environnement. –
Adopté.
(Non modifié)
La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement comprend notamment des députés et des sénateurs, des membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation, des membres du Conseil économique, social et environnemental et des personnalités qualifiées au titre de leurs travaux dans les domaines de l’évaluation des risques, de l’éthique ou de la déontologie, des sciences sociales, du droit du travail, du droit de l’environnement et du droit de la santé publique, ou appartenant à des établissements ou des organismes publics ayant une activité d’expertise ou de recherche et ayant mené des missions d’expertise collective.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités de fonctionnement de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement ainsi que sa composition, de manière à assurer une représentation paritaire entre les femmes et les hommes. –
Adopté.
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
Les membres de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement et les personnes qui lui apportent leur concours, ou qui collaborent occasionnellement à ses travaux, sont soumis à des règles de confidentialité, d’impartialité et d’indépendance dans l’exercice de leurs missions.
Ils sont tenus d’établir, lors de leur entrée en fonction, une déclaration d’intérêts. Celle-ci mentionne les liens d’intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a, ou qu’il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonction, avec des entreprises, des établissements ou des organismes dont les activités, les techniques et les produits relèvent des secteurs de la santé ou de l’environnement ainsi qu’avec des sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les mêmes secteurs. Elle est rendue publique et est actualisée, en tant que de besoin, à l’initiative de l’intéressé, et au moins une fois par an.
Les personnes mentionnées au présent article ne peuvent prendre part aux travaux, aux délibérations et aux votes au sein de la commission qu’une fois la déclaration établie ou actualisée. Elles ne peuvent, sous les peines prévues au premier alinéa de l’article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux travaux, ni aux délibérations, ni aux votes si elles ont un intérêt, direct ou indirect, à l’affaire examinée. Elles sont tenues au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. –
Adopté.
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent titre. –
Adopté.
TITRE II
EXERCICE DU DROIT D’ALERTE EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE ET D’ENVIRONNEMENT DANS L’ENTREPRISE
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
Le titre III du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement
« Art. L. 4133 -1. – Le travailleur alerte immédiatement l’employeur s’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement.
« L’alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
« L’employeur informe le travailleur qui lui a transmis l’alerte de la suite qu’il réserve à celle-ci.
« Art. L. 4133 -2. – Le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe un risque grave pour la santé publique ou l’environnement en alerte immédiatement l’employeur.
« L’alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
« L’employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a transmis l’alerte et l’informe de la suite qu’il réserve à celle-ci.
« Art. L. 4133 -3. – En cas de divergence avec l’employeur sur le bien-fondé d’une alerte transmise en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 ou en l’absence de suite dans un délai d’un mois, le travailleur ou le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut saisir le représentant de l’État dans le département.
« Art. L. 4133 -4. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé des alertes transmises à l’employeur en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2, de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 4133-3.
« Art. L. 4133 -5. – Le travailleur qui lance une alerte en application du présent chapitre bénéficie de la protection prévue à l’article L. 1350-1 du code de la santé publique. » –
Adopté.
(Suppressions maintenues)
(Non modifié)
L’article L. 4141-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l’environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier. » –
Adopté.
(Suppressions maintenues)
(Non modifié)
L’article L. 4614-10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est réuni en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement. » –
Adopté.
(Suppression maintenue)
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
(Suppressions maintenues)
(Non modifié)
Le livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE
« Art. L. 1350 -1. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l’environnement dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l’environnement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »

L'amendement n° 1, présenté par MM. Plancade, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Mézard, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne faisant l'objet d'une mesure discriminatoire telle que définie par le premier alinéa peut saisir le Défenseur des droits dans les conditions prévues par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits en application de son article 5.
La parole est à M. Jean-Pierre Plancade.

Cet amendement avait été adopté en première lecture par le Sénat. Le groupe du RDSE demande qu’il soit réintroduit dans la proposition de loi, sauf si Mme la ministre nous apporte la certitude que le Défenseur des droits pourra être saisi à tout moment.

La commission s’est de nouveau penchée sur cet amendement ce matin. Elle est d’accord sur le fond : le Défenseur des droits doit être saisi des questions de l’alerte et de la protection des lanceurs d’alerte.
Toutefois, aux termes de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, « le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne qui s’estime victime d’une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ». Si la proposition de loi est votée, le non-respect de ses dispositions permettra à la personne discriminée de faire appel au Défenseur des droits. L’amendement n° 1 est donc satisfait.
Monsieur Plancade, il était certes important de faire ce rappel en première lecture, mais la commission estime que votre amendement est superfétatoire. En conséquence, elle vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir le retirer ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Monsieur le sénateur, votre amendement est en effet satisfait.
L’article 17 de la proposition de loi étend la protection des lanceurs d’alerte aux personnes victimes de discrimination parce qu’elles ont relaté des faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l’environnement. Ces personnes pourront saisir le Défenseur des droits sans qu’il soit nécessaire de l’inscrire dans la proposition de loi.
D’ailleurs, comme l’a rappelé M. le rapporteur, l’article 5 de la loi organique du 29 mars 2011 prévoit que « le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne qui s’estime victime d’une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ». L’adoption des dispositions prévues dans la proposition de loi garantit l’application et le bénéfice des dispositions de cet article 5.
Vous avez eu raison, monsieur le sénateur, de rappeler la possibilité de saisir le Défenseur des droits, mais une proposition de loi ordinaire ne saurait modifier une loi organique sans courir le risque d’être censurée par le Conseil constitutionnel. Or les prérogatives du Défenseur des droits relèvent précisément de la loi organique.
Aussi, monsieur le sénateur, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
L'article 17 est adopté.
(Non modifié)
Toute personne physique ou morale qui lance une alerte de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal. –
Adopté.
(Non modifié)
Tout employeur saisi d’une alerte en matière de santé publique ou d’environnement qui n’a pas respecté les obligations lui incombant en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 du code du travail perd le bénéfice des dispositions du 4° de l’article 1386-11 du code civil. –
Adopté.
(Suppression maintenue)

Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.
Personne ne demande la parole ?...
Mes chers collègues, je vous signale que l’adoption d’une proposition de loi présentée par le groupe écologiste serait une première ! §
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi dans le texte de la commission.
J'ai été saisie de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe UMP et, l'autre, du groupe écologiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici le résultat du scrutin n° 123 :
Nombre de votants346Nombre de suffrages exprimés317Majorité absolue des suffrages exprimés159Pour l’adoption174Contre143Le Sénat a adopté définitivement la proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE. – Mme Chantal Jouanno applaudit également.

Madame la présidente, vous avez signalé, quelques instants avant le scrutin, que l’adoption d’une proposition de loi présentée par un groupe écologiste serait une première dans l’histoire du Parlement. Maintenant que la proposition de loi est définitivement adoptée, permettez-moi de vous faire partager mon émotion d’en avoir été le rapporteur !
Avant d’adresser quelques remerciements politiques, je tiens à saluer l’administration du Sénat, qui a accompli un travail très important pour aider les parlementaires dans la rédaction de la proposition de loi ; c’est aussi grâce à sa mobilisation que nous sommes parvenus à un texte aussi abouti.
Je rends hommage évidemment à l’auteur de la proposition de loi, Marie-Christine Blandin, qui a fait preuve d’une grande ténacité depuis l’origine de cette initiative, c’est-à-dire bien avant le début de la navette parlementaire il y a quelques mois. Cette proposition de loi qui vous tenait énormément à cœur, madame Blandin, c’est grâce à votre détermination qu’elle a été adoptée !
Je rends hommage aussi à tous les parlementaires qui ont travaillé sur ce texte, en particulier à son rapporteur à l’Assemblée nationale et à notre collègue Aline Archimbaud, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales en première lecture. J’associe à cet hommage tous nos collègues qui se sont exprimés en séance publique ou en commission, et que je ne peux pas tous mentionner.
Dans notre histoire, y compris immédiate, nombreux sont ceux qui ont souffert parce que des alertes n’avaient pas été lancées ou dépistées à temps. C’est pourquoi je trouve très symbolique qu’au sujet d’une proposition d’intérêt général, nous ayons été capables de dépasser les postures politiques et les majorités habituelles. C’est un signe de vitalité démocratique et de responsabilité collective !
Je remercie la ministre de l’écologie, Delphine Batho, dont je peux témoigner qu’elle s’est engagée personnellement pour l’adoption de cette proposition de loi, ainsi que les autres membres du Gouvernement concernés plus ou moins directement par ce texte, qui ne sont pas moins de cinq ! Je remercie enfin le Premier ministre pour les arbitrages qu’il a rendus.
Grâce à cette mobilisation collective, nous disposons désormais d’une loi qui, comme Mme Batho l’a indiqué, est applicable dans les meilleurs délais. Madame la ministre, nous serons attentifs à sa mise en œuvre, notamment à l’évolution du Comité de la prévention et de la précaution.
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE. – Mme Chantal Jouanno applaudit également.
Je tiens, à mon tour, à saluer cette première : l’adoption d’une proposition de loi présentée par un groupe écologiste n’a pas de précédent dans notre histoire et mérite donc d’être saluée comme il convient !
Je remercie les députés et les sénateurs de tous les groupes qui ont pris part à la construction de cette véritable avancée démocratique dont, en tant que ministre de l’écologie, je suis très fière.
Au nom du Gouvernement, en particulier de mes collègues Michel Sapin et Marisol Touraine, je me félicite de ce progrès pour l’indépendance de l’expertise et la prise en compte des lanceurs d’alerte. Il permettra d’éviter qu’une certaine loi du silence entoure parfois pendant trop longtemps des informations qui gagneraient à être prises en compte plus tôt pour éviter des drames sanitaires ou environnementaux.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous pouvez compter sur le Gouvernement pour prendre dans les meilleurs délais les mesures réglementaires nécessaires pour que cette loi soit appliquée dès sa promulgation. Quant aux moyens constants dont j’ai parlé, soyez assurés qu’ils seront mobilisés le plus rapidement possible.
Je remercie enfin les services de la direction générale de la prévention des risques et du Conseil général de l’environnement et du développement durable, qui ont suivi la construction parlementaire de cette belle avancée. §

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à seize heures dix, est reprise à seize heures vingt.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant réforme de la biologie médicale.
J’informe le Sénat que la commission des affaires sociales m’a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats qu’elle présente à cette commission mixte paritaire.
Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l’article 12 du règlement.

En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen du projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur et du projet de loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen.
Ces deux textes ont été déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale le 3 avril 2013.

L’ordre du jour appelle, à la demande du groupe écologiste, la discussion de la question orale avec débat n° 2 de Mme Aline Archimbaud à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les droits sanitaires et sociaux des détenus.
Cette question est ainsi libellée :
« En matière d’accès à une activité, Mme Aline Archimbaud rappelle que l’article 27 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 prévoit que « toute personne condamnée est tenue d’exercer au moins l’une des activités qui lui est proposée […] dès lors qu’elle a pour finalité la réinsertion de l’intéressé et est adaptée à son âge, à ses capacités, à son handicap et à sa personnalité ».
« Or le rapport d’information de M. Jean-René Lecerf et Mme Nicole Borvo Cohen-Seat intitulé Loi pénitentiaire : de la loi à la vie carcérale (n° 629, 2011-2012) notait qu’à la date de sa publication seules 39, 1 % des personnes détenues exerçaient un emploi ou suivaient une formation professionnelle.
« Certes, 24, 2 % de la population carcérale suit une formation relative à des enseignements fondamentaux, mais l’accès à une activité est encore largement insuffisant. De manière plus générale, les services pénitentiaires d’insertion et de probation manquent de moyens, tant financiers qu’humains, pour pouvoir accomplir leurs missions dans de bonnes conditions.
« En outre, bien que des efforts aient été effectués, les conditions de rémunération des détenus manquent de transparence. À titre d’exemple, l’« acte d’engagement » ne mentionne pas toujours le nombre d’heures travaillées. De même, les modalités de cotisation à la retraite restent floues. L’article 94 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites prévoyait que le Gouvernement remette à l’Assemblée nationale et au Sénat, au plus tard le 20 juin 2011, un rapport sur l’assimilation des périodes de travail en détention à des périodes de cotisations. Au 18 février 2013, ce rapport n’a toujours pas fait l’objet d’une transmission à la commission compétente du Sénat.
« Enfin, la publication de plusieurs textes d’application de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 enregistre un retard de plus en plus préoccupant.
« En matière de santé, Mme Aline Archimbaud rappelle que l’article 46 de cette même loi dispose que « la qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population ». Or de fortes inégalités dans l’accès aux soins perdurent. Le rapport sénatorial d’information de M. Jean-René Lecerf et Mme Nicole Borvo Cohen-Seat relevait les forts écarts de taux du nombre de professionnels de santé rapporté au nombre de détenus (en ‰) entre les différents départements. Celui-ci varie de 1 à 4 pour les médecins généralistes (de 1, 25 en Martinique à 4, 66 en Franche-Comté) et de 1 à 7 pour les psychiatres (de 0, 66 en Corse à 4, 61 en Guadeloupe).
« En outre, elle souligne les difficultés particulières rencontrées par les détenus handicapés ou malades. Selon une étude, menée dans les régions Rhône-Alpes et Auvergne sur les détenus « seniors » et reprise dans le rapport d’activité pour 2011 du Contrôleur général des lieux de détention, « 52 % des détenus interrogés ont indiqué qu’ils rencontraient des difficultés à accomplir seuls certains actes de la vie quotidienne (monter les escaliers, faire sa toilette, s’habiller, manger ou nettoyer sa cellule) et près d’un détenu sur quatre a exprimé la nécessité d’un aménagement de sa cellule, un tiers des détenus faisant état d’un manque d’équipement ou du besoin de l’aide d’une personne extérieure ». De manière plus générale, les mesures d’aménagement de peine pour raison médicale restent rares.
« Soulignant que la mise en œuvre effective des droits sanitaires des détenus et l’accès dans de bonnes conditions à une activité contribuent, à l’évidence, à une véritable politique de réinsertion, elle souhaiterait connaître quelles suites le Gouvernement entend donner aux préoccupations dont elle se fait l’écho. »
La parole est à Mme Aline Archimbaud, auteur de la question.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, il y a un peu plus d’un an, nous étions réunis dans cet hémicycle à l’occasion de l’examen par le Sénat du projet de loi de programmation relative à l’exécution des peines. Préparé à la hâte à la suite d’un fait divers tragique, ce texte était guidé par l’idéologie, que nous avions dénoncée, selon laquelle le tout-répressif constitue le meilleur remède à la récidive.
Les chiffres le montrent, le « consensus sécuritaire » de ces dernières années relève d’une pure idéologie, qui ne résiste pas à l’épreuve des faits : en dépit des réformes engagées par le gouvernement précédent, le taux de récidive n’a cessé d’augmenter, passant de 3 % en 2006 à 6 % en 2010 pour les crimes, et de 7 % à 11 % pour les délits.
Bien sûr, la lutte contre la récidive doit continuer de guider notre politique pénale. Mais, comme le gouvernement actuel, je considère que, pour être efficace, cette action nécessite de travailler prioritairement à la réinsertion. Cela peut prendre plusieurs formes, que le temps ne nous permet pas, aujourd’hui, de détailler toutes.
Monsieur le ministre, je sais que le Gouvernement s’est d’ores et déjà courageusement saisi de la question de l’aménagement des peines. Sachez que vous avez tout notre soutien sur ce dossier. Il serait d’ailleurs intéressant, une prochaine fois, de réfléchir à la mise en place en amont d’alternatives à l’incarcération. Toutefois, c’est sur les conditions sanitaires et sociales de détention que le groupe écologiste souhaite aujourd’hui, monsieur le ministre, mes chers collègues, attirer votre attention.
C’est une évidence : une réinsertion efficace doit se préparer tout au long de l’exécution d’une peine. Or les difficultés éprouvées par les détenus pour se former, accéder à une activité ou encore se soigner montrent que toutes les conditions ne sont pas réunies aujourd’hui pour que tel soit le cas.
Concernant les droits sociaux, je souhaite en premier lieu aborder la question du travail en détention. L’exercice d’une activité rémunérée est primordial pour les personnes détenues, car il leur permet de subvenir, si elles le souhaitent, à leurs besoins. Il garantit l’indemnisation des parties civiles, amorce une démarche de réinsertion et contribue à éviter la récidive.
Cependant, malgré la nécessité d’une telle activité, seules 39 % des personnes incarcérées bénéficient aujourd’hui d’un travail : ce pourcentage inclut la formation professionnelle rémunérée, à hauteur de 14, 6 % des actifs, et les emplois à l’extérieur dans le cadre d’un aménagement de peine. Ce chiffre tombe ainsi à 27 % si l’on ne prend en compte que le travail en détention.
Par ailleurs, n’oublions pas que le travail proposé est loin d’être toujours effectué à temps plein tout au long de l’année. Il est le plus souvent peu qualifié, connaît d’importantes fluctuations et sa rémunération est très faible, les revenus mensuels moyens des travailleurs détenus tournant autour de 318 euros, alors que le coût mensuel de la vie en prison est évalué à environ 200 euros.
Les personnes détenues ne bénéficient pas d’un contrat de travail et ne sont pas régies par le droit commun du travail. Les dispositions relatives non seulement à la période d’essai, au préavis, au droit commun d’expression collective des salariés, à la procédure de licenciement, mais également aux différents droits sociaux liés à l’exercice d’une activité professionnelle ne s’appliquent donc pas aux travailleurs privés de liberté. Les fiches de paie sont de surcroît souvent peu lisibles et les critères selon lesquels le montant de la rémunération est fixé, souvent très opaques.
Une question prioritaire de constitutionnalité est à l’étude sur ce sujet au Conseil constitutionnel et les prud’hommes ont accordé à une détenue, le 8 février dernier, le paiement d’un préavis de licenciement de 521 euros, les congés payés afférents, ainsi que des indemnités de 521 euros pour « inobservation de la procédure de licenciement ». Il serait bon que, sur cette question, le législateur et le Gouvernement agissent avant de se voir imposer un changement indispensable.
Exclu du droit commun, le travail réalisé en prison n’ouvre par ailleurs aucun droit à l’assurance chômage, situation qui compromet singulièrement la réinsertion des sortants. Pour ce qui est de l’assurance vieillesse, l’article 94 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites prévoyait la remise d’un rapport par le Gouvernement avant le 30 juin 2011, rapport dont nous n’avons jamais eu de nouvelles.
À ce jour, la situation des personnes incarcérées au regard de la retraite reste éminemment problématique. En l’absence d’un mode de calcul spécifique, la validation des semestres de cotisation est particulièrement difficile en prison, ce qui donne lieu à des montants de pensions très bas, de l’ordre de quelques dizaines d’euros seulement. En vertu de l’article R. 381-105 du code de la sécurité sociale, seuls les détenus travaillant au service général sont en mesure de valider leurs semestres de cotisation sur la base du temps de travail, plutôt que sur celle de la rémunération, cette règle n’étant d’ailleurs pas systématiquement appliquée par la Caisse nationale d’assurance vieillesse.
Une réflexion plus approfondie sur les moyens de faire progresser l’accès aux droits des personnes passées par la prison semble, à ce titre, nécessaire et urgent.
Par ailleurs, les dispositifs d’éducation et de formation professionnelle dans les lieux de détention subissent une situation persistante de crise structurelle et budgétaire. Pourtant, les besoins de la population carcérale sont considérables : plus d’un quart des détenus sont illettrés ou éprouvent des difficultés à lire, et près de la moitié d’entre eux n’ont aucun diplôme. En 2010, le taux de personnes ayant bénéficié d’une formation professionnelle n’a guère dépassé 8 %, et le taux de personnes scolarisées, 24 %.
Alors que les ministères de la justice et de l’éducation nationale se sont engagés à offrir aux personnes détenues « une éducation de qualité équivalente à celle dispensée dans le monde extérieur », la majorité des créations de postes réclamées par les unités d’enseignement en prison entre 2005 et 2010 ont été refusées pour des raisons d’économies budgétaires.

En outre, les fonds de fonctionnement de ces unités ont été réduits de près de 3, 5 %. Dès lors, les services de l’enseignement se trouvent dans l’incapacité de répondre à toutes les demandes…

… et sont contraints d’accorder la priorité aux formations de bas niveau, au détriment des niveaux plus élevés, notamment l’enseignement de second degré. Ils n’ont plus le temps nécessaire pour procéder au repérage systématique de l’illettrisme auprès des entrants. Du reste, moins de la moitié des personnes repérées comme illettrées et seulement un septième des personnes éprouvant des difficultés de lecture ont pu accéder à une formation générale.
Les crédits dévolus à la formation professionnelle sont marqués par la même tendance. L’offre de formation professionnelle a été réduite, et le temps annuel moyen de formation est tombé à 144 heures en 2010, contre 191 dix ans auparavant.
De surcroît, la pratique consistant à rémunérer tous les détenus stagiaires a été remise en cause : nombre de formations ne sont plus rémunérées, avec pour effet de détourner les détenus de ces cursus professionnalisants au profit de postes de travail non qualifiants, permettant seulement de bénéficier d’un revenu.
Monsieur le ministre, nous souhaitons également attirer votre attention sur les conditions de sortie des personnes détenues bénéficiant d’une mesure d’aménagement de peine sous écrou – semi-liberté, placement à l’extérieur ou sous surveillance électronique.
Ces détenus, contrairement aux personnes libérées définitivement ou bénéficiant d’une mesure de libération conditionnelle, n’ont pas le droit de récupérer à leur sortie les sommes figurant sur leur compte nominatif en prison. Or, selon les constats dressés par plusieurs structures, notamment l’Observatoire international des prisons, les sommes remises à la sortie des personnes bénéficiant de tels aménagements de peine sont souvent insuffisantes au vu des besoins.
Par exemple, en avril dernier, une personne placée sous surveillance électronique est sortie de la prison d’Annœullin avec 30 euros en poche, alors qu’elle disposait de 1 300 euros sur sa part disponible, une somme acquise grâce à son travail en détention.
Bien évidemment, l’absence de ressources suffisantes pour « reprendre pied » à la sortie est dramatique. Dans ces conditions, nous suggérons de permettre à ces personnes de bénéficier des fonds figurant sur leur « pécule de libération », …

… car il semble absurde et contre-productif, là encore en termes de prévention de la récidive, d’attendre la fin de la mesure d’aménagement de peine pour les leur remettre.
En outre, la précarité des conditions de la sortie est souvent renforcée par un manque de préparation à cette dernière.

Ainsi, comme l’a relevé le Contrôleur général des lieux de privation de liberté dans son rapport d’activité de 2012, le renouvellement des pièces d’identité n’est pas systématiquement organisé.
Dès lors, de nombreux détenus sortent sans justificatif d’identité, alors même que celui-ci constitue un préalable indispensable à de nombreuses démarches administratives : sans compte bancaire, il est impossible, par exemple, de contracter un abonnement mensuel de transport pour se rendre à Pôle emploi ou à un travail.
Monsieur le ministre, la seconde partie de ma question porte sur les conditions sanitaires de détention, qui, elles aussi, sont préoccupantes et semblent contraires à l’objectif de réinsertion que nous partageons.
Pourtant, il faut le reconnaître, d’importants progrès ont été accomplis, notamment depuis la loi du 18 janvier 1994, dont l’objectif était d’assurer aux personnes incarcérées « une qualité et une continuité de soins équivalant à ceux offerts à l’ensemble de la population ». En effet, depuis cette loi, les détenus sont affiliés au régime général de la sécurité sociale dès le premier jour de leur détention, et leurs dépenses de soins sont, à ce titre, intégralement prises en charge.
Cependant, un certain nombre d’obstacles importants s’opposent à la bonne prise en charge sanitaire des détenus, à commencer par des difficultés d’ordre administratif. Les délais d’affiliation auprès de certains organismes de sécurité sociale sont très longs : ils peuvent durer jusqu’à plusieurs mois.
Par ailleurs, bien que les personnes détenues puissent en théorie faire valoir un droit, par exemple à la couverture maladie universelle complémentaire, elles sont peu nombreuses à en disposer, du fait d’un déficit important d’information. Par exemple, une étude menée par la Caisse nationale d’assurance maladie en 2009 a montré que 67 % des détenus ne disposaient d’aucune couverture maladie complémentaire.
Un autre problème se pose concernant les affections de longue durée, les ALD, que l’assurance maladie ne souhaite pas prendre en charge durant l’incarcération. En la matière, la situation est chaotique. En effet, la communication entre la sécurité sociale et les services de l’administration pénitentiaire est extrêmement compliquée, ce qui provoque, par exemple, de très fréquentes ruptures de soins lors des permissions de sortie ou à la libération définitive, la sécurité sociale ne délivrant pas toujours aux détenus un document attestant de leur affiliation, et cela bien qu’une telle délivrance soit prévue par la réglementation.
Au-delà de ces difficultés d’ordre administratif, la présence des soignants en détention se heurte souvent à une culture pénitentiaire fondée sur le contrôle. Or celle-ci entre en contradiction avec les principes déontologiques de la médecine, qui, elle, suppose une relation de confiance avec le patient. Monsieur le ministre, mes chers collègues, ce point mérite lui aussi des réflexions approfondies et, certainement, des propositions de modification.
En pratique, on le sait, le secret médical est ainsi particulièrement mis à mal en prison. Lors des consultations, la confidentialité est difficile à réaliser, en raison notamment de l’exiguïté des locaux ou de leur manque d’insonorisation. La dispensation des médicaments est parfois effectuée par des personnels de surveillance, en contradiction avec les dispositions du code de la santé publique.
En outre, dans la majorité des établissements pénitentiaires, les distributions ne garantissent pas l’anonymat, notamment pour les traitements administrés aux patients atteints du VIH ou pour les traitements de substitution en cas d’addiction. Les informations circulent ensuite dans les lieux de détention, ce qui pose de réels problèmes.
L’accès aux soins est également souvent entravé par certaines règles qui prévalent dans les établissements pénitentiaires.
Par exemple, un déni existe autour de la question des pratiques sexuelles et de l’usage de drogues. Cette hypocrisie généralisée a pour conséquence les résultats médiocres enregistrés par la France dans la lutte contre les risques infectieux et la prévalence du VIH, qui est aujourd'hui 4, 5 fois supérieure en détention qu’en milieu libre.
Il y aurait aussi beaucoup à dire sur les difficultés que rencontrent certains détenus pour accéder à la boîte aux lettres du médecin ou encore sur les dysfonctionnements, liés notamment au manque d’effectif des surveillants, des interventions de nuit.
Les extractions en cas d’urgence ou de nécessité d’une consultation à l’extérieur ou d’une hospitalisation posent également de nombreux problèmes, puisque, en pratique et contrairement à ce que prévoit la réglementation, les personnes détenues sont presque systématiquement menottées lors de leur transfert, sans considération ni de leur « dangerosité » ni de leur état de santé. En 2006, après une visite en France, M. Alvaro Gil-Robles, commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, avait déjà dénoncé cette situation et indiqué qu’il y avait là une difficulté.
Par exemple, en 2010, un détenu de 28 ans victime d’un infarctus du myocarde survenu dans le centre de détention de Muret a été amené à demander réparation : ayant dû patienter trois heures avant d’être pris en charge, il avait subi les soins de préparation au bloc avec ses entraves aux pieds, bien que le médecin cardiologue ait demandé qu’elles lui soient ôtées. Et ce n’est qu’un exemple parmi bien d’autres.
Le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe a estimé que l’examen médical des détenus soumis à des moyens de contrainte, tel qu’il est pratiqué en France, constituait une « pratique hautement contestable tant du point de vue de l’éthique que du point de vue clinique ». Ces différentes pratiques sont d’autant plus inquiétantes qu’elles produisent, chez les personnes détenues, des refus de se soigner, ce qui, bien sûr, pose un problème de santé publique grave.
De manière générale, les moyens manquent. Là encore, dans son rapport d’activité de 2012, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté fait état d’une très grande inégalité dans l’offre de soins dans les lieux de détention.
En effet, l’accès aux soins spécialisés reste difficile : le manque de personnel médical, notamment de chirurgiens-dentistes, est général. Le problème est récurrent, les effectifs de soignants en prison ayant été déterminés en 1996 en fonction des places théoriques des établissements. Seize ans plus tard, le nombre de ces soignants est demeuré inchangé, alors que la population pénale, qui s’élevait alors à 57 000 personnes, en compte aujourd’hui 10 000 de plus.
Par ailleurs, l’offre de programmes d’éducation pour la santé et d’actions de prévention demeure souvent insuffisante faute de moyens humains, obligeant les unités de consultation et de soins ambulatoires, les UCSA, à se concentrer uniquement sur les soins curatifs.
Les récentes contaminations par le bacille de Koch, vecteur de la tuberculose, intervenues en prison mettent en lumière ce déficit de prévention. Le dernier cas révélé concerne cinq surveillants de la maison d’arrêt de Villepinte, contaminés par un détenu. Il faut dire que cet établissement, prévu au départ pour moins de 600 prisonniers, en compte aujourd'hui plus de 900…
De surcroît, l’accès aux soins est inséparable des conditions matérielles de vie des personnes privées de liberté. Or, en pratique et de manière générale, l’état d’insalubrité de certains établissements pénitentiaires limite l’utilité des contrôles.
Autre difficulté, les conditions de détention sont particulièrement mal adaptées à certains types de détenus. On pourrait notamment évoquer le vieillissement de la population pénale, qui entraîne, par ailleurs, une augmentation du nombre de personnes en situation de dépendance. On estime aujourd'hui que près d’un détenu sur dix a besoin d’une assistance quotidienne en raison d’un problème de santé. Or le manque de moyens favorise bien évidemment la dégradation accélérée des capacités d’une partie des détenus.
Enfin, les troubles psychiques concernent un nombre de plus en plus important de personnes en détention. Faute de structures de soins adaptées, l’hôpital laisse à la rue des malades, jusqu’à ce que leurs symptômes les fassent basculer dans la criminalité ou la délinquance. Aujourd'hui, ce problème a pris une dimension considérable, 16 % des détenus ayant été hospitalisés pour raisons psychiatriques avant leur incarcération.
Si la loi du 9 septembre 2002 a créé les unités hospitalières spécialement aménagées – ou UHSA –, certains professionnels, indiquant qu’ils les considèrent comme « un formidable effort dans la mauvaise direction », demandent une évaluation de la première tranche de ces nouvelles structures. Il est vrai qu’une réflexion doit être menée à leur sujet : en renforçant la psychiatrisation, en transformant l’hôpital en lieu de soin carcéral, les UHSA instrumentalisent la psychiatrie à des fins répressives, sans permettre à l’hôpital public d’améliorer ses missions de soin par ailleurs.
Il faudrait aussi réfléchir de façon urgente à l’atténuation de la responsabilité pénale des auteurs d’infraction dont le discernement était altéré au moment des faits. Mon collègue Jean-René Lecerf a notamment formulé des propositions très précises sur cette question.
Monsieur le ministre, pour résumer, vous aurez compris que notre groupe partage l’objectif que s’est fixé le Gouvernement : orienter les efforts et les moyens de la politique pénitentiaire vers la réinsertion plutôt que vers la répression. À ce titre, nous aimerions connaître les actions que le Gouvernement envisage pour améliorer les conditions sanitaires et sociales de détention en France.
Il nous semble important d’élargir le débat au-delà du problème de la récidive, un point important et sensible, qui a beaucoup été débattu ces dernières années. Depuis la révolution de 1789 – les textes de l’époque l’attestent –, sur la base de valeurs humanistes, notre République définit la prison comme le lieu de la sanction, mais aussi de l’amendement possible du condamné par le travail et par la formation. En 2013, quels moyens mettons-nous en œuvre pour donner aux détenus cette possibilité d’amendement ?
Monsieur le ministre, par cette question orale avec débat, nous voulions vous alerter sur la situation des détenus, qui est loin d’être satisfaisante, et qui est même terriblement préoccupante. Nous espérons que nous pourrons travailler ensemble à l’améliorer.
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe socialiste. – M. Bernard Fournier applaudit également.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le thème retenu par la conférence des présidents pour cette séance de question orale avec débat est particulièrement important, et nous pouvons remercier Aline Archimbaud de l’avoir proposé.
Aujourd'hui, force est de constater que les détenus ne sont pas seulement privés de leur liberté de mouvement. Ils sont également privés de la pleine application des droits sanitaires et sociaux qui, inhérents à la personne humaine, ne peuvent théoriquement faire l'objet d'aucun aménagement ni d’aucune restriction dans notre République. Je pense particulièrement au droit à la santé, au sens où l'entend l'Organisation mondiale de la santé.
Déjà, en 2010, la Cour des comptes rendait public un rapport dans lequel elle soulignait la gravité de la situation en ces termes : « La santé est un secteur très défaillant en prison », précisant par ailleurs que l'environnement pénitentiaire était inadapté pour les détenus atteints des pathologies les plus lourdes, telles que le VIH, et pour ceux qui se trouvent en fin de vie ou en situation de dépendance.
Cette situation s’explique notamment par le nombre insuffisant des médecins intervenant dans les prisons. Toutefois, elle est aussi inhérente aux conditions mêmes d’incarcération des détenus. La surpopulation provoque naturellement des maladies, tout comme l'état des structures.
Comment ne pas faire le lien entre des conditions de détention extrêmement difficiles, qui ressemblent parfois aux conditions de vie en situation d'extrême pauvreté, et une prévalence de la tuberculose dix fois plus élevée en milieu carcéral qu'à l'extérieur ? Je pense ici à un article du Monde concernant la prison des Baumettes, qui a défrayé la chronique en décembre dernier. Assez effrayant, il laisse perplexe quant à la situation sanitaire des détenus.
Depuis lors, la situation ne s'est pas améliorée ; elle s'est même considérablement détériorée si l'on considère la santé mentale des détenus. Selon les sources de l'administration pénitentiaire elle-même, en 2011, 80 % des détenus souffraient de troubles psychiatriques ; 7°% des détenus souffriraient ainsi de schizophrénie, quand seulement 1 % de la population totale est concernée en France. La proportion est strictement identique pour les détenus atteints de paranoïa. Cette surreprésentation des maladies mentales en milieu carcéral doit nous inviter à trouver de meilleures réponses pour l’accompagnement des détenus, ainsi qu'à réviser notre législation pénale.
Pour notre part, nous insistons sur la nécessité de réintroduire un mécanisme permettant de réduire réellement la sanction pénale pour les personnes qui sont reconnues pénalement responsables d'une infraction mais qui présentent une altération du discernement en raison d'une pathologie mentale. Cette mesure appellerait à son tour une réforme, sans doute tout aussi ambitieuse, de l'offre de soins psychiatriques en ville. Elle devrait reposer sur une approche bienveillante et non sécuritaire, ainsi que sur une politique de secteurs renforcée et modernisée.
En outre, au regard du nombre de détenus souffrant d’addictions aux drogues ou à l'alcool, je ne puis, dans la continuité du rapport remis par ma collègue Laurence Cohen en qualité de rapporteur pour avis sur la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, que regretter l'insuffisance, pour ne pas dire l'indigence, des politiques préventives de traitement et de réduction des risques en prison.
Cette absence de politique volontariste n'est pas sans conséquence pendant et après la détention. En prison, le risque infectieux est bien plus élevé qu'à l'extérieur : celui d’une contamination par l'hépatite C est multiplié par dix et celui de l'hépatite B, par quatre.
Si certains efforts ont été accomplis pour permettre l'accès des détenus à des traitements de substitution, il faut faire preuve de plus de détermination et d'imagination. Faisons confiances aux professionnels de santé et aux associations. Donnons-leur la parole pour qu’ils puissent formuler des propositions qui répondent à l'urgence sanitaire que représentent les détenus souffrant d'addictions.
Si le milieu carcéral présente d'importantes déficiences pour l'accès à la santé, il apparaît comme une véritable zone de non-droit au regard des droits sociaux. La prison, qui devrait être un temps de réinsertion sociale et professionnelle, ne remplit pas, loin s'en faut, sa mission.
L'article 27 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 prévoit tout de même que « toute personne condamnée est tenue d'exercer au moins l'une des activités qui lui est proposée [...] dès lors qu'elle a pour finalité la réinsertion de l'intéressé et est adaptée à son âge, à ses capacités, à son handicap et à sa personnalité ».
Pourtant, dans les faits, seuls 39, 1 % des personnes détenues exercent un emploi ou suivent une formation professionnelle. Et lorsqu'ils travaillent, les détenus ne sont pas protégés par les règles de droit commun qui s’appliquent aux salariés. Ils ne disposent pas d'un contrat de travail, mais d'un contrat d'engagement. Les exigences contractuelles imposées aux employeurs sont quasi-inexistantes en prison, et certains contrats ne précisent ni les tâches qu'auront à effectuer les détenus ni le nombre d'heures travaillées.
Cette situation, particulièrement l'absence de contrat, produisait encore, il y a peu, un effet surprenant : les conflits liés à l'exercice d'une activité professionnelle en prison ne relevaient pas des conseils de prud’hommes, dans la mesure où cette juridiction n’était compétente que pour les conflits nés à l'occasion d'un contrat de travail.
Très récemment, comme vient de le rappeler Aline Archimbaud, le conseil des prud'hommes de Paris s’est déclaré compétent, considérant que la fin de la collaboration d’un détenu avec une entreprise, sur l'initiative de cette dernière, devait s'analyser comme un licenciement ouvrant droit au bénéfice de toutes les protections et dispositions prévues dans le code du travail.
Cette décision doit nous inciter collectivement à élaborer un dispositif qui puisse être enfin sécurisant pour les détenus. Nous ne pouvons accepter que le respect de leurs droits dépende de décisions de justice rendues au cas par cas et qui soufrent, par définition, d'une certaine instabilité.
Aussi, monsieur le ministre, pourriez-vous nous indiquer la position du Gouvernement, ainsi que les mesures qu'il entend prendre dans le sens d'un renforcement réel des droits des détenus en prison, mais aussi après leur détention, notamment en matière de droits à la retraite ?
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la question des droits sociaux et sanitaires des détenus est fondamentale, sur un plan à la fois éthique et pratique. C’est pourquoi je remercie notre collègue Aline Archimbaud de l'avoir inscrite à l'agenda de la Haute Assemblée.
D'un point de vue éthique, cette question renvoie à celle de la nature même de la société que nous voulons. L'état d'un système carcéral en dit long sur le cadre politique et social qui l'a engendré. Autrement dit, montez-moi vos prisons, et je vous dirai qui vous êtes : une société de droit, de cohésion et d'inclusion ou bien une société qui tolère en son sein le non-droit et l'exclusion.
En France, au XXIe siècle, une telle alternative n’a pas lieu de perdurer, car le choix s’impose. Les prisons n'ont pas vocation à être des sanctuaires, ou plutôt des oubliettes, où les détenus seraient privés non seulement de la liberté, mais également de tout le reste. De par leur nature même, elles ont pourtant tendance à le devenir depuis de trop nombreuses années, ce qui compromet jusqu'à leur utilité.
En effet, l'enjeu n'est pas seulement éthique, il est aussi pratique et concret. C'est toute la question de l'efficacité de la peine qui est posée. Sauf exceptions, l'incarcération est une sanction ponctuelle, qui doit préparer la réinsertion. L'une n'a aucun sens sans l'autre. Or plus les conditions d'incarcération sont mauvaises, plus les chances de réinsertion s'amenuisent. Et, force est de le constater, la situation de notre pays est très préoccupante de ce point de vue.
Le problème n'est pas nouveau. Aline Archimbaud l'a rappelé, la France a semblé le découvrir ou le redécouvrir en 2000 avec le rapport de nos collègues Jean-Jacques Hyest et Guy-Pierre Cabanel, au titre si éloquent, Prisons : une humiliation pour la République.
Toutefois, pour parvenir, en 2000, à un tel constat, il aura fallu que la situation se dégrade depuis bien longtemps. Et il faudra attendre encore neuf ans pour que ce rapport trouve une traduction législative digne de ce nom, avec la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.
Ce texte a incontestablement représenté un progrès, dans la mesure où il a doté la France d'une loi fondamentale du service public pénitentiaire. Auparavant, les normes régissant les droits et obligations des détenus étaient principalement issues de dispositions réglementaires, de circulaires et de notes administratives. La loi de 2009 a instauré un droit à un minimum de revenus, un droit au travail et à l'insertion par l'activité économique, notamment avec l'acte d'engagement professionnel, un droit à la vie familiale, etc.
Pour autant, les choses ont-elles fondamentalement changé sur le terrain ? Non, ou du moins insuffisamment, si l'on en croit le rapport d'information de nos collègues Jean-René Lecerf et Nicole Borvo Cohen-Seat du 4 juillet dernier, qui en dresse le bilan. La loi de 2009 serait insuffisamment appliquée et par trop incantatoire. Cette situation est pour le moins insatisfaisante, mais elle n'a, hélas, rien d'étonnant.
En effet, de quoi parle-t-on lorsque l'on évoque les droits sanitaires et sociaux des détenus ? Le champ de la question est extrêmement large : il couvre les deux grands domaines que sont la garantie et le respect des droits et libertés fondamentales en prison et l'accès des détenus à une réinsertion socioprofessionnelle.
À lui seul, le premier de ces domaines est vaste. Il va du droit au respect de la vie privée au droit à la santé et à la sécurité, en passant par le droit à la famille, à la culture, à l'information et au culte.
Le second est moins vaste, mais tout aussi décisif : il s'agit du droit pour tout détenu à une formation et à un exercice professionnel au cours de sa détention.
Puisque l'on ne peut parler de tout en un temps si contraint, je me focaliserai sur ce second point. Il est déterminant, car si les détenus ne peuvent accéder dans de bonnes conditions à une formation et travailler durant leur détention, leur réinsertion sur le marché du travail sera particulièrement problématique à leur sortie.
Or, aujourd'hui, l'accès des détenus à une réinsertion socioprofessionnelle demeure malheureusement l’une des grandes faiblesses de l’institution pénitentiaire.
L'accès à la formation, c'est pour commencer la lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisme. Un rapport de 2006 du Conseil économique et social – avant que celui-ci ne devienne aussi environnemental – remis par M. Donat Decisier, souligne l’étendue des besoins en la matière et les lacunes du système.
Il y a six ans, 18, 3 % des détenus étaient en situation d'illettrisme et 13, 9 % d’entre eux rencontraient des difficultés pour la lecture. Or, à cette époque, le repérage de l'illettrisme auprès de la population carcérale n'était pas systématique et la loi de 2009 n'a pas abordé cette question pourtant majeure. Par conséquent, monsieur le ministre, où en sommes-nous aujourd'hui ?
Par ailleurs, les efforts déployés pour développer l'activité professionnelle en prison sont encore insuffisants. Alors que l'obligation d'activité constituait l'un des grands axes de la loi pénitentiaire, d'ailleurs introduit par le Sénat, son bilan est décevant : l'emploi et la formation ne concernent encore qu'une minorité de personnes détenues. Le taux d'activité global s'élève – le chiffre vient d’être cité – à 39, 1 %. Encore n'est-il qu'un trompe-l'œil au regard de l'objectif final de la réinsertion socioprofessionnelle, puisque la notion d'activité est ici très largement définie.
Parmi ces activités, combien sont suffisamment qualifiantes pour aider l’ancien détenu à réintégrer le marché du travail une fois sa peine purgée ? Environ la moitié seulement des 39 % des détenus occupés exerceraient de telles activités. Ainsi, 80 % des détenus ne bénéficient pas aujourd'hui d’une formation ou d'une activité professionnelle susceptible de favoriser leur réinsertion socioprofessionnelle.
Les limites du système sont connues et très bien analysées par le rapport Lecerf-Borvo. Elles sont tout d’abord juridiques : la notion d'activité est trop largement définie, l'acte d'engagement n'est pas encore mis en œuvre, la rémunération à un taux horaire préfixé demeure problématique. Néanmoins, elles sont aussi financières : à l'heure où les marges de manœuvre sont partout contraintes, bien sûr, une telle politique réclame des moyens.
Monsieur le ministre, le développement d'une véritable formation professionnelle des détenus constituera-t-il un axe prioritaire de l’action du Gouvernement ? La question est d'autant moins anodine que, plus généralement, la formation professionnelle est sans doute le plus important des chantiers qu'il nous faut lancer de façon urgente en matière d'emploi.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et du groupe écologiste.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce débat intervient alors que la Cour de cassation a décidé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité sur le droit du travail applicable aux détenus.
Le code de procédure pénale prévoit que « les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail ». Toute la question est de savoir si cette disposition porte atteinte, ou non, aux droits et libertés garantis par la Constitution.
La question du droit du travail en prison n'est pas nouvelle. En 2000, la commission d'enquête sur la situation dans les prisons françaises, présidée par M. Louis Mermaz, relevait que « l'absence de respect du droit du travail ruine la conception même du travail pénal comme outil d'insertion ».
Lors de la loi pénitentiaire de 2009, l’ancienne majorité n’est pas allée jusqu’à l’institution d’un contrat de travail en détention, estimant que l’application du droit commun – congés payés, rémunération au moins égale au SMIC, indemnisation en cas de rupture du contrat – dissuaderait les entreprises privées d’employer des personnes détenues.
Elle a prévu la conclusion d’un acte d’engagement entre l’administration et la personne détenue énonçant « les droits et obligations professionnels de celle-ci, ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération. » Cette disposition semble aujourd'hui inappliquée ; l’accès au travail reste encore soumis à l’arbitraire de l’administration pénitentiaire, le déclassement ne constituant qu’une simple mesure disciplinaire.
Dans son rapport de 2011, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté déplorait cette situation. Surtout, il relevait que les détenus exerçant une activité rémunérée pour le « service général » ou pour des entreprises extérieures étaient traités et payés de manière injuste, voire dérisoire. La loi impose des minimas de 45 % du SMIC pour la production et de 33 % pour le service général, mais les payes sont souvent inférieures, si bien que ces chiffres deviennent en réalité des plafonds.
Ajoutons à cela que les détenus travaillent dans des conditions bien éloignées des règles d’hygiène et de sécurité du code du travail qui s’imposent en détention : espaces pas ou peu aérés, fréquemment exigus, machines ayant quelquefois plus de trente ans d’âge ou étant d’un maniement dangereux, etc.
L’inspection du travail n’a même pas le droit de se rendre inopinément en prison ; elle doit y être invitée par l’administration. Le moins que l’on puisse dire, étant donné que l’on a affaire à des gens bien organisés, c’est que, ce jour-là, les choses se passent plutôt bien…
En février dernier, le conseil des prud’hommes de Paris a donné gain de cause à une détenue qui demandait notamment que soit reconnue comme licenciement la fin de sa collaboration avec l’entreprise venue sous-traiter dans l’établissement pénitentiaire.
Contrairement à cette décision, qui ne concerne que les relations établies entre un détenu et une entreprise, mais qui pourrait néanmoins faire jurisprudence, la question prioritaire de constitutionnalité, ou QPC, touche au code de procédure pénale. Les conséquences qui en découleraient s’appliqueraient donc à tous les détenus exerçant une activité professionnelle.
Le droit du travail semble entrer peu à peu dans la prison et la décision du Conseil constitutionnel pourrait nous pousser à nous emparer rapidement de cette question. Monsieur le ministre, quelle est la position du Gouvernement sur ce point ?
D’autres aspects font l’objet d’un rappel à l’ordre continu de la part du Contrôleur général. Dans son rapport de 2012, celui-ci a notamment insisté sur le fait que les personnes privées de liberté méconnaissent leurs droits ; il a rappelé l’exigence de leur donner une information effective, tant cette dernière reste aujourd’hui fréquemment parcellaire. Sur ce point, je voudrais saluer Mme la garde des sceaux, qui a souhaité faciliter la diffusion au sein des établissements pénitentiaires de la dernière édition du Guide du prisonnier, rédigé par l’Observatoire international des prisons.
S’agissant des droits sanitaires, le Contrôleur général note qu’en raison des difficultés d’accès aux hôpitaux et des conditions de détention inadaptées, certains détenus ne peuvent pas se soigner dans des conditions dignes en prison. Bien que la suspension de peine pour raison médicale existe, celle-ci reste selon lui trop restrictive. La prise en charge effective des urgences en milieu carcéral demeure disparate en raison, notamment, de l’éloignement géographique de certaines structures pénitentiaires.
Dans leur rapport sur l’application de la loi pénitentiaire de 2009, Jean-René Lecerf et Nicole Borvo Cohen-Seat soulignent que l’accès aux soins, quels qu’ils soient, souffre de fortes inégalités d’une région à l’autre, avec un taux de médecins pour 1 000 détenus variant d’un à quatre pour les généralistes et d’un à sept pour les psychiatres.
Il semble aussi que beaucoup reste à faire pour prendre en compte la situation des personnes âgées ou très malades en détention.
On le voit bien, les droits sanitaires et sociaux ne sont malheureusement pas toujours effectifs en prison. Beaucoup l’ont dit, la privation de liberté ne signifie pas la privation des droits. Les détenus restent des citoyens, des personnes humaines à part entière, et la meilleure chance de réussir leur insertion, c’est précisément de reconnaître leurs droits fondamentaux.
Nos prisons sont, encore aujourd’hui, des lieux où trop de femmes et d’hommes demeurent soumis à des conditions de vie dégradantes et humiliantes.
Le groupe RDSE auquel j’appartiens est depuis longtemps très attentif à cette question du respect des droits et de la dignité des détenus. Faut-il rappeler le rapport de 2000 de Guy-Pierre Cabanel, ancien président de notre groupe, et de Jean-Jacques Hyest intitulé Prisons : une humiliation pour la République, qui fait encore autorité, ou encore l’excellente discussion qui s’est déroulée ici-même, le 11 mai 2006, à l’occasion de la question orale avec débat du regretté président Jacques Pelletier sur le respect effectif des droits de l’homme en France ?
Monsieur le ministre, nous savons que Mme la garde des sceaux et vous-même préparez avec beaucoup d’engagement personnel une grande loi pénitentiaire, tant attendue à la fois par les détenus et les fonctionnaires de l’administration. Nous l’attendons et, d’ici là, nous approfondirons encore la question le 25 avril prochain, puisque le Sénat, à la demande du groupe RDSE, mènera ce jour-là un débat plus large sur la politique pénitentiaire en France.
Applaudissements.

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, la question des droits sanitaires et sociaux est une question majeure pour les détenus et leurs familles, mais aussi pour toutes celles et tous ceux qui travaillent en détention, ainsi que pour notre démocratie. Je remercie notre collègue Aline Archimbaud de l’avoir posée.
L’excellent rapport de nos collègues Jean-René Lecerf et Nicole Borvo Cohen-Seat, qu’il convient de saluer à nouveau, intitulé Loi pénitentiaire : de la loi à la réalité de la vie carcérale, posait un diagnostic implacable et lucide.
En démocratie, les droits de l’homme ne s’arrêtent pas aux portes des prisons, au contraire, et nous voudrions insister sur quelques points, dont certains furent déjà mentionnés.
Le premier point d’importance est le droit à l’intimité en prison, qui devrait être reconnu plus explicitement. Du fait de la promiscuité, ce droit est souvent dénié. C’est ici la question de la surpopulation carcérale qui se pose à nous, mais également celle de l’architecture de nos prisons et de la conception de la surveillance au sein de celles-ci.
Le deuxième point concerne le droit à l’hygiène la plus élémentaire, qui fait parfois défaut. À cet égard, j’invite chaque parlementaire à visiter une prison deux jours consécutifs, afin d’en mesurer toute la réalité. Le cas de Marseille, même s’il est particulièrement emblématique, n’est pas isolé ; je vous conseille également une visite à la prison d’Angers.
Le droit à l’accès aux soins adaptés et proportionnés reste un sujet majeur. Dans de très nombreuses prisons, 50 % des détenus sont littéralement assommés par de véritables camisoles chimiques qui, si elles permettent parfois – et encore, pas toujours – le sommeil, ne favorisent ni la vie sociale ni le sevrage d’autres dépendances ni la construction d’un projet après la prison.
L’accès à l’exercice physique et au sport reste extrêmement dérisoire par rapport aux attentes et aux besoins. Enfin, on fume beaucoup en prison, ce qui pose des problèmes de cohabitation dans les cellules entre fumeurs et non fumeurs. Il s'agit également d’une préoccupation sanitaire majeure.
L’accès aux soins, les bonnes conditions d’hospitalisation posent un problème récurrent, Aline Archimbaud l’a souligné, avec des détenus malades placés dans des conditions extrêmement difficiles, parfois inhumaines. A contrario, de nombreuses personnes souffrant de troubles psychiques très graves surpeuplent nos prisons faute de structures de soins adaptées pour les accueillir à temps. La prison n’est alors souvent qu’une ultime étape dans un parcours très difficile.
Je voudrais également aborder un autre point, plus délicat, plus complexe et qui ne fera pas l’unanimité ici : en théorie, il n’y a pas de sexualité ni de vie sexuelle en détention. Or cela pourrait se discuter, certains pays ayant fait d’autres choix.
Pour autant, même avec les règles telles qu’elles sont appliquées dans notre pays, il nous semble qu’un libre accès aux préservatifs, loin d’être une « invitation à… », serait un élément extrêmement important en matière de prévention du sida. Il s’agit d’un problème de santé publique pour les détenus, leurs familles, leurs conjoints, mais aussi pour tous, en démocratie.
Enfin, je voudrais soulever la question compliquée de la connaissance, ou plutôt de la méconnaissance, de leurs droits par les détenus, qui a un impact très important sur les droits sanitaires et sociaux. À l’arrivée en détention, les règles sont souvent très vite ou trop vite expliquées. La connaissance des droits qu’ont les détenus est extrêmement lacunaire, nous avons pu le constater à la prison d’Angers. Nous devons encore progresser concernant cette information des personnes sur leurs droits, et pas seulement sur leurs devoirs.
Aussi, nous demandons qu’il soit donné à chaque détenu un règlement intérieur complet et clair des règles appliquées à la prison. Cela nous semble constituer un impératif majeur.
Nous attendons toujours, sauf erreur de notre part, la publication du décret en Conseil d’État relatif à la loi pénitentiaire de 2009 sur les règlements intérieurs type par catégorie d’établissement pénitentiaire, qui sont essentiels à l’exercice par les détenus des droits et libertés que la loi leur reconnaît par ailleurs et qui permettraient, selon nous, un meilleur exercice des droits sanitaires et sociaux.
Même si les femmes représentent proportionnellement une infime minorité de la population carcérale en France, j’aimerais rappeler ici les difficultés particulières que rencontrent les détenues.
En détention se posent un certain nombre de problèmes spécifiques, par exemple pour les femmes enceintes ou les mères de jeunes enfants. Vous le savez comme moi, mes chers collègues, seuls vingt-cinq établissements sont équipés pour recevoir les mères et leurs jeunes enfants, qu’elles peuvent garder auprès d’elles jusqu’à l’âge de dix-huit mois.
Une soixantaine d’établissements pénitentiaires sur 191 accueille des femmes et cinq établissements seulement reçoivent les femmes condamnées à des peines moyennes ou longues. Cela signifie que le nombre de kilomètres à parcourir par les proches est beaucoup plus important pour les femmes incarcérées que pour les hommes détenus.
Par ailleurs, les centres de détention longue sont plutôt situés au nord de l’Hexagone, ce qui pose un véritable problème de visite, notamment pour les femmes du sud. Toutes les statistiques le montrent, les femmes reçoivent moins de visites en prison que les hommes ; les chaînes de solidarité sont rompues plus rapidement. Il conviendrait selon nous de prendre en compte ce problème spécifique.
La privation de liberté est la peine, rien que la peine, dans une démocratie qui se veut toujours en matière de droits humains une référence, prompte à donner des leçons à nos voisins proches ou éloignés. Les conditions difficiles de détention, telles qu’elles existent en France, n’ont, selon nous, aucune vertu éducative, n’aident pas à la construction d’un projet de sortie et sont une honte pour une démocratie qui se respecte.
Que comptez-vous faire, monsieur le ministre, de concert avec Mme la garde des sceaux, pour remédier à cette situation ? Nous vous remercions de votre réponse.
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe socialiste.

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, en introduction à mon intervention, après avoir remercié Aline Archimbaud de son initiative, je souhaiterais rappeler un certain nombre de points sur lesquels nous pourrions sans doute tomber d’accord – ce serait en quelque sorte notre propre conférence de consensus – et qui nous permettraient, je crois, d’avancer enfin dans notre appréhension de la prison, au bénéfice des personnes détenues comme des victimes, du personnel pénitentiaire comme de la société tout entière.
Tout d’abord, notre diagnostic est unanime, des commissions d’enquêtes parlementaires de 2000 – chacun se souvient du titre du rapport sénatorial Prisons : une humiliation pour la République – jusqu’aux déclarations du Président de la République devant le congrès en juin 2009.
Je le cite : « Comment accepter […] que la situation dans nos prisons soit aussi contraire à nos valeurs de respect de la personne humaine ? La détention est une épreuve dure, elle ne doit pas être dégradante. Comment espérer réinsérer dans la société ceux qu’on aura privés pendant des années de toute dignité ?
« L’état de nos prisons, nous le savons tous, concluait Nicolas Sarkozy, est une honte pour notre République, quel que soit, par ailleurs, le dévouement du personnel pénitentiaire ».
Ensuite, notre attachement à l’application volontariste de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 est très partagé, comme nous nous en sommes rendu compte, Nicole Borvo Cohen-Seat et moi-même, en rédigeant, au nom de la commission des lois et de la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois, notre rapport d’information sur l’application de la loi pénitentiaire. Néanmoins, plus de trois ans après son entrée en vigueur, des décrets d’application manquent encore à l’appel et bon nombre de ses dispositions, du régime des fouilles à l’expression collective des personnes détenues, de leur droit à l’image à l’obligation d’activité, ne font l’objet que d’une mise en œuvre évanescente.
Enfin, je suis convaincu qu’il est aujourd’hui indispensable de sanctuariser l’univers carcéral, ainsi, sans doute, que de larges aspects de notre politique pénale, afin de les prémunir de toute tentation politico-électoraliste.
Selon Pierre-Victor Tournier, dont je cite ici le titre du dernier ouvrage, la prison est « une nécessité pour la République », quelle que soit la majorité du moment. En ce qui me concerne, partageant cette réflexion attribuée à Albert Camus selon laquelle « une société se juge à l’état de ses prisons », j’aimerais, mes chers collègues, que nous puissions léguer, en ce domaine, une appréciation moins calamiteuse que celle que nous méritons depuis trop longtemps.
J’en viens maintenant au thème de notre question orale avec débat, à savoir les droits sanitaires des personnes détenues.
Comment ne pas évoquer une première évidence, dont il n’est cependant guère question ni dans la loi pénitentiaire ni dans les réflexions récentes sur la lutte contre la récidive, à savoir l’envahissement de nos prisons par la maladie mentale ?
Je rappelle que le Sénat a introduit dans la loi pénitentiaire un article sur le sens de la peine : « Le régime d’exécution de la peine de privation de liberté concilie la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne détenue, afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions. »
Or, dans un rapport d’information que Gilbert Barbier, Christiane Demontès, Jean-Pierre Michel et moi-même avions réalisé au nom de la commission des lois et de la commission des affaires sociales, nous avions à la fois repris les estimations des pouvoirs publics, selon lesquelles il y aurait près de 25 % de personnes atteintes de troubles mentaux en prison, et surtout estimé, à la lumière de travaux récents et de constats plus empiriques, à 10 % de la population pénale la proportion des personnes atteintes des troubles mentaux les plus graves – schizophrénie et autres formes de psychoses – et pour lesquelles la peine n’a aucun sens. Pourtant, ces personnes ont été jugées responsables. On a considéré que leur discernement avait simplement été altéré et non aboli.
Il va de soi que le mouvement de désinstitutionalisation de la psychiatrie et la forte diminution des capacités d’hospitalisation sont passés par là.
Pis encore, les personnes dont le discernement a été pour le moins diminué sont plus sévèrement sanctionnées que celles dont on considère qu’elles étaient pleinement conscientes de la portée de leurs actes.
Dès lors, comment s’étonner des drames que connaissent nos prisons, à l’instar de celui qui est survenu à Rouen, où un détenu a assassiné son codétenu avant de commencer à dévorer ses entrailles ? Comment ne pas comprendre la peur des uns et des autres dans la situation de surpopulation carcérale dont nous souffrons, comme la détresse des personnels pénitentiaires ?
Gilbert Barbier, Christiane Demontès et moi-même avons déposé une proposition de loi relative à l’atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits. Elle prévoit notamment de réduire d’un tiers la peine encourue tout en renforçant les obligations de soins.
Cette proposition de loi, qui eut Jean-Pierre Michel pour rapporteur, fut adoptée à la quasi-unanimité par le Sénat, malgré l’opposition du gouvernement de l’époque. Toutefois, elle attend toujours son inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.
Parallèlement, comment la société est-elle protégée lorsque l’abolition du discernement est une évidence, ou dans le cas des personnes dont l’extrême dangerosité est connue mais qui ne sont pas, ou pas encore, passées à l’acte ? Je pense au témoignage de ce père qui me racontait le drame de sa vie, la maladie mentale de son fils, de la multiplication des alertes à l’égorgement de l’animal de compagnie dans la baignoire, de l’appel au secours de la famille aux autorités jusqu’au meurtre gratuit d’une voisine et à l’enfermement carcéral.
Lorsqu’une délégation de la commission des lois, dont je faisais partie, ainsi que Robert Badinter, s’est rendue à Tournai, en Belgique, pour y visiter un établissement de défense sociale, elle a été impressionnée par le respect de la dignité des personnes dans un univers médical fermé. Même si ce système ne présente pas que des avantages au regard des libertés, il nous avait semblé que la réflexion sur les liens entre justice et santé méritait d’être largement approfondie.
Même les UHSA, les unités hospitalières spécialement aménagées, qui marquent pourtant un progrès dans le traitement des situations de crise des détenus atteints de troubles mentaux, ne risquent-elles pas de nous conduire à laisser incarcérer, sans avoir trop mauvaise conscience, des personnes pour qui la peine n’a aucun sens, et à prendre acte de la place de la folie dans nos prisons ?
Entendons-nous bien : il ne s’agit pas de contester les progrès accomplis dans les soins aux personnes détenues depuis la fin de la médecine pénitentiaire. En matière de soins somatiques, beaucoup a été fait, même si dans son dernier rapport le Contrôleur général des lieux de privation de liberté recense encore de nombreuses insuffisances. En matière de soins psychiatriques, beaucoup reste à faire, sachant, en outre, qu’il est difficile de trouver des psychiatres dans les déserts médicaux, où nombre d’établissements pénitentiaires ont été construits.
J’en viens au second volet de notre réflexion de ce soir : l’exercice d’une activité en détention. La loi pénitentiaire a mis en place, non sans mal, une obligation d’activité, sur l’initiative de la commission des lois du Sénat. Si, dans un premier temps, on nous a reproché de vouloir rétablir les travaux forcés ou de ne pas respecter traités et conventions internationales, ces critiques n’ont pas duré. L’obligation d’activité traduit la volonté de faire du séjour en prison un temps utile et de la réinsertion un objectif volontariste et déterminé.
En effet, l’obligation d’activité ne pèse pas uniquement sur la personne détenue, loin s’en faut. Elle incombe aussi à l’administration pénitentiaire et, au-delà, à la société tout entière. Or le bilan en matière d’emploi carcéral et de formation est largement insuffisant. Des efforts importants restent à accomplir. À cet égard, monsieur le ministre, permettez-moi de tracer quelques pistes.
Où en est l’instauration d’une priorité pour les productions des établissements pénitentiaires dans le cadre des marchés publics, promise par nombre d’anciens gardes des sceaux, dont Mme Dati et Mme Alliot-Marie ? Elle nécessiterait une modification du code des marchés publics, qui relève de la compétence réglementaire, comme en son temps cette préférence fut accordée pour les SCOP, les sociétés coopératives ouvrières de production.
Ne peut-on cesser de compartimenter les compétences pour rechercher le travail carcéral ? Ainsi, même dans les établissements à gestion privée, les démarches des directeurs d’établissement auprès des chambres de commerce et d’industrie, des chambres de métiers et de l’artisanat et des associations d’employeurs sont irremplaçables.
Les nouveaux établissements doivent comprendre des locaux, des ateliers adaptés au développement d’activités. C’est souvent le cas, mais pas toujours. Ainsi, le centre pénitentiaire du Havre, qui est pourtant récent, n’est pas exemplaire sur ce point.
L’administration pénitentiaire ne peut-elle mieux tirer parti des initiatives efficaces qui ont parfois été prises et les multiplier ? Ainsi, dans mon département, le Nord, une plateforme de formation au tri sélectif des déchets avait été mise en place à la prison de Loos-lez-Lille, puis reconstruite à la maison d’arrêt de Douai.
Les personnes détenues bénéficiaient à leur sortie d’un contrat de travail avec une société d’économie mixte partenaire de Lille Métropole Communauté Urbaine. Les résultats se sont révélés particulièrement encourageants. Or toute prison produit des déchets, les métiers du tri sont recherchés et offrent des débouchés quasiment assurés partout. Aussi, pourquoi ne pas encourager de telles initiatives ?
La formation professionnelle des personnes détenues gagnerait à être confiée aux régions. Or l’expérimentation prévue dans la loi pénitentiaire s’est heurtée au cahier des charges avec les partenaires privés et à l’obligation de limiter la compétence des régions aux établissements à gestion publique. Il importe, me semble-t-il, de corriger cet obstacle imprévu.
J’exprimerai enfin quelques craintes.
L’ensemble des interlocuteurs sur le travail carcéral attirent l’attention sur les risques liés au passage à la rémunération horaire prévue par l’article 32 de la loi pénitentiaire, au lieu d’une rémunération à la pièce. Ce dispositif ne doit absolument pas conduire à évincer d’un poste de travail les personnes détenues les plus fragiles afin de répondre aux objectifs de rentabilité des entreprises concessionnaires.
De même, on en a parlé, le Conseil constitutionnel se prononcera prochainement, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, sur la compatibilité avec les droits garantis par la Constitution des dispositions de l’article 717-3 du code de procédure pénale, aux termes duquel « les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail ».
Je rappellerai que l’urgence aujourd’hui est de fournir du travail aux personnes détenues, que nous sommes loin d’y parvenir dans des conditions satisfaisantes, que, contrairement à ce que l’on entend parfois, les entreprises qui fournissent aujourd'hui de l’activité aux personnes détenues sont des entreprises citoyennes et non des exploiteurs de la misère.
L’enfer peut être pavé de bonnes intentions. L’octroi d’un contrat de travail et de l’ensemble des droits qui y sont liés aux personnes détenues entraînerait inéluctablement l’effondrement de l’offre de travail et serait finalement un obstacle à la réinsertion. Il faudra procéder dans ce domaine par des progrès successifs, mais limités, afin de ne pas risquer de très sévères déconvenues.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, je conclurai en vous rappelant une date, celle du 24 novembre 2014, laquelle marque la fin du moratoire prévu, une fois de plus, dans la loi pénitentiaire et permettant de déroger à la règle de l’encellulement individuel.
C’est essentiellement grâce au Sénat que cette règle a été sauvegardée en 2009, bien que des dérogations indispensables aient été maintenues, notamment pour préserver certaines personnes détenues fragiles. Même s’ils ont sauvé le principe de l’encellulement individuel, les sénateurs n’en sont pas pour autant devenus des ayatollahs : ils considèrent qu’un taux de 30 % de cellules doubles, ce qui correspond au dernier programme 13 200, ne serait pas choquant.
Pour le reste, la surpopulation reste le principal facteur de dégradation des conditions de détention : elle nourrit les tensions et les violences, entraîne des suicides, rend insoluble les problèmes d’optimisation du travail et de formation professionnelle pour tous en milieu carcéral et pèse sur les conditions de travail du personnel pénitentiaire.
Il fut un temps où il fallait construire des places de prison. Les programmes Chalandon, Méhaignerie et Perben, notamment, furent les bienvenus. Aujourd'hui, la priorité est la réussite des aménagements de peine et des alternatives à l’incarcération. Toutefois, de même qu’une politique pénitentiaire ne saurait se réduire à l’évolution des capacités de détention, une politique d’aménagement des peines ne saurait se résumer à l’augmentation du nombre de bracelets électroniques.
Dans l’étude d’impact de la loi pénitentiaire, il était précisé que le recrutement de 1 000 conseillers d’insertion et de probation était un préalable à la réussite d’une telle politique. Nous en sommes loin.
La limitation des constructions de nouvelles places de prison doit permettre de résoudre le problème de tous ceux, personnels d’insertion et de probation et réseaux associatifs, qui permettront de conjuguer aménagement et réinsertion, retour des prisons de la République dans un État de droit intransigeant et progrès de la lutte contre la récidive, et cela pour la sécurité de tous.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et du groupe écologiste. – Mme Isabelle Pasquet applaudit également.
M. Thierry Foucaud remplace Mme Bariza Khiari au fauteuil de la présidence.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à souligner le grand mérite de Mme Archimbaud, grâce à qui ce débat a lieu aujourd'hui. Nous devons tous la remercier.
Un certain nombre d’entre nous étaient présents dans cet hémicycle lors de l’examen de la loi pénitentiaire et ont soutenu ce texte, sur l’ensemble de nos travées. Cette loi avait suscité chez nous beaucoup d’espérance et de nombreuses attentes, notamment parce qu’elle avait le grand mérite d’essayer de s’appuyer sur les règles pénitentiaires européennes, lesquelles sont des orientations fondamentales.
Trois ans et demi après le vote de la loi pénitentiaire, nous voici obligés aujourd'hui de nous pencher de nouveau sur la réalité carcérale. Et le constat n’est pas joyeux, comme le montrent le travail d’évaluation de Jean-René Lecerf et de Nicole Borvo-Cohen Seat, le rapport annuel du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, l’excellent rapport de notre collègue député, Dominique Raimbourg, mais aussi les travaux de la Chancellerie, notamment la conférence de consensus pour une nouvelle politique publique de prévention de la récidive et la circulaire de politique pénale publiée en septembre dernier par Mme la garde des sceaux.
Tous ces documents vont dans le même sens. Ils mettent d’abord en lumière une évidence, qui a déjà été évoquée et dont je ne dirai donc qu’un mot : il convient, mes chers collègues, de ne jamais oublier le sens de la peine. Celui-ci n’est pas, évidemment, de priver les détenus de leurs droits. La peine doit avoir un sens pour la société, comme pour le détenu. Elle doit viser à prévenir les futures infractions, d’empêcher la récidive. Or on ne prévient pas cette dernière en retirant le droit des prisons, en supprimant les droits des détenus.
Ces documents soulignent un autre aspect, d’une portée considérable, que plusieurs orateurs, notamment Jean-René Lecerf, ont évoqué. On peut parler longuement des droits, mais si l’on ne veut pas qu’ils restent purement formels, il faut se pencher sur les conditions matérielles que connaissent les détenus.
Tous les rapports que je viens de mentionner, ainsi que les prises de position de Mme Taubira, nous le rappellent : l’aspect matériel de la question est essentiel. Tant que nous connaîtrons cet état de surpopulation pénale, les droits que la loi pourra conférer aux détenus ne seront pas véritablement exercés par eux.
Je rappellerai d’un mot la situation. La surpopulation pénale est un fait. Elle se traduit par la cohabitation de plusieurs détenus dans une même cellule, dans laquelle, parfois, des matelas sont mis à même le sol, par manque de lits.
J’aime reprendre une formule, certes un peu provocante, je le reconnais, pour illustrer ce point. Je ne comprends pas qu’un arrêté fixe la superficie des chenils et accorde à chaque chien cinq mètres carrés quand nous sommes incapables de rédiger un texte réglementant la superficie à laquelle chaque détenu a droit ! Tout ne se compare pas, bien sûr, mais ce point a pour moi quelque chose de choquant.
Si nous en sommes là, c’est que nous sortons d’une décennie d’inflation carcérale. Au cours de la période 2002-2012, le nombre des personnes placées sous écrou s’est accru de 52 % et celui des personnes détenues de 34 %. Naturellement, ces augmentations ont provoqué les plus grandes catastrophes : la promiscuité, donc, souvent, la perte du droit à la dignité, la violence, les suicides. Elles compromettent le respect des droits sociaux et sanitaires qui sont au cœur de notre discussion.
Je tiens à évoquer plus longuement trois de ces droits : le droit au travail, le droit au maintien des liens familiaux et le droit à l’intégrité physique.
En ce qui concerne le droit au travail, je rappellerai seulement que l’article 27 de la loi pénitentiaire reconnaissait déjà le principe d’une obligation d’activité. Or nous ne pouvons que regretter l’interprétation réglementaire qui en a été faite.
Dans notre esprit, le droit à l’activité signifiait essentiellement un droit à la formation, donc, évidemment, à la réinsertion. Toutefois, le décret a élargi cette interprétation. Il a considéré que les activités éducatives, certes importantes, et sportives, sans doute essentielles, entraient dans le champ du droit à l’occupation. Ce n’est pas exactement ce que le législateur avait entendu !
Le chiffre a déjà été donné – vous m’excuserez, mes chers collègues, de le rappeler –, seuls 39 % des détenus exercent aujourd'hui une activité au sein d’une prison. C’est un drame pour la réinsertion, car c’est par le travail en prison que l’on apprend à travailler en dehors de celle-ci.
C’est un drame, également, au cœur même des prisons. Dans ces lieux, l’indigence est une misère effroyable. En prison, un indigent devient l’esclave des autres prisonniers, d’une multitude de façons, que je ne décrirai pas ici. En prison, l’indigence est source d’un esclavage moderne – et encore, ce dernier adjectif semble inapproprié.

Pourtant, nous le savons, un tiers des détenus ne perçoivent que 50 euros par mois. Une façon d’améliorer leur lot, pour pouvoir cantiner, par exemple, est d’exercer une activité. Sans cela, un détenu n’a pas de revenus, il est à la merci des autres.
Il faut donc revoir le volume de travail, ainsi que le montant de la rémunération. François Fortassin l’a très justement indiqué, la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel, issue du conseil des prud’hommes de Paris, est de la plus grande importance. Elle pose cette question simple : le droit du travail s’applique-t-il en prison ? La réponse semble contenue dans la question !
Si la décision rendue tendait à imposer l’application du droit du travail en prison, il pourrait en résulter un effet pervers extraordinaire : la fin du travail en prison. Il faut tenir compte de cette conséquence éventuelle, comme l’a justement indiqué Jean-René Lecerf.
Je voudrais maintenant évoquer devant vous, mes chers collègues, l’importance des liens familiaux pour les détenus. L’article 35 de la loi pénitentiaire affirmait le droit au maintien des droits familiaux en prison. C’est heureux, puisque la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales souligne, dans son article 8, que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
Une décision de la Cour européenne des droits de l’homme, qui n’est pas si ancienne, puisqu’elle date de 2010, va encore plus loin. Je voudrais, d’ailleurs, que les établissements pénitentiaires l’entendent bien. La Cour européenne indique, en effet, que l’administration pénitentiaire doit aider – j’insiste sur ce verbe – au maintien des liens familiaux. Il ne s’agit pas seulement de les tolérer, dans le sens où la loi actuelle le prévoit. Or c’est loin d’être le cas aujourd’hui.
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne dit pas autre chose. Il dresse sur ce point un bilan alarmant. Dans les premiers mois, en général avant la condamnation, les visites sont assez fréquentes. Un point m’a beaucoup frappé d'ailleurs : les visites sont plus importantes pour les hommes que pour les femmes.
Mmes Esther Benbassa et Corinne Bouchoux acquiescent.

D’une façon générale, je suis d’accord pour dire que la situation des femmes en prison est pire que celle des hommes.

Ensuite, plus la peine est longue, moins les visites sont fréquentes. Un tiers des visites sont ponctuelles, les visites régulières étant donc encore moins nombreuses.
Cette situation s’explique par l’éloignement des centres de détention. À cet égard, les chiffres sont très significatifs. Ils nous apprennent, en effet, que 16 % des détenus d’un centre de détention sont issus du département où celui-ci se trouve. Seulement 16 % des familles, donc, en sont proches. Pour les maisons centrales, lieu où les détenus purgent leur peine, le chiffre tombe à 6 %.
Les familles sont donc très éloignées du détenu. Le lien familial s’en trouve, évidemment, compromis. Il l’est également parce que les visites sont trop souvent limitées au week-end, parce qu’elles sont de courte durée – trente minutes pour la plupart d’entre elles –, et parce que le retard des familles à un rendez-vous est parfois puni. S’il y a retard, il n’y a pas de visite ! Tout cela, sans doute, n’incite pas les familles à faire tous les efforts nécessaires pour voir leurs proches, car ils sont, pour elles, trop difficiles à accomplir.
J’irai plus vite sur mon dernier point, qui est relatif au droit à l’intégrité des détenus.
Le droit à l’intégrité, ce n’est pas rien ! Il se décline, tout d’abord, dans le droit à ne pas faire l’objet de violences. Or la prison est le théâtre des plus grandes violences.
Mme Corinne Bouchoux acquiesce.

Il comprend, ensuite, le droit à ne pas se suicider. Or la France est un des pays européens où l’on se suicide le plus en prison.
Il recouvre, enfin, un autre droit, qui m’a été signalé par Maryvonne Blondin. Un vrai problème se pose, en effet, pour les transsexuels en prison. Ceux-ci sont peu nombreux, vivent dans la misère en dehors de la prison et dans une misère encore plus grande à l’intérieur de ses murs. On ne sait pas dans quelle prison les placer. Le choix se fait sans doute sur des critères qui n’ont rien à voir avec leur situation. Il se fait probablement sur la base de leur état civil, qui est erroné. Le traitement hormonal n’est, en outre, pas administré en prison.
Le droit à l’intégrité enveloppe également le droit de se faire soigner en prison. L’article 46 de la loi pénitentiaire insiste sur « la qualité et la continuité des soins » donnés aux personnes détenues. On connaît les disparités existant entre les territoires et selon les types de soins. J’insisterai sur la question des handicapés en prison. §Leur situation requerrait une adaptation des règles de sécurité. C’est un vaste chantier qui, certainement, attend Mme la garde des sceaux.
Enfin, un détenu n’a pas le droit de voir sa maladie mentale reconnue.
Mmes Esther Benbassa et Corinne Bouchoux acquiescent.

Le paradoxe, c’est que, d’un côté, nous connaissons une surpopulation pénale, et, de l’autre, certains détenus n’ont rien à faire en prison ! Un des moyens d’éviter la surpopulation serait de retirer ces personnes de prison. Il faudra, évidemment, aménager des lieux qui leur conviendront mieux. En tout cas, cela me semble tout à fait nécessaire.
Sur ce point, comme souvent, d’ailleurs, la justice – le tribunal administratif, d’un côté, le juge judiciaire, de l’autre – est le moteur des droits des prisonniers. Dans une décision intéressante de janvier 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Douai a accordé une provision à un jeune schizophrène, car ce dernier n’avait pas pu bénéficier des soins adaptés à son état. Le juge des référés a donc estimé qu’il y avait une provision à allouer au titre de son préjudice. Même si nous connaissons la portée limitée de ce type de décision, un tel jugement me paraît intéressant. Il faudra voir le sort qui lui sera réservé par la suite.
Pour terminer, je voudrais reprendre mes propos liminaires. On peut toujours parler des droits. Il le faut, d’ailleurs, et il est heureux que cette question ait été posée. Cependant, il est nécessaire d’aller au-delà. M. le ministre le sait bien, il faudra sans doute lancer le chantier d’une nouvelle loi pénitentiaire, qui tienne compte des exigences de la société – ne soyons pas naïfs – comme de celles de la réinsertion, à savoir l’application de véritables droits en prison. Il faudra également moderniser les prisons. Non pas forcément en construire plus – c’est un vaste débat ! –, mais faire en sorte que les centres de détention existants permettent d’assurer le maintien des liens sociaux, un travail et l’accès à la santé.
Il faut, surtout, selon moi, une politique pénale différente de celle que nous avons connue ces dernières années.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées de l'UMP.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, madame Archimbaud, mesdames, messieurs les sénateurs, Mme la garde des sceaux, actuellement retenue à Matignon, vous prie de bien vouloir excuser son absence. Celle-ci m’aura permis de représenter le Gouvernement et de participer à un débat de qualité, qui fut particulièrement intéressant. Je tiens, d’ailleurs, à saluer l’ensemble des orateurs qui se sont exprimés.
Comme vous, mesdames, messieurs les sénateurs, Mme la garde des sceaux partage la conviction selon laquelle la mise en œuvre des droits sanitaires ou autres des personnes détenues, ainsi que l’accès à une activité, sont une absolue nécessité pour garantir la réinsertion des personnes, prévenir la récidive et, par conséquent, éviter de nouvelles victimes.
Il s’agit de l’un des axes forts de la politique qu’elle mène depuis sa nomination au Gouvernement. Elle aura, d’ailleurs, l’occasion de discuter de l’application de la loi pénitentiaire et des sujets liés à l’administration pénitentiaire lors du débat organisé par le Sénat le 25 avril prochain, auquel elle m’a indiqué qu’elle participerait personnellement.
Toutefois, elle m’a d’ores et déjà chargé d’apporter un certain nombre de réponses et d’orientations aux questions que vous avez pu lui poser.
La loi pénitentiaire a été votée sous l’ancienne majorité, mais avec le soutien de l’opposition de l’époque, qui s’y était ralliée en raison d’un certain nombre d’avancées significatives dans la prise en charge des personnes détenues.
Force est toutefois aujourd’hui de constater que cette loi a été en partie vidée de son sens par la mise en place de mécanismes d’incarcération automatiques et par l’absence totale de prise en compte des publics sous main de justice, de manière spécifique dans les politiques publiques, durant des années, suscitant l’exclusion des personnes suivies par la justice d’un certain nombre de dispositifs liés à l’emploi, à la formation, au logement ou à la santé.
Le processus législatif n’a d’ailleurs pas été mené jusqu’à son terme, puisque la précédente majorité, en près de trois ans, n’a pu publier les trois derniers décrets d’application, qui portent sur des sujets particulièrement complexes, il faut le reconnaître, et sur lesquels le ministère de la justice travaille aujourd’hui activement.
Je répondrai maintenant plus précisément à vos interrogations.
Vous avez questionné le Gouvernement sur la formation professionnelle. L’accès à la formation est un droit et une nécessité pour une prison digne de la République. Quoi de plus gratifiant pour une personne condamnée que de montrer qu’elle est capable d’obtenir un diplôme et d’être davantage utile à la société dans laquelle elle va retourner, surtout quand on sait que la majorité des personnes détenues ont un niveau de formation très faible ?
Environ 700 actions de formation professionnelle sont aujourd’hui offertes aux personnes détenues, et plus de 28 000 personnes en ont bénéficié en 2012, soit une augmentation de 9, 6 % par rapport à 2011.
La première des pistes nouvelles est l’expérimentation de la décentralisation en matière de formation menée dans deux régions – Aquitaine et Pays de la Loire –, sur la base de l’article 9 de la loi pénitentiaire. Les premiers éléments qui nous ont été communiqués tendent à dresser un bilan très positif de l’expérience. Il semble toutefois important à Christiane Taubira de disposer une analyse plus fine des premiers résultats.
Une inspection commune de l’Inspection générale des services judiciaires, l’IGSJ, et de l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, devrait donc être ordonnée dans les semaines qui viennent.
Au-delà de cet axe fort, qui permettra une amélioration de l’offre et de la formation, il importe d’inciter les personnes à s’inscrire à une activité de formation professionnelle adaptée à leur parcours d’exécution de peine. L’administration pénitentiaire développe en ce sens des procédures d’accueil-information, puis de bilan, d’évaluation et d’orientation dès l’arrivée de la personne en détention. Une information continue et l’accès à l’information tout au long de la période d’incarcération sont également accessibles au public incarcéré.
S’agissant du travail, certes, de plus en plus de Français connaissent le chômage. Néanmoins, le droit à travailler et à pouvoir contribuer à la marche de la société, la possibilité de gagner de l’argent, de rembourser les victimes et de faire des cadeaux à ses enfants malgré sa condition de condamné devant assumer sa dette vis-à-vis de la société sont essentiels. Ils sont primordiaux pour demeurer un citoyen, pour devenir ou pour rester autonome, pour se réinsérer en sortant de prison et pour ne pas récidiver.
En moyenne, chaque mois, plus de 25 000 personnes détenues exercent une activité rémunérée en 2012. Les chiffres sont encore en légère augmentation par rapport à 2011. Le taux d’activité global des personnes écrouées s’est élevé à 37, 7 %, variant selon le type d’établissement : 28, 4 % en moyenne en maison d’arrêt et 52, 6 % en moyenne en établissement pour peine.
La question du travail en détention est complexe, comme le prouvent à la fois l’actualité et les décisions parfois contradictoires rendues par les différentes juridictions saisies. Ce dernier point a été rappelé par beaucoup d’entre vous.
La Cour de cassation vient, en tout état de cause, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel pour s’assurer de la constitutionnalité des dispositions relatives au travail en détention contenues dans la loi pénitentiaire.
La loi pénitentiaire a modifié sensiblement les conditions du déroulement de l’activité de travail, en particulier en ce qui concerne l’engagement des personnes détenues et les modalités de leur rémunération. Elle prévoit, notamment, la formalisation de la relation de travail entre l’établissement et la personne détenue par l’intermédiaire d’un acte d’engagement, ainsi que la rémunération horaire.
La mise en œuvre de ces nouvelles dispositions, tout à fait légitimes, est cependant délicate, car elle est susceptible d’avoir un impact important sur le coût du travail pénitentiaire pour les entreprises qui interviennent dans les établissements, ce qui pourrait se traduire par un désengagement de leur part dans un contexte de crise économique particulièrement aiguë.
Aussi est-il important de concilier les changements qui vont s’imposer avec la préservation du développement du travail pénitentiaire.
La garde des sceaux a donc demandé à l’administration pénitentiaire d’engager une réflexion approfondie sur ces points avec les partenaires traditionnels que sont les prestataires des établissements en gestion déléguée et les concessionnaires, notamment, mais aussi de dégager de nouveaux axes d’intervention.
De premières pistes apparaissent. Tout d’abord, la loi pénitentiaire a déjà prévu l’intervention des structures par l’insertion économique. Ce système n’avait pu être mis en place jusqu’ici, en particulier pour des raisons liées au montant de l’aide au poste. Le Gouvernement a réaffirmé sa volonté de concrétiser ce dispositif dans les meilleurs délais à l’occasion du plan de lutte contre les exclusions ; Christiane Taubira y travaille avec Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Une autre piste est la recherche de nouveaux partenaires dans le monde de l’entreprise. Plusieurs propositions sont actuellement à l’étude.
Enfin, dernière piste, les mutations sectorielles de l’économie conduisent l’administration pénitentiaire à développer le travail en secteur tertiaire au sein des établissements.
Comme vous le constatez, mesdames, messieurs les sénateurs, il n’est pas question pour la ministre de la justice de rester inactive sur ce sujet majeur et d’attendre de voir comment les choses évoluent. C’est au Gouvernement de prendre des initiatives et de faire preuve d’imagination. Nous savons pouvoir compter sur les propositions des parlementaires pour nous aider à avancer.
En ce qui concerne la production d’un rapport sur les droits à la retraite du public détenu prévu par l’article 94 de la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010, la garde des sceaux n’a pas encore été destinataire du résultat du travail mené par le ministère des affaires sociales et de la santé sur les bases des informations que le ministère de la justice a pu lui transmettre.
Néanmoins, il est évident que ce travail sera poursuivi. C’est d’ailleurs ce que fait d'ores et déjà l’administration pénitentiaire, en lien avec la Caisse nationale d’assurance vieillesse.
S’agissant des services pénitentiaires d’insertion et de probation, les SPIP, Christiane Taubira veut leur permettre d’assumer leurs fonctions auprès des personnes détenues dans les meilleures conditions. Cela passe par la préparation des procédures d’aménagement de peine, bien sûr, mais aussi par l’accompagnement des personnes détenues, en lien avec le personnel de surveillance, vers les activités, c'est-à-dire, en premier lieu, du travail, de la formation et de l’enseignement, mais aussi de la culture et du sport.
Quelque 3 820 personnels d’insertion et de probation étaient en exercice pour accomplir toutes ces missions, ainsi que celles de suivi en milieu ouvert, en 2012. Vous le savez, dans un contexte budgétaire pourtant contraint, la garde des sceaux a décidé de recruter dans ce secteur. 63 nouveaux emplois de conseillers d’insertion et de probation ont été inscrits dans la loi de finances pour 2013.
Il convient d’ajouter à ce chiffre le recrutement en 2013 de 88 conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation placés, de 20 psychologues et de 18 assistantes sociales de secteur, aux fins d’assurer un meilleur accompagnement et suivi des personnes détenues et de faire de l’emprisonnement une période utile, tournée vers la préparation de la sortie.
Je dirai un mot des structures de santé. Depuis la loi de 1994, le ministère des affaires sociales et de la santé a compétence en matière d’organisation, de crédits et d’affectation des personnels soignants au sein des établissements pénitentiaires.
L’inégalité entre les régions que vous dénoncez est cependant une réalité, qui peut avoir pour origine, notamment, l’installation d’établissements pénitentiaires dans des zones géographiques où les installations médicales et sanitaires sont peu nombreuses. C’est particulièrement vrai outre-mer.
La ministre de la santé a déjà lancé un vaste programme pour faire venir les médecins dans des zones jusqu’ici désertées au travers du « Pacte territoire-santé ». La ministre de la justice poursuivra ce travail avec Marisol Touraine, par exemple lors des comités santé-justice.
En ce qui concerne l’action spécifique du ministère de la justice, il convient de noter que l’administration pénitentiaire et la direction générale de l’offre de soins travaillent conjointement à la mise en œuvre et à l’optimisation d’une série de dispositifs permettant une meilleure prise en charge sanitaire des publics sous main de justice : hospitalisations dans les établissements hospitaliers de rattachement, mais aussi dans les unités hospitalières sécurisées interrégionales ; soins psychiatriques dispensés dans les centres hospitaliers spécialisés et dans des unités hospitalières spécialement aménagées dont le déploiement se poursuit sur le territoire ; restructurations et extensions des locaux des UCSA, les unités de consultation et de soins ambulatoires, chaque fois que l’architecture des bâtiments le permet et, dans tous les cas, sur les nouveaux établissements pénitentiaires.
Le plan de lutte contre les exclusions présenté par le Premier ministre a enfin permis d’inscrire des mesures concrètes en faveur des publics suivis par la justice, que ce soit par la mise en place de permanences en addictologie dans les établissements pénitentiaires, par exemple, ou encore par la désignation de référents justice dans les structures de soins ou médico-sociales, pour faciliter les admissions dans ces établissements et permettre ainsi une continuité des suivis.
J’en viens enfin aux difficultés particulières que rencontrent les personnes détenues handicapées ou malades.
L’accueil des personnes handicapées en milieu carcéral fait bien évidemment l’objet d’une attention particulière des services du ministère de la justice. Celle-ci se manifeste notamment sur le plan immobilier, avec la mise en service de cellules plus grandes et plus adaptées pour les personnes handicapées dans les établissements déjà sortis de terre, par exemple pour la rénovation de Fleury-Mérogis, et dans tous les programmes en préparation : entre 2 % et 3 % de cellules aménagées selon la taille des établissements.
Néanmoins, au-delà de l’aspect immobilier, Christiane Taubira souhaite également améliorer l’accompagnement humain des personnes malades ou souffrant de handicap. Tel est d’ailleurs l’enjeu du comité interministériel sur le handicap que M. le Premier ministre a mis en place et sur lequel les services du ministère de la justice travaillent déjà.
Ainsi, l’administration pénitentiaire veille par exemple à ce que les personnes détenues souffrant de handicap aient accès à des activités adaptées, en partenariat avec les fédérations sportives, mais aussi avec des structures proposant des activités d’ergothérapie, de musicothérapie, entre autres.
L’accompagnement, ce sont aussi les conventions qui sont signées avec une quarantaine d’associations et d’entreprises de services d’aide à domicile et de services de soins infirmiers à domicile pour permettre leur intervention en détention. À ce titre, Mme la garde des sceaux a demandé à l’administration pénitentiaire de lancer une vaste enquête dans les 191 établissements pénitentiaires pour disposer d’un état des lieux, jusqu’ici inexistant.
Et quand l’état de santé d’une personne n’est plus compatible avec son maintien en détention ou quand son pronostic vital est engagé, il est de la responsabilité des pouvoirs publics de lui permettre de se soigner dans des conditions dignes ou de terminer ses jours près de ses proches. Or, on le constate, la procédure d’aménagement de peine ou de suspension de peine pour motif médical est complexe et longue. S’il est indispensable de s’assurer que la personne concernée ne commettra pas de nouveaux faits, une telle prudence ne doit pas aboutir à laisser des gens mourir en détention.
C’est la raison pour laquelle Christiane Taubira et Marisol Touraine ont mis en place deux groupes de travail sur la thématique « santé-justice », le premier portant sur la réduction des risques en milieu carcéral et le second sur les suspensions et aménagements de peine pour motif médical. Les premières conclusions de ces groupes de travail seront remises à la mi-avril 2013 et les deux ministres présideront un comité « santé-justice » à la fin du mois d’avril ou au début du mois de mai prochain pour présenter leurs premières orientations sur ces sujets.
Encore une fois, vous le constatez, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement est mobilisé sur ces problématiques complexes, qui touchent à la fois au respect de la dignité, à la citoyenneté, à la réinsertion et, au final, à la place que la société fait aux personnes ayant commis des fautes.
À la société de clivages et d’exclusion qu’on a voulu nous imposer au cours de la dernière décennie, nous voulons répondre par une société de l’inclusion, qui punit ceux qui le méritent, mais qui aide ceux qui le veulent à se réintégrer.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste. – M. Jean-René Lecerf applaudit également.

Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant réforme de la biologie médicale.
La liste des candidats établie par la commission des affaires sociales a été affichée conformément à l’article 12 du règlement.
Je n’ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : Mmes Annie David, Catherine Génisson, MM. Ronan Kerdraon, Jacky Le Menn, Alain Milon, René-Paul Savary et Jean-Marie Vanlerenberghe ;
Suppléants : Mme Aline Archimbaud, MM. Gilbert Barbier, Yves Daudigny, Mmes Catherine Deroche, Colette Giudicelli, Michelle Meunier et M. René Teulade.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-huit heures cinq, est reprise à vingt-et-une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Charles Guené.