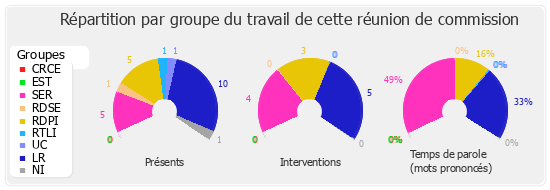Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
Réunion du 10 septembre 2013 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion

Dans le cadre des travaux de notre commission sur le projet de loi organique et le projet de loi ordinaire relatifs à l'indépendance de l'audiovisuel public, dont David Assouline est rapporteur, nous auditionnons M. Rémy Pflimlin, président-directeur général de France Télévisions. Nous évoquerons en outre avec lui l'avenant au contrat d'objectifs et de moyens de l'entreprise, finalisé pendant l'été.
Je me réjouis que le projet de loi conforte l'indépendance du service public. Cette valeur cardinale est une composante majeure de la relation que nous entretenons avec nos concitoyens. Le mode de nomination du président de l'audiovisuel public n'est qu'un élément de son indépendance. Celle-ci doit être confortée dans l'exercice de ses fonctions, notamment dans ses choix éditoriaux. Depuis ma nomination, je n'ai cessé de m'y employer. Un mode de financement pérenne est une autre composante fondamentale de l'indépendance. À cet égard, le maintien de la publicité en journée après 2015 est extrêmement important, même si ce dispositif limité continue de nous défavoriser par rapport à nos concurrents.
Le texte dispose en outre que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) tiendra compte de l'impact économique de ses décisions relatives à l'usage des canaux de diffusion. Ce point est fondamental. Jusqu'alors, la disponibilité d'un canal ouvrait automatiquement appel à candidatures, ce qui pouvait porter préjudice au marché, et atteinte à la bonne exécution des cahiers des charges.
La création d'une commission consultative sur la bande des 700 MHz, dite du second dividende numérique, est par ailleurs envisagée. Cette question est stratégique pour nous, dans le développement des nouvelles technologies, de l'interactivité et des passages en haute définition. Restreindre de telles possibilités techniques ne servirait pas le développement de nos entreprises.
J'en viens à l'avenant à notre contrat d'objectifs et de moyens. Nous y avons travaillé avec le gouvernement. Il a été présenté à notre conseil d'administration en juillet. Le contrat en vigueur, signé fin 2011, courait jusqu'en 2015, mais le choc subi par notre trajectoire de ressources a rendu sa modification impérative. En effet, la ligne budgétaire de 450 millions d'euros qui nous était accordée pour compensation de la suppression de la publicité après vingt heures a été fortement réduite et les prévisions de ressources publicitaires pour 2013, 2014 et 2015 ont été revues à la baisse en raison de la crise et de la nature de notre dispositif publicitaire. En 2015, nos ressources devraient ainsi baisser de 10 %, soit 300 millions d'euros sur un total de 3 milliards d'euros.
Notre contrat doit s'adapter à la modification de notre environnement. Notre objectif principal est désormais de parvenir à l'équilibre en 2015. Nous comptons d'abord différencier davantage notre offre de celle du privé, en réaffirmant notre double rôle : d'une part, fournir des informations indépendantes et de référence ; d'autre part être le lieu de développement de la création sous toutes ses formes - fiction, documentaire, animation, spectacle vivant. Deux autres objectifs clés guident notre stratégie : le rapport aux territoires, notamment en région et dans les outre-mer, où France Télévisions est partout présente ; et l'offre sportive gratuite, dans un contexte de croissance de l'offre sportive payante. Le service public est le seul endroit où peut se développer une telle offre.
Tout est mis en oeuvre pour accompagner l'évolution profonde qu'est l'émergence du numérique. Ordinateurs, smartphones, tablettes, montres connectées même depuis les progrès accomplis par Samsung : les supports d'images ne cessent de se multiplier. Nous devons être présents sur des supports toujours plus divers, afin que nos contenus soient vus par le plus grand nombre. Vous vous êtes battus pour l'exception culturelle : votre combat n'a de sens que si la création est diffusée. Sur l'audiovisuel public, elle l'est.
L'avenant au contrat d'objectifs et de moyens entérine en outre l'évolution du positionnement de France 4 et de France Ô, et valide la pause dans le développement des heures de diffusion des antennes régionales de France 3.
Ces arbitrages se conjuguent à des mesures d'économies destinées à conforter notre trajectoire de retour à l'équilibre en 2015. Toutes les dépenses sont concernées. Grâce au plan d'économies engagé en 2012, l'équilibre a été atteint en dépit d'une perte de 70 millions d'euros par rapport à 2011. Des économies importantes, de l'ordre de 10 %, ont été réalisées sur les coûts externes, les dépenses de structure et les frais généraux, ainsi que sur les achats de programmes - des audits systématiques sur les émissions de flux ont aidé à économiser entre 7 % et 8 % des sommes négociées depuis un an. Grâce aux choix des contenus que nous avons opérés, le coût de notre grille de programmes baissera de 1 % par an en moyenne par rapport à 2012, contre une croissance de 2 % à 3 % par an initialement prévue.
Le volet social n'est pas ignoré. À l'issue de négociations longues mais fructueuses avec l'ensemble des syndicats, nous avons signé de nouveaux accords d'entreprise, qui se substituent aux conventions collectives et accords des différentes entreprises en vigueur avant la constitution de France Télévisions en une entreprise unique. L'unification des statuts et des règlements du travail facilitera les mutualisations de moyens et les transferts de collaborateurs. Des économies en sont également attendues : les effectifs sont déjà passés de 10 600 en 2012 à 10 100 au début 2013, soit une baisse de 500 équivalents temps plein (ETP).
En 2015, nous ambitionnons de les réduire à nouveau pour parvenir à 9 750. Cette deuxième phase de réduction sera engagée le 1er octobre avec la présentation au comité central d'entreprise d'un plan de départs volontaires. À l'inverse des précédents plans de départ, celui-ci est fondé sur une nouvelle organisation, les départs n'étant pas remplacés. Les emplois non permanents, qui représentent près de 16 % de nos effectifs contre 19 % entre 2010 et 2012, poursuivront leur diminution. Une négociation a été lancée sur ce sujet, de même qu'un débat sur l'intermittence. Et comme toutes les entreprises, nous nous conformons à l'obligation légale de négocier sur l'emploi senior.
Le premier aléa que nous rencontrons sur le chemin du retour à l'équilibre tient à la recette publicitaire. Celle-ci dépend de l'offre en journée, de l'évolution de la concurrence, et de la situation économique. Nous prévoyions déjà un recul par rapport aux recettes réalisées en 2012, et nous avons constaté fin août un écart de près de 10 millions d'euros par rapport aux objectifs initiaux.
Deuxième défi à relever : le financement public. Sur la ligne budgétaire votée pour 2013, 31 millions d'euros ont d'ores et déjà été gelés. En somme, nous subissons le même traitement que l'administration, alors que nous sommes avec l'État dans une relation contractuelle dont l'équilibre dépend de la ressource que celui-ci nous alloue. Enfin, le plan de départs volontaires est tributaire, par définition, de la volonté de nos salariés. Si j'ai confiance dans son succès, la prudence n'en est pas moins de mise.
J'ai proposé au gouvernement, qui a accepté, qu'à l'instar des plans stratégiques glissants qu'élaborent les grands groupes industriels, le contrat d'objectifs et de moyens soit révisable. En effet, les choses changent. Par conséquent, il est sage de fixer un rendez-vous annuel, au moment de la discussion du budget, afin d'analyser ses éléments constitutifs et de modifier les objectifs assignés en conséquence, en gardant à l'esprit l'absolue nécessité de retourner à l'équilibre : une entreprise qui perd son équilibre affaiblit sa capacité d'investissement, perd son indépendance et compromet son avenir !

Le Parlement a six semaines pour rendre un avis sur les projets de contrats d'objectifs et de moyens et les avenants qui leur sont apportés. Il est regrettable que nous soyons saisis à la rentrée d'un contrat élaboré au mois de juillet. Ce n'est pas la première fois. Je l'ai déjà dénoncé sous le précédent gouvernement, je le dis à nouveau. Il en va du respect du Parlement. Faudra-t-il changer la loi sur ce point, faire courir le délai du début de la session suivante, quitte à le réduire quelque peu lorsque le Parlement ne siège pas ?
Vous avez dit que l'indépendance de l'audiovisuel public est aussi financière. C'est juste. Cette indépendance avait auparavant deux composantes : la redevance, qui ne dépendait pas complètement de l'État puisqu'il s'agit d'un prélèvement direct, l'autre moitié dépendant des recettes commerciales. Le paysage a changé. Pour une question de pérennité, et afin de réduire les incertitudes annuelles, une nouvelle stratégie entre l'audiovisuel public et l'État s'impose. Au Sénat, nous avions proposé de renforcer le poids de la redevance dans les ressources de France Télévisions : l'augmenter de deux euros par poste aurait rapporté 50 millions.
Sur l'indépendance organique : quel regard portez-vous a posteriori sur la procédure utilisée pour votre nomination ? Quel impact a-t-elle eu sur l'exercice de vos fonctions ? En matière de nomination, cette loi ne revient pas au statu quo ante puisque le statut des membres du CSA change également.
Le texte dépasse la question des nominations. Les amendements des députés en ont fait doubler le volume - nous essaierons de résister à cette tentation... Que pensez-vous de l'amendement ouvrant le droit au CSA de faire passer une chaîne de télévision numérique terrestre (TNT) payante à la TNT gratuite ? D'aucuns y voient un outil au service du pluralisme, d'autres, études économiques à l'appui, craignent la saturation du marché.
Quels liens entretiendra France Télévisions avec le CSA si celui-ci intervient dans la nomination de son président ? Êtes-vous favorable à ce que le CSA donne un avis sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens ? Les candidats à la présidence de l'audiovisuel public ne doivent-ils pas porter un projet d'orientation stratégique ? J'y serais personnellement favorable.
Vous annoncez la suppression de centaines de postes, mais que faites-vous exactement pour résorber l'emploi non permanent, dont le volume semble contredire la volonté affichée d'économie ? D'autant que si l'on va au bout de la logique défendue par le Sénat, consistant à réétudier la question des parts de coproduction et de l'internalisation, il faudra des salariés.
Dès ma nomination, je n'ai eu de cesse de faire de l'indépendance de France Télévisions une question centrale. Celle-ci dépend du mode de nomination de son président, mais également de l'exercice de son mandat. Ancien directeur général de France 3, puis patron d'un quotidien de presse régionale, je sais d'expérience que la crédibilité repose sur l'indépendance : la conforter à France Télévisions a été un réflexe presque naturel. Notre couverture des élections présidentielle et législatives en 2012 en témoigne, qui n'a suscité aucune observation du CSA.
Je me félicite que le CSA tienne compte de l'impact économique de ses décisions d'attribution de canaux. Au-delà des positions de principe, il faut avoir une vision claire de l'effet sur l'environnement économique de telles décisions, ainsi que de la viabilité des autorisations. Les enjeux de telles décisions, notamment en termes d'emploi et de création, sont loin d'être négligeables. Donner au service public les moyens de remplir ses missions impose d'analyser les conséquences à moyen et long termes de semblables choix.
S'agissant du rapport d'exécution du contrat présenté au CSA, je suis favorable à la solution trouvée par le projet de loi, qui consiste à le présenter également aux représentants de la Nation, car nous sommes le service public de la télévision.
Nous lançons trois négociations simultanées sur le plan de départs volontaires, sur l'emploi non permanent, que nous souhaitons réduire, et sur l'intermittence. Le taux d'emploi non permanent, dont une partie est liée à la production événementielle, a déjà diminué, et devrait poursuivre sa décrue pour passer de 18 % à moins de 15 %.

L'indépendance est un très beau mot, sans doute le plus prononcé lors des débats parlementaires, mais c'est aussi un mot ambigu : comment définir la notion d'indépendance, et à qui incombe cette tâche ? Nous aurons l'occasion d'en reparler lorsque nous aborderons le mode de nomination du président de l'audiovisuel public. Je ne suis pas sûr que son indépendance soit mieux protégée grâce à ce texte. En tant qu'administrateur de France Télévisions, je peux témoigner des efforts constants déployés par le président sortant pour la préserver, et j'aimerais que notre rapporteur interroge également le président du CSA sur le sentiment que lui inspire sa nomination par le président de la République...
Le nouveau contrat d'objectifs et de moyens a trois objets principaux : un retour à l'équilibre en 2015 et des mesures en dépenses et en recettes. Le contrat glissant est un nouveau concept intéressant, mais il est difficile de programmer quoi que ce soit quand on ignore les chiffres. L'objectif devrait être de stabiliser les choses, et les recettes aléatoires, de nature publicitaire ou issues de dotations publiques, doivent être plus précisément définies.
France Télévisions souhaite conforter ses ressources publicitaires, mais à long terme, ce ne sont sans doute pas les plus indiquées pour assurer la stabilité de la recette. Nous avons toujours souhaité distinguer le service public de l'offre concurrentielle en dispensant France Télévisions de cette manne, compensée par une redevance devenue contribution pour l'audiovisuel public. Il n'est certes pas envisageable de l'augmenter considérablement. Toutefois, si la situation budgétaire du pays était plus souple, ne pourrait-on envisager de s'appuyer davantage dessus, et, dans un marché de plus en plus contraint, que diriez-vous d'une suppression totale de la publicité sur les télévisions publiques ?

Je rejoins notre rapporteur : nous découvrons souvent les contrats et leurs avenants dans des conditions incompatibles avec leur examen sérieux.
Je vois dans celui-ci des manques flagrants. Le service public a vocation à toucher le plus large public possible. Or la répartition des audiences de France 3 montre clairement le vieillissement de ses téléspectateurs. Vous parlez de la concurrence sur le marché publicitaire, mais l'investissement publicitaire en France n'a jamais décru, excepté, peut-être, en 2008. Pour autant, les cibles d'audience marchande de France Télévisions dégringolent.
S'agissant du contrat proprement dit, que penseriez-vous d'une feuille de route élaborée en amont de la nomination du président de l'audiovisuel public ? Celle-ci présenterait des orientations stratégiques dont le contrat d'objectifs et de moyens assurerait la mise en oeuvre. Aujourd'hui, nous fonctionnons à l'envers ! De plus, nous n'avons pas d'indicateurs de performance dignes de ce nom. Ils sont particulièrement muets sur la satisfaction des usagers : le sondage Qualimat, simple baromètre de l'institut Ifop ne comporte que quatre questions. Il n'a donc rien à voir avec ce qui se pratique au Royaume-Uni par exemple.

Je rejoins à mon tour David Assouline : nous n'avons pas le temps d'examiner l'avenant au contrat d'objectifs et de moyens dans des délais convenables.
La semaine prochaine, nous allons examiner un autre texte, celui présenté par Mme Vallaud-Belkacem relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes. Il faudra aborder la question de la juste représentation des femmes dans les programmes télévisés.
La réforme de France 3 prévue pour 2015 comporte une réduction des programmes régionaux. Nous sommes tous très attachés à nos territoires. Il convient de conduire une réflexion sur le rôle de France 3 et la place de la diffusion régionale sur cette antenne.
Vous envisagez, dans le cadre de la réduction des emplois non permanents, de recourir à des sociétés de production privées. Travaillant sur l'intermittence, j'aimerais savoir si vous entendez également développer les contrats à durée indéterminée (CDI).
Enfin, France Télévisions respecte ses obligations en matière de retransmission de spectacle vivant et d'équilibre entre les différents genres. Mais sans doute devriez-vous veiller à la répartition des spectacles entre les différentes chaînes, afin de conserver au service public sa spécificité par rapport au privé.

Comment atteindre l'objectif de retransmission des événements sportifs où les femmes excellent, malgré la faible audience de ceux-ci ? Il y a sans doute du chemin à faire pour faire évoluer les esprits. Est-ce un chantier ouvert à France Télévisions ?
Les missions de France Télévisions exigent des investissements de moyen et long termes, c'est là ce qui différencie le secteur public des chaînes privées. Le financement du groupe doit donc être stable et prévisible : d'où ma préférence pour la redevance, dont l'assiette devrait d'ailleurs être modifiée pour inclure tous les foyers dotés d'écrans, comme en Allemagne, en Suisse, en Finlande ou en Suède.
Cela dit, à l'exception de la Grande-Bretagne, tous les pays ont opté pour un modèle de financement mixte. À condition que la redevance constitue l'essentiel de nos ressources, je ne suis pas hostile à la dynamique commerciale de la publicité. Jamais un annonceur n'a eu aucune influence sur les contenus que nous diffusons, et c'est ce qui fait le succès de nos émissions d'investigation ou destinées aux consommateurs.
J'ai été nommé à la présidence de France Télévisions après avoir exposé ma vision du groupe ici-même, et l'avoir soumise au débat. J'ai dit qu'à mes yeux, France Télévisions devait s'adresser à tous, et devenir un acteur déterminant du monde numérique ; nous sommes aujourd'hui leader en la matière. Après ma nomination, j'ai élaboré un plan stratégique, et c'est sur cette base que le contrat d'objectifs et de moyens a été négocié. Nous avons suivi une démarche proche de celle que vous avez indiquée. J'ai d'ailleurs rédigé une nouvelle version de ce plan stratégique avant la modification du contrat.
Oui, nous devons nous adresser à tous, mais les médias traditionnels s'adressent aujourd'hui de plus en plus aux adultes de plus de 40 ans parce que, oui, les adolescents et jeunes adultes préfèrent les nouveaux médias. C'est pourquoi nous nous efforçons de répondre à leurs attentes en développant nos outils numériques : télévision de rattrapage, nouvelles écritures... Je vous renvoie, dans l'avenant, au projet relatif à France 4. Nous sommes également résolus à investir davantage les réseaux sociaux, afin de faire circuler les contenus. France Télévisions doit être un groupe audiovisuel de son temps.
Quant au Qualimat, il concerne les programmes diffusés chaque jour en prime time et il se fonde sur un panel représentatif réuni par l'institut Harris.
Je suis déterminé à renforcer la place des femmes à France Télévisions. Je me suis d'ailleurs engagé devant Mmes Vallaud-Belkacem et Filippetti à rééquilibrer non seulement la structure d'emplois du groupe, mais aussi la présence des deux sexes à l'antenne. Dans toutes les émissions qui ont recours à des experts, trois sur dix d'entre eux au moins devront être des femmes. Accroître la place des femmes ou la diversité, ce n'est pas suivre une mode, c'est demeurer fidèle à notre identité : la nation est diverse, sa télévision doit l'être aussi.
Nous diffusons largement les compétitions féminines dans des sports traditionnels comme la natation, l'athlétisme ou le tennis. Quant au football et au rugby féminins, nous cherchons à leur donner une plus grande place, sur France 4 et France Ô d'abord, bientôt sans doute sur d'autres chaînes.
Je tiens à vous faire remarquer, madame la sénatrice Blondin, que nous atteignons nos objectifs dans le domaine du spectacle vivant même si l'on exclut l'humour. Toute l'année, nous diffusons du théâtre sur France 2, de l'opéra en région, et nous avons également retransmis cet été le concert du 14 juillet à la Tour Eiffel et des spectacles du festival d'Aix-en-Provence.
En vue de la prochaine réforme de France 3, la ministre de la culture et de la communication a décidé sur ma proposition de mettre en place une commission mixte associant des parlementaires, des représentants du ministère et de France Télévisions pour réétudier la question de la régionalisation. Il s'agit de voir comment la chaîne régionale peut participer au grand projet de la décentralisation. Je tenais il y a quelques jours une conférence de presse devant des journalistes parisiens, qui ne regardent pas France 3 régions : ils ignoraient que le 19 heures de France 3 est en tête de l'audimat à Marseille ! Cela dit, les questions économiques peuvent freiner le développement de France 3.
Puis la commission auditionne M. Olivier Schrameck, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) sur le projet de loi organique n° 815 et le projet de loi n° 816, adoptés par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatifs à l'indépendance de l'audiovisuel public.

Le temps dont nous disposons étant compté, je vous cède immédiatement la parole, monsieur le Président, afin que vous nous exposiez votre sentiment sur les projets de loi relatifs à l'indépendance de l'audiovisuel public.
Lors de mon audition du 23 janvier, je me suis engagé à vous rendre compte régulièrement des activités du CSA. Cependant, je m'en tiendrai aujourd'hui, comme vous le souhaitez, à quelques remarques sur ces deux projets de loi. Je tiens cependant à réaffirmer qu'à nos yeux, le contrôle par le Parlement des activités du CSA est indispensable. Nous avons besoin de vos observations et orientations pour jouer notre rôle en nous fondant sur la légitimité démocratique que vous incarnez.
Vous vous apprêtez à renforcer l'indépendance et les moyens du CSA tout en veillant à ce qu'il fonctionne selon des règles exemplaires. La réforme du mode de nomination des membres du Conseil me paraît à cet égard emblématique, et comme toutes les dispositions du projet de loi délibéré en conseil des ministres, il a reçu un avis très favorable du CSA.
Nous sommes conscients de la nécessité de rénover les dispositions régissant les compétences, les missions et le fonctionnement du Conseil, afin qu'il continue à jouer son rôle de régulateur dans un environnement diversifié et ouvert à la révolution numérique. Cette régulation doit être d'abord économique, et reposer sur une vision d'ensemble de l'évolution de plus en plus rapide du secteur audiovisuel.
Le projet de loi, qui dans sa version initiale rénovait les fondations institutionnelles du CSA, comporte depuis son examen par l'Assemblée nationale plusieurs dispositions réformant son mode d'action : ce sont là les premiers jalons d'une rénovation d'ensemble de la législation audiovisuelle, auxquels vous apporterez sans doute votre contribution.
Le projet de loi restitue au CSA le pouvoir de nomination des présidents de sociétés de l'audiovisuel public. C'est une compétence dont le Conseil a lui-même souligné la légitimité. Je ne me félicite pas moins que le texte prévoie leur audition par les commissions parlementaires compétentes, dans un délai raisonnable suivant leur nomination : le Parlement exercera ainsi son contrôle sur les orientations choisies.
La réforme du mode de désignation des membres du CSA, qui respecte les mandats en cours, garantit l'impartialité du collège en exigeant l'approbation des trois cinquièmes des membres des commissions parlementaires. Le CSA sera ainsi l'une des plus indépendantes des autorités indépendantes.
Avec un rapporteur indépendant du collège chargé de l'instruction, la procédure de sanction répond désormais aux exigences constitutionnelles et conventionnelles de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme.
Le texte a été enrichi par l'Assemblée nationale de dispositions dont plusieurs entrent en consonance avec les propositions formulées par le CSA dans son rapport public de 2012 - le Conseil renouait ainsi avec une tradition oubliée depuis 1994, afin justement d'éclairer les débats législatifs. Je me réjouis tout particulièrement de deux mesures relatives à son organisation et à son fonctionnement. D'une part, sa transformation en autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière lui donnera la souplesse de gestion dont il a besoin, sans préjudice de la nécessaire maîtrise des deniers publics. D'autre part, la reconnaissance aux membres du collège et de son président d'un droit d'expression à des fins pédagogiques me paraît tout à fait conforme à la vocation d'une autorité de régulation. Jusqu'à présent, l'article 5 de la loi du 30 septembre 1986 interdisait aux membres du CSA - artificiellement à mon sens, et sans portée pratique - toute prise de parole sur des questions relevant de l'exercice de leurs missions. En limitant cette interdiction aux questions en cours d'examen et au déroulement des délibérations, le projet préserve les règles d'une saine déontologie, tout en laissant les membres du Conseil s'expliquer sur leurs objectifs, leurs méthodes et leurs décisions.
Certains ont posé la question de savoir s'il fallait interrompre les mandats en cours des présidents de sociétés de l'audiovisuel public. Les dispositions prévues sur la révocation ne font que reprendre les dispositions antérieures en tirant les conséquences de la modification du mode de nomination, en vertu du principe de parallélisme des formes. Ce parallélisme existait aussi bien dans la loi de 2009 que dans le droit antérieur, auquel le projet de loi fait pour l'essentiel retour.
Sans doute serait-il opportun de nommer les présidents quelques mois avant le terme du mandat de leurs prédécesseurs afin d'assurer la continuité du service public, y compris dans la préparation et la mise en oeuvre des choix éditoriaux. C'est d'ailleurs une pratique établie pour certaines institutions culturelles.
Les nouvelles attributions confiées au CSA par l'Assemblée nationale correspondent à l'esprit de notre rapport public de 2012. Je pense tout d'abord à la capacité de différer l'attribution de fréquences si les conditions économiques ne s'y prêtent pas : la régulation ne peut pas s'opérer à guichets ouverts. Je mentionnerai ensuite la possibilité, lors du passage à la haute définition de services à vocation nationale, de restreindre l'appel à candidatures à des opérateurs déjà autorisés ; ou encore la faculté de statuer sur une demande de changement de régime, du payant au gratuit ou inversement, en tenant compte des conditions économiques du secteur - car celles-ci doivent retenir l'attention du régulateur, et un tel changement de régime mériterait une étude d'impact. Je me réjouis aussi que le Conseil soit appelé à contribuer, sous la forme d'un avis, au contrôle de l'exécution de leurs contrats d'objectifs et de moyens par les sociétés de l'audiovisuel public.
L'extension du champ des études d'impact répond précisément à la nécessité de mieux intégrer les finalités économiques de la régulation. Le rapport annuel du Conseil devra faire une plus large place aux incidences économiques de son action, ce que favorisera l'organisation d'un dialogue permanent avec les commissions du Sénat et de l'Assemblée nationale.
L'attribution et la gestion des fréquences, dans un contexte économique où il importe de valoriser et de promouvoir le secteur audiovisuel, constitueront une partie importante de notre travail. Parce qu'elles exigent réactivité et interactivité, elles ne sauraient être soumises à des procédures systématiques ou excessivement lourdes. Je me permettrai donc de faire une suggestion. L'article 6 quinquies prévoit, dans sa rédaction actuelle, que « toute autorisation de modification de convention susceptible d'avoir un impact significatif sur le marché en cause est précédée d'une étude d'impact ». Or il est difficile de déterminer a priori si une telle décision doit avoir un impact significatif. Une telle rédaction est source d'incertitude et multiplie les risques de censure contentieuse. En outre, des centaines de demandes de modifications de convention étant déposées chaque année, le risque d'engorgement apparaît redoutable. Il me paraît donc important de cantonner l'obligation de recourir à une étude d'impact aux modifications de conventions liant des chaînes de télévision ou des stations de radio nationales. Dans les autres cas, le CSA apprécierait si l'impact attendu sur les bassins locaux d'audience justifie par son « importance » - terme consacré par la loi en ce qui concerne les consultations publiques - une étude formalisée.
En revanche, il ne nous paraît pas légitime de nous affranchir d'une étude d'impact pour la seule raison que le Gouvernement aurait déposé une demande de réservation prioritaire, en vertu du II de l'article 26 de la loi de 1986. Telle serait la conséquence de l'article 6 septies et de son insertion dans l'article 31 de la loi de 1986, lequel ne renvoie pas à l'article 26. La priorité accordée au service public, à la demande du Gouvernement, ne serait nullement remise en cause par une analyse préalable, globale et cohérente des besoins susceptibles d'être exprimés par les opérateurs publics et privés.
Le droit en vigueur n'autorise aucune forme de conciliation sur les litiges relatifs à la circulation d'oeuvres audiovisuelles, notamment entre éditeurs et promoteurs. Le CSA, reprenant une proposition du rapport du sénateur Plancade, souhaite que cette faculté lui soit ouverte, au moins à la demande des parties.
L'article 6 quater prévoit, avant toute réallocation de fréquences affectées au CSA, la consultation d'une commission de modernisation de la diffusion audiovisuelle comprenant des parlementaires. Cela nous paraît tout à fait souhaitable, compte tenu de l'incidence de telles décisions pour tous les acteurs du secteur, et d'abord pour les téléspectateurs. Cette procédure pourrait être informellement anticipée à propos de la réallocation de la bande de 700 MHz.
Le CSA se tient à votre disposition pour vous présenter ses observations, tout au long de l'examen de ce texte grâce auquel il espère remplir plus efficacement ses importantes missions.

Je vous remercie de cet exposé très complet. Je constate que vous portez une appréciation très positive sur ce projet de loi. La précision de vos remarques sur certains de ces articles enrichira notre réflexion.

Cette audition est importante. Le projet de loi que nous examinons est issu de la volonté de modifier le mode de nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public. Et c'est ce qui a fait porter l'attention sur l'instance qui aura désormais la charge de les nommer, le CSA, afin d'en garantir l'indépendance, d'en rénover le statut et les attributions. La plus grande partie du texte lui est désormais consacrée.
Je tiens à souligner la portée presque révolutionnaire du nouveau mode de nomination des membres du CSA, qui fera du Conseil l'une des autorités indépendantes les plus indépendantes, avez-vous dit. Soumettre les candidatures à l'approbation des trois cinquièmes de nos commissions, c'est obliger à rechercher un consensus sur la compétence des personnes. Et je souhaite que cette règle soit appliquée aussi souvent que possible pour les autres nominations. J'aimerais vous entendre à ce sujet : qu'est-ce que cette nouvelle règle changera pour le CSA, à vos yeux ?
Un amendement adopté par les députés nous contraint à aborder une question imprévue. Il autorise le passage de la TNT payante à la TNT gratuite sans passer par la procédure habituelle de l'appel à candidatures. On parle beaucoup de cet amendement qui intéresse les médias, et qui a suscité un intense lobbying. Je veux encadrer cette procédure exceptionnelle, en imposant au moins une étude d'impact. Certains imaginent déjà quelle chaîne pourrait être concernée, ils croient le scénario déjà écrit... Eh bien, je veux les rassurer. Comment garantir la transparence de la décision ? En lançant un appel à contribution, afin que ceux qui sont intéressés directement ou indirectement puissent s'exprimer ?
Un autre amendement autorise une chaîne de la TNT régionale à devenir nationale dans le cadre du passage à la haute définition. Comme toutes les chaînes locales n'ont pas les 12 millions d'euros que cela coûte, certains supposent que cette disposition ne profiterait qu'à quelques chaînes au plus, voire à une seule.
Une dernière question. Le rapport Lescure préconise de transférer au CSA certaines attributions de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi). Après avoir patienté pour la publication du rapport Lescure pendant près d'un an, nous attendons maintenant un autre projet de loi qui reprenne ses propositions. De si longs délais sont dommageables, tant pour l'Hadopi que pour son personnel. Pourquoi, dans un esprit très pragmatique, ne pas profiter du présent projet de loi pour entériner ce transfert ?
J'aurais pu évoquer aussi votre relation avec les présidents des sociétés de l'audiovisuel public une fois nommés, et le contrôle que vous exercerez sur leur action. Le CSA nomme cinq des administrateurs de France Télévisions : pourquoi ne pas s'astreindre à la parité ? Peut-être verrait-on ainsi plus de femmes à l'antenne...
Merci de ces questions denses et importantes. Le CSA est pleinement conscient de la mutation, pour ne pas dire plus, que représente le nouveau mode de nomination de ses membres. L'idée en avait germé il y a quelques années. Le comité Balladur avait, par exemple, un moment envisagé de proposer l'approbation de la nomination du Défenseur des droits à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des commissions parlementaires compétentes. Cette procédure garantit non seulement la transparence du choix, puisqu'elle exige un accord entre des personnalités qui se réclament de courants politiques différents, mais aussi un haut degré de compétence des candidats proposés - compétences économiques, juridiques ou techniques qui sont d'ailleurs, désormais, explicitement prévues. Le seul risque est qu'un accord ne puisse être trouvé ; bien que j'aie été témoin de situations de ce genre en Espagne, quand j'y étais ambassadeur de France, j'ai pleine confiance en la sagesse des commissions parlementaires pour s'entendre.
Il me semble que l'on est parvenu ainsi à un équilibre, compte tenu du mode de nomination prévu par la Constitution pour le président du CSA. Celui-ci signe toutes les décisions du Conseil, lequel, doté d'un pouvoir de réglementation et de sanction, participe de la puissance exécutive, comme disent les juristes.
Le CSA avait lui-même proposé en avril, en dehors du contexte que nous connaissons maintenant, la nouvelle procédure de passage de la diffusion gratuite à la diffusion cryptée, ou vice versa. Cette proposition s'explique par notre conception de notre rôle, qui n'est pas d'appliquer mécaniquement une norme. Dans sa rédaction actuelle, la loi de 1986 obéit ici à une logique binaire : si la modification est substantielle, on ne peut rien faire ; sinon, on peut aboutir à un accord. Je préfère une perspective d'ensemble, qui prenne en compte les conditions économiques, mais aussi sociales et technologiques, comme le font l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), l'Autorité de la concurrence ou encore l'Autorité de contrôle prudentiel.
Cette procédure présente-t-elle des risques ? Je ne le pense pas. Une décision de ce genre serait soumise, plus encore que toute autre, à une étude d'impact. Je pense notamment au passage à la gratuité : vu l'état actuel de la télévision payante, une analyse globale et détaillée s'imposerait. Une consultation publique me paraîtrait également assez naturelle : la loi oblige déjà à mener une telle consultation lorsque le CSA s'apprête à rendre une décision susceptible d'avoir un impact « important » sur le marché en cause. Tout ce qui impose plus de transparence, tout ce qui oblige à mieux prendre en compte les intérêts directs et indirects des parties prenantes, me semble souhaitable.
Le CSA n'a aucune intention a priori. Il examinera les demandes avec objectivité, au vu des données économiques et avec le souci du pluralisme. Ces dispositions vont dans le bon sens, car elles garantissent une régulation attentive aux intérêts économiques, sociaux, industriels et culturels du secteur.
Il découle de ces développements sur son pouvoir d'appréciation en matière d'autorisation de fréquences, que le Conseil est favorable à la possibilité de limiter des appels d'offres au passage à la haute définition. Car il ne s'agit pas de multiplier les chaînes hertziennes : un progrès qualitatif n'est pas un progrès quantitatif. En autorisant les chaînes locales à devenir nationales à l'occasion du passage à la haute définition, on risquerait d'aboutir à une diversification non maîtrisée du réseau hertzien national, et l'on manquerait ainsi l'objectif recherché. Aussi me paraît-il utile d'ôter toute ambiguïté au texte actuel en précisant que l'appel d'offres ne s'adresse qu'aux services à vocation nationale.
Il n'appartient évidemment pas au CSA de décider quelle doit être l'institution qui prendra le relais de l'Hadopi, ni quel est le vecteur législatif le plus pertinent. J'ai néanmoins souhaité que le Conseil en délibère de manière informelle, puisqu'il est concerné au premier chef. Si l'on considère, suivant le rapport Lescure, que certaines compétences de la Hadopi en matière de régulation, de veille et de protection des droits sont susceptibles d'être transférées à une autre autorité, le choix du CSA répondrait à une logique profonde. En effet, le secteur audiovisuel est immergé dans le numérique, qui n'est pas un média parmi d'autres mais un média englobant. Bien plus, celui-ci le pénètre par tous les pores - canaux techniques, contenus, nouvelles chaînes. Il y a ainsi une logique fonctionnelle à ce que la régulation soit globale, à condition qu'elle soit assouplie, renouvelée dans ses méthodes et ses objectifs, et qu'elle fasse une large part à l'autorégulation ou à la régulation supervisée, en association avec les acteurs du numérique.
Pour le reste, je ne suis habilité à me prononcer ni sur la possibilité juridique, ni sur l'opportunité politique de recourir au présent projet de loi. L'appréciation juridique appartient au Conseil constitutionnel. Sur ce que l'on appelle les cavaliers législatifs, sa jurisprudence est nuancée. D'ailleurs, depuis la révision de 2008, un amendement est recevable même s'il ne présente qu'un lien indirect avec le texte déposé ou transmis. Des décisions récentes manifestent une certaine souplesse : en 2011 sur la réforme des juridictions financières dans un projet de loi initialement consacré aux juridictions militaires et marines, en 2013 sur l'élargissement du corps des inspecteurs du travail à l'occasion d'un texte sur la gestion prévisionnelle des emplois seniors, en 2013 encore sur l'extension des implantations d'éoliennes autorisée par un projet de loi de régulation du secteur de l'énergie qui n'en traitait d'abord aucunement.
J'insiste sur ma préoccupation quant à l'idée de transférer les compétences en cause sans procéder à la grande réforme suggérée par le rapport Lescure. Deux dispositions sont concernées : le transfert dans la loi de 1986 de l'article du code de la propriété intellectuelle qui définit les compétences de l'Hadopi, et le sort de la commission de prévention et de protection.
Il convient surtout d'assurer la continuité. En effet, si l'indétermination persistait sur le champ d'action de l'Hadopi, les risques seraient grands d'une dispersion et d'un affaiblissement des compétences techniques et de l'expérience du personnel. On observe déjà une modification du comportement des utilisateurs, et une extension massive du piratage. J'ai rencontré il y a peu des représentants du monde du cinéma : Blic (Bureau de liaison de l'industrie cinématographique), Bloc (Bureau de liaison des organisations du cinéma), ARP (Société civile des auteurs-réalisateurs-producteurs) et UPF (Union des producteurs de films) ; ils m'ont signalé une aggravation spectaculaire de la situation. Il faut donc donner une indication nette, quelle qu'en soit la forme, sinon le CSA héritera d'une situation irréversiblement dégradée.
Le projet de loi accorde une attention particulière à la parité. Le collège du CSA est d'ores et déjà composé de cinq femmes et de quatre hommes ; la base de départ n'est donc pas mauvaise. La seule nomination à laquelle nous ayons procédée jusqu'à présent est celle de Mme Brigitte Lefèvre comme représentante du CSA au conseil d'administration de France Médias Monde, alors connue sous le nom d'Audiovisuel extérieur de la France. Lors du prochain remplacement de Muriel Mayette au sein de Radio France, nous serons attentifs à cette problématique. Tout cela, ainsi que notre groupe de travail sur les droits des femmes, démontre un volontarisme indéniable de notre part.
Dans nos relations avec les présidents d'entreprises audiovisuelles publiques, nous respectons leur pouvoir éditorial. Toutefois, leur nomination par le CSA induira un type de relations différent. Cela doit nous pousser à accentuer notre suivi. Nous avons ainsi été favorables à l'extension de notre compétence en amont, lors de la transmission des avenants aux contrats d'objectifs et de moyens, comme en aval, lorsqu'il est rendu compte de leur exécution. L'Assemblée nationale n'a retenu que ce contrôle en aval. Mais lorsque l'un de ces contrats lui sera transmis, le CSA l'examinera et vous transmettra ses réflexions.

Je remercie M. Schrameck pour la précision et la grande sagesse de sa présentation. Je soutiens la proposition d'instituer un tuilage entre les présidents sortant et entrant d'entreprises audiovisuelles publiques, que je voulais moi-même proposer. Aujourd'hui, les présidents nommés en cours d'année n'ont pas de prise sur la programmation de l'année suivante. Comme le rapport de David Assouline le montre, ce manque de continuité est dommageable.
J'aimerais aussi vous interroger sur le passage de la TNT payante à la TNT gratuite. Même si je comprends le sens de la mesure, j'y suis très réticent. La télévision réclame des investissements très importants. Les réponses aux appels d'offre sont faites dans un certain contexte. Un changement en cours de route peut perturber cet écosystème. Les modifications doivent être faites au terme de la durée prévue des autorisations. Dans un monde où la gratuité signifie un financement par la publicité, qui ne constitue pas une ressource inépuisable, l'amendement au premier alinéa de l'article 6 octies est porteur de risque.

Un élu est un généraliste ; si son sentiment est partagé par ses compatriotes, c'est sans doute qu'il est dans le vrai... Mon impression est que les médias détiennent un pouvoir considérable. Sur certaines chaînes privées, l'information consiste essentiellement en une recherche de scoops où la violence domine.
En matière de sport aussi, ce sont les médias qui commandent. Trouvez-vous normal qu'en hiver, quand il fait moins quinze, les matchs de football aient lieu à vingt-et-une heures ? Dans un autre ordre d'idées, la couverture médias de l'actualité parlementaire fait montre de différences de traitement donnant l'impression que l'Assemblée joue en première division et le Sénat en deuxième... Ce fut le cas lors du débat sur la Syrie la semaine dernière.
Il est paradoxal de donner au CSA un pouvoir complet sur les autorisations de nouvelles chaînes, mais un pouvoir limité sur les modifications substantielles. Sur le plan économique, la remise en jeu de l'autorisation est un choix binaire, soit disparition et recréation, soit choix d'un tiers. Or la régulation d'un ensemble complexe comme l'audiovisuel doit plutôt accompagner ses évolutions ; elle doit procéder d'une vue d'ensemble et éviter des ruptures périlleuses pour le développement de nos potentiels économiques, culturels et sociaux. Le CSA prendra en compte tous les intérêts, et notamment ceux des « tiers intéressés », ce qui n'implique pas forcément un processus de rupture.
Monsieur le sénateur Boyer, sur le contenu des programmes, nous respectons le pouvoir éditorial des chaînes et nous nous limitons à des observations générales sur la structure et le coût de la grille des programmes. Vous mettez en évidence la contagion de la violence et les problèmes qu'elle pose pour les publics sensibles, que le législateur nous a chargés de protéger. Sur ce sujet, j'appelle votre attention sur la nécessité de ne pas nous cantonner au domaine strict de l'audiovisuel. Sans possibilité d'agir sur la sphère numérique, notre pouvoir devient résiduel. Nous étions il y a peu saisis de la question de la diffusion d'un clip par une chaîne de télévision ; mais tandis que nous en discutions, il avait déjà été visionné un million de fois sur Internet !
Concernant le pluralisme, on peut constater des améliorations depuis quelques mois : le délai de transmission des comptages de temps de parole entre majorité et opposition et de la répartition du temps entre personnalités politiques et responsables gouvernementaux est passé de trois mois à un mois. Nous serons extrêmement attentifs, pour les élections qui s'annoncent, à ce que les règles du pluralisme soient scrupuleusement respectées. Nous réfléchissons en ce moment à d'éventuelles rénovations tenant compte des évolutions techniques ; ces sujets méritent qu'on y réfléchisse longuement, et certainement pas à la veille des élections.
Concernant le sport, nous ne pouvons pas agir sur la programmation. Mais nous avons le souci de garantir un accès au sport pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas payer des services télévisés. Une négociation concernant le tennis va s'ouvrir dans les mois qui viennent : pour nous, les restrictions budgétaires ne sauraient conduire à une remise en cause radicale de la répartition des responsabilités entre les télévisions payantes et le service public, dont un des rôles est de retransmettre des performances sportives de haute qualité.

Vous avez été un avocat brillant des dispositions du projet de loi. Y a-t-il des points que vous auriez préférés différents ?
Nous aurions souhaité que d'autres compétences soient attribuées au CSA dès à présent. Notre contrôle économique est insuffisant : nous ne pouvons pas opérer de régulation ex ante. Nous comprenons pourtant la logique en deux temps, consistant d'abord en une réforme des institutions, puis en une refonte de la régulation de l'audiovisuel, sur la base du rapport Lescure. Mais il faut aller vite, car les mutations sont extrêmement rapides. De nombreuses dispositions ont été prises alors que le paysage audiovisuel était totalement différent. Un réexamen d'ensemble s'impose.

Je souhaite la bienvenue à Mme Aurélie Filippetti, ministre de la culture et de la communication.
C'est avec fierté que je vous présente, au nom du Gouvernement, ce projet de loi, qui a été enrichi par l'Assemblée nationale lors de son examen en juillet dernier. Il touche aux fondements de la démocratie et aux conditions d'existence de la liberté d'expression. Il répond aux engagements du président de la République. C'est un texte concis et sans détour, comme le principe d'indépendance qu'il défend. Après les coups portés par la loi du 5 mars 2009, il était temps de renouer avec la défense de la liberté d'expression.
Le projet de loi s'articule autour de trois grands principes : indépendance, démocratie et impartialité. L'indépendance : c'est à nouveau le CSA et non plus le Président de la République qui choisit les patrons de Radio France, de France Médias Monde et de France Télévisions. Nicolas Sarkozy avait entendu, en reprenant ce pouvoir, « mettre fin à une hypocrisie » : non, les garanties démocratiques ne sont pas une hypocrisie et nous les rétablissons aujourd'hui. Le mode actuel de nomination des dirigeants de chaîne éveille la suspicion, ce qui rend plus difficile l'exercice de leur mission.
La démocratie, ensuite : la procédure de nomination des membres du CSA réserve un plus grand rôle au Parlement et à ses commissions chargées des affaires culturelles en particulier, en y associant l'opposition parlementaire. Seul le président du CSA sera désormais nommé par le Président de la République ; le collège passe de neuf à sept membres ; six seront désignés par les présidents des assemblées après avis conforme adopté à une majorité de trois-cinquièmes par chacune des deux commissions, impliquant nécessairement l'opposition. C'est une avancée majeure et le signe d'une société de confiance. Certains craignent des blocages mais j'ai confiance dans votre capacité à surmonter les logiques partisanes, sur un sujet si important.
L'impartialité, enfin : ce projet s'accompagne d'un projet de loi organique qui en tire les conséquences en retirant les présidents des sociétés audiovisuelles publiques de la liste des emplois auxquels nomme le Président de la République sur le fondement de l'article 13 de la Constitution. La procédure de sanction se conformera aux jurisprudences constitutionnelle et européenne ; les fonctions de poursuite et d'instruction, assurées par le rapporteur, seront séparées de la fonction de sanction, qui appartient au collège.
Le travail des députés a enrichi le texte, pour faire du CSA une autorité de régulation rénovée qui devra davantage rendre compte et justifier ses choix, dans un souci de transparence. Le statut est modifié : le CSA devient une autorité publique indépendante. Je m'associe aux initiatives des députés, qui vont plus loin que le texte du gouvernement sur trois points : les membres seront nommés pour leurs compétences ; les règles d'incompatibilités sont améliorées ; les nominations respecteront la parité, en parfaite cohérence avec la ligne suivie par le gouvernement.
Grâce aux députés, le projet de loi prend également en compte les enjeux économiques, en faisant précéder d'une étude d'impact toute nouvelle autorisation délivrée par le CSA et susceptible de modifier le marché audiovisuel. Le rapport annuel du CSA est enrichi ; ses décisions seront motivées donc mieux comprises par les entreprises visées. Le conseil pourra désormais autoriser le changement du mode de financement des chaînes, pour le passage du payant au gratuit par exemple. Il faudra être d'une grande prudence à l'égard de cette prérogative nouvelle, pour sécuriser juridiquement les décisions du CSA et pour garantir que ces modifications du modèle ne mettent en péril ni le pluralisme ni les équilibres économiques du secteur. Nos débats permettront sans doute d'atteindre la solution la plus équilibrée.
Enfin, les députés ont ajouté des dispositions sur divers points en suspens, en particulier le maintien de la publicité en journée dans l'audiovisuel public après 2015 ou une meilleure gestion du domaine public hertzien, avec l'abrogation des canaux compensatoires de la TNT.
Avec ce projet de loi, nous vous demandons de régler rapidement ce qui peut l'être : l'indépendance, condition et première étape d'une réforme de grande ampleur de l'audiovisuel. J'ai voulu que des réflexions soient engagées dès aujourd'hui, pour aboutir à des décisions réfléchies. Les conclusions de la mission Lescure ont montré que les bouleversements en marche appelaient une réforme de fond, sur laquelle nous avons voulu recueillir l'avis des secteurs concernés. C'est pourquoi j'ai organisé les assises de l'audiovisuel en juin et engagé une concertation pour adapter le cadre juridique, en prenant en compte l'essor des divers terminaux connectés à Internet. Je viens de lancer une consultation publique sur la modernisation de la réglementation applicable à la communication. Cela nous sera utile pour élaborer la position de la France dans les négociations européennes sur l'évolution des directives Services de médias audiovisuels, Paquet télécom et Commerce électronique.
La présente réforme du CSA est le socle sur lequel fonder la régulation des médias dans une grande démocratie.

Le projet de loi représente une avancée sur une question essentielle : l'indépendance. Nous n'avons pas souhaité rétablir l'ancien mode de nomination des membres du CSA. La présente réforme du mode de désignation n'a rien d'anodin. La procédure retenue, le vote des commissions compétentes à la majorité positive des trois-cinquièmes, témoigne de votre confiance dans le Parlement et dans la capacité des parlementaires à se rassembler. Cette procédure fera date et pourra certainement être étendue à d'autres organismes dont l'autorité repose sur l'indépendance.
Le texte a été enrichi à l'Assemblée nationale. Le Sénat jouera lui aussi son rôle ; il contribue souvent à sécuriser les dispositifs juridiques, car il aime le travail bien fait.
Plusieurs questions sont apparues dans le débat public. En premier lieu, un amendement, que vous avez soutenu, a été adopté à l'Assemblée nationale : il donne la possibilité au CSA d'autoriser une chaîne de la TNT payante à devenir gratuite. Levons nos préventions à l'égard de cette disposition. Comme l'a souligné M. Olivier Schrameck que nous venons d'entendre, dans un univers évolutif comme celui de la communication, il est bon que le CSA puisse intervenir avec plus de souplesse. Les projets économiques ont un sens dans une conjoncture donnée, il est normal qu'ils évoluent. Or, aujourd'hui, pour qu'une chaîne payante rejoigne le bouquet de la TNT gratuite, elle doit fermer son écran pour en ouvrir un autre, ce qui est bien lourd. Je suis donc favorable à cet amendement, sous réserve d'un encadrement de la procédure, qui doit être motivée et qui ne saurait être discrétionnaire. Sur ce sujet, les acteurs se font entendre. On attend du Sénat une clarification.
Un autre amendement adopté par l'Assemblée nationale permet à des chaînes qui disposent d'une autorisation locale de pouvoir accéder, à la faveur d'une candidature à la haute définition (HD), à une diffusion nationale. M. Schrameck y est réticent. Force est de constater, cependant, que le coût représenté par ce passage limitera le nombre des candidats. Quel est votre point de vue ?
Enfin, Madame la ministre, quel est votre sentiment sur les propositions de M. Lescure à propos de l'exception culturelle ? Vous avez déjà lancé des études et une consultation. La mise en oeuvre de certaines mesures suppose une modification de nature législative. Le transfert des compétences de l'Hadopi vers le CSA apparaît comme un compromis. Déjà, un décret a abrogé la possibilité de couper la connexion Internet. La mise en oeuvre d'une telle sanction avait à juste titre suscité des émotions, car l'accès à Internet est essentiel à l'exercice de la citoyenneté. Pourquoi ne pas saisir l'occasion de ce texte pour enfin mettre en oeuvre cette mesure qui a déjà fait l'objet d'une large discussion ? Le rapport Lescure a été publié en mai. Depuis, il règne une grande incertitude. A quand une grande loi de l'audiovisuel pour harmoniser l'ensemble du secteur ?

Il faut saisir l'occasion de fusionner ces entités. N'attendons pas que la situation se dégrade encore et finalement échappe à tout contrôle. Les incertitudes sont nombreuses concernant les prérogatives du CSA ou le fonctionnement de l'Hadopi. Nous sommes dans l'expectative. Nous attendons des décisions.
La procédure d'autorisation par le CSA du passage du modèle payant au gratuit doit être encadrée. Des études d'impact sont nécessaires pour évaluer l'équilibre économique du secteur, notamment les parts de marché publicitaire, et maintenir le pluralisme, afin que les principes de la loi du 30 septembre 1986 soient respectés. Le CSA dispose des moyens et compétences pour mener ces études qui apporteront des garanties au dispositif voté par l'Assemblée nationale.
En outre, le passage à la HD des chaînes locales n'implique pas automatiquement une diffusion nationale. Je ne doute pas que le Sénat, dans son souci de sécurisation juridique, saura lever cette ambiguïté.
Sur l'Hadopi, le rapport Lescure concluait à la pertinence de maintenir une riposte graduée, qui a une vertu pédagogique. Mais il préconisait d'alléger le dispositif et de le recentrer sur la contrefaçon commerciale. Aussi, j'ai confié à Mme Mireille Imbert-Quaretta le soin de réaliser une étude de la lutte contre la contrefaçon commerciale. Concernant le piratage domestique, la possibilité de couper l'accès à Internet constituait une sanction disproportionnée ; il fallait supprimer cette anomalie.
Par ailleurs, le rapport Lescure prônait le rattachement de la commission de protection des droits au CSA, pour renforcer ses moyens et ses compétences dans le numérique. Le gouvernement a arbitré en ce sens.
Néanmoins, des mesures de sécurisation juridique s'imposent concernant la lutte contre la contrefaçon. Le rapport Lescure préconisait des sanctions administratives à la place de sanctions pénales. Nous les avons jugées insuffisantes à garantir les libertés individuelles. Enfin, sur d'autres aspects du rapport, comme le développement de l'offre légale ou le financement de la création, le gouvernement a entamé un processus de concertation afin d'aboutir à des accords interprofessionnels, par exemple concernant la chronologie des médias ou la gestion collective.

Ce texte réforme les modalités de désignation des présidents des chaînes publiques et entend renforcer le pluralisme et l'indépendance de l'information. C'est important. Nous participerons à cette réflexion. Mais gardons-nous de toute vision manichéenne ! La loi de 2009 n'était pas attentatoire à la liberté d'expression et chacun a pu voir comment le Président de la République s'est comporté : aucune atteinte à la déontologie n'a été à déplorer, y compris pendant les périodes électorales. Le président Pflimlin, nommé par l'ancien Président de la République, a rappelé combien il était attaché à son indépendance et affirmé qu'il n'avait pas connu la moindre difficulté à cet égard. Quant à M. Schrameck, président du CSA, nommé par l'actuel Président de la République, il n'a pas témoigné spontanément d'une distance critique à l'égard de ce texte. Il n'a formulé ses préconisations qu'en réponse aux questions qui lui ont été posées. Abordons donc ce débat sans polémique. N'opposons pas de supposés amis et de prétendus ennemis de l'indépendance des médias. Nous voulons tous disposer d'une information libre et pluraliste.
Enfin, lors du vote de la loi Hadopi, nous avions défendu, avec certains membres de l'opposition de l'époque, la riposte graduée, conçue comme un instrument pédagogique. Si nous supprimons toute sanction, la dissuasion devient purement théorique. Songeons à l'efficacité. Nous devons défendre la création et le droit des créateurs à ne pas être spoliés.

M. Schrameck a certes manifesté son adhésion au projet de loi mais il a aussi appelé notre attention sur certains articles qui à son avis posent question. Sa présentation était positive mais critique et objective. De même, je salue sa liberté de ton sur l'Hadopi ; il a reconnu une évolution peu satisfaisante ces derniers mois.

Nos auditions soulignent de manière récurrente l'instabilité à la tête des chaînes du service public ainsi que le caractère erratique des stratégies et des modes d'organisation... Tout le monde convient de la nécessité d'orientations à moyen et long termes. L'État actionnaire doit définir en amont, en lien éventuellement avec le CSA, une feuille de route fixant des objectifs de service public, au lieu de commencer par désigner des candidats en leur demandant un projet inévitablement imprécis. L'idée avancée par M. Schrameck d'un tuilage entre le président sortant et le nouveau est intéressante. Madame la ministre, quelles mesures garantiraient une gouvernance pérenne de l'audiovisuel public ?

Le mot clef de ce texte est l'indépendance. Celle-ci, comme la démocratie, comme le bonheur, n'est pas un état mais un cheminement, et elle dépend d'une volonté partagée. Nous voulons tous une gouvernance indépendante, mais nous n'empruntons pas tous le même chemin. Suffit-il de changer le mode de désignation, ou le mode de scrutin à une élection, pour nous rapprocher de l'idéal démocratique ? La méthode proposée n'est peut-être pas la meilleure.
Sur la riposte graduée, nous étions plus unis au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Je suis un défenseur de l'Hadopi. J'ai pris acte de votre décret supprimant l'interruption temporaire de l'accès à Internet. Au demeurant, cette sanction n'avait été mise en oeuvre que dans quelques cas. La sanction administrative proposée par le rapport Lescure mais que vous ne souhaitez pas aurait pour conséquence de multiplier le nombre des amendes. L'Hadopi a rempli sa mission pédagogique. Tant mieux, car la défense du droit d'auteur et de l'acte créatif n'est pas une préoccupation spontanée des jeunes, qui ne comprennent pas tous pourquoi une oeuvre doit être payante.
Monsieur Assouline, vous souhaitez transférer au CSA, dès cette loi, le soin de mettre en oeuvre la riposte graduée. Pourquoi le CSA serait-il plus compétent que Hadopi ? Son expérience dans le numérique est-elle meilleure ? Cela coûterait-il moins cher ? Pourquoi démanteler un organisme qui a démontré son efficacité, comme l'ont reconnu M. Lescure ou M. Schrameck ?

N'oublions pas, en élaborant ce texte, que nous nous inscrivons dans un monde globalisé. Or nos compatriotes vivant à l'étranger n'ont pas accès aux programmes de France Télévisions. En Espagne, les chaînes publiques 1 et 2, ainsi que la chaîne publique sportive, sont disponibles en direct sur Internet. De même, la Suède offre un accès gratuit sur Internet aux séries de fiction nordiques. Au Canada, un site donne accès à des rediffusions consultables à l'étranger. Tout cela conduit certains de nos compatriotes installés à l'étranger à passer par le réseau privé virtuel Virtual Private Network (VPN), à la légalité douteuse, afin de masquer leur adresse Internet Protocol (IP) et faire croire qu'ils résident en France. Ne faudrait-il pas confier au CSA la mission de veiller à ce que tous nos compatriotes aient accès aux programmes de France Télévisions, y compris grâce à des procédures de télévision de rattrapage ?
Monsieur Legendre, vous soulignez que le Sénat ne compte que des partisans de l'indépendance. Ce projet de loi a précisément pour objet de confier au Parlement, majorité et opposition réunies, le pouvoir de désigner les membres du CSA. L'Hadopi n'est pas au coeur de ce texte qui concerne l'indépendance de l'audiovisuel. Les avancées sont indéniables, majeures. Selon moi, ce texte est bien « la grande loi », car il pousse l'indépendance à un degré jamais atteint. Il restera à régler des points techniques, à donner suite à certaines propositions du rapport Lescure. Je songe à l'amélioration de la disponibilité des oeuvres sur Internet, à la révision du code de la propriété intellectuelle, à la chronologie des médias, à l'open data, au financement de la création, à la gestion collective, aux échanges non marchands, etc.
Avec le développement de l'offre légale et le financement de la création, la lutte contre la contrefaçon est le dernier pilier de la réforme. En la matière, le rapprochement des structures est à la fois plus rationnel, car source d'économies, et plus pertinent du point de vue des compétences, car le CSA traite déjà de sujets numériques. Avec la convergence des médias, il n'est pas souhaitable de conserver une autorité dédiée à la lutte contre le téléchargement illicite. Le gouvernement reprend à son compte les préconisations du rapport Lescure sur ce point.
Monsieur Gattolin, la proposition de tuilage évoquée par M. Schrameck est pertinente. Le CSA aura la main sur les nominations, il aura donc toute possibilité pour assurer un meilleur suivi et davantage de continuité.
Comme vous le savez, le développement de l'éducation artistique et culturelle constitue une de mes priorités. Celle-ci inclut une sensibilisation au droit d'auteur. En rencontrant des artistes, les jeunes comprennent mieux comment ceux qui créent peuvent vivre.
Dernier point : le modèle français comporte, c'est une spécificité, des producteurs externes, si bien que les chaînes ne possèdent pas les droits pour la diffusion dans le monde entier. TV5 Monde diffuse un certain nombre de programmes. Le passage par VPN est un problème. Il faudrait une remise à plat plus générale. N'oublions pas que les citoyens britanniques résidant à l'étranger doivent payer une redevance spéciale pour regarder les programmes de la BBC même lorsqu'ils y ont accès grâce à Internet.