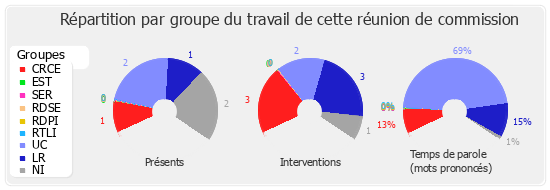Mission commune d'information sur le bilan et les conséquences de la contamination par l'amiante
Réunion du 15 juin 2005 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion
Audition de Mm. Marcel Royez secrétaire général arnaud de broca et Me Philippe Karim félissi représentants au sein du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante fiva de l'association des accidentés de la vie fnath
Audition de Mm. Marcel Royez secrétaire général arnaud de broca et Me Philippe Karim félissi représentants au sein du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante fiva de l'association des accidentés de la vie fnath
La mission a tout d'abord procédé à l'audition de MM. Marcel Royez, secrétaire général, Arnaud de Broca et Me Philippe Karim Félissi, représentants au sein du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), de l'Association des accidentés de la vie (FNATH).
a rappelé que l'Association, créée en 1921, regroupait 80 entités départementales ou inter-départementales, 1.500 associations locales et 200.000 adhérents à jour de leurs cotisations. Il a souligné qu'elle était l'association la plus représentative des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, mais qu'elle ne limitait pas le champ de ses activités à ce seul domaine, comme l'atteste le changement de nom intervenu il y a deux ans : la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) est ainsi devenue l'Association des accidentés de la vie, intitulé plus approprié pour prendre en compte, notamment, les victimes d'accidents domestiques ou de la circulation. Il a ensuite exposé les activités de l'Association : elle milite pour la prévention des accidents, pour une meilleure indemnisation et réinsertion des victimes, elle défend et soutient ses adhérents, en engageant des recours contentieux si nécessaires, et elle exerce enfin une activité de lobbying auprès des pouvoirs publics.
Tôt sensibilisée au dossier de l'amiante, la FNATH a contribué à la création de l'Association nationale des victimes de l'amiante (ANDEVA) en 1996 et M. Marcel Royez en a été le premier président, avant d'être remplacé par M. François Desriaux. Elle a rapidement alerté les pouvoirs publics sur les dangers inhérents à l'utilisation de cette fibre puis a contribué à l'instauration de mesures de prévention et à la création des dispositifs d'indemnisation des victimes. M. Marcel Royez a regretté que des dispositifs spécifiques aux victimes de l'amiante aient été mis en place et a plaidé pour un traitement égalitaire de toutes les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, avec une réparation intégrale du préjudice subi.
Evoquant le problème posé par l'amiante en place, ainsi que le très long délai de latence des maladies de l'amiante, il a estimé que les principales difficultés étaient sans doute encore à venir. Considérant que les responsabilités avaient été bien établies dans plusieurs rapports officiels, issus en particulier de la Cour des comptes et de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS), il a insisté sur les insuffisances, mises en lumière par la contamination par l'amiante, de notre système de prévention et de gestion des risques professionnels et sanitaires.

a rappelé que la Cour des comptes, dans un rapport remis à la commission des affaires sociales du Sénat, avait suggéré de « recentrer » le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) afin d'utiliser les sommes ainsi économisées pour mieux indemniser les bénéficiaires du FIVA. Il a souhaité connaître l'avis de la FNATH sur cette proposition. Il a ensuite demandé si l'Association était favorable au regroupement du contentieux relatif aux offres d'indemnisation du FIVA auprès d'une cour d'appel unique, afin de remédier à l'hétérogénéité des décisions rendues par les tribunaux, et quelle appréciation elle portait sur la création des pôles « santé publique » de Paris et Marseille.
Après avoir rappelé que le FIVA et le FCAATA étaient les deux piliers du dispositif d'indemnisation, M. Marcel Royez s'est prononcé en faveur d'une réforme d'ensemble du système de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, afin de remédier à l'injustice consistant à mieux indemniser les victimes de l'amiante que celles d'autres maladies professionnelles.
Il s'est interrogé sur les motivations ayant présidé à la création du FCAATA, qui semble poursuivre deux objectifs : venir en aide aux victimes, mais aussi accompagner la reconversion d'activités industrielles affectées par la décision d'interdire l'amiante. Il a rappelé que deux populations bénéficiaient de l'ACAATA - les personnes malades de l'amiante et les travailleurs exposés à l'amiante mais qui n'ont pas développé de pathologie - et a déploré les injustices résultant du mode de fonctionnement du FCAATA : le ministre en charge du travail décide, après une procédure lourde et centralisée, d'inscrire sur une liste les établissements dont les salariés auront droit à l'ACAATA, mais certains choix apparaissent arbitraires. Il faut donc, par priorité, améliorer le fonctionnement du Fonds, afin que toutes les entreprises ayant exposé leurs salariés à l'amiante soient incluses dans son périmètre. Si des contraintes budgétaires imposaient de restreindre l'accès à l'ACAATA, il faudrait, dans ce cas, veiller à ce que toutes les personnes malades de l'amiante continuent de bénéficier de l'allocation.

Après que M. Roland Muzeau eut demandé un éclaircissement sur le sens de son intervention, M. Marcel Royez a précisé que la FNATH souhaitait que toutes les victimes de l'amiante bénéficient du FCAATA, mais que, dans l'hypothèse où les crédits viendraient à manquer, il était indispensable de tenir les personnes malades à l'écart de ces restrictions. Les salariés ayant été exposés à l'amiante, mais n'ayant pas développé de pathologie, pourraient alors être pris en charge dans le cadre de mesures plus générales visant à lutter contre la pénibilité au travail.

a indiqué qu'il connaissait des exemples d'entreprises utilisatrices de l'amiante dont l'inscription sur ces listes avait été refusée. Il s'est demandé si les pouvoirs publics ne cherchaient pas à limiter le nombre d'entreprises inscrites sur les listes pour éviter que les dépenses n'excèdent l'enveloppe budgétaire prévue. Il a également demandé des précisions sur les propositions de réforme de l'indemnisation formulées par la FNATH.
a estimé que des entreprises étaient entrées dans le dispositif de manière abusive, voire frauduleuse, pour bénéficier d'un système commode de préretraite, tandis que d'autres en avaient été écartées arbitrairement pour limiter les dépenses, contrairement à l'intention du législateur, qui n'a pas souhaité enfermer l'indemnisation des victimes dans une enveloppe budgétaire limitative.
A défaut de proposer une réforme globale de l'indemnisation, il a ensuite soumis plusieurs pistes de réflexion à la mission. Il a suggéré que l'on inverse la charge de la preuve dans la procédure d'instruction des dossiers du FCAATA : l'exposition à l'amiante serait présumée et il faudrait alors prouver que l'entreprise n'a pas utilisé l'amiante, ou que le salarié n'a pas été exposé, pour refuser le bénéfice de l'ACAATA. Il a de nouveau insisté sur la lourdeur de la procédure d'instruction des demandes d'inscription sur les listes, qui sont d'abord examinées par les directions régionales du travail avant d'être transmises au ministère, et qui sont soumises à l'avis consultatif de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), et il s'est interrogé sur le bien-fondé de cette dernière consultation.

s'est dit surpris que la FNATH semble prête à accepter que le bénéfice de l'ACAATA soit réservé aux seuls malades de l'amiante, dans l'hypothèse où des restrictions budgétaires seraient décidées, jugeant qu'une telle position risquait d'inciter les pouvoirs publics à donner satisfaction au Mouvement des entreprises de France (MEDEF), qui plaide en faveur d'une telle évolution.
Faisant observer que la peur n'évitait pas le danger, M. Marcel Royez a répondu qu'il était normal, dans la mesure où ce scénario était régulièrement évoqué dans le débat public, que la FNATH définisse une position. Il a également répété que la revendication de son association était d'obtenir une amélioration de l'indemnisation, et non une politique plus restrictive, et a demandé qu'il n'y ait plus de confusion entre la politique de réparation et la politique de reconversion des activités industrielles.
Il a ensuite abordé la question de la cour d'appel unique, pour faire part des fortes réserves de l'Association sur cette proposition. La FNATH, qui souhaite, de manière générale, que les victimes de l'amiante soient traitées selon les règles de droit commun, voit deux inconvénients à cette mesure : elle irait, en premier lieu, à l'encontre de l'objectif de proximité entre les citoyens et la justice et elle imposerait, en second lieu, d'augmenter considérablement les moyens affectés à la cour d'appel ainsi désignée, sauf à augmenter les délais de jugement de manière déraisonnable. Il a noté que le problème de l'hétérogénéité des décisions de justice n'était pas propre au dossier de l'amiante et a suggéré que la Chancellerie communique davantage auprès des cours d'appel sur les pratiques les plus courantes en matière d'indemnisation, afin qu'elles harmonisent progressivement leurs décisions.
Concernant les pôles « santé publique », M. Marcel Royez a approuvé l'idée d'une spécialisation des juridictions pour traiter de questions d'une grande complexité technique, mais a déploré la faiblesse des moyens qui leur sont alloués, qui ne permettraient même pas de traiter de manière satisfaisante le seul dossier de l'amiante.

a rappelé qu'une réflexion était en cours, en vue d'une réforme de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, et a souhaité connaître les propositions de la FNATH sur ce sujet. Puis il a demandé si les adhérents de l'association victimes de l'amiante rencontraient des difficultés pour faire reconnaître par les caisses de sécurité sociale l'origine professionnelle de leur maladie. Il s'est inquiété, enfin, de la situation des salariés affectés à des travaux de désamiantage, ou qui exercent des métiers de maintenance et d'entretien, et a demandé s'ils semblaient désormais correctement protégés contre les dangers de l'amiante et si l'inspection et la médecine du travail exerçaient une vigilance suffisante.
a répondu que la FNATH demandait, depuis plusieurs années, une réforme de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, afin d'atténuer un niveau de mutualisation des risques jugé excessif. Le sociologue Philippe Askénazy a montré que la prévention des risques professionnels était plus efficace aux Etats-Unis que dans notre pays car les compagnies privées qui assurent ces risques outre-atlantique ajustent immédiatement le niveau de leurs primes au niveau de risque constaté dans chaque entreprise, ce qui incite ces dernières à mener des politiques de prévention énergiques. Il apparaît donc souhaitable d'individualiser davantage la tarification des risques professionnels, en tenant compte, en outre, de la totalité des accidents du travail et des maladies professionnelles et non seulement de ceux qui ont été déclarés et reconnus.
Il a ensuite plaidé pour une séparation des fonctions d'évaluation et de gestion du risque. La fonction d'évaluation ne devrait pas être exercée par les partenaires sociaux, mais par des experts indépendants, adressant leurs recommandations directement aux pouvoirs publics. L'affaire de l'amiante a en effet montré que le lobbying des industriels, qui ont longtemps affirmé que « l'usage contrôlé » de ce matériau garantissait la sécurité des salariés, pouvait nuire à une évaluation rigoureuse des risques, tandis que les syndicats apparaissent parfois partagés entre l'objectif de défense de la santé et de la sécurité au travail et l'objectif de préservation de l'emploi. C'est pourquoi la FNATH est favorable à la création d'une Agence de la santé au travail, indépendante des industriels.
Après que M. Marcel Royez eut évoqué le manque d'indépendance des médecins du travail vis-à-vis de l'employeur, Mme Michèle San Vicente a souligné que certains médecins du travail avaient tenté d'alerter sur les dangers de l'amiante, mais qu'ils redoutaient les conséquences négatives de ces initiatives pour leur carrière.

a indiqué que les employeurs avaient l'obligation, depuis 2000, de remplir un document unique recensant les substances et matériaux manipulés par les salariés, mais que le respect de cette obligation faisait l'objet de très peu de contrôles et qu'aucune sanction n'était prévue en cas d'infraction. Le plan « santé au travail » annoncé par le Gouvernement ne répond pas suffisamment à ces lacunes et il revient donc au Parlement de doter les organismes de contrôle des moyens propres à leur permettre d'exercer convenablement leur mission.
a confirmé que le droit du travail n'était pas toujours bien appliqué, surtout dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité au travail. Les contrôles effectués sur les chantiers de désamiantage ont par exemple montré que, dans 76 % des cas, des éléments essentiels de la réglementation n'étaient pas appliqués. En outre, les trois quarts des procès-verbaux rédigés par les inspecteurs du travail ne donnent lieu à aucune poursuite, car ils sont classés sans suite par les parquets. Une meilleure spécialisation des inspecteurs du travail faciliterait les contrôles sur les problèmes très techniques posés par la toxicité de certaines substances utilisées en milieu professionnel. La médecine et l'inspection du travail devraient également développer leurs fonctions d'anticipation des risques et de prévention.
a ensuite expliqué que la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles s'était améliorée. La décision de retenir comme point de départ du délai de prescription le moment où les salariés sont informés du lien possible entre leur maladie et leur activité professionnelle leur a permis de faire valoir plus efficacement leurs droits et le nombre de déclarations de maladies professionnelles a, de ce fait, augmenté. Toutefois, les salariés et leurs médecins traitants demeurent mal informés sur la possible origine professionnelle de certaines pathologies et songent rarement à la rechercher.
La procédure d'élaboration des tableaux de maladies professionnelles demeure en revanche laborieuse : il a fallu dix ans, par exemple, pour élaborer le tableau relatif aux dorsalgies, ou celui relatif aux cancers broncho-pulmonaires.

a demandé quel jugement portait l'Association des accidentés de la vie sur la loi Fauchon, à laquelle il est souvent reproché d'empêcher la mise en cause pénale des responsables de la contamination par l'amiante.
a indiqué qu'il convenait de dresser un bilan de son application par les tribunaux avant de se prononcer de manière définitive. Il a jugé que la distinction entre responsabilités directe et indirecte introduite par ce texte n'avait rien d'absurde. Il a surtout regretté que les parquets n'exercent pas davantage de poursuites dans des affaires mettant en cause la santé et la sécurité au travail.

est revenu sur la question de l'expertise en matière d'évaluation des risques professionnels et a demandé quelle autorité pourrait remplir cette mission.
a rappelé que plusieurs organismes disposaient déjà d'une expertise en ce domaine, notamment l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) et l'Institut national de veille sanitaire (InVS). Leurs experts doivent cependant être mis à l'abri des pressions des industriels, pour éviter, comme cela a pu être le cas à l'INRS, que des chercheurs soient sanctionnés en raison de leurs travaux. Dans cette perspective, il a jugé préférable que les partenaires sociaux ne siègent pas au conseil d'administration de la future Agence de la santé au travail.
est intervenu pour souligner que la loi Fauchon ne concernait que les personnes physiques et qu'une faute simple était donc suffisante pour engager la responsabilité des personnes morales. Il s'est également interrogé sur le bien-fondé du maintien de règles de prescription identiques pour les personnes physiques et pour les grands groupes, qui peuvent être fortement impliqués dans des crises sanitaires.
a ajouté que le FIVA devrait réviser sa politique d'indemnisation, afin de tenir compte des apports de la jurisprudence, ce qui permettrait de réduire de manière importante le nombre de recours contentieux.

La mission a ensuite entendu une communication de M. Pierre Fauchon, sénateur.
a indiqué qu'il souhaitait présenter à la mission l'économie générale de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, dont il a été largement à l'origine.
Il a rappelé qu'il existait deux sortes de responsabilité : la responsabilité civile et la responsabilité pénale. La première correspond à la nécessité de réparer un dommage causé, notamment par la mutualisation du risque que permet le système d'assurances. La responsabilité pénale, a-t-il précisé, constitue une notion bien distincte : il s'agit de punir des fautes, selon le degré de gravité de celles-ci, qui intéressent non seulement la victime, mais également la société. S'il est établi de longue date que l'imprudence engage la responsabilité civile et donne lieu à une réparation, il a fait observer que cette règle n'allait pas de soi en matière pénale, puisqu'il n'y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre. Il a toutefois noté que certains faits d'imprudence constituaient des délits que la société se devait de réprimer. Il a estimé que la jurisprudence traditionnelle, selon laquelle la moindre imprudence pouvait entraîner à la fois la responsabilité civile et pénale, ne paraissait pas satisfaisante, car l'absence de décision pouvait aboutir, par exemple, à engager la responsabilité des élus locaux, des directeurs d'hôpitaux ou encore des enseignants.
a indiqué que, sur la base de ce constat, la commission des lois du Sénat, dont l'attention avait été attirée par des maires faisant l'objet de poursuites, avait engagé une réflexion dans le cadre d'un groupe de travail constitué en son sein. Il a rappelé que certains étaient favorables à une loi spéciale pour les maires, mais qu'il s'était opposé à cette proposition en raison du caractère général de l'application de la loi pénale. Il a ajouté que le Premier ministre de l'époque, M. Lionel Jospin, avait déclaré, devant l'Association des maires de France, que le gouvernement était opposé à une loi spécifique pour les élus locaux.
Il a rappelé que ce problème avait été traité en deux étapes. Une loi de 1996 avait posé le principe de la nécessité, pour apprécier la responsabilité pénale d'une personne physique, de prendre en compte les moyens et les pouvoirs dont elle disposait. Il a noté que cette loi s'était révélée insuffisante et qu'il convenait donc de définir le délit non intentionnel, ce qu'il a fait en déposant une proposition de loi. Il a fait observer que le rapporteur de l'Assemblée nationale sur ce texte, M. René Dosière, avait proposé d'engager la responsabilité pénale des personnes physiques sur la base d'une faute d'une « exceptionnelle gravité », ce qui pouvait apparaître restrictif. Une réflexion approfondie a alors été engagée pour proposer une rédaction plus appropriée, en relation avec le garde des sceaux de l'époque, Mme Elisabeth Guigou. Ainsi, il a été proposé que la reconnaissance de la responsabilité pénale soit fondée sur l'existence d'une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qui ne pouvait être ignorée.
a fait observer que deux aspects de la loi du 10 juillet 2000 pouvaient poser problème. Le premier tient à l'existence d'un lien de causalité indirecte entre l'imprudence commise et le dommage subi. De ce point de vue, il a estimé que certaines des interprétations retenues aujourd'hui étaient inexactes. Il a rappelé que le choix d'une causalité indirecte résultait de la volonté de ne pas faire entrer dans le champ d'application de la loi les accidents de la circulation, qui relèvent presque toujours d'une causalité directe. Par ailleurs, a-t-il rappelé, cette loi n'est pas applicable aux personnes morales. Il a expliqué ce choix par la possibilité de l'existence d'une responsabilité pénale diffuse au sein d'une personne morale, une commune par exemple. Il a ainsi cité le cas d'une affaire d'accident de la circulation s'étant déroulée dans l'Orne, où l'expertise avait montré que 15 intervenants avaient été concernés par la construction d'un parking et d'un arrêt de bus. La loi se devait de tenir compte d'une telle complexité.
Il a indiqué que la loi du 10 juillet 2000 était d'application immédiate, puisqu'elle constituait une loi pénale plus douce. Il a fait observer que, sur son fondement, certaines relaxes avaient pu être prononcées, la faute caractérisée n'ayant pas été reconnue, comme dans l'affaire du Drac ou dans un procès mettant en cause le maire d'une commune qui n'avait pas signalé le danger de se promener au bord d'une falaise. Il a également noté, à l'inverse, que des condamnations, parfois relativement lourdes, avaient été prononcées, par exemple dans l'affaire de l'avalanche de Chamonix, ou à l'encontre d'un enseignant dont un élève s'était tué en tombant d'une fenêtre restée ouverte dans la classe. Il a ensuite évoqué le procès récent du tunnel du Mont-Blanc qui, selon lui, s'est déroulé dans des conditions exemplaires et où toute la gamme des prévenus était présente. Il a fait remarquer que, si le jugement était toujours en attente, le procureur avait demandé une peine moins lourde pour le chauffeur du camion que pour les dirigeants, ce qui contredit l'idée répandue selon laquelle la loi du 10 juillet 2000 fait « payer les lampistes »
Evoquant les principales critiques adressées à cette loi, M. Pierre Fauchon a fait observer qu'elle n'était pas réservée aux élus, mais qu'elle était au contraire d'application générale, comme le montre d'ailleurs la jurisprudence. Concernant l'affirmation selon laquelle la loi ferait obstacle aux poursuites, il a noté que Mme Marie-Odile Bertella-Geffroy, lors de son audition, n'avait pas abondé en ce sens, et il a estimé que la loi impliquait nécessairement une instruction plus approfondie. Il a considéré que la critique la plus fondée portait sur l'impossibilité de condamner en cas de responsabilité indirecte. Sur ce point, il a estimé qu'il convenait d'attendre le jugement de la Cour de cassation, le problème ne se posant pas pour l'instant. Il a cité une étude sérieuse diffusée sur un site Internet, selon laquelle les condamnations prononcées par les magistrats à l'encontre des élus, sur la base de la loi du 10 juillet 2000, après une période de familiarisation avec celle-ci, étaient en réalité relativement lourdes.
S'agissant de l'amiante, qui pourrait devenir la « plus grosse affaire pénale du siècle », il a considéré que le juge devait établir une faute caractérisée de la part de l'employeur qui n'aurait pas pris les mesures nécessaires en matière de sécurité au travail. Il a rappelé que le juge d'instruction n'avait pour tâche que d'instruire le dossier et de le transmettre au juge du fond, à qui il appartient de se prononcer sur l'existence ou non d'une faute caractérisée. Il a estimé qu'il était également possible, pour les victimes de l'amiante, de recourir à la procédure de la citation directe.

s'est enquise de la possibilité d'obtenir des informations sur les incidences de la loi du 10 juillet 2000 en matière de responsabilité pénale.

a indiqué que des statistiques avaient été demandées sur ce point à la Chancellerie.

a fait observer que des comparaisons seraient difficiles à établir, puisqu'aucune affaire n'est identique. Il a rappelé que le rapport annuel de la Cour de cassation fournissait des éléments d'information en la matière et s'est demandé s'il ne serait pas utile d'auditionner un magistrat sur l'évolution jurisprudentielle. Il a considéré qu'en matière de réglementation du travail, la responsabilité pénale devait peser sur le chef d'entreprise lui-même et que la faute caractérisée devait être appréciée plus sévèrement. Enfin, il a noté que la loi du 10 juillet 2000 avait permis de mettre un terme aux poursuites abusives visant des enseignants ou des maires.