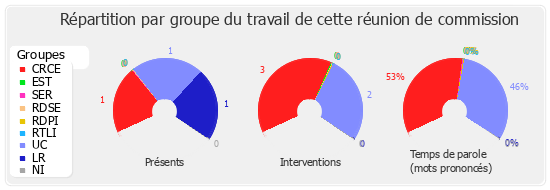Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale
Réunion du 16 janvier 2008 : 1ère réunion
Sommaire
- Rétention et irresponsabilité pénale pour trouble mental
- Audition de m. jean-pierre escarfail président et mme anne bordier-coispellier vice-présidente de l'association pour la protection contre les agressions et crimes sexuels apacs (voir le dossier)
- Audition de m. jean-olivier viout procureur général près la cour d'appel de lyon (voir le dossier)
- Audition de m. jean-louis senon professeur de médecine à l'université de poitiers (voir le dossier)
- Audition de m. gilles lebreton professeur de droit public à l'université du havre (voir le dossier)
La réunion
La commission a procédé à des auditions sur le projet de loi n° 158 adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pour cause de trouble mental.

a rappelé que le rapporteur avait préparé l'examen du projet de loi par de nombreuses auditions ouvertes aux membres de la commission, par un déplacement dans la province de Québec au Canada et par la visite de nombreux établissements en France, en Belgique et au Royaume-Uni. Il a précisé que les structures néerlandaises et allemandes avaient par ailleurs été étudiées dans le cadre de la mission sur les mesures de sûreté concernant les personnes dangereuses, conduite en 2006. Indiquant que le projet de loi avait été adopté, en le modifiant, par l'Assemblée nationale le 9 janvier 2008, il a constaté l'utilité des auditions complémentaires proposées à la commission avant d'entendre la garde des sceaux et d'examiner le rapport de M. Jean-René Lecerf.
Audition de M. Jean-Pierre Escarfail président et Mme Anne Bordier-coispellier vice-présidente de l'association pour la protection contre les agressions et crimes sexuels apacs
Audition de M. Jean-Pierre Escarfail président et Mme Anne Bordier-coispellier vice-présidente de l'association pour la protection contre les agressions et crimes sexuels apacs
La commission a tout d'abord entendu M. Jean-Pierre Escarfail, président, et Mme Anne Bordier-Coispellier, vice-présidente de l'association pour la protection contre les agressions et crimes sexuels (APACS).
a exprimé son accord global avec le projet de loi, jugeant utiles les modifications apportées par l'Assemblée nationale afin d'étendre la portée du dispositif de rétention de sûreté, d'abord limité aux auteurs de crimes sexuels sur les mineurs de moins de quinze ans, aux auteurs de crimes commis sur tous les mineurs et sur les majeurs avec des circonstances aggravantes. Estimant que l'analyse de la délinquance et de la criminalité devait être conduite dans un cadre logique, il a expliqué que l'on pouvait situer au sommet d'une échelle de gravité les tueurs en série, soit environ cinq condamnations par an, les plus médiatisées, puis les violeurs en série, dont il a estimé que cinquante à cent étaient condamnés chaque année. Il a évoqué le cas d'un criminel qui, condamné à seize ans pour le viol de quatorze jeunes femmes et libéré après dix années de rétention, avait commis trois nouveaux viols dans les trois mois suivant sa sortie.
Mentionnant ensuite les violeurs occasionnels, les auteurs d'agressions, de viols intrafamiliaux et d'actes pédophiles, il a précisé qu'un millier d'homicides étaient commis chaque année en France, dont une part importante liée à des crimes sexuels, et que le nombre de viols était évalué à trente mille par an. Considérant que chaque catégorie de criminels ou de délinquants devait faire l'objet de soins appropriés, il a jugé que l'éducation constituait l'outil le plus efficace pour prévenir la délinquance occasionnelle, que l'usage du bracelet électronique paraissait adapté aux violeurs les moins dangereux et que les centres de rétention socio-médico-judiciaires de sûreté envisagés par le projet de loi devaient être mis en place pour traiter les cas les plus graves.
Considérant que notre système judiciaire devait intégrer les avancées de la neurologie, M. Jean-Pierre Escarfail a considéré que les progrès accomplis en cette matière conduisaient à atténuer progressivement la frontière entre les personnes psychotiques, c'est-à-dire atteintes d'une maladie mentale, et les psychopathes frappés de troubles de la personnalité. Il a avancé que les recherches montraient chez ces deux catégories de personnes un dysfonctionnement du système neuronal et avaient permis d'identifier des neurones miroirs jouant un rôle essentiel dans l'aptitude à éprouver de l'empathie. Si les personnes atteintes de troubles psychotiques peuvent être distinguées des psychopathes, a-t-il expliqué, les deux doivent recevoir des soins appropriés, de chimiothérapie ou de psychothérapie.
Indiquant que l'Association pour la protection contre les agressions et crimes sexuels situait son action dans le cadre de la protection des droits de l'homme, il a rappelé que M. Alvaro Gil-Robles, ancien commissariat aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, avait estimé que la France, en autorisant l'hospitalisation d'office sur décision administrative de personnes souffrant de troubles mentaux, ne respectait pas la Convention européenne des droits de l'homme, car de telles décisions devaient être confiées à la justice. Il a souligné que le commissaire européen aux droits de l'homme recommandait également que les décisions d'enfermement des pervers psychopathes soient prises par des magistrats selon une procédure comportant toute les garanties de droit.
a insisté sur la nécessité de tenir compte de l'impact des nouvelles mesures proposées sur les victimes, considérant que le rejet du projet de loi reviendrait en fait à exposer chaque année plusieurs dizaines de femmes à un danger de mort, qu'il soit causé par l'agression ou par la propension au suicide des victimes d'agression sexuelle. Rappelant que près de mille homicides volontaires étaient commis chaque année en France, il a précisé que la part des homicides liés à des agressions sexuelles était considérée comme proche du nombre de morts causées par des violences conjugales, soit entre 150 et 180 par an. Il a ajouté que les victimes éprouvaient ensuite de grandes difficultés à se reconstruire et que la proportion des personnes effectuant des tentatives de suicide après une agression sexuelle était estimée à 20 %.
Jugeant que le recours systématique à la prison se situait à l'opposé d'une approche pertinente de la criminalité sexuelle, il a déclaré que, dans une cinquantaine d'années, la prison conçue comme une réponse uniforme aux crimes et délits paraîtrait aussi aberrante que le bagne aujourd'hui. Il a estimé que la justice devait évoluer et apporter des réponses adaptées en organisant un suivi social et en recourant au bracelet électronique pour les personnes soupçonnées d'atteintes graves au droit. Le placement sous surveillance électronique des accusés de l'affaire d'Outreau aurait permis, a-t-il expliqué, d'éviter le drame provoqué par la détention provisoire de personnes qui ont finalement été acquittées.
S'agissant des criminels en série, il a souligné que l'on ne pouvait connaître, au moment de leur jugement, les traitements qui seraient adaptés à leur cas une vingtaine d'années après le début de leur peine, ni prévoir l'évolution de leur personnalité.
Evoquant la création par le projet de loi de commissions régionales de la rétention de sûreté composées de hauts magistrats, il a affirmé que, pour la gestion des longues peines, la justice de condamnation, chargée de juger les faits passés, et la justice de libération, chargée d'évaluer les risques futurs, devaient être placées sur un pied d'égalité. Estimant que le jugement des actes passés pouvait apparaître plus aisé que l'appréciation du danger à venir et la définition d'une mesure de sûreté, il a expliqué que nombre de pays pratiquaient cependant cette évaluation. Il a considéré que l'individualisation des mesures de sûreté devait constituer un principe aussi intangible que l'individualisation des peines.
S'agissant de l'appréciation de la dangerosité des auteurs de crimes et délits sexuels, il a indiqué que les enquêtes conduites à l'étranger démontraient la possibilité de réaliser des évaluations plus approfondies que celles conduites en France, où l'on s'en remet à l'avis d'un petit nombre d'experts se fondant sur de brefs entretiens avec la personne. Il a indiqué qu'il participait lui-même à une commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté chargée, dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, de donner un avis au juge d'application des peines avant le placement sous surveillance électronique mobile d'une personne condamnée et à laquelle le projet de loi confie l'évaluation de la dangerosité des personnes susceptibles de faire l'objet d'une mesure de rétention. Relevant que le Canada et les Pays-Bas avaient mis en place des procédures d'évaluation sophistiquées, il a précisé qu'en Suisse, la procédure d'évaluation faisait intervenir non seulement une commission pluridisciplinaire, mais aussi des surveillants pénitentiaires, des travailleurs sociaux, des psychiatres, des psychologues et des criminologues ayant pu suivre la personne sur une longue durée.
Rappelant que le risque zéro n'existait pas en matière de criminalité, M. Jean-Pierre Escarfail a estimé que la juridiction de libération chargée d'évaluer le la dangerosité d'un criminel à sa sortie de prison devait se prononcer au regard de la probabilité qu'un psychopathe commette une nouvelle agression.
Jugeant indispensable de lier la justice et la thérapie dans une approche pluridisciplinaire, il a relevé que les intéressés devaient être soignés le plus rapidement possible. Considérant que les centres socio-médico-judiciaires de sûreté participaient de cette démarche pluridisciplinaire, il a estimé que, suivant le modèle suédois, un protocole de soins où les remises de peines ne seraient plus automatiques, mais toujours conditionnelles et fondées sur l'évolution de la personne, devait se substituer à l'attribution indifférenciée de grâces présidentielles et de remises de peine qui ont dénaturé notre système pénal. Il a précisé que ce protocole de soins devrait être mis en oeuvre dès le début de la peine, afin d'amener l'intéressé à comprendre qu'il peut maîtriser son destin. Considérant que ce système serait conforme à la Convention européenne des droits de l'homme, il a indiqué que les pays obtenant les meilleurs résultats en matière de prévention par les soins étaient ceux qui avaient choisi de distinguer la gestion de la peine et celle des mesures de sûreté.
a rappelé qu'une victime était amenée à effectuer des démarches difficiles pour obtenir la condamnation de son agresseur, sans en retirer d'autre bénéfice que la mise à l'écart temporaire de ce dernier. Elle a estimé que la justice devait donner toute leur portée aux efforts des victimes en évitant que la personne condamnée ne commette ensuite d'autres crimes, alors que sa dangerosité était connue. Elle a espéré que le projet de loi permette d'apporter des soins efficaces aux auteurs de crimes sexuels et de parvenir au taux de récidive le plus faible possible.

indiquant qu'il avait déjà entendu M. Jean-Pierre Escarfail et Mme Anne Bordier-Coispellier lors d'une audition préalable, a déclaré qu'il avait été frappé par la faiblesse des moyens consacrés au traitement des criminels sexuels, les représentants de l'APACS ayant cité un criminel dont la principale activité, au cours de sa détention, avait été de pratiquer la musculation. Il a souhaité savoir quel système étranger leur paraissait le plus efficace pour soigner les délinquants sexuels et éviter leur récidive. Il a considéré que les commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté semblaient multiplier les expertises psychiatriques contradictoires au lieu de se référer selon une procédure pluridisciplinaire aux observations des personnes appelées à suivre l'intéressé dans la durée. Il s'est interrogé sur la nécessité de créer des établissements différents d'une part pour les psychotiques qui, atteints de troubles mentaux, pourraient être soignés dans des hôpitaux fermés, et d'autre part pour les psychopathes, affectés de troubles de la personnalité et pour lesquels des centres de rétention paraîtraient plus adaptés. Il a souhaité savoir si la rétention de sûreté constituerait pour le condamné une incitation forte à accepter les soins en prison, le refus des soins pouvant entraîner, à l'issue de sa peine, sa rétention dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.
a estimé qu'une commission pluridisciplinaire pouvait émettre un avis d'autant plus fondé qu'elle examinait l'ensemble du profil criminologique de la personne, et pas seulement son profil psychiatrique. Il a précisé que le système canadien prenait ainsi en compte l'enfance et les conditions d'éducation de la personne pour apprécier son parcours général et évaluer les risques de récidive à sa sortie de prison. Relevant que la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté conduisait déjà une évaluation plus large que celle fondée sur une approche uniquement psychiatrique, il a souligné la nécessité de conduire des évaluations globales et de donner à la commission le temps nécessaire pour les réaliser, en suivant les exemples néerlandais et suisse.
Evoquant les soins apportés aux délinquants sexuels, il a expliqué qu'au Canada, était pratiquée une forme de thérapie de groupe les obligeant à une attitude de vérité les poussant à sortir du déni. Il a indiqué que cette démarche avait été reprise par M. Philippe Pottier, lorsqu'il dirigeait le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) d'Angoulême et par le docteur Roland Coutanceau, directeur du centre médico-psychologique pour adultes de la Garenne-Colombes. Il a déclaré que l'obligation de soins se réduisait aujourd'hui en France à une obligation formelle pour les délinquants sexuels et devait être réformée. Rappelant que les traitements apportés aux criminels étaient aujourd'hui très distincts, les psychotiques étant soumis à des calmants équivalents à une forme de camisole chimique, alors que les psychopathes reçoivent notamment des anti-androgènes, il a expliqué que les traitements devaient tenir compte des progrès de la chimiothérapie. Il a expliqué que les recherches conduites sur les neurones miroirs pourraient permettre l'élaboration, dans une vingtaine d'années, de médicaments visant à rétablir les capacités d'empathie, inexistantes chez les psychopathes.
relevant que les soins psychiatriques étaient quasi-inexistants en prison, a considéré que ce suivi médical devrait commencer dès le début de la peine afin d'optimiser la période carcérale et d'assurer la réinsertion des condamnés. Elle a expliqué que l'agresseur dont elle avait été elle-même la victime avait refusé les soins proposés en prison, qui lui auraient permis d'obtenir une remise de peine de deux mois, mais l'auraient astreint à un suivi à sa sortie, alors que son refus lui a permis de sortir de prison sans aucune obligation de suivi psychiatrique. Elle a estimé que les trois personnes agressées par ce criminel dans les trois mois suivant sa libération pourraient engager des poursuites contre l'Etat, qui, averti par ses victimes précédentes, n'avait pas pris de mesures de prévention efficaces. Exprimant le souhait que le nouveau système mis en place bénéficie à la fois aux victimes, mieux protégées, et aux auteurs de crimes et de délits, qui recevront des soins, elle a souligné que les équipes chargées d'apporter des soins aux détenus ne devraient pas comprendre que des psychiatres, mais également des psychologues, des neurologues et des médecins généralistes.
Puis la commission a entendu M. Jean-Olivier Viout, procureur général près la cour d'appel de Lyon.

a souligné l'intérêt de l'audition de M. Jean-Olivier Viout devant la commission compte tenu de son expérience et de ses compétences dans le domaine pénal, celui-ci ayant présidé le comité d'orientation chargé de préparer la future loi pénitentiaire. Il a souhaité recueillir ses observations sur le projet de loi destiné à mieux protéger la société face à des personnes particulièrement dangereuses, en particulier sur la qualité des soins prodigués en prison aux délinquants dangereux et le champ d'application de la nouvelle mesure de rétention de sûreté limitée à certains crimes les plus graves.
Marquant qu'il participait régulièrement aux audiences de la chambre de l'instruction et de la cour d'assises pour garder le contact avec la réalité judiciaire, M. Jean-Olivier Viout a souligné le bien-fondé des deux objectifs poursuivis par le projet de loi : améliorer le traitement par l'autorité judiciaire des auteurs d'infractions déclarés pénalement irresponsables en raison d'un trouble mental et introduire une mesure de rétention de sûreté pour retenir dans des centres fermés les personnes particulièrement dangereuses ayant commis les crimes les plus graves, à l'issue de leur peine.
Abordant le volet de la réforme relatif à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, il s'est réjoui de la formulation finalement retenue, rappelant que le gouvernement avait initialement envisagé de faire référence à la « culpabilité civile ». Il a ajouté que le Conseil d'Etat, saisi de l'avant-projet de loi, avait fait observer, à juste titre, que la reconnaissance de la culpabilité d'une personne irresponsable mettait à mal l'étymologie et les concepts juridiques classiques.
Il a distingué les deux cas de figure prévus par la réforme dans lesquels la déclaration pour irresponsabilité pénale peut être prononcée : lorsque l'auteur de l'infraction est jugé par la juridiction de jugement devant laquelle il a été renvoyé ou lorsque l'auteur présumé des faits est mis en examen par le juge d'instruction.
Evoquant la première hypothèse, le procureur général près la cour d'appel de Lyon s'est félicité qu'un débat public préalable au prononcé de la décision soit prévu et qu'il soit clairement mentionné que la juridiction de jugement doit reconnaître que les faits reprochés au prévenu lui sont imputables, mais que ce dernier est irresponsable pénalement à raison d'un trouble psychique ou neuropsychiatrique qui affecte sa capacité de discernement ou le contrôle de ses actes. Il a souhaité que les conditions dans lesquelles l'arrêt est prononcé par la cour d'assises soient précisées au sein du nouvel article 706-130 du code de procédure pénale.
S'agissant de la procédure applicable devant la chambre de l'instruction, M. Jean-Olivier Viout a jugé le dispositif proposé satisfaisant. Il a suggéré que la comparution à l'audience du mis en examen soit -si son état le permet- de droit et non à la discrétion du président de la chambre de l'instruction, des parties civiles ou de la chambre de l'instruction comme prévu dans le texte adopté par les députés. La présence du mis en examen lors de l'audience lui a paru nécessaire pour assurer le caractère contradictoire de la procédure. Il a indiqué qu'à l'issue de l'audience, la chambre de l'instruction avait trois possibilités : déclarer un non-lieu pour insuffisance de charges contre le mis en examen, renvoyer celui-ci devant la juridiction compétente ou encore prononcer un arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale à raison d'un trouble mental.
Il a également évoqué la possibilité pour les parties civiles de demander le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel pour statuer sur les intérêts civils, se demandant si cette juridiction est la plus compétente pour évaluer le montant du préjudice subi. La Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) lui a paru plus qualifiée pour exercer cette mission.
Il a mis en avant que la déclaration d'irresponsabilité pénale pour trouble mental permettrait aux victimes, au terme d'un débat judiciaire contradictoire organisé dans le cadre d'une formation collégiale -et non plus tenu dans l'intimité du cabinet d'un juge d'instruction et sans la moindre apparence de procès- de voir la vérité des faits reconnue et la soustraction à la sanction pénale de son auteur débattue. Il a également souligné l'importance du caractère public des débats, faisant valoir que la prise en compte d'une infraction grave n'est pas la seule affaire de la victime, mais concerne également la société et l'opinion publique, en raison des atteintes à l'ordre public.
Le procureur général près la cour d'appel de Lyon a toutefois regretté que la saisine de la chambre de l'instruction pour prononcer une déclaration d'irresponsabilité pénale demeure une simple possibilité laissée à la discrétion du ministère public, du juge d'instruction ou des parties civiles, craignant qu'un dispositif non contraignant ne vide de sa substance la portée de cette procédure. Il a cité en exemple la faculté de réexaminer la détention provisoire d'une personne mise en examen tous les six mois introduite à la suite de l'affaire d'Outreau par la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, constatant que cette mesure pourtant opportune était en pratique rarement mise en oeuvre, faute d'être systématique.
L'argument selon lequel une saisine obligatoire de la chambre de l'instruction pourrait provoquer un engorgement de cette juridiction lui a semblé peu pertinent au regard du nombre actuel de non-lieux prononcés (200 pour 35 cours d'appel, soit une demi-douzaine par chambre de l'instruction en 2004). Il a plaidé pour une saisine automatique de la chambre de l'instruction, au moins pour tous les crimes.
s'est étonné de la longueur du délai -six mois- durant lequel, en cas de saisine de la chambre de l'instruction, la durée de la détention provisoire peut être prolongée dans l'attente de la décision de cette juridiction. Il a estimé ce délai anormalement long dans le contexte actuel d'une stricte limitation de la durée de la détention provisoire. Un raccourcissement de ce délai -que l'Assemblée nationale a ramené de six à quatre mois en matière criminelle- lui a paru en outre d'autant plus nécessaire que le mis en examen pourra être déclaré pénalement irresponsable pour trouble mental.
a expliqué que les mesures de sûreté susceptibles d'être prononcées par la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement à l'encontre d'une personne reconnue pénalement irresponsable pour trouble mental ne constituent pas des peines en ce qu'elles visent à prévenir un danger ou à réduire un risque. Il a ajouté qu'il revient à l'autorité administrative de décider de mettre en oeuvre de telles mesures en application du principe de précaution et que depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal en 1994, l'autorité judiciaire peut seulement prononcer des peines privatives ou restrictives de liberté complémentaires d'une condamnation pénale. Il a estimé que la faculté de prononcer des mesures de sûreté indépendamment d'une reconnaissance de culpabilité pénale par le juge pénal introduira une rupture avec l'état du droit en vigueur et conduira à un retour en arrière. En outre, l'autorité judiciaire serait conduite à exercer des missions devant incomber à l'autorité administrative.
Le procureur général près la cour d'appel a au surplus jugé paradoxal le dispositif tendant à rendre la personne déclarée irresponsable pénalement punissable de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende en cas de non-respect d'une mesure de sûreté. Il a noté toutefois que, dans cette hypothèse, le texte prévoyait la possibilité de prononcer une déclaration d'irresponsabilité pénale pour trouble mental.
Il a estimé que le texte pourrait utilement être complété en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les mesures de sûreté sont prononcées, en particulier s'agissant du moment durant lequel l'expertise psychiatrique requise préalablement à la décision doit intervenir.
Il a par ailleurs regretté que le projet de loi ne soit pas suffisamment précis sur les voies de recours, notamment en ce qui concerne la faculté pour le ministère public de faire appel d'un arrêt de la cour d'assises statuant sur les mesures de sûreté.
s'est demandé si la responsabilité d'ordonner des mesures de sûreté ne devrait pas exclusivement incomber aux préfets, éventuellement sur proposition du ministère public. Il a jugé paradoxal que la décision d'hospitaliser d'office l'auteur d'une infraction déclaré pénalement irresponsable pour trouble mental revienne à l'autorité administrative, alors que dans le même temps, le juge pourtant dessaisi de ce pouvoir reste maître de la décision pour prononcer des mesures de sûreté. Il a jugé préférable de clarifier les responsabilités de chacun.
Il s'est demandé si la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté au sein de laquelle siège un juge judiciaire et instituée par la loi du 12 décembre 2005 pourrait jouer un rôle dans ce dispositif. Il a fait valoir en outre que le projet de loi aurait pour effet de bouleverser l'essence des missions de la juridiction d'instruction, dont la vocation est d'intervenir seulement au stade de la phase préparatoire du procès.
a observé que de nombreux pays étrangers, tels que l'Allemagne, l'Angleterre et le Pays de Galles, l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas, donnent à l'autorité judiciaire le pouvoir d'ordonner l'hospitalisation d'office de l'auteur d'une infraction atteint d'un trouble mental. Il a indiqué qu'en Suède, il n'existe pas de régime d'irresponsabilité pénale. Il a ajouté que dans les systèmes étrangers, une fois l'hospitalisation d'office décidée par le juge, celui-ci n'a plus de pouvoir sur la personne mise en cause.
Sur le deuxième volet du texte, il a expliqué que l'instauration de la rétention de sûreté par le projet de loi vise à soustraire du circuit social les criminels les plus dangereux. Il a pleinement souscrit à l'objectif poursuivi par ce dispositif inédit, ajoutant que plusieurs garde-fous étaient prévus pour l'encadrer. A cet égard, il a évoqué le champ d'application de la rétention de sûreté, limité à certains crimes limitativement énumérés (meurtre, assassinat, torture ou acte de barbarie, viol et enlèvement et séquestration) commis sur des victimes particulièrement vulnérables, se félicitant de ce que l'Assemblée nationale, sur la proposition de sa commission des lois, en ait étendu la portée aux crimes commis sur tous les mineurs et non plus seulement ceux de moins de quinze ans aux termes du texte initial. Il a également indiqué que la rétention de sûreté ne pourra être décidée que sous réserve que la juridiction de jugement ait effectivement envisagé le recours à cette éventualité. Il a en outre noté que la mise en oeuvre de cette mesure est conditionnée à l'intervention de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté chargée d'évaluer la dangerosité du délinquant avec l'appui de deux experts. Enfin, il a observé que la situation de l'intéressé devrait être réexaminée chaque année.
Il s'est interrogé sur l'opportunité de confier à l'autorité judiciaire la responsabilité de placer en centre fermé en vue d'une prise en charge médicale et sociale des personnes ayant purgé leur peine qui ne sont plus sous main de justice. Il a en effet jugé ambigu le statut de la commission régionale chargée de décider de la rétention de sûreté et composée d'un président de chambre et de deux conseillers de cour d'appel, se demandant quel serait le degré d'indépendance des magistrats vis-à-vis des conclusions des experts. Il a également estimé que la mission ainsi confiée aux juges déborde le cadre de leur office.
Il a établi une distinction de nature entre le régime de la surveillance judiciaire issu de la loi du 12 décembre 2005, qui peut donner lieu à des injonctions de soins dont la durée est limitée à la durée légale des réductions de peine accordées et la rétention de sûreté, mesure qui ne peut être décidée qu'une fois la peine intégralement purgée. Il a estimé que la prise de décision d'enfermer une personne dangereuse après la phase judiciaire doit incomber à l'autorité administrative, et non à l'autorité judiciaire, au risque de créer une confusion des rôles.

s'est demandé si l'hospitalisation d'office qui relève actuellement de l'autorité administrative ne devrait pas être décidée par le juge, par essence gardien des libertés individuelles, s'interrogeant au demeurant sur la compatibilité de notre droit sur ce point avec les exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et du citoyen. Il a fait observer que le projet de loi tend à instaurer un régime dual selon qu'une personne particulièrement dangereuse ayant commis une infraction très grave est déclarée ou non irresponsable pénalement.
Partageant cette analyse, M. Jean-Olivier Viout a indiqué que la réforme aura pour effet de créer un système dichotomique sur ce point.

A propos de la rétention de sûreté, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a exprimé des réserves sur l'architecture retenue par la réforme qui prévoit que la rétention de sûreté est décidée par une commission régionale, sous réserve d'un appel devant une commission nationale et, le cas échéant, d'un pourvoi en cassation. Il a souligné l'ambiguïté du statut de la commission régionale qui s'apparente plus à une juridiction d'application des peines, bien que l'on ne se situe plus dans le cadre de la phase judiciaire.
S'agissant des modalités retenues pour évaluer la dangerosité de la personne, le rapporteur s'est demandé si l'intervention de deux experts prévue par les députés est le système idoine. Il s'est interrogé sur le point de savoir s'il ne serait pas opportun de mettre en place un dispositif d'observation plus long faisant intervenir plusieurs acteurs.
Enfin, il a constaté que le projet de loi, en créant la rétention de sûreté, opère un changement de nature des mesures de sûreté.
Le procureur général près la cour d'appel de Lyon a souligné qu'une fois la peine purgée, il appartient aux acteurs extérieurs au monde judiciaire (police, corps médical) d'intervenir pour protéger la société de la dangerosité d'un individu. Il a considéré que la rétention de sûreté est une mesure de sûreté distincte d'une peine.
a estimé que le placement d'une personne en milieu psychiatrique pourrait être régi par des règles différentes. A cet égard, il a cité l'exemple des Pays-Bas, où un dispositif coûteux d'une durée de trois mois a été mis en place. Il a mis en avant les limites de l'expertise psychiatrique, en en soulignant le caractère nécessairement succinct et le manque de fiabilité constaté parfois. Il a néanmoins relevé que la dualité d'experts retenue par l'Assemblée nationale constitue une avancée. Il a considéré que le suivi de la personne dangereuse placée en milieu psychiatrique doit relever de la responsabilité de l'autorité médicale, et non du juge.

a craint que la procédure de déclaration d'irresponsabilité pénale ne soulève des difficultés en cas de pluralité d'auteurs d'infraction dans une même affaire.
Il s'est interrogé sur le rôle du procureur de la République chargé de saisir la commission régionale compétente pour décider d'une mesure de rétention de sûreté, une fois rendu l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Il s'est demandé si le parquet dispose dans ce cadre d'une compétence liée ou d'une liberté d'appréciation.
a jugé cette question légitime. Il a constaté l'absence de précision du projet de loi sur les pouvoirs du parquet en matière de saisine de la commission régionale, ce qui l'a conduit à considérer que le ministère public ne disposera d'aucune marge d'appréciation, si ce n'est au regard du contrôle de la légalité de la procédure. Il a considéré, dans un souci de simplification, que la saisine de la commission régionale pourrait être confiée au greffe.
Il a indiqué que la réforme proposée ne lui semblait pas présenter de problème particulier en cas de pluralité d'auteurs d'une même infraction dans le cadre d'une même affaire.

a estimé que la possibilité de saisir la chambre de l'instruction d'une procédure de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental prévue par le projet de loi est de nature à introduire une regrettable confusion des rôles entre la chambre de l'instruction et la juridiction de jugement.
Puis la commission a entendu M. Jean-Louis Senon, professeur de médecine à l'université de Poitiers.
a précisé qu'il était professeur de psychiatrie à l'université de Poitiers, docteur en droit et enseignant en criminologie, et avait été médecin chef d'un service médico-psychologique régional (SMPR) pendant vingt ans.
Il a insisté, en premier lieu, sur l'absence de superposition entre criminalité et maladie mentale, en indiquant qu'entre 2 % et 5 % des auteurs d'homicide et entre 1 % et 4 % des auteurs d'actes de violence sexuelle seulement étaient atteints de troubles mentaux. Il a ajouté que si les malades mentaux, précarisés et manipulables, présentent entre quatre et sept fois plus de risque de commettre un crime ou un délit que le reste de la population, ils sont également dix-sept fois plus souvent victimes d'une telle infraction.
Il a exposé la différence entre la maladie mentale et le trouble de la personnalité ou du comportement, en faisant valoir que les symptômes de la maladie mentale et les traitements idoines faisaient l'objet d'un consensus au niveau international alors que les réponses aux troubles de la personnalité et du comportement différaient selon les pays et revêtaient encore un caractère expérimental.
a observé que les personnes atteintes d'une maladie mentale, les schizophrènes par exemple, pouvaient certes commettre des actes criminels, mais que ces actes présentaient des particularités : il s'agit souvent de violences intra-familiales et leurs auteurs peuvent être soignés, dans un cadre hospitalier, au moyen de traitements neuroleptiques.
Il a ajouté que les violences commises par les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité s'expliquaient souvent par l'histoire de leurs auteurs, marquée par des carences éducatives et un manque de repères, mais ne pouvaient faire l'objet d'une réponse thérapeutique.
a souligné, en deuxième lieu, combien il est difficile de définir la dangerosité d'un individu et d'évaluer le risque du passage à l'acte criminel, les critères à prendre en compte faisant l'objet de débats, qu'il s'agisse des antécédents de la personne, de ses carences ou de son impulsivité.
Il a jugé possible de distinguer la dangerosité psychiatrique, qui peut être évaluée, de la dangerosité criminologique, dont l'évaluation s'avère plus délicate et requiert l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire composée de juristes, de psychologues, de psychiatres et de sociologues. A cet égard, il a souhaité que des psychiatres, des psychologues et des sociologues se forment à la criminologie.
En troisième lieu, M. Jean-Louis Senon a jugé inconcevable d'organiser la rétention des individus considérés comme particulièrement dangereux dans le cadre de la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation, dès lors qu'ils ne souffriraient pas d'une maladie reconnue et pouvant faire l'objet d'un traitement thérapeutique. L'hospitalisation d'office de ces personnes est inenvisageable sur le plan éthique et inopérante sur le plan psychiatrique, a-t-il déclaré.
Il a précisé que trois ou quatre équipes spécialisées seulement, en France, étaient en mesure de « mobiliser » des auteurs de crime atteints de troubles de la personnalité ou du comportement et de parvenir à leur faire prendre conscience de la nécessité d'entendre et de respecter autrui.
Observant qu'en matière de psychiatrie le modèle ambulatoire avait supplanté le modèle asilaire, il a jugé nécessaire de maintenir dans chaque département une unité formée à la prise en charge des patients susceptibles de se montrer violents.
Il a ajouté que les psychiatres en général, et les psychiatres intervenant dans le secteur public en particulier, étaient débordés en raison d'une insuffisance d'effectifs et d'un nombre croissant de demandes de prise en charge. Il a précisé que 830 postes de praticiens hospitaliers étaient actuellement vacants, de même que la moitié des postes de psychiatres en SMPR, et que les vacances de postes concernaient également les infirmiers.
Il a constaté que les psychiatres, contraints d'effectuer des choix, avaient progressivement abandonné la prise en charge des détenus. Aussi a-t-il jugé nécessaire qu'ils se recentrent sur les malades mentaux pouvant avoir des comportements violents.
En conclusion, M. Jean-Louis Senon a une nouvelle fois insisté sur l'absence de superposition entre maladie mentale et dangerosité.

a rappelé que la commission d'enquête sénatoriale sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France avait constaté que les prisons étaient devenues des asiles, tant était forte la proportion des détenus atteints de troubles mentaux.

a rappelé que le projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental se préoccupait avant tout des auteurs d'infractions présentant une dangerosité criminologique. Il a toutefois observé, dans le cadre de ses visites d'établissements pénitentiaires, que maints détenus souffraient de troubles psychiatriques.
a confirmé que 40 % des détenus étaient déprimés, 55 % anxieux, et environ 10 % psychotiques, 7 % étant schizophrènes. Il a observé que la proportion des détenus souffrant de troubles psychotiques était plus faible dans les maisons d'arrêt et plus importante dans les centres de détention.

s'est interrogé sur la pertinence du maintien de la distinction entre l'altération et l'abolition du discernement, observant qu'une telle distinction avait été abandonnée en Belgique.
Il s'est également demandé, compte tenu du nombre considérable des vacances de postes dans le secteur psychiatrique public, s'il ne serait pas opportun de faire appel, au moins temporairement, aux psychiatres du secteur libéral pour prendre en charge les détenus atteints de troubles mentaux, sur le modèle de la Belgique et des Pays-Bas.
a considéré que les règles élaborées pour assurer la défense sociale en Belgique, très attentatoires aux libertés individuelles, ne devaient pas servir d'exemple.
Il a jugé peu probable et s'est déclaré réservé sur la prise en charge des détenus atteints de troubles mentaux par des psychiatres libéraux, en mettant en exergue l'écart des rémunérations entre le secteur public et le secteur libéral, qui rend ce dernier peu attractif et la méconnaissance de l'univers carcéral par les psychiatres libéraux.
Il a indiqué que l'augmentation du numerus clausus des étudiants en psychiatrie, en 2008, devrait permettre d'augmenter le nombre des psychiatres du secteur public, les étudiants manifestant en effet un intérêt pour la médecine en milieu pénitentiaire.

En réponse à M. Jean-Jacques Hyest, président, qui l'interrogeait sur les progrès de la science en matière de troubles de la personnalité évoqués par M. Jean-Pierre Escarfail, président de l'association pour la protection contre les agressions sexuelles, M. Jean-Louis Senon a indiqué que les recherches s'orientaient dans deux directions, la psychanalyse des comportements violents d'une part, les neurosciences ou sciences cognitives comportementales d'autre part, en soulignant que les travaux conduits jusqu'à présent étaient restés au stade de l'expérimentation et soulevaient plus de questions qu'ils n'apportaient de réponses.
Après avoir relevé que le nombre des auteurs de crimes odieux n'était ni plus ni moins important que par le passé, il a rappelé que le bilan des tentatives de psychiatrisation des criminels menées depuis les années 1960 aux Etats Unis était pour le moins contrasté. Aussi a-t-il invité à la prudence et souligné la nécessité de recourir à l'expérimentation.

a souhaité savoir s'il était possible de déterminer la dangerosité criminologique de certains individus et s'il existait des traitements pour la réduire.
Observant que les résultats du programme de prise en charge des auteurs de violences sexuelles mis en place au Canada n'étaient pour le moment guère probants, M. Jean-Louis Senon a indiqué qu'il convenait de faire preuve de modestie et d'évaluer la dangerosité des détenus dans la durée plutôt que dans les trois mois précédant leur libération.
Soulignant que les individus présentant une dangerosité criminologique, dont les cas ne sont d'ailleurs pas nombreux, ne posent pas de difficultés pendant leur détention car la représentation de la loi y est forte, il a jugé nécessaire de les évaluer hors du milieu carcéral, dans le cadre d'une libération conditionnelle avec obligation de soins.

l'ayant interrogé sur ce point, M. Jean-Louis Senon a confirmé qu'il convenait de prendre le risque d'accorder des permissions de sortie, puis une libération conditionnelle afin de permettre aux détenus présentant une dangerosité criminologique de se réadapter progressivement à la vie en société.
Il a en revanche jugé nécessaire d'appliquer plus systématiquement l'article D. 398 du code de procédure pénale et de prévoir l'hospitalisation d'office, dans l'une des cinq unités pour malades difficiles (UMD), des malades mentaux. Il a estimé que ces structures étaient parfaitement appropriées et que le nombre des places disponibles devait être augmenté. Il a également affirmé l'utilité des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) pour la prise en charge des malades atteints de troubles temporaires.

a jugé nécessaire de prendre en charge les individus jugés dangereux dès leur incarcération, après une expertise approfondie, plutôt que d'attendre les dernières semaines précédant leur libération.
a indiqué que, faute de moyens suffisants, les SMPR avaient jusqu'à présent concentré leur attention sur les détenus atteints d'une maladie mentale causant des troubles au sein de leur établissement pénitentiaire ou présentant un risque de suicide.
Il a jugé difficile d'assurer une prise en charge au long cours des détenus présentant des troubles de la personnalité ou du comportement, en indiquant que les soins ne pouvaient pas être dispensés en continu pendant quinze ans, mais par séquences. A cet égard, il a observé que les peines d'emprisonnement infligées en France étaient d'une durée bien plus longue que dans les autres pays occidentaux, donnant en exemple deux personnes coupables d'inceste condamnées respectivement à quatre ans de réclusion en Allemagne et à douze ans de réclusion en France.
Il a insisté sur la nécessité d'une prise en charge selon trois séquences : lors de la détention provisoire, lors du transfèrement du détenu dans un centre de détention, puis quatre ou cinq ans avant sa sortie de prison, dans le cadre d'une libération conditionnelle. Il a souligné que les sorties dites « sèches » exposaient les détenus à un plus grand risque de réitération ou de récidive, en raison de phénomènes de décompensation.
Enfin la commission a entendu M. Gilles Lebreton, professeur de droit public à l'université du Havre.
Présidence de M. Patrice Gélard, vice-président
M. Gilles Lebreton s'est tout d'abord interrogé sur la conformité du projet de loi n°442 (A.N. XIIIème lég.) relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pour cause de trouble mental.
En premier lieu, il a examiné la conformité du texte à l'article 5 de la Convention relatif au droit de toute personne à la liberté, considérant, d'une part, que la rétention de sûreté prévue par le projet de loi constitue bien une privation de la liberté d'aller et venir, et non une simple restriction, régie, elle, par le protocole n° 4 à la CEDH, d'autre part, que la Cour européenne des droits de l'homme avait jugé applicable cet article 5 à la « période préventive » que comportent certaines peines dans le système pénal britannique, proche de la rétention de sûreté. Il a déclaré que le projet de loi remplissait les six critères fixés par la jurisprudence de la Cour européenne pour autoriser une privation de liberté, à savoir l'existence :
1. d'une base légale,
2. de raisons plausibles de nature à justifier une privation de liberté, critère satisfait à ses yeux par l'exigence de « particulière dangerosité » des personnes retenue par le projet de loi,
3. d'un lien de causalité suffisant entre la condamnation initiale et le maintien en détention, critère satisfait par le texte au travers de l'obligation pour la juridiction de jugement de prévoir, lors de la condamnation, un réexamen de la situation de la personne, susceptible de conduire à une rétention de sûreté si celle-ci est jugée, en fin de peine, comme particulièrement dangereuse,
4. d'un régime de détention adapté à son motif, impératif également satisfait pour lui par le texte prévoyant des « centres socio-médico-judiciaires »,
5. d'une peine strictement nécessaire et proportionnelle aux objectifs poursuivis, ce qu'il a considéré comme prévu par le projet de loi,
6. enfin d'un contrôle exercé par le juge à intervalles raisonnables et d'une possibilité de recours tous les ans ou les deux ans, exigence remplie par le texte compte tenu de l'obligation de réexamen annuel de la situation de la personne.
En second lieu, M. Gilles Lebreton s'est interrogé sur la conformité du projet de loi à l'article 7 de la CEDH relatif à la non-rétroactivité des peines. Il a considéré que la rétention de sûreté constituait bien une peine au sens de cet article, rappelant que la Cour européenne des droits de l'homme apprécie cette notion, non au regard de la qualification retenue en droit national, mais en fonction des conséquences de la mesure prononcée au regard de la privation de liberté. Il s'est dès lors inquiété des risques de contrariété du projet de loi avec l'article 7 de la CEDH.
En troisième lieu, examinant la conformité du projet de loi à l'article 6-2 de la CEDH relatif à la présomption d'innocence, M. Gilles Lebreton a déclaré que la Cour interprétait avec souplesse ce principe, acceptant des régimes de présomption de responsabilité, dès lors qu'ils sont enserrés dans des « limites raisonnables qui prennent en compte la gravité de l'enjeu et les droits de la défense ». En conséquence, il n'a pas jugé contraires à l'article 6-2 de la CEDH les dispositions du projet de loi.
Abordant la question de la constitutionnalité du texte, il l'a tout d'abord appréhendée au regard de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen relatif à la proportionnalité et à la nécessité des peines. Il a estimé que la rétention de sûreté constituait bien une peine au sens de cet article, rappelant la conception extensive de cette notion adoptée dans certaines décisions par le Conseil constitutionnel, qui a retenu cette qualification même pour des mesures individuelles défavorables, telles que des retraits de cartes de séjour, dès lors qu'elles revêtent un caractère punitif, fût-il déguisé. En conséquence, après avoir rappelé que l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à appliquer la rétention de sûreté à des personnes condamnées pour un crime aggravé commis sur toute personne, et non seulement, comme le prévoyait le texte initial, pour un crime sur un mineur de quinze ans, il a jugé excessive cette extension et mis en avant un risque d'inconstitutionnalité au regard du principe de proportionnalité des peines.
Il a étudié l'hypothèse selon laquelle la rétention de sûreté ne serait pas analysée comme une peine, soulignant que le Conseil constitutionnel avait considéré, dans une décision rendue le 8 décembre 2005, que le port du bracelet électronique ne constituait « ni une peine, ni une sanction », dès lors qu'il s'agissait d'une simple restriction de liberté et d'un aménagement de peine, et n'encourait ainsi aucune censure du chef de non-respect du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, inscrit également à l'article 8 de la Déclaration de 1789. En revanche, le Conseil constitutionnel a estimé dans cette même décision que, bien que dépourvu de caractère punitif, le placement sous surveillance électronique mobile ordonné au titre de la surveillance judiciaire devait respecter le principe, résultant des articles 4 et 9 de la Déclaration de 1789, selon lequel « la liberté de la personne ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire ».
En conséquence, M. Gilles Lebreton a souligné que, quelle que soit la qualification juridique retenue, la rétention de sûreté devait respecter le principe de proportionnalité.
a ensuite analysé la conformité du projet de loi aux articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789, sur les fondements desquels le Conseil constitutionnel a constitutionnalisé le principe, posé à l'article L. 121-3 du code pénal, selon lequel « il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». Il a jugé délicat de considérer que la rétention de sûreté sanctionnait l'intention de commettre à nouveau un crime, mais estimé que le risque d'inconstitutionnalité était écarté du fait que la rédaction du projet de loi subordonnait la rétention de sûreté à la circonstance que la juridiction ait expressément prévu, dans sa décision, le réexamen ultérieur de la situation de la personne condamnée.

a observé que le législateur pouvait prévoir de sanctionner des délits non intentionnels, comme dans la loi du 10 juillet 2000 dont il est à l'origine.
S'interrogeant sur la conformité du texte à l'article 66 de la Constitution, M. Gilles Lebreton a souligné que la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel admettait des atteintes à la liberté individuelle en cas de risques importants de trouble à l'ordre public, cette exigence étant satisfaite par la condition, posée par le projet de loi, de « particulière dangerosité » des personnes.

s'est interrogé sur la portée du lien de causalité entre la condamnation initiale et le maintien en détention, au regard de l'article 5 de la CEDH. Il a rappelé par ailleurs que la rétention de sûreté pouvait s'appliquer aux personnes actuellement placées sous surveillance judiciaire en cas de manquement grave à la surveillance judiciaire ; il s'est demandé, dans cette hypothèse, si l'objection liée au principe de non-rétroactivité devait être retenue dès lors qu'un tel manquement pouvait être considéré comme une nouvelle infraction punissable de la rétention de sûreté.
a expliqué que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le maintien en détention devait reposer sur un motif de même nature que celui de la condamnation initiale. Il s'est demandé si l'application de la rétention de sûreté en cas de manquement aux obligations de la surveillance judiciaire ne revenait pas à contourner le principe de non-rétroactivité.

a estimé que la rétention de sûreté s'apparentait moins à un prolongement de peine qu'à une hospitalisation d'office, justifiée par la dangerosité de la personne et la nécessité de protéger la société. Il a considéré que le lien de causalité devait s'apprécier, non à la date de la condamnation, mais à celle où la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté constate que la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui, et qu'en conséquence, le principe de non-rétroactivité n'interdisait pas une application de la rétention de sûreté à des personnes condamnées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.
M. Gilles Lebreton a redouté que cette analyse, dissociant la rétention de sûreté de la condamnation initiale, ne tombe, dès lors, sous le coup de la règle « non bis in idem », la personne étant sanctionnée une seconde fois pour des mêmes faits.

a jugé indispensable de clarifier la nature juridique de la rétention de sûreté, soutenant qu'il serait plus cohérent, soit de considérer qu'elle constitue une mesure de police destinée à assurer la protection de la société, soit de prévoir des peines à perpétuité ou à durée indéterminée, susceptibles d'être aménagées en fonction de la dangerosité des personnes.