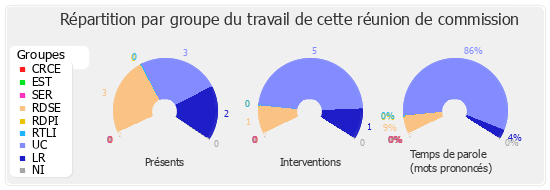Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
Réunion du 17 février 2010 : 1ère réunion
Sommaire
- Audition de m. jean-michel casa directeur de l'union européenne au ministère des affaires étrangères et européennes (voir le dossier)
- Accord entre la france et le royaume d'arabie saoudite relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure
- Accord entre la france et le venezuela sur l'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles
- Convention entre la france et la république dominicaine sur le transfèrement des personnes condamnées
- Enjeux géopolitiques de l'eau
- Audition de m. william c. ramsay directeur du programme energie de l'ifri (voir le dossier)
La réunion
Lors d'une première séance tenue dans la matinée, la commission a procédé à l'audition de M. Jean-Michel Casa, directeur de l'Union européenne au ministère des affaires étrangères et européennes, sur la politique étrangère de l'Union européenne au lendemain du traité de Lisbonne.

Après avoir rappelé les principales étapes de la carrière diplomatique de M. Jean-Michel Casa, M. Josselin de Rohan, président, s'est interrogé sur les nouveaux instruments de politique étrangère de l'Union européenne après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Il a notamment souhaité obtenir un éclairage particulier sur la mise en place du futur service européen pour l'action extérieure et sur la représentation de l'Union européenne, désormais dotée de la personnalité juridique, auprès des Etats tiers et des organisations internationales, notamment aux Nations unies.
a rappelé que la création du service européen pour l'action extérieure (SEAE), prévue par l'article 27, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, constituait une innovation majeure du traité de Lisbonne, à laquelle la France, qui avait joué un rôle important dans sa conception, était tout particulièrement attachée. Ce service européen pour l'action extérieure, parfois surnommé « service diplomatique commun », représente, en effet, un instrument essentiel pour renforcer la cohérence entre les relations extérieures de l'Union, les aspects externes des politiques mises en oeuvre par l'Union européenne et la politique étrangère conduite par les Etats membres. Une autre originalité tient à la composition de ce service qui, à terme, devra rassembler à parité des fonctionnaires compétents du secrétariat général du Conseil, de la Commission européenne, et des personnels détachés des services diplomatiques nationaux.
La présidence suédoise avait élaboré un rapport préparatoire sur la mise en place de ce service européen pour l'action extérieure, qui a été approuvé par les chefs d'Etat et de Gouvernement lors du Conseil européen d'octobre 2009 et qui constitue la base de travail. Le Conseil européen a souhaité une adoption de la décision relative à l'organisation et au fonctionnement de ce service avant la fin du mois d'avril au plus tard : un important travail reste à accomplir pour tenir cette échéance. Il est vrai que l'approbation de la composition de la Commission européenne par le Parlement européen, après les nombreuses auditions des commissaires désignés, a pris un certain temps. Par ailleurs, la mise en place de ce nouveau service original est d'une certaine complexité juridique et administrative et soulève des enjeux politiques importants. Néanmoins, dès l'approbation du collège, le nouveau Haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Mme Catherine Ashton, a confirmé que la mise en place du SEAE serait sa première priorité. Elle a constitué à cet effet un groupe de haut niveau, composé des principaux responsables administratifs de la Commission européenne, du secrétariat général du Conseil et des représentants du « trio » des trois présidences tournantes du Conseil (Espagne, Belgique, Hongrie).
A partir des travaux de ce groupe de travail, Mme Catherine Ashton devrait présenter un projet de décision relative à ce service dans les prochaines semaines. Ce projet sera soumis aux représentants permanents des Etats membres au sein du COREPER, puis au Conseil des ministres. Elle a également fait savoir qu'elle souhaitait débattre de la création de ce service avec le Parlement européen dès le mois de mars.
Si, en vertu du traité, la création de ce service nécessite une décision du Conseil prise à l'unanimité, sur proposition du Haut représentant, après approbation de la Commission européenne et après consultation du Parlement européen, il convient toutefois d'observer que les autres actes juridiques liés à la mise en place de ce service relèvent de la procédure législative ordinaire, c'est-à-dire de la procédure de co-décision, qui place le Parlement européen sur un pied d'égalité avec le Conseil. Il s'agit, notamment, des actes relatifs à la modification du statut des fonctionnaires européens, à la modification du règlement financier et à la mise en place d'un budget propre à ce service, qui feront vraisemblablement partie d'un paquet global avec la décision relative à la création du service européen pour l'action extérieure.
Si le Parlement européen a donc son mot à dire à propos de la création de ce service, l'idée selon laquelle le futur service européen pour l'action extérieure devrait être intégré au sein de la Commission européenne, qui avait été notamment évoquée dans le rapport d'Elmar Brok, s'est toutefois heurtée à l'opposition unanime des Etats membres, qui ont insisté sur le caractère sui generis de ce service, distinct et équidistant de la Commission européenne et du secrétariat général du Conseil. Comme le souligne ainsi le rapport adopté par le Conseil européen, le SEAE devra disposer d'une autonomie en termes de budget administratif et de gestion du personnel.
a ensuite présenté la position française concernant le périmètre, la structure et la composition de ce service.
Le service européen pour l'action extérieure devrait être un service sui generis placé sous l'autorité du Haut représentant mais qui devrait également pouvoir assister le président du Conseil européen, ainsi que le président et les membres de la Commission européenne, dans l'exercice de leurs fonctions respectives, mais aussi et surtout coopérer étroitement avec les Etats membres. La France souhaite que le Haut représentant soit assisté par un secrétaire général fort, à l'instar du secrétaire général du Conseil ou de la Commission. Il aura pour mission de faire fonctionner le service européen pour l'action extérieure au quotidien, notamment pendant les nombreux déplacements du Haut représentant à l'étranger.
Le périmètre du futur service européen pour l'action extérieure devrait être le plus large possible afin de permettre au Haut représentant d'exercer pleinement son mandat. En vertu du traité, le Haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, en sa qualité de vice-président de la Commission, a en effet la responsabilité de la coordination des aspects touchant aux relations extérieures au sein de la Commission européenne. Cela s'applique en particulier à l'aide au développement et à la politique de voisinage, dans une certaine mesure à la politique commerciale, mais aussi à la réponse de l'Union européenne aux crises, comme celle qu'a connue récemment Haïti, qui fait l'objet du nouveau portefeuille confié par le président de la Commission à la commission européenne bulgare. La crise haïtienne a en effet montré que si l'Union européenne a été, de loin, le premier contributeur en termes d'aide matérielle et financière, son action a souffert d'un manque de visibilité et de coordination.
Cette conception large du service suppose donc qu'il comprenne des directions géographiques, couvrant toutes les régions et tous les pays, y compris des pays bénéficiaires de l'aide au développement ou faisant l'objet de négociations d'adhésion, mais aussi des directions thématiques, comme par exemple une direction chargée de la réponse aux crises ou une direction chargée des relations avec les Nations unies.
Il est également très important que le service européen pour l'action extérieure comprenne une direction chargée de superviser la programmation stratégique des différents instruments financiers, comme l'instrument de pré-adhésion, l'instrument européen de voisinage et de partenariat, l'instrument de coopération et de développement ou le fonds européen de développement (FED), afin qu'il puisse jouer le rôle d'un chef de file dans l'élaboration des grandes orientations de ces fonds, même si leur gestion devrait continuer de relever de la Commission européenne.
Conformément au rapport adopté par le Conseil européen d'octobre 2009, les structures de la politique de sécurité et de défense commune et de gestion de crises, comme l'Etat-major de l'Union européenne, la direction « gestion des crises et planification », la « capacité civile de planification et de conduite » ou encore le « centre de situation » devraient faire partie du SEAE, tout en relevant directement de l'autorité du Haut représentant afin de préserver l'autonomie de leurs chaînes de commandement.
Le service devrait aussi comprendre un nombre limité de fonctions de soutien, en particulier en matière de sécurité, d'informatique ou de gestion des ressources humaines, tout en s'appuyant sur d'autres services, comme ceux de la Commission européenne ou du secrétariat général du Conseil, pour les services juridiques, de protocole ou de traduction par exemple, par souci d'efficacité et pour limiter les doubles emplois et donc les coûts. Enfin, ce service devrait bénéficier d'une autonomie budgétaire et administrative complète.
S'agissant de ses effectifs, le service européen pour l'action extérieure devrait comprendre entre 2000 et 3000 agents, selon que l'on y intègre ou non les agents des délégations de l'Union européenne, agents provenant à la fois des services compétents du secrétariat général du Conseil, de la Commission européenne ainsi que des Etats membres. A ce stade, seuls les chefs des délégations de l'Union européenne et les agents chargés de l'analyse politique devraient faire partie du service. Certains agents devraient en revanche continuer de relever de la Commission européenne, par exemple lorsqu'ils sont chargés de la politique commerciale. Si, dans un premier temps, les fonctionnaires issus de la Commission européenne et du secrétariat général du Conseil devaient être les plus disponibles, le personnel provenant des Etats membres devrait, lorsque le service aura atteint sa pleine capacité, représenter plus du tiers des effectifs, y compris au sein du personnel diplomatique des délégations de l'Union européenne.
Le Parlement européen a réclamé récemment de pouvoir être associé à la nomination des chefs de délégation de l'Union européenne ou des représentants spéciaux, en procédant à leur audition préalablement à leur désignation, sur le modèle du Sénat américain, mais cette demande a été rejetée par les Etats membres et par le Haut représentant, qui devrait détenir seul le pouvoir de nomination. Ainsi, trente deux postes de chefs de délégation devraient être proposés l'été prochain (dans des pays comme la Chine, le Brésil, l'Afghanistan ou Haïti), dont la moitié à pourvoir par des diplomates des Etats membres. Le ministère des affaires étrangères et européennes a d'ailleurs entrepris de constituer un « vivier » des meilleurs diplomates français, afin que notre pays soit bien représenté au sein du futur service européen pour l'action extérieure et parmi ces chefs de délégations.
Si le rapport adopté par le Conseil européen prévoit que le service européen pour l'action extérieure devra entretenir des relations avec le Parlement européen, il est vrai que la question se posera à l'avenir du rôle des parlements nationaux, par exemple lors du lancement d'opérations militaires ou de gestion de crises de l'Union européenne.
a évoqué, en conclusion, la question de la représentation de l'Union européenne auprès des pays tiers et des organisations internationales.
En ce qui concerne la représentation de l'Union européenne dans les pays tiers, dès l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et conformément à ses dispositions, les anciennes délégations de la Commission européenne sont devenues des délégations de l'Union européenne, ayant vocation à représenter non seulement la Commission européenne mais l'ensemble de l'Union, sous l'autorité du Haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.
Toutefois, en vertu d'un accord avec la présidence espagnole du Conseil, seules 53 délégations se sont vu, à ce stade, reconnaître dans un premier temps un rôle de coordination et de représentation en reprenant à compter du 1er janvier les fonctions exercées jusque là par les ambassades du pays exerçant la présidence tournante du Conseil.
En effet, la présidence espagnole a souhaité, dans cette phase transitoire, conserver un rôle de représentation à certaines de ses ambassades situées dans des pays avec lesquels sont prévus prochainement des sommets de l'Union européenne, comme les pays d'Amérique latine ou la Russie par exemple. A terme, toutefois, les délégations de l'Union européenne exerceront les fonctions de représentation de l'Union dans l'ensemble des pays tiers, y compris les fonctions exercées jusqu'à présent par les ambassades bilatérales du pays exerçant la présidence tournante du Conseil. Il conviendra également de trouver des solutions ad hoc pour les pays tiers où la Commission européenne ne disposait pas de représentations, comme la Mongolie par exemple. Il sera, par ailleurs, nécessaire de s'interroger sur l'avenir des représentants spéciaux désignés sous l'empire du traité précédent. Certains de ces postes de Haut représentant devraient être fusionnés avec ceux de chefs de délégation de l'Union européenne, mais d'autres pourraient conserver leur mandat, comme par exemple le représentant spécial de l'Union européenne au Proche-Orient.
Enfin, la question complexe de la représentation de l'Union européenne auprès des organisations internationales nécessite un examen au cas par cas. Le remplacement par l'Union européenne, désormais dotée de la personnalité juridique, de la Communauté européenne, qui ne disposait souvent que d'un statut de simple observateur, devrait s'accompagner d'un renforcement de son statut auprès de certaines organisations internationales. Ce pourrait être notamment le cas aux Nations unies, où il existe deux représentations, l'une du secrétariat général du Conseil, l'autre de la Commission. La Communauté européenne ne disposait que d'un statut d'observateur : on pourrait envisager de conférer à l'Union européenne un statut comparable à celui d'un « quasi-Etat », pour s'exprimer au nom de l'Union en tant que telle.

a souhaité avoir des précisions sur les dispositions qui seront prévues en matière de statut des agents du futur service européen pour l'action extérieure, notamment leur traitement et leur carrière et leur mode de nomination. Il s'est également interrogé sur la coordination entre ce service et les diplomaties nationales et le risque de création d'une vingt-huitième diplomatie.
a indiqué que, à ce stade, une révision du statut des fonctionnaires européens était envisagée afin de garantir au personnel détaché des Etats membres le statut d'agent temporaire, qui leur garantirait les mêmes droits et obligations qu'aux fonctionnaires issus de la Commission et du Conseil, et notamment une égalité de traitement. L'objectif est en effet d'attirer des personnes dotées des plus hautes qualités. En revanche, se posera la question des effets de ce détachement sur la carrière des fonctionnaires concernés, mais ce sujet relève de la compétence de chaque Etat.
Le Haut représentant sera l'autorité investie du pouvoir de nomination, mais les recrutements devraient s'effectuer sur la base d'une procédure associant les Etats membres.
Chaque Etat membre devra veiller à être bien représenté au sein du service européen pour l'action extérieure mais aussi dans les délégations de l'Union européenne. Dans l'attente de la décision établissant le service, la procédure de désignation des chefs de délégation des 32 postes qui seront ouverts cet été devrait être une procédure spécifique, inspirée de la procédure de recrutement de la Commission, mais avec la participation des Etats membres.
Afin d'éviter le risque d'une multiplication des diplomaties, il est primordial que le service européen pour l'action extérieure entretienne des relations étroites tant avec la Commission européenne qu'avec les Etats membres, et que le Haut représentant pour les affaires étrangères et européennes joue pleinement son rôle, à la fois de vice président de la Commission européenne chargé de la coordination des aspects extérieurs mais aussi pleinement de président du Conseil Affaires étrangères.
Par ailleurs, c'est aussi pour favoriser l'émergence d'une culture diplomatique commune que les diplomates issus des Etats membres devront être bien représentés au sein de ce service, dans une proportion d'au moins un tiers.
Si la présidence espagnole du Conseil continue actuellement à exercer un rôle en matière de représentation extérieure, cette situation est transitoire et, à l'avenir, la présidence tournante n'exercera en principe plus de compétences dans ce domaine lors des Sommets bilatéraux. Le Haut représentant a, en effet, pour vocation de conduire la politique étrangère de l'Union, même si le traité prévoit que le président du Conseil européen représente, à son niveau, l'Union européenne et que le président de la Commission européenne a également un rôle à jouer dans ce domaine.

a indiqué que, depuis l'adoption du traité de Lisbonne, l'Union donnait l'impression d'avoir « disparu des radars », comme l'a montré la réponse à la situation en Haïti. Il a souhaité avoir des précisions concernant la définition des orientations, la prise de décision, la gestion et le contrôle de l'aide au développement, en estimant que l'essentiel était de parvenir à un système garantissant l'efficacité des fonds européens.

s'est interrogé sur l'état d'avancement des négociations sur le nouvel accord de partenariat entre l'Union européenne et la Russie, notamment en matière énergétique.

a regretté l'absence de l'Union européenne sur le dossier du Proche-Orient, en raison des divisions entre les Etats-membres, et s'est demandé si la mise en place du service européen pour l'action extérieure permettrait réellement de surmonter ces divisions et d'aboutir à ce que l'Union européenne parle d'une seule voix.
Elle a également estimé que les parlements nationaux avaient un rôle essentiel à jouer en matière de politique étrangère et de défense, qui demeure une matière intergouvernementale. Elle a rappelé le rôle important joué par l'assemblée parlementaire de l'Union de l'Europe occidentale, seule enceinte permettant aux parlements nationaux de débattre ensemble des questions de sécurité et de défense, en s'interrogeant sur son avenir.

s'est demandé si l'on ne mettait pas trop d'espoir dans la mise en place du service européen pour l'action extérieure pour la détermination des positions communes en matière de politique étrangère.
Elle a également fait part de ses interrogations au sujet de l'aide au développement en estimant que l'essentiel à ses yeux était de garantir la cohérence, la visibilité et l'efficacité de cette politique compte tenu de son importance.
Enfin, elle s'est interrogée au sujet de la place et de l'usage du français au sein du futur service européen pour l'action extérieure alors que la nouvelle haute représentante ne semble pas totalement maîtriser le français.

s'est demandé si l'idée de conférer un statut renforcé, équivalent à celui d'un Etat, à l'Union européenne au sein des Nations unies, alors que l'Union européenne n'est pas un Etat, ne pourrait pas avoir d'éventuelles implications négatives, notamment sur le siège permanent de la France au sein du Conseil de sécurité, que certains pays pourraient remettre en cause en s'appuyant sur ce motif.
Ayant fait observer que Mme Catherine Ashton était sans cesse sollicitée par le Parlement européen, il a émis le souhait que la commission des affaires étrangères puisse l'entendre prochainement.
Enfin, il a fait part de ses interrogations au sujet de l'attraction du régime de rémunérations et des primes accordées aux agents du service européen pour l'action extérieure, en émettant la crainte que notre diplomatie se voie amputée de ses meilleurs éléments.
En réponse, M. Jean-Michel Casa, directeur de l'Union européenne au ministère des affaires étrangères et européennes, a apporté les précisions suivantes :
- pour beaucoup d'Etats membres, y compris le Royaume-Uni ou l'Allemagne, l'aide au développement se distingue de la politique étrangère. Ils estiment ainsi que cette politique doit rester au premier chef du ressort de la Commission. La France estime cependant qu'afin d'assurer une meilleure visibilité, une plus grande cohérence et une réelle efficacité de l'aide au développement, il faut confier au Haut représentant la mission de définir les grandes orientations stratégiques, la Commission continuant d'assurer la gestion des instruments de coopération ;
- les relations avec la Russie constituent un bon exemple de l'insuffisante coordination des diplomaties nationales et des différents aspects de la politique extérieure de l'Union, à l'image de l'énergie par exemple, et l'objectif de la création du service européen pour l'action extérieure vise précisément à rapprocher en amont les points de vue entre les Etats membres ;
- précisément, les négociations sur le nouvel accord de partenariat entre l'Union européenne et la Russie n'ont que peu progressé jusqu'à présent, car elles achoppent sur le volet commercial, étant donné que la question de l'adhésion de la Russie à l'Organisation mondiale du commerce est toujours en suspens ; alors que la principale attente des Européens tient au volet énergétique, la partie russe demande, pour sa part, la levée de l'obligation de visas. Par contre, l'attitude de la Russie sur la question iranienne a évolué dans le sens d'une meilleure coopération et de l'adoption de sanctions plus fortes ;
- au Proche-Orient, il est vrai que l'Union européenne, qui représente le premier contributeur à l'Autorité palestinienne, ne joue pas un rôle à la hauteur de celui des Etats-Unis, qui demeurent le principal acteur du processus de paix, même si les positions des pays européens se sont beaucoup rapprochées ces dernières années, comme le montrent par exemple les conclusions adoptées par le Conseil en décembre 2009. L'Union européenne pourrait pourtant jouer un rôle important dans le cadre d'un règlement global du conflit et dans sa mise en oeuvre, par exemple en apportant des garanties européennes en matière de sécurité, avec l'envoi d'une mission de sécurité sur le terrain, un rôle pilote sur la question des réfugiés ou sur le contrôle des frontières, une aide à la construction d'un état palestinien. L'action du SEAE et l'action du Haut représentant devraient donner plus de visibilité à l'Europe ;
- l'avenir de l'assemblée parlementaire de l'Union de l'Europe occidentale est devenu incertain depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, même s'il faut reconnaître que c'est la seule assemblée interparlementaire qui joue un rôle en matière de sécurité et de défense. Le Parlement européen a vu ses prérogatives renforcées avec le traité de Lisbonne. Ces pouvoirs pourraient se renforcer au fur et à mesure que la politique de sécurité et de défense va s'européaniser. Mais les parlements nationaux ont également un rôle à jouer ; étant donné que le traité de Lisbonne est muet sur ce sujet, à la différence de ce qui existe par exemple pour le contrôle de la subsidiarité, il faudra peut-être inventer ; certains ont ainsi évoqué une Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires (COSAC) en matière de défense ;
- la création du service européen pour l'action extérieure ne suffira évidemment pas à elle seule à aboutir à une diplomatie commune ; les décisions continueront en effet de relever des ministres des affaires étrangères des Etats membres, réunis dans le Conseil des Affaires étrangères, sous la présidence du Haut représentant ; la mise en place de ce service devrait toutefois favoriser l'émergence progressive d'une culture diplomatique commune en permettant un rapprochement des points de vue et une plus grande unité d'action ;
- si, dans un premier temps, le service européen pour l'action extérieure devait comprendre une proportion significative de fonctionnaires issus du secrétariat général du Conseil et de la Commission européenne, progressivement, la part des diplomates issus des Etats membres est appelée à s'accroître afin d'atteindre au moins un tiers des effectifs ;
- au sein de l'assemblée générale des Nations unies, la Communauté européenne ne disposait, jusqu'à présent, que d'un statut d'observateur, soit un statut inférieur à celui, par exemple, de l'Autorité palestinienne, et il semble logique de renforcer ce statut, non pas en l'alignant sur celui des Etats, mais en allant vers un statut intermédiaire afin de permettre au représentant de l'Union d'exprimer, avec une visibilité suffisante, des positions communes, à l'image du rôle que jouait jusqu'à présent l'Etat qui exerçait la présidence tournante du Conseil ; en revanche, s'agissant du Conseil de sécurité des Nations unies, les dispositions du traité de Lisbonne sont très claires puisqu'elles prévoient explicitement que les Etats concernés conservent l'ensemble de leurs prérogatives, tout en leur permettant d'exprimer davantage les positions de l'Union européenne ;
- le régime de rémunération des fonctionnaires européens est d'ores et déjà beaucoup plus attractif que celui des diplomaties nationales et il est important que le service européen pour l'action extérieure puisse attirer des personnes de qualité ;
- si le Haut représentant est investi du pouvoir de nomination, les Etats membres devront participer au processus de recrutement mais les modalités concrètes ne sont pas encore fixées ;
- la France est soucieuse du respect du multilinguisme et de la place du français dans les institutions et organes européens. Un important programme de formation au français est mis en oeuvre à destination des nouveaux membres de la Commission, de leurs cabinets mais également des principaux titulaires de postes de direction au sein de la Commission notamment. Cette offre de formation au français a par exemple été proposée à Mme Catherine Ashton. Pour mémoire, le français est, avec l'anglais, l'une des deux langues de travail dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité.
La commission a ensuite procédé à l'examen du rapport de Mme Nathalie Goulet sur le projet de loi n° 311 (2008-2009) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure et de défense civile.

a rappelé que la France développait une coopération en matière de sécurité intérieure avec de nombreux pays, axée sur la volonté d'en harmoniser et d'en renforcer la cohérence par le recours à un modèle unifié d'accord portant sur la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée transnationale. Elle a précisé que l'accord franco-saoudien relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure et de défense civile, signé à Ryad le 24 février 2008 à l'occasion d'une visite en Arabie saoudite du ministre de l'intérieur français de l'époque, Mme Michèle Alliot-Marie, s'inscrivait dans cette démarche.
a constaté que l'Arabie saoudite se trouvait particulièrement exposée au terrorisme depuis 2001, et que le royaume avait été confronté, en 2003 et 2004, à une vague d'actions terroristes particulièrement violentes, revendiquées par Al-Qaïda, et marquée par des attaques à la voiture piégée et l'assassinat de ressortissants occidentaux. Cette série de violences a renforcé la volonté des autorités saoudiennes de lutter contre le terrorisme, déjà manifestée après les attentats du 11 septembre 2001. Une reprise en main vigoureuse des extrémistes religieux et une intensification des mesures sécuritaires ont ainsi été réalisées. En février 2005, le royaume a organisé une conférence internationale sur le terrorisme. La situation sécuritaire continue à faire l'objet de la plus grande attention et, s'il faut déplorer l'assassinat de quatre ressortissants français en février 2007 dont les circonstances n'ont toujours pas été élucidées, aucun attentat n'a eu lieu depuis décembre 2004 sur le territoire saoudien.
a fait cependant valoir que le terrorisme restait la menace principale qui pèse actuellement sur l'Arabie saoudite. Ainsi, l'annonce de la création, en janvier 2009, au Yémen, d'un groupe dénommé « Al-Qaïda pour la Djihad dans la péninsule arabique », constitué de Yéménites et de Saoudiens, montrait, comme les interpellations régulièrement effectuées, que la menace demeurait réelle.
La contrebande, les trafics de drogues, la petite et la moyenne criminalité sont également en expansion régulière dans le Royaume. L'insécurité routière, qui provoque plus de 8 000 morts par an pour une population d'environ 27 millions d'habitants, est aussi une des nouvelles priorités du ministère de l'intérieur, pour laquelle l'expertise française est sollicitée.
La police saoudienne compte environ 180 000 hommes et constitue l'essentiel des forces de sécurité intérieure, l'autre service intervenant étant celui des douanes. Les différents services de police sont placés sous l'autorité directe du ministre de l'intérieur et du ministre adjoint chargé des affaires de sécurité. Chaque direction comporte un service central et des services régionaux installés dans les treize provinces, placés sous la responsabilité du gouverneur de la province dont les pouvoirs sont équivalents à ceux d'un préfet français avant la décentralisation.
La coopération française en matière de sécurité intérieure est appréciée des autorités saoudiennes et deux accords de coopération policière ont déjà été conclus en novembre 1980 et mars 1987. Ils ont conduit à la création d'un bureau de liaison franco-saoudien en octobre 1982, conformément au protocole de coopération signé par les deux ministres de l'intérieur le 2 novembre 1980, qui porte exclusivement sur la formation et sur la coopération technique.
L'Arabie saoudite a toujours intégralement financé les actions de formation conduites à son profit par la France, que ce soit en bilatéral ou en partenariat avec l'Université Arabe Naïef des Sciences de Sécurité. Cette coopération a montré aux Saoudiens le savoir-faire et le professionnalisme des services spécialisés français dans des domaines multiples liés à la sécurité intérieure tels que la formation au tir, la lutte contre les stupéfiants, la police technique et scientifique, la protection des hautes personnalités, la lutte contre le terrorisme, la sûreté aéroportuaire ainsi que la gestion de l'ordre public et la sécurité routière. Ainsi, en 2008, quinze actions de formation ont été organisées pour plus de 300 stagiaires.
Les actions prioritaires devraient porter à l'avenir sur la lutte contre le terrorisme, la lutte contre les stupéfiants, les contrefaçons, la police technique et scientifique, la circulation routière et la sécurité civile.
Les autorités saoudiennes souhaitent la conclusion d'un accord de coopération en matière de sécurité intérieure et de défense civile depuis les années 1990.
Le présent texte est le résultat de négociations commencées au milieu des années 2000, sur la base de l'accord-type français simplifié. Il s'agit d'un accord entre gouvernements, alors que les textes antérieurs se présentaient sous la forme de protocoles prévoyant que la coopération se ferait par l'intermédiaire d'un bureau de liaison sans existence diplomatique. Le nouveau texte précise que cette coopération sera mise en place par des organismes officiellement désignés et les domaines d'exercice de l'assistance et de la coopération technique y sont plus clairement définis et encadrés.
Si l'accord est prioritairement axé sur la coopération technique, il pose les bases d'une coopération opérationnelle, qui doit s'effectuer dans le strict respect des législations nationales. Il est conclu pour cinq ans et renouvelable par tacite reconduction.
Outre la France, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, Taiwan, le Japon et la Russie sont les principaux fournisseurs aux services saoudiens d'assistance technique et de formation dans le domaine de la sécurité intérieure. L'Arabie saoudite, quant à elle, apporte une assistance au Yémen, à Bahreïn et au Liban. Elle finance la coopération qu'elle reçoit, comme celle qu'elle fournit.
a précisé que l'initiative de coopération d'Istanbul, lancée par l'OTAN en 2004, visait à instaurer un partenariat en matière de défense et de sécurité avec les pays du Moyen-Orient, avec une priorité à l'égard des États du golfe arabo-persique. Plusieurs d'entre eux y ont adhéré, mais Oman et l'Arabie saoudite ont différé leur décision.
Puis Mme Nathalie Goulet, rapporteur, a rappelé l'importance du contrat de surveillance des 9 000 km de frontière du royaume, le projet MIKSA (Ministry interior of Kingdom of Saudi Arabia) en négociation entre la France et l'Arabie saoudite depuis 1986, et finalement remporté en 2009 par la firme EADS. Elle s'est réjouie de cette issue positive, qui confortera la place occupée par notre pays comme fournisseur de matériels de sécurité. Elle a également évoqué les incertitudes liées à la succession du roi Abdallah, âgé de 86 ans. Celui-ci a désigné comme prince héritier son demi-frère, le prince Sultan, âgé de 81 ans et de santé fragile, puis, en deuxième rang, le prince Naïef, un autre de ses demi-frères, actuel ministre de l'intérieur, âgé de 76 ans. Mme Nathalie Goulet a souligné que la réputation de rigorisme religieux de ce dernier ne devrait pas mettre en péril les réformes en cours.
Puis, en conclusion, Mme Nathalie Goulet, rapporteur, a proposé l'adoption de l'accord, ratifié en 2009 par l'Arabie saoudite, et a suggéré que son examen en séance plénière se fasse sous forme simplifiée.

s'est enquis du financement, par l'Arabie saoudite, des divers mouvements intégristes dans le monde, dont certains sont à l'origine de plusieurs attentats terroristes.

En réponse, Mme Nathalie Goulet, rapporteur, a rappelé que les groupes qui ont perpétré les différents attentats du 11 septembre 2001 étaient en effet majoritairement composés de ressortissants saoudiens. Elle a également cité le cas de la Bosnie, où des éléments saoudiens tentent de radicaliser, y compris par le versement direct d'argent aux familles musulmanes, un islam traditionnellement tolérant. Elle a reconnu la difficulté d'entraver de telles initiatives.
Puis la commission a adopté le projet de loi et proposé que son examen en séance plénière fasse l'objet d'une procédure simplifiée.
La commission a ensuite procédé à l'examen du rapport de M. Jean-Louis Carrère sur le projet de loi n° 429 (2008-2009) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela sur l'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles.

a rappelé que les deux conventions de Vienne, conclues en 1961 et 1963, instaurent un régime protecteur spécifique aux personnels diplomatiques et consulaires qui s'étend, sur certains points, aux personnes à leur charge, comme leurs conjoints et leurs enfants. De ce fait, ces personnes ne peuvent occuper un emploi salarié dans le pays d'affectation du diplomate, à moins qu'un accord bilatéral n'aménage leur statut pour le leur permettre.
Il a précisé que ces conventions définissent les privilèges et immunités diplomatiques et consulaires, dont le but est « non pas d'avantager des individus mais d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentant des Etats ».
Ces textes interdisent aux agents diplomatiques et consulaires d'exercer, dans l'Etat d'accréditation, une activité professionnelle ou commerciale en vue d'un gain personnel. En revanche, rien n'est prévu pour les membres de leur famille. Il n'y a donc pas d'interdiction à occuper un emploi salarié pour les membres à charge d'un agent diplomatique ou consulaire, mais une difficulté liée aux immunités dont ils bénéficient peut exister dans la mesure où celles-ci peuvent être contraires aux intérêts de leur employeur ou de tiers.
Le fait que les personnes à charge bénéficient de ces privilèges et immunités requiert un texte spécifique pour lever les obstacles juridiques à leur emploi salarié. C'est le but du présent accord, conforme à l'accord-type établi par la France en ce domaine.
Après avoir présenté les principales dispositions du texte, M. Jean-Louis Carrère, rapporteur, s'est attaché à faire une rapide présentation du Venezuela. Le président Hugo Chavez cherche à bâtir, depuis son accession au pouvoir en 1999, une diplomatie Sud-Sud émancipée des Etats-Unis et de l'Europe. Caracas souhaite développer l'influence des pays du Sud et renforcer leur coopération mutuelle.
Le Venezuela a des relations denses avec la Chine. De sa coopération industrielle et militaire avec la Russie, il tente de retirer d'importants transferts de technologie. Cela n'altère pas les relations commerciales avec les Etats-Unis qui ont atteint, en 2008, le niveau record de 70 milliards de dollars, principalement dû aux exportations énergétiques.
L'autre priorité de la politique étrangère du Venezuela, l'intégration régionale, est une émanation directe de l'idée bolivarienne et de la référence à la « grande Colombie » de Simon Bolivar, qui regroupait les actuels Colombie, Equateur, Panama et Venezuela. Elle se développe dans le cadre de l'Alliance pour les peuples de notre Amérique (ALBA) qui s'appuie sur une « diplomatie énergétique », à travers l'initiative régionale Petrocaribe, consistant en la fourniture de pétrole, à des conditions préférentielles, aux Etats d'Amérique centrale et des Caraïbes.
Dans le domaine intérieur, la victoire au référendum du 15 février 2009 a permis une révision de la Constitution de 1999 ouvrant à tout titulaire d'un mandat électif le droit de se représenter sans limitation de mandats consécutifs. Ce référendum a démontré que Hugo Chavez demeurant populaire malgré sa présence au pouvoir depuis une décennie. La nouvelle constitution renforce la concentration des pouvoirs, qui s'est notamment manifestée en 2008 par la réduction, au profit de l'Etat, des pouvoirs régionaux, ce qui pénalise principalement les élus de l'opposition, dans un contexte de faible indépendance de la justice et de pressions croissantes sur tous les moyens d'information.
Avec un PIB estimé à 312 milliards de dollars, le Venezuela est la quatrième puissance économique d'Amérique latine, mais sa principale fragilité structurelle réside dans l'excessive dépendance à l'égard du secteur pétrolier, les exportations hors pétrole ne représentant qu'environ 4 % du total des exportations.
PDVSA (Petroleos de Venezuela S.A.), la compagnie pétrolière vénézuélienne, produit 93 % des recettes d'exportation du pays, contribue directement à 30 % du budget de l'Etat et, indirectement, à plus de la moitié. Elle finance l'intégralité des programmes sociaux, dont les « misiones », mises en place en matière de santé, d'éducation ou de fourniture de biens de première nécessité, qui donnent au président Chavez une puissante assise sociale.
Les relations avec la France sont bonnes : la participation du Venezuela à la recherche d'une solution à la question des otages en Colombie a suscité un dialogue soutenu. Du point de vue économique, le Venezuela est, pour la France un partenaire important, notamment en raison des investissements réalisés par nos entreprises sur place. Ce partenariat s'appuie sur l'accord d'encouragement et de protection réciproques des investissements, entré en vigueur en avril 2004. Les grands groupes français sont bien implantés dans le pays qui présente un potentiel considérable dans de nombreux secteurs : énergétique, hydroélectrique, thermique, transports. La nationalisation du secteur cimentier en 2008 a touché Lafarge, qui a toutefois obtenu une indemnisation que le groupe français a jugée satisfaisante, et la récente nationalisation de la filiale locale du groupe Carrefour ne semble pas, non plus, de nature à décourager les entreprises françaises.
En conclusion, M. Jean-Louis Carrère, rapporteur, a précisé que l'accord, déjà ratifié par le Venezuela, devrait bénéficier, en France, à douze conjoints des personnels de l'ambassade du Venezuela à Paris et à trois conjoints de la représentation permanente auprès de l'Unesco, et, au Venezuela, à vingt conjoints des trente-quatre agents expatriés relevant de notre ambassade.
Il a proposé l'adoption du texte, et suggéré que son examen en séance plénière se fasse en procédure simplifiée.

a souligné l'importance qu'a prise, progressivement, l'Iran parmi les partenaires les plus actifs du Venezuela.
Puis la commission a adopté le projet de loi et proposé que son examen en séance plénière fasse l'objet d'une procédure simplifiée.

Puis la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Rachel Mazuir sur le projet de loi n° 271 (2009-2010), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine.
a tout d'abord rappelé que deux jeunes Françaises avaient été graciées fin 2009 par le Président de la République dominicaine, Leonel Fernandez, après avoir purgé une peine pour trafic de stupéfiants, mais que l'heureux dénouement de cette affaire ne devait pas faire oublier les autres ressortissants français toujours emprisonnés en République dominicaine. Il a précisé que la visite officielle de M. Alain Joyandet, secrétaire d'Etat chargé de la coopération et de la francophonie, à Saint-Domingue, en novembre 2009, avait été l'occasion de signer entre les deux Etats une convention sur le transfèrement des personnes condamnées. Cette convention a déjà été adoptée par l'Assemblée nationale.
Puis M. Rachel Mazuir, rapporteur, a indiqué que le transfèrement consistait à permettre à une personne, condamnée dans un pays autre que le sien à une peine d'emprisonnement, de purger sa peine dans son pays d'origine. Ce sont ainsi de meilleures conditions de détention qui sont promises aux détenus concernés, dans la mesure où la convention bilatérale de transfèrement vise à rapprocher les personnes détenues de leur environnement familial, professionnel et social, ainsi qu'à mieux préparer leur réinsertion à l'issue de leur peine.
a souligné que le cadre juridique international de référence, en matière de transfèrement, était la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées, ratifiée par 47 Etats du Conseil de l'Europe, mais également par 18 Etats non européens. Il a indiqué que la France avait également conclu plusieurs conventions bilatérales de transfèrement avec d'autres Etats, et que c'est dans cette catégorie que se classait la convention avec la République dominicaine.
Les relations bilatérales en matière judiciaire entre les deux Etats reposent sur deux conventions bilatérales en matière d'entraide judiciaire pénale et d'extradition, signées respectivement en 1999 et en 2000. Cependant, aucune convention de transfèrement n'était venue compléter ce dispositif juridique.
Il a précisé que la convention franco-dominicaine relative au transfèrement, de forme classique, énonçait plusieurs principes de mise en oeuvre, parmi lesquels celui du libre consentement des personnes condamnées et celui de l'accord des deux Etats, insistant sur le fait que la décision d'accepter ou de refuser un transfèrement relevait donc in fine de la souveraineté de chaque État partie.
Au-delà de ces principes généraux, M. Rachel Mazuir, rapporteur, a énuméré les conditions préalables à une procédure de transfèrement : la décision judiciaire doit être définitive et aucune autre procédure ne doit être en cours à l'encontre du condamné dans l'Etat de condamnation, la durée de la peine restant à subir doit être d'au moins six mois, et enfin, en vertu du principe de double incrimination, les faits à l'origine de la condamnation doivent également constituer une infraction pénale dans l'État vers lequel sera opéré le transfèrement.
A l'issue du transfèrement, le condamné continue de purger la peine qui lui a été infligée dans l'État de condamnation, même si celle-ci peut être aménagée conformément au droit de l'État vers lequel il est transféré. Les deux États conservent toute latitude d'accorder, conformément à leur droit interne, des mesures d'aménagement ou de réduction de peine, mais seul l'État où la condamnation a été prononcée peut statuer sur une demande de révision.
Enfin, un autre principe important est celui de l'obligation d'information du détenu de la possibilité, pour lui, de pouvoir bénéficier de ce transfèrement.
En conclusion, M. Rachel Mazuir, rapporteur, a rappelé que cette convention bilatérale sur le transfèrement des personnes condamnées complétait utilement les conventions d'entraide judiciaire en matière pénale et en matière d'extradition déjà en vigueur entre la France et la République dominicaine, en facilitant le règlement de situations très difficiles à vivre pour les personnes concernées. Il a indiqué que cette convention venait d'être ratifiée par République dominicaine, et qu'ainsi une ratification rapide par la France permettrait aux Français détenus en République dominicaine d'être rapatriés, s'ils le souhaitent, dans le courant de l'année.
Suivant les conclusions du rapporteur, la commission a adopté le projet de loi et proposé qu'il fasse l'objet d'une procédure d'examen simplifié en séance plénière.
Lors d'une seconde séance tenue dans l'après-midi, la commission a procédé à l'audition de M. Barah Mikaïl, chercheur à l'Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS), sur les enjeux géopolitiques de l'eau.
a tout d'abord rappelé que la première prise en compte du facteur hydraulique dans les relations diplomatiques date du sommet de Mar-el-Plata, à la fin des années 1990, mais que malgré les avancées politiques et juridiques il y avait toujours un fossé entre les populations qui souffrent d'une insuffisance d'accès à l'eau potable et celles qui en disposent largement. Il a également rappelé que la première des « guerres pour l'eau » date, selon l'historien Aaron Wolf, de 2 500 avant JC en Mésopotamie, lorsque deux tribus se sont affrontées pour l'appropriation de l'eau. Il a mentionné la guerre des six jours, précédée dès 1959 de tensions importantes autour des ressources hydriques, la volonté d'Israël de détourner une partie des eaux du Jourdain, le début de la construction d'un barrage par les pays arabes afin de priver Israël de cette ressource, puis finalement le bombardement de ce barrage par l'armée de l'air israélienne.
a toutefois souhaité relativiser l'importance de la ressource hydrique et rappeler que la première pierre d'achoppement dans les conflits restait de nature territoriale, même si certaines guerres ont effectivement éclaté pour l'eau, que ce soit au niveau interétatique ou infra étatique, comme en Inde ou aux Etats-Unis où l'appropriation de l'eau a donné lieu à des tensions importantes entre Etats fédérés.
Il a ensuite évoqué l'existence d'un « droit à l'eau », qui a été débattu au Forum de l'eau qui s'est tenu à Istanbul au printemps 2009, tout en spécifiant les limites de ce droit. Ce droit n'est pas en effet synonyme de gratuité, ce qui ruinerait les efforts des opérateurs chargés de la distribution. M. Barah Mikaïl a ensuite évoqué « l'agenda 21 » rédigé lors du sommet de la terre en 1992 dont le chapitre 18 contenait des dispositions relatives à la nécessité que les citoyens de la planète payent l'eau dont ils ont besoin. Il a rappelé que même dans les bidonvilles les habitants devaient payer l'eau qu'ils consommaient. Il a souligné que le secteur privé aurait une importance de plus en plus grande dans la distribution de l'eau. Comme le montre la directive européenne de 2000, les critères de qualité entraînent une hausse des coûts que ne peut plus assumer totalement la sphère publique.
a ensuite évoqué le problème de gestion des eaux transfrontalières. Il a cité le cas du Mexique qui, au XIXè siècle, avait perdu une bonne partie de son territoire au profit des Etats-Unis d'Amérique et avait ensuite tenté de faire prévaloir un droit d'accès aux eaux du fleuve Colorado dont il avait perdu la maîtrise. Le gouvernement des Etats-Unis avait alors, à l'époque, fait prévaloir l'idée (doctrine Hartman - 1896) de la territorialité absolue d'un Etat sur les fleuves et les rivières qui traversent son territoire et donc leur droit absolu à disposer des eaux du Colorado. Mais, par la suite, les Etats-Unis ont développé une autre théorie juridique, vis-à-vis du Canada, en faisant valoir les droits de la puissance avale. Ces dispositions négociées à partir de 1909 avec le Royaume-Uni constituent un arsenal juridique qui ôte toute possibilité au Canada de bloquer l'écoulement des eaux vers l'aval. Au total, c'est une sorte de raison du plus fort qui l'emporte en matière d'appropriation de l'eau, et le fait, pour un pays, d'être situé en amont d'un autre ne lui donne des droits que pour autant qu'il dispose d'une puissance militaire supérieure à celle du pays de l'aval.
Au Moyen-Orient, il a évoqué le cas des eaux du Tigre et de l'Euphrate dont le partage soulève des problèmes depuis très longtemps. En 1960, la Turquie, réalisant le profit qu'elle pourrait tirer de l'utilisation des eaux du Tigre et de l'Euphrate, a mis en place un projet prévoyant la construction de vingt-deux barrages et bassins hydroélectriques permettant le développement du sud-est anatolien et l'irrigation massive de ses terres agricoles (1,8 million d'hectares). Les répercussions évidentes de ce projet sur la Syrie et l'Irak ont conduit la Banque mondiale à lui refuser son financement. En 1988, le protocole de Damas fut signé entre la Syrie et la Turquie, engageant ce dernier pays à écouler un volume annuel vers la Syrie. Mais il ne fut pas respecté par le gouvernement turc. S'il est évident que ce projet de développement du sud anatolien avait pour objectif politique de réduire l'influence du PKK kurde, la Syrie -soutenant ce parti-instrumentalisait à son profit la question kurde pour faire pression sur Ankara. A partir de 2002, les choses ont changé. La situation s'est améliorée avec l'arrivée de l'AKP au pouvoir et le développement des relations économiques et commerciales entre les deux pays. Les divergences sur le partage des eaux n'en demeurent pas moins, comme l'a montré l'opposition des pays au Forum d'Istanbul.
S'agissant des eaux du Jourdain et du réservoir d'eau du lac Tibériade, M. Barah Mikaïl a rappelé qu'Israël n'était pas dans une situation de « stress hydrique », mais bien de pénurie hydraulique. Or la Syrie et le Liban détiennent les affluents du Jourdain. Lors de l'opération « Litani » l'armée israélienne s'était livrée à des détournements de cours d'eau, estimant que le fait que le fleuve Litani se déverse dans la Méditerranée sans être utilisé constituait un gâchis. Là encore, M. Barah Mikaïl a souligné l'importance de la raison du plus fort. Israël est situé en aval des cours d'eau, mais sa situation de force extrême par rapport à la Syrie ou au Liban fait qu'il n'a pas même besoin de faire la guerre pour que ses voisins ne soient pas tentés d'utiliser l'eau comme facteur de pression. Le contrôle total du lac Tibériade après la guerre de 1967 illustre cet état de fait.
Il a encore évoqué la situation d'Israël vis-à-vis de la Jordanie. Le traité de paix de 1994 prévoit des dispositions en matière hydrique qui n'ont jamais été respectées par Israël. A l'été 2007, ce sont les Israéliens qui ont fait, moyennant finances, un « prêt hydraulique » de vingt millions de mètres cubes d'eau à la Jordanie, dont huit millions de mètres cubes devront être restitués à terme. Par ailleurs, il a rappelé l'importance stratégique des nappes phréatiques situées en Cisjordanie et le fait que les colons israéliens ont un accès libre aux ressources hydrauliques, ce qui n'est pas le cas des Palestiniens (multiplication par trois des tarifications, interdictions de creuser des puits...), situation qu'il a qualifiée d'inique.
Enfin, s'agissant des eaux du Nil, il a rappelé que la Grande-Bretagne, puissance coloniale, avait fait prévaloir les intérêts de l'Egypte (75 % des eaux) sur ceux du Soudan (25 %). Le dernier traité date de 1959 et ne concerne pas l'Éthiopie qui est pourtant à l'origine de 80 % des eaux du Nil bleu. Ce dispositif contient en germe les conflits futurs. Il a été permis par la supériorité militaire égyptienne. En 1989, la visite d'hydrologues israéliens en Éthiopie pour la mise en valeur de ces ressources a conduit l'Égypte à menacer ce pays d'une guerre. Il a également rappelé que lorsque Nasser avait nationalisé le canal de Suez, c'était, notamment, pour disposer des ressources financières suffisantes afin de construire le barrage d'Assouan. La primauté des intérêts nationaux sur l'intérêt général fait que l'Egypte n'est pas prête à reconnaitre des droits à l'Éthiopie. Toutefois, une structure intergouvernementale, l'Initiative pour le bassin du Nil, a été mise en place en 1999. Les Éthiopiens ont ainsi déclaré leur intention de construire un barrage sur le Nil, sans que cela ait soulevé de tollé en Egypte, preuve que la situation peut évoluer.
Enfin, il a conclu son intervention en insistant sur le fait que le Soudan était la zone de tous les dangers dans le bassin nilotique. Le référendum, prévu en 2011, sur l'indépendance du sud Soudan, sur le territoire duquel s'écoule 20 % du débit du Nil, risque d'entraîner de fortes turbulences politiques. Après le sud Soudan, dans la province du Nil bleu, le Darfour pourrait également avoir des velléités d'indépendance aboutissant à une désintégration de ce pays qui profiterait à l'Ethiopie et affaiblirait l'Egypte.
Puis un débat s'est ouvert au sein de la commission.

s'est enquis de la nature juridique des accords liant les Etats-Unis d'Amérique et le Canada pour la gestion de leurs eaux transfrontalières. Il s'est également interrogé sur les conséquences sur les ressources en eau des achats massifs de terres effectués par la Chine sur le continent africain, notamment en Ethiopie et au Soudan.
En réponse, M. Barah Mikaïl a précisé que :
- la gestion des eaux entre les Etats-Unis et le Canada relève de plusieurs accords bilatéraux ;
- il est difficile de mesurer l'impact des achats chinois de terres, car il s'agit d'une phase de mise en place. D'autres pays comme l'Arabie saoudite et la Corée du Sud procèdent également à des achats de ce type, et une partie des fonds souverains du Qatar est consacrée à la location pour 99 ans de terres agricoles. Ces initiatives traduisent le besoin croissant de terres agricoles, besoin qui s'est récemment exprimé par des émeutes de la faim dans les pays les plus pauvres. Toutefois, si les États s'inquiètent d'une certaine perte de souveraineté sur leur territoire, les populations voient l'avantage financier qu'elles reçoivent pour des terres qu'elles ne pouvaient pas mettre en valeur.

a évoqué le travail effectué sur les ressources hydriques par la Communauté des Pyrénées qui réunit, pour l'Espagne, les provinces d'Aragon, de Catalogne, de Navarre et du Pays basque et, pour la France, les régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Il s'est interrogé sur l'opportunité d'établir une directive européenne qui protégerait la qualité des eaux transfrontalières.
a répondu que :
- l'Union européenne a déjà élaboré une directive du 23 octobre 2000 qui porte sur des critères qualitatifs de ces eaux et dont le bilan doit être effectué en 2015. C'est sur cette base que certain pays membres, dont la France, ont été frappés d'amendes. Le Sud-Ouest de la France est particulièrement affecté par la gestion agricole qui nuit à la qualité des eaux, et qui ne pourra être améliorée que par une tarification croissante de ces eaux ;
- l'agriculture représente en effet 70 % de la consommation mondiale d'eau et est la première responsable des pollutions. Ce secteur doit donc effectuer des efforts marqués pour réduire sa consommation. Il faudrait également faire évoluer les mentalités et les modes de vie.

a évoqué la situation qui prévaut en Jordanie où les ressources aquifères souterraines sont proches de l'épuisement et s'est interrogé sur la solution envisageable pour que ce pays continue à être approvisionné en eau, notamment en utilisant la désalinisation de l'eau de mer.
En réponse, M. Barah Mikaïl a précisé qu'une étude de faisabilité d'une usine de désalinisation de l'eau de mer est en cours par la Banque mondiale. Une telle usine réclamerait des financements importants qui pourraient être réunis ; le principal obstacle est d'ordre politique car l'Etat d'Israël pourrait craindre que l'eau ainsi produite bénéficie aux Territoires palestiniens. La résolution de la question hydrique pose alors la question de la paix politique. Les mouvements écologistes font valoir, de leur côté, que ce sont les prélèvements excessifs effectués sur le Jourdain qui font baisser le niveau de la Mer morte. Tel Aviv avait envisagé, en 2003, de relier la Méditerranée à la Mer morte pour améliorer le niveau de cette dernière. Ce projet a finalement été abandonné, notamment parce qu'il conduisait à une séparation physique de la Bande de Gaza et de l'Egypte.

s'est interrogé sur le rôle de l'eau dans les tensions qui pèsent sur l'Afghanistan.
En réponse, M. Barah Mikaïl a précisé que :
- il n'existe pas de preuve tangible de la volonté d'un ou de plusieurs Etats de puiser dans les ressources afghanes. Un des échecs majeurs de la reconstruction de ce pays réside dans le nombre très limité des infrastructures d'irrigation remises en état : on les évalue en effet aux environs de 13 % ;
- c'est en réalité le Tibet qui constitue le château d'eau de cette région et alimente à la fois l'Inde, l'Asie centrale et la Chine.

a constaté que les ressources en eau diminuaient partout dans le monde, et notamment en Afrique, en particulier pour les pays enclavés, sans accès à la mer. Ainsi, au Mali comme au Tchad, les puits doivent être sans cesse approfondis pour atteindre la nappe phréatique. Il s'est donc interrogé sur l'avenir des ressources en eau de ces pays.
En réponse, M. Barah Mikaïl a précisé que :
- l'approvisionnement en eau n'est pas limité par les quantités disponibles, mais par les financements de plus en plus coûteux des infrastructures nécessaires pour y accéder. En effet, l'eau présente sur terre n'est composée d'eau douce que pour 2 % dont seulement 0,2 % est potable ; ces quantités suffisent pourtant pour l'ensemble de la consommation de 6 milliards de personnes et même pour une population à venir de 9 milliards ;
- il existe effectivement des zones où la pénurie hydraulique est réelle : ce sont le Maghreb et le Sahel, le Moyen-Orient et Haïti. L'ensemble du continent africain est, au contraire, caractérisé par une richesse hydraulique mal utilisée du fait des carences des infrastructures. Il faut donc déplorer que la majorité de la mortalité entraînée par un manque d'accès à des eaux de qualité y soit concentrée. Ces problèmes de gestion se trouvent aussi aggravés par les effets de la corruption.

a évoqué un récent voyage effectué en Jordanie, qui l'a sensibilisée aux effets pervers entraînés par les travaux massifs d'aménagement du Golfe d'Aqaba où se multiplient les marinas. Elle a fait état des réticences manifestées par Israël à voir les Palestiniens disposer des eaux de la Mer noire.

s'est enquis des outils possédés par l'ONU pour traiter le problème de l'eau.
En réponse M. Barah Mikaïl à précisé que :
- la volonté d'Israël de ne pas accepter pleinement la création d'un Etat palestinien repose indiscutablement sur la crainte de lui voir reconnus des droits sur les eaux de la Mer morte ;
- à l'heure actuelle, l'ONU ne dispose que d'Aquastat qui dépend de l'OAA (Organisation pour l'agriculture et l'alimentation). La Cour internationale de justice statue également sur des conflits interétatiques portant sur l'eau mais ses décisions ne sont pas toujours suivies d'effets ; la Cour internationale de justice jugeant ex aequo et bono pourrait pourtant jouer un rôle important ;
- la création d'une ONU de l'eau a été parfois évoquée, mais l'efficacité d'une telle organisation reste à prouver. Dans la situation actuelle, ce sont les rapports transfrontaliers qui régissent l'accès aux ressources en eau.
Puis la commission a procédé à l'audition de M. William C. Ramsay, directeur du programme Energie de l'Institut français des relations internationales (IFRI).
A l'aide d'un diaporama, M. William C. Ramsay a dressé un tableau des enjeux géopolitiques de l'énergie. Il a souligné que si les tendances actuelles se poursuivaient jusqu'en 2030, 80 % de l'énergie utilisée dans le monde proviendrait des énergies fossiles, ce qui engendrerait une augmentation de 60 % des émissions de gaz carboniques et une augmentation de 6°C de la température. Cette augmentation dramatique de la pollution s'accompagnera de nombreux autres effets pervers, dont une dépendance et une vulnérabilité accrue des pays de l'OCDE à l'égard des producteurs d'hydrocarbures, ainsi que de la persistance d'une pauvreté en énergie pour plus de 1,5 milliard de personnes. La majeure partie de l'augmentation de la consommation d'énergie proviendra des pays hors OCDE, alors que la consommation des pays membres de l'OCDE devrait rester stable. Parmi les sources d'énergie, le charbon devrait voir sa part croître de façon considérable en raison, notamment, des réserves détenues par la Chine et l'Inde. Cette augmentation est d'autant plus préoccupante qu'il s'agit d'une source d'énergie particulièrement polluante.
Il a précisé que 77 % de l'augmentation de la demande d'énergie de 2007 à 2030 sera liée à la consommation d'énergies d'origines fossiles avec, en particulier, une augmentation de la demande de pétrole de 85 milliards de barils en 2008 à 105 milliards de barils en 2030. En 2008, la consommation d'énergies fossiles des pays hors OCDE a déjà dépassé celle des pays membres de l'OCDE, celle de charbon des pays hors OCDE a dépassé celle des pays de l'OCDE en 1988 et celle de gaz en 2008. Ce croisement s'effectuera en 2016 pour le pétrole.
a ensuite évoqué l'évolution de la production et des investissements pétroliers ces deux dernières années. Il a indiqué que les projections de consommation dans les cinq années à venir montraient que les pays hors OCDE devraient augmenter leur consommation de 8 milliards de barils alors que la consommation des pays de l'OCDE devrait diminuer d'un milliard de barils. La croissance de la consommation de 7 milliards de barils qui en résultera devrait inciter les pays producteurs à investir. Cependant la diminution conjoncturelle de la consommation entre 2007 et 2009 de 4 milliards de barils et la surcapacité de l'Arabie saoudite et du Koweït d'environ 6 millions de barils par jour ont conduit les compagnies pétrolières à réduire leurs investissements dans la production d'hydrocarbures de 19 % en 2009, les investissements dans les énergies renouvelables diminuant également dans la même période de 38 % du fait de la baisse des cours du brut et de la moindre rentabilité de ces investissements. Ces tendances contradictoires expliquent qu'il y ait une réelle incertitude sur les montants des investissements dans les années à venir. Selon les scénarios de l'OPEP retenus, le montant global des investissements réalisés entre 2008 et 2020 au sein des membres de cette organisation devrait être compris dans une fourchette très large allant de 130 milliards de dollars à 430 milliards de dollars.
Évoquant l'évolution de la production de gaz naturel, il a indiqué que les prix avaient, dans l'ensemble, suivi ceux du pétrole. Il a précisé qu'il fallait cependant distinguer le prix du gaz indexé au prix du pétrole, tel que le gaz consommé en Europe et au Japon, du gaz issu du « marché libre » américain et britannique, 60 % moins cher. Il a souligné que le marché du gaz avait été largement modifié par le développement de la production de gaz non conventionnel issu de schisme bitumineux. En trois ans la production du gaz non conventionnel des schistes bitumineux a augmenté de 430 milliards de mètres cube. Cette augmentation a conduit les Etats-Unis à réduire sensiblement leur importation de gaz liquide naturel et a ainsi contribué à la diminution du prix du gaz qui est devenu, aujourd'hui, concurrentiel avec celui du charbon en Europe et aux Etats Unis. Cette évolution devrait favoriser une substitution du gaz au charbon dans la production d'électricité.
Il a ensuite fait observer que de très nombreux investissements dans les infrastructures de transport de gaz avaient été initiés en Europe et en Asie pour diversifier la trajectoire des gazoducs afin de sécuriser les approvisionnements, ajoutant que de nombreux terminaux de regazification du gaz liquéfié avaient été créés aussi sur la façade atlantique de l'Europe ainsi qu'en Méditerranée. Il a constaté que seuls 73 % de la capacité de gaz serait d'ici 2015 non utilisée et que les consommateurs payaient le coût de ces investissements, en particulier pour les très coûteuses usines de regazification et le gazoduc Nordstream.
La production de la Russie diminue de manière rapide, à tel point que l'on peut s'interroger sur les capacités de ce pays à satisfaire une augmentation de la demande. Une part très significative de l'approvisionnement, de l'ordre de 40 % du marché domestique russe, pourrait être donnée à des indépendants. S'agissant des gazoducs, M. William C. Ramsay a souligné leur vulnérabilité, notamment au terrorisme, et du fait que certains d'entre eux sont très mal entretenus. De plus, l'élection de Victor Ianoukovytch en Ukraine va vraisemblablement conduire à l'apaisement des tensions avec la Russie, ce qui permet de s'interroger -mais trop tard- sur l'utilité du Nord Stream. La production russe cheminera en fait par trois gazoducs au lieu de deux, au détriment sans doute de l'Ukraine.
a ensuite évoqué la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il a souligné que si les tendances actuelles étaient poursuivies, la production annuelle de gaz carbonique passerait de 28 giga tonnes par an, en 2010, à 42 giga tonnes en 2030 et à 62 giga tonnes en 2050. Il a fait valoir que le développement de nouvelles technologies et les engagements pris par les États pour réduire les émissions carbone pouvaient considérablement infléchir ce scénario. Il a souligné que les engagements pris à Copenhague permettraient, s'ils étaient respectés, de réduire à 31 giga tonnes la production de carbone en 2020. Il a estimé que les négociations à Copenhague avec 193 pays avaient illustré les limites du multilatéralisme. Il a jugé qu'il aurait été sans doute préférable de chercher un accord entre les 15 principaux pays consommateurs, qui produisent à eux seuls 81 % des émissions de gaz carbonique, puis d'essayer d'obtenir un consensus sur cet accord au sein des 193 pays participant à la conférence.
Il a souligné, en conclusion, que l'enjeu principal, dans les années à venir, n'était pas le manque de sources d'énergie mais le choix du type d'énergie le moins polluant. L'utilisation potentielle de l'énergie solaire inépuisable ou de l'uranium offre en effet à la créativité humaine un champ quasi infini.

s'est demandé si le développement de nouvelles technologies serait en mesure de limiter les émissions de gaz à effet de serre des pays en voie de développement.
a estimé que l'aspiration des pays en voie de développement à une plus forte croissance économique était naturelle et légitime, observant qu'eux-mêmes avaient bien été conscients de la nécessité de trouver un équilibre entre le développement et la préservation de leur environnement. Il a souligné qu'un infléchissement des modes de consommation et une diversification des sources d'énergie dans ces pays étaient nécessaires. Il a concédé que si les Etats-Unis, le Japon et l'Europe semblaient mobilisés par les défis liés aux changements climatiques, les pays émergents comme l'Inde et la Chine demeuraient méfiants à l'idée de s'engager sur des objectifs trop contraignants.

s'est interrogé sur la part de la voiture dans les émissions de gaz à effet de serre.
a indiqué que cette part était limitée par rapport à celle liée à la production d'électricité, soulignant que la première cible en matière de réduction d'émission de gaz carbonique est l'usage du charbon dans les centrales électriques, en particulier en Inde ou en Chine.

s'est interrogé sur les progrès effectués en matière de captation de gaz carbonique lors de la combustion du charbon.
a indiqué que le développement des technologies de captation du gaz carbonique ne serait possible que s'il existait, au niveau du prix du carbone, une plus forte incitation des investisseurs à utiliser ce type de technologies.

a fait observer que s'il fallait aider la Chine et l'Inde à produire de l'énergie de façon moins polluante, il fallait également que les pays occidentaux fassent des progrès, en particulier, en matière de traitement des déchets nucléaires.
a souligné qu'il existait dans les pays occidentaux une forte résistance des populations devant le stockage des déchets nucléaires, observant que les progrès des technologies permettraient sans doute d'en améliorer le traitement. Il a indiqué qu'il était vraisemblable que de nombreux pays développent à l'avenir des centrales nucléaires. Si cette évolution peut être bénéfique d'un point de vue environnemental, il convient de veiller à ce que les pays qui se dotent de centrales soient bien en mesure d'assurer la sécurité de ces installations. Il a enfin souligné que la source d'énergie d'avenir était sans doute l'exploitation de l'énergie solaire.

s'est interrogé sur la pertinence d'un projet de ferme photovoltaïque à grande échelle dans le Sahara.
s'est déclaré réservé sur la rentabilité de tels investissements compte tenu du coût de transport de l'électricité ainsi généré et du coût d'achat des panneaux photovoltaïques. Il a souligné qu'un des freins à l'utilisation de l'énergie solaire était aujourd'hui le stockage de l'électricité ainsi générée.

s'est interrogé sur le rôle que pouvait avoir la voiture électrique dans la réduction des émissions de gaz carbonique.
a estimé que l'utilisation de la voiture électrique ne serait vraiment intéressante que lorsque l'électricité utilisée par ces voitures serait produite d'une manière qui nuise moins à l'environnement. Il a indiqué que, dans les pays où la production d'électricité était issue du charbon, l'intérêt de la voiture électrique était limité.

a fait valoir qu'il y avait peu de raisons pour que l'Inde et la Chine n'utilisent pas leur réserve de charbon jusqu'à épuisement.
a indiqué que les autorités chinoises étaient bien conscientes des dangers liés à l'utilisation du charbon et qu'elles réfléchissaient à la diversification de leurs sources d'énergies et à un accroissement de la part du gaz naturel dont le prix est de plus en plus concurrentiel. Dans la mesure où les autorités chinoises ont des raisons financières et stratégiques de continuer à utiliser leurs propres ressources en charbon, il convient de les aider à trouver des technologies qui permettent une utilisation de ce charbon plus respectueuse de l'environnement.
a enfin répondu à une question sur la situation en Iran et ses conséquences sur le marché de l'énergie. Il a indiqué que la situation en Iran perturbait les anticipations des acteurs du marché du pétrole, à terme, mais que cela n'avait pour l'instant que peu d'influence sur le prix du baril. Évoquant l'éventualité de sanctions à l'égard de l'Iran, il a estimé qu'il y avait peu de chances pour qu'un accord soit trouvé au sein des instances onusiennes avec la Chine et qu'il conviendrait sans doute de trouver un accord entre les alliés sur des sanctions économiques qui rendent compliquées les exportations de pétrole, en dissuadant notamment les compagnies de réassurance de donner des garanties aux transporteurs de pétrole issus de l'Iran.

a jugé qu'il y avait un juste équilibre à trouver entre la nécessité de faire pression sur les autorités iraniennes et le risque de ressouder l'opinion publique iranienne autour de son président.

s'est interrogé sur les raisons qui conduisaient les puissances occidentales à avoir peur que l'Iran n'utilise un jour l'arme nucléaire. Il a jugé que, compte tenu des risques de représailles immédiates qu'encourrait l'Iran, l'utilisation de cette arme lui paraissait peu probable. Il a souligné que, en outre, il lui paraissait sinon légitime du moins compréhensible qu'une puissance régionale comme l'Iran, entourée de voisins qui, comme le Pakistan ou Israël, disposent de l'arme nucléaire, veuille accéder au rang de puissance nucléaire.
a concédé qu'il n'y avait pas plus de raisons de penser que le Pakistan n'utiliserait l'arme nucléaire que l'Iran et que les risques viennent encore plus des sources non étatiques que des gouvernements en fonction.

a souligné que les sanctions étaient justifiées par le fait que l'Iran, signataire des accords de non-prolifération nucléaire, avait renié sa signature, fragilisant ainsi l'ensemble de cet accord et faisant peser, de ce fait, sur le monde, un risque important de prolifération. Il a indiqué que si la Chine était sans doute en mesure d'imposer à la Corée du Nord une renonciation à l'arme nucléaire en échange d'un soutien alimentaire, il semblait que personne n'était en mesure d'imposer une décision aux Iraniens. Il s'est enfin interrogé sur le niveau du prix du baril de pétrole.
a indiqué que le niveau du prix du baril à 78 dollars ne correspondait sans doute pas aux fondamentaux du marché mais répondait aux anticipations des acteurs du marché qui estiment que la baisse de la consommation n'est pas durable.

s'est interrogé sur l'état des capacités de raffinage des pays consommateurs.
a indiqué qu'il existait actuellement une surcapacité de raffinage due notamment aux investissements des pays producteurs ainsi qu'à la qualité des productions d'hydrocarbure qui exigeait un raffinement plus sophistiqué qu'auparavant.