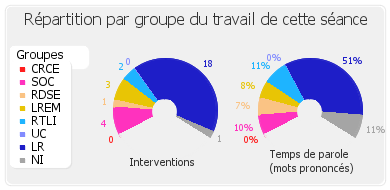Séance en hémicycle du 3 décembre 2013 à 21h30
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à seize heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Léonce Dupont.

La séance est reprise.

Mes chers collègues, je vous rappelle que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de sénateurs appelés à siéger au sein de trois organismes extraparlementaires.
La commission des finances a fait connaître qu’elle propose la candidature de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx pour siéger au sein du conseil d’administration du Fonds pour le développement de l’intermodalité dans les transports et celle de M. Jean Arthuis pour siéger au sein de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
Par ailleurs, la commission des lois a fait connaître qu’elle propose la candidature de M. Jean-Patrick Courtois pour siéger au sein du Conseil national de la sécurité routière.
Ces candidatures ont été affichées et seront ratifiées, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.

Conformément aux dispositions de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relatives à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, M. le Premier ministre a demandé à M. le président du Sénat de lui faire connaître l’avis de la commission du Sénat compétente sur le projet de nomination de M. Jean-Louis Nadal aux fonctions de président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Cette demande d’avis a été envoyée à la commission des lois.
M. le président du Sénat a également demandé à la commission des lois de lui faire connaître, pour l’application de l’article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, son avis sur le projet de nomination de M. Alain Delcamp comme membre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Acte est donné de ces communications.

L’ordre du jour appelle le débat sur la sécurité sociale des étudiants, organisé à la demande du groupe UMP.
La parole est à Mme Catherine Procaccia, au nom du groupe UMP.

Monsieur le président, madame la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, mes chers collègues, voilà un an, Ronan Kerdraon et moi-même rendions le rapport qui nous avait été demandé par la commission des affaires sociales du Sénat sur la sécurité sociale et la santé des étudiants. Ce rapport a fait grand bruit dans la presse : il était en une du journal Le Monde à la période de Noël 2012 et un reportage dans le journal télévisé de France 2 lui a été consacré. Les journalistes, qui eux aussi ont des enfants, ont été consternés par les dysfonctionnements du système.
Ce travail nous a également valu le privilège de recevoir de nombreux mails très personnalisés décrivant des situations parfois dramatiques, par exemple une entente préalable restée sans réponse au bout d’un an pour un appareillage orthopédique indispensable…

… ou des cartes Vitale non délivrées six mois après l’inscription. Cependant, nous n’avons pas eu l’occasion de présenter officiellement nos conclusions aux deux ministres concernées, c’est-à-dire à vous, madame Fioraso, ainsi qu’à Mme Touraine.
Heureusement, plusieurs études le prouvent, les étudiants sont une population en bonne santé, malgré ce qu’affirment certaines mutuelles. Reste que ceux qui le sont moins pâtissent depuis de trop nombreuses années d’un système défaillant. La Cour des comptes, dans son dernier rapport sur la sécurité sociale, va encore plus loin dans les critiques et préconise des pistes d’amélioration, dont certaines vont dans le sens de notre rapport. Je me félicite donc que ce thème d’actualité ait été inscrit à l’ordre du jour, même si, comme la plupart d’entre vous, j’aurais aimé en être avertie un peu plus d’une semaine à l’avance…
Quoi qu’il en soit, madame la ministre, ce débat vous donnera l’occasion de nous apporter des réponses et vous permettra de rassurer étudiants et parents, qui se demandent pendant combien d’années encore les gouvernements vont laisser perdurer de telles situations. Je dis bien les gouvernements, car j’inclus dans ce constat celui d’aujourd’hui et les précédents, voire les prochains, quelle que soit leur orientation politique. Sachez que j’ai comptabilisé le nombre de questions posées par les députés et les sénateurs sur les dysfonctionnements des mutuelles. J’en ai recensé 217 au Sénat et 260 à l’Assemblée nationale en cinq ans. Impressionnant ! Pour les seuls députés, depuis un an, 98 questions ont été posées sur le sujet. À ce rythme, on ne pourra reprocher aux services des ministères concernés de faire des copier-coller pour répondre aux questions des parlementaires s’ils veulent continuer à travailler.
Il est temps que le système de sécurité sociale des étudiants soit toiletté et adapté. En 1947-1948, lorsque fut créé le régime d’assurance maladie délégué, les étudiants étaient peu nombreux et leurs études moins longues ; la carte Vitale et l’informatique n’existaient pas, non plus que la formation en alternance. Si depuis soixante ans le monde étudiant a changé, le système, lui, a peu évolué, mais il a connu des soubresauts mouvementés.
L’UNEF, l’Union nationale des étudiants de France, a créé en 1948 la MNEF, la Mutuelle nationale des étudiants de France, compétente sur l’ensemble du territoire, sauf en Lorraine où existait déjà une mutuelle. La MNEF a détenu le monopole assurantiel jusqu’à ce que soient autorisées les mutuelles à vocation régionale en 1972. Une dizaine d’années après, la Cour des comptes dénoncera le fonctionnement de cette mutuelle. Cette retentissante histoire financière donnera naissance en 2000 à LMDE, La Mutuelle des étudiants, sans doute avec l’espoir de mieux commencer le XXIe siècle…
Certaines mutuelles régionales n’ont pas non plus été épargnées par les scandales, qui ont aussi conduit à des changements de noms. Depuis lors, un contrôle est exercé par l’Autorité des marchés financiers et par l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
Aujourd’hui, et c’est une particularité en France, les étudiants ont donc le choix, pour leur régime de base, entre deux organismes offrant des prestations strictement identiques : La Mutuelle des étudiants, avec ses 920 000 affiliés, ou l’une des dix mutuelles régionales, avec leurs 850 000 affiliés. Les prestations perçues sont comparables à celles du régime général, lequel verse aux mutuelles, en sus de ces prestations, des remises de gestion destinées à compenser les coûts.
Chacune des mutuelles est indépendante, même si des accords de partenariat ont pu être noués, comme entre LMDE et la Mutuelle générale de l’éducation nationale, la MGEN. Les mutuelles régionales forment, quant à elles, le réseau emeVia, qui est une structure de coordination et de représentation.
Au fur et à mesure des décennies, le régime étudiant, censé permettre une première « appropriation » de la sécurité sociale par les jeunes, est passé de compliqué à abracadabrantesque ! Il serait pourtant aisé de le simplifier. Songez que, selon la profession des parents, l’inscription est obligatoire à dix-huit ans, à vingt ans, à vingt et un ans, voire facultative, comme pour les enfants des cheminots, qui demeurent rattachés à leurs parents jusqu’à vingt-huit ans.
Il conviendrait également de s’attaquer à ces allers et retours permanents entre les régimes : les jeunes quittent le régime des parents pour intégrer la sécurité sociale étudiante ; s’ils poursuivent une activité salariée ou font une année en alternance, ce qui est de plus en plus préconisé par votre ministère, madame Fioraso, ils rejoignent le régime général, puis retournent dans le système étudiant pour quelques mois avant d’intégrer définitivement le régime général au moment de leur première activité salariée.
Toujours dans un but de simplification, il serait souhaitable de modifier l’appellation de ces organismes. Le code de la sécurité sociale leur attribue le qualificatif de « mutuelle », mais les deux réseaux commercialisent également des contrats de complémentaire santé. Cette double casquette est source de confusion, bon nombre de jeunes croyant être assurés par une complémentaire maladie. C’est pourquoi, dans notre rapport, nous préconisons de dissiper cette ambiguïté trompeuse et de réserver le terme « mutuelle » à leur seule activité d’assureur. S’agissant de cette dernière, nous nous contentons de demander une labellisation de contrats vraiment adaptés aux étudiants, sujet auquel devrait être sensible le Gouvernement, particulièrement Mme Touraine, qui tente d’imposer une clause de recommandation pour les salariés dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
La Cour des comptes va plus loin : elle affirme que « l’adhésion au régime complémentaire étudiant est […] financièrement peu intéressante », la plupart des étudiants bénéficiant, grâce à la complémentaire de leurs parents, d’une tarification familiale plus avantageuse. Si seulement 26 % des étudiants effectuent cette démarche, ce n’est donc pas uniquement une question de pouvoir d’achat, comme le soutient LMDE, mais une question de qualité de prestations et surtout de double emploi, sans compter que la Cour des comptes estime que les remises de gestion financent en partie les coûts liés à la complémentaire ; le coût analytique de gestion du régime obligatoire pourrait donc baisser de 15 % par la seule adoption d’une hypothèse neutre de répartition. Dans ces conditions, est-il légitime que l’assurance maladie obligatoire finance la complémentaire santé ?
Notre rapport évoque trois évolutions possibles pour la sécurité sociale étudiante.
La première, qui est sage, envisage une gestion partagée avec le régime général. Cette solution serait pratique, mais peu ambitieuse : en répartissant les rôles, on préserve l’existence des mutuelles, et donc la paix syndicale, mais on leur reconnaît aussi une capacité limitée. En outre, LMDE est déjà adossée à la MGEN.
La deuxième piste, si elle est rationnelle sur le plan de la gestion, a montré ses limites dans le passé : le retour à un organisme unique. Cette solution mettrait fin à une concurrence coûteuse, mais elle supposerait un organisme capable de gérer efficacement 2 millions d’étudiants. Est-ce envisageable ? Si la plupart des mutuelles régionales fonctionnent plutôt efficacement, c’est parce qu’elles sont de petite taille et assurent un contact de proximité. La plus grosse, la SMEREP, la Société mutualiste des étudiants de la région parisienne, elle, n’est pas un modèle d’efficacité. Quant à LMDE, malgré les déclarations annuelles récurrentes depuis six ans de ses présidents successifs, l’amélioration annoncée n’est toujours pas au rendez-vous. Elle est encore et toujours en cours…
J’ai bien conscience que certains veulent utiliser notre rapport pour confier à LMDE l’ensemble du régime délégué et qu’une interview de mon collègue Kerdraon tend à alimenter cette hypothèse. Avec un an de recul, je ne crois pas que ce soit la solution. Je suis même maintenant persuadée du contraire. Quel serait l’intérêt de fusionner une mutuelle qui fonctionne mal avec d’autres, plus petites, qui fonctionnent mieux ? En soixante ans, aucune mutuelle n’a su s’adapter à une population croissante d’étudiants. Et ce n’est pas en doublant la capacité de la moins efficace que cette faculté d’adaptation s’améliorera !
Certes, les avis de la Cour des comptes sont très rarement suivis. Je pense notamment à la gestion des comptes des comités d’entreprise, autre dossier dans lequel je me suis beaucoup engagée. Toutefois, le fait d’aller totalement à l’inverse de leurs préconisations serait très mal venu. Sans compter que l’enquête du journal Le Monde a fait resurgir le fantôme du scandale de la MNEF, encore bien présent dans les esprits, et fera douter d’autres que moi de l’opportunité de cette solution.
Bref, une telle issue, logique sur le papier, me paraît aujourd'hui impossible. En effet, qu’il y ait une ou onze mutuelles, l’existence même d’un régime étudiant séparé nécessite d’affilier plusieurs centaines de milliers de personnes chaque année.
La troisième hypothèse que nous préconisons est celle qui serait la plus simple pour tous les Français : supprimer le régime délégué et maintenir l’étudiant affilié au régime dont il dépendait mineur, et ce jusqu’à ce qu’il travaille. Cela aurait le mérite de réduire non seulement les coûts de gestion, mais aussi la lourdeur et la lenteur des mutations inter-régimes. Quoi de plus simple, puisque les systèmes informatiques existent ? Rien n’empêche que le jeune ait son propre compte et ses identifiants !
À y regarder de plus près, serait-ce vraiment une révolution ? En effet, 35 % à 40 % des étudiants ont moins de vingt ans et demeurent ayants droit du régime de leurs parents ; près de 6 % d’entre eux sont rattachés au régime général de la sécurité sociale par leur activité salariée ; enfin, les enfants de cheminots continuent à relever du régime de la SNCF jusqu’à vingt-huit ans.
La France est l’unique pays à avoir mis en place un tel régime spécifique, qui revêt une ambiguïté certaine : seuls ceux qui poursuivent des études ont le droit, ou la malchance, d’en dépendre. Ni les apprentis ni les autres jeunes ne sont concernés ! Étrange pays qui assure à sa jeunesse une protection sociale différente selon le type de formation…
La Cour des comptes avance, quant à elle, une quatrième piste que je qualifierai non pas de normande, pour ne pas vexer le président Dupont, …
Sourires.

… mais de mi-chèvre mi-chou. Elle propose de laisser aux étudiants le choix entre l’affiliation à la sécurité sociale étudiante ou le maintien du rattachement au régime de leurs parents. Selon la Cour des comptes, cela inciterait les mutuelles à « réorienter leurs efforts vers la recherche d’adhérents et la qualité du service rendu au meilleur coût ». Cette solution est présentée comme une étape transitoire, avant la remise en cause du régime délégué. Je pense cependant qu’elle déstabiliserait les mutuelles, qui ne pourraient ni prévoir le nombre d’affiliés ni adapter leurs services.
J’espère, madame la ministre, que vous nous direz à laquelle de ces quatre pistes de réflexion va votre préférence et celle du Gouvernement. Mais, surtout, ne nous dites pas que toutes les décisions seront reportées à la future grande loi de santé publique ! Vous n’êtes pas Mme Touraine…
Rires sur les travées du groupe socialiste.

Vous le savez, madame la ministre, j’avais déposé de multiples amendements, issus des conclusions de notre rapport, lors de l’examen du projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche, que vous nous avez présenté. J’avais même réussi à vous faire accepter deux de ces dispositions : le suivi vaccinal des étudiants par les SUMPPSS, les services universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé, et le renforcement du programme régional pour l’accès à la prévention et aux soins des étudiants les plus démunis, prévu dans le cadre des conventions signées entre les ARS et les SUMPPSS.
Quant à l’idée de favoriser l’accès à la CMU, la couverture maladie universelle, aux étudiants en situation de précarité, une disposition en ce sens a été intégrée au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Depuis un an, nous avons ainsi obtenu, cher Ronan Kerdraon, trois avancées.

En revanche, le couperet de l’article 40 de la Constitution est tombé s’agissant d’un amendement visant à faire débuter le régime social des étudiants dès la reprise des cours, soit en septembre, et non plus en octobre. N’estimez-vous pas aberrant, madame la ministre, que les étudiants commencent leur année en septembre et ne puissent être assurés qu’un mois après ? Pourtant, cela fait une dizaine d’années que la rentrée a été avancée ! Je vous réclame seulement ce simple arrêté de bon sens, qui irait dans l’intérêt de tous.

Une autre amélioration, elle aussi importante, relève de votre ministère : l’obligation, pour les universités et les écoles, de transmettre aux régimes étudiants les inscriptions par voie informatique. Cela éviterait des erreurs. Il en est de même de l’uniformisation des modalités de recueil des informations. Je n’ose croire qu’une telle disposition puisse porter atteinte à l’autonomie des universités et des grandes écoles.
Le point suivant relève du ministère des affaires sociales, mais vous devriez réussir à convaincre votre collègue en la matière. Il s’agit d’autoriser le lancement d’opérations de mutations inter-régimes dès réception des informations des établissements de l’enseignement supérieur. Actuellement, les mutuelles doivent encore attendre le fameux 1er octobre, alors que la plupart des étudiants s’inscrivent au mois de juillet.
Les démarches d’affiliation inter-régimes sont l’un des facteurs de lenteur. Il est anormal que le régime général n’autorise pas la transmission électronique de certaines informations, en particulier du nom du médecin traitant. D’après les mutuelles, cela retarde la transmission du dossier et allonge inutilement les délais d’obtention de la carte Vitale, l’étudiant devant de nouveau remplir ce document. À propos précisément de la carte Vitale – parions d’ailleurs que je ne serai pas la seule ce soir à aborder cette question –, …

… puisque la ministre de la santé a décidé d’étendre le tiers payant, il devient encore plus inacceptable qu’une grande partie des étudiants l’attende parfois pendant six mois. De tels délais relèvent également de la lourdeur des mutations inter-régimes, déjà évoquée, mais aussi des méthodes de travail des mutuelles.
La Cour des comptes constate que les demandes de La Mutuelle des étudiants sont bien plus rejetées que celles de la SMEREP, qui ne fonctionne déjà pas très bien, ce qui signifie que les dossiers transmis sont mal remplis. Or une procédure est prévue lorsque l’étudiant n’a pas reçu sa carte : les mutuelles sont autorisées à demander la création d’une nouvelle carte en janvier. Pourquoi les mutuelles régionales le font-elles, alors que LMDE attend six mois pour déclencher cette procédure, quasiment à la fin de la scolarité ? Je vous propose donc de créer un droit opposable à la carte Vitale au bout de deux mois et d’intégrer dans la convention d’objectifs et de moyens, en tant que critère de qualité, le nombre de cartes envoyées.
Autre indicateur de qualité : le taux de réponse ou de non-réponse aux assurés. La quasi-totalité des mails que nous avions reçus concernaient LMDE et nous alertaient sur les non-remboursements et, surtout, l’absence de réponses.
La Cour des comptes, dont j’ai lu intégralement le rapport, confirme notre analyse. Il y a une chance sur quatorze de joindre un conseiller par téléphone. La situation ne s’améliore pas puisque les appels sont de plus en plus nombreux et les points d’accueil sont débordés. Il n’est répondu ni aux mails ni aux courriers, sauf à ceux émanant des enfants des adhérents de la MGEN, qui seraient traités prioritairement. Certes, il est concevable que la MGEN, qui a injecté des moyens financiers non négligeables et qui oriente les enfants des fonctionnaires vers LMDE, fasse pression, mais ces pratiques sont en contradiction, me semble-t-il, avec les principes d’égalité devant le service public.

Il faut espérer que la MGEN incite aussi la mutuelle à développer des services sur internet pour désengorger les plateformes d’accueil ; la consultation du dossier personnel et des remboursements ne suffisent pas. Outre l’édition d’attestations diverses doivent apparaître les accusés de réception des réclamations et, surtout, l’état de la demande. Trop de dossiers sont déclarés perdus, ce qui n’est pas acceptable. La gestion par internet devrait donc s’imposer à tous.
En guise de conclusion, je veux vous faire partager ma déception. En effet, en un an, hormis pour ce qui concerne les dispositions prévues par les amendements que vous aviez acceptés, madame la ministre, rien n’a bougé, malgré notre rapport, malgré les avis de la Cour des comptes, malgré les articles du Monde, malgré l’enquête menée par l’UFC-Que Choisir, malgré certaines déclarations, émanant parfois des rangs des parlementaires socialistes.
Qu’est-ce qui justifie aujourd’hui le maintien d’un régime étudiant séparé, qui coûte cher ? Je vous propose de consacrer une partie des 93 millions d’euros susceptibles d’être économisés à des politiques de prévention ciblées, efficaces et, surtout, évaluées. Même si vous décidiez, pour quelque raison que ce soit, de maintenir ce système sous respiration artificielle, pourquoi n’en simplifieriez-vous pas drastiquement la gestion, qu’il s’agisse des modalités d’inscription ou des mutations inter-régimes ?
Je sais, madame la ministre, puisque nous avions échangé à ce sujet, que vous partagez nos préoccupations. Si je compte sur vous, je ne suis pas la seule ! Ce ne sont pas moins de 500 parlementaires qui ont posé des questions au Gouvernement ; les étudiants et les parents en ont assez !
Pour terminer, j’évoquerai simplement ces étudiants étrangers, dont vous souhaitez qu’ils soient plus nombreux à venir en France. Ils sont encore plus mal lotis que les Français. Pensez-y !
Applaudissements sur les travées de l'UMP. – M. Gilbert Barbier applaudit également.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la santé des étudiants est un sujet que nous tient particulièrement à cœur. Aussi me réjouis-je de ce débat, qui ne peut que contribuer à améliorer leur protection sociale. Même si les jeunes, cela vient d’être dit, sont moins malades que le reste de la population, ce fait ne doit en aucun cas constituer une excuse à une dégradation des services sanitaires et sociaux qui leur sont dédiés.
En France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, les étudiants de l’enseignement supérieur n’ont jamais été aussi nombreux puisqu’ils sont près de 2 350 000. Or 63 % d’entre eux considèrent que la société ne leur offre pas les conditions nécessaires à leur réussite. Ces dernières années, la situation sanitaire et sociale de ces étudiants s’est en effet fortement dégradée. Comme l’a affirmé le Président de la République, « les conditions de vie des étudiants ne cessent de se dégrader […], leur précarité augmente, les inégalités entre eux s’accroissent ».
Depuis 1948, les étudiants bénéficient d’un régime spécifique de sécurité sociale. La gestion est assurée aujourd’hui par deux organismes : LMDE et le réseau emeVia. Ce régime n’a pas d’équivalent au sein de l’Union européenne.
Depuis des années, le niveau de vie des jeunes recule sous les effets de la crise. Ainsi, la part des étudiants vivant sous le seuil de pauvreté est de 20, 3 %, contre 14, 3 % pour la population générale. La dégradation de leurs conditions de vie a des effets notables sur leur santé : le renoncement aux soins des jeunes n’est plus une probabilité, mais bien une réalité ! En 2011, 34 % des étudiants renonçaient à se soigner, contre 25 % en 2005. Car se soigner est devenu un parcours du combattant ! Pour lutter contre le renoncement aux soins, la société doit offrir aux jeunes l’accès au droit commun.
Chaque année, le projet de loi de financement de la sécurité sociale constitue l’occasion d’améliorer les choses, mais l’année 2014 et la future loi de santé publique représentent à mon sens une réelle opportunité de traduire nos propositions en actes.
Premier point positif, énoncé dans la stratégie nationale de santé, le tiers payant devra être généralisé d’ici à 2017, pour faciliter l’accès aux soins de ville. Dans une optique de montée en charge progressive du dispositif et afin de lutter contre le renoncement aux soins des jeunes, j’avais déposé, lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, un amendement visant à faire bénéficier les étudiants du tiers payant dès 2014. Les contraintes budgétaires actuelles, que je comprends, ne nous ont pas permis de l’adopter.
En termes de couverture complémentaire, les étudiants sont statistiquement trois fois moins couverts que la population générale : 19 % n’ont pas de complémentaire santé, alors qu’ils étaient 13 % en 2008. Plus alarmant encore, 34 % d’entre eux renoncent à se soigner, contre 15 % pour l’ensemble de la population. Il est temps de réinventer, de redéfinir le parcours de santé des jeunes, afin de mettre l’offre de soins au service des patients.
Dans un rapport sénatorial publié en décembre 2012, dont je suis corapporteur avec ma collègue Catherine Procaccia, nous avions souligné une qualité de services globalement très insatisfaisante. En effet, les étudiants et leurs familles sont régulièrement confrontés à des délais de remboursement importants et à des difficultés pour contacter les mutuelles. Les problématiques ne changent guère : longs délais de remboursement et, surtout, très grandes difficultés à joindre un correspondant, tant au téléphone que par courrier ou messagerie électronique.
L’enquête plus exhaustive qu’a publiée l’UFC-Que Choisir en septembre 2012 a confirmé cette impression : elle mettait en avant la complexité du système pour les étudiants, le coût pour la société, une qualité de service « en berne », une difficulté récurrente à joindre certaines plateformes téléphoniques et des courriers et mails restés sans réponse. L’UFC-Que Choisir avait relevé que le taux d’appels décrochés, c’est-à-dire le pourcentage des appels entrants effectivement traités, pouvait varier du simple au double selon les mutuelles.
Par ailleurs, un tiers des nouveaux étudiants seraient toujours sans carte Vitale trois mois après leur affiliation.
Néanmoins, quelques progrès sont observés. Je pense notamment au rapprochement entre LMDE et la MGEN, qui a facilité une « gouvernance partagée ». Les services de la MGEN assument ainsi des tâches touchant au cœur du fonctionnement de LMDE. Par exemple, leurs plateformes informatiques sont communes, ce qui permet à La Mutuelle des étudiants de bénéficier de moyens logistiques et techniques performants et, ainsi, d’améliorer ses services. Il s’agit en particulier des activités de liquidation et d’exploitation informatique.
Reste que le processus d’affiliation est une première cause de difficulté. La refonte de cette procédure, notamment l’ouverture des droits dès le 1er septembre, permettrait une nette amélioration dans le traitement des dossiers. Actuellement, les mutuelles étudiantes reçoivent une information de la part de l’établissement d’enseignement supérieur qui est chargé de recueillir le choix de son centre de gestion par l’étudiant. Ces informations sont fournies sous des formats variables, éventuellement via un formulaire papier qui n’a pas été actualisé depuis trente ans. Alors que les inscriptions s’effectuent le plus souvent au début de l’été, l’affiliation au régime étudiant ne débute qu’à compter du 1er octobre et les établissements transmettent les informations selon leur bon vouloir, parfois plusieurs semaines après cette date théorique d’ouverture des droits. En outre, l’ensemble des inscriptions arrivent sur une période courte dans l’année, ce qui crée un pic d’activité très important. Il existe donc une première série de difficultés au moment de l’affiliation.
Le régime étudiant est un régime de transition. Par définition, les jeunes n’y étaient pas inscrits avant de commencer leurs études supérieures. C’est la « mutation inter-régimes ». Ce seul fait engendre une lourdeur administrative, le régime étudiant se voyant dans l’obligation de récupérer les informations de la caisse antérieure. Aussi ai-je tendance à penser que la fusion des deux mutuelles étudiantes en un régime unique global permettrait une amélioration, tout en conservant l’objectif d’autonomie de 1948.
Mon souhait n’est pas de mettre fin à la délégation de service public, car on ne peut nier l’utilité de la sécurité sociale étudiante : elle développe des couvertures sanitaires adaptées aux problématiques étudiantes, mène des campagnes d’information ainsi que des actions de prévention indispensables. Il est temps en revanche de mettre fin à la concurrence à laquelle se livrent trop souvent les deux organismes. La situation est devenue intolérable et le statu quo n’est plus envisageable. Cette concurrence, « commerciale » voire sauvage, est préjudiciable aux étudiants eux-mêmes.
À son tour, la Cour des comptes a pointé les défaillances du système et l’insatisfaction des étudiants. Les deux rapports convergent. Les pouvoirs publics doivent maintenant se saisir de ce besoin réel de réformer en profondeur le système de sécurité sociale des étudiants.
La revendication originelle de 1948 d’un régime spécifique unique intégré à la sécurité sociale et géré démocratiquement par des étudiants reste, me semble-t-il, toujours d’actualité. Cependant, la fin de cette dualité permettrait – ce n’est pas inintéressant – de supprimer des surcoûts de gestion importants pour le régime étudiant. Il serait donc tout à fait envisageable que les mutuelles étudiantes se regroupent. Elles conserveraient l’accueil physique, les courriers et les réclamations, et l’assurance maladie liquiderait les prestations, assurerait les contrôles et la gestion des fraudes, voire gérerait les affiliations en ce qui concerne le répertoire national inter-régimes ou les cartes Vitale. Comme nous l’avons souligné avec Catherine Procaccia dans notre rapport, cette solution présenterait des avantages indéniables.
Je suis convaincu, mes chers collègues, que nous devons au minimum nous diriger vers une telle solution : pas de big-bang, mais une amélioration sensible des modalités de gestion. Car, aujourd’hui, la complexité du système dessert en réalité l’autonomie de l’étudiant : les parents sont dans l’obligation, lorsqu’ils le peuvent, d’aider leurs enfants face au véritable fatras auquel ils sont confrontés.
Il apparaît aussi clairement que le mutualisme étudiant manque cruellement des moyens nécessaires au bon accomplissement de ses missions de service public que sont la prévention et l’éducation à la santé. Ce sous-financement est, semble-t-il, lié au mode de calcul retenu par la CNAMTS, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dans le cadre de la remise de gestion accordée aux mutuelles. Ainsi, seul 1, 3 euro par an et par étudiant est prévu en matière de prévention.
Par ailleurs, des mesures ont été prises ces dernières années qui pèsent lourdement sur la gestion des mutuelles étudiantes. Ainsi, les frais de gestion sont estimés à 13, 7 % des remboursements, contre 4, 5 % pour l’assurance maladie. La taxe spéciale sur les contrats d’assurance, qui était de 3, 5 % le 1er janvier 2011 et qui a été relevée à 7 % depuis le 1er octobre, est venue s’ajouter à la taxe CMU de 6, 27 %. L’État prélève au final 13 euros sur les 100 euros de cotisation versés par un étudiant à sa mutuelle.
Le Sénat, l’UFC-Que Choisir et la Cour des comptes ont tiré la sonnette d’alarme. Aujourd’hui, le moment est propice à une réforme.
La mesure la plus urgente serait vraisemblablement l’attribution d’un chèque santé national, dont le montant reste à définir, mais qui pourrait être compris entre 100 et 200 euros. Des collectivités locales, notamment certains conseils régionaux, l’ont mis en place avec succès. Je pense au conseil régional d’Île-de-France et au conseil général de Loire-Atlantique. Ce dispositif mériterait, au nom de l’équité territoriale et de l’égalité de tous devant la santé, d’être repris par l’État. D’ailleurs, dès 2006, un député, nommé par la suite ministre, Laurent Wauquiez, proposait sa création dans un rapport. François Hollande avait lui-même souhaité ouvrir une concertation sur l’extension du chèque santé. Il me semble que nous pouvons dès ce soir poser cette question.
Dans le même esprit, l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé serait un levier important pour favoriser l’accès aux soins des étudiants. Néanmoins, des critères d’attribution particulièrement restrictifs – indépendance fiscale, décohabitation, absence de pension alimentaire – constituent un frein à son accès.
Il est important de noter que, en dix ans, le coût de la sécurité sociale étudiante a augmenté de plus de 17 %. Pourtant, le budget de rentrée d’un étudiant est toujours aussi serré. Ayons toujours à l’esprit, mes chers collègues, qu’agir aujourd’hui pour enrayer la dégradation de l’état sanitaire des étudiants, c’est éviter des dépenses supplémentaires demain à notre système de protection sociale.

Mais, à plus long terme, c’est bien à l’élaboration d’un véritable statut social – temps de l’étudiant, logement, santé et alimentation – auquel nous devrons nous atteler, en concertation avec les organisations représentatives d’étudiants, sous peine d’aggraver le fossé qui existe entre eux et la société dans son ensemble.
Je tiens à aborder un autre point, celui des services alloués aux étudiants pour leur santé.
Des structures existent au sein des établissements d’enseignement supérieur pour assurer le suivi sanitaire des étudiants et effectuer auprès d’eux des actions de prévention. Malheureusement, elles sont souvent confrontées à un manque chronique de moyens ainsi qu’à l’absence d’une véritable politique de santé publique qui leur permettrait d’avoir un cadre d’action clair et déterminé.
Au sein des universités, ce suivi est assuré par les SUMPPS ; il en existe cinquante-neuf, répartis sur l’ensemble du territoire. Ces services ont en particulier pour mission d’organiser au moins un examen préventif par étudiant au cours des trois premières années passées dans l’enseignement supérieur. Les SUMPPS organisent également chaque année des campagnes d’information et de sensibilisation. Il est aussi possible de s’y procurer de la documentation médicale de prévention sur de nombreux thèmes.
Depuis 2008 et la parution du décret qui a profondément modifié leurs conditions de fonctionnement, les SUMPPS peuvent officiellement se constituer en centres de santé ; ils sont alors en mesure d’exercer une réelle activité de soins auprès des étudiants. Ce statut doit certainement être encouragé.
Les SUMPPS souffrent d’un manque de visibilité auprès des étudiants. Une enquête sur la santé des étudiants parue en 2011 révèle que seulement 1, 9 % d’entre eux choisissent de s’y rendre lorsqu’ils sont malades. La politique universitaire doit à ce stade jouer un rôle important.
Il faut savoir que ces structures s’adressent d’abord aux étudiants inscrits à l’université. Certes, 80 % d’entre elles ont signé des conventions avec d’autres établissements d’enseignement supérieur, mais ces partenariats ne suffisent pas à couvrir l’ensemble de la population étudiante, notamment les étudiants inscrits en brevet de technicien supérieur ou en classe préparatoire, qui continuent d’être scolarisés dans les lycées.
En outre, les moyens humains et financiers des SUMPSS sont insuffisants pour leur permettre d’exercer leurs missions dans des conditions satisfaisantes. Deux sources principales de financement alimentent leur budget : une dotation de l’État et une participation des étudiants comprise dans leurs droits de scolarité, soit 5 euros depuis la rentrée de 2012.
D’autres structures peuvent venir en aide aux étudiants. C’est notamment le cas des bureaux d’aide psychologique universitaires, qui sont composés d’équipes pluridisciplinaires et qui accueillent gratuitement les étudiants. Il n’en existe cependant que vingt sur l’ensemble du territoire.
Autre service qui, à mon sens, doit également disposer de moyens supplémentaires : le service d’accueil des étudiants handicapés. Dans chaque université, ce service est un véritable lieu de ressources où l’on peut trouver des informations et des aides. Il définit avec l’étudiant les mesures d’accueil et d’accompagnement indispensables à sa réussite.
L’évolution du nombre d’étudiants handicapés dans l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur est une preuve du travail qui est fait sur place et qui doit continuer à s’améliorer. En 2000, ils étaient plus de 7 000 à poursuivre des études supérieures ; en 2012, ils étaient 13 000, soit une progression moyenne de 7, 3 % par an. C’est bien, mais nous pouvons et devons faire mieux, notamment en offrant aux étudiants handicapés les moyens de faire les études qu’ils souhaitent, dans de bonnes conditions. Toutefois, en fonction de la nature de leur handicap, les étudiants sont inégalement présents dans les différentes filières de formation.
Face à ces constats, quels remèdes pouvons-nous préconiser ?
Le fonctionnement de l’ensemble de ces services doit être amélioré de façon urgente sur plusieurs points. En premier lieu, il convient de mettre fin à la situation de précarité dans laquelle se trouvent trop souvent leurs personnels. Les SUMPPS n’ont pas tous le statut de centres de vaccination, alors même que cette mission est au cœur de leur rôle de prévention. Il serait nécessaire d’étendre cette compétence à l’ensemble des services.
S’il est difficile, compte tenu des contraintes budgétaires actuelles, d’envisager une hausse importante des moyens alloués aux SUMPPS par l’État, un effort nous semble cependant indispensable afin de leur permettre de répondre correctement aux demandes de soins de premier recours des étudiants. En tout état de cause, ces services doivent nouer des partenariats avec les autres services de soins et d’accompagnement sur le territoire.
De façon générale, leurs méthodes de communication, notamment en ce qui concerne la visite médicale de prévention, gagneraient à être améliorées à partir d’une étude des meilleures pratiques observées dans certains services. À plus long terme, et avant toute mesure d’ampleur, il pourrait être demandé un rapport d’inspection pour dresser un état des lieux de la situation, de leur positionnement et des perspectives d’évolution. Le principe d’autonomie des universités, qui fait dépendre les services médicaux du niveau d’engagement de leur président, ne devrait pas, à tout le moins, s’opposer à une meilleure coopération, à un échange des bonnes pratiques et à un pilotage stratégique sur le plan national.
J’ouvre à cet instant une parenthèse pour signaler que le problème de la sécurité sociale des étudiants est un sujet qui touche trois ministères : celui des affaires sociales et de la santé, celui de l’enseignement supérieur et de la recherche et celui de l’éducation – je ne parle même pas du ministère de l’économie sociale et solidaire. Cette situation est difficile à gérer, car elle ne fait que multiplier les interlocuteurs.
Autre grand projet de l’année qui vient, la négociation de remise de gestion, qui va sans doute permettre une redéfinition de l’ensemble des missions.
La vie étudiante étant une phase d’apprentissage avant l’arrivée à l’âge adulte, elle constitue un moment privilégié pour permettre aux jeunes d’acquérir certains réflexes et de bonnes habitudes dans leurs comportements en matière de santé. L’ensemble des syndicats étudiants se saisissent aussi du problème. Je pense à la FAGE – la Fédération des associations générales étudiantes –, à l’UNEF, laquelle organise des états généraux de la santé et de la protection sociale des jeunes le 31 janvier prochain. Nous pouvons compter sur leur coopération et leur soutien.
Madame la ministre, mes chers collègues, je pense que nous avons mis en lumière les difficultés, les défaillances du système de protection sociale destiné aux étudiants. Nous savons dès lors le travail qu’il nous reste à accomplir et les pistes à explorer.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. Michel Le Scouarnec applaudit également.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens avant tout à remercier le groupe UMP, qui a suscité l’inscription de ce débat à l’ordre du jour de notre assemblée. Cette initiative nous donne l’occasion de poursuivre le travail effectué par nos collègues Catherine Procaccia et Ronan Kerdraon, près d’un an après la publication de leur rapport. Sous leur autorité, le groupe de travail sur la sécurité sociale et la santé des étudiants a organisé dix-sept auditions et quatre déplacements, qui ont permis de définir plusieurs pistes de réflexion intéressantes, parfois divergentes dans leurs conclusions.
À la suite de revendications de l’UNEF en faveur d’une plus grande autonomie et d’une reconnaissance du statut d’étudiant, la loi du 23 septembre 1948 a étendu aux étudiants le régime applicable aux salariés et en a prévu le service par une mutuelle. Il s’agissait à l’époque d’offrir à ces jeunes une protection sociale spécifique.
L’idée était généreuse. Pourtant, force est de constater que, plus d’un demi-siècle plus tard, le régime délégué de sécurité sociale étudiante est devenu inefficace et coûteux, comme l’ont montré les deux orateurs précédents. Cela nous impose de nous pencher très sérieusement sur le sujet.
Dès septembre 2012, l’UFC-Que Choisir – dont les affirmations sont parfois contestables par ailleurs – avait dressé un bilan accablant : les étudiants, dans leurs relations avec les mutuelles, sont confrontés à un incroyable parcours du combattant. Il leur est ainsi souvent difficile, voire impossible, de joindre un correspondant, les files d’attente devant les guichets sont interminables, les courriers de réclamation en attente de traitement s’accumulent et les remboursements des prestations prennent de plus en plus de retard. Plus grave encore, comme cela a été dit, un tiers des nouveaux inscrits attendent plus de trois mois leur carte Vitale, délai pendant lequel les étudiants ne bénéficient pas du tiers payant. Or nous savons bien que, chaque année, ils sont un peu plus nombreux à renoncer à des soins médicaux, faute d’argent. Cette situation n’est pas acceptable !
Ces dysfonctionnements sont aggravés par une concurrence entre la mutuelle nationale et les mutuelles régionales et une confusion volontaire, comme l’a souligné Catherine Procaccia, entre sécurité sociale et complémentaire santé. À chaque rentrée, les mutuelles se livrent une véritable bataille pour attirer un maximum d’étudiants auxquels elles espèrent surtout vendre une complémentaire santé, souvent 20 % à 30 % plus chère qu’une complémentaire classique. Les nouveaux inscrits ignorent d’ailleurs, pour la plupart, que les mutuelles étudiantes cumulent une délégation de service public et une activité d’assureur, et 37 % d’entre eux ne savent pas que les complémentaires santé sont facultatives.
Nous devons également nous référer à ce qu’écrit la Cour des comptes, qui s’est, elle aussi, saisie de ce dossier, comme on l’a déjà évoqué. Au-delà de l’insuffisance de la qualité de service et de la complexité de la gouvernance, elle pointe du doigt le surcoût faramineux du régime étudiant. Les mutuelles auraient ainsi dépensé, en 2011, 93 millions d’euros en frais de gestion pour remplir leur mission de sécurité sociale, ce qui représente près de 13 % du montant des prestations versées. Alors que l’ensemble des gestionnaires du régime général réduisent leurs frais de gestion, les remises de gestion versées par l’assurance maladie aux mutuelles étudiantes ont progressé de 8, 1 % entre 2006 et 2011. La CNAMTS leur a ainsi versé, en 2011 et 2012, 54, 77 euros par étudiant alors que les mutuelles de fonctionnaires n’ont perçu qu’une dotation équivalente à 44, 29 euros par affilié. L’enjeu financier est considérable !
Ces dysfonctionnements appellent nécessairement des réponses concrètes immédiates, comme l’indiquent les deux auteurs du rapport sénatorial. Nous sommes tous d’accord sur ce point : le statu quo n’est plus envisageable. La question qui se pose désormais est donc simple : quel avenir envisageons-nous pour la sécurité sociale étudiante ? À l’évidence, ce mode de gestion, défavorable aux étudiants et coûteux pour la collectivité, doit être reconsidéré. Faut-il conserver le régime délégué et le confier à une seule structure ? Personnellement, je ne suis pas favorable à cette solution.
La Cour des comptes préconise la reprise de la gestion de la population étudiante par les caisses d’assurance maladie. Cette solution aurait le mérite d’améliorer la qualité de service et permettrait une économie qui a été évaluée à 70 millions d’euros.
Madame la ministre, les travaux menés par Catherine Procaccia et Ronan Kerdraon ont démontré l’impérieuse nécessité de réformer le régime de sécurité sociale étudiante. La Cour des comptes a fait des recommandations. Quelles suites comptez-vous leur donner ? Parce que ce système est complexe, instable et peu compréhensible, parce qu’il remet en cause l’accès aux soins des étudiants, j’espère que vous donnerez l’élan nécessaire à l’amélioration de la situation.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, sans vouloir paraître grandiloquente ou politiquement incorrecte, il est évident que, sur ce dossier, il y a quelque chose à changer. La sécurité sociale, me disait un ancien étudiant, c’est Kafka !
Les étudiants sont trois fois moins couverts par une complémentaire santé que la moyenne de la population française : 19 % n’ont en effet pas de complémentaire santé, alors que la moyenne nationale se situe aux alentours de 6 %. Une fois ce constat fait, on doit impérativement s’interroger sur les raisons de l’exclusion des étudiants du dispositif de l’ACS, l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, alors qu’ils y sont éligibles et contribuent à son financement.
Pour rappel, comme cela a été dit, l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé consiste en une réduction forfaitaire du montant de la cotisation annuelle à payer à l’organisme auprès duquel est contractée la complémentaire santé. En pratique, la caisse primaire d’assurance maladie remet à l’assuré qui le demande et qui remplit les conditions d’éligibilité une attestation, un « chèque », qu’il fournit à l’organisme de son choix – mutuelle, assurance ou institution de prévoyance –, chèque dont le montant varie selon l’âge du bénéficiaire. L’organisme choisi déduit alors l’aide obtenue du montant de la cotisation.
Les étudiantes et les étudiants boursiers sont par définition éligibles à l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé puisque leurs revenus correspondent aux barèmes de l’ACS, laquelle est destinée aux foyers fiscaux dont les revenus n’excèdent pas 35 % du plafond de la CMU, soit 11 600 euros en 2013. Toutes et tous devraient donc en bénéficier, pour un montant de 200 euros par ans, comme c’est le cas pour les autres bénéficiaires âgés de seize à quarante-neuf ans. Cependant, ils en sont de facto exclus.
Trois verrous réglementaires cumulatifs engendrent un taux de recours quasi nul : l’obligation de justifier d’un logement indépendant, or 41 % des étudiants n’en disposent pas ; l’obligation de ne pas percevoir de pension alimentaire de la famille, or 73 % d’entre eux déclarent que l’aide familiale est leur première source de revenu ; l’obligation d’être indépendant fiscalement, or 82 % des étudiants ne le sont pas. Cumulées, ces conditions aboutissent au fait que, parmi les étudiants âgés de seize à vingt-neuf ans, seuls 1, 3 % d’entre eux pourraient en bénéficier.
Deux injustices inhérentes au système aggravent encore la situation.
Tout d’abord, le montant de la bourse sur critères sociaux entre dans l’assiette des revenus pris en compte pour l’instruction de la demande d’ACS. Obtenir une bourse réduit les chances d’obtenir l’ACS, parfois même pour la famille entière, ce qui est pour le moins paradoxal.
Ensuite, alors que les étudiants financent l’ACS par le biais de la taxe CMU par un prélèvement de 6, 27 % sur leur complémentaire santé affecté au fonds CMU, lequel est la seule source de financement de l’ACS, ils en sont exclus. Ils payent mais n’en profitent pas !
Pour toutes ces raisons, il est incompréhensible que l’ACS ne bénéficie pas aux étudiants boursiers. Selon nous, ouvrir cette possibilité constituerait un formidable levier de promotion de la santé pour les étudiants. Les interventions de nos collègues ont d’ailleurs montré à quel point cela est nécessaire. Une telle mesure favoriserait également l’autonomie en donnant aux étudiants les moyens de s’équiper d’une complémentaire santé propre et de mieux gérer leur santé. En outre, ce dispositif serait neutre pour les finances publiques.
Il est à relever – cela a été dit précédemment – que plusieurs initiatives ont été développées par des collectivités territoriales pour pallier les lacunes des dispositifs existants. Par exemple, la région Pays de la Loire a lancé à la rentrée de 2011 un « pass complémentaire santé », dont le montant peut s’élever jusqu’à 100 euros pour l’acquisition d’une première complémentaire. Au cours de l’année universitaire 2012-2013, 7 000 jeunes en ont bénéficié.
Pour simplifier encore l’accès aux droits sociaux, j’appelle l’attention sur le remarquable rapport remis par notre collègue Aline Archimbaud, dans lequel elle propose que la demande puisse se faire au moment où l’étudiant remplit en ligne le dossier social, c’est-à-dire en amont. Cette demande est en effet une démarche connue de la quasi-totalité des étudiants et des familles. Elle pallierait donc le manque de notoriété du dispositif ACS. On pourrait même imaginer une automaticité entre l’obtention d’une bourse sur critères sociaux et de l’ACS.
L’article 45 du projet de loi de financement de la sécurité sociale semble aller en ce sens en indiquant que « les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l’article L. 821-1 du code de l’éducation, déterminées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la sécurité sociale, peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire ». La question est de savoir quand cet arrêté interviendra et ce qu’il prévoira exactement, car nous n’avons à ce stade aucune certitude sur la portée de ce qui a été voté par nos collègues de l’Assemblée nationale. J’espère en tout cas qu’il ne s’agira pas finalement de n’ouvrir l’ACS qu’aux étudiants en « rupture familiale », dont le nombre ne s’élèverait qu’à 500 ou 1 000 chaque année, même si leur situation doit être prise particulièrement au sérieux. Malgré tout, cela constitue un signal encourageant, ne serait-ce que parce que c’est la première fois qu’un gouvernement reconnaît les difficultés des étudiants pour accéder à l’ACS et à la CMU complémentaire.
Un autre espoir réside dans les décrets relatifs à l’accord national interprofessionnel, qui sont en cours de rédaction, puisque l’ANI reconnaît que tout salarié doit avoir accès une complémentaire santé. Cependant, la plupart des emplois précaires vont a priori être exclus du champ d’application de ce texte. La majorité des étudiants qui ont un emploi « à côté » ne devraient donc pas être protégés à ce titre.
Un espoir est-il encore permis en la matière ? Bien sûr, cela induirait un changement significatif dans la structuration du système actuel concernant les étudiants. Cependant, la santé de nos étudiants n’est ni de gauche ni de droite ; c’est la santé « tout court ». Ce sujet ne doit pas nous diviser. Il faut aligner le régime des étudiants le plus possible sur le droit commun, les insérer dans une protection sociale inclusive et non exclusive, afin d’éviter les dérapages et les ratés qui ont pu être constatés au fil du temps. Il faut instaurer une vraie prévention pour nos étudiants.
Madame la ministre, les étudiants vous regardent. Ils comptent sur vous. Nous devons répondre à leur attente.
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, du groupe socialiste et du groupe CRC.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, permettez-moi avant toute chose de remercier et de féliciter très sincèrement Catherine Procaccia et Ronan Kerdraon, pour la qualité de leur rapport sur la sécurité sociale des étudiants, qui constitue la base de notre débat d’aujourd’hui.
Je ne reviendrai ni sur le mode de gestion spécifique des mutuelles étudiantes, au périmètre complexe et à la gouvernance insatisfaisante, ni sur la qualité de service globalement insuffisante, notamment en ce qui concerne les relations avec les assurés ou le remboursement des prestations ; ces difficultés ont été abordées par nos deux collègues et, bien entendu, je soutiens pleinement leurs propositions. Je centrerai principalement mon propos sur les coûts de gestion, comme l’ont fait Catherine Procaccia et Gilbert Barbier.
Après l’enquête de l’UFC-Que Choisir, publiée en 2012, qui avait suscité de nombreuses réactions de la part des mutuelles étudiantes dans nos territoires, et le rapport d’information de nos collègues, c’est la Cour des comptes qui, dans le rapport qu’elle a présenté en septembre dernier, a critiqué le système de sécurité sociale étudiante, qui est confronté à de profondes difficultés. Selon la Cour des comptes, les remises de gestion versées par la CNAMTS aux mutuelles étudiantes ont augmenté de plus de 8, 1 % de 2006 à 2011. De même, après prise en compte de l’évolution des effectifs, les frais de gestion unitaires des mutuelles étudiantes ont progressé entre 2005 et 2011 de 7, 2 %, alors que ceux de l’ensemble des caisses primaires ont augmenté de 5 %. En outre, les mutuelles étudiantes paraissent significativement moins productives que les caisses primaires en ce qui concerne les remboursements par assuré.
Si la plupart des mutuelles étudiantes ont, à l’image du réseau de l’assurance maladie, amélioré leur productivité entre 2007 et 2011 à la faveur de la dématérialisation croissante des feuilles de soins et par réduction de leurs effectifs, ce n’est cependant pas un cas général, comme le montrent les difficultés qu’a connues Vittavi dans un passé très récent. Quant à La Mutuelle des étudiants, elle connaît pour sa part un déséquilibre chronique.
Comme cela a été souligné, les mutuelles étudiantes ont dépensé 93 millions d’euros, en 2011, en frais de gestion pour remplir leur mission de sécurité sociale. Ce chiffre représente près de 14 % du montant des prestations versées, soit trois fois plus que l’assurance maladie. Ce mode de gestion déléguée doit donc, selon nous, être reconsidéré. Nos deux collègues auteurs du rapport ont présenté trois scénarios.
Le premier consisterait à conserver l’architecture actuelle d’un régime délégué à plusieurs structures. Un meilleur partage des tâches de gestion entre les mutuelles étudiantes et l’assurance maladie permettrait d’assurer la pérennité du système. Ainsi, les mutuelles pourraient garder leurs liens avec les étudiants en traitant l’accueil physique, les courriers et les réclamations. L’assurance maladie aurait la capacité de liquider les prestations, assurer les contrôles et la gestion des fraudes. Ce scénario demeure, à mes yeux, trop complexe.
Le deuxième scénario, qui consisterait à confier le régime délégué à une seule structure, fait débat dans notre assemblée. Nos deux collègues rapporteurs ont en effet une vision différente. Certes, la concurrence entre LMDE et les mutuelles régionales occasionne des frais commerciaux et de marketing. Le scénario ici proposé permettrait d’éviter cette concurrence, réduisant ainsi sans doute les coûts de fonctionnement. Cependant, selon moi, une fusion serait forcément mal perçue, car les mutuelles auraient le sentiment d’être mises sous la tutelle d’une autre mutuelle. Ce système me paraît injuste et, par conséquent, il n’a pas ma faveur.
Le dernier scénario consisterait à conserver l’affiliation de l’étudiant au régime dont il relève au moment de son inscription dans l’enseignement supérieur. Cette solution, que l’on pourrait qualifier de radicale, ferait disparaître la particularité d’un régime étudiant mais permettrait de réduire les coûts par la simplification des procédures.
Ce scénario a d’ailleurs été recommandé par la Cour des comptes : celle-ci a précisé que la reprise de la gestion de la population étudiante par les caisses d’assurance maladie entraînerait une économie de près de 70 millions d’euros.
À défaut, le scénario « mi-chèvre mi-chou », comme l’a dit Mme Procaccia, pourrait offrir une solution transitoire : il s’agirait de laisser aux étudiants le choix entre l’affiliation à la sécurité sociale étudiante et le maintien de leur rattachement au régime de leurs ascendants. Toutefois, chacun le sait, les régimes transitoires s’éternisent parfois…
J’ajoute que cette simplification résultant de la suppression de régimes spécifiques pourrait être étudiée pour des régimes autres que le régime étudiant, mais ce n’est pas l’objet du débat de ce soir.
Compte tenu des difficultés économiques que connaît notre pays, il me paraît nécessaire de reconsidérer la gestion déléguée de la sécurité sociale étudiante, devenue inefficace et coûteuse. Prenons en compte les différentes pistes proposées, car il y a des économies à réaliser.
Comme nombre de nos collègues, j’espère donc que cet excellent rapport ne restera pas lettre morte, madame la ministre. Des associations réclament déjà la mise en place d’une commission d’enquête sur le fonctionnement des mutuelles étudiantes. Sans en arriver là, le Gouvernement devrait, à mon sens, apporter rapidement des solutions concrètes au problème soulevé par nos collègues dans leur rapport.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la question de la sécurité sociale et de l’état de santé des étudiants est symptomatique de notre incapacité à faire suffisamment de prévention en France, et ce pour au moins deux raisons.
La première est que, toutes choses étant égales par ailleurs, la médecine préventive estudiantine est très insuffisamment développée.
La seconde, c’est qu’elle devrait être bien plus développée que toute autre, compte tenu des populations auxquelles elle s’adresse.
Cela fait bien longtemps, depuis la dernière loi de santé publique de 2004, que sur toutes les travées de cet hémicycle des voix s’élèvent pour un basculement fondamental de notre système de santé vers la prévention. Chacun le sait bien, ce système ne peut demeurer essentiellement curatif, comme il l’est aujourd’hui. Autrement dit, il nous faut réinjecter un peu d’Orient dans notre pratique médicale occidentale.
Traditionnellement, en Chine, le médecin n’est rémunéré que si son patient demeure en bonne santé... §D’où l’intérêt du thérapeute à le maintenir tel ! Cette sagesse-là, nous en sommes singulièrement éloignés.

Les gains du développement de la prévention en termes de santé publique sont considérables.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : dépister un cancer à ses premiers stades de développement décuple les chances de l’éradiquer. Les gains à attendre du développement de la prévention sont bien sûr aussi financiers. À l’heure où la soutenabilité des dépenses de santé pose chaque année question, il s’agit tout de même là d’une donnée à méditer.
Depuis 2004, il est vrai que certains dépistages se sont systématisés, en particulier dans le domaine des MST, les maladies sexuellement transmissibles, et du cancer, que je viens d’évoquer. Néanmoins, cela demeure encore très insuffisant ; c’est un changement beaucoup plus radical qu’il nous faut mettre en œuvre.
Notre système de santé doit pouvoir assurer le suivi global de tous les citoyens par-delà l’enfance. J’insiste sur cet aspect, parce que, à ce jour, seule la pédiatrie est une médecine autant préventive que curative. Elle constitue d’ailleurs un exemple à suivre.
Le développement de la prévention doit donc commencer dès l’autonomisation des jeunes vis-à-vis de leurs parents en matière de santé. Or, les étudiants représentant aujourd’hui 36 % de la population de dix-huit à vingt-cinq ans et n’ayant jamais été aussi nombreux, la politique de la santé estudiantine occupe naturellement une place stratégique au regard de cette problématique.
Développer la prévention en direction des étudiants, c’est développer l’éducation citoyenne à la santé et préparer des générations en meilleure santé.
Qu’en est-il aujourd’hui ? Je ne peux que m’en référer à l’excellent rapport de nos collègues, qui a inspiré le présent débat. Il montre que de gros progrès peuvent et doivent encore être réalisés en la matière.
Les services universitaires ou interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé manquent de tout. Ils manquent de moyens financiers et humains, bien sûr.
Ce phénomène a été accentué par le principe d’autonomie des universités, puisque, dorénavant, la dotation de l’État est versée aux universités de manière globale, sans qu’une partie soit fléchée sur les SUMPPS, les services universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé. Chaque université est donc libre de la ventiler comme bon lui semble, ce qui conduit à de fortes inégalités entre elles, donc entre étudiants.
Les personnels des SUMPPS manquent d’un statut homogène. Enfin, et c’est très important, ces services manquent de visibilité. Concrètement, bien peu d’étudiants en identifient l’action. Le résultat, c’est que seul un tiers des jeunes scolarisés en licence ont effectué leur visite médicale préventive. Ce seul chiffre devrait nous alarmer.
Le fond du problème est que les SUMPPS dépendent des universités, qui n’identifient pas la santé des étudiants comme une priorité ; d’où les propositions très intéressantes figurant dans ce rapport de rattacher ces services aux CROUS, les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, et d’étendre leur champ de compétence à tous les étudiants, y compris à ceux qui ne relèvent pas de l’université.
Nous pourrions penser que, puisque nous ne faisons pas suffisamment de préventif, nous sommes très performants en curatif. C’est là que le rapport est des plus instructifs, et aussi des plus inquiétants. Visiblement, les mutuelles étudiantes n’ont pas encore réussi leur mue. Après le scandale de la MNEF, la Mutuelle nationale des étudiants de France, on aurait pu espérer que ce soit le cas.
Pourtant, alors que ses auteurs se veulent des plus objectifs et mesurés, le rapport est accablant : complexité du système liée à la concurrence des organismes de base et complémentaires, aux conditions tarifaires et de prestations variables, aux mutations inter-régimes lorsque l’étudiant passe de celui de ses parents à sa mutuelle ; piètre qualité des prestations d’accueil et de suivi – un tiers des nouveaux étudiants serait encore sans carte Vitale trois mois après leur affiliation ; enfin, médiocrité de la couverture complémentaire – 10 % des étudiants n’en disposeraient pas et les contrats proposés ne seraient pas toujours adaptés pour la prise en charge de certains soins spécialisés. Autant de constats qui rejoignent les conclusions de l’enquête accablante réalisée par l’UFC-Que choisir en septembre 2012.
Nous pouvons nous demander si les mauvaises pratiques ont bien été abolies. C’est un fait historique, la MNEF, qui demeure la principale mutuelle étudiante, a été créée par l’UNEF, le syndicat étudiant du parti socialiste.
À la suite des dérives de gestion, la MNEF a fait peau neuve et laissé place à LMDE, La Mutuelle des étudiants, en 2000. Pour autant, la nouvelle organisation s’est-elle départie de toute dépendance politique ? Je veux bien le croire, mais les mauvaises performances qui perdurent nous interpellent, d’autant plus que le choix d’un système de mutuelles à la fois autonomes du régime général et concurrentes n’a rien d’une évidence !
C’est là encore un apport notable du rapport : dans la plupart des autres pays européens, les étudiants relèvent du régime général. Aucun autre pays n’a créé de régime spécifique pour les étudiants. Dans ce cas, pourquoi maintenir ce système ? La question mérite d’être posée.
En y répondant, nous trancherions entre les trois scénarios envisagés dans le rapport en optant pour le troisième, comme l’a rappelé à l’instant Mme Deroche : dorénavant, pourquoi ne pas affilier les étudiants en leur nom propre au régime de leurs parents ? Ainsi, disparaîtrait tout risque de captation politicienne. Coupons le mal à la racine ; c’est aussi une logique de prévention !
Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la situation sanitaire et sociale des étudiants est aujourd’hui préoccupante.
Plus de la moitié des jeunes vivent avec moins de 400 euros par mois, se situant en dessous du seuil de pauvreté. La crise économique, on le sait, touche particulièrement les jeunes et fragilise évidemment les étudiants, ce qui doit nous amener à une vigilance accrue.
Corollaire ou conséquence, les mesures de déremboursement qui se sont succédé concernant les médicaments ou la hausse du forfait hospitalier ont contribué à l’augmentation des frais de santé et alimenté la dégradation de la situation.
La précarité financière des étudiants conduit ainsi 34 % d’entre eux à renoncer à se soigner et à sacrifier leur santé au nom d’arguments économiques. Autre chiffre : 19 % des étudiants ne bénéficient d’aucune assurance complémentaire de santé, alors qu’ils sont trois fois plus nombreux que la population générale.
C’est donc un fait, les étudiants sont particulièrement fragilisés en termes d’accès aux soins ; ils méritent une attention toute particulière.
La France a créé un régime spécifique de sécurité sociale pour les étudiants par la loi du 23 septembre 1948, cela a été rappelé. Il s’agit d’un régime délégué, affilié au régime général de sécurité sociale et géré par des mutuelles étudiantes.
L’idée était de reconnaître l’autonomie des étudiants et de leur donner un droit à une prévoyance sociale particulière, au sein de laquelle ils sont représentés. Cette représentativité leur permet de participer et de décider directement de la gestion de ce régime, de valoriser les problématiques qui sont les leurs, dans leurs intérêts et la reconnaissance de leurs spécificités.
Nous partageons cette volonté d’autonomisation des étudiants. Nous militons en effet pour l’octroi d’une allocation d’autonomie pour les étudiants, qui leur permettrait de s’assumer entièrement, sans dépendre financièrement de leurs parents ni compromettre la réussite de leurs études par un travail étudiant.
Cependant, de ce principe louable ont découlé de grandes difficultés objectives de gestion de ce régime. Au nom de l’autonomie étudiante, on a créé un système extrêmement complexe et peu lisible, dont les étudiants sont finalement les premières victimes.
Le système actuel est loin d’être satisfaisant, les difficultés de gestion restant légion. C’est un constat que nous partageons tous, et rares sont ceux qui n’en ont pas fait l’expérience, pour eux-mêmes ou pour leurs enfants.

Les modalités d’affiliation sont extrêmement complexes et les situations nombreuses, ce qui nuit à la lisibilité du dispositif.
C’est d’autant plus vrai que ce secteur est géré par plusieurs acteurs mis en concurrence : mutuelle nationale ou mutuelle régionale s’affrontent sur la gestion du régime général, mais également sur les couvertures de santé complémentaires facultatives qu’elles proposent.
Le brouillage est également renforcé par le fait que, le régime étudiant étant un régime de transition entre l’affiliation au régime des parents et celui du futur régime professionnel, s’ensuivent des changements qui peuvent être extrêmement complexes et se traduire par de longues périodes sans affiliation ou sans carte de sécurité sociale.
Viennent enfin s’ajouter des problèmes dans la qualité du service rendu : longues files d’attentes, difficultés à contacter les mutuelles en cas de problèmes, etc. Comme ils ont été évoqués, je ne m’y étendrai pas.
Quelles réponses apporter face à ces difficultés objectives ? La question est délicate et ne doit pas, selon nous, conduire à des conclusions hâtives et des solutions radicales.
Elle devrait, en revanche, nous inciter à nous interroger plus longuement sur les moyens dont disposent ces mutuelles pour mener à bien leur service : sont-ils réellement suffisants pour faire face à la complexité et la diversité des situations ? Ce qui est certain, c’est qu’un équilibre doit être trouvé entre la préservation d’un régime de sécurité sociale général et la reconnaissance légitime de l’autonomie étudiante.
Nous pensons en réalité que le maintien d’une sécurité sociale unifiée avec représentation de tous les acteurs concernés au sein des instances du régime général aurait été la meilleure solution. Les régimes délégués sont autant de régimes particuliers qui, in fine, affaiblissent le régime général de la sécurité sociale au détriment des affiliés, en l’occurrence les étudiants.
Cependant, ce n’est pas dans la réforme des mutuelles étudiantes et la suppression du régime délégué que se situe à notre sens l’enjeu d’une réforme en matière de santé étudiante. Si réforme il doit y avoir, c’est une réforme globale de la sécurité sociale en général, notamment en ce qui concerne les élections des administrateurs qui, je le rappelle, n’ont pas eu lieu depuis dix-sept ans !
Les dysfonctionnements du système de sécurité sociale étudiante, sans être occultés, ne sont finalement que secondaires. Ils ne sont que les symptômes d’une maladie, et non son origine. Ils sont la traduction matérielle de l’absence d’une véritable politique de prévention et d’accès aux soins pour les étudiants, que la réduction des moyens budgétaires pour 2014 va encore accentuer.
Outre une revalorisation urgente des moyens, il faut adopter sans plus tarder des mesures d’exonération de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance, ou TSCA, …

… au moins pour les étudiants, afin de ne pas aggraver la situation des jeunes face à la santé. Nous avons défendu cette disposition lors des débats relatifs au dernier projet de loi de finances. Le Sénat l’a adoptée, mais elle est restée sans suite à l’Assemblée nationale, ce que nous ne pouvons que regretter.
Enfin, des mesures de simplification des conditions d’accès à la CMU et à l’aide pour une complémentaire de santé, dont les étudiants précaires sont exclus, doivent permettre à chaque étudiant boursier de bénéficier de ces dispositifs. À nos yeux, il s’agit de mesures bien plus fondamentales que la réforme du régime de sécurité sociale étudiante.
Mes chers collègues, telles sont selon nous les priorités pour la santé étudiante, parce que la jeunesse est le moment privilégié où se forgent les habitudes en matière de santé, pour toute la vie. §

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, tout d'abord, je tiens à saluer le travail accompli l’an passé au Sénat, au sein de la commission des affaires sociales, au sujet de la sécurité sociale et de la santé des étudiants. Je songe en particulier à Catherine Procaccia et Ronan Kerdraon, les corapporteurs de cette étude, qui viennent de nous en présenter les principales conclusions.
Un état des lieux circonstancié a été dressé. Des propositions ont été formulées – pour les court et moyen termes – en vue d’améliorer l’accès de tous les étudiants à une couverture sociale de qualité. Des pistes ont été avancées pour renforcer, globalement, l’accompagnement des étudiants dans leurs parcours de soins, en particulier concernant la politique de prévention.
De fait, si, au moment des études, la population étudiante est majoritairement en bonne santé, des constats spécifiques doivent retenir notre attention.
D’une part, le renoncement aux soins touche davantage les étudiants que le reste de la population. Un tiers des quelque 2, 4 millions d’étudiants que compte notre pays est concerné. C’est là une proportion très élevée. Parmi les facteurs explicatifs figurent le manque de temps, l’automédication et les difficultés financières, plus particulièrement lorsqu’il s’agit de se rendre chez certains spécialistes, chez qui le reste à charge est plus substantiel.
D’autre part, les conduites à risques et les comportements addictifs, ainsi que les pathologies particulières comme le stress ou les fragilités psychologiques, semblent aller croissant à mesure que l’étudiant progresse dans son cursus. Les résultats de la nouvelle étude menée par l’Observatoire de la vie étudiante devraient être rendus publics mardi prochain. Il faudra leur prêter toute l’attention qu’ils méritent.
Comment tenir compte de ces spécificités, liées à une période charnière de la vie ?
Le régime délégué d’assurance maladie, qui est spécifiquement dédié aux étudiants, a peu évolué depuis sa création. Son fonctionnement est aujourd’hui d’une grande complexité, et il semble de plus en plus difficile d’atteindre un niveau de prestations satisfaisant : s’accumulent de fréquents retards dans les remboursements ou dans la délivrance de la carte vitale, ainsi que les lourdeurs administratives ou de gestion.
Pour diverses raisons qui ont déjà été exposées, notre système s’essouffle et s’écarte ainsi de sa mission de service public. Il impose aux étudiants un parcours du combattant qui peut les éloigner un peu plus encore d’un parcours de soins adapté.
Certes, les besoins des étudiants en matière de santé sont globalement plus faibles que pour le reste de la population. Toutefois, les habitudes prises à cet âge sont déterminantes pour la suite.

Par conséquent, il est de notre responsabilité de renforcer leur accompagnement, ce qui nécessite d’améliorer et de simplifier le système de protection sociale en tant que tel, pour le rendre plus accessible. Globalement, il faut donner une meilleure visibilité aux politiques de santé mises en œuvre à destination des jeunes.
Alors qu’elles font aujourd’hui défaut, les études statistiques doivent être encouragées, pour mieux appréhender l’évolution des besoins des étudiants en matière de santé et de prévention. À ce titre, j’ai pris connaissance d’une vaste enquête récemment engagée par les universités de Bordeaux III et de Versailles, en partenariat avec l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, l’INSERM. Cette étude tend à étudier la santé d’un panel d’étudiants pendant une durée de dix ans.
Le rapport présenté au Sénat il y a un an présente un grand nombre de scénarios et de propositions, dont certaines concernent directement les lieux d’enseignement, les établissements d’enseignement supérieur ou les structures rattachées, en les identifiant à juste titre comme des lieux d’accompagnement, de prévention et d’information privilégiés. Les vies scolaire et étudiante constituent en effet des phases d’apprentissage, qui permettent aux jeunes d’acquérir certains réflexes et certaines bonnes pratiques.
Par ailleurs, la santé scolaire figure au rang des apports significatifs du groupe socialiste du Sénat au titre de la loi pour la refondation de l’école de la République, puisque nous avons contribué à y introduire la notion de parcours de santé.

Madame la ministre, cette démarche répond à l’ambition forte qui nous anime pour l’enseignement supérieur et en particulier pour l’université, que vous avez traduite au cœur du projet de loi adopté par le Parlement.
Parallèlement, le plan national pour la vie étudiante garantira, d’ici à la fin de 2014, l’ouverture d’une trentaine de centres de santé universitaires. Ces établissements devront jouer un rôle d’échange d’informations concernant les soins, l’offre par les praticiens et les droits existant en matière de protection sociale, tout en accentuant la lisibilité des actions menées en matière de santé, notamment sur le front de la prévention. C’est tout l’enjeu du travail qui nous attend !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, au cours des quelques minutes qui me sont imparties, je tâcherai d’être le moins redondant possible et de compléter les éclairages qui viennent de nous être apportés.
Avant tout, je tiens à remercier ceux qui nous font rêver aujourd’hui, en suggérant des modifications législatives au sujet de la santé étudiante. Je songe en particulier à Catherine Procaccia et à Ronan Kerdraon, qui ont rédigé un rapport extrêmement important. La vie de nos étudiants, c’est celle de la France tout entière, c’est l’avenir, c’est donc un enjeu tout à fait déterminant !
Pour ce qui me concerne, j’ai pris part à quelques auditions
M. Ronan Kerdraon acquiesce.

, très modestement. J’ai ainsi eu l’occasion de mesurer la complexité du système, non sans me remémorer certains souvenirs d’étudiant !
Sourires.

Nos jeunes découvrent véritablement la vie lorsqu’ils veulent s’affilier à une « mutuelle ». Je note d’emblée que ce terme un peu particulier prête à confusion : il peut conduire à confondre les régimes obligatoire et complémentaire, alors que les étudiants disposent, par définition, d’une couverture sociale universelle. En toute logique, la phase d’études n’est que transitoire, et les étudiants sont appelés à retrouver, par la suite, le régime commun.
La procédure d’affiliation présente également une grande complexité. Du reste, les précédents orateurs l’ont déjà souligné, l’affiliation ne correspond pas à la date effective du début des études. Il ne me semble pourtant pas très compliqué de prendre les dispositions permettant d’éviter ce mois de décalage !
Mme la ministre acquiesce.

Madame la ministre, avec ce seul acte symbolique, mais ô combien important pour la vie de nos étudiants, vous avez la possibilité de marquer la législature.

Le dispositif serait ainsi mieux en phase avec la réalité temporelle qui constitue la vie de tous les jours.
Encore ne parlons-nous ici que du volet « prévention ». Pour le reste, espérons que nos pauvres étudiants ne tombent pas malades ! Dans cette hypothèse, ils devront de nouveau subir un parcours du combattant, notamment pour obtenir un remboursement. Je n’insisterai pas sur ce point, qui a été largement évoqué. Il n’empêche que, compte tenu des difficultés financières auxquelles ils se heurtent souvent, les étudiants voient leur situation se compliquer terriblement en cas de maladie. Si les remboursements ne suivent pas, leurs difficultés budgétaires s’accumulent. C’est la raison pour laquelle ils ne sont pas incités à se soigner.
Restons attentifs à ce problème. Il n’est pas normal que le système ne soit pas encore dématérialisé, que la carte vitale tarde à venir. Dans ce domaine aussi, des avancées relativement faciles peuvent être réalisées !
J’insisterai davantage sur la prévention. On ne le répétera jamais assez : pour faire de la prévention médicale, il faut des médecins ! On le rabâche depuis un certain temps, il faut élargir significativement le numerus clausus. Il faut former des praticiens aux nouveaux métiers de préventionnistes. La prévention est un métier : elle doit être ciblée, elle exige des compétences spécifiques, soumises aux innovations médicales. Il s’agit là d'ailleurs de fonctions tout à fait intéressantes. Mais encore faut-il former suffisamment de médecins dans ce domaine !
On le sait, dans le milieu étudiant, plusieurs réflexes de prévention spécifiques devraient être acquis. Je songe aux conduites addictives. Toute une part de la société française est victime de ces mauvaises pratiques, au sein de laquelle notre jeunesse figure en première ligne. Je songe également à la fragilité psychologique, qu’il ne faut pas négliger, notamment en période de crise sociétale, et, partant, à la prévention des suicides.

Je songe à la vaccination. Ce sujet a déjà été abordé : c’est véritablement à cet âge qu’il faut enseigner aux étudiants un certain nombre de réflexes préventifs, notamment à titre médical. Enfin, je songe au dépistage de certaines maladies, comme le sida.
Aussi la prévention revêt-elle une importance capitale. Il faut moderniser notre système de santé, mieux l’organiser et mieux le profiler. Cibler notre politique de prévention permettrait d’obtenir des résultats immédiats. A contrario, sans ciblage, les mesures mises en œuvre resteront inutiles !
Comment répondre, par exemple, au phénomène du binge drinking, cette calamité qui accable la population estudiantine ? Plutôt que d’adopter des mesures préventives, les pouvoirs publics songent à instaurer une fiscalité comportementale frappant les substances absorbées par nos jeunes. Or, à mon sens, nous avons bel et bien des actions à mener sur le front de la prévention.
Mes chers collègues, je conclurai brièvement, pour éviter toute répétition. Je souscris totalement aux propositions qui ont été formulées.
Il faut uniformiser les systèmes existants. Il faut aussi favoriser la reconnaissance du handicap, en améliorant les liens avec les maisons départementales des personnes handicapées, les MDPH. Cette préconisation n’est tout de même pas très difficile à appliquer, et elle permettrait de répondre aux problèmes de handicap que subissent nos étudiants.
En outre, je le dis sans la moindre ambiguïté : supprimons le régime délégué ! C’est là une proposition concrète. Pour éviter toute confusion avec les régimes complémentaires, il ne faut plus qualifier ces dispositifs de « mutuelles ».
De surcroît, madame la ministre, je me permets d’insister sur ce point, il faut former un plus grand nombre de médecins. Je compte sur vous pour transmettre ce message à votre collègue Marisol Touraine, ministre de la santé. Il s’agit là d’un enjeu essentiel !

Mme Catherine Procaccia. La formation des médecins est du ressort de Mme Fioraso, mon cher collègue !
Sourires.

M. René-Paul Savary. C’est vrai, et je prie Mme la ministre de bien vouloir m’excuser. Nous sommes face à un sujet interministériel !
Mme Catherine Procaccia opine.

Au surplus, il faut former des médecins préventionnistes selon les méthodes modernes de prévention. Demain, la médecine prédictive, qui se fonde sur les prédispositions génétiques, permettra de mieux prendre en compte l’ensemble de ces problèmes.
Enfin, j’insisterai sur la précarité que subissent nos étudiants. Certains d’entre eux souhaiteraient exercer un travail à temps partiel.

Or la fiscalité en vigueur décourage ceux qui veulent mener de front un travail et des études. Peut-être faudrait-il revoir ce dispositif, pour lutter efficacement contre la précarité et, ainsi, permettre aux étudiants d’assumer plus facilement leurs dépenses de santé. Je salue à cet égard les propos de Ronan Kerdraon. Un statut social des étudiants apporterait une pierre à notre édifice de protection sociale. Il permettrait de mieux répondre aux préoccupations des mutuelles étudiantes.
Enfin, si le Gouvernement ne peut répondre aux propositions que nous formulons ce soir à son intention, sans doute une mission d’information parlementaire pourra-t-elle l’épauler dans sa tâche !
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, étant la dernière oratrice à m’exprimer dans ce débat, je crains de ne pas avoir grand-chose de nouveau à vous dire. J’ai donc retiré quelques passages du texte de mon intervention. Je commencerai en félicitant les rapporteurs, qui ont réalisé un travail important, bien documenté et précieux pour nous tous.
En 2011, selon une étude menée par La Mutuelle des étudiants, LMDE, sur un échantillon représentatif de près de 8 500 étudiants, 19 % d’entre eux ne bénéficiaient pas de complémentaire de santé, soit 6 points de plus qu’en 2005.
Sachant que la sécurité sociale ne rembourse plus que 55 % des soins courants, en moyenne, on mesure aisément les grandes difficultés financières auxquelles se heurtent un certain nombre d’étudiants dans la prise en charge des actes de soin !
Comme le souligne le rapport, « les renoncements risquent d’être d’autant plus importants pour les soins dentaires, d’optique ou de gynécologie ». En effet, LMDE précise que « les consultations gynécologiques, en particulier pour la demande de contraceptifs, occupent une place importante dans l’activité de soins des SUMPPS ». Je vous rappelle, mes chers collègues, que certaines régions ont mis en place des dispositifs de type « pass contraception ».
Vous indiquez, à juste titre, que si les étudiants sont dans leur très grande majorité en bonne santé, l’appréciation qu’ils portent sur leur bien-être est plus nuancée. Cet aspect est capital. Une attention particulière doit ainsi être portée à la fragilité psychologique, au développement des conduites à risque ou des comportements addictifs et aux rappels de vaccination.
La publication du nouveau volume de l’Observatoire de la vie étudiante est imminente, mais le précédent livrait des chiffres inquiétants : 30 % des étudiants sont déprimés et 26 % se sentent seuls et isolés. Or, cela semble une évidence, un étudiant en bonne santé a plus de chance de réussir son orientation, son parcours universitaire et donc son entrée dans le monde du travail.
Vous avez en outre évoqué, madame Procaccia, la question de l’accès aux soins des étudiants les plus défavorisés, qui est devenu très compliqué. De vrais risques sanitaires existent : des maladies oubliées réapparaissent et les cas de gale, de tuberculose ou de rougeole se multiplient.
Concernant la rougeole, un virus hautement contagieux et potentiellement grave pour les adultes, l’augmentation du nombre de cas depuis cinq ans est particulièrement préoccupante. La corrélation de ce mouvement avec l’insuffisance des couvertures vaccinales dans un environnement sanitaire déficient est évidente. Des phénomènes similaires ont été constatés en Grande-Bretagne ou en Allemagne.
De plus, on observe que certains des étudiants étrangers sur notre territoire se trouvent dans une situation particulière de fragilité et sont confrontés à des difficultés financières, à l’isolement et à la complexité des démarches administratives.
Votre rapport suggère d’améliorer leurs conditions d’accueil, notamment en « simplifiant leur parcours administratif une fois leur visa accordé ». Cette heureuse initiative permettrait à ces jeunes, qui nous font l’honneur d’étudier dans notre pays, de rencontrer, notamment, plus facilement le personnel de santé.
Je me félicite que l’un des objectifs affichés du Gouvernement dans son budget pour 2014 concernant l’enseignement supérieur et la recherche soit de développer la prévention. Le programme 231, « Vie étudiante », est en effet en hausse de plus de 6 %.
L’objectif est d’assurer un meilleur suivi sanitaire de la population étudiante, de garantir l’accès aux soins pour tous en renforçant le partenariat avec les mutuelles étudiantes, les différents acteurs de la santé et les associations étudiantes et, ainsi, de répondre aux urgences médicales.
Renforcer les programmes de prévention est un objectif important, compte tenu de cette situation typiquement française dans laquelle le préventif se voit accorder 3 % du budget, quand le curatif en reçoit 97 % ! L’éducation à la santé doit permettre d’acquérir les bases et les bonnes habitudes afin de préserver sa qualité de vie en adoptant les bonnes pratiques.
Mme Françoise Cartron a évoqué tout à l'heure ce que nous avons adopté au Sénat et inscrit dans la loi de refondation de l’école : le fameux parcours de santé des élèves du premier et du second degré. La continuité doit être assurée dans le supérieur. Demeure bien sûr le problème de la démographie médicale et du statut des médecins qui s’investissent dans notre système scolaire.
Les conventions entre les ARS et les SUMPPS ont également été évoquées. Malheureusement, elles existent dans les textes mais n’ont pas encore été mises en application dans tous les territoires. Il s’agit là d’un point important, et j’invite ceux d’entre nous qui sont membres d’ARS, c'est-à-dire d’agences régionales de santé, à rappeler systématiquement qu’il est nécessaire de les signer.

Même si, aujourd’hui, des actions de prévention sont menées, elles sont « éparpillées et difficiles à évaluer ».
Il est donc urgent de favoriser le pilotage de la politique de santé. J’avais proposé un amendement au projet de loi sur l’enseignement supérieur et la recherche, qui avait été adopté par le Sénat en commission et en séance publique mais qui a péri, avec l’article 57 ter dans son entier, lors de la commission mixte paritaire. Il s’agissait d’insérer la rédaction suivante : « Le réseau des œuvres universitaires assure une mission d’information et d’éducation pour la santé des étudiants. »
Sourires sur les travées du groupe CRC.

En effet, l’action importante des mutuelles étudiantes dans ce domaine, les implications étroites, en bonne intelligence, des travailleurs sociaux du CROUS ou des universités, sont fondamentales pour la santé des étudiants.
Hélas, cet amendement n’a pas été conservé, alors même qu’il n’était pas incompatible, à mon sens, avec les préconisations de ce rapport.
Dans un tel contexte, un engagement politique fort est nécessaire pour améliorer la situation.

Mme Maryvonne Blondin. Nous aspirons tous, en effet, à réaliser la maxime : « Un esprit sain dans un corps sain » !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je veux tout d’abord vous remercier d’avoir pris l’initiative d’organiser ce débat sur la santé et la sécurité sociale des étudiants. Il n’est pas si fréquent, en effet, que la représentation nationale s’intéresse à la vie des étudiants, qui pourtant, comme bon nombre d’entre vous l’ont dit, représentent notre avenir et constituent donc un enjeu très important pour le pays.
Je veux également féliciter les deux auteurs de ce rapport, Mme Catherine Procaccia et M. Ronan Kerdraon, de la qualité de ce document. Un an après sa publication, il reste d’actualité, ainsi qu’ils l’ont eux-mêmes souligné.
Le redressement de notre pays passe obligatoirement par une recherche et un enseignement supérieur dynamiques, et de qualité. Au travers de la loi du 22 juillet 2013 sur l’enseignement supérieur et la recherche, la réussite des étudiants et l’amélioration de leurs conditions de vie ont été placées au cœur des priorités. Le Gouvernement a saisi à bras-le-corps la question des conditions de vie des étudiants.
Comment viser l’obtention d’un diplôme, en effet, lorsque l’on ne peut pas se loger correctement ou lorsque le loyer représente jusqu’à 70 % d’un budget, comme c’est trop souvent le cas en région parisienne ? Comment réussir sa formation quand une pauvreté grave et durable empêche de se concentrer, quand on est amené à travailler plus de quinze heures par semaine, compromettant ainsi ses chances de réussite aux contrôles et examens, ou encore quand on ne se nourrit ni régulièrement ni correctement ?
Mme Geneviève Fioraso, ministre. Entre 2012 et le projet de loi de finances pour 2014, le budget consacré aux bourses sur critères sociaux aura augmenté de 457 millions d’euros. Cet effort considérable – historique, même, selon un mouvement étudiant qui n’est pas affilié, ce dont je serai pourtant parfois heureuse
Sourires.
Ce geste vient relancer la démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur, qui avait fortement régressé, et, surtout, il vise à combattre les causes sociales de l’échec à l’université.
La création d’un échelon 0 bis permet dès cette année à plus de 55 000 boursiers de recevoir une aide de 100 euros par moins, grâce à laquelle leurs chances de réussite vont s’accroître de près de 10 %. La création d’un échelon 7, dont bénéficieront plus de 30 000 boursiers particulièrement défavorisés, confère à ses bénéficiaires un niveau de ressources propice à la concentration sur leur formation, avec 550 euros par mois.
Le budget des aides individuelles annuelles a été augmenté de 4, 5 millions d’euros pour permettre, au total, à 7 000 étudiants indépendants de leur famille, ou en rupture familiale, d’étudier dans des conditions plus satisfaisantes.
Quant à la santé des étudiants, le sujet de notre débat de ce soir, elle a également fait l’objet de plusieurs décisions ambitieuses, fondées sur une analyse sans concession. Nous avions d’ailleurs eu l’occasion d’aborder ces points lors de l’examen au Sénat du projet de loi sur l’enseignement supérieur et la recherche.
Dès le mois de septembre 2012, j’ai encouragé l’ouverture de centres universitaires de santé, les fameux SUMPPS, fixant l’objectif à trente centres d’ici à la rentrée 2014. Dix-neuf sont aujourd’hui ouverts, et cinq sont presque terminés. Nous profiterons de ce processus pour changer le nom de ces services : cela semble anecdotique, mais un beau logo « Campus santé » serait sans doute plus attrayant et visible que ce SUMPPS, voire parfois SIUMPPS, difficile à prononcer comme à identifier.
Cet objectif sera tenu et l’accès aux soins des étudiants en sera amélioré. Ces centres permettent, sur les campus, la prise en charge des patients et la réalisation de premières prescriptions. Ils facilitent leur orientation dans le réseau de soins. En matière de santé, aussi, l’inscription des établissements dans leur écosystème est une évidence qu’il est absolument temps de réaliser, vous l’avez tous dit.
J’ai aussi obtenu une hausse des ressources de la médecine préventive universitaire. La contribution des étudiants est passée de 4, 57 euros à 5, 10 euros cette année, dégageant d’importantes marges nouvelles pour renouveler les services et les actions de prévention.
Je vous rappelle enfin deux mesures qui pourraient être proposées par le Gouvernement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, porté par ma collègue Marisol Touraine – je vous prie de bien vouloir l’excuser, car elle était retenue ce soir de façon impérative – afin d’améliorer la couverture sociale des étudiants, particulièrement des moins favorisés d’entre eux : premièrement, l’accès automatique des 7 000 étudiants en rupture familiale à une allocation individuelle annuelle et à la couverture médicale universelle complémentaire, ou CMUC ; deuxièmement, l’arrêt de la prise en compte des bourses étudiantes dans l’évaluation des ressources des demandeurs de CMUC ou d’une aide complémentaire santé.
Un deuxième effort pourrait répondre à la proposition de Corinne Bouchoux en faisant en sorte de systématiser, dès l’année prochaine, l’aide complémentaire santé au moment de la demande de bourse sur critères sociaux, ce qui simplifierait les choses et systématiserait le processus.
Beaucoup reste à faire, bien sûr. Avec ma collègue Marisol Touraine, nous travaillons à définir de nouvelles politiques plus systématiques, en matière d’accès aux soins, en particulier en matière d’odontologie, d’ophtalmologie, de gynécologie ou de santé mentale, c'est-à-dire dans les domaines susceptibles de détériorer de manière irréversible la santé des jeunes, mais également en ce qui concerne le renouvellement de la prévention.
J’ai à l’esprit le regain de l’usage du tabac chez les jeunes, ou ces alcoolisations rapides et brutales que l’on déplore trop souvent, et pas seulement dans les périodes dites « d’intégration ». Ces dernières ne portent plus le nom de « bizutage », mais elles sont encore l’occasion de violences absolument inacceptables, ainsi que nous l’avons vu récemment, qui ne se produisent pas nécessairement dans les établissements accueillant les enfants des milieux les plus populaires d'ailleurs. Nous devons mettre fin à ces actes barbares.
Nous souhaitons également encourager le pilotage des actions de santé par les établissements d’enseignement supérieur, même si, je le rappelle, l’autonomie ne favorisera pas des traitements différenciés selon les lieux. En effet, nous voulons intégrer dans les contrats de sites entre le ministère et les pôles universitaires les plans santé opérés dans ces sites. Ces dispositions seront précisées dans un plan national pour la santé des étudiants que je présenterai au printemps.
Je veux remercier les sénateurs qui ont participé au débat sur la loi sur l’enseignement supérieur et la recherche et dont les contributions relatives à la santé, de niveau législatif ou non, éclairent utilement les politiques en cours d’engagement. Ainsi que l’a fait remarquer Catherine Procaccia, certains de leurs amendements ont été intégrés au texte qui a été adopté.
Je remercie Françoise Cartron d’avoir salué le projet i.Share suivi par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’INSERM, c'est-à-dire l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, et l’université de Bordeaux, un projet de cohorte important, avec un financement de 9 millions d’euros au titre du programme des investissements d’avenir, et qui nous permettra d’améliorer la prévention.
D’ailleurs, la prévention n’est pas l’apanage des seuls médecins. Elle fait partie – je réponds là à une remarque de M. René-Paul Savary – des nouveaux métiers de santé sur lesquels nous menons actuellement une réflexion.
J’en viens maintenant au régime étudiant de sécurité sociale. Nous en sommes tous d’accord, les étudiants ont droit à une assurance maladie efficace. Toutefois, de nombreux problèmes, connus de tous, se posent : ils sont hétérogènes, comme l’a démontré le débat. Rétablir la clarté est donc la première des exigences.
La priorité est de rendre efficace le service apporté aux étudiants. C’est cet objectif simple que s’est assigné le Gouvernement. Cette attitude pragmatique est le fondement de notre action.
Je dirai un mot sur la situation des étudiants face aux problèmes de santé. Vous avez tous évoqué l’inégalité d’accès aux soins selon les origines sociale et territoriale des étudiants. Cette situation est réelle : les chiffres le montrent, même s’il faut les manipuler avec vigilance ; ils diffèrent en effet selon les sources, et je vous laisse deviner, mesdames, messieurs les sénateurs, lesquels, de ceux des mutuelles ou de l’Observatoire national de la vie étudiante, sont les plus inquiétants.
En moyenne, de 10 % à 20 % des étudiants – la disparité des chiffres explique cette fourchette – ne bénéficieraient pas d’une complémentaire santé. La proportion est de 40 % pour les étudiants dont les parents ont un revenu mensuel inférieur à 1 500 euros, contre 28 % – c’est encore trop ! – pour les autres.
Comme vous l’avez également souligné, les étudiants étrangers rencontrent, de leur côté, davantage de difficultés que les autres, sans compter les tracasseries administratives auxquelles ils doivent faire face. La liste des papiers qu’ils doivent fournir est totalement décourageante pour un adulte ; imaginez alors pour un jeune ! Ces étudiants sont donc confrontés à des obstacles importants pour ce qui concerne tant l’adhésion à une mutuelle que le remboursement des soins.
Face à cet état de fait, la situation des mutuelles, est, comme vous l’avez tous relevé, complexe – c’est un euphémisme.
Concrètement, ainsi que cela a été longuement rappelé au cours du débat, LMDE, La Mutuelle des étudiants, s’est trouvée, voilà quelques mois, confrontée à une situation très difficile : elle n’a plus été capable de traiter les courriers reçus dans des délais acceptables et les étudiants affiliés ne pouvaient plus joindre par téléphone le correspondant de leur mutuelle.
La Mutuelle générale de l’éducation nationale, la MGEN, s’est engagée à approfondir son partenariat avec La Mutuelle des étudiants. Un protocole a été signé. Les premières mesures d’urgence ont permis de sortir de cette situation de blocage, qui a mis les étudiants dans l’embarras.
Ainsi, le stock de courriers non traités a été fortement réduit et le service aux étudiants s’est globalement amélioré. La Direction générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle, qui est l’une des deux grandes directions du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, m’a signalé une nette décrue du nombre de courriers de réclamation qui lui parvenaient régulièrement.
L’accord entre LMDE et la MGEN n’est pas encore totalement finalisé. Je connais les points de tension qui existent entre les deux parties – je sais qu’elles accordent une vigilance toute particulière à certains sujets –, ainsi qu’avec l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la direction de la sécurité sociale, qui dialoguent intensément en vue de trouver des solutions sûres, fiables et durables. J’encourage chaque acteur à faire preuve d’un esprit constructif, imaginatif et rigoureux, parce que nous ne pouvons pas décevoir les étudiants.
L’amélioration incontestable du service, même si une marge importante de progression demeure, ne clôt pas le débat. Des questions plus structurelles sont posées, que vous avez rappelées dans vos interventions et que je commenterai brièvement, après avoir salué très sincèrement, encore une fois, la qualité du rapport d’information réalisé par Catherine Procaccia et Ronan Kerdraon.
Je n’apporterai pas de réponses trop catégoriques aux questions posées, car le Gouvernement attend dans les toutes prochaines semaines, dans le cadre de la modernisation de l’action publique, deux rapports, réalisés par l’IGAS, l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGF, l’Inspection générale des finances, et l’IGAENR, l’Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, qui viendront éclairer les évolutions possibles.
En effet, à ma demande, un rapport portera sur la gestion de l’assurance maladie des étudiants, tandis que l’autre concernera la santé de ceux-ci. Le Parlement a vocation à en avoir connaissance, comme tous les documents publiés dans ce cadre.
Permettez-moi d’en venir à quelques-unes des questions structurelles posées. Je souligne, tout comme vous, le choix original opéré, en 1948, par notre pays, en créant ce régime délégué, que l’on ne retrouve pas ailleurs en Europe et qui fait aussi partie, madame, monsieur le sénateur, de l’étude que vous avez réalisée.
On connaît les arguments – je le répète, ils ne sont pas partisans – qui ont motivé la création de ce régime, et qui ont tout leur mérite : encourager la responsabilité des étudiants, prévoir une gestion démocratique, avec des conseils d’administration de pairs désignés par la voie de l’élection, conforter, ce faisant, la capacité de prévention par les jeunes eux-mêmes sont des intentions absolument louables.
Je pense, par exemple, à la prévention de la transmission du virus HIV, avec l’initiative conjointe de Sidaction, du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, du ministère de l’éducation nationale et du ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Ces acteurs ont lancé auprès des lycéens et des étudiants, dans le cadre de la campagne de lutte contre le sida, un concours pour réaliser des vidéos avec des téléphones portables. Je crois à l’efficacité des campagnes de prévention réalisées par les jeunes eux-mêmes et pour les jeunes : grâce à un langage commun, l’approche est beaucoup plus prescriptive que les campagnes plus institutionnelles, même si, je rassure là les orateurs qui s’en sont inquiétés, nous devons tout de même en réaliser.
Dans le même temps, se posent, en termes d’organisation du système, des questions difficiles en ce qui concerne l’articulation entre le régime étudiant et le régime général.
Comment expliquer correctement cette organisation complexe aux jeunes ? À quel moment le faire ? Au lycée, à l’entrée de l’université ? Par quel canal le faire, par celui des mutuelles délégataires ou plutôt par une voie institutionnelle plus neutre et, dirai-je, plus dépassionnée ?
Compte tenu de la complexité de la question de l’assurance maladie et de l’existence de plusieurs régimes spéciaux – chacun avec des particularités –, comment éviter que les jeunes et les familles ne se perdent dans des propositions compliquées et obscures ? Par exemple, à quel âge et dans quelles conditions les étudiants concernés dépendront-ils de l’un ou de l’autre régime de sécurité sociale ?
Avant d’assister à ce débat, les membres de mon cabinet ministériel et moi-même nous sommes demandé à quel régime étaient affiliés nos enfants étudiants... Je dois dire que nous avons tous été bien en peine de répondre à cette question. Cela prouve que nous vivons nous aussi cette complexité.
En tout état de cause, comment faciliter des mutations inter-régimes trop lentes et parfois chaotiques, qui font courir des risques sérieux de rupture des droits des étudiants ? La moindre des ambitions serait de systématiser des mutations par voie électronique – cela a été dit et cela sera fait –, alors que, trop souvent, les démarches s’opèrent encore via des imprimés, qui tardent à circuler et parfois même s’égarent.
Un point particulièrement sensible concerne les étudiants salariés. Le défaut d’articulation entre les régimes étudiant et général conduit à deux risques jumeaux.
Certains étudiants sont couverts deux fois, en tant qu’étudiants et salariés, en réglant deux cotisations. Cela peut même se produire au sein de l’université, …
… avec des doctorants qui s’affilient comme étudiants, avant de se voir proposer un contrat avec leur établissement, par lequel ils régleront des cotisations sociales. D’autres – c’est encore plus grave – peuvent ne pas du tout être couverts, alors qu’ils pensent l’être.
La complexité, déjà signalée, est renforcée, évidemment, par le fait que le régime étudiant est délégué non pas à un opérateur, mais à deux réseaux distincts, qui sont, disons-le, davantage concurrents que complémentaires ou alternatifs.
Ce n’est simple à comprendre ni pour les étudiants et leurs familles ni, d’ailleurs, pour les établissements, qui ont la charge, au moment de l’inscription, de l’affiliation à la sécurité sociale. D’ailleurs, on conçoit que les agents ne soient pas très à l’aise lorsqu’ils ont à jouer les arbitres entre LMDE et les mutuelles régionales. J’ai bien entendu le problème de décalage d’un mois qui se pose pour ce qui concerne la date d’affiliation : il sera résolu, je m’y engage, dès la rentrée de 2014, car il est tout simplement absurde.
Applaudissements.
L’efficacité et la pertinence de cette concurrence font débat. Dans son rapport sur la sécurité sociale, la Cour des comptes estime que ce duopole est source de coûts inutiles et superflus. Le rapport attendu dans le cadre de la modernisation de l’action publique, la MAP, viendra préciser cette analyse, et les différents scénarios que vous avez proposés – fusion, gestion partagée avec le régime général ou adhésion au régime parental avec une affiliation distincte – seront examinés attentivement.
Il est certain que la division en deux réseaux n’est pas propice à engager les investissements de modernisation nécessaires. Il s’agit, à cause de la rotation des étudiants, de systèmes d’informations très lourds, dont le fonctionnement doit être assuré avec le maximum de sécurité, de fiabilité et de confidentialité. L’adossement de LMDE à la MGEN porte déjà ses fruits en termes d’efficacité professionnelle. Le Gouvernement veillera à ce que le régime étudiant ne prenne pas de retard, en raison d’une organisation ancienne, dans la dématérialisation des procédures et la réalisation des investissements indispensables à cet effet.
Cette exigence est confortée par la situation des finances publiques. Il ne faut pas tergiverser lorsqu’il est possible de proposer un service de qualité à un moindre coût grâce à des mutualisations. Marisol Touraine engagera en 2014 des négociations sur les conventions d’objectifs et de gestion avec les opérateurs de l’assurance maladie. Chacun doit contribuer aux économies nécessaires, y compris les opérateurs du régime étudiant de sécurité sociale.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement agit avec ambition pour la modernisation de l’action publique. La riche histoire de la sécurité sociale étudiante ne justifiera jamais l’immobilisme ou l’inefficacité.
Dès ma nomination, en lien avec ma collègue Marisol Touraine et en dialogue étroit avec le Premier ministre, j’ai ouvert plusieurs chantiers afin d’améliorer la santé des étudiants.
Il est possible, j’en suis sûre, de concilier les objectifs initiaux dans ce qu’ils ont de meilleur, c'est-à-dire la responsabilisation des étudiants et leur implication, en particulier en faveur de la prévention sanitaire, avec la maîtrise des coûts et le renforcement de l’efficacité du service rendu. De premiers progrès sont sensibles, à tous les niveaux. Beaucoup reste encore à faire ; le Gouvernement en est conscient et agira sans tabou.
Dès le printemps prochain, au-delà des amendements que vous avez proposés et qui ont été intégrés au projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche, et outre l’adossement de LMDE à la MGEN, en me fondant sur votre rapport d’information, mais aussi sur les rapports publiés dans le cadre de la modernisation de l’action publique, je présenterai un plan relatif à la vie étudiante, avec une composante santé qui devrait répondre à bon nombre de vos questions et satisfaire vos demandes.
Ce plan améliorera les conditions de vie et la santé des 2, 4 millions d’étudiants, quels que soient leur établissement d’enseignement supérieur de rattachement, leur territoire et leur nationalité. Il fera partie du contrat de site signé entre le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et le pôle universitaire.
Le débat dont vous avez pris l’initiative contribuera utilement à alimenter nos réflexions et à éclairer nos actions. Je vous remercie de votre convergence et de la sérénité qui a présidé à ce débat, extrêmement constructif et riche dans ses propositions.
Applaudissements.

Nous en avons terminé avec le débat sur la sécurité sociale des étudiants.

Je rappelle que la commission des finances et la commission des lois ont proposé des candidatures pour trois organismes extraparlementaires.
La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.
En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame :
– Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, membre du conseil d’administration du Fonds pour le développement de l’intermodalité dans les transports ;
– M. Jean Arthuis, membre de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ;
– et M. Jean-Patrick Courtois, membre du Conseil national de la sécurité routière.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 4 décembre 2013, à dix-huit heures :
Débat sur les perspectives d’évolution de l’aviation civile à l’horizon 2040 : préserver l’avance de la France et de l’Europe.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures trente.