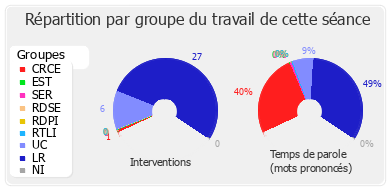Séance en hémicycle du 1er mars 2005 à 16h30
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à dix heures quarante, est reprise à seize heures trente, sous la présidence de M. Christian Poncelet.

La séance est reprise.

M. le président. L'ordre du jour appelle le dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes.
Mmes et MM. les sénateurs se lèvent.

Huissiers, veuillez faire entrer M. le Premier président de la Cour des comptes.
M. le Premier président de la Cour des comptes est introduit dans l'hémicycle selon le cérémonial d'usage.

Monsieur le Premier président, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui, au nom de tous mes collègues et en mon nom personnel, dans cet hémicycle où vous êtes souvent intervenu dans d'autres fonctions.
C'est la première fois que vous venez déposer solennellement sur le bureau de notre assemblée le rapport annuel de la Cour des comptes, toujours très attendu par tous les membres de la Haute Assemblée.
Permettez-moi de rappeler à cette occasion combien le Sénat est attaché au développement des relations institutionnelles avec la Cour des comptes. Sous l'autorité de leurs présidents, MM. Jean Arthuis et Nicolas About, nos commissions des finances et des affaires sociales bénéficient en particulier du concours efficace de la Cour dans le cadre de leur mission de contrôle de l'application des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, sur le fondement des articles 47 et 47-1 de la Constitution.
Monsieur le Premier président, je forme en cet instant, le voeu que ces relations toujours très fructueuses puissent se renforcer encore sous votre présidence.
Vous avez maintenant la parole, monsieur le Premier président.
M. Philippe Séguin, Premier président de la Cour des comptes. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, mesdames, messieurs les sénateurs, en application de l'article L. 136-1 du code des juridictions financières, j'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat le rapport public annuel de la Cour des comptes, que j'ai remis ce matin même à M. le Président de la République et que je présenterai tout à l'heure à l'Assemblée nationale.
M. le Premier président de la Cour des comptes remet à M. le président du Sénat le rapport annuel de la Cour des comptes.

M. le président. Merci, monsieur le Premier président. Ce rapport est bien épais !
Sourires
Oserai-je relever, monsieur le président, que, en me conformant ainsi à une tradition qui remonte à l'année 1832, j'ai l'occasion de monter de nouveau à la tribune de la Haute Assemblée pour la première fois depuis dix-sept ans ? Je ne vous cacherai pas en tout cas l'émotion que j'en ressens, et je vous remercie à cet égard, monsieur le président, de vos propos.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous le savez mieux que quiconque, le rapport public annuel n'est plus la seule publication de la Cour des comptes. Pour s'en tenir, par exemple, aux trois ou quatre derniers mois écoulés, la Cour, outre ses communications sur l'exécution de la loi de finances et sur l'application de la loi de financement de la sécurité sociale, a publié des rapports thématiques consacrés à « l'accueil des immigrants et à l'intégration des populations issues de l'immigration », au « maintien en condition opérationnelle des matériels des armées », ou encore au « démantèlement des installations nucléaires et à la gestion des déchets ».
Près d'une dizaine d'autres rapports publics particuliers - telle est en effet leur appellation - sont actuellement en cours d'élaboration et seront transmis à la Haute Assemblée, pour la plupart, dès cette année ; ils témoigneront de la diversité des interventions de la Cour et de ce qu'elle me paraît pouvoir apporter en termes d'appréciation de l'efficacité des politiques publiques et de contribution à l'amélioration de la qualité de la gestion publique.
S'agissant par ailleurs du contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique, la Cour a publié depuis un an des rapports sur le Comité français pour l'Unicef, sur l'Association française contre les myopathies et, voilà quelques jours à peine, sur l'Association pour la recherche sur le cancer.
Elle s'apprête en outre à procéder aux vérifications qui déboucheront sur un bilan global, lequel sera rendu public, de l'utilisation des fonds recueillis en France à la suite du tsunami. Le rapport, élaboré à l'échelon national, sera complété par un autre, de portée internationale, qu'elle réalisera en sa qualité de commissaire aux comptes de l'Organisation des Nations unies.
Si le rapport public annuel, accessible aux citoyens depuis 1938, n'est donc plus la seule expression publique de la Cour des comptes, nous entendons néanmoins lui conserver toute son importance. Bien loin de le considérer comme vidé de son sens par la croissance du nombre des autres publications, nous nous attachons à le faire évoluer pour qu'il ne cesse de constituer à la fois un relevé des activités de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes, un inventaire des observations les plus significatives et les plus exemplaires des choix et des pratiques des pouvoirs publics dans la mise en oeuvre de leur politique et, enfin, un état des suites réservées aux interventions des juridictions financières.
Les deux volumes du rapport qui vous est remis, monsieur le président, y contribuent chacun à leur manière.
Le rapport d'activité, publié depuis quatre ans dans un fascicule distinct, est le moyen de donner la mesure de nos activités et de répondre à une obligation de transparence à laquelle les juridictions financières veulent d'autant plus souscrire que c'est pour elles le moyen de faire connaître l'efficacité de leurs interventions.
L'absence de suites aux interventions de la Cour est en effet une légende qui n'a probablement que trop duré. Peut-être la Cour et les chambres régionales sont-elles trop modestes pour revendiquer la paternité des réformes intervenues après leur passage ? Peut-être retient-on plus l'anecdote que les réformes de fond auxquelles nous avons contribué ? Toujours est-il que, contrairement aux idées reçues, nombre de nos contrôles produisent des effets tangibles. L'actualité même en offre la démonstration : les péripéties diverses qu'affronte actuellement telle fédération sportive doivent, pour le moins, quelque chose à la Cour des comptes. A l'inverse, le redressement de telle association de lutte contre le cancer n'aurait pas été possible sans l'intervention, en son temps, de notre juridiction.
Dans le rapport d'activité, vous trouverez d'autres illustrations encore des résultats obtenus. Ils sont loin d'être négligeables, si l'on considère, par exemple, la réforme entreprise par la protection judiciaire de la jeunesse après le contrôle de la Cour en 2003, ou les modifications significatives auxquelles ont procédé nombre de collectivités territoriales dans leur mode de relation avec leurs délégataires de service public, après les contrôles des chambres régionales des comptes.
Quant au contenu du second volume, il n'a peut-être pas le caractère exhaustif de jadis, mais il ne se limite pas non plus à un propos d'ambiance. Il permet, à partir de quelques exemples significatifs, de prendre la mesure de ce qu'est la gestion publique et des écarts qui peuvent la séparer de ce qu'elle devrait être, ou encore d'en retracer les évolutions, d'en évaluer les succès ou les insuffisances.
Tant ses nouvelles publications que le nouveau contenu du rapport public attestent que la Cour s'efforce sans cesse de s'adapter aux évolutions de son environnement, parmi lesquelles, en particulier, le renforcement progressif et continu, depuis plus de dix ans, de sa contribution à l'information du Parlement. Ce renforcement - vous l'avez justement évoqué, monsieur le président -, à l'initiative duquel je m'honore d'avoir pris une part, fût-elle modeste, dans une vie antérieure, aura été confirmé, amplifié et approfondi par la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF.
Ainsi la Cour contribue-t-elle activement aux travaux de votre commission des finances et de votre commission des affaires sociales. Depuis 2002, ce ne sont pas moins de douze rapports que la Cour aura élaborés à la demande de la commission des finances, et nous nous attacherons à honorer de même les demandes qui seront formulées au titre de l'année 2005. La Cour est d'ailleurs très sensible à l'habitude prise par la commission des finances, sous l'impulsion de son président, M. Arthuis, d'organiser une audition des ministres ou des directeurs concernés pour débattre des conclusions de chacun de ces rapports.
De la même façon, la collaboration avec la commission des affaires sociales est très fructueuse, et je m'apprête à transmettre à son président, M. About, le rapport qu'il nous a demandé sur la question des victimes de l'amiante. Nous ferons d'ailleurs ainsi, et pour la première fois, une application de l'article L. 132-3-1 du code des juridictions financières, qui autorise désormais la commission chargée des affaires sociales à saisir elle-même la Cour des comptes d'une demande d'enquête sur toute question relative à la loi de financement de la sécurité sociale.
Enfin, les référés de la Cour font désormais l'objet, dans les conditions prescrites par la loi, de communications systématiques à votre assemblée.
Sans doute nous faudra-t-il aller plus loin encore si nous voulons être certains de disposer des meilleurs moyens pour apprécier l'efficience et l'efficacité des administrations, c'est-à-dire leur performance, et pour optimiser l'usage qui est fait de ce bien rare qu'est l'argent public.
Je demanderai ainsi à la Cour - et le président de la commission des finances, M. Arthuis, n'est pas le dernier à nous y inciter - de mieux et plus clairement encore exprimer ses recommandations afin de faciliter les suites qui leur seraient réservées par l'exécutif ou, à défaut, pour mettre davantage le Parlement en mesure d'en pointer l'absence et d'en évaluer les conséquences.
Peut-être faudra-t-il également veiller à ce que l'ensemble de ces recommandations et préconisations soit connu du Parlement. Si l'on ne devait pas souhaiter une communication plus rapide des référés aux deux assemblées, du moins pourrait-on envisager que leur soit transmise trimestriellement une synthèse des propositions qu'y formule la Cour, ce qui faciliterait leur exploitation rapide.
Mais les principales implications à tirer du nouveau contexte que j'évoquais restent à venir.
Demain, on le sait, la Cour des comptes assumera à l'intention du Parlement la tâche nouvelle de certification des comptes de l'Etat. Elle jouera par ailleurs, avec les chambres régionales des comptes, un rôle majeur dans le processus de l'évaluation de la performance des politiques publiques. Il reviendra ainsi aux juridictions financières d'être les garantes d'une mise en oeuvre satisfaisante de la LOLF, dont le législateur a tenu à ce qu'elles soient l'un des rouages essentiels.
Ne nous y trompons pas, en effet : rien n'ira de soi dans le jugement de la performance, qui ne pourra évidemment pas reposer seulement sur les données chiffrées. Un complément d'appréciation d'ordre qualitatif sera indispensable. Les Anglo-saxons l'ont d'ailleurs bien compris, qui sont nombreux à avoir abandonné l'approche par les seuls indicateurs pour opter en faveur d'une autre, fondée sur les mesures de performances, laquelle permet une évaluation à la fois quantitative et qualitative plus conforme à la réalité multiforme et évolutive de l'action publique.
Ce complément d'ordre qualitatif, il va revenir à la Cour des comptes de l'apporter. Mais il n'y aura pas que cela.
La Cour devra ainsi être non seulement autorisée, mais parfois expressément invitée à formuler des propositions de réforme de la LOLF, dont ce serait une erreur de la considérer comme un monument intangible.
Ainsi, je ne suis ni le premier ni le dernier à souligner que la France est probablement le seul pays à présenter la totalité des dépenses de l'Etat sous la forme de programmes, alors même qu'on peut se demander si toutes les formes de l'action publique peuvent y trouver systématiquement leur traduction.
Il est probable que nous découvrirons rapidement le danger qu'il y aurait à rester prisonnier de tel programme qui serait considéré comme complet et immuable, alors que les actions, par nature, changent en fonction des décisions des pouvoirs publics. Il faudra pour le moins accepter que la gestion par programme soit appliquée avec souplesse et pragmatisme en attachant plus d'importance à l'esprit général du programme qu'à son contenu et, si cela ne suffit pas, avoir le courage de procéder aux changements qui s'avèreraient nécessaires.
La réussite de la LOLF constitue un enjeu trop important en termes de renforcement de la démocratie parlementaire, de transparence et de responsabilité des gestionnaires dans l'usage de l'argent public pour que toutes les chances de réussite ne soient pas réunies.
Vous aurez compris, mesdames, messieurs les sénateurs, que les juridictions financières sont résolues à tout mettre en oeuvre pour qu'il en soit ainsi. Mais vous ne serez pas étonnés de m'entendre dire que, pour qu'elles puissent agir avec une totale impartialité et avec efficacité, il me paraît souhaitable de reconsidérer leur place.
Bref, il s'agit de tirer toutes les conséquences du choix qui a été fait par notre pays de ne retenir aucun des modèles habituels de positionnement de l'institution supérieure de contrôle, à savoir son rattachement à l'exécutif ou au législatif. Certes, le choix ainsi opéré en 1958 par le constituant n'était qu'implicite. Et sans doute cela peut-il expliquer qu'il ait fallu attendre les années quatre-vingt-dix pour que le Parlement et la Cour des comptes en tirent les premières conséquences concrètes, et l'année 2001 pour que le Conseil constitutionnel pose clairement le principe de l'équidistance de la Cour vis-à-vis du Parlement et du Gouvernement, qu'ultérieurement la logique de la LOLF allait rendre incontournable.
Dans ces conditions, peu après ma nomination il m'est vite apparu que la présence des juridictions financières dans un programme rattaché à une mission du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie - comme à tout autre élément de l'exécutif - était difficilement défendable. C'est pourquoi la Cour, avec le renfort du Conseil d'Etat, a formulé un certain nombre de suggestions pour que son positionnement soit remis en conformité avec le principe que j'ai rappelé. L'affaire nous a paru d'importance, car ce sont la clarté, la qualité et la pérennité des rapports du Parlement et de la Cour qui sont en question.
Je sais gré à la commission des finances du Sénat d'avoir prêté une oreille attentive à nos analyses et je la remercie de la part qu'elle a prise au dégagement d'une esquisse de solution qui, pour être totalement satisfaisante, devra selon nous prendre en compte le fait que les juridictions financières forment un tout indissociable devant être traité comme tel et, par ailleurs, proscrire tout rattachement qui, par définition, mettrait en cause notre double et égale référence au législatif et à l'exécutif.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les treize insertions du présent rapport public ne tiennent pas de ce que l'on dénomme communément « l'épinglage ».
Sourires
Il s'agit dans plusieurs cas d'appréciations du suivi réservé à des observations antérieures. Ainsi en va-t-il pour la refondation indemnitaire. Cinq ans après les premières analyses de la Cour, la réforme opérée paraît aujourd'hui essentiellement formelle et l'on peut déplorer que l'objectif de motivation des personnels et de rénovation de la gestion publique, affiché entre-temps par les pouvoirs publics, ne l'ait pas davantage inspirée.
Il s'agit encore de démontrer que la Cour intervient non pas seulement pour blâmer, mais parfois aussi pour souligner les progrès accomplis et l'amélioration de la gestion publique. La construction progressive du service public de la transfusion sanguine ou la rationalisation de l'organisation financière de France Télévisions, dans le cadre d'une holding que la Cour avait appelée de ses voeux, en constituent deux bons exemples.
Il s'agit bien sûr aussi, et de manière plus classique, d'alerter sur des gestions défaillantes. C'est le cas des opérations immobilières du ministère des affaires étrangères, lesquelles révèlent une situation critique, caractérisée par des incohérences nombreuses et un défaut de pilotage patent, sources de surcoûts, de retards dans les réalisations et, au final, d'une efficacité largement insuffisante. Il est urgent que ce ministère professionnalise la gestion de son patrimoine. A défaut, ses projets de révision de ses implantations parisiennes, tout comme la modernisation de l'hébergement de son réseau diplomatique et consulaire, risqueraient d'en pâtir fâcheusement.
Il s'agit enfin de rapporter les conclusions de divers contrôles effectués par les chambres régionales des comptes dans les collectivités territoriales, auxquelles la Haute Assemblée est très attachée. Les insertions concernant les services départementaux d'incendie et de secours ou les comités régionaux du tourisme montrent les enseignements qu'il faut tirer de certains enchevêtrements de compétences et de l'insuffisante coordination de divers opérateurs.
Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les quelques considérations dont je souhaitais, avec votre permission, assortir le dépôt du présent rapport public.
Applaudissements

Monsieur le Premier président, le Sénat vous donne acte du dépôt de ce rapport.
La parole est à M. le président de la commission des finances.

Monsieur le président, monsieur le Premier président, mes chers collègues, c'est avec beaucoup de plaisir et d'attention, comme il se doit, que nous venons d'entendre M. le Premier président nous présenter le rapport public annuel de la Cour des comptes.
Dans quelques instants, monsieur le Premier président, vous irez présenter votre rapport devant l'Assemblée nationale. Croyez bien que nous apprécions l'honneur que vous faites au Sénat.
Je ne reviendrai pas sur le contenu de ce rapport que nous ne manquerons pas, spécialement à la commission des finances, d'analyser comme toujours avec le plus grand soin. Il enrichira notre réflexion et nos travaux pour porter une appréciation sur l'efficacité de la dépense publique et sur le bon usage des deniers publics.
Précisément, monsieur le Premier président, je voudrais vous remercier de l'attention que vous portez personnellement, et avec votre détermination bien connue, à l'approfondissement des relations entre la Cour des comptes et le Parlement, singulièrement le Sénat.
La mission d'assistance sur l'Institut national de recherches archéologiques préventives et les quatre enquêtes que nous vous avions demandées en 2004, en application des premier et deuxième alinéas de l'article 58 de la LOLF, nous ont été présentées ou vont nous être présentées dans les prochaines semaines. Elles donneront lieu, comme les neuf déjà réalisées depuis deux ans au sein de la commission des finances, à des auditions contradictoires réunissant, autour des commissaires, les magistrats de la Cour des comptes ayant conduit les enquêtes ainsi que les représentants des organismes contrôlés et, le cas échéant, les ministères de tutelle.
C'est donc un dialogue constructif qui permet de conférer au contrôle budgétaire un caractère positif : il s'agit moins de dénoncer et d'accuser que de favoriser et d'encourager des évolutions positives, des réformes, des progrès.
Ainsi la commission a t-elle souhaité donner encore plus de publicité à ses travaux, en ouvrant ces auditions contradictoires le plus largement possible aux médias. C'est de cette façon, me semble-t-il, que nous contribuerons à donner la plus grande transparence, et donc la plus grande diffusion, à nos travaux communs.
Ainsi, pour l'année 2005, ai-je l'honneur, monsieur le Premier président, de vous saisir officiellement aujourd'hui de cinq enquêtes issues des demandes des rapporteurs spéciaux compétents, portant sur les sujets suivants.
La première concerne les frais de justice, dont l'évolution est préoccupante : plus 40 % en deux ans, l'enveloppe annuelle atteignant un peu plus de 400 millions d'euros.
La deuxième enquête a trait à la gestion immobilière du ministère de l'équipement.
La troisième concerne la situation du Fonds d'intervention pour la sauvegarde, la transmission et la restructuration des activités commerciales et artisanales, le FISAC.
La quatrième a trait au Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale, financé par une taxe sur les messages publicitaires.
Enfin, la cinquième enquête concerne le fonctionnement du service public de l'équarrissage.
Nous vous remercions encore, monsieur le Premier président, de contribuer ainsi à nous assister dans le développement de la mission de contrôle budgétaire du Parlement, qui est chaque jour davantage notre « seconde nature », selon la désormais célèbre formule du Président Christian Poncelet.
Cette mission de contrôle se trouve bien évidemment renforcée avec la LOLF, qui sera mise en oeuvre à partir du prochain projet de loi de finances et sur laquelle, vous le comprendrez, je souhaite insister quelque peu cette année.
La LOLF, issue d'initiatives parlementaires venant de différents groupes et dépassant les clivages partisans, doit en effet conduire à transformer la nature du contrôle budgétaire, et vous savez que la commission des finances s'y emploie activement. Cette dernière a affiné ses méthodes, en examinant les techniques qui ont été mises en oeuvre tant en France par le secteur public ou les entreprises privées, les cabinets spécialisés, qu'à l'étranger par nos homologues des différents parlements.
La commission des finances a rédigé son propre guide des bonnes pratiques de contrôle et communique chaque année davantage, comme elle l'a fait voilà dix jours sur les vingt-cinq contrôles réalisés en 2004 par ses rapporteurs spéciaux, que je tiens à féliciter de nouveau pour l'exemplarité de leur engagement.
Mais, nous le savons tous, la Cour des comptes verra sa mission considérablement renforcée au travers de la certification des comptes de l'Etat, à laquelle elle devra procéder, et aussi de par la loi de règlement, point sur lequel je reviendrai dans un instant.
C'est pour cette raison que je rejoins, monsieur le Premier président, votre préoccupation de garantir, y compris par son autonomie financière, l'indépendance de la Cour des comptes.
A cet égard, le rattachement, dans la nouvelle nomenclature budgétaire, du programme « juridictions financières » à la mission ministérielle « gestion et contrôle des finances publiques » impliquerait la détermination en amont des crédits de la Cour des comptes par un ministre, en l'occurrence celui de l'économie, des finances et de l'industrie. En d'autres termes, le certifié, plus précisément celui qui tient les comptes et qui les arrête, fixerait les moyens financiers du certificateur. Une telle situation, croyez-le bien, ne nous satisfait aucunement, car ce serait contraire aux principes auxquels nous sommes attachés.
Voilà pourquoi la commission des finances avait, dès l'an dernier, proposé la création d'une mission « transparence et régulation de l'action publique », composée des programmes « juridictions financières » et « autorités administratives indépendantes » : cette formule présenterait l'avantage de résoudre le problème de la fongibilité des crédits entre autorités régulatrices et administrations concernées.
A dire vrai, je m'étais étonné, à l'époque, de l'absence d'échos favorables de la part des premiers intéressés. Cela pouvait s'apparenter à une sorte d'encéphalogramme plat, voire à un refus, comme si, tout compte fait, il était plus sage de négocier au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Depuis quelques semaines, nous avons perçu un changement de pied, dans le sens de la recherche de l'équidistance entre l'exécutif et le législatif.
Compte tenu des derniers éléments en ma possession, avec notre rapporteur général, Philippe Marini, mais aussi avec nos homologues de l'Assemblée nationale, le président Pierre Méhaignerie et le rapporteur général Gilles Carrez, nous veillerons, dans la concertation, à trouver une solution satisfaisante. Ainsi, l'idée de réunir, au sein d'une mission dédiée aux seules institutions citées par la Constitution, des programmes spécifiques pour les juridictions financières et le Conseil d'Etat peut être, me semble-t-il, favorablement accueillie, même si, nécessairement, des demandes similaires émaneront des juridictions judiciaires.
Ces programmes seraient régis par les règles budgétaires de droit commun, qui pourraient être naturellement assouplies le cas échéant, sans toutefois être supprimées, afin de conforter l'indépendance de ces juridictions ; je pense plus spécifiquement à l'exercice du contrôle financier ou à la régulation budgétaire. De même faudra-t-il réfléchir à la possibilité de modifier le champ du titre actuellement réservé aux seules dotations des pouvoirs publics, afin d'y adjoindre, sans pour autant les assimiler, les crédits relevant de cette mission sui generis.
Par-delà les modalités concrètes précises, il y a accord sur le fond, et je veux croire que le dialogue toujours fructueux entre le Gouvernement, les assemblées et la Cour des comptes nous permettra de dégager une solution acceptable par tous dès le prochain projet de loi de finances.
J'ajouterai que l'indépendance, comme vous le savez, tient non seulement à la lettre des textes, mais aussi à l'esprit dont font preuve ceux qui sont aux responsabilités. De ce point de vue, je suis plutôt déjà rassuré, monsieur le Premier président. La déontologie doit être le meilleur garant de l'objectivité et prévenir je ne sais quelle suspicion que pourraient susciter les allers et retours, sans doute rythmés par les alternances politiques, de certains magistrats entre la Cour des comptes et les cabinets ministériels. Cette observation vaut également pour le Conseil d'Etat.
Permettez-moi également d'insister sur le nécessaire renforcement de la loi de règlement, qui résultera naturellement de la logique de performance et de résultat induite par la LOLF.
En effet, le projet de loi de finances initiale présentera, pour chaque programme de chaque mission, des objectifs et des indicateurs de performance. La réalisation de ces objectifs sera mesurée dans la loi de règlement qui, de simple mais indispensable quitus comptable, se transformera progressivement en instrument d'évaluation de l'accomplissement par l'Etat de ses missions. C'est dire l'importance accrue, tant pour la Cour des comptes que pour le Parlement, de cette loi de règlement.
J'exprime d'ores et déjà le souhait que nous puissions modifier l'organisation de nos travaux parlementaires. Ainsi, désormais, au printemps, avant que ne s'engage le débat d'orientation budgétaire, nous devrons, monsieur le président, mes chers collègues, consacrer non plus une ou deux heures, mais au moins une semaine, en séance publique, à l'examen de la loi de règlement.
M. Jean-Jacques Jégou applaudit.

A cette occasion, nous inviterions en séance les ministres pour leur permettre de commenter devant tous nos collègues des autres commissions les résultats de leur politique.

Nous sommes bien conscients du fait que la LOLF est appelée à devenir un puissant instrument de réforme, réforme de l'Etat bien sûr, mais aussi réforme du Parlement et de l'organisation des travaux de ce dernier.
Monsieur le Premier président, je souhaiterais souligner, en conclusion, l'importance pour nous tous de cette première année de mise en oeuvre de la « nouvelle Constitution financière ».
La LOLF va changer les méthodes de travail tant de la Cour des comptes que du Parlement.
Pour ce qui concerne les assemblées, il faudra définir le nouveau périmètre des rapports budgétaires, reformater les questionnaires budgétaires, revoir certaines règles concernant la discussion budgétaire et l'examen des amendements. Il faudra également nous interroger sur l'application de l'article 40 de la Constitution.
La Cour des comptes, pour sa part, sera aussi sûrement appelée à faire évoluer certaines de ses méthodes pour répondre aux exigences de la LOLF, en particulier la certification de sincérité et de régularité des comptes de l'Etat, y compris les comptes consolidés de l'Agence des participations de l'Etat. Il conviendra de lui en donner les moyens, car les contraintes de cette innovation majeure, notamment en termes de délais, ne doivent pas être sous-estimées.
En effet, il nous faudra nous imposer la faculté d'adaptation que nous réclamons à juste titre aux administrations de l'Etat et au Gouvernement.
Cette faculté d'adaptation, qui n'est nouvelle ni pour vous, monsieur le Premier président, ni pour nous, nous en témoignerons ensemble, puisque nous sommes dotés d'une expérience chaque année renforcée de coopération mutuelle dont je ne peux que me féliciter.
Mes chers collègues, la réforme de l'Etat est en marche. Son succès se mesurera à l'aune de la volonté que manifesteront, sans faille, l'exécutif et le Parlement.
Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Huissiers, veuillez reconduire M. le Premier président de la Cour des comptes.
M. le Premier président de la Cour des comptes est reconduit selon le même cérémonial qu'à son entrée dans l'hémicycle.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-sept heures dix, est reprise à dix-sept heures vingt-cinq.

J'informe le Sénat que le groupe de l'Union pour un mouvement populaire a présenté quatre candidatures pour les commissions des affaires économiques et du Plan, des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, des affaires culturelles et des affaires sociales, aux places laissées vacantes, que le groupe socialiste a présenté une candidature pour la commission des affaires économiques et du Plan, à la place laissée vacante, et que le groupe communiste républicain et citoyen a présenté une candidature pour la commission des affaires sociales, à la place laissée vacante.
Ces candidatures vont être affichées et les nominations auront lieu conformément à l'article 8 du règlement.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, la réforme de l'organisation du temps de travail présentée dans la proposition de loi issue de l'Assemblée nationale dont vous êtes saisis aujourd'hui est une réforme importante, par son contenu comme par les principes qui la sous-tendent.
Ce texte participe d'abord de cette ambition qui est la nôtre de rompre avec des schémas autoritaires imposés sans réelle concertation
Exclamations sur les travées du groupe CRC
Cette proposition de loi s'inscrit dans la ligne des réformes engagées depuis près de trois ans par le Gouvernement pour mettre l'économie française sur le chemin du dynamisme et de la croissance et pour donner à nos entreprises les moyens d'un développement pérenne.
Ces réformes nous paraissent indispensables. Bien sûr, les recettes mises en oeuvre jusqu'en 2002 avaient pu faire illusion en haut de cycle et permettre à certaines grandes entreprises de mener à bien leur réorganisation. Mais elles ont vite montré leurs limites lorsque la conjoncture s'est retournée ! Alors que notre pays est exposé à une concurrence internationale sans cesse plus vive, il est illusoire de prétendre assurer sa prospérité seulement à coup de contrats aidés dans les collectivités publiques, pour les jeunes diplômés, ou de partage autoritaire du travail dans les entreprises.
La tâche du Gouvernement a été rendue plus difficile en raison d'une conjoncture peu favorable : en 2003, la zone euro, avec laquelle nous réalisons la majorité de nos échanges, a connu une croissance très faible : 0, 4 %. Notre pays, dont la croissance a été de 0, 5 % en 2003, n'a pas échappé à cette morosité.
En 2004, notre horizon a commencé à s'éclaircir. Avec un taux de 2, 3 %, la croissance a retrouvé un niveau encourageant, qui représente l'un des meilleurs résultats de la zone euro. Les créations d'emplois ont atteint le chiffre de 40 000 et la consommation des ménages a progressé de 3, 8 % sur un an.
Cette embellie, nous la devons, certes, à une conjoncture internationale plus favorable, mais surtout aux premiers effets des réformes structurelles engagées depuis deux ans. Je pense en particulier à la maîtrise du coût du travail sur les bas salaires, grâce à une politique volontariste de baisse des charges, à l'encouragement à la création d'entreprises par la loi sur l'initiative économique, dite loi Dutreil - le nombre de créations d'entreprises a d'ailleurs atteint l'année dernière un niveau inégalé, à savoir 224 000 -, au soutien aux activités de haute technologie et aux investissements collectifs, au développement de la formation tout au long de la vie grâce à la création du DIF, le droit individuel à la formation, à la rénovation du dialogue social dans les entreprises et les branches grâce à l'ouverture de nouveaux champs pour la négociation collective et la modernisation des règles de négociation - ce sont les acquis des lois des 3 et 17 janvier 2003 et de la loi du 4 mai 2004.
Toutes ces réformes procèdent d'une inspiration commune : donner aux entreprises, par le dialogue social, les moyens de leur développement, assurer aux salariés des parcours professionnels de qualité, et conforter la compétitivité de notre économie sur les marchés internationaux, là où se joue notre avenir.
Si ces réformes ont commencé à porter leurs fruits en termes de croissance et de résultats financiers, leur impact sur l'emploi reste malheureusement, je le concède bien volontiers, encore très insuffisant.
Comme en témoignent les chiffres du chômage rendus publics la semaine dernière, avec 10 % de la population active en recherche d'emploi, la situation du marché du travail reste, à mes yeux, préoccupante : sur douze mois, nous avons connu alternativement six mois de baisse puis six mois de hausse du chômage. Là où d'autres pays parviennent à réduire massivement leur niveau de chômage dès que la croissance dépasse 2 % en rythme annuel, nous parvenons tout juste à absorber l'augmentation de la population active.
Ces résultats doivent-ils nous conduire à remettre en cause les principes qui nous ont guidés jusqu'ici ? Je ne le crois pas. Je suis au contraire convaincu que cela doit nous inciter à poursuivre avec plus de détermination encore dans la voie des réformes structurelles.
C'est cette conviction qui nous a conduits, au sein du pôle de cohésion sociale animé par Jean-Louis Borloo, à élaborer la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Cette loi est porteuse de réformes ambitieuses : elle s'attaque aux dysfonctionnements du marché du travail, elle renforce l'accompagnement des chômeurs et elle donne aux entreprises les outils nécessaires pour accompagner au mieux les restructurations auxquelles elles sont confrontées.
La proposition de loi dont vous avez à débattre aujourd'hui participe, elle aussi, du souci qui est le nôtre de moderniser le fonctionnement de notre économie, mais en agissant cette fois sur les règles de fonctionnement des entreprises et sur l'organisation du temps de travail.
J'entends, il est vrai, des interrogations sur l'opportunité d'une telle réforme, alors que le taux de chômage demeure élevé et que nombre d'entreprises, les grandes notamment, semblent avoir surmonté tant bien que mal le passage aux 35 heures.
Certains estiment même - je pense notamment aux prises de position récentes de plusieurs organisations syndicales - que la proposition de loi constituerait un retour en arrière au mieux superflu. Revoir l'organisation du temps de travail au sein des entreprises aurait pour conséquences, selon eux, de freiner les embauches et de limiter la progression du pouvoir d'achat des salariés. Mais c'est se méprendre tant sur le diagnostic que sur la nature du remède proposé.
S'agissant du diagnostic, considérer que le passage aux 35 heures aurait été globalement favorable à notre économie et aurait constitué une source d'emplois et de richesse qu'il faudrait tenter de réactiver aujourd'hui me paraît un contresens.
Toutes les études en ont fait le constat : l'emploi n'est pas une marchandise. Il ne se partage pas réellement, contrairement à ce que certains ont pu légitimement espérer. Il est le fruit de la croissance et de l'initiative collective et individuelle. Une réduction autoritaire et uniforme de la capacité de travail est un facteur de rigidité qui pénalise les entreprises et leur interdit de répondre à de nouvelles opportunités de marchés.
Si nous avons effectivement créé, entre 1998 et 2001, 350 000 emplois, c'est parce que la conjoncture internationale était favorable. En outre, le passage aux 35 heures s'est accompagné de subventions massives accordées aux entreprises pour compenser les effets de cette mesure sur le coût du travail.
Protestations sur les travées du groupe socialiste.
... soit un coût annuel pérenne de 22 000 euros par emploi créé. Je crois que nous devons, les uns et les autres, méditer ce chiffre.
Au total, la réduction du temps de travail a eu un coût élevé, y compris pour les salariés.
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Ce coût est important en termes de stress et de charge de travail, notamment pour les salariés les moins qualifiés : 28 % des salariés considèrent que leurs conditions de travail se sont dégradées
Exclamations ironiques sur certaines travées du groupe socialiste
Ce coût est également élevé en termes de pouvoir d'achat : le passage contraint aux 35 heures s'est traduit, dès que la conjoncture s'est retournée, par une forte décélération de la progression des salaires, qui a atteint son point le plus bas en 2003. En 2004, la tendance a commencé à s'inverser : d'après les chiffres qui seront présentés dans quelques jours devant la sous-commission des salaires de la Commission nationale de la négociation collective, le salaire moyen a augmenté de 2, 6 %, ce qui a représenté, en 2004, une progression nette du pouvoir d'achat des ouvriers de 0, 7 %, supérieure à la hausse moyenne des salaires.
Cette tendance à la croissance devrait s'accentuer en 2005.
Autrement dit, contrairement à ce que l'on entend ici ou là, assouplir l'organisation du temps de travail dans les entreprises, comme le Gouvernement s'y est employé depuis 2003, ne pénalise nullement les salaires et le pouvoir d'achat des salariés, bien au contraire !
Soutenir que la réforme de l'organisation du temps de travail constituerait un retour en arrière intempestif constitue de plus un contresens sur la nature de cette réforme.
Il n'est pas question ici, au nom d'un quelconque esprit de revanche, d'abolir les 35 heures et de remettre en cause la durée collective du travail.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
Quoi que l'on pense des lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000 et de leur bilan, tout cela n'aurait aujourd'hui guère de sens : qu'on le veuille ou non, les entreprises et les salariés ont dû s'organiser autour de cette nouvelle durée légale, et il ne s'agit évidemment pas aujourd'hui, par la contrainte, de remettre une nouvelle fois à plat leur organisation.

Pourquoi 70 % des personnes interrogées souhaitent-elles en rester aux 35 heures ?
La démarche privilégiée par le Gouvernement est une démarche pragmatique et réaliste. Elle vise simplement, dans le prolongement des lois du 17 janvier 2003 et du 4 mai 2004, à donner aux entreprises et aux branches des outils supplémentaires pour sortir des rigidités nées du passage autoritaire et brutal aux 35 heures.
Les ajustements nécessaires seront trouvés par la négociation collective, au plus près du terrain, en fonction des besoins des entreprises et des attentes des salariés.
En effet, conformément aux principes fixés par le Président de la République le 14 juillet dernier et rappelés par le Premier ministre lors de la présentation du « Contrat France 2005 », il faudra que ces nouveaux équilibres prennent pleinement en compte les légitimes aspirations des salariés, notamment en termes de pouvoir d'achat.
Autrement dit - et ce sera l'enjeu des accords à négocier -, tout surcroît de travail devra se traduire par un surcroît de rémunération à la hauteur des sujétions acceptées par les salariés, sous la forme soit d'un complément immédiat de salaire, ...
... soit d'une épargne en temps ou en argent utilisable à plus long terme.
Enfin, contrairement à ce que l'on a pu entendre parfois, ce texte respecte évidemment pleinement les garanties prévues par le code du travail, tant en termes de congés ou de période de repos qu'en termes de durée maximale du travail, journalière ou hebdomadaire.
Les assouplissements prévus, que ce soit par le compte épargne-temps ou par le mécanisme du temps choisi, n'ont rien de commun avec le régime de dérogation individuelle à la durée maximale du travail - l'opt out - qu'autorise la directive européenne sur le temps de travail actuellement soumise à révision à Bruxelles.
Le système de l'opt out, en vigueur dans certains pays de l'Union, permet à un employeur, en accord avec son salarié, de s'affranchir complètement, et sans autre limite que le respect des périodes de repos incompressibles, des durées maximales de travail.
Ecoutez-moi !
C'est parce que ce mécanisme est radicalement étranger à nos principes et à nos traditions et qu'il fait peser une pression inacceptable sur les salariés concernés que la France combat vigoureusement sa pérennisation.
Nous avons d'ailleurs rencontré jusqu'ici un certain succès - je parle avec la prudence qui s'impose -, comme l'atteste la position prise sur notre initiative par le Conseil européen des ministres de l'emploi le 7 décembre dernier. Je vous renvoie d'ailleurs à son compte-rendu.
J'ai eu l'occasion de rappeler aux partenaires sociaux la fermeté de notre position sur ce projet de directive la semaine dernière, dans le cadre de la commission du dialogue social européen et international que j'avais tenu à réunir.
Notre réforme respecte pleinement les garanties existantes en matière de durée maximale du travail. Elle repose sur le primat de l'accord collectif de travail sur les arrangements de gré à gré.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le texte qui vous est soumis est un texte d'équilibre et de confiance.
Murmures sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.
Depuis 2003, nous avons fait le choix du dialogue social. Nous avons voulu recréer de nouveaux espaces de liberté pour les entreprises et les salariés. Ce texte, qui a été élaboré par des parlementaires, en concertation avec le Gouvernement, ...
M. Gérard Larcher, ministre délégué. ... et qui a fait l'objet d'une large concertation avec les partenaires sociaux, en est une nouvelle illustration.
Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
J'ai la conviction que, par ces assouplissements, nous oeuvrons au service de l'emploi, en desserrant les freins qui entravent le développement de l'activité dans notre pays et en accompagnant la reprise qui s'est dessinée en 2004.
En conclusion, mesdames, messieurs les sénateurs, la lutte pour le plein emploi et la nécessité pour nous d'offrir à la fois plus de sécurité et plus de flexibilité au marché du travail correspondent à un enjeu qui doit dépasser les clivages. Il s'agit en effet d'un enjeu non seulement pour notre pays, mais aussi pour celles et ceux qui, malheureusement, sont dépourvus d'emploi. C'est un enjeu qui me semble devoir rassembler au-delà des idéologies, car c'est un choix pragmatique pour faire gagner notre pays.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Riressur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis l'origine, la politique de réduction du temps de travail a donné lieu à des débats vifs et très tranchés, pour ne pas dire passionnels. Vous venez encore de nous en donner un exemple.
Certains observateurs affirment, avec beaucoup de sincérité, que les 35 heures ont été créatrices d'emplois et positives pour les entreprises, dans la mesure où elles leur auraient permis de se réorganiser et d'améliorer leur productivité. D'autres estiment au contraire, avec la même sincérité et la même bonne foi, en invoquant des arguments tout aussi sérieux, qu'elles ont entraîné une augmentation des coûts de production, incitant ainsi à la délocalisation, et qu'elles ont démotivé les salariés, qui songeraient avant tout à organiser leurs loisirs pour échapper à des cadences de travail accrues, précisément par les 35 heures.
Pour ma part, je ne souhaite pas entrer dans ce débat. Je me contenterai de rappeler deux idées simples relatives à la durée du travail.
D'abord, on ne peut pas sérieusement faire croire aux Français qu'ils peuvent gagner plus en travaillant moins.

Dans les faits, la réduction du temps de travail s'est accompagnée d'une modération salariale - on l'oublie souvent - qui explique les revendications actuelles en matière d'augmentation du pouvoir d'achat et la faiblesse de la consommation dans notre pays. Je l'avais prédit. Pourtant, Mme Aubry, à qui j'avais fait part de mes observations alors que je rapportais ses deux textes successifs, n'avait pas tenu compte de mes observations.

Par ailleurs - c'est la seconde idée simple -, je constate qu'aucun pays industrialisé n'a suivi notre exemple de réduction du temps de travail : aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne ou en Italie, on travaille souvent quarante heures par semaine.
L'économie française, exposée à la concurrence internationale, ne peut se permettre de diverger trop nettement des évolutions qui sont constatées à l'étranger.
J'observe, par ailleurs, que les pays où l'on travaille le plus sont également ceux où le taux de chômage est généralement le plus faible.
Dans ces conditions, des adaptations de la législation relative au temps de travail apparaissent nécessaires, sans qu'il soit toutefois question de remettre en cause la durée légale du travail, qui reste fixée - cela a été dit et redit - à 35 heures par semaine.
Tel est l'objet poursuivi par la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui.
Il est important de rappeler que ce texte est le fruit d'une longue élaboration. Il répond précisément à la feuille de route tracée par le Chef de l'Etat lors de son intervention télévisée du 14 juillet dernier. Le Président de la République avait demandé qu'il y ait « plus de liberté pour les travailleurs, et notamment pour ceux qui veulent travailler plus pour gagner plus, et plus de liberté pour les entreprises afin de mieux s'adapter aux marchés ».
Le texte de cette proposition de loi est cosigné par quatre de nos collègues députés - Pierre Morange, qui est le rapporteur du texte, Hervé Novelli, Patrick Ollier, président de la commission des affaires économiques, et Jean-Michel Dubernard, président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales -, mais il a été rédigé en étroite collaboration avec le Gouvernement

L'assouplissement des 35 heures fait partie des mesures phares du « Contrat France 2005 » présenté par le Premier ministre à la fin de l'année passée.
Le texte a donné également lieu à une large concertation avec les partenaires sociaux.

M. Louis Souvet, rapporteur. Cela signifie que les gens ont été écoutés, et vous n'avez d'ailleurs pas manqué de participer activement à cette concertation.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

La commission des affaires sociales a poursuivi cette démarche en auditionnant l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives.
J'ajoute que le texte renvoie à la négociation collective le soin de mettre en oeuvre les mesures proposées, traduisant ainsi la confiance de notre majorité dans le rôle des partenaires sociaux. Il s'inscrit ainsi dans le prolongement de la réforme adoptée au début de l'année 2003, sur l'initiative de François Fillon, qui autorisait les partenaires sociaux à déterminer librement le volume du contingent d'heures supplémentaires et la rémunération de ces dernières.
Je comprends que l'opposition puisse être particulièrement mobilisée contre ce texte, dans la mesure où celui-ci touche à l'une des réformes emblématiques de la législature précédente.
Cependant, il me semble que les conséquences de ce texte ont été surestimées. En effet, de nombreux dirigeants de grandes entreprises ont indiqué publiquement qu'ils étaient satisfaits des accords en vigueur dans leur entreprise en matière d'aménagement et de réduction du temps de travail et qu'ils n'envisageaient pas de les remettre en cause après l'adoption du présent texte. Leur position est compréhensible : le passage aux 35 heures a été coûteux en temps, en argent et en énergie ; des compromis satisfaisants ont été trouvés, d'ailleurs parfois difficiles à exprimer, et les entrepreneurs souhaitent aujourd'hui se consacrer pleinement à leur activité plutôt que rouvrir le dossier de la négociation du temps de travail.
J'en arrive maintenant à la présentation des trois articles du texte : le premier rénove et simplifie les règles régissant le compte épargne-temps, le deuxième crée un nouveau régime d'heures choisies et le troisième prévoit des dispositions transitoires pour les entreprises employant moins de vingt et un salariés.
Créé en 1994, le compte épargne-temps est un dispositif qui permet aux salariés d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de se constituer une épargne. Bien qu'il soit a priori intéressant pour les salariés de bénéficier d'un instrument leur permettant de gérer leur temps de travail avec plus de souplesse, le compte épargne-temps peine à se développer en raison de sa complexité. Actuellement, les modalités d'alimentation de ce compte doivent respecter au moins six seuils différents, et son utilisation est soumise à de strictes conditions de délai.
La proposition de loi vise à supprimer ces restrictions, à simplifier considérablement les règles de fonctionnement du dispositif et à faciliter la monétisation, c'est-à-dire la transformation en argent de droits inscrits sur le compte épargne-temps. Un salarié pourra aisément affecter des jours de congé, des jours de RTT ou des repos compensateurs sur son compte et obtenir en contrepartie un complément de rémunération. Il pourra également épargner les droits accumulés en les transférant sur un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne retraite d'entreprise.
D'un point de vue comptable, les droits affectés par les salariés sur le compte épargne-temps sont provisionnés par les entreprises et inscrits à leur passif. Pour éviter d'alourdir excessivement ce passif, il est prévu que les droits accumulés seront liquidés dès lors qu'ils dépasseront un certain montant défini par décret. Si l'entreprise fait faillite, les droits acquis seront garantis par l'AGS, l'Association pour la garantie des salaires.
J'en viens maintenant à l'article 2, qui vise à introduire dans notre droit du travail un nouveau régime d'heures choisies : il s'agit de permettre aux salariés qui le désirent de travailler, en accord avec leur employeur, au-delà de leur contingent d'heures supplémentaires, le contingent légal - je le rappelle pour mémoire - étant fixé à 220 heures par an.
La mise en oeuvre des heures choisies est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement prévoyant notamment la modalité de rémunération de ces heures. Ces dernières ne pourront, en tout état de cause, être rémunérées à un taux inférieur à celui qui est applicable aux heures supplémentaires effectuées dans l'entreprise. L'accord pourra éventuellement prévoir, de surcroît, un repos compensateur.
L'article 2 traite également du cas des cadres ayant conclu une convention de forfait individuelle en heures sur une base annuelle ou une convention de forfait en jours. Ces cadres étant soumis à des modalités particulières de décompte de leur temps de travail, il est nécessaire d'adapter à leur intention le régime juridique des heures choisies afin qu'eux aussi puissent, sur la base du volontariat, travailler plus pour gagner plus.
Enfin, l'article 3 concerne les entreprises de moins de vingt et un salariés. Il proroge jusqu'à la fin de l'année 2008 des règles dérogatoires qui devaient en principe arriver à échéance à la fin de l'année 2005.
Le taux de majoration des heures supplémentaires restera ainsi à seulement 10 % dans ces entreprises, contre 25 % dans les entreprises de plus de vingt salariés.
Les heures supplémentaires s'imputeront toujours sur le contingent au-delà de la 36e heure, alors qu'elles s'y imputent au-delà de la 35e heure dans les plus grandes entreprises.
Ces mesures dérogatoires, qui étaient déjà prévues dans la deuxième loi Aubry du 19 janvier 2000, ont pour objet d'aider les petites entreprises à s'adapter plus facilement aux 35 heures en ménageant à leur intention des périodes de transition plus longues.
Ce dispositif a été légèrement retouché en première lecture puisque l'Assemblée nationale a adopté, sur l'initiative du Gouvernement, un amendement modifiant son champ d'application.
Pour des raisons historiques, ces dérogations concernaient jusqu'à présent les entreprises qui comptaient au plus vingt salariés au 1er janvier 2000. De ce fait, les entreprises qui, depuis cette date, ont dépassé le seuil de vingt salariés - parce qu'elles ont grandi, parce qu'elles ont fait de bonnes affaires et parce qu'elles se sont fortifiées - continuent, sans justification objective, d'en bénéficier. De la même manière, la question se pose du traitement à accorder aux petites entreprises créées après le 1er janvier 2000.
Dans un souci de clarification, l'Assemblée nationale a donc décidé que ces règles dérogatoires s'appliqueraient désormais aux entreprises comptant vingt salariés au plus à la date de promulgation de la présente loi. On estime qu'environ 6 000 entreprises - on a dit 10 000 à l'origine, mais il semble que ce soit 6 000 -, dont l'effectif dépasse à présent les vingt salariés, perdront le bénéfice de ces dérogations.
L'article 3 organise par ailleurs un système transitoire de renonciation par les salariés de ces entreprises à une partie des jours de repos issus de la réduction du temps de travail en échange d'une majoration de leur rémunération. Ce régime s'applique dans les entreprises de moins de vingt et un salariés tant qu'elles ne se sont pas dotées d'un compte épargne-temps et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2008.
Le travail réalisé à l'Assemblée nationale a permis d'améliorer la rédaction du texte et d'apporter des précisions utiles concernant notamment le régime des cadres soumis à des conventions de forfait. Pour ces motifs, la commission des affaires sociales ne vous présentera que trois amendements à cette proposition de loi, mes chers collègues.
Le premier a pour objectif d'empêcher que la cinquième semaine de congés payés puisse être échangée contre un complément de rémunération.
Nous avons en effet considéré que la législation relative aux congés payés relève d'une logique de protection de la santé et de la sécurité au travail à préserver.
Nous n'avons pas, de plus, voulu toucher à cet acquis social important.
Le deuxième amendement est de nature fiscale. Il vise à compléter le dispositif d'encouragement à l'épargne-retraite, adopté par l'Assemblée nationale au profit des plans d'épargne retraite d'entreprise ou des régimes de retraite supplémentaire d'entreprise.
Le troisième amendement, enfin, tend à indiquer clairement que le recours aux heures choisies ne saurait conduire un salarié à dépasser la durée maximale journalière du travail, qui est fixée à dix heures.
Sous réserve de l'adoption de ces quelques amendements, la commission des affaires sociales a émis un avis favorable à l'adoption de cette proposition de loi qui lui paraît de nature à desserrer les contraintes qui pèsent sur les salariés comme sur les entreprises de notre pays.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
M. Adrien Gouteyron remplace M. Christian Poncelet au fauteuil de la présidence.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, sans aucun doute, la question des 35 heures constitue depuis plusieurs années l'une des lignes de fracture majeures qui distinguent la droite de la gauche. Les promoteurs de cette réforme, engagée en 1998 et généralisée à compter de l'année 2000, s'appuient sur l'idée que le travail est une sorte de stock de milliards d'heures qu'il est possible de partager entre plus ou moins de travailleurs, mais ils ne tiennent pas compte d'autres paramètres comme le secteur d'activité, la taille de l'entreprise, la qualification de la main-d'oeuvre, le niveau de l'activité, la concurrence internationale, etc.
Toutefois, si la fixation autoritaire de la durée du travail à 35 heures fait débat, la problématique de la réduction du temps de travail, elle, n'est pas un thème réservé à la gauche.
A cet égard, monsieur le ministre, je m'étonne des reproches qui vous sont parfois adressés alors même que vous êtes l'un des premiers à avoir estimé que, dans certaines conditions, la réduction du temps de travail pouvait constituer l'un des outils de la lutte contre le chômage.

En effet, dès 1992, à une époque où l'idée pouvait apparaître quelque peu iconoclaste au sein de votre famille politique, vous préconisiez « d'encourager une nouvelle répartition du travail par des mesures incitatives ». C'était dans un rapport sur la politique de la ville que vous aviez présenté et publié au nom de la commission des affaires économiques du Sénat, et vous développiez cette idée sur plusieurs pages, que je tiens à la disposition de nos collègues. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

Ce qui m'a frappé, en lisant ce que vous écriviez voilà un peu plus de douze ans, c'est que, d'emblée, vous estimiez que « les modalités concrètes de la répartition du travail doivent d'abord être dégagées de manière pragmatique et adaptées à la diversité des contextes économiques par la voie de la négociation collective au sein de l'entreprise et des branches d'activité ».

Pour vous, ce n'était qu'au vu du résultat des premières expériences que le législateur était fondé à intervenir pour « harmoniser ces procédures ».
Chacun peut constater la différence majeure d'approche avec ce qui a été fait pour instaurer les 35 heures !
J'incline à penser, mes chers collègues, que c'est là, dans le rôle reconnu à la négociation collective, que se trouve la source majeure de nos divergences : nous, nous considérons que la négociation collective est essentielle pour parvenir à une réduction progressive du temps de travail adaptée aux réalités économiques et aux contraintes des entreprises, tandis que l'opposition a voulu, par la force contraignante de la loi, loger tout le monde à la même enseigne.
Or, à l'évidence, le bilan des lois Aubry sur les 35 heures n'est pas flatteur. Il ne m'appartient pas de dresser aujourd'hui le tableau complet, portant sur plusieurs années, de cette réforme. D'autres s'y sont livrés avec une grande rigueur, en ayant le souci de ne pas taire les avantages qu'ont pu en tirer un certain nombre de grandes entreprises, notamment dans le secteur industriel : je pense naturellement aux travaux menés l'an dernier par la mission commune d'information de l'Assemblée nationale, au rapport de M. Michel de Virville sur le code du travail
Exclamations sur les travées du groupe socialiste

Ainsi, on ne peut gommer les points noirs de cette législation, points noirs qui ne sont guère contestés chez les économistes.
D'abord, cette réforme a profondément fragilisé le tissu industriel. Nos entreprises ne sont en effet pas toutes égales devant la nouvelle donne. Bien sûr, comme je viens de l'indiquer, les grands groupes ont tiré parti de cette nouvelle législation. Les grosses structures ont pu rationaliser leur organisation, jouer avec la modulation pour augmenter leur productivité, prendre le temps de négocier avec les organisations syndicales, externaliser les activités qui devenaient trop onéreuses, optimiser le bénéfice des aides publiques associées à la réforme. Personne ne le conteste.
Mais, pour les PME, notamment celles qui sont soumises à la concurrence internationale, pour les petites entreprises qui ne possèdent ni l'assise financière ni la logistique humaine pour supporter toute la bureaucratie nécessaire à la mise en oeuvre d'un tel dispositif, les effets sont dévastateurs :enchérissement général des coûts, incapacité à répondre en flux tendus aux évolutions de la demande et aux exigences des clients, difficultés de recrutement de cadres, voire de main-d'oeuvre qualifiée, toujours tentés de rejoindre des grandes entreprises ; nous avons l'impression que tout a été fait pour attenter à leurs capacités concurrentielles.
Le second aspect de la mise en place des 35 heures, tout aussi important d'ailleurs que le premier, concerne les salariés, dont beaucoup ont subi de plein fouet les conséquences de la modération salariale sur laquelle a été gagée une partie de la réforme des 35 heures, ainsi que les limites contraignantes imposées dans la gestion de leur temps. Quel étrange décalage entre discours et réalité que d'avoir prétendu leur donner un plus grand choix, alors même qu'était réduite leur faculté d'arbitrer entre leurs propres priorités : disposer de plus de temps libre ou travailler plus pour gagner plus afin d'augmenter leurs revenus !
Ainsi, la réduction du temps de travail a directement affecté la rémunération de dizaines de milliers de salariés, surtout parmi les plus modestes, à tel point que l'amélioration du pouvoir d'achat est redevenue aujourd'hui la question primordiale de nos concitoyens !
Enfin, avec cette réforme, la France s'est singularisée parmi les pays industrialisés. Nulle part ailleurs, en effet, la diminution du temps de travail n'a été brutalement décidée par le pouvoir politique, ni réalisée avec tant d'ampleur et aussi rapidement. D'ailleurs, aucun pays partenaire, même ceux qui sont dirigés par des gouvernements socialistes, n'a jamais cherché à nous imiter.
Dans ce contexte, la proposition de loi de nos collègues députés vient à point nommé. Il faut le réaffirmer : elle ne remet nullement en cause les 35 heures
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC

... dispositif législatif auquel se sont adaptées, malgré les difficultés, la plupart des entreprises françaises concernées qui, dorénavant, ont avant tout besoin de stabilité.
S'inscrivant dans le cadre du « Contrat France 2005 », défini le 9 décembre 2004 par M. le Premier ministre, cette proposition de loi ouvre simplement aux salariés des espaces de liberté nouveaux leur permettant, tout en bénéficiant d'une protection individuelle garantie par des accords collectifs, d'exercer véritablement un choix de rythme de travail et d'arbitrer entre revenus supplémentaires ou temps libre.
Elle fait suite aux assouplissements apportés par la loi Fillon du 17 janvier 2003, et complétés par la loi du 4 mai 2004, qui ont modifié les dispositions les plus pénalisantes de la législation sur le temps de travail.
Grâce à ces réformes, un premier équilibre a permis de répondre tant aux aspirations des salariés à augmenter leurs revenus qu'à la nécessité pour les entreprises de disposer de facilités supplémentaires afin de s'adapter aux évolutions de leurs marchés.

C'est donc dans un cadre conventionnel rénové par la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social que pourraient s'inscrire les nouveaux assouplissements envisagés dans la présente proposition de loi. Il y est en effet suggéré de développer plus avant les pistes ouvertes par la loi Fillon du 17 janvier 2003 concernant la gestion du compte épargne-temps, le CET, le développement du temps choisi ainsi que les dispositions temporaires propres aux entreprises de vingt salariés au plus.
M. le rapporteur ayant détaillé le dispositif des trois articles du texte, je me bornerai à indiquer quelles réflexions ceux-ci ont suscité au sein de la commission des affaires économiques et à vous faire connaître sa position.
A l'article 1er, qui vise à favoriser le développement du CET, en en simplifiant le mécanisme et en assouplissant ses conditions d'alimentation et de liquidation, trois types de questions peuvent se poser.
En premier lieu, la faculté nouvellement offerte au salarié d'imputer sur son CET des heures de repos compensateur obligatoire est-elle susceptible d'affecter sa santé ? La réponse est négative, puisque aucune des dispositions du socle législatif fixant la durée hebdomadaire maximale du travail, organisant le travail de nuit et imposant des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire n'est remise en cause. Je tiens à insister sur ce point : aucune de ces garanties prévues par le code du travail pour protéger la santé des travailleurs n'est modifiée. Dès lors, étant donné que la réforme du CET s'inscrit dans ce cadre protecteur, toute argumentation articulée autour de la problématique de la santé n'est qu'un faux procès.
En deuxième lieu, les nouvelles possibilités d'abondement du CET vont-elles permettre à l'employeur d'échapper aux mécanismes de majoration des heures supplémentaires ? Vos propos, monsieur le ministre, tant à l'Assemblée nationale que dans votre intervention ici même aujourd'hui sont très clairs : la rémunération, les majorations, l'évolution de la monétarisation des droits ou encore l'assujettissement aux cotisations sociales sont strictement conformes aux dispositions légales ou aux règles conventionnelles applicables à l'entreprise. Donc, là encore, inutile de crier à l'anathème ! §
Enfin, s'agissant des garanties protégeant les droits acquis du compte, vous avez également explicité comment s'effectuerait le provisionnement par l'entreprise ou la prise en charge par l'AGS, l'association pour la garantie des salaires, en cas de défaillance, voire, au-delà d'un certain plafond, par un tiers garantissant, selon un mécanisme d'assurance.
Compte tenu de tous ces éléments, la commission des affaires économiques a émis un avis favorable sur l'article 1er. Elle est en effet convaincue que la modernisation du CET, qui offre aux salariés de nouvelles libertés dans la gestion de leur temps et de leurs revenus professionnels tout au long de leur vie active, devrait favoriser un nouvel essor de ce dispositif.
L'article 2 de la proposition de loi institue le régime du temps choisi permettant aux salariés, en accord avec le chef d'entreprise, de travailler plus s'ils souhaitent augmenter leur rémunération.
L'un des effets pervers du mécanisme légal d'organisation du temps de travail dans l'entreprise est qu'il empêche les salariés qui le souhaitent individuellement de travailler plus pour augmenter leurs revenus. La modération salariale ayant accompagné le processus progressif de mise en oeuvre des 35 heures a ainsi contraint un certain nombre de travailleurs à subir la stagnation de leur pouvoir d'achat sans disposer de la faculté d'accroître leur rémunération par une augmentation de la durée de leur travail.
A l'inverse, nombre de petites entreprises sont souvent conduites à refuser tout simplement des commandes. En effet, elles sont trop petites pour disposer d'un volant de main- d'oeuvre permettant de jouer, par le jeu du contingent légal ou conventionnel des heures supplémentaires, avec les aléas de cette activité ; par ailleurs, l'accroissement ponctuel de la demande ne justifie pas l'embauche d'un nouveau salarié.
L'on ne peut que déplorer cette situation paradoxale dans laquelle la loi interdit d'accroître temporairement la durée du travail quand bien même le salarié et le chef d'entreprise le souhaiteraient et y auraient tous deux intérêt.
De même, il convient de prendre en compte la situation de diverses catégories de cadres qui ne peuvent concilier l'organisation de leur travail et les impératifs de résultats auxquels ils sont soumis qu'en renonçant, sans contrepartie, à certains de leurs droits.
Je ne reviendrai pas sur le dispositif de cet article, qu'a excellemment présenté M. Louis Souvet. Je m'étonne seulement que cette faculté nouvelle offerte aux salariés d'arbitrer entre leur temps de loisir et leur pouvoir d'achat rencontre tant d'oppositions de principe.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

En effet, mes chers collègues, l'alternative est simple. Soit, à défaut pour le salarié d'avoir atteint le plafond du contingent annuel d'heures supplémentaires, la nouvelle législation restera dans les faits lettre morte - mais quelle raison justifie alors de la combattre aussi vigoureusement ? Soit, au contraire, la loi nouvelle trouve à s'appliquer parce qu'un certain nombre de salariés sont placés dans les conditions d'y recourir et estiment avoir intérêt à le faire, et, dès lors, pourquoi le législateur leur interdirait-il cette opportunité ?
C'est avec la conviction qu'il est nécessaire et légitime de permettre à ceux de nos concitoyens qui le souhaitent de travailler davantage pour augmenter leurs revenus que la majorité de la commission des affaires économiques a émis un avis favorable sur cet article 2.
Quant à l'article 3 de la proposition de loi, il vise à répondre à la situation spécifique des petites entreprises de vingt salariés au plus qui, en l'absence d'une convention ou d'un accord collectif, ne peuvent mettre en oeuvre un régime conventionnel de rémunération des heures supplémentaires dérogeant au droit commun, ni proposer à leurs salariés d'ouvrir un CET.
Malgré les délais laissés par les lois Aubry puis par la loi Fillon de 2003, un nombre significatif de petites entreprises n'ont pas encore été en mesure d'organiser, par la voie de la négociation collective, un régime propre de majoration des heures supplémentaires. Or les conditions mêmes du dialogue social ont été substantiellement modifiées par la seconde loi Fillon de 2004, ce qui impose d'ouvrir un délai supplémentaire aux partenaires sociaux pour leur permettre de s'approprier et de mettre correctement en oeuvre ces nouvelles conditions.
En outre, parallèlement aux mesures d'assouplissement envisagées concernant le CET et le développement du temps choisi, il semble opportun et équitable de permettre aux salariés de ces très petites entreprises de valoriser, eux aussi, sous forme monétaire une partie du temps de repos dont ils disposent. Tout comme la mesure précédente, cette innovation ne pourrait être que temporaire dans l'attente que des accords collectifs permettent le développement du CET dans les entreprises.
Telles sont les raisons de la prolongation ou de l'institution des régimes dérogatoires propres aux entreprises de moins de vingt salariés prévus dans l'article 3.
Sur cet article, la commission des affaires économiques vous proposera, mes chers collègues, d'adopter un amendement destiné à formaliser de manière juridique l'engagement pris publiquement par M. le Premier ministre au début de mois de février dernier, à savoir que les régimes dérogatoires ainsi institués seront bien temporaires jusqu'au 31 décembre 2008 seulement.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, sous réserve de cet amendement, la commission des affaires économiques a émis un avis favorable à l'adoption de cette proposition de loi qui, sans remettre en cause le principe des 35 heures, apporte au dispositif des éléments de souplesse ouverts aux salariés.

Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour avis. S'ils s'en saisissent, cela ne pourra manquer de favoriser le développement de nos entreprises objectif auquel personne, j'imagine, ne songerait à s'opposer !
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'

J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :
Groupe Union pour un Mouvement Populaire, 75 minutes ;
Groupe socialiste, 49 minutes ;
Groupe Union centriste-UDF, 20 minutes ;
Groupe communiste républicain et citoyen, 16 minutes
Groupe du Rassemblement démocratique et social européen, 12 minutes.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Raymonde Le Texier. §

« Faut-il brûler le code du travail ? » Tel était, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le titre d'un article du journal Le Monde le 15 février dernier. C'est effectivement la question que l'on peut se poser lorsque l'on décrypte la proposition de loi qui nous est soumise !
Si, aujourd'hui, le Gouvernement fait mine de concentrer ses attaques sur les lois Aubry, c'est pour enfermer la gauche dans la justification du passé. Les 35 heures sont ainsi un chiffon rouge qu'il agite pour mieux cacher ses intentions véritables, à savoir abolir les règles qui protègent les salariés.
Cela a commencé en janvier 2003, avec l'adoption de la loi Fillon, qui sonnait déjà le glas de la réduction du temps de travail, et s'est trouvé confirmé avec la loi de programmation pour la cohésion sociale et les fameux amendements Larcher. Cela se poursuit - et ne s'achèvera malheureusement sans doute pas aujourd'hui - avec cette proposition de loi.
Quand est évoquée dans ce texte la liberté, c'est la loi du plus fort qui est rétablie ; quand il y est question d'assouplissement, c'est la hiérarchie des normes qui est détruite et, s'agissant du choix, c'est la contrainte qui est consacrée !
Comme preuve de ce travestissement des valeurs, la méthode choisie par ce gouvernement est révélatrice : pourquoi passer par une proposition de loi sur un thème si important ? Par intérêt pour le Parlement et respect des parlementaires, nous dit-on.
Ainsi, qu'une telle attitude permette d'éviter la concertation avec les syndicats, de passer outre l'avis du Conseil économique et social et du Conseil d'Etat n'aurait rien à voir dans ce choix ! En outre, que le Gouvernement veuille de cette façon ne pas donner à l'opinion l'impression d'être aux ordres du MEDEF n'entrerait pas en considération !

Enfin, qu'une telle procédure soit destinée à dédouaner l'exécutif d'une paternité encombrante ne saurait être imaginable !
Tant de lâcheté dans le procédé et de détermination dans l'exécution tendent à montrer que, si le Gouvernement n'assume pas cette loi, il n'en est pas innocent !

La loi de 2004 sur le dialogue social stipule que « toute réforme substantielle modifiant l'équilibre des relations sociales doit être précédée d'une concertation effective avec les partenaires sociaux et, le cas échéant, d'une négociation entre ceux-ci ».
Sans doute, s'agissant du présent texte, la cause est-elle bien mauvaise pour que le Gouvernement s'affranchisse des obligations qu'il avait lui-même souscrites !
Si la méthode éveille les soupçons, l'analyse de la proposition de loi les confirme, transformant la méfiance en inquiétude et l'inquiétude en colère.
En effet, cette proposition de loi repose sur une escroquerie sociale et un mensonge économique, bref sur une supercherie politique.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Escroquerie sociale, d'abord : l'objectif de la droite et du MEDEF est clair : remettre en cause le droit du travail. Dans de nombreux cas, cette proposition de loi ne laisse au salarié pour seule protection que le maigre paravent de la durée maximale du travail et la directive européenne sur les congés payés.
A terme, les garanties réelles qui resteront aux travailleurs sont l'interdiction de travailler plus de quarante-huit heures par semaine et le droit à quatre semaines de congés.
A ce propos, nous avons pris acte avec intérêt de l'amendement qui sera proposé par la commission. Sans doute a-t-elle pensé que les auteurs de cette proposition de loi allaient un peu loin !
Mensonge économique ensuite : alors que, en moyenne, le nombre d'heures supplémentaires effectuées excède rarement cinquante-six, on peut s'interroger sur les motivations obsessionnelles du Gouvernement à augmenter le temps de travail. La majorité des branches ne manifestent aucun besoin d'augmenter la durée du temps de travail, d'autant que la conjoncture économique n'y est pas favorable.
C'est à une crise de la demande que l'on assiste aujourd'hui, et non à une pénurie de l'offre. Les entreprises ne traversent pas une crise de rentabilité : elles font des profits, mais elles préfèrent rétribuer leurs actionnaires plutôt que leurs employés, spéculer plutôt qu'investir, délocaliser plutôt que miser sur la productivité, la qualité, l'innovation et la recherche.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC. - Exclamations sur les travées de l'UMP.

Cette loi n'aurait-elle pour seul objet que de répondre à la pénurie d'emplois constatée dans certains secteurs ? En effet, dans la grande distribution alimentaire et le BTP, par exemple, les difficultés de recrutement sont telles qu'elles contraignent les employés à effectuer des heures supplémentaires bien au-delà du contingent autorisé, plaçant ainsi leurs employeurs dans l'illégalité. La nouvelle législation, qui porte à deux cent vingt le nombre d'heures supplémentaires autorisées et qui permet la transformation du repos compensateur en épargne-temps, ne peut que répondre à leurs attentes.
En réalité, en réglant les problèmes de certaines branches identifiées, cette proposition de loi a surtout pour effet de saper les fondements du droit du travail et réduit comme une peau de chagrin la protection du salarié.
« En trois articles », me direz-vous ? Et pourquoi pas ? Boris Vian l'avait bien compris, qui chantait :
« Voilà des mois et des années
« Que j'essaie d'augmenter
« La portée de ma bombe
« Et je n'me suis pas rendu compt'
« Que la seul' chos' qui compt'
« C'est l'endroit où s'qu'elle tombe. »
Sourires sur les travées du groupe socialiste.

Mais ici, pour être ciblé, le dispositif mis en place par cette proposition de loi n'en est pas moins redoutablement efficace, au moins autant que la communication qui l'accompagne.
Premier axe de propagande : pour contrer toute critique, les promoteurs du dispositif insistent avant tout sur la liberté de choix du salarié. C'est une véritable tartufferie, qui exploite avec cynisme la pression du chômage sur le monde du travail.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Un étudiant en première année d'économie sait déjà que plus le chômage est élevé, plus le salarié devient une simple variable d'ajustement, « pressurable » à volonté et corvéable à merci.
La loi dite de cohésion sociale renforce et légitime cette règle issue des lois du marché : en effet, celle-ci fait du refus par le salarié d'une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail - salaire, lieu, temps... - un motif de licenciement. Ainsi, quand à la contrainte économique s'ajoute la contrainte juridique, il devient pour le moins difficile, voire franchement risqué, de refuser d'accomplir des heures supplémentaires.
Parlons aussi de ces « heures choisies » que la proposition de loi met gracieusement à disposition du salarié méritant qui souhaite travailler au-delà du contingent d'heures supplémentaires. Outre que la possibilité de bénéficier de ces heures dépend davantage des besoins et de la volonté du patron que du désir de l'employé, le nombre d'heures comme le montant de leur rémunération se négocient directement entre l'employé et l'employeur.

Seul encadrement : l'accord collectif, mais il n'est plus qu'une garantie de façade. En effet, celui-ci, depuis les fameux amendements Larcher, est essentiellement considéré comme une opportunité de déroger aux conventions collectives et aux accords de branche. Dans ce cas, en prime, le repos compensateur obligatoire ne s'applique pas.
Le salarié se retrouve seul face à l'employeur, à sa discrétion, pour ne pas dire à sa merci. Encore est-ce là la lecture réaliste ! En effet, dans le langage éthéré et fleuri des thuriféraires de la droite, on appelle cela « une démarche de confiance dans le dialogue social » !
Deuxième axe de propagande de la proposition de loi : « travailler plus pour gagner plus ».
Curieusement, une fois cet axiome énoncé, la proposition de loi, quant à elle, se concentre seulement sur le compte épargne-temps. N'est-ce pas curieux ? On s'attendrait à ce que le salarié, mû par la nécessité d'augmenter son salaire, se voie tout simplement offrir le paiement direct de ses heures supplémentaires. Eh bien non ! C'est sur l'initiative de l'employeur que les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail sont stockées.

Or à qui profite la transformation d'un complément de salaire en temps ? Avant tout à l'employeur, qui voit la part des charges sociales pouvant lui être imputée s'il paye des heures supplémentaires disparaître quand le travail, transformé en temps, ne fait plus l'objet d'un salaire mais d'une monétarisation. La différence sémantique est subtile ; les conséquences financières, quant à elles, sont palpables.
Par conséquent, abonder l'argent placé par le salarié est bien la moindre des choses lorsque les exonérations de charges dont bénéficie en contrepartie l'employeur sont bien plus élevées !
Tel est notamment le cas dès lors qu'un compte épargne-temps est transformé en plan d'épargne retraite ou en plan d'épargne entreprise.
Les charges alors récupérées par l'employeur représentent un vrai manque à gagner pour l'Etat et la sécurité sociale. Nous connaissons pourtant tous l'ampleur du déficit de notre système de protection sociale. Nous savons également tous, hélas ! que la réforme fait peser tout le poids de la solidarité et des déficits sur l'assuré social.
Par quelque bout que l'on prenne les réformes portées par ce Gouvernement, on constate que le cynisme du baron Seillière se révèle payant !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Bref, cette proposition de loi met en place un système qui permet d'augmenter la flexibilité sans imposer une obligation de rémunération immédiate, tout en offrant la perspective d'une économie de charges. On comprend que le MEDEF exulte !
Le plus amusant, si l'on peut dire, c'est que la rédaction de ce premier article apporte une autre information, qui est loin d'être négligeable : le salarié peut choisir de « compléter sa rémunération » à partir de son compte épargne-temps, en fonction de ce que définit la convention ou l'accord collectif.
Et là, les choses se corsent ! Un accord collectif, même conclu avec un syndicat minoritaire, voire avec un syndicat « maison », s'appliquera au sein de l'entreprise, quand bien même il contreviendrait à une convention de branche. Si le patron est habile, le salarié peut se voir dépouillé de la liberté de choisir la façon dont son compte épargne-temps sera géré et ce dernier pourra être automatiquement converti en plan d'épargne entreprise ou en plan d'épargne retraite.
« Travailler plus pour gagner plus », dites vous ?
Jusqu'alors, le contrat de travail ne pouvait être moins protecteur pour le salarié que l'accord d'entreprise, l'accord d'entreprise que l'accord de branche et l'accord de branche que l'accord interprofessionnel. Désormais, ce principe fondamental du droit social est renversé.
Les amendements Larcher contenus dans la loi de programmation pour la cohésion sociale avaient amorcé le processus d'abolition de la hiérarchie des normes. Cette proposition de loi complète la manoeuvre. Pis encore, dans certains cas, elle abolit carrément toute hiérarchie juridique.

Ainsi, dans les entreprises de vingt salariés et moins, un accord individuel entre le salarié et l'employeur peut contredire un accord collectif. C'est la théorie du renard dans le poulailler !

Lacordaire disait : « Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui libère ».
Privé de toute protection en matière de droit du travail autre que celles qui sont garanties par l'Union européenne, le salarié va pouvoir se rendre compte de lui-même de la justesse de cette citation. Car, aujourd'hui, le droit du travail devient l'exception et la dérogation la norme.
Et ce n'est pas fini : dans ce gouvernement, on n'oublie jamais que le gâteau n'est vraiment bon que si l'on y ajoute une cerise !
Revenons donc à ce merveilleux compte épargne-temps, dans lequel le salarié peut placer ses heures supplémentaires, son repos compensateur, ses primes, ses jours de RTT, une semaine de congés payés, ... et un raton laveur, pour que l'inventaire soit complet.
Se pose alors la question de la gestion de ce fameux compte épargne-temps. En effet, même si tout est fait pour neutraliser et retarder l'exercice du droit de tirage des salariés, il semble difficile de ne pas provisionner ce compte.
Or, si les employeurs ont intérêt à développer le compte épargne-temps, plus les sommes placées y sont importantes, plus le besoin de détourner l'obligation de provisionner les sommes théoriquement dues aux salariés se fait pressant.
Qui peut garantir, dans ces conditions, l'abondement réel des sommes placées dans le compte épargne-temps ? Quelle garantie ce dernier offrira-t-il dès lors qu'il alimentera des plans d'épargne retraite fondés sur des placements en bourse ? Que se passera-t-il en cas de redressement judiciaire ou de liquidation de l'entreprise ? Cette question est loin d'être anecdotique, lorsqu'on sait que la durée de vie d'une PME est en moyenne de cinq ans.
En fait, le compte épargne-temps est surtout un jackpot pour l'employeur : les salaires sont captés pour devenir un outil financier au seul bénéfice des patrons et des banquiers. En siphonnant directement les salaires à la source, il sert d'accélérateur à l'épargne retraite. C'est un mécanisme de crédit très efficace consenti aux employeurs par leurs salariés à travers deux éléments essentiels du contrat de travail : le salaire et la durée du travail.
Le compte épargne-temps, qui ne rapporte aucun intérêt et ne tient pas compte de l'inflation, sera en revanche pour le salarié un placement pour le moins médiocre et hasardeux. Ce dernier ferait mieux de se faire payer ses heures supplémentaires et de placer les sommes ainsi obtenues sur un compte rémunéré !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Par ailleurs, en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise, la seule garantie du salarié reste l'Association pour la garantie des salaires, l'AGS.
Or cette garantie est plafonnée. De plus, l'AGS cumule un déficit impressionnant - 700 millions d'euros pour l'année 2002-2003 -, qui fait craindre pour sa pérennité. Les salariés dont le compte épargne-temps sera fortement doté risquent donc de dépasser le plafond, surtout si celui-ci est identique pour les salaires et pour ledit compte épargne-temps.
Tout ce qui dépassera le plafond sera alors perdu - « Travailler plus pour gagner plus », dites-vous encore ? - d'autant que l'AGS est gérée uniquement par le patronat, dont la politique vise à faire baisser le plafond de garantie de l'organisme. Or, avec ce gouvernement, ce que le MEDEF veut, il l'obtient.
Mes chers collègues, cette proposition de loi organise cyniquement le démantèlement du droit du travail. La déréglementation s'opère au profit exclusif des entreprises et réduit le salarié à n'être plus que la chair à canon du profit. Alors que les bénéfices des entreprises sont en forte hausse, alors que le montant des dividendes versés aux actionnaires explose, aucune revalorisation des salaires n'est envisagée !
En trois articles, c'est au respect même du travail et à la légitimité de sa rétribution que cette proposition de loi porte ses coups. Ici, la réforme n'est que le triste masque de la régression.
Malheureusement, l'histoire l'a souvent montré, quand le changement s'appuie sur la manipulation et le mensonge pour mieux servir une caste, ce n'est pas le progrès qu'il porte, mais bien la réaction qu'il installe.
Cette proposition de loi est à la liberté du salarié ce que l'arbitraire est à la justice : une offense et une négation même de son principe.
C'est pourquoi, monsieur le ministre, nous allons combattre de toutes nos forces ce texte inique.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

M. Henri de Raincourt. Non, il va remettre les pendules à l'heure après votre délire !
Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai présidé en 1998 la commission d'enquête qui s'est penchée sur la mise en place de la réduction du temps de travail en France.
Les travaux de cette commission avaient notamment permis, à l'époque, de rappeler combien, dans notre société, le travail est essentiel à l'épanouissement de l'homme et de la femme, à leur dignité et au maintien de leur sens des responsabilités.
Or il faut bien constater aujourd'hui que la réduction imposée et généralisée du temps de travail a quelque peu modifié la perception de la notion « travail » par notre société.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Cette politique était en réalité un pari intellectuel : ses effets attendus en termes de créations d'emplois reposaient sur une construction théorique, faisant abstraction, notamment, de l'environnement économique national, et surtout international.
Il est difficile de prétendre que cette politique a réussi quand la France, qui est le seul pays européen a avoir fait le choix de la réduction du temps de travail, se situe au douzième rang parmi les pays de l'Union pour ses performances en matière d'emploi.
Il n'est certes pas question de remettre en cause les 35 heures : on sait que les revirements en droit social fragilisent les partenaires sociaux et l'ensemble des acteurs du secteur économique.
Les 35 heures resteront donc la durée légale du temps de travail. II est toutefois nécessaire d'y apporter quelques assouplissements pour remédier à l'insuffisante progression du pouvoir d'achat des salariés et pour favoriser la compétitivité de nos entreprises.
Faisons un rapide bilan des 35 heures.
Avec les 35 heures, on a voulu appliquer de façon autoritaire une règle uniforme.

Or la prise en compte de la liberté des individus et de la diversité des situations professionnelles aurait dû servir de garde-fou.

M. Alain Gournac. Les 35 heures généralisées ont créé des injustices parmi les entreprises et parmi les salariés.
Exclamations sur les travées du groupe CRC.

Les grandes entreprises ont eu la possibilité de passer aux 35 heures en annualisant et en flexibilisant la durée du travail tout en bénéficiant des allégements de charges financées par la collectivité, tandis que les petites entreprises, qui n'avaient pas les mêmes capacités à amortir ce choc, ont été mises en difficulté.

De nombreux cadres, qui subissent une pression importante dans leur travail, ont profité des forfaits jours prévus par la loi tandis qu'une grande partie des salariés se voyaient imposer des horaires sans avoir le choix d'effectuer des heures supplémentaires.
Les promoteurs des lois de 1998 et 1999 ont commis l'erreur de rester à un niveau macroéconomique, ignorant gravement, de ce fait, la situation des petites entreprises et de leurs salariés. D'ailleurs, des voix à gauche se sont élevées pour dénoncer cette bévue : en novembre 2000, mes chers collègues, Laurent Fabius §...
Sourires sur les travées de l'UMP.

...observa ainsi : « Chacun voit que les situations des entreprises ne sont pas toutes les mêmes. Pour certaines entreprises, les 35 heures ne posent pas de problème. Pour d'autres, c'est plus difficile. Des lois ont été votées, on ne les annulera pas, mais nous devons certainement traiter les situations diverses avec souplesse. »
Bravo ! C'est tout à fait ce que nous faisons aujourd'hui.
Les 35 heures ont également fait stagner les salaires, et c'est une injustice sociale dont sont victimes les Français les plus modestes.
En valeur absolue, les salariés modestes ont perdu entre un et deux points de pouvoir d'achat depuis trois ans.
Les 35 heures ont également entraîné la création de multiples SMIC. Heureusement, le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin a revalorisé significativement le SMIC horaire
Protestations sur les travées du groupe CRC

... afin d'aboutir à une unification vers le haut, cette fois, et non vers le bas !

M. Alain Gournac. Les 35 heures ont parfois détérioré les conditions de travail. Ainsi que l'a exposé Gérard Larcher, notre ministre délégué aux relations du travail, une étude de juin 2003 émanant de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, la DARES, faisait apparaître qu'un tiers des salariés et 44 % des ouvriers et des employés se disaient être plus stressés depuis la mise en place des 35 heures dans leur entreprise.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste.

En effet, certains accords ont pu prévoir davantage de flexibilité dans les horaires, ce qui peut satisfaire certains salariés mais en déstabiliser d'autres...
Les 35 heures ont contribué à dégrader la compétitivité internationale des entreprises françaises.
Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

II faut leur permettre de faire face à la concurrence grâce à davantage de réactivité.
Il était donc impératif d'introduire de la souplesse et de la liberté.
La loi Fillon de janvier 2003 a déjà ouvert des pistes...

...en permettant la négociation de nouveaux accords sur la durée du temps de travail et sur le régime des heures supplémentaires.
La loi de 2004 sur le dialogue social est venue compléter cette législation en favorisant la conclusion d'accords collectifs.
La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui invite avec pragmatisme à répondre aux besoins de nos entreprises et aux aspirations de leurs salariés.
Centrée sur la conclusion d'accords collectifs et l'adhésion personnelle du salarié à la modification de la durée de son temps de travail, elle offre à ce dernier une sécurité totale.
Ce texte permet d'enclencher une dynamique de revalorisation des bas salaires et du pouvoir d'achat en général.
Les conditions d'utilisation du compte épargne-temps sont assouplies. Les jours de repos ou de congé des salariés seront plus facilement cumulables dans ce compte et seront transformables en complément de salaire s'ils le souhaitent. Les seuils sont revus à la hausse, permettant une plus large utilisation, qui doit - c'est le but - se généraliser.
Je me réjouis notamment des dispositions qui facilitent l'abondement des produits d'épargne retraite créés par la loi Fillon par le biais du compte épargne-temps.
Le relèvement du contingent des heures supplémentaires permettra à ceux qui le souhaitent de travailler plus pour gagner plus.

Ces heures choisies qui s'ajoutent aux heures supplémentaires donneront droit à des majorations de salaire et, le cas échéant, à des contreparties en termes de repos. Cela s'inscrit bien entendu dans la limite des quarante-huit heures hebdomadaires.
Les inquiétudes de certains concernant l'absence de garantie pour le salarié sont dénuées de tout fondement puisque, précisément, le dispositif est totalement conditionné par l'accord du salarié et s'inscrit dans le cadre d'un accord collectif protecteur.

L'autre argument selon lequel une majorité de salariés ne souhaiteraient pas modifier la durée de leur temps de travail est assez étonnant. Même si cela est vrai - et j'en doute -, nous devons laisser aux autres le choix de modifier la leur.

Nous souhaitons revaloriser l'effort aux yeux de tous. Le travail est ainsi de nouveau lié plus étroitement à la rémunération et à la satisfaction de participer à la prospérité de l'entreprise.
Le travail libère parce qu'il rend autonome. Aussi les salariés pourront-ils moduler leur temps de travail en fonction de leurs besoins d'argent ou de temps libre à consacrer à leur famille ou à leurs loisirs.
Contrairement aux idées ayant présidé à la mise en place généralisée des 35 heures, c'est le travail qui crée le travail, qui crée l'emploi, parce qu'il est créateur de richesse.

Autre souplesse, les cadres pourront également renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire, ce qui correspond à une forte demande. Encore une fois, cela ne s'effectuera, bien entendu, qu'à la demande du salarié.
Enfin, le dernier article procède à la prorogation pour trois ans du dispositif concernant les entreprises de moins de vingt salariés en matière de taux de rémunération des heures supplémentaires et d'imputation sur le contingent.

II permet aussi aux salariés d'échanger leurs jours de RTT contre une rémunération, dans la limite de dix jours. Là encore, « accord collectif », « volontariat », « respect des partenaires sociaux », « confiance » sont les maîtres mots du dispositif.
Ce texte, mes chers collègues, s'inscrit dans une dynamique de libération des énergies et vient compléter les politiques publiques de lutte contre le chômage précédemment engagées.
Les résultats indéniables des abaissements de charges sur l'emploi des salariés les moins qualifiés nous montrent la voie qu'il faut continuer à suivre.
Aussi le plan annoncé le 16 février dernier en faveur des emplois de services prévoyant des allégements de charges sociales va-t-il dans le bon sens.
La loi de programmation pour la cohésion sociale devrait également améliorer le contenu de la croissance en emplois.

M. Alain Gournac. Le groupe UMP adoptera cette proposition de loi, car elle crée un environnement favorable à l'émergence et au développement de nouvelles activités, favorise les initiatives, libère le travail de contraintes injustifiées et met un terme au rationnement du travail.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, autant le dire tout de suite, la présente proposition de loi me semble, dans ses grandes lignes, aussi utile qu'un cautère sur une jambe de bois.

Elle ne mérite ni excès d'indignité ni l'inverse.
La Haute Assemblée est aujourd'hui appelée à aménager un système qui est fondamentalement vicié. S'il n'est pas douteux que la réduction du temps de travail, rendue possible par le progrès technique et ses gains de productivité, est un mouvement historique irrésistible, en revanche, le choix d'une réduction du temps de travail brusque, drastique et autoritaire est nettement plus contestable.
De l'avis des plus éminents experts, de droite comme de gauche, le cadre rigide des lois Aubry coûte beaucoup à notre économie sans avoir véritablement favorisé la création d'emplois, tout au moins dans les proportions escomptées. On parlait de 800 000 emplois, on en a eu 300 000 à 400 000.
De plus, sa mise en place n'a pas été un monument de démocratie sociale.

Pour toutes ces raisons, le système souple institué en 1996 par Gilles de Robien était de loin préférable, à mon avis, à celui qui régit aujourd'hui l'organisation du temps de travail dans l'entreprise.
En effet, le monde de l'entreprise n'est pas un tout homogène. Les structures de production se trouvent confrontées à des besoins et des impératifs différents en fonction de leur secteur d'activité. Elles ont aussi besoin de pouvoir s'adapter aux fluctuations du marché, de leur environnement économique.
Face à cette réalité protéiforme, seuls les partenaires sociaux, dans le cadre de leurs conventions ou accords collectifs, sont à même de pouvoir juger des dispositifs de RTT les plus adaptés à la situation réelle de leur branche ou de leur entreprise.
Malgré tout, les 35 heures sont un acquis social sur lequel nous ne reviendrons pas. Vous l'avez vous-même confirmé, monsieur le ministre.
Partant de ce constat, que peut-on dire de la présente proposition de loi ? Pas grand-chose en réalité.
L'assouplissement du compte épargne-temps n'est, bien entendu, pas une mauvaise mesure, quoique assez anecdotique.
La possibilité de convertir ses droits acquis en augmentation de salaire me paraît être le seul apport substantiel du dispositif proposé.
Il en est de même du droit ouvert par l'article 2 aux salariés, aux cadres en particulier, de renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de leur salaire.
Mais, à côté de cela, ce que l'on nous présente comme la mesure phare du texte, la création des « heures choisies », me semble plus contestable.
D'abord, lorsque l'on parle d'« heures choisies », il est bon de se demander : « choisies par qui ? » Ne nous voilons pas la face, lorsque l'on connaît un peu les rapports existants au sein de l'entreprise - j'ai une longue expérience en ce domaine en tant que syndicaliste...

... mais aussi en tant que dirigeant - on sait qu'en pratique les heures choisies le seront par l'employeur et rarement par le salarié.

Ainsi, ce régime d'heures choisies ouvre en théorie la semaine des 48 heures. La barrière communautaire européenne, M. le ministre l'a rappelé, deviendrait donc l'ultime filet de protection sociale.
En réalité, même ces critiques et ces craintes sont infondées. Tout simplement parce que, la plupart du temps, tous les partenaires nous l'ont dit, les heures choisies ne serviront à rien. En effet, dans la majorité des entreprises, le contingent d'heures supplémentaires est bien loin d'être utilisé en totalité.
Ce système servira donc en fait à la marge, pour des emplois saisonniers, pour des cadres ou des agents qui travaillent en urgence sur un projet.
Reste la question de la prorogation du régime dérogatoire applicable aux petites entreprises, posée par l'article 3.
Une telle dérogation est injuste. Il n'y a aucune raison de traiter moins bien les salariés employés dans des entreprises de moins de vingt salariés que leurs homologues des grandes structures.
L'argument invoqué est d'ordre économique. Il est possible et même probable qu'une majoration de 25 % des premières heures supplémentaires serait insupportable pour certaines petites entreprises.
C'est pourquoi nous vous proposerons, par un amendement, de contourner la difficulté en compensant la majoration de ces heures supplémentaires au même taux pour toutes les entreprises par une exonération de charges sociales gagée à due concurrence par une augmentation de TVA. Il serait ainsi question de commencer à mettre en place un système de TVA sociale.
Monsieur le ministre, malgré la gravité du sujet, je terminerai sur une note d'humour afin de détendre l'atmosphère.
Je ne prolongerai pas mon propos, car cinq minutes de notre temps de parole représentent 1/420e de notre temps de travail hebdomadaire légal.
Sourires

Or, vous le savez, le temps est un bien très précieux, inestimable même depuis la loi Aubry. Alors, épargnons-le !
Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Sourires

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, objet de débat et de controverses dans l'ensemble des pays industrialisés, la question de la durée du temps de travail soulève des enjeux économiques et sociétaux majeurs. En France, elle est au centre d'un combat acharné de la part du MEDEF et de la droite parlementaire depuis le 10 octobre 1997.
Depuis cette date, vous n'avez eu de cesse de dénoncer, sans jamais apporter la preuve de vos assertions, « la stratégie perdante de la RTT » et les régressions tant économiques que sociales dont elle serait responsable. Le très orienté rapport d'information du député Hervé Novelli n'a pu démontrer que la baisse de la durée du temps de travail ait entraîné une baisse de la compétitivité. Son auteur a même dû convenir de la création de 350 000 emplois, ce qui n'est pas sans importance à l'heure où la croissance française est moins créatrice d'emplois que par le passé.
Le président de l'Union professionnelle artisanale, l'UPA, a dit « pouvoir prouver que l'application des accords signés a permis de faire des gains de productivité et d'augmenter les bénéfices ». Quant aux salariés, ils sont une grande majorité à vouloir préserver cet acquis social et à porter en même temps une forte exigence de maintien de leur pouvoir d'achat.
Le chantage à l'emploi auquel se sont scandaleusement livrés de grands groupes, en l'occurrence Bosch, Siemens et SEB, profitant du contexte pour obtenir une nouvelle réduction du coût du travail, visait à arracher aux salariés une augmentation de leur durée de travail sans compensation salariale.
Tout en passant sous silence les contraintes budgétaires plus pressantes du pacte de stabilité, le Gouvernement Raffarin, sans chercher bien sûr à contenir, voire à endiguer ces offensives libérales, s'est engouffré dans les voies déjà ouvertes pour remettre sur le devant de la scène le sujet controversé de la réforme des 35 heures, qualifié jadis de débat imbécile par le Président de la République.
Dans un pays qui compte 4 millions de demandeurs d'emplois, où le taux de chômage officiel a désormais franchi la barre fatidique des 10 % de la population active, où le pouvoir d'achat, moteur de la croissance, est lui aussi en berne et où, en outre, le sous-emploi est massif, notamment aux âges extrêmes, la priorité sociale est-elle vraiment de revenir sur les 35 heures ?
Selon nous, l'urgence est plutôt de lutter résolument contre le chômage, en réfléchissant moins en termes de « travailler plus » qu'au fait d'être plus nombreux à travailler et de travailler mieux.
Au lieu de cela, vous stigmatisez une France paresseuse, notre société de loisirs oubliant au passage les individus privés de travail, ceux qui sont contraints aux petits boulots cumulés pour tenter de vivre, tous les travailleurs pauvres de l'hôtellerie et de la restauration, des services, de la distribution, qui, faute de pouvoir travailler plus de vingt heures payées au SMIC, gagnent 525 euros par mois, mais aussi les femmes, qui occupent 85 % des emplois à temps partiel de moins de quinze heures hebdomadaires, aux journées éclatées et harassantes entre transport, travail peu valorisant et enfants qui attendent, sans compter les saisonniers et tous ceux qui occupent un emploi précaire.
A tous ces adultes en âge de travailler, aux 3, 6 millions de personnes dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté, vous proposez - pour ne pas dire vous imposez - le sous-emploi, en copiant les politiques anglo-saxonnes du workfare.
Le texte que nous examinons est un non-sens dans ce contexte. Avec votre projet, on pourra faire travailler les salariés plus de 2 000 heures, ce qui était la revendication du patronat d'avant 1936 !
Les slogans sont instrumentalisés pour mieux revisiter, dans un sens hyper-individualiste, les relations de travail, comme l'a déploré M. Olivier Favereau : ce professeur d'économie souligne que, « regardés de près, du point de vue de la théorie économique, ces deux slogans, travailler plus pour gagner plus et rétablir la liberté de choix, sous couvert de modernité et de flexibilité, trahissent une vision de l'économie et de l'entreprise qui fleure bon le XIXe siècle ... ».
Qui sont les archaïques ?
Il regrette encore que l'« on nous propose, pour améliorer les performances de l'économie française, le schéma extensif qui est le prototype du capitalisme le plus archaïque - et certainement le moins défendable - non seulement sur le critère de justice sociale, mais aussi sur le critère d'efficacité économique ».
Je vous laisse, mes chers collègues, plaider en faveur d'un texte dit « pragmatique et équilibré ». Quant à moi, je suis convaincu du caractère étroitement idéologique des mesures qu'il recèle, visant prioritairement à accentuer la libéralisation du marché du travail.
Près de sept français sur dix ont exprimé de la sympathie envers les salariés du privé et du public qui sont descendus massivement dans la rue pour défendre les 35 heures, les salaires et l'emploi.
Les syndicats auditionnés par notre rapporteur ont tous confirmé, y compris les organisations patronales - à l'exception, bien sûr, ce qui nous rassure, du MEDEF et de la CGPME, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises -, qu'ils n'étaient pas demandeurs d'une remise en cause des 35 heures.
François Fillon fut déjà, de main de maître, à l'initiative de mesures assouplissant substantiellement la loi Aubry II, laquelle, il est vrai, s'était affranchie de deux verrous susceptibles de donner à la réduction du temps de travail toute son efficacité.
En 2003, M. Fillon évoquait aussi la liberté de pouvoir gagner davantage, alors qu'il ouvrait largement la possibilité d'abaisser à 10 % la majoration des heures supplémentaires via la négociation collective, déplaçant par la même occasion lesfrontières entre le rôle de la loi et celui de la convention, puisque les taux de droit commun, 25 % pour les huitpremières heures supplémentaires et 50 % au-delà, devenaientsupplétifs.
Quant à l'aménagement d'un régimespécifique de majoration des quatre premières heuressupplémentaires à 10 % seulement au bénéfice des pluspetites entreprises employant vingt salariés au plus, on peut constater là aussiqu'il était de nature à retirer du pouvoird'achat aux salariés.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires, fixé sans limite par simple accord d'entreprise, est passé de 130 à 180 heures. Les conventions de forfaits ont été élargies, contribuant à remettre en cause la durée légale.
Plus récemment, cette fois sous votre responsabilité, monsieur le ministre, à l'occasion de l'examen par le Parlement de la loi dite de cohésion sociale, des dérogations importantes ont été introduites au régime du travail de nuit pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, au risque de banaliser ce mode dérogatoire du temps de travail, nécessitant à ce titre une protection juridique sans faille et des garanties de compensation pour préserver la santé et la sécurité des salariés, mais aussi leur vie personnelle.
Une autre norme servant à définir le temps de travail effectif, celle qui a trait au temps de trajet, a elle aussi été appréhendée législativement de façon restrictive, au mépris de la jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation.
Bref, tous les outils permettant aux entreprises d'échapper à la réduction du temps de travail ou d'instrumentaliser cette dernière pour en tirer un maximum d'avantages, dans une logique de flexibilité et de compétitivité, existent bel et bien.
De l'avis unanime, certains de ces outils ne seraient pas pleinement utilisés par les entreprises. Je pense évidemment au contingent d'heures supplémentaires, porté à 180 heures annuelles, dont seules 70 heures en moyenne seraient utilisées aujourd'hui. Pourquoi alors décider de franchir un pas supplémentaire en portant ce dernier à 220 heures ?
Pourquoi tant d'acharnement de la part du Gouvernement à défendre une réforme contre les salariés, réforme qui, de surcroît, ne répond pas aux besoins de la majorité des entreprises ? Pour le bien-être des salariés, leur santé, leur pouvoir d'achat ? Pour l'emploi ?
Non, bien sûr ! Nous verrons ultérieurement qu'en réalité tout est illusion, leurre, prétexte à masquer les vrais débats.
Pour la CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens, « le thème de l'adaptation des 35 heures fait figure de bouc émissaire et occulte les autres problèmes structurels de l'économie française, comme la tendance au sous-investissement des entreprises ou l'insuffisance du financement du tissu industriel ».
Si les gouvernements Raffarin successifs ont effectivement agité les 35 heures, c'est pour mieux masquer l'échec de leurs politiques fiscale, économique et sociale, dont on mesure aujourd'hui les effets déplorables sur l'emploi et le pouvoir d'achat et, a contrario, les effets plus que bénéfiques sur le capital.
Aux résultats spectaculaires affichés par BNP-Paribas et la Société Générale a succédé l'avalanche des résultats des grandes compagnies françaises en 2004, tous plus mirifiques les uns que les autres : 9 milliards d'euros de profits nets pour Total, soit un bénéfice en hausse de 23 %, un bénéfice net en hausse de 143 % pour L'Oréal, une hausse de 30 % de profits pour Schneider Electric, un bénéfice net d'Arcelor en hausse de 900 % et, dans toutes ces entreprises, des suppressions d'emplois.
Dans ces conditions, vous aurez beaucoup de mal à nous convaincre de l'opportunité de vos choix, visant notamment à faciliter et à accélérer les restructurations et les procédures de licenciement, à abaisser toujours davantage le coût du travail et, par là même, à « smicariser » le salariat, ou de la nécessité de réduire encore l'impôt de solidarité sur la fortune, voire d'envisager, comme s'y est engagé le Président de la République, d'exonérer totalement, d'ici à trois ans, les entreprises de toute cotisation sociale au niveau du SMIC, sans parler de la réforme de la taxe professionnelle pour les collectivités territoriales.
Il sera particulièrement difficile pour ce gouvernement de rester désespérément sourd aux revendications légitimes des salariés et des fonctionnaires portant sur leur pouvoir d'achat.
Décidément, les contrastes sont trop forts entre, d'une part, l'aisance financière des entreprises, qui leur permet, selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, de dégager un taux de marge de plus de 40 %, conduisant ces dernières, au niveau européen, à verser 199 milliards d'euros de dividendes aux actionnaires et à payer, pour les plus grandes, 8 milliards en rachat d'actions et, d'autre part, la réalité de la modération salariale, la perte de pouvoir d'achat des salariés, toujours plus nombreux à être exposés à des carrières précaires et aux bas salaires, alors que leur productivité horaire est parmi les plus élevées d'Europe.
En 1975, moins de 5 % des salariés étaient rémunérés au SMIC. En 1993, ils étaient plus de 8 %. Ils sont désormais 14 %.
Je citerai d'autres statistiques éloquentes : en 2002, les salariés étaient près de 17 % à émarger à 950 euros net par mois, somme inférieure au SMIC, représentant les deux tiers du salaire médian et servant à référencer les bas salaires.
Par ailleurs, le nombre de branches professionnelles dont la grille démarre en dessous du salaire minimum a plus que doublé en quinze ans.
Le résultat des négociations annuelles menées dans toutes les entreprises sur le thème des salaires montre lui aussi toutes ses limites. En moyenne, les ouvriers de la métallurgie, dont près de la moitié vivent avec moins de 960 euros par mois, obtiennent des augmentations de salaires de 1, 8 % !
Allez-vous enfin, monsieur le ministre, prendre la mesure du caractère urgent et crucial de la question salariale, en la traitant dignement, notamment en convoquant sur ce thème une conférence nationale ?
S'agissant plus globalement du pouvoir d'achat des Français, allez-vous enfin admettre que sa moyenne de croissance est effectivement bien inférieure à celle des années passées - quand il ne « dégringole » pas ! - et que, là encore, vous portez une lourde responsabilité.
Par vos choix fiscaux, vous avez fait de la baisse des impôts pour les plus riches une priorité et, par vos pseudo-réformes des retraites, de la sécurité sociale, de la dépendance, vous avez augmenté les prélèvements sociaux.
Mes chers collègues, nous savons également que l'objet de cette proposition de loi déborde de la seule question du temps de travail.
Ne s'agit-il pas aussi, en réservant soi-disant une place plus importante à la négociation collective, d'individualiser encore davantage les rapports de travail et de renvoyer le salarié dans un tête-à-tête forcément déséquilibré avec son employeur ?
Laurent Mauduit, dans une analyse parue dans Le Monde du 16 février dernier, se demande légitimement si la droite libérale n'ambitionne pas toujours de brûler le code du travail, tant il est vrai que les réformes passées ou celles qui sont en préparation, notamment la réécriture du code du travail ou la création du fameux contrat intermédiaire, ajoutées au discours ambiant qui fait suite aux rapports de MM. de Virville ou Camdessus, tendent à remettre en cause le cadre traditionnel du contrat de travail.
La liberté du contrat de travail est un thème présent dans le texte qui nous est soumis. Or cette liberté est une fiction juridique, comme l'a rappelé récemment à La Tribune Philippe Waquet, remarque étant faite « que le contrat de travail est la seule convention qui établisse une relation de subordination entre les parties : le salarié doit obéir au patron ».
A vous entendre, les salariés n'auraient plus besoin d'être protégés par un socle commun de garanties, y compris contre eux-mêmes s'agissant de leur santé, ou contre leur employeur avec qui ils seraient à égalité !
C'est ainsi que vous justifiez l'article 2 du texte favorisant sur la base du volontariat - ou plutôt de la contrainte ! - le développement du temps dit choisi conduisant les salariés à effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel et faisant exploser pour les cadres au forfait la durée maximale de 218 jours actuellement applicable.
Toujours sous couvert de liberté du temps retrouvée, vous dénaturez le compte épargne-temps en l'axant sur son utilisation en argent, et vous circonscrivez étroitement la volonté du salarié dans ses modes d'utilisation tout en valorisant les choix de l'entreprise. Quelle conception univoque de la liberté !
Le MEDEF rêvait d'inverser la hiérarchie des normes, de déplacer l'équilibre entre ce qui relève de l'ordre public social, du législateur, et ce qui relève des normes pouvant être élaborées par la négociation collective, laquelle devrait être la plus décentralisée. M. Fillon, en bon génie, a exaucé ce premier voeu !
En généralisant plus récemment les fameux accords de méthode, ce gouvernement a également ouvert la porte à des dérogations, toujours synonymes de moindres garanties collectives pour les salariés, en matière de licenciements économiques. Avec ce texte, une autre barrière, trop encombrante pour le MEDEF, pourrait, elle aussi, sauter.
Désormais, via la possibilité de racheter des jours de repos, ouverte par l'article 3 aux salariés des PMI-PME, en dehors de tout accord collectif, un salarié pourra individuellement renoncer à ses droits en matière de réduction du temps de travail. Sous couvert de liberté de choix, le système de l'« opting out », cher aux Anglais, s'immisce dans notre droit social français et bouleverse gravement ses fondamentaux.
Bientôt, les contrats de travail fleuriront de clauses individuelles moins favorables aux salariés que la convention collective, moins favorables aussi que le code du travail. Le MEDEF, exhortant hier le Gouvernement pour qu'il abroge une fois pour toutes les 35 heures, est aujourd'hui pleinement satisfait.
Les déclarations de son président, on ne peut plus euphoriques et positives, saluant l'entrée « dans un nouveau monde » - rien de moins ! - confirment que les trois petits articles de la présente proposition de loi, élaborés sous la conduite du Gouvernement, ouvrent véritablement de nouvelles perspectives aux entreprises. Ces dernières pourront négocier directement avec les salariés de l'organisation et de la durée individuelle du temps de travail.
Nous nous opposons farouchement à cette lame de fond désorganisant la protection collective des salariés. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les parlementaires communistes se sont résolument engagés à la fois contre la directive Bolkestein et contre le traité de Constitution européenne. Ces textes, dont la cohérence est identique, sacrifient les droits et protections des travailleurs sur l'autel de la compétitivité pour asseoir la domination des marchés financiers.
La révision en cours de la directive européenne sur le temps de travail doit, elle aussi, monopoliser toute notre attention.
Tout d'abord, parce que, comme l'a dénoncé Gérard Filoche dans un entretien publié dans l'Humanité le 13 février dernier, « la Commission Barroso espère parvenir à autoriser jusqu'à 65 heures, en sortant du temps de travail, les temps d'astreinte ou les temps de garde ».
Ensuite, parce que la durée maximale fixée à 48 heures, qui n'existe pas dans les dix pays entrants, susceptible d'être revue à la baisse pour la protection de la santé des salariés, est la seule référence qui subsistera en France une fois assoupli le dispositif du compte-épargne temps, tel que prévu par l'article 1er.
A travers la centaine d'amendements déposés par le groupe communiste républicain et citoyen, nous montrerons que d'autres voies praticables au service de l'emploi, de la qualité et de salaires décents, sont possibles.
Nous nous attacherons également, en miroir aux critiques justes formulées à l'encontre du bilan social des 35 heures, de proposer - ce dont se dispensent les auteurs de la proposition de loi - des mesures de nature à améliorer les conditions de travail des salariés, à mieux articuler les temps de vie et, donc, à donner tout son sens à l'idée de temps choisi. Nous défendrons aussi des propositions afin de mettre un terme aux discriminations entre salariés.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, « le mal le plus profond, c'est le mépris du travail ». En paraphrasant, on pourrait dire : « travaillons plus pour gagner plus ». Une telle injonction pourrait paraître ultra-libérale à certains. En réalité, elle est tout simplement pleine de bon sens.

Quelle que soit l'époque, elle est pourtant plus réaliste que de nous pousser à travailler moins pour prendre des parts de marchés dans la très difficile compétition mondiale.
Quelle que soit notre appréciation personnelle - ou partisane - il y a une réalité : nous devons inéluctablement travailler plus pour payer nos retraites et une protection sociale digne du XXIe siècle.
Avec les 35 heures, nous avons proposé à nos concitoyens une forme de renoncement : renoncer à être les premiers, renoncer à conquérir les marchés, renoncer à l'enthousiasme. C'est un repli sur soi, un refus de la compétition, l'acceptation d'un déclin.

Il a fallu une dialectique bien éloignée de toute logique économique pour tenter de démontrer, sans y croire, que la mise en place des 35 heures serait une bonne décision pour la France. Cette réduction autoritaire du temps de travail fut une erreur économique, une erreur budgétaire et, surtout, une erreur sociale.

Erreur économique, car cette disposition française, qui a provoqué l'incrédulité ironique de nos concurrents, a handicapé nos entreprises, freiné notre PIB et fait reculer le revenu des Français dans les palmarès européens.

Erreur budgétaire, car l'allégement des charges sociales pour les entreprises passant aux 35 heures a généré pour l'Etat une dépense inutile et absurde - 8 milliards d'euros en 2003, 11, 3 milliards d'euros en 2004 - sans aucune valeur ajoutée en retour ni réelles créations d'emplois.
Il n'est pas équitable que ces non-rentrées fiscales pèsent les non-salariés, c'est-à-dire que les agriculteurs, les commerçants, les artisans et les professions libérales, en général, soient obligés de payer plus d'impôts pour que d'autres travaillent moins !

Erreur sociale, car, en limitant le temps de travail, on a interdit aux Français les plus modestes qui souhaitaient travailler plus pour gagner plus d'améliorer leur pouvoir d'achat afin de progresser dans l'échelle sociale.

Or, comme l'a justement souligné notre collègue Robert Badinter, « le travail de chacun doit être pleinement rémunéré en considération de ses efforts ». Ceux qui souhaitent travailler plus et qui ont travaillé davantage gagneront davantage !

Aujourd'hui, les 35 heures sont considérées comme un acquis social bien qu'elles constituent un handicap évident pour la compétitivité de notre pays.
N'y ajoutons pas un affrontement politique. Faisons le choix de la liberté de travailler, sur lequel nous devons tous nous réunir.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Le « temps choisi » répond à cette attente.
Pour cela, faisons table rase de toutes les désinformations.
Sourires

Rehaussons le débat en refusant les slogans de ceux qui en connaissent l'inexactitude lorsqu'ils parlent de « coup de grâce aux 35 heures » ou qu'ils affirment que les Français travailleront plus sans gagner plus si cette proposition de loi est votée. Ils savent que c'est faux !
Premièrement, il est faux de dire que les 35 heures ne seront plus la durée légale du temps de travail. Ce nouveau texte n'apporte aucun changement sur ce point dans le code du travail.

Deuxièmement, en ce qui concerne les heures supplémentaires, il est faux de dire que leur rémunération jusqu'à 48 heures par semaine, ou 44 heures sur douze semaines, ne bénéficiera plus d'une majoration. Si les heures volontairement portées par le salarié sur son compte épargne-temps, entre 35 et 39 heures, ne sont pas majorées en tant que telles, elles seront récupérées ultérieurement, et les heures supplémentaires au-delà de 39 heures seront majorées comme toute heure supplémentaire normale.
J'en profite pour affirmer que les heures supplémentaires favorisent l'emploi.Elles augmentent la production et les salaires, donc l'offre et la demande, dont la concomitance sont les bases d'une évolution saine de l'économie.

Troisièmement, il est encore faux d'affirmer que les heures rachetées dans les entreprises de moins de vingt salariés, toujours avec l'accord du salarié, ne seront pas majorées. Sur ce point précis, l'article 3 de la proposition de loi prévoit expressément cette majoration.
Quatrièmement, pour ce qui concerne les cadres, il est toujours faux de vouloir faire croire que les jours rachetés pourront être payés à un niveau inférieur à celui des jours normaux. Ce rachat implique que ces jours soient payés comme des jours ordinaires.
Cinquièmement, il est faux de dire que les salariés seront laissés seuls face aux chefs d'entreprise qui feront un chantage au licenciement.
Cette proposition de loi n'aura aucun effet direct...

... si un accord de branche ou d'entreprise n'a pas été négocié au préalable. Je suis convaincu que, tous ici, nous sommes des tenants des mérites et vertus de la négociation collective.

Au final, il s'agit bien de définir un principe du temps choisi, de préserver la liberté individuelle dans des conditions encadrées par des accords collectifs.

Cette liberté est toujours préférable à des législations plus contraignantes, autoritaires et malthusiennes comme le furent les lois Aubry sur les 35 heures.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, en votant cette proposition de loi, nous ferons 100 % de satisfaits chez les salariés du secteur privé.

Je veux parler des 77 % de salariés qui, selon les sondages, ne souhaiteraient pas augmenter la durée de leur temps de travail, qui est toujours de 35 heures par semaine aux termes de la loi, et qui pourront donc effectivement rester à 35 heures. Je veux aussi parler des 23 % restants qui, eux, souhaitent travailler plus pour gagner plus !

M. Aymeri de Montesquiou. Alors, votons ce texte qui permettra à la fois un progrès économique et un progrès social !
Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis plusieurs mois, le code du travail est sans cesse mis à mal dans des proportions spectaculaires, très révélatrices de la politique du Gouvernement.
En effet, par des moyens détournés, en cherchant à faire passer des amendements dans le cadre de projets de loi, le Gouvernement est parvenu, à plusieurs reprises, à revenir sur des acquis sociaux fondamentaux.
Dans la loi relative à la formation professionnelle et au dialogue social, des amendements visant à faire en sorte que des accords d'entreprise puissent ouvrir droit au bénéfice de dérogations au code du travail ont été adoptés. Auparavant, ces dérogations n'étaient réservées qu'aux accords de branche.
Plus récemment, un autre exemple illustre bien la méthode du Gouvernement. Je veux parler du projet de loi de cohésion sociale, dont le but affiché était de réduire la fracture sociale, et dont le résultat s'est traduit par l'introduction discrète de dispositions tendant à faciliter les licenciements.
Que nous propose-t-on aujourd'hui ? Des dispositions sur le régime du compte épargne-temps, le contingent des heures supplémentaires et la possibilité ouverte, par simple accord d'entreprise, de transformer du temps libre en rémunération sans obligation de passer par des accords de branche. Une fois encore, sous couvert de bonnes intentions et par des moyens détournés, une proposition - et non un projet de loi ! - s'en prend au code du travail, le but étant de tirer un trait sur les lois Aubry relatives aux 35 heures.
On nous rejoue l'air du « travailler plus pour gagner plus », vieux refrain libéral, et cela en donnant aux salariés la possibilité d'effectuer plus d'heures supplémentaires. Mais c'est faux ! Les heures supplémentaires, au lieu d'être majorées de 25 %, comme c'est le cas aujourd'hui, ne le seront plus que de 10 %. Faites le calcul : il faudra travailler cinq heures contre deux actuellement pour gagner autant !
On nous propose aussi le « temps choisi », qui serait discuté entre le salarié et le chef d'entreprise d'égal à égal. De qui se moque-t-on ? Je vois mal une caissière de grande surface, ni un ouvrier du BTP, d'ailleurs, pouvoir choisir ses horaires face à son patron.
Sourires sur les travées du groupe socialiste.

Qu'on le veuille ou non, outre qu'elle a permis de créer des emplois, la réduction du temps de travail est un acquis social, un acquis sociétal.
Une enquête scientifique consacrée aux effets de la réduction du temps de travail pour les salariés a montré que les femmes ont pu, dans une mesure considérable, mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, et que les hommes ont pu s'investir plus fortement dans la vie familiale, ce qui permet d'améliorer la qualité de vie.
Plus que le temps partiel, qui concerne une femme active sur trois et qui enferme dans la précarité, les 35 heures étaient une solution efficace et égalitaire pour concilier vie personnelle et vie professionnelle. L'harmonie de la cellule familiale, que cette dernière soit monoparentale, recomposée ou traditionnelle, n'est-elle pas une question importante pour notre société ?
En définitive, à qui profitera la mise en oeuvre des dispositions de cette proposition de loi ? Sûrement pas aux salariés, à qui l'on paiera à terme des jours de RTT qu'ils auraient préféré passer en famille et qui travailleront plus pour gagner moins que sous la réglementation actuelle ; sûrement pas aux femmes, auxquelles les emplois précaires resteront dévolus.
Le dialogue social est mis à mal, le mandatement disparaît, les formations syndicales sont écartées des petites entreprises et le démantèlement progressif du droit du travail se poursuit.
En fait, la mise en oeuvre des dispositions de cette proposition de loi profitera surtout au patronat, qui pourra rendre les femmes et les hommes au travail « malléables » et corvéables à merci. La commission des affaires sociales l'a d'ailleurs remarqué, et, en vue de limiter les dégâts, elle a adopté un amendement tendant à restreindre les possibilités de recours aux heures supplémentaires au-delà du nouveau contingent légal de 220 heures par an.
Monsieur le ministre, croyez-vous que ce soit du patronat qu'il faille se soucier aujourd'hui ? Après l'annonce récente d'une explosion des profits des grandes entreprises françaises et des dividendes versés par ces dernières, le taux de chômage est repassé au-dessus de la barre des 10 % de la population active, seuil qui n'avait plus été franchi depuis cinq ans ! Ce n'est pas en revenant sur une loi qui a fait ses preuves en matière de création d'emplois que vous allez inverser la tendance.
Ce texte est inacceptable, et nous voterons naturellement contre.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

M. Jean-Pierre Fourcade. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ayant soutenu à cette tribune par le passé la loi Robien contre l'avis d'un certain nombre de mes amis, je ne suis pas suspect d'être fondamentalement hostile à la réduction du temps de travail.
Ah ! sur les travées du groupe socialiste.

Toutefois, si la réduction du temps de travail est une mesure valable quand elle offre l'occasion d'améliorer la productivité d'une entreprise industrielle ou de services disposant de nombreuses machines et de beaucoup d'outillage, elle n'a aucun sens quand il s'agit de réduire le temps de travail de salariés qui sont assis derrière des guichets, qui rendent des services aux personnes ou qui sont chargés de régler des problèmes de la vie quotidienne.

Par conséquent, le fait d'avoir généralisé et rigidifié le dispositif de réduction du temps de travail place notre pays dans une position singulière.
Quand on observe les progrès de la Chine ou de l'Inde, quand on constate le développement économique des Etats-Unis, quand on voit ce qui se passe au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie ou même en Pologne, pays dont nous parlions avec M. le ministre voilà quelque temps, on peut établir trois constats.
Premier constat, la France occupe l'avant-dernier rang, parmi l'ensemble des pays de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économiques, en matière de durée du travail par personne.

Deuxième constat, le taux de chômage que nous connaissons - le seuil des 10 % de la population active vient d'être franchi - est l'un des plus élevés de l'OCDE.

Laissez-moi finir, chers collègues !
Troisième constat, notre pays supporte un déficit budgétaire qui compte parmi les plus forts de l'OCDE.
Pour ne pas soupçonner l'existence d'une corrélation entre ces trois constats, il faut vraiment être très ignorant en matière de politique économique, ...

... il faut vraiment être fermé aux problématiques de l'économie mondiale !

Cela m'amène à apporter mon soutien aux auteurs de la proposition de loi dont nous débattons ce soir.
Ce texte a été excellemment présenté par les deux rapporteurs, que je tiens à saluer, et les orateurs qui m'ont précédé, notamment MM. Gournac, de Montesquiou et Vanlerenberghe, ont parfaitement résumé son contenu.
Pour ma part, je suis favorable à l'amélioration et à l'assouplissement du dispositif du compte d'épargne-temps. Je le suis également aux propositions concernant les cadres, mais je souscris, non par habitude mais parce que cela répond à mes convictions, à l'amendement adopté par la commission des affaires sociales et tendant à préserver la cinquième semaine de congé, laquelle me paraît représenter un acquis. Je reconnais bien là l'empreinte de M. Souvet, qui se trouve à l'origine de cette initiative.
Cela étant, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'éprouve deux motifs d'inquiétude, sur lesquels je voudrais maintenant insister quelque peu.
Mon premier motif d'inquiétude concerne les petites entreprises, notamment celles qui sont de création récente.
L'action du Gouvernement a permis la création de 224 000 petites entreprises l'année dernière. Si l'on applique à ces nouvelles petites entreprises le régime général applicable aux multinationales ou aux filiales de celles-ci dans notre pays, on peut d'emblée être certain que leur taux de disparition sera élevé et que leur développement sera contrecarré.
Or, et c'est là qu'intervient le pragmatisme auquel s'est référé M. le ministre, que constate-t-on ? On constate que, à l'heure actuelle, les grandes entreprises ayant négocié des accords relatifs aux 35 heures ont stabilisé leur effectif salarié ou l'ont même légèrement réduit en procédant à des délocalisations, et que les créations d'emplois nouveaux dans ce pays sont essentiellement le fait, aujourd'hui, de petites entreprises.
Par conséquent, si notre législation nationale désavantage les petites entreprises et entrave leur développement, si l'on s'obstine à dire qu'il faut, pour des raisons de justice, que les heures supplémentaires soient rémunérées au même tarif dans les petites entreprises et dans les grandes, on aboutira à la fois à favoriser la création d'entreprises et à les tuer dans les deux ou trois années qui suivront.
C'est pourquoi je souhaite, monsieur le ministre, que l'on maintienne, s'agissant du régime applicable aux petites entreprises, les dispositions de la loi Fillon et des textes récents. Un certain nombre d'acteurs, notamment la CGPME, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, et l'UPA, l'Union professionnelle artisanale, demandent que l'on pérennise de manière définitive ce dispositif. Je ne crois pas que ce soit nécessaire, mais il faut laisser du temps aux petites entreprises.

Tous les maires ici présents et qui essaient de favoriser la création de petites entreprises savent que les deux ou trois années suivant celle-ci constituent la période la plus délicate.

M. Jean-Pierre Fourcade. Par conséquent, il ne faut pas casser le dynamisme des petites entreprises, car c'est d'elles que viendra la solution au problème de l'emploi.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Mon second motif d'inquiétude, monsieur le ministre, tient au fait que le dispositif des 35 heures engendre des dépenses extrêmement lourdes pour le budget de l'Etat, et qu'aucun autre pays de l'Union européenne ne connaît une telle situation.
Certes, je sais bien que, lorsque l'on a décidé la généralisation des 35 heures, on a en quelque sorte payé les entreprises pour qu'elles l'acceptent, ce qui a entraîné une considérable dérive budgétaire, représentant aujourd'hui entre un cinquième et un quart de notre déficit budgétaire. Les chiffres sont colossaux, et nous sommes les seuls en Europe à supporter une telle charge ! D'ailleurs, les ministres de l'économie et des finances ou les Premiers ministres de nos partenaires européens s'étonnent que nous puissions traîner un tel boulet ! Comment voulez-vous, disent-ils, retrouver un niveau de croissance satisfaisant en portant un fardeau de 10 milliards à 15 milliards d'euros annuels ?

M. Jean-Pierre Fourcade. Voilà quelle est la réalité de notre situation dans le monde !
Applaudissements sur les travées de l'UMP. - Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

... allez discuter avec les Suédois ou les Finlandais, et vous verrez que nous sommes considérés comme des « rigolos » par l'ensemble de nos partenaires ! Voilà la réalité !
J'ajouterai, chers collègues qui vous voulez des parangons en matière de compensation, que vous avez allègrement oublié les collectivités territoriales quand vous avez généralisé les 35 heures.

Aujourd'hui, notre fiscalité locale, dont certains ici se plaignent, se ressent des effets de l'application générale des 35 heures.

M. Jean-Pierre Fourcade. Les collectivités territoriales n'ont reçu aucune compensation de la part de l'Etat à ce titre ! Aucune !
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Je voudrais que l'on mette un terme aux conflits stériles : le vrai problème qui se pose à nous est de savoir si nous voulons lutter efficacement contre le chômage. Dans l'affirmative, il faut tout d'abord permettre aux petites entreprises de se créer et de se développer.

Il faut ensuite cesser de subventionner les entreprises qui ont négocié des accords relatifs aux 35 heures et élaborer, monsieur le ministre, un système de réduction programmée des dépenses, afin de récupérer des capacités budgétaires qui seront très utiles pour développer la recherche ou financer les investissements, notamment publics, qui nous font actuellement défaut.

Il faut enfin, comme le prévoit la proposition de loi, assouplir les dispositifs. Les personnes se satisfaisant de travailler 35 heures par semaine doivent pouvoir continuer à le faire.

Il ne faut donc pas toucher à la durée légale actuelle du travail de 35 heures, mais il faut laisser travailler davantage, sans les pénaliser, les salariés, notamment les cadres, et plus particulièrement encore les cadres âgés, les « seniors », dont la participation à l'activité du pays est d'une importance essentielle, nous le savons, pour le financement des régimes de retraite et le développement de la protection sociale.

M. Jean-Pierre Fourcade. Tel est l'objet de cette proposition de loi, et c'est la raison pour laquelle je la voterai.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Je rappelle au Sénat que le groupe Union pour un mouvement populaire a présenté quatre candidatures pour les commissions des affaires économiques et du Plan, des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, des affaires culturelles et des affaires sociales, que le groupe socialiste a présenté une candidature pour la commission des affaires économiques et du Plan et que le groupe communiste républicain et citoyen a présenté une candidature pour la commission des affaires sociales.
Le délai prévu par l'article 8 du règlement est expiré. La présidence n'a reçu aucune opposition.
En conséquence, je déclare ces candidatures ratifiées et je proclame :
- M. Francis Grignon pour siéger à la commission des affaires économiques et du Plan, à la place laissée vacante ;
- Mme Fabienne Keller pour siéger à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, à la place laissée vacante ;
- M. Philippe Richert pour siéger à la commission des affaires culturelles, à la place laissée vacante ;
- M. Roland Ries pour siéger à la commission des affaires économiques et du Plan, à la place laissée vacante ;
- Mme Esther Sittler pour siéger à la commission des affaires sociales, à la place laissée vacante ;
- Mme Gélita Hoarau pour siéger à la commission des affaires sociales, en remplacement de M. Paul Vergès, dont l'élection comme député au Parlement européen est devenue définitive.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt-et-une heures trente, sous la présidence de Mme Michèle André.