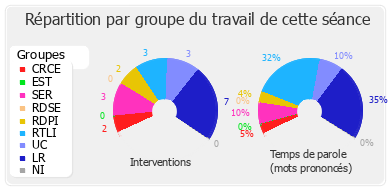Séance en hémicycle du 12 décembre 2018 à 21h45
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à vingt heures vingt, est reprise à vingt et une heures cinquante, sous la présidence de M. Philippe Dallier.

La séance est reprise.

L’ordre du jour appelle le débat, organisé à la demande du groupe Les Indépendants – République et Territoires, sur le thème : « Emplois non pourvus en France : quelles réponses ? quelles actions ? »
Nous allons procéder au débat sous la forme d’une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents.
Je vous rappelle que l’auteur de la demande du débat dispose d’un temps de parole de huit minutes, puis le Gouvernement répond pour une durée équivalente.
À l’issue du débat, le groupe auteur de la demande dispose d’un droit de conclusion pour une durée de cinq minutes.
Voici qui est original : M. Joël Guerriau, représentant du groupe auteur de la demande, auquel je devrais donner la parole en cet instant, n’est pas là !
Sourires.

Mes chers collègues, je vais donc suspendre la séance quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à vingt et une heures cinquante-deux, est reprise à vingt et une heures cinquante-cinq.

La séance est reprise.
Madame la ministre, mes chers collègues, M. Joël Guerriau ne nous ayant pas encore rejoints, nous allons innover et commencer par entendre le Gouvernement.
Assentiment.
Monsieur le président, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je tiens tout d’abord à remercier le groupe Les Indépendants – République et Territoires d’avoir inscrit ce thème très important à l’ordre du jour de la Haute Assemblée.
Il va permettre de prolonger les débats que nous avons eus il y a une semaine exactement, sur la mission « Travail et emploi », rapportée notamment par votre collègue Emmanuel Capus. Plus largement, ce débat sur les emplois non pourvus nous permet de poursuivre nos discussions sur les réformes en cours et sur les ordonnances pour le renforcement du dialogue social, ainsi que sur la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Le paradoxe, et c’est tout le sens de la question qui est posée, c’est l’existence concomitante, d’une part, de 2, 6 millions de personnes qui cherchent un emploi et, d’autre part, d’un nombre croissant d’entrepreneurs qui veulent embaucher, mais qui, faute de trouver les compétences, voire même des candidats, renoncent à des marchés ou à défaut sont contraints à recourir au travail détaché.
En 2018, l’enquête besoins en main-d’œuvre, ou BMO, de Pôle emploi, montre que la pénurie de candidats dans 83 % des cas est le premier motif des difficultés de recrutement, devant l’inadéquation des candidatures et la nature du poste proposé.
Ce sont ainsi entre 250 000 à 330 000 offres d’emploi qui n’avaient pas été pourvues en 2017. Même si nous n’avons bien évidemment pas encore les chiffres, ce sera plus en 2018, en raison de la dynamique de création d’emplois : 211 000 créations nettes en un an, soit l’équivalent des habitants de la ville de Rennes. Plus la dynamique de création d’emplois est forte, plus le désajustement entre l’offre et la demande, entre les compétences disponibles et les compétences recherchées, apparaît.
Il convient toutefois de rappeler que, dans un contexte d’accroissement fort des offres d’emploi déposées – plus 9, 2 % entre la mi-2017 et la mi-2018, soit 3, 5 millions d’offres déposées –, une large majorité des offres – plus de 90 % – sont pourvues. Ici, on parle du delta. Dans l’ensemble, le système fonctionne, mais nous sommes tous d’accord ici pour trouver insupportable que 300 000 emplois ne soient pas pourvus faute de compétences alors qu’il existe tant de demandeurs d’emploi.
Une étude de la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, la DARES, publiée hier, identifie clairement deux situations de tension sur le marché du travail. Elles sont sensiblement différentes.
D’une part, on trouve des métiers pour lesquels on recherche des personnes plutôt qualifiées, avec des besoins de recrutements forts, mais où le nombre de demandeurs d’emploi est faible. Dans ce cas, la problématique apparaît davantage liée à la qualification et au manque de qualification disponible sur le marché : soudeurs, chefs cuisiniers, ingénieurs de l’informatique, techniciens de l’électricité, de la maintenance, etc.
D’autre part, on trouve des métiers où les besoins de recrutement de la part des entreprises sont importants et coexistent avec un nombre significatif de chômeurs, souvent peu qualifiés et avec une forte rotation de la main-d’œuvre : ouvriers du bâtiment, aides à domicile, serveurs.
Une question préalable se pose : comment en sommes-nous arrivés à une telle situation, qui se retrouve sur l’ensemble du territoire, même si certains d’entre eux sont plus tendus que d’autres ?
Ces tensions sur le marché du travail sont liées au fait que la croissance s’accélère : il y a donc plus de demandes. Mais elles résultent aussi d’une série de résignations dont le caractère insidieux et interdépendant au fil du temps a produit ces effets.
La France est un des pays qui a connu trente ans de chômage de masse – et nous n’en sommes pas encore sortis –, fruit de décennies de croissance en berne, qui ont entamé notre capacité d’anticipation des besoins en main-d’œuvre. Chacun le comprendra aisément, cela n’a pas grand sens de se former quand on n’a pas de perspectives d’avenir. Résultat, la qualification de notre main-d’œuvre disponible est assez peu élevée par rapport aux besoins. Il importe de sortir de cette fatalité.
Nous sommes ensuite résignés face à un système de formation professionnelle pourtant en pointe dans les années soixante-dix et quatre-vingt, mais qui s’est progressivement sclérosé, devenant très injuste puisque seul un demandeur d’emploi sur dix a accès à la formation depuis une dizaine d’années. Encore aujourd’hui, un salarié sur trois – notamment les ouvriers, les employés et les salariés des TPE – a peu accès à la formation.
Résignation également face à une image dévalorisée ou simplement datée des métiers, en particulier des métiers manuels ainsi que de leur voie de formation en apprentissage. Nous sommes en train de changer cet état de fait. La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a créé une vraie dynamique puisque nous enregistrons une hausse de 6 % du nombre d’inscrits et de 45 % des demandes à la rentrée. Néanmoins, il faudra clairement continuer également à lutter contre ce phénomène.
Enfin, résignations face à des règles de l’assurance chômage qui ne permettent pas suffisamment de lutter contre la précarité et d’inciter au retour à l’emploi. Ce sera tout l’objet de la réforme à venir de l’assurance chômage.
Notre première réponse par rapport à ces défis a bien évidemment été la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, avec la formation professionnelle et l’apprentissage. Nous avons également répondu par un effort inédit par son ampleur et sa durée en direction du Plan d’investissement dans les compétences, le PIC, qui s’étalera sur cinq ans.
Je rappellerai les trois axes d’action mis en œuvre par le Gouvernement.
Le premier axe, c’est le renforcement de l’attractivité des métiers en tension, couplée à une meilleure identification en temps réel de leur besoin en compétences. À cette fin, il convient tout d’abord d’améliorer la connaissance des métiers, car elle est très faible. Un effort devra être fait en matière d’éducation et d’orientation. Tel est le sens de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Nous avons lancé avec Pôle emploi le 20 septembre dernier l’opération #VersUnMétier. Elle consiste à organiser une fois par semaine et dans l’ensemble des agences Pôle emploi une rencontre – job dating, ateliers, visites – entre employeurs et candidats autour d’un métier ou d’un secteur en tension. Beaucoup d’emplois en tension sont accessibles à des salariés qui n’ont aucune expérience ni compétence dans le domaine, à condition qu’ils suivent une formation, ce à quoi personne ne pense.
Par exemple, dans le secteur de la cybersécurité ou du développement web, on peut former en plusieurs mois des personnes pour qu’elles soient en mesure d’occuper des emplois qualifiés. Pour autant, si on ne présente pas ces métiers et si on ne dit pas qu’ils sont accessibles, les demandeurs d’emplois restent dans l’ignorance et ne demandent pas à se former.
Cette meilleure connaissance des métiers, nous l’avons aussi renforcée sur le plus long terme au travers de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Le même objectif est visé avec l’instauration des prépa-métiers ou des prépa-apprentissage en cours de lancement. Le PIC permettra de financer des prépa-apprentissage dans à peu près tous les secteurs.
En outre, près de la moitié du Plan d’investissement dans les compétences se fera en partenariat avec les régions au travers de pactes. Le PIC comprendra un important volet sur les métiers en tension. Je signerai d’ailleurs le premier pacte, celui du Grand Est, mercredi prochain à Metz avec le président de cette région.
La loi permet aussi de mettre en place les dispositifs « Pro A », de « reconversion et promotion par l’alternance », qui seront en particulier ciblés sur les nouveaux métiers.
Le Plan d’investissement dans les compétences comprendra 10 000 formations numériques puisque le secteur cherche 80 000 personnes et 10 000 formations aux métiers verts, qui se développent à toute vitesse. Au travers des PIC régionaux, nous disposerons de nombreux leviers pour travailler sur ces métiers en tension, y compris via le financement de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans toutes les branches qui le souhaitent.
Enfin, le volet de l’assurance chômage sera important, car il importe également que le travail paie mieux. Cela fait partie des mesures annoncées par le Président de la République en début de semaine pour rendre l’emploi plus attractif.
En clair, ce débat aborde un vrai sujet. Il s’agit même d’une question d’intérêt national. L’offre et la demande, cela signifie plus de compétences pour les entreprises et moins de chômage pour les demandeurs d’emploi. Pour ce faire, il importe d’agir sur tous les leviers : la connaissance des métiers, l’incitation au travail, la reconnaissance des métiers et la formation massive pour tirer vers le haut l’ensemble des compétences. C’est ce à quoi nous nous sommes attelés avec votre concours.
MM. Daniel Chasseing et Olivier Cigolotti applaudissent.

La parole est à M. Joël Guerriau, pour le groupe auteur de la demande de débat.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, chaque année, des centaines de milliers d’offres d’emploi ne trouvent pas preneur. À l’heure où le taux de chômage en France est de 9, 3 % alors qu’il n’est que de 2, 3 % en République tchèque et de 3, 4 % en Allemagne et en Pologne, nous pouvons légitiment nous interroger, d’autant que le taux de chômage a baissé dans tous les États membres pour atteindre 6, 6 % en moyenne dans la zone euro alors qu’il stagne en France.
Nous avons tous en mémoire une phrase qui a fait le buzz « traverser la rue pour trouver du travail ». Derrière cette phrase devenue célèbre se cache une réalité à nuancer.
En 2017, Pôle emploi a publié une étude sur les fameux emplois non pourvus. Ces offres restées sans réponse ne le sont pas forcément faute de « gens prêts à travailler ». Sur les 300 000 offres, 97 000 d’entre elles ont été annulées par les recruteurs eux-mêmes et 53 000 concernaient des offres toujours en cours. Et si 150 000 recrutements restants ont été abandonnés faute de candidat, surtout faute de profils adéquats, selon cette étude 19 500 offres d’emploi n’ont fait l’objet d’aucune candidature.
Enfin, quand on sait que les employeurs ont transmis en 2017 près de 24 millions de déclarations d’embauche, le nombre d’emplois non pourvus prend à cet égard une importance relative.
Néanmoins, cette absence de candidatures pose la question de l’inadéquation entre l’offre et la demande. Il existe des secteurs qui peinent à recruter et qui en souffrent.
Les candidatures sont inadaptées, les entreprises déplorent le manque de compétences, de connaissances techniques, d’expérience professionnelle ou l’absence d’un diplôme en lien avec le métier.
Les principaux postes non pourvus sont ceux d’employés et d’agents de maîtrise de l’hôtellerie et de la restauration, de cuisiniers, d’assistantes maternelles, de conducteurs de véhicule, de cadres, de technico-commerciaux, d’ingénieurs, de techniciens de l’informatique et de carrossiers. Cette liste ne présente aucune surprise, ces métiers connaissant régulièrement des problèmes de recrutement.
Si certains secteurs en tension demeurent, c’est sur eux qu’il faut donc concentrer nos efforts. Ce sont souvent des emplois ressentis comme peu valorisants et/ou peu rémunérateurs, mais aussi des métiers que l’on ne connaît pas vraiment ou qui ont mauvaise presse, comme celui de chaudronnier qui a aujourd’hui peu à voir avec l’image que l’on s’en fait communément.
Mon département, la Loire-Atlantique, malgré un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale, ne déroge pas à cette situation. Selon le recensement de Pôle emploi des besoins en main-d’œuvre pour 2018, plus de 50 % des 54 236 projets de recrutement sont réputés difficiles. Pour 442 d’entre eux, la difficulté est même estimée à 100 %.
Dans ces projets de recrutement très difficiles qui représentent donc moins de 1 % du volume global, on retrouve principalement les métiers de charpentier, de régleur, d’ouvrier qualifié industriel, d’ouvrier non qualifié en artisanat, de vendeur en gros, de personnel navigant de l’aviation, d’agent de maîtrise en entretien, de conducteur d’engins, de contrôleur de transports ou encore de concierge.
Si certaines offres d’emploi ne trouvent pas preneur, c’est peut-être aussi parce qu’elles ne sont pas assez attractives, que ce soit au niveau des missions, du salaire ou au regard de la pénibilité.
Quand on recherche un emploi, on privilégie celui qui correspond à son souhait et à sa formation, ce qui est assez légitime. Généralement, le fait d’élargir ses recherches à d’autres secteurs d’activité fait que les niveaux de qualification et de rémunération sont alors moindres. Il est alors difficile pour la personne en recherche d’emploi de se projeter dans un nouveau projet professionnel quand celui-ci, en plus de l’éloigner de son profil initial, est financièrement non stimulant.
Enfin, l’attractivité d’un poste dépend aussi des conditions de vie et de la qualité de vie environnante. Entre 2007 et 2011, environ 500 000 personnes ont dû renoncer à un poste en raison de problèmes de logement et du surcoût de la mobilité exigée. À ce niveau, le mouvement des « gilets jaunes » a mis en évidence dans nos campagnes la problématique du coût de l’essence.
Un postulant qui se rend compte qu’aucun logement ne lui sera accessible au regard de ses revenus et/ou que les transports ne seront pas adaptés à ses horaires, même s’il a les capacités professionnelles pour répondre à l’offre, risque de se retrouver en difficulté et ne déposera peut-être pas sa candidature. C’est un élément très important à prendre en compte, surtout pour les secteurs qui fonctionnent essentiellement en temps partiel et en CDD. La restauration est, de ce point de vue, un bon exemple.
Cet environnement favorable est du ressort des collectivités locales, qui doivent penser leur aménagement en ce sens. Il est aussi du ressort des entreprises, qui doivent adapter ces offres non pourvues, notamment en termes de temps de travail, de rémunérations, de mobilité géographique, pour mieux répondre aux possibilités des candidats.
Enfin se pose le problème des nombreux jeunes formés dans des filières aux débouchés insuffisants pour satisfaire tout le monde. Le rôle des instances publiques doit être d’orienter ceux qui n’ont pas de projet professionnel défini vers les secteurs en tension et en devenir, et de les inciter à se former en ce sens.
Dans un monde du travail où le secteur des services occupe près de 75 % de l’économie française, où la numérisation et la robotisation constituent une vague irrésistible, la politique de formation est un enjeu stratégique. La formation professionnelle, initiale et continue demeure donc un enjeu clé. Il est essentiel de mieux cibler les formations et surtout de mieux les adapter aux demandeurs d’emploi.
Pour conclure, le chômage n’est pas simplement un choix personnel qui se résoudrait en traversant la rue.
Concernant les emplois non pourvus, il ne faut pas se concentrer sur une vaine bataille de chiffres. Le marché du travail est en perpétuelle évolution et a besoin de souplesse. La question fondamentale de la politique de l’emploi demeure l’accroissement du nombre d’offres, pas leur pourvoi intégral !
Néanmoins, pour changer la donne, chacun doit prendre ses responsabilités : à l’État de mieux adapter l’offre de formation aux besoins ; aux entreprises de rendre certains métiers boudés par les candidats plus attractifs en termes de salaire, d’horaires ou de conditions de travail ; aux collectivités de faciliter la mobilité géographique liée aux coûts du logement ou des transports. Bref, ce débat a pour objet d’esquisser des pistes, car il y a urgence.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires. – MM. Yves Bouloux et Olivier Cigolotti applaudissent également.

Je rappelle que chaque orateur dispose de deux minutes maximum pour présenter sa question avec une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente. Dans le cas où l’auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires à la condition que le temps initial de deux minutes n’ait pas été dépassé.
Dans le débat interactif, la parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, alors que le Président de la République a annoncé regretter ses propos blessants à l’égard des Français, nous avons encore toutes et tous en tête la réponse faite à un jeune en recherche d’emploi qui l’avait interpellé sur la question du chômage et auquel il avait répondu : « Je traverse la rue et je vous trouve un emploi » !
L’attitude arrogante du Président de la République qui ramène le problème du chômage à une question de bonne « volonté » reprenait un vieil argument du patronat selon lequel ce sont les chômeurs qui ne souhaitent pas travailler.
Pourtant les chiffres sont têtus. Selon Pôle emploi, en 2017, plus de neuf offres d’emploi sur dix ont été pourvues et les offres d’emploi qui n’ont fait l’objet d’aucune candidature sont rares : seulement 18 000 d’entre elles, soit 0, 6 % du total. Rapporté aux 6 millions de chômeurs, cela représente un poste disponible pour trois cent trente-trois demandeurs d’emploi. Nous sommes donc bien loin du compte !
Face à ce « problème », le Premier ministre a déclaré vouloir faire du développement de la formation et de l’apprentissage « une voie royale pour trouver un métier ». Pourtant, à la demande du Gouvernement, l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, l’AFPA, projette de fermer trente-huit centres de formation et de supprimer 1 541 postes en CDI.
Avez-vous l’intention, madame la ministre, de laisser fermer des sites de formation de l’AFPA sur nos territoires alors qu’ils sont pourtant indispensables à la formation aux nouveaux métiers ?
Madame la sénatrice, votre question soulève beaucoup de points. Je reprendrais ceux qui correspondent à la formation.
Oui, tout n’est pas formation, mais les enquêtes de l’INSEE, de Pôle emploi ou de Bpifrance montrent qu’une fois sur deux les difficultés de recrutement sont liées à un problème de compétence et donc de formation.
Voilà pourquoi nous avons engagé une grande réforme de l’apprentissage. Comme je l’ai rapidement évoqué dans mon propos liminaire, on peut réussir grâce à l’apprentissage, car il s’agit d’une véritable voie d’excellence et de réussite. Les résultats sont très encourageants. Les décrets n’ont pas encore été publiés que la dynamique est déjà enclenchée autour de la loi puisque l’apprentissage augmente significativement. Des outils ont d’ores et déjà été mis en place pour permettre aux opérateurs d’agir.
En ce qui concerne le Plan d’investissement dans les compétences, il a démarré de façon très forte. Nous nous préparons à signer avec la quasi-totalité des régions des plans d’accélération.
En ce qui concerne l’AFPA, la situation est très claire. Cela fait dix ans que l’AFPA survit chaque année grâce à une aide d’urgence de l’État qui lui permet de boucler son budget. Depuis cinq ans, ce sont plus de 700 millions d’euros de déficit qui ont été accumulés. Cette situation est désespérante à la fois pour les territoires et pour les salariés de l’AFPA, qui ne voient pas l’avenir.
La Direction générale de l’AFPA a proposé une réforme structurelle qui va permettre de recentrer cette agence sur des missions plutôt régaliennes : la formation des réfugiés, des personnes les plus vulnérables et les plus en difficulté.
On ne peut pas continuer à demander à l’AFPA de toujours jouer le jeu de la concurrence et donc de perdre, très souvent, les appels d’offres lancés par les régions parce qu’elle n’est pas dans la même situation que ses concurrents.
Il faut faire en sorte, bien sûr, de garder une offre de formation dans les territoires. Les centres AFPA feront ainsi une offre mobile – l’« AFPA nomade » –, afin que des formations soient assurées sur tout le territoire, y compris là où des regroupements sont faits.
Sur le plan social, j’ai demandé à la Direction générale de mener cette réforme afin de sauver l’AFPA, et ce dans les meilleures conditions. Pour 600 personnes qui partent à la retraite, 600 postes seront créés. J’espère que tous ces mouvements se feront de façon volontaire. C’est en tout cas l’esprit de la réforme.
Mais on ne pourra pas, en 2019, compter sur l’AFPA pour tout !

Je vous remercie pour votre réponse, madame la ministre, mais elle ne me satisfait guère.
La décision qui touche l’AFPA va en effet se traduire par des fermetures d’établissements publics qui fonctionnaient sur nos territoires et permettaient à des personnes, au terme de six à onze mois de formation, d’acquérir une qualification, ce qui n’est pas rien ! Cet organisme affichait tout de même un taux de réinsertion dans l’emploi de l’ordre de 66 %.
Nous regrettons donc cette décision du Gouvernement.
S’agissant de l’apprentissage, je suis d’accord avec vous lorsque vous dites qu’il peut mener à une voie d’excellence. Lorsque la formation initiale est bonne, l’apprentissage permet en effet de décrocher un diplôme d’études supérieures.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis ce soir pour échanger sur un sujet qui fait trop souvent l’objet de questionnements, d’interrogations, voire d’incompréhensions : celui des emplois non pourvus. Pourtant, on le sait, il ne suffit pas de « traverser la rue » et de postuler à un emploi pour être embauché.
S’il existe dans certains secteurs, comme ceux du bâtiment, de l’industrie hôtelière ou des services à la personne, un fossé entre demandeurs d’emploi et recruteurs, il n’est pas forcément et exclusivement le fait des premiers.
De même, si la plupart des offres d’emploi non pourvues dans ces secteurs le sont en raison de leur manque d’attractivité, la question de la formation – vous l’avez dit, madame la ministre – reste posée.
Après le plan de formation de 500 000 chômeurs mis en place par le précédent gouvernement, vous avez lancé le Plan d’investissement dans les compétences, le PIC, avec pour ambition de former 1 million de demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés et 1 million de jeunes éloignés du marché du travail. Nous ne pouvons que saluer cette volonté.
Au regard du projet de loi de finances pour 2019, marqué par la forte contraction des crédits de la mission « Travail et Emploi » pour la deuxième année consécutive, de près de 3 milliards d’euros, et par un affaiblissement historique des différents opérateurs publics chargés de l’accompagnement vers l’emploi, permettez-moi de formuler mes plus vives inquiétudes. Je m’interroge tout particulièrement sur les capacités de ces acteurs à porter le PIC.
Prenons l’exemple de Pôle emploi, particulièrement touché, avec une baisse de la subvention pour charges de service public de 85 millions d’euros et l’annonce de la suppression d’au moins 800 équivalents temps plein l’an prochain.
Je n’ai pas le temps, malheureusement, d’évoquer la situation des missions locales et des Maisons de l’emploi, elles aussi fragilisées, ni même de revenir sur les difficultés, précédemment évoquées, de l’AFPA, qui montrent bien que la question de l’accompagnement et de la formation des chômeurs dans nos territoires reste posée.
Pourriez-vous, madame la ministre, nous présenter un premier bilan du PIC et de ses perspectives ?
Mmes Viviane Artigalas, Michelle Meunier et Nadine Grelet-Certenais applaudissent.
Madame la sénatrice, nous avons voulu, afin d’éviter que la qualité ne baisse, ne pas lancer trop vite le PIC.
Nous avons vu, dans le passé, que procéder par à-coups ne permettait pas forcément à l’offre de formation et aux opérateurs qui accompagnent celle-ci d’être au rendez-vous. Nous avions donc choisi, pour 2018, d’atteindre un niveau d’effort de formation supérieur à celui de l’année précédente, mais pas trop élevé, pour permettre aux régions, aux professions et à l’ensemble des opérateurs de préparer la mise en place du système.
Nous allons accélérer le rythme en 2019 puisque nous allons quasiment doubler l’effort de formation dans le PIC, le système de formation et les régions étant désormais mûrs pour cela.
Pour ce qui est des opérateurs, nous avons inscrit ce sujet dans la réflexion que nous menons région par région.
Selon l’investissement qui est fait dans les régions, la situation n’est pas la même. En Bretagne et en Normandie, par exemple, il n’y a pas de fermeture de centres AFPA, car ces régions ont toujours « joué le jeu » à l’égard de ces centres. J’insiste, il y a donc des différences selon les régions.
S’agissant de Pôle emploi, sa recette principale est assise sur la masse des salaires. Lorsque l’emploi est en hausse, les salaires augmentent. Aujourd’hui, les ressources de Pôle emploi continuent donc à augmenter, malgré la baisse de subventions de l’État.
De ce fait, Pôle emploi aura donc davantage de moyens l’année prochaine : 100 millions d’euros supplémentaires. Ces moyens bénéficieront à l’accompagnement et aux effectifs, puisque la suppression des 400 équivalents temps plein est plus que compensée par la numérisation, laquelle permet de dégager davantage de productivité.
Quant au budget de l’ensemble des missions locales, il est en baisse, avec l’ensemble des trois enveloppes, de 1, 1 %. Cela signifie que la demande de productivité est très faible, et là aussi la numérisation est en cours.
Tous les réseaux sont donc en ordre de marche pour accompagner aujourd’hui cette transformation.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, au troisième trimestre de 2018, ce sont 5, 6 millions de personnes qui étaient inscrites à Pôle emploi en catégorie A, B et C, parmi lesquelles 3, 4 millions étaient sans emploi.
Selon une étude de Pôle emploi portant sur l’année 2017, 300 000 offres n’ont pas été pourvues et 150 000 ont réellement conduit à un abandon de recrutement, faute de candidats.
Ces chiffres apportent un éclairage intéressant. Pour autant, les emplois non pourvus sont bien une réalité, que ce soit dans l’hôtellerie-restauration, la chaudronnerie, le BTP ; je pense notamment aux emplois de couvreur, de maçon et de technicien.
Nous constatons également qu’il existe très peu d’emplois non pourvus dans les grandes entreprises, alors que les entreprises de moins de 50 salariés, et a fortiori de moins de 10 salariés, peinent à recruter. Cela s’explique par le manque de culture « ressources humaines » des TPE.
Madame la ministre, nous avons travaillé cet été avec vous sur la formation et l’apprentissage. C’était indispensable.
Si nous voulons que ces offres d’emploi trouvent preneur, il convient de rendre ces métiers plus attractifs. Or l’attractivité de ces secteurs n’étant pas constituée du simple fait de l’existence de postes disponibles, il est important de trouver d’autres leviers.
Les employeurs expliquent à Pôle Emploi l’insuffisance de recrutement par un manque d’expérience, de motivation ou de compétence des candidats.
Une enquête auprès de 5 000 professionnels de l’hôtellerie-restauration montrait que les faibles salaires et les heures supplémentaires non rémunérées étaient cités en tête des raisons expliquant les difficultés de recrutement du secteur.
Pour rendre ces métiers plus attractifs, les accords de branche ou d’entreprise sont des leviers intéressants, mais il est indispensable de mobiliser d’autres moyens.

C’est pourquoi j’aimerais savoir ce que le Gouvernement pourrait mettre en œuvre – pourquoi pas avec le concours des chambres de commerce et d’industrie, les CCI, et des chambres de métiers et de l’artisanat ? – pour que ces entreprises puissent recourir à un service d’accompagnement et de soutien tout au long de leur activité.
Monsieur le sénateur, vous soulevez un problème important. En termes de recherche de compétences ou de ressources, les petites et moyennes entreprises sont, à la fois, celles qui ont le plus besoin d’embaucher et celles qui sont le moins équipées en matière de recrutement.
Le premier point que vous avez évoqué est la capacité d’ingénierie des ressources humaines.
Dans le cadre du PIC, une partie est réservée à la structuration de l’offre et à l’accompagnement, dans laquelle nous avons prévu des appels à projets pour l’accompagnement par les branches des petites et moyennes entreprises.
La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit également la création d’opérateurs de compétences, les OPCO, par grandes familles de métiers, dont le rôle sera de conseiller les petites et moyennes entreprises.
Nous allons aussi développer l’apprentissage, dont nous avons beaucoup parlé cet été.
Il faut enfin évoquer des conditions de travail, au sens large, qui sont moins attractives dans certains métiers que dans d’autres.
Ma conviction est qu’il n’y a pas de fatalité. Évoquer les conditions de travail, c’est parler de santé et de sécurité au travail, et parfois d’horaires de travail, de salaires, voire de précarité du travail.
N’ayant pas le temps d’approfondir tous ces sujets, je m’en tiendrai à celui de la précarité.
Les secteurs les moins attractifs sont aussi ceux qui proposent le plus d’emplois en CDD et en intérim. Être obligé de se déplacer loin de chez soi pour occuper un emploi peu qualifié et temporaire, alors même que les règles de l’assurance chômage n’incitent pas à reprendre un travail lorsqu’il est temporaire, on comprend que cela n’encourage pas à travailler et que les difficultés restent importantes.
Il nous faut donc travailler sur les conditions de travail et réfléchir à la question des règles qui rendent l’emploi précaire moins attractif pour les employeurs. C’est l’un des objectifs de la réforme de l’assurance chômage.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaite remercier les orateurs qui m’ont précédé pour leurs interventions qui ont mis en avant les grands enjeux de ce débat.
Je voudrais, quant à moi, évoquer plus spécifiquement la question de l’apprentissage, pour lequel de nombreuses offres de formation et de contrats de travail en alternance ne sont pas pourvues.
Dans ma région, nombreux sont les lycées professionnels et les entreprises qui cherchent sans succès de jeunes apprentis, notamment dans les filières traditionnelles de l’hôtellerie-restauration, de l’alimentation, de l’industrie, mais aussi dans certaines filières plus innovantes, comme le numérique.
L’apprentissage est une voie d’avenir qui forme à de nouveaux métiers, des plus traditionnels aux plus innovants. Dans les Hauts-de-France, il est possible de préparer plus de 530 diplômes par la voie de l’apprentissage.
Cette année encore, plus de 33 000 jeunes de ma région ont choisi l’apprentissage pour se former au métier de leur choix, dans l’un des 380 centres de formation. Mais c’est loin d’être suffisant ! Il faudrait 50 000 jeunes pour satisfaire les entreprises et remplir les formations.
Comment améliorer cette situation ? Comment mieux communiquer auprès des jeunes pour revaloriser ces filières ? Car choisir l’apprentissage, c’est opter pour l’excellence, l’accès à une qualification reconnue et la perspective d’une insertion professionnelle rapide : près de 70 % des apprentis trouvent un emploi dans l’année qui suit l’obtention de leur diplôme.
Le Gouvernement a décidé de simplifier le dispositif et de créer de nouveaux circuits de financement dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Il faut maintenant aller plus loin en travaillant sur le terrain avec les collectivités locales, les centres de formation et les entreprises afin d’attirer davantage de jeunes dans ces filières et formations d’avenir.
Monsieur le sénateur, nous partageons cette conviction que l’apprentissage est l’une des grandes voies permettant de lutter contre le chômage massif des jeunes, véritable drame pour notre pays, pour les jeunes et pour leurs familles.
Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, que vous avez évoquée, a été le premier à soutenir la réforme que nous mettons en place afin de développer massivement l’apprentissage.
De nombreux freins existaient. Votre question concerne particulièrement l’appétence, la connaissance et l’envie des jeunes d’aller vers l’apprentissage.
Pour donner envie de se diriger vers l’apprentissage, il faut rendre attractifs, à la fois, le métier, en le faisant connaître, et l’apprentissage lui-même. La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel permet d’accomplir plusieurs révolutions à ce niveau.
Tout d’abord, tous les jeunes, de la classe de quatrième jusqu’à la première, suivront désormais 54 heures annuelles de découverte des métiers, organisées par les régions, les professionnels, les collèges et les lycées.
Depuis un an, il est beaucoup question de cette loi, notamment grâce àdes reportages et des témoignages. Bien que nous en soyons seulement au tout début de la réforme, nous avons eu l’heureuse surprise de constater, au mois de juin dernier, que les demandes des jeunes à la sortie de la troisième ont crû de 45 %. Ce n’était jamais arrivé ! L’une des raisons de ce succès est que l’éducation nationale met désormais sur le même plan toutes les filières, y compris dans l’évaluation des proviseurs et des conseillers principaux d’éducation. Là aussi, c’est la première fois que cela arrive.
Dans le cadre de mes incessantes visites de terrain, j’ai dû visiter une cinquantaine de CFA dans l’année. Une chose me frappe : lorsque je demande aux jeunes comment ils ont connu l’apprentissage, deux sur trois me répondent qu’un membre de leur famille fait ce métier ou leur a fait découvrir l’apprentissage. Il convient donc de mener une véritable opération de reconquête des esprits. Au vu des premiers résultats obtenus, je suis confiante.
Nous devons désormais mieux organiser l’offre et la demande, dans la mesure où des entreprises cherchent des apprentis, et des apprentis cherchent des entreprises. Les régions vont s’y atteler dans le cadre de leurs compétences d’orientation. Une fois la mise en contact entre les jeunes et les entreprises organisée par les organismes publics et les professions, nous allons pouvoir progresser massivement.
Il est intéressant que les jeunes commencent à découvrir la diversité des emplois. L’opération que nous avons menée ces dernières semaines avec des youtubeurs – des jeunes en apprentissage qui témoignaient de leur expérience – a ainsi eu un succès énorme, touchant 3 millions de personnes.
Je voudrais insister sur la situation des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des jeunes handicapés, qui ont très peu accès à l’apprentissage. C’est la raison de la nomination à mes côtés de Patrick Toulmet en tant que délégué interministériel au développement de l’apprentissage dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Sa mission sera de labourer le terrain et d’aller au contact de ces jeunes afin qu’ils accèdent, eux aussi, à l’apprentissage, cette voie de réussite.
MM. Jean-Raymond Hugonet et Serge Babary applaudissent.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je remercie les membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires d’avoir pris l’initiative de ce débat. Je ne reviendrai pas sur les chiffres qui ont été cités.
Nous traitons là d’un mal français, lié à l’inadéquation entre les entreprises et la main-d’œuvre disponible. Il s’agit, au-delà, d’un élément majeur du sentiment d’injustice qui forge le populisme, décrédibilise nos institutions, et sur lequel pas plus l’ancien monde que le nouveau n’ont trouvé de solution.
Mes questions, qui sont au nombre de trois, s’appuient sur l’expérience de la filière logistique, qui est confrontée à des difficultés, et à laquelle Le Figaro de ce jour a consacré un article intitulé Pénurie de main-d ’ œuvre dans le transport et la logistique. Je vous ferai part, aussi, de la situation des entreprises de l’Isère.
Premièrement, ces entreprises, souhaitant recruter, ont dû solliciter l’éducation nationale pour faire connaître leurs métiers – leur approche était très large, et comprenant aussi les jobs d’été. N’est-il pas temps de casser les codes et d’imposer à l’éducation nationale des immersions plus étroites dans le milieu économique de proximité ? Je ne parle pas seulement de formation, je parle aussi de connaissance de l’autre et, encore une fois, du milieu économique.
Je ne reprendrai pas la fameuse phrase du Président de la République, dont on peut penser ce que l’on veut… Mais elle est significative d’une chose : nos concitoyens doivent intégrer le fait qu’en attendant de trouver un emploi dans la branche pour laquelle on a été formé, il est indispensable d’accepter de s’engager dans une autre branche. Pour cela, il demeure indispensable de réviser les règles d’indemnisation aux fins d’inciter à la reprise d’un emploi ; c’est l’objectif de la réforme de l’assurance chômage.
Deuxièmement, pouvez-vous nous éclairer, madame la ministre, sur les éléments qui vont dans ce sens dans la dernière lettre de cadrage du Gouvernement sur l’assurance chômage, adressée aux partenaires sociaux ?
Troisièmement, je veux vous faire part de l’expérience de la filière logistique iséroise, qui a créé un pôle d’intelligence logistique visant à promouvoir ses métiers. Cette initiative s’est construite avec Pôle emploi, qui a accepté de se remettre en cause au vu de l’inadéquation à l’œuvre sur le marché du travail, et avec le préfet.
Pensez-vous que les préfets et les agents de l’État ont des consignes suffisamment pressantes et effectives pour s’atteler à cette dynamique économique, dont l’enjeu devrait être une priorité majeure ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, ainsi que MM. Yves Bouloux et Jean-Raymond Hugonet applaudissent.
Madame la sénatrice, vous avez évoqué plusieurs points très importants.
Tout d’abord, la filière de la logistique et du transport fait en effet partie des métiers en forte tension, car le nombre d’offres d’emploi y explose. C’est le pendant des problèmes de la distribution, dans la mesure où c’est le e-commerce qui fait augmenter ce chiffre.
Dans le cadre du PIC, un dispositif est prévu pour cette branche professionnelle logistique, qui est décliné dans les différents plans régionaux.
Vous avez mentionné l’Isère. Je suis obligée de dire que, dans certaines régions, il est plus difficile et plus long de mettre en œuvre les plans régionaux et le plan d’investissement parce que celles-ci ne souhaitent pas s’associer au PIC. C’est le cas, pour l’instant, de la région Rhône-Alpes, et je le regrette. J’espère que cela changera.
Compte tenu de la baisse très forte des crédits de formation pour les demandeurs d’emploi en région Rhône-Alpes – une diminution de 65 % pour les bas niveaux de qualification –, nous ne sommes pas en mesure de signer ces formations, et c’est Pôle emploi qui prend le relais.
Pôle emploi est certes très impliqué, mais, vous l’avez dit, il faut aussi mobiliser l’éducation nationale. Je le disais, il y aura chaque année dans l’ensemble des collèges et des lycées une ouverture à la découverte des métiers, dont bénéficieront plus de 3 millions de jeunes chaque année. Si je me fie à mon expérience, ce qui convaincra le plus les jeunes de se diriger vers l’apprentissage, c’est de rencontrer des professionnels, un apprenti, un maître d’apprentissage, un jeune qui aura cinq ans de plus que lui, un ingénieur qui a fini ses études et va lui transmettre la passion d’un métier qu’il ne connaît pas et auquel il va s’identifier.
Pour préparer la rentrée, le ministre de l’éducation nationale Jean-Michel Blanquer et moi-même avons écrit de concert aux préfets et aux recteurs pour leur demander de se mobiliser et de réfléchir à ce problème du rapport entre l’offre et la demande, en visant les jeunes qui sortent de troisième. Je pense notamment aux jeunes décrocheurs qui, pour certains, « disparaissent » pendant deux ou trois ans avant que les missions locales puissent intervenir. Il faut agir dès la sortie de l’école, à tous les niveaux, à bac + 4 comme à la sortie de la troisième.
Enfin, vous avez évoqué l’assurance chômage. À cet égard, nous nous sommes concentrés sur les règles liées à la précarité, ce que j’appelle la « précarité excessive ». Aujourd’hui, neuf propositions d’embauche sur dix sont en CDD ou en intérim. C’est probablement le problème majeur posé par nos règles d’assurance chômage, et notre priorité est de le régler. Bien évidemment, les partenaires sociaux ont toute liberté pour aller plus loin dans la réflexion. Peut-être feront-ils aussi des propositions sur ce sujet ?

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les chiffres ont déjà été annoncés : on décompte en France près de 300 000 emplois non pourvus, et l’un des secteurs les plus touchés est celui de l’aide à domicile.
En effet, 78 % des responsables de structures déclarent rencontrer des difficultés de recrutement. Pourtant, il s’agit d’un secteur en pleine évolution. D’ici à 2030, le nombre d’emplois d’aide à domicile à pourvoir s’élèvera à environ 300 000.
L’importance de ce gisement d’emplois s’explique par le boom démographique. Il y a aujourd’hui en France 15 millions de personnes âgées de plus de 60 ans ; elles seront près de 20 millions en 2030.
Les difficultés de recrutement dans ce secteur s’expliquent principalement par le manque d’attractivité de ces emplois dévalorisés. Les témoignages le confirment, si le niveau des salaires est avancé comme la principale raison de ces freins, les contraintes de temps et d’organisation du travail, ainsi que la pénibilité, sont également largement mises en cause.
C’est aussi le volume des personnes formées sur le territoire qui pose problème. Car aider les autres, c’est un métier, qui nécessite une vocation, certes, mais également une formation et un accompagnement.
Madame la ministre, vous avez à cœur, je le sais, de porter des objectifs forts en matière de formation des salariés, et vous avez largement œuvré en ce sens dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Quelles mesures comptez-vous prendre pour redonner à ces emplois locaux non délocalisables, qui font partie du tissu d’entraide de notre pays, stabilité, perspective et reconnaissance ?
Madame la sénatrice, vous avez raison, il s’agit, à la fois, d’une question d’emploi et d’intérêt social puisqu’elle concerne la société de demain.
Le sujet de l’aide à domicile, qui touche les personnes en situation de handicap et les personnes âgées, devient de plus en plus essentiel dans notre société du fait du vieillissement de la population. Les offres non pourvues dans ce secteur sont très nombreuses. Si l’on en dénombre 2 100 sur le site du chèque emploi service universel, le CESU, on sait qu’il y en a beaucoup plus. Tous les organismes du secteur cherchent à recruter.
Vous avez cité les raisons de ces difficultés de recrutement.
Il s’agit, d’abord, de la non-valorisation de ces métiers, qu’elle soit symbolique, sociale, financière, ou au niveau des conditions de travail.
La non-valorisation symbolique est importante. Ces métiers ne sont pas choisis, mais subis ; on les exerce parce qu’on n’a pas pu faire autre chose. La société n’a pas encore accepté de reconnaître que les aides à domicile et les aidants sont essentiels pour la société. Il est d’ailleurs caractéristique que ces métiers – nous l’avons constaté, ainsi que les partenaires sociaux, dans les conventions de branche –, qui sont souvent des métiers de services à la personne occupés à 90 ou 95 % par des femmes, sont ceux pour lesquels les classifications de branche sont les moins précises, ce qui explique une partie des salaires les plus bas.
Vous le savez, nous nous battons aussi pour l’égalité de salaire entre les femmes et les hommes. Or c’est typiquement dans de tels métiers que la question se pose.
Il faut aussi évoquer la précarité.
Dans ce secteur, on embauche beaucoup sur des contrats précaires, et ce sont souvent des personnes en situation de précarité qui acceptent ces emplois, non délocalisables, mais qui, dès qu’elles trouvent une solution un peu plus pérenne, prennent un autre emploi.
Il convient de travailler sur ces questions avec la profession, et cela entre aussi dans la mission des opérateurs de compétences, les OPCO, que nous mettons en place. Aujourd’hui, les professionnels de ce secteur sont dispersés dans différents organismes paritaires collecteurs agréés, les OPCA. Ils vont désormais se retrouver dans un seul et même lieu pour parler ensemble des compétences, mais aussi de l’avenir de ces métiers.
Les possibilités d’emploi sont immenses dans ce secteur, mais il convient de travailler sur le fond et sur l’organisation de ces professions afin qu’elles deviennent des métiers plus attractifs et d’avenir, en prévoyant des passerelles et des qualifications permettant une évolution au fil du temps.

Je remercie Mme la ministre de ses réponses. Une tâche considérable nous attend dans les mois à venir, car cette question est très complexe et l’urgence est là. Il faut aussi revoir le dispositif de formation, notamment les certificats d’aptitude professionnelle, les CAP, et les baccalauréats professionnels. Ce travail de fond devra être mené avec M. Blanquer.

« On est combien aujourd’hui ? » : c’est la question que se posent chaque jour des employés du secteur médico-social.
Cette question cruciale dissimule à peine une surcharge de travail, des cadences intenables, des toilettes à réaliser à la hâte. La santé des soignants est en jeu : tabagisme, maladies cardiovasculaires, stress, horaires décalés et invalidité font de ces métiers des professions à risques.
Les syndicats des personnels estiment que 35 % des agents – infirmières aides-soignantes, aides médico- psychologiques, agents de service hospitaliers –, que ce soit dans le public ou dans le privé, ont le sentiment que l’effectif présent ne permet ni d’assurer la sécurité et la qualité des soins ni de respecter la dignité des patients. De leur côté, les établissements font part de leurs difficultés à recruter. Pour les nuits, les week-ends et les périodes de congé, 63 % des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, rencontrant des difficultés de recrutement ont des postes non pourvus depuis six mois ou plus.
Au vu de ses besoins criants, madame la ministre, vous venez de vous prononcer sur des pistes. Mais j’aimerais vous entendre concrètement sur des améliorations à prendre en termes de reclassement, de déroulement de carrière, de rémunération et de protection sanitaire.
Comment comptez-vous, madame la ministre, redonner leurs lettres de noblesse à ces métiers du soin ?
Madame la sénatrice, vous posez une vaste question, qui déborde le sujet précis de notre débat, même s’il y a trait en partie.
Sur ces métiers, ma collègue ministre des solidarités et de la santé a engagé un chantier. Je suis frappée qu’en l’occurrence les possibilités de qualification ou d’évolution de carrière pour les premiers niveaux ne soient pas très importantes. Or, comme pour tous les métiers, l’existence d’un ascenseur social dans sa profession ou dans des métiers connexes, est un point non négligeable en termes d’attractivité, d’intérêt du travail et de développement de carrière.
L’une des difficultés de ce secteur, c’est qu’il y manque une visibilité sur les carrières et les compétences. Il y a des employeurs publics, privés, associatifs et à but lucratif qui se retrouvent dans des instances différentes pour parler de ces sujets. Cela n’aide pas ! Aussi, l’opérateur de compétences qui travaillera sur ce sujet sera un bon « carrefour » pour réfléchir à la question des diplômes.
Je rappelle que, dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, vous avez prévu, sur la proposition du Gouvernement, que le contenu professionnel des diplômes et leur enchaînement seraient désormais élaborés par les professionnels ; dans le cas de diplômes d’État, on vérifiera bien sûr la cohérence d’ensemble.
C’est très important parce que sur ces métiers qui ont grandi très vite – je ne parle pas de ceux qui sont purement médicaux, qui relèvent d’une hiérarchie – il n’y a pas eu de véritable construction de parcours. Les personnes qui en bénéficient ont fait cette démarche à titre individuel. Il n’y a donc ni véritables passerelles ni construction de métier.
La ministre des solidarités et de la santé s’attachera à traiter ce sujet sur le fond, mais l’appui des systèmes de formation aidera à construire ces parcours.

Je vous remercie, madame la ministre, et je prends note de vos suggestions.
Vous le savez, bon nombre de blouses blanches soutiennent les revendications des « gilets jaunes », et nous sommes attachés à ce que leurs demandes soient prises en compte, à savoir qu’une moindre importance soit accordée à la culture du chiffre, que soit privilégiée la qualité du soin et qu’une attention nécessaire soit portée à l’évolution de ces personnes dans leur métier.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, afin d’illustrer ce débat en parlant de ce que je connais le mieux, je vais prendre en exemple mon département de l’Aveyron.
Le nombre d’emplois non pourvus y est au minimum de 3 000. Notre taux de chômage est de 6, 6 %. Oui, nous recherchons activement des travailleurs ! Oui, les emplois ne sont pas tous dans les métropoles. Nous avons des atouts dans nos territoires ruraux : la sécurité, la proximité avec la nature, la qualité de vie, etc.
Bien sûr, cela a été dit, la formation doit être améliorée, et la réforme de l’assurance chômage qui va être examinée par le Parlement sera déterminante pour favoriser le travail.
Trouvons rapidement la solution à ce paradoxe : manque de travailleurs d’un côté, trop de demandeurs d’emploi de l’autre. Cela ne peut pas durer !
Par ailleurs, nous sommes plusieurs départements à vouloir attirer de nouvelles populations. Nous nous efforçons de nous faire connaître, de mettre en avant les qualités de nos territoires. Par exemple, lorsque j’étais président du conseil général, j’avais créé un site intitulé « L’Aveyron recrute », qui permet de recenser les offres d’emploi disponibles dans le département.
Pour nous, le développement économique et les nombreux emplois disponibles sont surtout liés à l’attractivité du territoire. Je sais toutefois que l’emploi dans nos territoires ruraux est nécessaire, mais pas suffisant. Pour cela, le maintien d’un service public de qualité est indispensable – je pense notamment à l’accès à la santé, à l’éducation et au très haut débit.
Je reste persuadé qu’il faut investir aussi dans nos infrastructures routières, ferroviaires et numériques afin de favoriser la mobilité sur nos territoires. Les emplois non pourvus dans l’Aveyron pourraient enfin trouver preneur et, plutôt que de travailler dans les métropoles saturées, pourquoi ne pas créer un début d’exode urbain ?
Madame la ministre, dans quelle mesure pouvez-vous prendre en compte l’aménagement du territoire afin d’aider nos chefs d’entreprise à recruter ?
Monsieur le sénateur, vous soulevez deux questions importantes.
La première, c’est que les territoires ne sont pas du tout dans la même situation à l’égard du chômage. Le taux de chômage est de 6, 8 % en Aveyron et de 5, 8 % en Mayenne, alors que la moyenne nationale se situe à 9, 1 %. Certains départements connaissent un taux de chômage de 18 % et, dans les outre-mer, le taux peut être de 25 % ou 30 %. La stratégie ne peut évidemment pas être la même selon le niveau du taux de chômage.
La seconde, c’est l’attractivité inversée liée au phénomène de métropolisation qui, depuis trente ou quarante ans, s’accentue. La crise des dernières semaines a montré à quel point la question des territoires ruraux, des petites villes ou des villes moyennes était un véritable sujet, puisque beaucoup de ces habitants avaient le sentiment d’être loin des grandes métropoles où se concentrent l’emploi, l’activité, une partie des services publics et, d’une certaine façon, les richesses.
Face à cette situation, nous devons mener des stratégies différenciées. C’est ce que nous avons commencé à faire avec les pactes régionaux d’investissement dans les compétences. Pour aller plus loin, il faut aborder la question de la mobilité, que vous avez évoquée. C’est le deuxième frein à l’emploi après la compétence. Un Français sur quatre a refusé, au cours de sa vie, une formation ou un emploi faute de mobilité.
Il s’agit d’abord de la mobilité de proximité : c’est le problème de l’accès à des modes de transport, et il faudra certainement encourager le développement du covoiturage dans la loi sur les mobilités, mais d’autres formes existent.
Il s’agit, ensuite, de la mobilité résidentielle, c’est-à-dire, pour être clair, le fait de déménager. Aujourd’hui, nos politiques d’emploi et de formation sont liées, mais la mobilité et le logement sont souvent mis dans des silos différents, avec des compétences différentes, y compris dans nos institutions.
Dans le grand débat national que nous allons lancer dans quelques semaines et qui sera très territorialisé – vous avez entendu le Premier ministre l’évoquer –, les questions de logement et de transport seront très importantes. Car une partie des solutions viendra aussi, demain, du couplage des offres : vous aurez un emploi et un logement, ou un emploi et une mobilité.
Aujourd’hui, nous n’y sommes pas encore. Pôle emploi propose des aides à la mobilité, qui peuvent aller jusqu’à 5 000 euros par an et qui sont d’ailleurs peu et pas assez connues des demandeurs d’emploi. Il faut aller plus loin et prévoir de véritables ingénieries, car avec les possibilités actuelles en matière de télétravail, de travail à distance pour le conjoint, on peut certainement créer plus d’emplois dans des zones qui en ont perdu beaucoup par le passé.
Pour cela, il faut mixer tous les acteurs, puisque nous avons besoin à la fois des départements, des intercommunalités, des communes, de l’État et des acteurs privés.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, sur le front de l’emploi, la France est le dernier grand pays industriel à ne pas s’être remis de la crise de 2008 : plus de 9 % de chômage – vous venez de le dire – et 300 000 emplois non pourvus. Nous sommes tous d’accord, cela pose un gros problème.
Une des raisons majeures de cette situation est la probable inadéquation de notre appareil de formation, en grande partie parce que les entreprises, qui sont les mieux placées pour connaître leurs propres besoins, n’y occupent pas assez de place.
Les entreprises trop éloignées de la formation, cela entraîne trois conséquences, que vous avez d’ailleurs évoquées : une inadéquation trop fréquente de la formation aux besoins réels, une méconnaissance totale par les jeunes de l’entreprise en général, de son fonctionnement et de son activité – vous avez dit qu’ils avaient une image datée des métiers et vous avez raison –, et enfin une méconnaissance de l’éventail des métiers et des opportunités de carrière.
Or, dans la formation initiale, il existe un dispositif performant qui est l’apprentissage. Bon nombre des métiers en tension nécessitent un apprentissage. L’objectif de 500 000 places qui est régulièrement cité – je crois que vous l’avez fait vôtre – est toujours le même. J’ai entendu votre engagement ; néanmoins, nous stagnons depuis des années à 300 000 places.
Avant de faire décoller l’apprentissage, encore ne faudrait-il pas l’entraver. Sur les 300 000 apprentis, 100 000 sont formés dans des centres de formation et des écoles dépendant des chambres consulaires. Or, loi de finances après loi de finances, le Gouvernement assèche véritablement ces chambres consulaires, poursuivant en cela la politique du précédent quinquennat. Pour 2018, la recette affectée est réduite de 100 millions d’euros.
Le ministre de l’économie, Bruno Lemaire, a déclaré devant notre commission des affaires économiques qu’il ne faudrait pas que cette réduction ait un effet négatif sur les CFA et les écoles, et il l’a répété ce soir lors de son audition dans le cadre de l’examen du projet de loi PACTE, mais il ne nous a pas dit comment.
En l’état actuel, les CCI vont être contraintes de fermer des centres de formation, de se détourner de l’apprentissage au profit de la formation continue ou de la formation d’étudiants étrangers, plus lucratives.
Ma question est simple : comment ferez-vous pour garantir que le nombre d’apprentis des chambres consulaires non seulement ne diminue pas, mais augmente de deux tiers comme il conviendrait pour atteindre nos objectifs ?
Madame la sénatrice, en ce qui concerne l’appareil de formation et notamment les centres de formation d’apprentis, nous avons complètement libéré, dans la loi Avenir professionnel, la capacité à développer et à créer ces centres. Nous avons même lancé, il y a quelques jours, un kit sur ce sujet. Désormais, une collectivité territoriale, une association, une chambre consulaire, une profession, une entreprise pourra créer ou développer un CFA. Je peux vous dire que le nombre de projets en cours est très important.
Par ailleurs, vous avez évoqué les organismes consulaires, qui assurent une grande partie de l’apprentissage aujourd’hui. La réforme prévue dans la loi Avenir professionnel va régler – j’évoque ici non pas le financement des chambres en général, mais la question de l’apprentissage – un problème patent : la moitié des régions n’utilisaient pas tout l’argent de l’apprentissage pour l’apprentissage. De nombreux CFA étaient donc en difficulté, et une subvention d’équilibre était nécessaire chaque année, ce qui est vraiment « limite ».
On sait que, dans certaines régions, une formation de CAP cuisinier est payée 2 500 euros par an tout compris – je ne sais pas comment on peut financer une formation de qualité avec cette somme – alors que, dans d’autres, elle peut coûter jusqu’à 14 500 euros.
Maintenant, ce sont les professionnels qui fixeront le coût au contrat, afin de permettre au CFA de « vivre dignement » – pas dans l’opulence – et de proposer une formation de qualité. Nous contrôlerons évidemment a posteriori. Mais, j’y insiste, ce sont les professionnels qui vont définir ce coût au contrat. Les professions ont jusqu’à la fin du mois de février pour le faire, mais les premières simulations montrent que, dans un très grand nombre de cas, le financement par apprenti sera plus important qu’avant. Car de nombreuses formations étaient payées en deçà des frais, ce qui obligeait les organismes consulaires à compléter la différence.
La loi a prévu que, désormais, le CFA aurait sa propre comptabilité analytique. Avec ce nouveau mode de financement, je suis très confiante. Nous sommes allés sur le terrain dans toutes les régions, et nous avons visité plusieurs centaines de CFA. Quand on explique à leurs responsables la loi en détail, ils sont très rassurés, car ils comprennent qu’ils pourront se développer. Nous aurons, je le crois, une offre de qualité en matière d’apprentissage.
Enfin, je veux dire que nous allons développer les « prépas apprentissage ». Plus de 300 CFA ont déjà postulé. Ce dispositif est très important : il permettra à des jeunes qui voudraient entrer en apprentissage, mais n’ont pas tout à fait le savoir-être professionnel ou ne connaissent pas bien les métiers, de s’y préparer. Cela attirera aussi un flux plus important.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je voudrais également remercier le groupe Les Indépendants d’avoir demandé l’inscription à l’ordre du jour de ce débat, qui n’est pas sans lien avec les propos de M. le Président de la République lors des Journées du patrimoine. Mes collègues l’ont déjà dit, l’expression « traverser la rue » a marqué – c’est évident – les esprits. Ces mots avaient douloureusement entaché la personne du président, comme si le chômage était une question de choix personnel et de volonté.
La question des emplois non pourvus participe de cette idée que le travail est là, à portée de main de tout demandeur d’emploi et qu’il suffirait que ce dernier s’en saisisse. Or, mes chers collègues, vous le savez, si les offres d’emploi publiées n’aboutissent pas, ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de candidats.
L’étude de Pôle emploi parue en décembre 2017 et intitulée « Offres pourvues et abandon de recrutement » l’explique très bien : sur les 300 000 offres n’ayant pas trouvé preneur, près d’un tiers ont fait l’objet d’un retrait à la suite d’un changement de stratégie de l’entreprise et 50 000 offres faisaient l’objet de recrutement en cours. Nous avons effectivement les mêmes chiffres.
Pour les offres restantes, pouvons-nous tenter de renverser la logique induite par ce débat en posant la question de l’attractivité de l’emploi proposé ? En effet, quelles sont les offres d’emplois qui ne trouvent pas preneur ?
On a cité les contrats courts, les CDD de moins d’un mois, dont le nombre a explosé, les horaires décalés, les contrats dont la faible rémunération ne couvre pas les coûts induits par ce travail – voiture, carburant, frais de garde, etc. Les « gilets jaunes » ont également confirmé que la mobilité était un enjeu fondamental, notamment en milieu rural. Je le constate dans la Sarthe.
En outre, l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » prouve que l’emploi est d’abord une question d’accompagnement social et permet de démythifier la rhétorique trop entendue des emplois non pourvus. Il est d’ailleurs très regrettable que l’exécutif n’ait pas étendu cette expérimentation à d’autres territoires dans le projet de loi de finances pour 2019.
Ainsi, madame la ministre, vous avez affirmé précédemment vouloir envisager d’adapter le logiciel du marché du travail en termes d’attractivité des métiers, de mobilité et d’accompagnement. Pouvez-vous nous éclairer sur les moyens concrètement investis dans ces trois domaines, sans que cela pèse trop, bien évidemment, sur les collectivités locales, déjà fortement mises à contribution ?
Mme Michelle Meunier applaudit.
Madame la sénatrice, vous avez évoqué plusieurs sujets, je me concentrerai sur la question que vous avez évoquée à la fin de votre propos relative aux structures d’accompagnement vers l’emploi des plus vulnérables.
Aujourd’hui, il est trop difficile pour une partie de nos concitoyens d’accéder directement à un emploi, parce qu’ils ont connu des accidents de la vie ou des démarrages difficiles. Pour eux, nous mettons en place une stratégie en plusieurs points.
Le premier, je l’ai évoqué à propos des jeunes, porte sur les savoir-être professionnels. Selon Pôle emploi, un demandeur d’emploi sur trois, jeune ou moins jeune, a des difficultés relationnelles, de présentation, ou pour oser s’exprimer, pour travailler en équipe ou respecter des horaires. Ce sont, dirais-je, les « basiques » de ce qu’on appelle les savoir-être professionnels – je pourrais utiliser d’autres termes, mais ils sont en anglais. Nous finançons de telles actions dans le cadre de Pôle emploi, du Plan d’investissement dans les compétences et des « prépas apprentissage ».
Le deuxième point, qui correspond à une conviction profonde, porte sur le tissu associatif très riche de notre pays, qui sait accompagner des chômeurs de longue durée, des anciens SDF, des personnes en situation de handicap. Ce sont les entreprises adaptées pour le handicap, ce sont les chantiers d’insertion et l’insertion par l’activité économique pour les personnes en difficulté sociale.
Dans le budget pour 2019, comme vous avez pu le constater, j’ai mis en place, avec une programmation sur quatre ans, des moyens très importants pour pouvoir développer cette offre sur le quinquennat. Nous voulons augmenter de 40 000 le nombre de places en entreprise adaptée et porter de 130 000 à 230 000 le nombre de places dans l’insertion par l’activité économique, parce que ce sont des tremplins vers l’emploi, qui reposent sur le bon triptyque : une situation d’emploi, un accompagnement social et une formation.
En ce qui concerne les « Territoires zéro chômeur », nous prolongeons dans le budget l’expérimentation en 2019, avec un doublement du nombre de places. Il faut continuer cette expérimentation l’année prochaine pour en faire le bilan, comme l’a prévu la loi.
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, avec près de 6 millions de demandeurs d’emploi en France, on peut légitimement s’interroger sur les métiers qui demeurent en tension aujourd’hui.
En effet, les difficultés de recrutement que rencontrent 23 % des entreprises durant le premier semestre 2018 mettent en lumière des phénomènes endémiques. Ainsi, 70 % des entreprises ayant eu du mal à recruter évoquent des problèmes de qualification ; 63 % d’entre elles évoquent aussi l’absence de candidatures. La part des embauches jugées difficiles s’accentue et s’élève à 44, 4 % en 2018, tous secteurs confondus.
Ces difficultés ont augmenté le plus dans les entreprises d’un à quatre salariés. Elles sont bien sûr liées à la pénurie de candidats, à l’inadéquation des profils, mais aussi aux conditions de travail.
Pour les métiers de bouche par exemple, les projets de recrutement sont jugés difficiles à 74 % dans la boucherie, à 72, 9 % chez les charcutiers-traiteurs, à 67 % en boulangerie-pâtisserie. Si l’on sait que ce déficit d’attractivité s’explique en partie par la priorité donnée à l’enseignement général au détriment des métiers de l’économie de proximité, où les opportunités sont pourtant plus nombreuses, on peut donc attendre de la part du Gouvernement des actions fortes visant à corriger ce phénomène.
Alors que le besoin de main-d’œuvre existe réellement dans les TPE artisanales notamment, comme dans le secteur du BTP, je vous demande, madame la ministre, de bien vouloir m’indiquer les dispositions qui sont prises pour accroître l’attractivité de ces métiers.
Madame la sénatrice, je me permettrai d’abord d’apporter une précision : il n’y a pas 6 millions de demandeurs d’emploi en France, si l’on entend par demandeur d’emploi une personne prête à travailler demain si elle trouve un emploi.
C’est le nombre d’inscrits en flux qui s’élève à 6 millions, car on peut avoir un travail et être inscrit à Pôle emploi, qui est aussi un service de mise en relation avec des offres. Au sens de l’INSEE et du Bureau international du travail, le BIT, le nombre de demandeurs d’emploi immédiatement disponibles pour prendre un emploi en France est de 2, 6 millions. Néanmoins, ce nombre est encore énorme, et c’est notre but à tous de le faire diminuer.
Vous avez évoqué ceux qui ne répondent pas. Cela s’explique parfois par les règles de l’assurance chômage, car certaines d’entre elles conduisent à perdre un revenu si l’on reprend un travail. Ce n’est pas possible ! Une personne ne retournera pas travailler si elle gagne moins. Ce problème ne concerne pas tous les demandeurs d’emploi, mais il fait partie des règles sur lesquelles les partenaires sociaux se penchent.
Certaines personnes sont aussi découragées, après avoir cherché indéfiniment et frappé à toutes les portes. Au cours des contrôles – l’année dernière, Pôle emploi a réalisé 300 000 contrôles –, nous nous sommes aperçus que 66 % des chômeurs cherchaient réellement un travail, que 20 % n’en cherchaient plus par découragement – ces contrôles les ont redynamisés, les ont relancés dans une dynamique d’emploi, qui a produit d’excellents résultats – et que 14 % n’en cherchaient vraiment pas, tout en ayant les moyens d’en chercher sans être découragés. Ce dernier cas relève d’un autre type d’action. Ces chiffres montrent bien que la majorité cherche du travail, mais qu’il est possible d’être parfois découragé. C’est pourquoi l’accompagnement est très important.
En ce qui concerne les métiers, j’ai déjà eu l’occasion de répondre lors de questions précédentes. L’une des grandes voies, c’est – je le crois – l’apprentissage.
L’apprentissage ouvre à tous les métiers, de ceux du numérique aux métiers verts. Le secteur agricole a besoin aujourd’hui de relève et cherche notamment des mécaniciens agricoles et des vétérinaires ; la plupart des jeunes qui ne sont pas du monde agricole pensent que ce domaine n’est pas pour eux. Cela nous ramène au problème de l’Ardèche…
Il faut aller vers une ouverture très large des métiers. Les jeunes filles pensent que les métiers de la technique ne sont pas pour elles : on en est encore là en France en 2018 ! Dans le numérique, 90 % des emplois sont pourvus par de jeunes hommes ; pourquoi n’y aurait-il pas plus de femmes ? Une action doit aussi être mise en œuvre sur ce point.
Avec le grand projet d’ouverture que Jean-Michel Blanquer et moi-même menons avec les régions et les branches dans tous les collèges et lycées pour faire découvrir les métiers, on peut changer les choses en quelques années. La génération qui entre en quatrième bénéficiera de nombreuses initiatives pour faire découvrir les métiers. C’est cela qui permettra de changer le regard. C’est d’ailleurs déjà le cas, ce qui est très encourageant, alors que nous commençons à peine ces opérations. Des actions sont menées à titre expérimental, nous allons maintenant les déployer massivement pour tous les jeunes du pays, ce qui va être d’une grande aide.
Dans les métiers que vous avez évoqués, certains travaillent dans des conditions difficiles, d’autres pas, mais comme ces métiers ne sont pas connus, personne n’y va. Il reste beaucoup à faire !

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le 16 septembre dernier, un échange entre Emmanuel Macron et un jeune horticulteur en recherche d’emploi a relancé la question des emplois non pourvus.
Dans un contexte de chômage élevé, l’existence d’emplois ne trouvant pas preneur est un paradoxe fréquemment dénoncé en France. Si le chiffre de 300 000 emplois non pourvus est souvent avancé, en réalité aucun indicateur ne permet aujourd’hui de mesurer l’ampleur réelle du phénomène ni d’en analyser les causes.
Le seul élément de réflexion à notre disposition réside dans les résultats de l’enquête « Besoins en main-d’œuvre » réalisée chaque année sous le pilotage de Pôle emploi et du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie, le CRÉDOC.
Ainsi, après une hausse de 8, 2 % en 2017, l’enquête sur les « Besoins en main-d’œuvre des entreprises » pour l’année 2018 fait état d’une hausse inédite de 18, 7 % du nombre de projets de recrutement, soit une augmentation de 370 000 par rapport à 2017.
Près de 2 350 000 projets de recrutement étaient ainsi anticipés pour l’année 2018. Les plus fortes augmentations d’intentions d’embauche se situent dans la construction et l’industrie, avec des hausses respectives de 37 % et 27, 4 %.
Si ces chiffres sont plus qu’encourageants, cette même étude révèle malheureusement que les difficultés de recrutement perçues par les employeurs sont nettement en hausse. Par exemple, le secteur de l’hôtellerie-restauration où, selon l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie, l’UMIH, entre 50 000 et 100 000 emplois n’ont pas été pourvus à l’été 2018.
Cela explique probablement pourquoi ce début de reprise économique n’est pas encore perçu par les Français.
Désormais, 44, 4 % des projets de recrutement sont jugés difficiles par les employeurs, contre 37, 5 % l’an dernier. Selon les recruteurs, les candidatures inadéquates demeurent le principal motif de ces difficultés – soit l’employeur constate une pénurie de candidats, soit les profils ne lui conviennent pas. Se pose alors la question de l’employabilité de certains candidats et de l’attractivité de certains emplois, qui atteint même le recrutement des apprentis en CFA.
Il est important d’encourager la reprise d’activité. L’emploi doit être plus rémunérateur et valorisant que les minima sociaux.
Pouvez-vous, madame la ministre, me préciser aujourd’hui le plan d’action que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour anticiper le besoin de main-d’œuvre pour 2019 ? Compte tenu des secteurs qui vont recruter, ne faut-il pas encourager les AFPA plutôt que de les fermer ?
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.
Monsieur le sénateur, je voudrais d’abord dire, en étant quelque peu provocatrice, que ces difficultés de recrutement sont un « beau » problème. Car cela signifie que la France recrute aujourd’hui !
Nous avons plus de tensions parce que nous recrutons davantage qu’il y a quelques années. L’élément nouveau depuis un an est que l’on recrute plus en CDI, ce qui n’était pas arrivé depuis plus de dix ans.
L’industrie s’est remise à recruter. Pourquoi avons-nous une pénurie dans ce secteur ? En quinze ans, nous avons perdu un million d’emplois dans l’industrie en France ! Ce domaine est sorti de la tête des familles et des jeunes, pour lesquels ces métiers ne sont plus vus comme des métiers d’avenir.
Depuis un an, l’industrie cherche du monde. Bien évidemment, il faut reconstruire toute l’offre de formation. De plus, dans l’industrie, ce sont des métiers qualifiés. On cherche des soudeurs – cela a toujours été le cas, mais maintenant c’est dans des proportions énormes. On cherche des forgeurs numériques : tous ces métiers intègrent maintenant le numérique, mais les jeunes en ont une image qui date, si j’ose dire, de l’époque de Zola, alors qu’ils sont aujourd’hui extrêmement modernes, passionnants et plutôt mieux rémunérés que d’autres. On cherche des techniciens supérieurs et de maintenance. On cherche dans tous les secteurs ! On lance un plan fibre, mais on ne trouve pas de poseurs de fibre… Nous pourrions passer la soirée à citer des exemples bien réels.
Le premier sujet est celui des compétences, d’où cet effort massif au travers de l’apprentissage et du plan d’investissement dans les compétences ; c’est vraiment la priorité. Rien que pour les 124 territoires d’industrie qui viennent d’être annoncés, nous avons prévu dans ce plan 110 millions d’euros pour les questions de compétences et de qualification.
Certains métiers se sont aussi beaucoup développés. Vous avez évoqué l’hôtellerie-restauration, qui pose pour partie la question des conditions de travail, mais qui va de pair avec l’extraordinaire explosion du tourisme. La hausse du nombre d’emplois dans ces métiers dans notre pays est de 9 % depuis dix ans. C’est une bonne nouvelle, et c’est un « beau » problème, allais-je dire, à condition de le résoudre !
Certains emplois ne sont pas attractifs, on le sait, mais nous manquons de certains autres métiers, par exemple les chefs cuisiniers, pour lesquels une qualification qui ne s’acquiert que par l’apprentissage est nécessaire.
Nous avons la qualité, et même la meilleure. Je profite de l’occasion pour vous annoncer que la France a postulé pour être l’organisatrice en 2023 des jeux Olympiques, si j’ose dire, de l’apprentissage et des métiers que sont les WorldSkills. J’espère que nous pourrons alors faire briller les talents de la France dans tous les domaines. Cela permettra aussi de montrer l’attractivité des métiers, y compris les métiers techniques et ceux de l’aide aux personnes.
Il y a toutes sortes de métiers dans l’apprentissage, et chaque fois qu’on promeut l’apprentissage, on promeut le travail, on promeut la valeur du travail et on promeut l’attractivité des entreprises.
Mmes Frédérique Puissat, Patricia Morhet-Richaud et Sophie Primas applaudissent.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, parmi les paradoxes français, le problème des emplois non pourvus n’est pas le moindre, alors que le taux de chômage est encore à plus de 9 %. Leur nombre pose une sérieuse question sur l’efficacité de notre politique de l’emploi et la vitalité de notre économie.
Selon Pôle emploi, sur 300 000 offres d’emploi non pourvues en France, 97 000 ont été annulées, du fait de la disparition du besoin ou d’un manque de budget disponible dans les entreprises ; 53 000 n’ont pas abouti et sont encore en attente de recrutement, et 150 000 ont été abandonnées, faute de candidats. Je note avec satisfaction que j’ai exactement les mêmes chiffres que notre collègue Joël Guerriau.
Les 150 000 abandons ne sont pas seulement le reflet d’un dysfonctionnement du marché du travail. Madame la ministre, quatre raisons peuvent expliquer ces abandons par les recruteurs.
Premièrement, il peut arriver que les candidats ne disposent pas de l’expérience et/ou des compétences attendues pour le poste. En matière de recrutement, il n’est pas seulement question de formation, il est aussi question d’expérience et de compétences et favoriser l’apprentissage est essentiel. Que comptez-vous faire pour les autres filières ?
Deuxièmement, le manque d’attractivité des postes. Comment l’État pourrait-il concourir à l’attractivité de certains métiers et de certains secteurs et branches d’activité ?
Troisièmement, l’inexpérience des recruteurs et leur méconnaissance du marché du travail. Prévoyez-vous la mise en place d’aides spécifiques aux employeurs les moins autonomes, PME et TPE en premier lieu, qui néanmoins ont besoin de recruter ?
Quatrièmement, enfin, la fracture territoriale et la faible mobilité étant susceptibles de renforcer ce phénomène, quelles actions envisagez-vous pour les territoires éloignés des métropoles ?
J’ajouterai en outre trois autres questions. Comment adapter le contrôle des chômeurs à la réalité des emplois non pourvus ? Quelle réponse spécifique pouvons-nous apporter pour les départements et régions d’outre-mer ? Enfin, pensez-vous pouvoir améliorer la problématique des emplois non pourvus par des actions à l’échelle européenne, avec l’appui du réseau EURES ?
Le sujet du recrutement est effectivement très important. À mon sens, et j’ai un peu d’expérience dans ce domaine, il nous faut changer nos approches. Aujourd’hui, malgré des changements en cours, les employeurs ont une approche trop « clonée », c’est-à-dire que, s’ils ne cherchent que des hommes entre 28 et 40 ans, qui ont le bon diplôme et la bonne expérience, sans handicap et qui n’habitent pas dans un quartier prioritaire de la ville, ils ne vont pas les trouver. C’est ce que je leur dis souvent. En revanche, s’ils s’ouvrent aux seniors, aux femmes, aux personnes en situation de handicap, aux réfugiés, aux habitants des quartiers prioritaires de la ville, et qu’on aide ces publics à accéder à l’emploi, alors, à ce moment-là, le vivier de ressources devient beaucoup plus grand.
Je crois que cette approche est très importante, même si elle ne permet pas de répondre à toutes les situations. J’étais voilà quelques semaines à Poitiers dans une entreprise qui a accueilli des réfugiés formés dans le cadre d’un de nos programmes, avec un taux de succès à 100 %. Les dirigeants, ravis d’avoir trouvé des gens motivés, formés, ont changé leur manière de recruter.
C’est pareil pour les jeunes et pour les habitants des quartiers prioritaires de la ville. L’expérimentation « emplois francs », qui a mis quelques mois à bien prendre son envol, est en phase d’accélération. En la matière, il faut passer outre les préjugés et les stéréotypes, qui s’apparentent parfois à de la discrimination.
Cela fait partie aussi de notre stratégie de lutte contre le chômage. Il y a des représentations erronées des métiers et de l’emploi du côté des demandeurs d’emploi, mais il y a aussi des représentations erronées des demandeurs d’emploi du côté des recruteurs.
Cette approche est d’autant plus importante que tout le monde va évoluer dans ces métiers. On a testé chez Pôle emploi un type de recrutement où l’on s’intéresse non pas aux CV ou aux diplômes, mais aux compétences. Je puis vous dire que les succès sont remarquables, car cela permet aux demandeurs d’emploi de découvrir qu’ils ont des compétences et de les formaliser. Du côté des employeurs, les taux de réussite sont très importants.
En résumé, il faut aussi que nous changions les mentalités, ce que j’ose appeler le logiciel de recrutement.
Sur la question européenne – c’est un des volets de la réforme de l’apprentissage –, nous allons mettre tous les moyens pour développer l’Erasmus de l’apprentissage. Nous avons déverrouillé grâce à la loi tout ce qui empêchait de le faire. Cela fera partie de l’attractivité de l’apprentissage. Nos apprentis, comme nos étudiants, doivent pouvoir s’ouvrir à d’autres pays, apprendre d’autres techniques et découvrir d’autres cultures.
M. Yves Bouloux, ainsi que Mmes Frédérique Puissat, Patricia Morhet-Richaud et Corinne Imbert applaudissent.

M. Jean-Raymond Hugonet. Monsieur le président, madame la ministre, m’exprimant en dernier orateur devant un hémicycle bondé et des tribunes combles
Sourires.

… je ne peux m’empêcher de penser à La Bruyère lorsqu’il disait : « Tout est dit, et l’on vient trop tard… »
Madame la ministre, notre pays compte aujourd’hui 5 649 600 demandeurs d’emploi. Et pourtant, dans le même temps, la pénurie de compétences est devenue une des préoccupations majeures des entreprises.
Plus d’un tiers d’entre elles ne parviennent pas à recruter les salariés dont elles ont besoin.
Dans le cadre de la récente enquête « Besoins en main-d’œuvre 2018 », Pôle emploi estime à 44, 4 % la proportion de recrutements jugés difficiles par les entreprises en 2018, contre 37, 5 % en 2017. Ainsi, 744 354 projets de recrutement sont considérés comme difficiles cette année. On estime par ailleurs que plus de 300 000 offres d’emploi restent non pourvues, faute de candidature.
Cette situation est d’autant plus choquante qu’elle est incompréhensible.
Certains feront porter la responsabilité sur les entreprises, en mettant en avant la dureté des conditions de travail dans certains métiers ou la faiblesse des salaires proposés. D’autres justifieront cette situation par l’inefficacité actuelle du dispositif de formation professionnelle. D’autres, enfin, considéreront que rien n’est fait pour inciter les demandeurs d’emploi à retrouver le chemin de l’entreprise et que les abus sont multiples.
En réalité, l’ensemble de ces arguments sont sans doute à prendre en compte.
Aucun secteur n’échappe au problème et il existe des pistes à creuser.
La préparation opérationnelle à l’emploi individuelle est une forme de réponse. Rappelons qu’elle consiste à identifier une compétence et à former une personne en vue d’une offre d’emploi disponible. Plus de 85 % des salariés entrant dans ce dispositif ont retrouvé un emploi. Sa généralisation pourrait être envisagée.
Autre piste à explorer, l’incitation à la reprise d’emploi. Est-il, par exemple, acceptable qu’un salarié qui se voit offrir un CDI à l’issue de son CDD puisse le refuser et faire le choix de s’inscrire à Pôle emploi ?
Enfin, cela a été dit, il nous faut davantage miser réellement sur l’apprentissage, dont l’efficacité n’est plus à démontrer, mais qui peine toujours à s’imposer.
On le voit, mes chers collègues, cette question difficile passe obligatoirement par un éventail de solutions. Il faut donc la traiter dans sa globalité en imaginant une chaîne de réponses multiples. Il est maintenant très urgent d’agir !
Monsieur le sénateur, je partage tout à fait votre point de vue. Tous ceux qui pensent qu’il y a une baguette magique et une seule pour la lutte contre le chômage se trompent. Je pense comme vous qu’il y a un éventail de solutions. Il faut agir sur tous les leviers à la fois : l’offre, la demande, la formation, la mobilité, la motivation, la dignité du travail, les formes et conditions du travail. Bref, et, d’ailleurs, l’ensemble de vos questions le montrent, lutter contre le chômage de masse, c’est en même temps valoriser le travail, le retour au travail et donner les moyens à chacun d’accéder à un emploi.
C’est une question vaste, et peut-être y a-t-il des sujets que nous n’avons pas encore assez développés. Pour autant, je pense qu’avec le Plan d’investissement dans les compétences nous avons choisi d’accélérer. Nous finançons massivement les préparations opérationnelles à l’emploi individuelles, car, comme vous l’avez dit, elles sont très efficaces. Nous allons aussi développer l’insertion par l’activité économique via les entreprises adaptées.
Enfin, nous misons sur l’opération #VersUnMetier, qui porte spécifiquement sur les métiers en tension. Cette opération a été lancée avec le directeur général de Pôle emploi voilà deux mois et demi. Déjà 10 000 actions ont été menées dans plus de 800 agences Pôle emploi. Le succès est au rendez-vous, car c’est non pas un agent de Pôle emploi qui parle d’un métier aux demandeurs d’emploi, mais directement le chef d’entreprise, l’entrepreneur ou un collaborateur.
J’étais il y a quelques semaines à Paris dans une agence du XXe arrondissement où une cinquantaine de demandeurs d’emploi étaient venus découvrir ce qu’était un référent web. Dans une PME, il s’agit de la personne qui sait à la fois s’occuper des connexions de l’ordinateur, faire un emailing, réaliser un petit développement web. C’est un peu le « couteau suisse » dont a besoin la PME. Il arrive que ces salariés soient à la disposition d’un groupement d’employeurs, parce qu’il n’y a pas de besoin à plein-temps pour un seul employeur. Il y a donc une offre potentielle de CDI très intéressants, répartis sur deux ou trois entreprises. Ces emplois ne nécessitent pas de qualifications préalables ; on n’a pas besoin d’être geek ni d’avoir fait des maths. Il suffit de suivre les quatre mois de formation intensive, que nous finançons grâce au Plan d’investissement dans les compétences.
Ce genre d’approche montre une chose : il faut actionner tous les leviers et, je terminerai sur ce point, mobiliser les leviers et les acteurs sur le terrain, car ce sont de multiples microsolutions de ce type qui font reculer le chômage chaque jour. Nous nous y attelons, et nous avons besoin du soutien de tous pour le faire.

Pour clore ce débat, la parole est à M. Daniel Chasseing, pour le groupe auteur de la demande.
Vous disposez de cinq minutes, mon cher collègue.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le marché du travail présente une inadéquation persistante entre l’offre et la demande, faute de candidats ou faute de profils adéquats. Les secteurs du bâtiment et de la construction sont les premiers concernés, mais il y a aussi la filière des services à la personne, le commerce, les TPE, les emplois saisonniers, en horaires décalés, et le travail le week-end.
En décembre 2017, le conseil d’administration de Pôle emploi constatait que 150 000 à 200 000 offres n’étaient pas pourvues, faute de candidats. Les principales causes incriminées par les recruteurs sont le manque de formation, soit le manque de compétences nécessaires, la faible attractivité de certaines offres due à un déficit d’image, aux conditions de travail ou à l’éloignement.
Pourquoi ce constat ? En France, 150 000 jeunes sortent chaque année du milieu scolaire sans formation et sans diplôme ; il y a au total 1, 3 million de personnes dans cette situation. La France compte 22 % de ses jeunes au chômage, et seulement 300 000 à 400 000 apprentis, tandis que l’Allemagne compte 1, 4 million d’apprentis et seulement 7 % de jeunes au chômage. Mon collègue Jean-Pierre Decool a fait état des difficultés de recrutement des apprentis dans certaines filières, notamment l’hôtellerie-restauration.
De plus, le système d’orientation n’est pas suffisamment performant en France : 50 % des jeunes disent avoir mal été accompagnés dans les établissements scolaires. Notre pays accuse un grand retard dans ce domaine, l’orientation se limitant bien souvent à la présentation des filières, quand dans d’autres pays, comme en Finlande, l’orientation est pleinement intégrée dès l’école élémentaire, avec également, au collège, des visites dans les entreprises, des films sur les métiers et des entretiens individuels assurés par un enseignant spécifique.
En ce qui concerne la formation, seulement 19 % des ouvriers en font la demande à l’employeur, contre 50 % des cadres. La réalisation d’entretiens professionnels dans les TPE serait souhaitable.
La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel apporte des solutions pour les apprentis, avec une transformation d’un système trop complexe. Elle vise notamment l’aide pérenne aux entreprises, les horaires de travail adaptés, la simplification des contrats d’apprentissage, la possibilité d’apprentissage jusqu’à 30 ans et la mise en place d’une meilleure information par les régions dans les lycées.
Il s’agit également, à travers les ordonnances prises sur le fondement de la loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, d’encourager le dialogue social dans les entreprises pour améliorer la formation des salariés.
Actuellement, les CFA et les lycées professionnels sont gérés respectivement par les branches et l’éducation nationale, qui doivent travailler ensemble pour tenir compte de la spécificité de l’emploi des territoires et faire de l’apprentissage une voie d’excellence. Il est nécessaire d’associer Pôle emploi, la région, les partenaires sociaux et les entreprises pour réorganiser la formation, en particulier en tenant compte des compétences recherchées dans les bassins d’emploi.
Le Gouvernement a misé sur la formation professionnelle, avec un financement de 15 milliards d’euros entre 2018 et 2022 pour rehausser le niveau de compétences des plus éloignés de l’emploi.
L’aide à la mobilité, notamment dans le milieu rural, est essentielle. Il faut une différence de salaire suffisamment incitative, coût de mobilité compris, entre les personnes qui travaillent et celles qui restent inactives.
Le réseau emplois compétences pourrait tenir le rôle de plateforme de coordination, chargée de centraliser, de traiter les données locales et d’anticiper les besoins par le déploiement de formations centrées sur les compétences recherchées dans les bassins d’emploi.
Pour conclure, je dirai que la lutte contre le chômage passe par la formation initiale et continue, notamment par une voie d’apprentissage, mais aussi par une coopération étroite avec les entreprises, les plus à même d’identifier les salariés dont elles ont besoin. Les personnes handicapées pourront, avec le doublement des entreprises adaptées, trouver aussi une solution. Redonner un sens et une valeur au travail, faire de l’apprentissage une voie d’excellence, favoriser les mobilités internes et géographiques, ainsi que les formations en entreprise : tels sont les principaux axes d’action que nous proposons pour apporter une réponse aux problèmes des emplois non pourvus et du chômage.
Je veux enfin remercier notre collègue Joël Guerriau, qui a pris l’initiative de ce débat, mais également Mme la ministre et tous nos collègues, qui nous ont permis d’avoir des échanges de qualité.
MM. Emmanuel Capus et Jean-Pierre Decool, ainsi que Mme Patricia Schillinger applaudissent.
Monsieur le président, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je vous remercie d’avoir permis ce débat. J’ai apprécié cette conclusion, qui, je crois, montre bien que la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et le Plan d’investissement dans les compétences nous offrent tous les moyens pour développer l’apprentissage et la formation. Nous avons aussi progressé sur le développement de la mobilité, qui est importante, même si nous avons bien identifié qu’il s’agissait probablement d’un des axes de progrès : il faut mieux relier l’offre de formation à la demande.
En matière d’apprentissage, je suis confiante : le secteur du bâtiment a lancé une opération « 15 000 bâtisseurs » ; l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat pense que ses adhérents pourront créer 60 000 places de plus dans le secteur grâce à la loi ; l’industrie s’est quant à elle engagée à en créer 40 000 de plus. Le mouvement a déjà commencé à la rentrée.
Grâce à cette stratégie, si nous arrivons, d’une part, à faire vraiment décoller l’apprentissage dans notre pays, et donc à réduire significativement le chômage des jeunes, et, d’autre part, à permettre à tous ceux qui sont les plus éloignés de l’emploi de bénéficier de cette croissance inclusive, nous aurons fait œuvre utile et nous pourrons faire baisser significativement le chômage. C’est un travail de longue haleine ; il ne faut rien lâcher, sur aucun des leviers, car tous sont importants. Cette vue d’ensemble et cette détermination à agir sur le terrain, avec l’ensemble des acteurs concernés, peuvent nous permettre d’obtenir des résultats. Il n’y a pas de fatalité ni de raison à ce que la France, sixième puissance économique mondiale, continue d’avoir 9, 1 % de chômage et 20 % de chômage des jeunes. C’est notre combat à tous ! Encore une fois, je vous remercie de ce débat, qui a permis d’éclairer plusieurs aspects très importants.
Mme Patricia Schillinger, ainsi que MM. Emmanuel Capus, Jean-Pierre Decool et Loïc Hervé applaudissent. – plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains applaudissent également.

Nous en avons terminé avec le débat sur le thème : « Emplois non pourvus en France : quelles réponses ? quelles actions ? »

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, jeudi 13 décembre 2018, à quinze heures :
Questions d’actualité au Gouvernement
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures vingt-cinq.
La liste des candidats désignés par la commission spéciale pour faire partie de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l ’ Union européenne a été publiée conformément à l ’ article 12 du règlement.
Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai d ’ une heure prévu par l ’ article 9 du règlement, cette liste est ratifiée. Les représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire sont :
Titulaires : MM. Jean Bizet, Ladislas Poniatowski, Jean-François Rapin, Olivier Henno, Didier Marie, Jean-Marc Todeschini et André Gattolin ;
Suppléants : MM. Éric Bocquet, Jean-Noël Guérini, Benoît Huré, Claude Kern, Ronan Le Gleut, Mme Claudine Lepage et M. Olivier Paccaud.