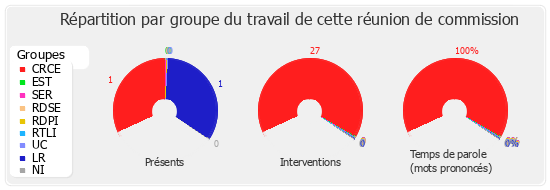Mission commune d'information Inondations dans le Var
Réunion du 11 juillet 2012 : 1ère réunion
Sommaire
- Audition de m. thibaud normand chef du service prévention des risques de la dreal- paca (voir le dossier)
- Audition de mme stéphanie bidault déléguée générale et de m. nicolas bauduceau directeur scientifique et technique du centre européen de prévention des risques d'inondation cepri (voir le dossier)
- Audition du général pierre chavancy chef de la division emploi de l'etat-major des armées (voir le dossier)
- Audition de m. jean-luc salagnac chef du projet impact du changement climatique sur le cadre bâti ic3b au centre scientifique et technique du bâtiment cstb (voir le dossier)
La réunion

Mes chers collègues, nous recevons aujourd'hui, pour entamer notre dernier cycle d'auditions, Monsieur Thibaud Normand, chef du service de la prévention des risques au sein de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de la région qui intéresse particulièrement notre mission, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Notre mission a eu l'occasion de se déplacer à deux reprises dans votre région, les 4, 5 et 6 avril derniers dans le Var et les Alpes-Maritimes, puis les 11, 12 et 13 avril dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône où nous avons rencontré, à cette occasion, le Préfet Hugues Parant et votre directeur adjoint, M. Laurent Neyer.
Tout au long de nos travaux, certaines questions sont revenues avec une acuité indéniable, que ce soit au sujet des PPRI et notamment leur mode d'élaboration, qu'à propos de l'entretien souvent défaillant des cours d'eau ou encore de la culture du risque.
Après une formation à l'École Polytechnique puis dans le corps des Mines, vous avez intégré en 2010, Monsieur Thibaud Normand, la DREAL de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au sein du service de prévention des risques que vous dirigez désormais. Fort de votre expérience de terrain, vous allez pouvoir éclairer les membres de la mission, notamment sur la question plus spécifique qu'est la cartographie du risque telle qu'elle est pratiquée actuellement par les services de l'État, ce qui contribuera à lever des interrogations que notre rapporteur nourrit sur la méthode employée.
Je vous laisse donc la parole pour une quinzaine de minutes avant un échange avec le rapporteur.
Je souligne que la pertinence des modèles utilisés nous paraît en cause. En effet, ceux-ci sont multiples et appliqués de différentes manières ce qui engendre des conséquences tout aussi diverses sur le terrain. Quelle est donc leur crédibilité ? Quelle est leur marge d'erreur réelle ? Ces modèles posent d'autant plus question qu'ils induisent les PPRI proposés par l'Etat et, de fait, déterminent la définition des zones rouges ou bleues.
Enfin, nous nous interrogeons également au sujet des zones urbaines constituées, qui sont des zones bleues donc inondables. Il apparaît que les services de l'Etat ont changé de position et qu'il est désormais possible d'y construire des parkings souterrains tandis que dans les zones urbaines non constituées, ces constructions sont maintenant interdites alors qu'elles avaient cours jusqu'alors.
Je tâcherai de répondre au mieux de mes possibilités.
En guise d'introduction, je souhaite souligner que la DREAL représente le ministère en région et travaille aux cotés des directions départementales des territoires et de la mer (DDTM), en particulier sur trois sujets :
- l'instruction des Programmes d'Action et de Prévention des Inondations (PAPI) ;
- l'appui méthodologique pour les PPR ou l'analyse de situation de risques ;
- la mise en oeuvre de la directive inondation et notamment de la cartographie.
Je souhaite insister sur le fait que les PPRI sont, certes, conçus sous la conduite des DDTM, mais qu'ils s'intègrent dans un « écosystème » constitué de partenaires de l'Etat. Des guides méthodologiques existent à ce propos. Vous mentionniez des règles et des modèles émis au niveau national. Il convient néanmoins de les différencier parce qu'en réalité, il n'existe pas de modèle unique imposé à l'échelle nationale. À mon avis, ils ne seraient pas légitimes sur le plan scientifique, étant donnée la grande variété cartographique des situations.
En revanche, les guides méthodologiques donnent des éléments de cadrage sur les périodes de crues à prendre en compte, notamment en ce qui concerne le critère de la crue centennale. Il est important d'énoncer ces éléments méthodologiques au niveau national pour qu'ils soient considérés de façon homogène.
Concernant les acteurs partenaires de la DDTM, la DREAL intervient en appui méthodologique surtout sur les dossiers les plus difficiles. Des agents sont spécialisés par type de risque. En ce qui concerne l'inondation, les agents spécialisés peuvent approfondir les problématiques et faire le lien entre différents départements pour s'assurer que les méthodologies sont appliquées de manière homogène étant donné que le risque d'inondation est une compétence départementale.
Je vais illustrer l'apport scientifique et technique du ministère par un exemple concret. Les inondations de juin 2010 dans le Var ont été particulièrement fortes et inédites sur le plan historique. Suite à ces inondations, un travail de retour d`expérience a été mené avec l'ensemble des partenaires scientifiques du ministère et les services déconcentrés. En effet, nous avons la chance que le CETE référent pour les risques naturels en France soit situé à Aix-en-Provence. Nous nous appuyons beaucoup sur ce service, lorsque l'Etat est en position d'assistance à maîtrise d'ouvrage et que nous menons des études hydrologiques ou hydrauliques sur des bassins importants. À ce propos, nous avons tenu hier un comité de pilotage au sujet de l'Huveaune à Marseille. Nous avions besoin que le CETE nous aide à évaluer le travail du bureau d'études. Le rôle du CETE est vraiment important : initialement en charge de l'ouvrage, il assure désormais le maintien de compétences en assistant l'Etat, maître d'ouvrage, tandis que la réalisation revient désormais au bureau d'études.
Nous avons fait appel à d'autres services du réseau scientifique et technique que vous avez déjà eu, pour certaines, l'occasion d'entendre : l'IRSTEA, anciennement CEMAGREF, le CETMEF, et l'IFFSTAR, l'ancien laboratoire des Ponts et Chaussées. Ces acteurs se sont montrés très intéressés et ont souhaité travailler sur ce territoire étant donné que cette crue était assez remarquable. Néanmoins, nous souhaitions éviter que des situations, que nous avions déjà observées lors de grandes crues précédentes, ne se répètent. En effet, suite à ces crues, des nombreuses études et des articles scientifiques ont été réalisés et publiés isolément par les acteurs, ce qui a alors nécessité de longues conférences de consensus.
Le ministère, en collaboration avec le SCHAPI et le service de prévention des crues (SPC), a demandé à ces organismes de se réunir. Peu après, des réunions de terrain rassemblant tous les acteurs ont donné lieu à un repérage des lieux et un partage des méthodes. Un groupe associant la DREAL et la DDT s'est alors constitué et travaille de concert depuis deux ans au sujet de ces inondations.
Dans un premier temps, l'objectif était de déterminer le débit observé, ce qui n'est pas une tâche facile étant donné que lors de la crue, la rivière sort de son lit.
Oui, mais le calcul du débit comprend toujours une marge d'erreur.
Nous devions ensuite déterminer la période de retour. Cet événement était-il centennal ? Devait-il servir de référence pour le PPRI ? Cette question est cruciale pour les services de l'Etat. Un tel travail incombe à l'hydrologie ; il suppose une recherche scientifique plus poussée et prend plus de temps, parce que ces bassins versants sont spécifiques.
Le groupe a déterminé pour le PPRI les endroits de crue centennale, de crue plus fréquente et moins fréquente, notamment en amont de l'Argens. Nous devrons donc modéliser une crue centennale pour le PPRI à l'endroit où elle ne l'était pas précédemment. Le groupe a continué de travailler avec l'interface du bureau d'études chargé de synthétiser l'ensemble des éléments pour réaliser le PPRI. Nous avons confronté nos méthodes et nos observations pour caler les modèles.
Par ailleurs, les collectivités territoriales participent aussi au retour d'expérience des inondations de juin 2010. Le département avait amorcé une étude sur le bassin versant réalisée par l'hydrogéologue M. Lefort. Cette étude n'a pas conduit à chiffrer les débits et les périodes de retour, mais a plutôt énoncé quelques grands principes d'aménagement. M. Lefort qui avait déjà rendu un rapport a été ensuite associé à notre groupe pour essayer de chiffrer ces éléments.
Cependant, suite aux inondations de novembre 2011, le département du Var a mené une nouvelle étude pour caractériser ces éléments et enrichir sa connaissance du bassin versant afin de réaliser un PAPI. Le bureau d'études en charge nous a associés à son travail et nous en avons fait de même. Cette collaboration est représentative des échanges que nous souhaitons avec les collectivités locales. Nous nous devions de les associer parce que tous les modèles ainsi définis permettront de construire le PAPI, principalement porté par les collectivités territoriales. En ce sens, il est important qu'elles s'approprient les études et y portent un regard critique.
De manière générale, notre souci est d'associer à toutes les études hydrauliques et hydrologiques que nous lançons les syndicats de rivières. En effet, la première phase de ces études est le recueil des données de terrain et dans ce cas, les syndicats de rivière sont à même de nous apporter leurs connaissances de terrain et nous aider à faire le bilan des crues passées.
D'autres éléments d'information sont tout aussi importants, notamment les données hydrométriques et de prévision des crues. Le SPC est donc associé à notre démarche. Pour permettre de caler les modèles, toutes ces informations sont ajoutées à la banque de données HYDRO, partagée avec les collectivités locales. La connaissance des crues rapides certes progresse vite, mais elle demeure moins précise que celle des crues lentes.

Cette banque de données HYDRO est-elle à la disposition de toutes les collectivités territoriales ?
Chaque SPC dispose d'une banque de données HYDRO. Les données sont partagées avec les collectivités territoriales. Pour en disposer sous un format spécifique, il suffit de contacter le SPC. Les collectivités peuvent ainsi disposer d'hydrogrammes de crues historiques.

Les données permettent ainsi de caler de manière plus fine les modèles.
Tout à fait. Même si les modèles conservent un degré d'incertitude, chaque événement fait l'objet d'un retour d'expérience pour améliorer le modèle. C'est l'objectif de chaque SPC.
Je souhaite souligner que la concertation avec les collectivités territoriales figure clairement dans la directive européenne sur la gestion du risque d'inondation. Celle-ci prévoit une association de l'ensemble des acteurs, notamment durant l'étape de la cartographie. Concrètement, nous partageons les données avec les syndicats de rivière que nous associons aux comités de pilotage pour la réalisation des cartes. Cette démarche est désormais appliquée pour les nouvelles études hydrauliques et hydrologiques.
Cette directive date de 2007 et elle a été transposée en 2010. Elle comporte plusieurs étapes :
La première étape est l'évaluation préliminaire harmonisée au niveau du territoire pour considérer tous les enjeux des zones potentiellement inondables. C'est ainsi que nous nous rendons compte que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est la seconde région, après l'Ile-de-France, comportant le plus d'habitants de zones potentiellement inondables. Cette étape nous apporte une vision macroscopique de la situation.

Cette région est-elle plus soumise au risque d'inondation que les régions du Languedoc-Roussillon ou de Rhône-Alpes ?
Oui, si nous considérons le nombre de personnes potentiellement touchées.

Ce n'est pas le cas pour la récurrence des évènements ou leurs conséquences, n'est-ce pas ?
Non, pas pour l'intensité des évènements en effet. Il s'agit d'une donnée simpliste indépendante de l'aléa ; or, nous souhaitions un indicateur homogène à l'échelle nationale.
La seconde étape de la directive est une cartographie qui permettra un zoom sur les territoires à risque important pour mettre en oeuvre des stratégies locales. Nous souhaitons nous assurer que les PAPI sont mis en place sur tous les territoires présentant des risques importants. Par exemple, des PAPI ou des projets couvre les cours d'eau des Alpes-Maritimes, tandis qu'il existe un seul PAPI dans les Bouches-du-Rhône et que le Var en manque aussi.
Oui, il s'agissait du premier département de la région PACA à mettre en oeuvre la première génération de PAPI. En ce qui concerne la nouvelle génération de PAPI, deux projets qui proviennent de ce département ont été examinés en commission mixte inondations.

Concernant le Languedoc-Roussillon, nous avons constaté que les collectivités territoriales du Gard et la ville de Nîmes en particulier menaient une réflexion approfondie et des actions importantes. Anticipent-elles les attentes de l'Etat ? Comment évaluez-vous leur participation ?
Le Languedoc-Roussillon est la première région en termes de développement des PAPI. L'implication des communautés est pérenne et se traduit par des actions concrètes très efficaces.
Il est intéressant de préciser que nous savons depuis plusieurs années les actions qu'il conviendrait de mener sur l'habitat pour améliorer sa résilience. Il s'agit de méthodes simples que nous avons identifiées. Il n'existe cependant pas en France, à ce jour, de programmes de travaux étendus relatifs aux logements dans les zones inondables parce que les financements sont multipartites et complexes à mettre en place.
Néanmoins, des initiatives émergent, notamment dans le Vaucluse, sur le bassin du sud-ouest du Mont Ventoux, suite à un accord entre les collectivités, le département, la région et l'Etat. Le programme sur l'habitat sera mené dans un périmètre de zone inondable déterminé dans le PPRI et via une approche PAPI.

Depuis plusieurs années, les actions simples qui permettraient aux habitants de vivre mieux dans des zones inondables sont connues selon vous. Pensez-vous réellement qu'on puisse atteindre de bons objectifs en termes de protection ?
Dans l'attente de précisions des représentants du conseil scientifique et technique du bâtiment (CSTB), je peux vous indiquer que les points de vulnérabilité de l'habitat et les solutions sont connus.
L'apposition des réseaux électriques à un mètre de hauteur plutôt qu'au ras du sol est un exemple. Ce changement a un coût mais il n'est pas prohibitif.
En revanche, il est difficile de mettre en place une démarche concertée à l'ensemble d'un quartier, d'une commune ou d'un bassin versant parce qu'il faut obtenir un financement, les riverains n'acceptant pas aisément de payer le reste à charge sur leurs propres deniers. L'Etat pourrait contribuer, via le fonds Barnier si des prescriptions existent, mais les collectivités devraient alors décider de concert de compléter cet apport.
Dans le cas du Vaucluse, les travaux chez les riverains commencent en ce moment. L'intervention du département et de la région a été nécessaire pour faire aboutir le projet après plusieurs années.
Par ailleurs, la démarche de réduction de vulnérabilité n'est pas homogène selon ses cibles. Dans le cadre du plan Rhône, à l'attention des agriculteurs, la chambre d'agriculture doit investir et servir d'interface entre les agriculteurs et l'Etat. Les mesures de réduction de vulnérabilité pour les agriculteurs sont différentes de celles des habitants et nécessitent de surélever les équipements agricoles les plus précieux. Grâce à la volonté des acteurs locaux et de l'Etat, le financement du projet a atteint 80 % et les premiers dossiers ont été validés, il y a environ un an.

L'habitat neuf intègre-t-il initialement les mesures de protection contre les inondations ?
L'habitat neuf soulève la question du PPRI sur la possibilité de construction. En effet, le PPRI comporte des prescriptions relatives à l'habitat neuf dans les zones constructibles sous conditions.

À ce propos, je ne comprends pas qu'en zone urbaine non constituée, il ne soit plus possible de construire des parkings en sous-sol alors qu'en zone urbaine constituée, ces constructions restent possibles.
Je ne connais pas ce cas précisément. Néanmoins, la règle du ministère est de distinguer les espaces urbanisés où la continuité de vie doit être préservée et les zones hors centres urbains où les contraintes sont plus fortes.

Comment expliquer aux concitoyens que la règle est plus stricte précisément là où se trouvent le moins d'habitations et donc de personnes exposées au danger ?
Il faut considérer cette question à l'aune de l'aménagement du territoire.
Prenons l'exemple d'une petite commune du Rhône en campagne avec une artère principale. La définition du centre urbain dense serait limitée à l'habitat existant en coeur de village. La règle est de préserver le développement de la commune dans les limites des zones urbaines.

En l'occurrence, il ne s'agit pas d'un critère de risque, mais d'aménagement du territoire. Je comprends que l'aménagement du territoire soit un critère pour la lutte contre le mitage mais pas en termes de vulnérabilité et de risque. Les élus locaux ont du mal à comprendre que les règles soient plus strictes dans les zones périphériques. Je ne sais pas comment expliquer à mes concitoyens une limite entre des zones parfois situées à seulement 200 mètres de distance. La divergence des règles de réduction de la vulnérabilité du bâtiment nouveau selon qu'elles s'appliquent aux zones urbaines constituées ou aux zones urbaines non constituées me laisse songeur, surtout si je les compare aux principes d'égalité de traitement.
La différence réside dans les règles, mais pas dans l'aléa parce que le risque peut être le même pour les deux zones. La deuxième phase du PPR, relative à l'urbanisme, détermine cette limite ainsi que l'appréciation locale de la situation. Néanmoins, la logique est que si l'habitat doit être transformé ou densifié, il convient de le faire dans la zone urbaine constituée.
Il est évident qu'une compétence en matière d'hydrologie et d'hydraulique doit être conservée au sein de l'Etat pour maintenir un regard critique sur les études. La DDTM ne dispose pas d'expert en hydrologie ou hydraulique étant donné que son rôle ne relève pas de l'expertise, mais elle doit néanmoins disposer des clés de lecture pour appréhender le travail des bureaux d'études en faisant appel à l'expertise d'autres services.
Il existe des guides techniques comme le « guide méthodologique pour le pilotage des études hydrauliques » écrit par le CETMEF et précisant concrètement ce que doit comporter une étude hydraulique, et notamment, les tests de sensibilité pour vérifier la variabilité des modèles, ainsi que les différents types de modèles. Datant de 2007, il comprend, dans sa préface, des mises en garde sur les incertitudes que comportent les études.
Le guide est destiné aux services de l'Etat afin de vérifier la qualité des études, mais je ne peux pas vous garantir que les bureaux d'études le suivent rigoureusement.

Concernant l'initiative du Vaucluse, nous souhaitons savoir comment il a été possible d'obtenir des propriétaires de l'habitat existant qu'ils réalisent des travaux.
La région a récemment défini son cadre d'intervention en matière de prévention des risques naturels dans lequel il a inclus la réduction de la vulnérabilité. Il souhaite donc rejoindre l'initiative du plan Rhône porté par Mme Helle, vice-présidente du conseil régional.

Cette information mérite d'être diffusée pour faire naître des prises de position politiques et donner des idées à d'autres acteurs.
Les services de DDT sont de taille modeste. Ils ont donc besoin de mutualiser les compétences au sein du réseau des DDT et avec le CETE pour faire face à la diversité des risques. Le travail en réseau et le renforcement des compétences dans le contexte de réductions des effectifs représente donc un véritable défi.

Je souhaite revenir sur l'incertitude du modèle. Quelle crédibilité peut-on donner à ces modèles ?
Je ne dispose pas de chiffrage moyen de l'incertitude des études. Différentes sources d'incertitudes peuvent survenir.
En premier lieu, les études se calent sur des connaissances observées, lors de crues passées. Or, la mesure des débits est affectée d'une marge d'erreur.
En deuxième lieu, l'hydrologie est la transformation de la pluie en débit du cours d'eau. L'hydrologie intègre comme hypothèse les différentes natures de terrain et la topographie. Ces lois sont bien connues dans les plaines, mais plus incertaines pour les fortes pentes et les précipitations rapides. Le SPC Méditerranée-est est assuré par Météo France parce que, dans ce territoire, la pluie se transforme plus vite en débit et il est plus compliqué de prévoir la montée des eaux.
Enfin, l'hydraulique consiste à déterminer la vitesse et la hauteur des cours en fonction de leur débit. Elle s'appuie sur plusieurs éléments dont la topographie qui n'est pas toujours très précise.
Il existe donc une conjonction d'incertitude étant donnée la confrontation des méthodes empiriques et du territoire. Je présume que la marge d'erreur est de l'ordre de 10 % pour les études d'aléa. Néanmoins, les données sont de plus en plus précises.
En termes de modèles, il existe plusieurs façons de déterminer la zone inondable.
Tout d'abord, l'atlas des zones inondables est une méthode naturaliste et empirique consistant en l'observation empirique des cours d'eau et des plaines alluviales. Elle permet d'identifier les zones inondées par le passé, sans obtenir d'information sur la vitesse, ni la hauteur de l'eau. Cette méthode n'est pas suffisante pour élaborer un PPRI.
Ensuite, les modèles à une dimension supposent que l'eau circule dans le même sens le long du cours d'eau et mesurent la vitesse et la hauteur de l'eau en chaque point du cours d'eau. Cette méthode n'est pas suffisante dans les zones à enjeu fort ou avec une configuration géographique complexe.
Aussi, de nos jours, la modélisation à deux dimensions permet d'observer des vitesses transversales, des hauteurs plus précises et intègre mieux la topographie. Cette méthode est à privilégier dans les zones à fort enjeu. Elle ne peut être généralisée étant donné son coût et le temps de calcul qu'elle requiert. De plus, les méthodes sophistiquées nécessitent un réglage minutieux des paramètres et donc plus de vigilance
Sans les connaître précisément, leur fiabilité s'améliore à chaque modélisation. Néanmoins, nous ne sommes pas à l'abri d'évènements imprévus. La difficulté peut prévenir du comportement des cours d'eau en PACA : les lits de la Durance et du Var changent.

La marge d'incertitude est donc limitée. De nos jours, la directive européenne engage l'Etat et les collectivités à travailler ensemble. L'Etat demeurant le maître d'ouvrage, quelle est la place des collectivités locales en réalité ?
Je suis d'avis que l'Etat doit garder la maîtrise d'ouvrage.
Les circulaires émises par les ministères et le décret paru en juin 2011 nous demandent d'associer les collectivités par des réunions lors de prescription du PPRI. Il ne s'agit pas d'une co-construction des PPR pour autant, mais d'une association. Actuellement, cette association est plus prononcée lors de la détermination des enjeux. Je pense que cette association devrait être aussi prégnante pendant la phase de détermination des zones d'aléa. Il ne s'agit pas d'opposer l'expertise de l'Etat à celle des collectivités, mais de prendre aussi en compte ces dernières étant donné que le bureau d'études est en charge de recenser toutes les études du bassin versant et d'en faire la synthèse.

Si la collectivité territoriale n'approuve pas les conclusions du bureau d'études et de l'Etat, de quel recours dispose-t-elle ?
Le PPR ne prévoit pas de recours, ni de contre-expertise. Néanmoins, l'objectif est d'aboutir à un consensus au sujet de l'aléa. Les collectivités territoriales participent elles-mêmes à l'étude puisqu'elles sont représentées au comité de pilotage. Elles peuvent donc porter à la connaissance de l'Etat des études dont les conclusions seraient divergentes.
Cette démarche a été initiée pour l'Huveaune. Je ne dispose pas encore de retour d'expérience étant donné que le PPR n'est même pas prescrit.
Non. À l'inverse, nous disposons d'un contre-exemple pour la Durance. Le SMAVD était associé aux études d'aléa et a décidé de prendre ses distances pour préserver son regard critique sur le PPRI. Ce jeu d'équilibre dépend des acteurs locaux, de l'entente entre services des collectivités territoriales et ceux de l'État. Le syndicat de la Durance ne voulait pas être associé à cette étude vraisemblablement pour se réserver la possibilité de contester la définition des zones. Quoi qu'il en soit, cette association n'a pas fonctionné comme nous le souhaitions. Cependant, cet exemple remonte à quelques années et nous avons sûrement progressé depuis.

Il faut distinguer deux problèmes : la volonté de dialogue et ses résultats. La volonté des collectivités territoriales d'endosser une part de responsabilité du PPRI est réelle. Néanmoins, la critique de l'Etat est assez commode finalement.
La négociation entre l'Etat et les collectivités territoriales se résume finalement dans l'échange de droits à construire contre des risques, ce qui est absurde. Nous nous demandons si un dialogue, voire une co-production, au niveau technique, entre les experts de l'Etat et les collectivités territoriales, est possible pour aboutir à un diagnostic véritablement partagé.
J'ai évoqué des exemples de démarche concertée où des services techniques ont été associés aux études d'aléa. Lorsque la collectivité détient des informations sur un cours d'eau qui n'est pas suivi au niveau national, elle peut les apporter à la construction des études, même si l'Etat demeure le seul maître d'ouvrage.
Néanmoins, la phase d'aléa, qui vise à déterminer le risque par des études hydrauliques et hydrologiques, et ne devrait pas faire l'objet de négociation, dans l'absolu.

En théorie, les aléas ne se discutent pas, vous avez raison. Pourtant ils se marchandent, dans la réalité. C'est justement sur la base de ce constat que nous avons initié notre réflexion pour trouver des solutions pragmatiques, plutôt que de déplorer que les règles ne soient pas appliquées.
La seconde phase du PPR, relative aux enjeux, donne lieu à des discussions sur l'existant, le centre urbain ou encore le développement. Il convient de dissocier cette phase de la première qui porte sur la détermination du risque.

Certes. Le risque est-il nécessairement l'objet d une expertise partagée ?
Peut-on, dès cette première phase, envisager la possibilité de modifications de travaux ?
À notre avis, l'une des raisons de blocage est qu'il n'existe pas de perspectives qui motiveraient les acteurs à appliquer les obligations réglementaires.
Il n'existe pas de base réglementaire fine précisant les aléas dans les PPRI. Néanmoins, la loi du Grenelle II prévoit que des décrets précis définissent les risques dans les PPR. Ce cadre législatif permettra d'éviter les négociations.
Concernant les perspectives, il n'est pas possible d'élaborer des PPR conditionnels qui soumettraient l'application du règlement à la réalisation de certains travaux, par exemple.
Selon la politique actuelle de l'État, le PPR doit traiter de la situation actuelle.
La prise en compte des ouvrages de protection dans les PPR est stricte : les ouvrages et les digues représentent pour l'Etat davantage une source de danger qu'une protection infaillible. Ils doivent protéger l'existant et non permettre de construire davantage.

C'est contraire à l'approche hollandaise : la digue est censée résister pour permettre l'activité, alors qu'en France, la digue n'est pas infaillible, donc le risque, même minime, ne doit pas être pris.
Nous avons progressé sur ce point. En effet, des services unifiés procèdent aux contrôles des ouvrages hydrauliques au niveau régional et la compétence en incombe à la DREAL. Néanmoins, la détention de la maîtrise d'ouvrage pose toujours problème.

Nous ne nions pas ces progrès. Néanmoins, les Pays-Bas, qui sont un pays référence en la matière, a pris des mesures pour garantir la qualité et la résistance de ses digues. Ainsi, il est possible d'autoriser des activités dans les zones protégées.
Je vous accorde que nous pouvons nous inspirer des Pays-Bas. Néanmoins, la configuration de leurs territoires et leurs possibilités de développement sont bien différentes des nôtres.

Le dispositif français est parfait, en théorie. Or, nous devons bien constater qu'il n'est pas correctement appliqué dans la pratique. En dehors de tout jugement moral sur les acteurs, nous souhaitons simplement trouver des solutions pragmatiques pour que la situation change enfin.
Je peux évoquer quelques points de progrès. Tout d'abord, un meilleur cadrage juridique des PPRI est nécessaire pour un traitement équitable des citoyens au regard du risque et pour définir de manière homogène les aléas. La programmation des PPR, fixée par la loi de 1995, est relativement jeune. Une priorisation des risques et donc des PPR en concertation avec les acteurs locaux et en intégrant les impératifs de l'aménagement du territoire me paraît également nécessaire.

Nous convenons qu'une mesure plus exacte du risque est nécessaire. Néanmoins, si les aménagements, les entretiens et les investissements consentis n'ont aucun impact sur les perspectives de développement, le manque d'enthousiasme des élus n'est pas si étonnant.
Les travaux ont pour principal objet de protéger l'existant. Pour les expropriations, l'État demeure le seul payeur. Pour les travaux, l'État les cofinance.

Certes, mais pour les travaux, 60 % du financement restent à trouver, et ce, dans une période de restriction financière. Nous constatons que les arbitrages ne sont plus réalisés correctement alors que l'obligation n'en est pas moins ardente.
Audition de Mme Stéphanie Bidault déléguée générale et de M. Nicolas Bauduceau directeur scientifique et technique du centre européen de prévention des risques d'inondation cepri
Audition de Mme Stéphanie Bidault déléguée générale et de M. Nicolas Bauduceau directeur scientifique et technique du centre européen de prévention des risques d'inondation cepri

Nous poursuivons nos auditions avec Mme Stéphanie Bidault et M. Nicolas Bauduceau, respectivement déléguée générale et directeur scientifique et technique du centre européen de prévention des risques d'inondation (CEPRI).
Le CEPRI n'est pas inconnu aux membres de la mission qui a pu, au cours de ses travaux, puiser de nombreuses informations dans les publications du CEPRI, dont la qualité de l'expertise est généralement louée par les interlocuteurs.
Le CEPRI est pourtant une structure jeune puisqu'il est constitué sous la forme juridique d'une association créée en décembre 2006 à la suite d'une mission locale de préfiguration montée en parallèle du vote de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la répartition des dommages. Il compte ainsi une équipe pluridisciplinaire comme en témoigne votre présence. Mme Stéphanie Bidault, vous êtes en effet docteur en droit public et vous avez été, pendant plusieurs années, chargée d'enseignement ; votre thèse porte justement sur la maîtrise de l'espace et la prévention des risques majeurs. M. Nicolas Bauduceau, vous êtes, pour votre part, ingénieur agronome INA-PG, titulaire d'un DEA d'économie internationale.
Notre mission connaît bien votre organisme puisqu'elle a entendu le 12 juin dernier votre Président, M. Éric Doligé, également membre de cette mission commune d'information. Il a ainsi pu nous exposer les grands axes de la réflexion conduite par le CEPRI.
En complément de cette audition, vous pourrez, dans un instant, nous apporter un éclairage technique sur la question de la résilience du territoire et plus particulièrement sur les techniques de construction des bâtiments qui y concourent.
Nous vous laissons donc la parole pour environ un quart d'heure, viendront ensuite les questions que nous vous adresserons.
M. Éric Doligé a longtemps été le président du CEPRI mais depuis une semaine, il a été remplacé par Mme Marie-France Beaufils, sénatrice et membre de cette mission.
Notre association accorde de l'importance aux mesures de réduction de la vulnérabilité. Elle prône des notions nouvelles en matière de gestion du risque d'inondation qui relèvent de la résilience. Avant que M. Nicolas Bauduceau n'aborde plus particulièrement le thème de l'urbanisme résilient, je vais tâcher de définir ce qu'est la résilience.
La résilience, telle que nous l'entendons, est la capacité d'adapter du bâti au risque d'inondation afin de pouvoir retourner à une activité normale après l'inondation. L'idée est de pouvoir vivre avec le risque d'inondation en préservant l'attractivité des territoires. Notre structure sert d'interface entre l'Etat et les collectivités territoriales que nous essayons de rassembler autour d'objectifs uniques que sont la sécurité des populations et la préservation de la compétitivité des territoires.

Cette approche qui nous intéresse est opposée à la logique de l'Etat, basée exclusivement sur la protection du risque. Or, il s'agit de vivre avec le risque. Cette dernière considération n'est pas intelligible pour l'Etat et les investissements ne sont pas encouragés à l'échelle locale par sa doctrine actuelle.
Quels sont donc vos arguments à l'appui de votre point de vue, notamment concernant la définition de l'aléa ? La façon dont le risque est mesuré et cartographié est-elle discutable sur le plan scientifique, selon vous ?
Par ailleurs, certaines villes vivent avec le risque. Par exemple, j'ai visité Sommières où j'ai constaté que le retour à la normale se limitait souvent à un grand nettoyage après la crue, le recours à la déclaration de catastrophe naturelle n'étant même pas nécessaire. Existe-t-il donc des techniques de construction pour limiter les conséquences des inondations ?
Nous sommes d'avis qu'il convient d'assurer la protection de la population avant tout, mais sans geler complètement l'activité d'une commune. En effet, ceci conduit à bloquer les aménagements. Quels arguments pourriez-vous nous donner pour conforter notre position ?
Avant tout, je souhaite préciser que la gestion du risque inondation est relativement récente dans le droit français et date des années 1980. La France a appliqué une politique basée essentiellement sur la protection via la création d'ouvrages tels que les digues. Depuis quelques années, une politique de prévention émerge. Dans les règlements, beaucoup d'outils ont été développés au gré de la survenance des inondations qu'ils concernent, par exemple, l'information ou encore la maîtrise de l'urbanisation. La politique de gestion du risque inondation n'a pas été construite avec une approche d'ensemble cohérente.
Comme notre précédent président, M. Éric Doligé, l'avait souligné, l'opportunité pour le CEPRI est la transposition de la directive inondation pour la stratégie nationale de gestion du risque inondation. En effet, il nous semble intéressant de fédérer l'ensemble des acteurs autour des objectifs communs de résilience et de prévention pour vivre avec le risque.
Par ailleurs, pour répondre à votre interrogation sur l'aléa, le CEPRI a pris le parti de sensibiliser et d'informer son public par le biais de la notion de « conséquence négative d'une inondation ». Il ne s'agit pas simplement de communiquer sur l'aléa en termes scientifiques, en fournissant des indicateurs de hauteur et de vitesse d'eau, mais au sujet de ce que l'inondation engendre sur le territoire. Cette façon de faire passer le message auprès des collectivités territoriales nous apparaît plus intéressante et plus incitative. Elle aide les élus à agir, notamment lors des concertations des PPRI parce que nous leur expliquons très concrètement ce que peut générer une inondation sur leur territoire. Les élus sont alors plus enclins à informer la population et à organiser les secours. Cette approche est, d'ailleurs, en cohérence avec la directive inondation de 2007 qui invite les Etats membres à communiquer sur la notion de conséquences négative des inondations.
M. Nicolas Bauduceau va détailler nos outils et notre perception de la notion d'urbanisme résilient.
J'essaierai d'être concis même si la construction adaptée au risque inondation est un sujet éminemment technique, économique et social. Après un travail de plusieurs années, nous aboutissons à des conclusions que des experts reconnus en la matière partagent aussi avec nous.
Nous nous sommes posé trois questions majeures :
Est-il techniquement possible de concevoir des logements « zéro dommage » ? ;
De tels ouvrages sont-ils pertinent sur le plan économique ? ;
Enfin, sur le plan social, seront-ils bien acceptés par les populations ?
Sur le plan technique, il n'existait pas, avant nos travaux, de consensus sur la manière d'adapter des logements au risque d'inondation. Nous avions constaté trois manières d'opérer :
La première consiste à éviter l'eau, en construisant au-dessus de l'eau. Cette solution est indéniablement la plus efficace, mais elle n'est possible que pour de l'habitat neuf.
La seconde est d'empêcher l'eau d'entrer à l'intérieur de l'habitation grâce à l'installation de systèmes temporaires d'étanchéité, tels que les batardeaux. Ces systèmes sont très efficaces s'ils sont convenablement posés. Par conséquent, ils supposent de disposer du temps nécessaire pour les installer avant l'arrivée de l'eau et ils ne sont opérationnels que si la hauteur de l'eau est inférieure à 1 mètre.
Enfin, lorsque les autres solutions ne sont pas applicables, la troisième option consiste à céder à l'entrée de l'eau en s'assurant que les matériaux de la maison sont le moins altérables possibles. Par exemple, les systèmes électriques et les chaudières doivent être surélevés pour éviter leur immersion, les fenêtres et les portes sont en bois sont remplacées par du PVC. Néanmoins, cette stratégie ne permet pas de se prémunir contre des dommages importants. Pour vous donner un ordre d'idée des dégâts matériels, les dommages causés à l'immobilier dans une maison inondée par 1,5 mètre d'eau pendant 8 jours s'évaluent de 30 000 à 40 000 euros. Néanmoins, des mesures de réduction de la vulnérabilité peuvent permettre de faire baisser le montant de ces dommages de 15 à 20 %.
Sur le plan économique, la France s'est lancée via les prescriptions sur l'existant du PPR dans une vaste politique de la réduction de la vulnérabilité des logements, sans mesurer la rentabilité de l'adaptation des habitations. Pour mesurer cette rentabilité, il faut considérer la fréquence des crues auxquelles sont exposés les logements. Plus, les crues sont fréquentes, plus le gain est important. La rentabilité n'est donc pas la même partout en France : par exemple, la vallée du Rhône est très protégée, notamment par des digues préservant des crues millénales, tandis que d'autres zones ne sont protégées que des crues décennales, trentennales comme le Val-de-Marne ou centennales pour Paris. Une politique rigoureusement homogène n'a pas de sens du point de vue économique. À l'inverse, la rentabilité économique est néanmoins forte pour les constructions neuves surélevées. Les Pays-Bas ont adopté des mesures de réduction de la vulnérabilité des logements parce qu'ils ont des crues relativement fréquentes. Ces mesures sont réellement rentables en deçà des périodes de retour de 25 ans. Cependant, ce calcul économique est à nuancer parce qu'il n'intègre que les aspects matériels, et non les coûts en vie humaine.
La question sociale, quant à elle, n'est pas neutre parce qu'elle remet en cause le critère de la rentabilité qui s'applique à l'échelle macroscopique d'une société, mais qui s'avère ne pas être aussi pertinent pour le particulier. En effet, ce dernier doit assumer un coût financier pour se prémunir d'un sinistre alors même qu'il n'est pas sûr de le rencontrer, parce qu'il occupe sa maison en moyenne de 7 à 10 ans. De plus, tandis que le sinistre est incertain, le gain est, pour sa part, garanti pour le particulier qui souscrit une assurance, et ce, qu'il ait au préalable réalisé un investissement pour adapter sa maison au risque ou non.
À ces considérations d'ordre financier, viennent s'ajouter des freins purement psychologiques. Pour les illustrer, prenons le cas d'une étude britannique qui a été réalisée sur un échantillon de 1 000 personnes victimes d'inondation, dont des entrepreneurs. Il leur a été demandé pourquoi ils ne mettaient pas en place des mesures de protection de la vulnérabilité ; ils ont répondu de la manière suivante :
- la majorité a évoqué la question des coûts élevés à l'échelle individuelle et a exprimé une attente en termes de mesures de prévention collectives ;
- Néanmoins, 25 % d'entre eux déclarent que de telles mesures, signalant objectivement la zone inondable, pénaliserait la vente de leur maison. Cette réponse témoigne de l'absence pure et simple d'un marché pour l'adaptation du bâti : une maison adaptée n'a pas plus de valeur marchande qu'une maison non protégée, alors même qu'une maison à faible consommation énergétique, par exemple, se vendrait plus cher ;
- En outre, 17 % des répondants ajoutent que de telles mesures leur paraissent anxiogènes, puisqu'elles leur rappelleraient au quotidien qu'ils vivent en zone inondable.
Nous constatons donc que les freins sont nombreux et de nature différente. Néanmoins, ces freins ne signifient pas qu'il faille écarter les mesures d'adaptation des logements existants parce que certaines zones sont soumises à des crues fréquentes et que les dangers pour la population sont bel et bien réels.
En conclusion, il faut retenir que les constructions mal réalisées sont quasi irréversibles et créent des dettes pour l'avenir. L'idéal est donc de construire manière adéquate.

Cette conclusion est un peu désespérante. Dès lors qu'une zone est inondable, à moins de tromper l'acheteur, le bien est donc forcément dévalorisé.
Nous nous demandons s'il est pertinent de défendre une politique sérieuse d'adaptation à la manière de celle concernant le risque sismique ?
Oui, une telle politique est pertinente sans pouvoir être homogène sur tout le territoire. Elle doit être ciblée sur les zones les plus exposées aux crues. Par ailleurs, les mesures d'adaptation coûtent cher sauf lorsqu'elles sont réalisées lors de programmes de renouvellement urbain. Les rénovations sont réellement des occasions à saisir. Par exemple, si vous souhaitez changer votre porte, installer un élément en PVC en lieu et place du bois reviendra même moins cher. La politique d'adaptation des logements doit donc être intelligente en s'insérant dans ces opportunités.

Cependant, il est habituellement entendu que les zones inondables ne doivent pas être densifiées ou reconstruites. Une telle doctrine ne nous condamne-t-elle pas au statu quo ?
Notre propos portait principalement sur l'adaptation des logements existants. Il est difficile de revenir en arrière malgré les prescriptions des PPRI. Celles-ci s'avèrent inefficaces pour plusieurs raisons. Soit l'information ne parvient pas aux habitants, soit la limite de la valeur vénale des travaux par rapport à celle de la maison ne permettrait pas de réduire véritablement la vulnérabilité de l'habitation.
Le CEPRI maintient que les opérations de rénovation urbaines en zone inondable sont une opportunité à considérer sérieusement.
Certes, mais elles existent pourtant bel et bien. Soyons donc réalistes et adaptons ces bâtiments au risque d'inondation à l'occasion de leur rénovation, avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons mené des études qui révèlent qu'il est bien plus aisé de considérer les mesures de réduction de la vulnérabilité aux inondations dès l'origine de la construction plutôt que d'essayer de revenir en arrière.
Par ailleurs, d'autres pays européens testent des techniques de nouvelle construction en zone inondable.

Force est de constater que certains pays européens s'adaptent aux inondations. Est-il pertinent de dire qu'ils savent mieux vivre avec les inondations qu'en France ?
Oui, parce que les stratégies y sont bien plus marquées qu'en France. Les Pays-Bas mettent en oeuvre des moyens de protection de haute volée : les digues sont faites pour résister à des retours de retour de 1 250 ans et ces durées sont prévues dans la loi. Avec le réchauffement climatique, il est même question de les porter à 10 000 ans.
Absolument mais il leur serait plus difficile de mener une politique de prévention et d'adaptation dans le même temps. La population ne comprendrait pas qu'on lui recommande de se préparer au cas où une digue cèderait alors même que les moyens de protection sont exacerbés.
À titre de comparaison, Paris est protégée contre des crues de 100 ans tandis que Rotterdam l'est pour des périodes de retour de 10 000 ans. En termes de compétitivité, cet élément n'est pas neutre et nous n'égalons pas certaines capitales européennes si l'on intègre le critère du risque.
C'est mon avis, à titre personnel. Nous sommes au milieu du gué. Comment expliquer que les villes de Tours ou Orléans soient bien mieux protégées que Paris ? Comment se fait-il que l'amont de la région parisienne, qui accueille pourtant le stockage des déchets, les voies SNCF, ainsi que la production électrique et thermique de la région parisienne, soit une zone inondable d'une période de retour de seulement 30 ans ?
Il nous manque réellement une stratégie à l'échelle nationale. Si nous visons la protection, nous devons alors considérer les problèmes et les coûts colossaux inhérents à l'entretien des digues. Si nous privilégions l'adaptation, nous devons vraiment nous engager dans cette démarche. Or, à l'heure actuelle, les budgets ne sont pas orientés en ce sens.

L'État croit qu'en réglementant, il règlera le problème, d'autant plus que cela ne coûte rien contrairement aux politiques engagées de protection ou d'adaptation. Nous nous contentons d'élaborer des PPRI, puis de réaliser des rapports pour constater qu'ils ne sont pas mis en oeuvre. L'idéal serait, en effet, de créer des ouvrages pour protéger le territoire mais, en réalité, nous ne disposons pas des financements nécessaires et nous ne savons même pas de qui relève réellement cette compétence.
Le travail pédagogique est vraiment important. En France, la politique de gestion des inondations oppose fortement l'Etat et les collectivités territoriales. Cette opposition est exacerbée lors des évènements. Sur le territoire, le maire et le préfet se renvoient la balle.
Néanmoins, le CEPRI constate que les partenariats fonctionnent assez bien : les programmes d'actions de prévention des inondations permettent d'associer différents acteurs partageant le même diagnostic au sujet de la vulnérabilité de leur territoire. Ils peuvent alors construire une politique publique concertée pour atteindre un objectif commun. Ce partenariat fonctionne mieux qu'une logique réglementaire descendante.
Certes, la politique des PPRI est censée parer à de grandes erreurs sur des zones inconstructibles. Néanmoins, il semble qu'elle ne permettra pas véritablement de réduire la vulnérabilité du territoire. Les évènements causés par Xynthia et ceux qui sont survenus dans le Var démontrent que la politique actuelle n'est pas suffisante. Les réponses doivent être apportées, non par le biais d'un seul outil, mais par une politique globale sur le territoire qui combine plusieurs outils. Dans ce contexte, le partenariat entre l'Etat et les collectivités territoriales permettrait d'agir de concert, et donc plus efficacement.
Oui. De notre point de vue, et sur le plan technique, il faut proscrire toute construction des zones de fort courant parce que nous ne savons pas y bâtir.
La hauteur d'eau est une problématique différente. L'aléa est une combinaison de la hauteur et de la vitesse de l'eau. Or, certaines zones rouges ont en réalité un faible courant et une importante hauteur d'eau. Nous pensons que des réponses techniques peuvent y être mises en application.
De même, dans les zones bleues, d'aléa faible, les constructions sont encore autorisées alors que les prescriptions au sujet des habitations neuves ne vont pas assez loin. Ainsi, la construction continue, avec pour seule condition de prévoir un étage pour le refuge, alors même que les dommages potentiels sont considérables et que nous ne savons pas comment évacuer la totalité des habitants de ces zones en cas de sinistre. Il conviendrait de réviser les bases techniques pour déterminer les mesures à mettre en oeuvre.
La directive inondation a défini des territoires à risque qui concernent presque tous des communautés urbaines et d'agglomération. Ces dernières sont des acteurs importants de l'aménagement du territoire qui ont programmé des investissements colossaux dans les zones inondables, mais qui sont peu impliqués dans la gestion du risque. Le plus souvent, ils ne connaissent pas la directive inondation, ni le risque ou les conséquences négatives des inondations.
Pourtant, c'est un fait. Par exemple, les 13 éco-cités sont des programmes issus du grand emprunt, comme vous le savez. 11 d'entre elles se situent en zone inondable. Je crois que 25 000 à 50 000 personnes sont censées rejoindre ces zones en l'espace d'une génération.
La réglementation ne fonctionne pas : aujourd'hui, nous construisons partout en zone inondable.

Le problème des zones inondables est avant tout une question d'aménagement du territoire.

Cela soulève aussi des problèmes d'équité. Les zones d'expansion de crue font partie des techniques efficaces et peu onéreuses pour gérer le risque d'inondation. Néanmoins, cette mesure implique que, pour pouvoir protéger et assurer le développement d'une partie du territoire, certaines zones soient paralysées. De même, les habitations en zone bleue perdent de la valeur. Est-il absurde d'imaginer une contribution publique même si ces expansions sont réalisées sur des terrains privés ?
Enfin, l'entretien des rivières non domaniales, théoriquement à la charge des particuliers, devra incomber aux collectivités territoriales si nous voulons que la situation change.
Comment percevez-vous ces problèmes d'aménagement du territoire ?
Nous ne constatons pas de perte de valeur des maisons situées en zone bleue. Parfois, elles prennent même de la valeur étant donnée que leur proximité avec l'eau représente une aménité attractive. La perte de valeur est constatée uniquement après une inondation, mais elle ne dure pas.
Nous ne pensons pas qu'il faille vider de leur population les zones bleues parce que cela n'aurait pas de sens : les zones bleues concernent souvent des centres urbains équipées des infrastructures de réseaux et des services publics, les coûts de délocalisation seraient faramineux. Il ne s'agit pas de vider ces zones de leurs habitants, mais il ne s'agit pas non plus d'y construire n'importe comment. Des voies intermédiaires sont à explorer, à l'exemple de celles qui sont choisies par Francfort ou Hambourg. Elles prouvent que des quartiers peuvent continuer de vivre en période d'inondation sans être évacués.
En termes d'équité, il est difficile pour les maires, sur le plan politique, d'investir dans la construction dans un quartier à risque d'inondation et, dans le même temps, de ne rien faire pour les populations vivant dans des habitats qui nécessiteraient aussi une réhabilitation. Ce choix politique ne serait pas accepté si les nouveaux quartiers ne servaient pas à diminuer la vulnérabilité des quartiers déjà existants.
Les Pays-Bas l'ont bien compris et projettent la construction de l'hôpital de Rotterdam dans une zone inondable, au-dessus de l'eau, afin d'offrir une zone de repli pour les populations vivant autour du bâtiment. Celui-ci aura aussi la capacité de se convertir en hôpital d'urgence en cas de sinistre. Pendant que la France pense que construire en zone inondable est un problème, les Pays-Bas affirment que c'est justement une solution.

Oui, mais lorsque nous citons l'exemple des Pays-Bas, nos interlocuteurs avancent souvent que ce pays n'a pas d'autres choix étant donnée la configuration de son territoire, contrairement à la France.
Peut-être, mais il n'en demeure pas moins qu'ils réalisent des constructions adaptées dont nous pourrions nous inspirer.
Nous devons changer sans doute notre regard sur la situation : par exemple, nous ne nous interrogeons pas sur la destination de notre budget de gestion du risque prévention. Nous ne cherchons pas à évaluer l'affectation des fonds dépensés pour la protection ou la prévision par exemple. Or, ce cadre budgétaire nous donnerait une idée plus claire de la stratégie réellement mise en oeuvre en France et nous permettrait d'évaluer sa pertinence.
Quoi qu'il en soit, nous observons à l'inverse une augmentation continue des dommages matériels.
Je pense que les assureurs ont des chiffres fiables. La mission des risques naturels doit aussi en disposer.

Néanmoins, les mesures visant à améliorer la résilience des bâtiments ne sont pas une panacée. Nous ne savons pas si elles sont réellement pertinentes, sauf peut-être au moment de la construction, mais il faudrait tout de même déterminer le surcoût.
La résilience est vraiment pertinente pour la construction neuve. Dans certaines situations, il est même possible de construire sans surcoûts des bâtiments résilients comme ce fut le cas à Rennes. En revanche, la pertinence de l'adaptation du bâti existant doit être évaluée au cas par cas, en priorisant les zones où les crues sont les plus fréquentes et où la dangerosité est la plus élevée.
Lorsque nous construisons des quartiers neufs et résilients, des difficultés émergent parce que nous ne savons pas encore rendre les réseaux d'énergie, d'eau et d'assainissements résilients. Nous devons investir dans cette réflexion pour développer une réelle expertise en France. Si nous avions autant investi sur la construction résiliente que nous l'avons fait pour la protection depuis vingt ans, je pense que nous saurions d'ores et déjà construire des quartiers résilients.
- Présidence de M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur -

Nous recevons aujourd'hui le Général Pierre Chavancy, qui dirige la division emploi de l'État-major des armées.
Depuis 2008, le Livre Blanc consacre l'idée d'un continuum entre la défense et la sécurité nationales. Il aborde à ce propos les questions de résilience, dont il fait un objectif fondamental de la stratégie de sécurité nationale mise en oeuvre par l'État et les collectivités publiques dans le cadre de la protection. La contribution des armées s'articule en la matière au dispositif de la sécurité civile. Il nous paraît important de savoir de quelle façon, selon quelles procédures et avec quels moyens.
En examinant le déroulement des opérations de secours dans le Var en juin 2010, nous avons constaté que cette contribution avait été décisive, notamment dans l'utilisation des moyens aériens. Nous avons aussi compris que, dans l'urgence, les procédures avaient été raccourcies, ce qui est heureux. Des conclusions ont-elles été tirées de ce retour d'expérience ?
Plus globalement, nous observons une réduction du format de nos armées, une plus grande spécialisation de leur mission et une projection plus importante de nos forces sur des théâtres d'opérations extérieures. La mission souhaiterait connaître la façon dont ces missions sont conciliées et savoir s'il y a, dans le cas qui nous intéresse, une réserve de forces préalablement positionnée et susceptible d'intervenir au profit de la sécurité civile.
Général Pierre Chavancy - Je vous remercie Monsieur le Sénateur. Je suis en charge, à l'Etat-major des Armées, de l'emploi des forces. Le Colonel Olivier Salaun est mon adjoint pour le territoire national. Il pourra donc répondre à des questions précises, notamment celles qui sont relatives aux événements du Var.
Dans un premier temps, je souhaite vous décrire le contexte global de l'engagement des armées. Ce sujet est très important à plusieurs titres et, en premier lieu, parce que notre Patrie est la terre de nos pères. De plus, nous disposons actuellement, sur le territoire national, d'autant d'hommes que ceux qui sont affectés aux opérations extérieures et, bientôt, la France sera la première zone d'engagement des forces militaires.
Je vais vous communiquer quelques données générales et vous entretenir des spécificités des engagements terrestres. J'aborderai le cas des catastrophes naturelles, qui vous intéresse plus particulièrement. Puis, je vous ferai part des conclusions du rapport d'avril 2012 de l'Inspection Générale de l'Administration (IGA) qui traite des catastrophes naturelles.
Je souhaite au préalable rappeler que le territoire national est constitué de la métropole, des DOM/COM mais également des espaces aériens et maritimes, ainsi que du cyberespace.
Êtes-vous responsable de tous ces espaces ?
Général Pierre Chavancy - En partie : l'Etat-major des armées s'occupe des questions militaires dans ces espaces.
Nous y menons des missions permanentes, qui nous sont attribuées par la loi, ainsi que des missions occasionnelles planifiées. Nous devons également faire face à des missions occasionnelles totalement inopinées comme c'est le cas lors de catastrophes naturelles.
Une typologie des crises est établie par le Secrétariat générale de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), qui en distingue trois sortes :
· Les crises locales ou régionales, encore appelées crises « au fil de l'eau ». Elles relèvent des Préfets et elles sont déjà identifiées. Ces crises sont relativement récurrentes et faciles à gérer.
· Les crises majeures ou « majeures renforcées » appellent la mise en oeuvre du contrat de protection du territoire prévu par le Livre Blanc, soit le déploiement de forces terrestres pouvant atteindre jusqu'à 10 000 hommes en quelques jours. Ces crises nécessitent une gestion centralisée par la cellule interministérielle de crise.
· Les crises « hors cadre » font appel à tous les moyens disponibles, y compris les réservistes, étant donnée la concomitance d'événements d'importance majeure comme lors des catastrophes naturelles et environnementales.
Tous les dispositifs associés à ces crises font l'objet de documents provenant des services du Premier ministre.
Au sujet du cadre général de l'engagement des armées, le Chef d'Etat-Major des Armées (CEMA) assume les responsabilités de conseiller du gouvernement et de commandant des opérations des troupes. Au-delà des crises, il assume donc le commandement opérationnel sur le terrain. Néanmoins, dans la quasi-totalité des cas, nous ne sommes pas primo intervenants.
En matière de contribution aux missions de sécurité intérieure, l'armée de l'air assure la sûreté de l'espace aérien. Une unité de commandement est affectée à la surveillance permanente des radars et des unités opérationnelles sont en disponibilité sous sept minutes. Huit avions, situés aux quatre coins du territoire, sont prêts à intervenir à tout moment sur ordre. L'Etat-major est en lien direct avec son donneur d'ordre, le Premier ministre.
La sauvegarde maritime revêt un caractère particulièrement interministériel étant donné que le représentant de l'Etat en mer, le Préfet maritime, coordonne les moyens relevant des Ministères de la Défense, des Finances et de l'Intérieur. À ce titre, il a autorité sur les autorités opérationnelles de la Marine nationale et il reporte au Premier ministre. La chaîne des armées n'est donc pas décisionnelle.
Quant aux engagements terrestres, les deux missions principales sont :
· la participation à la lutte contre le terrorisme, à l'exclusion des actes de délinquance. Néanmoins la frontière entre ces deux prérogatives n'est pas toujours claire comme en témoignent les actualités en Guyane ;
· l'intervention lors des catastrophes naturelles.
Une structure étatique, l'Etat-major interministériel de zone (EMIZ), est en place aux niveaux départemental, zonal et national. Néanmoins, d'autres administrations sont également parties prenantes telles que la Santé, le Transport, l'Agriculture ou l'Environnement. Une organisation militaire parallèle à l'EMIZ existe à tous les niveaux : le Centre de Planification et de Conduite d'Opérations (CPCO) regroupe toutes les opérations sur le territoire national ou à l'extérieur, tandis que les structures zonales, les EMIAZDS, et le Centre Opérationnel des Délégués Militaires Départementaux sont des structures totalement dédiées.
Je souhaite rappeler quelques principes généraux :
· Les pompiers, policiers et gendarmes sont primo intervenants, à la différence de l'armée.
· La décision d'engagement est centralisée. Le rapport de l'IGA a souligné que, paradoxalement, cette centralisation est justement un gage d'efficacité.
· Le dialogue entre les corps civils et militaires se base sur l'expression du besoin, la traduction en termes de moyens engagés revenant toujours au CEMA. Il est plus efficace pour un Préfet d'exprimer une demande en termes d'effet à obtenir, le militaire traduisant en termes d'hommes ou de matériels.
Ne serait-il pas plus efficace que les personnes sur le terrain justement définissent les moyens à mettre en oeuvre puisqu'ils connaissent les lieux ?
Général Pierre Chavancy - Bien entendu, la réalité du besoin est mieux appréhendée au niveau local. Néanmoins, le CEMA a, pour sa part, une connaissance approfondie des moyens militaires et de leurs capacités.
Il devrait exister davantage de ressources prédéfinies par scenario, par type de besoins et prêtes à être employées, selon la survenance des événements. Néanmoins, une chaîne militaire permanente couvre les 96 départements français, surtout dans ce que nous appelons les « déserts militaires ».
L'une des raisons pour lesquelles la centralisation s'avère plus efficace est que nos moyens sont de plus en plus échantillonaires et très inégalement répartis. À titre d'illustration, les matériels les plus souvent engagés lors de catastrophes naturelles sont les moyens du génie, ce qui touche à l'environnement, ainsi que des hélicoptères. Or, l'affectation de ces matériels exige une vision globale des ressources, de leur localisation et de leur disponibilité. Par exemple, si une menace nucléaire survenait dans le Sud Est de la France, il est peu probable que les acteurs locaux aient connaissance de la seule unité de lutte contre les armes nucléaires NRBC. En outre, cette unité, composée de militaires, pourrait être en opération à ce moment-là. Enfin, les moyens les plus proches ne sont pas forcément ceux qui peuvent être déployés le plus rapidement. Les plans d'affectation sont donc suivis par les armées, qui ont une vision quotidienne du positionnement des moyens. Cette surveillance est centralisée dans une cellule située à Lille pour l'Armée de terre.
Combien de temps est nécessaire pour mobiliser les moyens ?
Général Pierre Chavancy - L'échelle de prise de décision d'engagement est de l'ordre de la minute dans le cas d'une intervention urgente. L'arrivée des moyens peut prendre quelques heures, ou moins, s'ils sont acheminés par avion plutôt que par la route. Tout dépend du degré d'urgence.
Il est donc très important d'indiquer précisément le problème.
Général Pierre Chavancy - Exactement. Il peut s'agir d'une route nationale bloquée par des troncs d'arbres pour laquelle le délégué militaire départemental choisit de recourir aux moyens du génie ou à l'infanterie. La réponse à un même problème peut-être multiple selon le degré d'urgence, la disponibilité des moyens et la configuration des lieux. La compétence du militaire dans ce domaine doit vraiment être reconnue et respectée.
Néanmoins, nous devons progresser en termes de pédagogie pour faire comprendre à tous les niveaux que les armées n'ont plus les moyens dont elles disposaient il y a encore une dizaine années. La position des Préfets est également difficile puisqu'ils doivent rendre des comptes à tout moment.
On appelle « zones de déserts militaires » les départements qui ne comprennent aucune unité militaire, mais où sont précisément basés les délégués militaires départementaux les plus aguerris pour compenser l'absence d'unités.
Nous utilisons un réservoir unique de forces. En effet, le contrat opérationnel du Livre Blanc, qui prévoit le déploiement de forces terrestres pouvant atteindre 10 000 hommes, est honoré en puisant dans des effectifs disponibles. Ces effectifs varient tous les jours. Au centre de Lille, une personne est exclusivement et quotidiennement dédiée à la recherche de ces 10 000 hommes, en cas de besoin, étant donné que nous n'avons pas les moyens de dédier des unités aux crises en permanence.
Ce réservoir unique de forces intervient dans les missions intérieures ou à l'extérieur. À raison de 2 200 hommes par jour, à compter du 1er janvier 2013, la première zone d'engagement des armées françaises sera le territoire national avec le retrait des soldats français engagés en Afghanistan.
Quelles seront leurs missions ?
Général Pierre Chavancy - Il s'agit essentiellement du plan Vigipirate, de l'opération Harpie de lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane et d'autres missions plus ponctuelles telles que les Jeux olympiques.
Concernant le cas particulier des catastrophes naturelles, je vais prendre l'exemple de l'inondation de Draguignan en juin 2010 pour illustrer l'importance pour les acteurs locaux d'exprimer un problème plutôt que de demander des solutions. Le Préfet a finalement obtenu trois fois plus d'hélicoptères qu'il ne l'avait initialement demandé. Je souligne que la volonté des militaires n'est pas de minorer les moyens affectés, mais bel et bien de répondre au mieux au problème.
Dans ce cas de figure, il était tout de même difficile d'évaluer la situation. J'ai l'impression que le Préfet ne prenait pas la mesure des évènements, les toutes premières heures. C'est la raison pour laquelle il a d'ailleurs fait appel à l'Armée.
Votre appréciation est juste. Il y a eu une rupture de communication entre Toulon et Draguignan. Néanmoins, le matin du jour des fortes pluies, l'Officier Général de Zones de Défense et de Sécurité (OGZDS) avait, d'ores et déjà, placé en alerte toutes les unités militaires de la zone, étant donnée la situation météorologique.
Oui dès le matin, même si l'alerte météorologique était toujours orange, le Général Pichot de Champfleury pressentait néanmoins que la situation pouvait dégénérer. Il a rapidement passé en revue les unités et identifié des hélicoptères disponibles sur les bases aériennes du Luc et d'Hyères. Ainsi, dès que la demande d'engagement est arrivée, les machines étaient déjà prêtes. Celles qui pouvaient voler de nuit sont alors intervenues.

Ces éléments ne figurent pas dans les rapports.
Général Pierre Chavancy - Monsieur le Sénateur, je crains que vous n'ayez raison. Certaines contrevérités ont néanmoins été dissipées par le rapport IGA/CGA qui met en évidence nos bons résultats.
L'administration pénitentiaire a aussi pris la décision de commencer à évacuer sans attendre l'ordre, étant donné les conséquences désastreuses qui auraient pu se produire.
Il convient de louer de telles initiatives dans un contexte où personne ne savait ce qui se passait réellement et où les moyens de communication avaient été coupés. C'est donc l'alerte orange qui a donné l'impulsion.
L'alerte n'est jamais passée au rouge. Les OGZDS recensent les forces vives dès qu'une alerte est émise ou qu'une suspicion de danger apparaît, pour être prêt à répondre aux demandes éventuelles du corps civil.
Général Pierre Chavancy - À ce titre, plusieurs facteurs clés de succès sont à retenir :
· Le dispositif d'alertes hydrologique et météorologique permet une anticipation et une mobilisation précoces des unités militaires présentes ou disponibles. L'officier militaire local peut joindre Paris pour prévenir de l'imminence de l'événement.
· Par ailleurs, les militaires ne sont pas primo intervenants, certes, mais dans une logique d'urgence où des vies humaines sont en danger, l'armée intervient au plus vite.
· Des plans de zones à risque permettent une logique de planification, typique de l'administration militaire. Cela n'est pas partagé par beaucoup d'autres administrations à l'exception de la sécurité civile.
· L'IGA met en exergue dans son rapport une difficulté lié à la réforme administrative de l'Etat, avec un préfet de département responsable alors que la plupart des expertises de risques sont détenues au niveau régional.
· La coordination 3D qui reste perfectible. À ce titre, nous participons à un groupe de travail au SGDSN pour améliorer la coordination interministérielle.

Les catastrophes sont certes multidimensionnelles, mais à inviter tous les acteurs autour de la table ne risque-t-on pas de devenir contre-productif ? Peut-être conviendrait-il de prévoir des formations plus resserrées pour améliorer la réactivité ?
Général Pierre Chavancy - Je crois que plus nous nous préparons, plus nous sommes efficaces le jour J. Si nous avons des fiches réflexes préparées, nous sommes mieux armés. La vitesse d'intervention est certes nécessaire, mais la précipitation peut être catastrophique. Par exemple, avant d'envoyer un hélicoptère, il faut s'assurer au préalable qu'aucun autre n'a déjà été diligenté pour éviter ce que les secouristes appellent le « sur-accident ». Cela nécessite de l'organisation et d'une certaine distance.
Le rapport de l'IGA a mis en exergue la réactivité des armées, notamment les points forts suivants :
· le suivi permanent des capacités disponibles, conformément au Livre Blanc ;
· la décision centralisée permettant plus de réactivité et une meilleure appréhension des moyens disponibles ce qui n'empêche pas une conduite décentralisée ;
· la demande d'un effet à obtenir plutôt qu'une commande des moyens ;
· l'importance de la concertation sur l'effet final recherché ;
· la répartition des rôles entre les différents acteurs. Au niveau des états-majors interministériels de zone, il y a souvent de grands absents : au-delà des spécialistes de la sécurité, les transports, l'environnement, ou la santé sont également des sujets à prendre en compte. Au-delà des Armées, la coordination interministérielle doit encore progresser.
Des voies d'amélioration, que nous avions déjà identifiées, nous ont été également suggérées :
· une pédagogie accrue envers les décideurs civils qu'il faut sensibiliser à la décroissance des moyens militaires et à l'évolution de leur maillage territorial ;
· le renforcement quantitatif et qualitatif nécessaire de la chaine OTIAD (Organisation Territoriale Interarmées de Défense), surtout dans les déserts militaires, de façon à ce que le Préfet dispose d'un interlocuteur compétent ;
· l'élargissement des délégations des OGZDS, jusqu'alors réduites à l'engagement immédiat des forces à la mise à disposition d'infrastructures militaires pour accueillir des sinistrés par exemple ;
· la meilleure implication des réservistes, qui sont des militaires professionnels à temps partiel qui connaissent souvent parfaitement le tissu local et représentent des forces vives et des relais intéressants pour l'Armée.
L'implication des populations, notamment des bénévoles nous intéresse particulièrement. Dans le département du Var, les Comités communaux des feux de forêt (CCFF) sont intervenus massivement et efficacement en 2010 et 2011.
En effet, la diffusion de la culture du risque n'est pas aisée étant donné que les informations officielles ne sont pas toujours crues par les populations ou, à l'inverse, peuvent déclencher des phénomènes de panique.
Peut-être qu'une chaîne de médiateurs avec la population, participant aux opérations régulières en cas de crise, pourrait être un élément de réponse, comme en témoigne l'exemple italien ? L'association des réservistes à une telle mission vous semble-t-elle intéressante ?
Général Pierre Chavancy - Cela ne peut être qu'une bonne idée. Les réservistes ont la culture du risque, et ils ont parfois un passé de militaire. Cette démarche est au coeur de notre réflexion. Néanmoins, nous devons savoir qui supportera le coût du maintien de réservistes sur le terrain.
Il pourrait s'agir de militaires réservistes résidant dans la commune et volontaires. Cette réserve de compétences n'est pas négligeable.
Général Pierre Chavancy - Tout à fait. Le Colonel Olivier Salaun peut développer le thème de la participation des armées et des populations à la résilience, sujet sensible et actuel.
Il existe déjà des initiatives similaires. Des réservistes oeuvrent parfois auprès de communes pour les aider à réaliser les Plans Communaux de Sauvegarde (PCS), notamment en Gironde. De même, des lieutenants d'active basés localement sont intervenus auprès de communes de la région de Draguignan pour aider les maires à exprimer leurs besoins et à obtenir des ravitaillements. Bien entendu, de telles initiatives ne restent possibles que si ces réservistes ne sont pas eux-mêmes déjà sinistrés.
Quoi qu'il en soit, ces actions engendrent un coût : une journée pour un commandant ou un lieutenant-colonel réserviste coûte environ 150 euros. Or, le budget de la réserve reste modeste au sein de la Défense.
Général Pierre Chavancy - Par ailleurs, certains réservistes travaillent, ce qui nécessite que leurs employeurs les dégagent de leurs responsabilités professionnelles.

Nous pourrions imaginer un système d'indemnisation pour compenser la perte de salaire, à l'exemple d'autres pays, ou envisager ses initiatives sous l'angle du bénévolat accompagné d'un défraiement, sans qu'il ne revête un caractère obligatoire. Il est dommage de se priver de ces compétences.
Général Pierre Chavancy - Vous avez raison.
Le rapport de l'Inspection Générale identifie également d'autres points d'amélioration :
· Sans accroître à outrance le nombre de protagonistes impliqués, il convient d'engager des discussions avec des acteurs pertinents selon les évènements survenus. Ainsi, il est, par exemple, pertinent de dialoguer avec EDF lorsque les lignes de communication sont coupées.
· La réforme administrative créée des ruptures problématiques comme lorsque les départements endossent la responsabilité du risque alors que les régions en détiennent souvent l'expertise.
· La coordination interministérielle est à développer, étant donnée la faible participation de certains ministères à des EMIZ, par ailleurs sous-dimensionnés.
· La professionnalisation des acteurs de la gestion de crise est perfectible.
· Une culture de la planification est aussi à approfondir.
Je vous remercie pour toutes ces précisions et pour votre franc-parler. Nous essayons, au travers des retours d'expérience recueillis, d'envisager l'amélioration des dispositifs existants.
À votre avis, la coordination avec les corps civils est-elle satisfaisante ? Comment se déroule t elle ? Le Préfet vous demande-t-il directement d'intervenir ?
Général Pierre Chavancy - Le préfet exprime ses besoins. La réponse en termes de moyens affectés est définie par le Centre de Planification et de Conduite des Opérations depuis Paris. La gestion de l'intervention est complètement décentralisée, surtout s'il s'agit de faire face à une crise inopinée. La réaction face à l'imprévu nécessite une réponse rapide et adaptée.
Le Préfet exprime un besoin et vous mettez des moyens à sa disposition. Qui répartit les moyens et affecte les missions, par exemple aux hélicoptères pour secourir des personnes en danger ?
Ceci relève clairement de la coordination 3D. Cette coordination comprend deux volets : d'une part, la sécurité des vols afin d'éviter tout accident, et d'autre part, la désignation et la répartition des missions.
Lorsque l'événement survient dans un seul département, l'organisation est assez simple. Le Préfet est le directeur des opérations de secours. Le Chef du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) est généralement le commandant des opérations de secours. La cellule de coordination 3D vient naturellement supporter ce commandement, qui répartit les moyens en fonction des informations.
Mais la zone sinistrée peut toucher plusieurs départements, voire plusieurs zones de défense comme ce fut le cas pour Xynthia, à cheval sur la zone ouest et sud-ouest. Dans ce cas, il convient de définir une cellule unique de coordination 3D. Or, la désignation de celui qui devra endosser la responsabilité d'un tel commandement, et donc d'éventuelles conséquences juridiques, pose problème, comme l'a mis en exergue le groupe de travail du SGDSN.
En tant que militaires, nous pensons que si les sinistres s'étendent sur plusieurs départements et restent contraints dans la même zone de défense, le Préfet de zones de défense et de sécurité devrait être responsable, même si nous savons qu'il n'est pas le supérieur hiérarchique des Préfets de département.
Lorsque le sinistre touche plusieurs zones de défense, un des Préfets de zones de défense et de sécurité pourrait alors être désigné, à moins que le pouvoir central soit décisionnaire.
Le groupe de travail interministériel n'est pas parvenu à un consensus sur ce point.
Général Pierre Chavancy - Je n'ai pas développé les aspects relatifs à la responsabilité juridique, mais ils constituent évidemment un sujet très important.
- Présidence de M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur -
Audition de M. Jean-Luc Salagnac chef du projet impact du changement climatique sur le cadre bâti ic3b au centre scientifique et technique du bâtiment cstb
Audition de M. Jean-Luc Salagnac chef du projet impact du changement climatique sur le cadre bâti ic3b au centre scientifique et technique du bâtiment cstb

Notre cycle d'auditions s'achève avec M. Jean-Luc Salagnac, Chef du projet Impact du Changement Climatique sur le Cadre Bâti (IC3B) au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment.
Le CSTB est un établissement public créé en 1947 pour être le fer de lance de la reconstruction d'après-guerre, mais il s'est adapté constamment aux innovations du bâtiment.
À l'heure du développement durable, le CSTB s'est penché sur la question de la résistance des bâtiments aux inondations et au moyen d'alléger les dommages que les crues peuvent causer aux infrastructures. Dans sa feuille de route pour la recherche à l'horizon de 2020, le CSTB a ainsi intégré à ses réflexions le sujet de la maîtrise du risque. Le CSTB participe à un groupe de travail avec le CEPRI et a ainsi élaboré un référentiel.
Je vous propose donc d'exposer le résultat de vos recherches, au besoin en étayant vos propos d'exemples.
L'une des questions que nous nous posons est « peut-on construire en zone inondable ? ». La règle est de ne pas le faire. Néanmoins, nous nous apercevons que des constructions existent en zone inondable et que, souvent, les habitants de ces zones ne souhaitent pas déménager. Un des éléments de réponse réside peut-être dans la qualité du bâtiment, de la même manière qu'il est désormais possible de construire des immeubles résistants aux secousses telluriques.
Les réponses que nous avons reçues jusqu'à maintenant sont extrêmement mitigées et nous nous demandons si les coûts inhérents aux travaux en zone inondable sont justifiés alors que la résistance et la qualité des constructions restent aléatoires.
Nous souhaiterions aborder ces questions avec vous. Plus particulièrement, que pouvez-vous nous dire de l'efficacité des méthodes de construction dont nous disposons ? Existe-t-il des voies d'amélioration que nous pouvons généraliser ? Devrions-nous imposer des restrictions ?
J'ai préparé une présentation. Au préalable, je souhaite commencer par une chronologie rapide des travaux du CSTB :
- Le guide de la remise en état des bâtiments après inondations, en 1995, constatant un certain vide de la littérature concernant cette problématique,
- Le guide d'évaluation de la vulnérabilité des bâtiments vis-à-vis du risque d'évaluation en 2003,
- Un protocole d'évaluation des performances des batardeaux en 2004,
- Le rapport « bâtiments amphibies et autres solutions pour construire en zone inondable » en 2005,
- La publication scientifique « Vulnérabilité des bâtiments à l'inondation : la qualification du comportement des matériaux » en 2006,
- Un bilan des outils de prévention réalisé en 2008,
- L'élaboration d'un référentiel de travaux de prévention du risque d'inondation dans l'habitat existant (DGALN) en 2011, dont le guide est à paraître dans le courant du mois de juillet 2012,
- La participation au projet SMARTeST dans le cadre européen du FP7, de 2009 à 2012.
Comme vous avez pu vous en rendre compte, nos travaux ont été financés pour l'essentiel par le Ministère du logement et, dans une moindre mesure, par le Ministère de l'environnement et la DPPR. Nous sommes actuellement en train de terminer le projet européen.
Je propose d'articuler mon propos autour de certaines questions:
- Un bâtiment peut-il être « étanche » ?
- Comment les règles de construction prennent-elle en compte l'inondation ?
- Que sont les matériaux peu sensibles à l'eau ?
- Comment assurer la sécurité des personnes ?
- Comment limiter les dommages aux bâtiments neufs et existants ?
- Où en est la qualification des dispositifs de protection ?
- Quelles sont les difficultés de mise en oeuvre des solutions existantes ?
Un bâtiment peut-il être « étanche » ?
Je répondrais qu'il est techniquement possible de concevoir un bâtiment étanche à condition que le maître d'ouvrage le décide et se donne les moyens de le faire. Il est possible d'ancrer un bâtiment, de poser des portes étanches et d'étanchéifier des parois, par exemple.
Ces bâtiments s'opposent au passage de l'eau et de la vapeur d'eau. Il est essentiel que la vapeur d'eau produite à l'intérieur puisse être évacuée d'un tel bâtiment. Dans un bâtiment ordinaire, cette évacuation se fait pour partie à travers les parois et pour partie via la ventilation. Un bâtiment étanche devrait permettre l'évacuation de la vapeur d'eau d'une manière alternative pour que l'atmosphère intérieure soit viable.
Les bâtiments ordinaires, le plus souvent en France, construits en maçonnerie de bloc de bétons ou de terre cuite ne sont pas étanches parce qu'il existe par construction de nombreuses voies d'eau possibles (murs, passage de canalisations, sols). Il serait quasiment impossible d'obstruer toutes ces ouvertures.
Par ailleurs, la poussée de l'eau n'est pas un facteur dimensionnant pour les murs d'un bâtiment ordinaire. La poussée du vent, surtout lorsqu'il s'agit d'immeubles hauts, ou des actions mécaniques telles que le poids de la neige ou les séismes sont des facteurs dimensionnant. Les règles de construction concernent très peu l'inondation. Par conséquent, les dimensionnements des bâtiments ordinaires n'intègrent pas la poussée de l'eau sur les murs pour définir leur résistance. Or, l'expérience montre qu'un mur ordinaire de 2,5 mètres de haut est fragilisé dès que la différence de hauteur de l'eau de part et d'autre de ses faces atteint un mètre. On peut observer des ruptures au cinquième ou au sixième rang de maçonneries pour un mur soumis à une telle sollicitation.
En outre, un autre phénomène courant, celui des chocs lors des inondations, n'est pas pris en compte dans les calculs de dimensionnement d'ouvrage. Le choc peut provenir des objets charriés par les flots ou de l'arrivée d'une vague d'eau. Les vitres peuvent alors se briser et des structures être endommagées.
Néanmoins, même si nous pouvions construire un bâtiment maçonné étanche, les joints de maçonnerie seraient soumis à une forte traction du fait de poussée d'Archimède et n'y résisteraient pas. Des voies d'eau s'ouvriraient alors.
Finalement, il n'est pas possible d'empêcher durablement l'eau de rentrer dans un bâtiment ordinaire. Ce serait du gaspillage d'essayer de le faire.
Cependant, il est tout de même possible de limiter les dégâts dus à l'inondation sur un bâtiment ordinaire, grâce à des moyens comme les batardeaux, à condition que la hauteur et la vitesse de l'eau restent modérées et que l'inondation ne dure pas plus de quelques jours.
Comment les règles de construction prennent-elle en compte l'inondation ?
Les règles de construction intègrent essentiellement la poussée d'Archimède. Ces règles résultent de considérations mécaniques comme c'est également le cas pour la prise en compte des aléas sismiques ou des effets du vent. Pour l'inondation, des dispositions diverses ont été prises, notamment au sujet des cuvelages enterrés. Elles sont décrites dans le DTU 14.1.
Une de ces dispositions consiste à construire un conduit au sous-sol qui permet de remplir le volume du cuvelage afin de lester le bâtiment dès qu'une cote de conception est atteinte en cas d'inondation.
Un autre dispositif réglementaire, l'arrêté du 30 juillet 1979, concerne les cuves d'hydrocarbures. Celles-ci peuvent se décrocher de leur support et se mettre à flotter en cas d'inondation. Les dispositions prévues sont destinées à dimensionner les berceaux de support des cuves pour éviter qu'elles ne se décrochent.
Que sont les matériaux peu sensibles à l'eau ?
Les termes « matériaux peu sensibles à l'eau » sont souvent utilisés dans les PPR. Or, ces matériaux sont ne sont pas codifiés, ce qui rend leur compréhension difficile pour les administrés.
Oui, ils existent dans l'absolu, mais les termes ne sont pas précis. Une vitre dans un aquarium par exemple est peu sensible à l'eau. À l'inverse, une plaque de plâtre disparaît dans l'eau. À Venise, des matériaux minéraux bien choisis ont vocation à braver le temps. Ils ont été initialement utilisés pour construire la base de la ville, en contact avec l'eau, tandis que les bâtiments sont en maçonnerie. Or, de nos jours, l'effet conjugué de l'enfoncement et de la montée de l'eau mettent en péril les maçonneries.
Depuis que les hommes bâtissent, ils savent que l'eau est l'ennemi principal du bâtiment, qu'il s'agisse d'infiltration, de condensation, de capillarité. Une bonne construction doit permettre d'éviter un contact prolongé des matériaux avec l'eau liquide. Les règles de construction ont dont été énoncées afin d'éviter ce contact, qu'il s'opère par remontées capillaires, condensation ou infiltration. Par exemple, les enduits sur les murs extérieurs ne devraient pas atteindre le sol pour éviter que l'eau ne monte par capillarité, la vapeur d'eau devrait être bien évacuée afin d'éviter les condensations d'eau à l'intérieur, et les couvertures de toiture devraient être étanches pour prévenir les infiltrations. Les défauts sont souvent le fruit de la conjonction d'une mauvaise conception, d'une mauvaise réalisation et d'un entretien insuffisant
Néanmoins, certaines situations imposent une exposition importante à l'eau, telles que les douches collectives, les fromageries ou tout bâtiment abritant un process de production ou les parois sont destinées à être en contact très fréquent avec l'eau liquide . Des tests permettent de caractériser les matériaux aptes à être utilisés dans ces circonstances. Mais, ces tests sont limités dans le temps, de quelques heures à quelques jours et sont effectués avec de l'eau propre, ce qui ne correspond pas à la réalité des inondations.
L'analyse des conséquences, notamment sanitaires, de l'intrusion de matériaux minéraux et organiques dans l'habitat est un champ inexploré. J'ai réalisé des photographies et des prélèvements de champignons dans des zones inondées qui ne semblent pas inoffensifs. Or, aucune étude n'est encore systématiquement réalisée.
De manière générale, les résultats des tests ne sont pas directement exploitables pour qualifier des matériaux résistant à l'inondation et la notion de matériau peu sensible à l'eau n'est pas codifiée. Finalement, seuls les aspects mécaniques cités et les destinations qui exposent le bâti à l'eau sont pris en compte.
Comment assurer la sécurité des personnes ?
La règle est de disposer d'une zone de repli en attente des secours, qu'elle soit à l'intérieur du bâtiment ou éloignée, en dehors de la zone d'inondation du bâtiment. Je vous renvoie au guide à paraître sous le timbre de la DGALN sur les travaux de prévention du risque d'inondation dans l'habitat existant pour l'illustration des zones refuges.
Dans le cas d'un refuge à l'intérieur du bâtiment, il faut en outre pouvoir disposer soit d'une fenêtre de toiture ou d'un balcon afin de faciliter l'évacuation par hélicoptère ou par bateau. Dans ce dernier cas, un anneau d'ancrage peut être utile pour amarrer l'embarcation.
Le guide préconise également un accès par l'intérieur, dégagé et idéalement matérialisé par le biais d'un éclairage de secours, accessible aux personnes handicapées même sans courant électrique. Les équipements doivent être vérifiés pour s'assurer de leur fonctionnement le moment venu. L'objectif primordial est que les personnes en détresse puissent être repérées et secourues.
Dans l'Aude, l'une des conditions d'attribution d'une aide à la remise en état suite à l'inondation de 1999 était de prévoir une zone de refuge dans les bâtiments sinistrés.
S'il est situé en dehors du bâtiment, le choix du refuge doit permettre d'avoir le temps de fuir et de se mettre à l'abri en cas d'inondation. Il dépend donc de la topographie des lieux.
Comment limiter les dommages aux bâtiments neufs
La limitation des dommages aux bâtiments neufs commence par le zonage urbain, c'est-à-dire le respect des prescriptions établies dans ces zones.
Dans les zones où la construction reste autorisée, le PPR impose le respect de certaines règles. Différentes stratégies sont alors possibles :
- L'évitement consiste à surélever les maisons afin que le plancher bas soit hors d'atteinte. Ainsi, les maisons du quartier du Gruissan près de Narbonne, situé entre la mer et les eaux douces, sont construites sur pilotis.
- La protection assure une étanchéité temporaire des ouvertures du bâti par le biais notamment de batardeaux. Il convient donc de prévoir un écopage si l'exposition à l'eau dure car ces dispositifs peuvent présenter des fuites et l'eau peut passer par de nombreuses voies comme dit en début d'exposé.
- L'option qui consiste à céder implique de laisser l'eau pénétrer et traverser le bâtiment. Elle suppose des matériaux peu sensibles à l'eau et un aménagement particulier des équipements de la maison.
Un document intitulé « Construire en zone inondable », de la DDE Moselle, publié dans les années 1990 offre de nombreuses illustrations intéressantes sur les diverses possibilités de construction en hauteur. Néanmoins, il convient de nuancer ces conseils dans le cadre d'un ensemble d'habitations car les bâtiments sont reliés entre eux par de nombreux réseaux.
Je vous renvoie également au cas célèbre de la Farnsworth House de Mies van der Rohe, construite aux Etats-Unis en zone inondable et surélevée de 1,60 mètre. En dépit des précautions de l'architecte, cette maison a été très endommagée par l'invasion de l'eau lors d'une inondation pendant laquelle l'eau est montée bien plus haut que la cote de conception. Il faut garder à l'esprit que la surélévation est certes une précaution, mais ce n'est pas la panacée.
Par ailleurs, les bâtiments amphibies peuvent aussi représenter un moyen de limiter les dommages aux bâtiments neufs. Ils sont construits sur le principe des bateaux à l'ancrage et montent ou descendent selon le niveau de l'eau. Des ducs d'Albe préviennent les dérives. Les plus fameuses illustrations de ce type de constructions sont les 25 logements amphibies construits par l'entreprise Dura Vermeer en Hollande sur des flotteurs en béton. Le promoteur français Batiflo utilise pour sa part des flotteurs en plastique pour son siège à Pau. Aux Etats-Unis, il existe des flotteurs en composite ciment verre ainsi qu'en acier.
Non, mais il s'agit de constructions qui restent toutefois confidentielles. Batiflo a également réalisé le Club House de l'hippodrome de Maisons-Laffitte ainsi que quelques maisons flottantes privées.
Néanmoins, les Hollandais ont développé un réel savoir-faire et une ingénierie qu'ils exportent désormais notamment en Asie. Il est à noter que les quartiers flottants que l'on peut voir en Hollande ou aux Etats-Unis sont des constructions à exclure en cas de courant.
Pour ce qui est de la surélévation de bâtiments, il s'agit d'une technique relativement courante aux États-Unis notamment pour des constructions en bois. En France, où la maçonnerie domine, cette technique n'est pas transposable de manière courante car les maçonneries supportent mal les inévitables mouvements induits par la surélévation, technique qui entraînerait de plus des coûts dissuasifs.
Oui, le principe est assez simple : il suffit de glisser des madriers en dessous de la maison, de soulever et d'installer des poteaux sur lesquels repose la construction. Par contre, ces constructions sont peu esthétiques.
Comment limiter les dommages aux bâtiments existants ?
Il s'agit ici uniquement des stratégies consistant à se protéger de l'eau ou à céder à l'invasion de l'eau à l'intérieur du bâtiment.
En ce qui concerne la stratégie qui consiste à céder, elle nécessite de surélever certains équipements tels que les chaudières et les autres équipements de valeur.
Par ailleurs, dans la perspective de renforcement des performances thermiques des bâtiments, j'attire votre attention sur la pertinence d'utiliser certains matériaux. Dans le rapport du CSTB relatif à la question des matériaux peu sensibles à l'inondation, je mettais en annexe une publicité pour une plaque de ciment, commercialisée sur le marché français, indiquant qu'elle résistait à l'inondation. Il est vrai qu'une plaque de ciment est plus résistante à une immersion prolongée qu'une plaque de plâtre dans l'absolu, mais cette assertion ne tient plus lorsque l'on considère une cloison entière ou un doublage. Les autres matériaux constitutifs comme l'isolant ou des éléments d'ossature en bois seraient affectés également que la plaque soit à base de ciment ou de plâtre. Il convient donc d'être vigilant.
Un guide des travaux de prévention du risque d'inondation dans l'habitat existant publié sous le timbre de la DGALN va paraître prochainement. Malgré l'existence d'une offre pléthorique de batardeaux, très peu sont vendus et, en dépit des efforts pédagogiques pour amener les populations à se protéger des inondations, la sensibilisation n'est pas réellement efficace. Le guide est conçu pour inciter les populations exposées à réaliser des aménagements afin de réduire les dommages en cas de sinistre, à l'occasion d'une rénovation ou d'une transformation de l'habitat. Ce guide prend le parti d'indiquer les mesures préconisées qui peuvent être effectuées sans surcoût significatif dans le cadre de travaux déjà prévus. Il a été conçu en partenariat avec plusieurs acteurs tels que des assureurs, des concepteurs, des entreprises et des collectivités locales. Ce guide sera disponible en ligne très prochainement.
Où en est la qualification des dispositifs de protection ?
Il existe des produits de conceptions très variées tels les barrières périphériques, les batardeaux ou barrières d'ouvertures. Il s'agit par exemple d'un mur provisoire doté d'une jambe de force, de soufflets ou de barrage-poids.
Nous avions effectué des tests de batardeaux pour le compte du Ministère de l'environnement en 2004. Nous avions alors évalué le taux de fuite en simulant le montage en applique sur une porte, la résistance aux chocs aux éléments charriés par les flots mais aussi aux barques de secours. Nous avions également testé les conditions de montage, ainsi que d'autres éléments pratiques.
Le meilleur produit que nous avions testé était britannique et coûtait environ 800 euros, ce qui représente un investissement conséquent de 4 000 à 5 000 euros pour un pavillon. Après deux ans, l'importateur de ce produit a arrêté sa commercialisation car il ne s'en est pas vendu une seule unité. Une réponse à ce coût élevé est donnée par les habitants d'un quartier de Villeneuve-Saint-Georges fréquemment inondé par les réseaux de collecte d'eau fluviale. Dans ce quartier, la plupart des habitants ont développé eux-mêmes pour un coût modique des batardeaux constitués de planches fixées temporairement aux murs pour obstruer les portes.
Il existe peu de signe de qualité hormis au Royaume-Uni et aux États-Unis. L'un d'eux est délivré par FM Global, une société d'assurance mutualiste américaine qui qualifie les produits pour ses clients sur la base d'un référentiel très complet. Ce service a un coût élevé qui en limite la diffusion.
Dans le cadre du projet européen SMARTeST, qui fédère huit pays partenaires, nous avons constitué une base de données d'environ 150 fournisseurs dont aucun ne vit exclusivement de cette activité.
Dans le cadre de ce projet européen, je souhaite vous présenter une vision conceptuelle du bassin versant et un système de gestion de l'inondation. Nous utilisons la méthode courante du Source-pathway-receptor. Ce schéma est utilisé notamment pour décrire les phénomènes de pollution et leur cheminement. Une fois transposée aux inondations, cette méthode permet de décrire le chemin que suit l'eau avant de toucher les récepteurs. Avant d'entrer dans les zones urbaines jusqu'à atteindre le quartier et le bâtiment, l'eau peut traverser d'autres zones, comme des zones d'expansion
Nous souhaitions à travers cette représentation schématique attirer l'attention sur l'importance du rôle des différentes échelles, en amont des zones urbaines, pour gérer l'inondation. En effet, il existe des actions envisageables pour les différents récepteurs :
- Il est possible de créer des espaces de stockage et d'influer sur la nature du couvert dans les zones d'expansion
- Dans la zone urbaine, l'usage du sol est important pour limiter les ruissellements. De plus, il est possible de créer des espaces de stockage souterrain, comme par exemple sous le Stade de France, même si ces équipements publics sont onéreux.
- Au niveau du quartier, le stockage est également envisageable et il est possible de réaliser des protections comme des digues ou des barrières périphériques temporaires afin que les stratégies pour limiter les dommages aux bâtiments soient optimisées, en amont de l'évènement.
Dans le bassin versant Oise-Aisne, soit une zone moyennement urbanisée, des études et des travaux ont été réalisés de telle manière que, pour une crue trentennale, il est maintenant probable que le niveau de l'eau garde un seuil modéré, permettant ainsi aux habitants des zones urbaines d'investir en confiance dans les équipements de prévention. Ce résultat demande du temps et une continuité de l'action publique locale. Finalement, il a été possible de convaincre certains habitants d'être inondés afin de servir la communauté moyennement compensation.

Pourtant, un système de compensation manque cruellement à l'heure actuelle. Il n'existe pas de compensations véritables pour les habitants en zone d'extension de crues.
Absolument, mais il semblerait que celui-ci en soit un. Je pourrais vous donner un contact pertinent pour étudier ce cas.
De l'Entente Oise-Aisne.
Cet exemple est assez exceptionnel. Néanmoins, il prouve qu'il est possible de mettre en place des solutions que nous pensions être utopiques.

Nous devons les envisager, si nous voulons réellement améliorer la situation.
Je pense que la situation topographique du terrain s'y prêtait également. Dans les zones pentues, il est plus difficile d'arrêter les eaux.

Certes, mais l'idée est que certains habitants, qui acceptent de recevoir l'eau et subissent le préjudice de l'inondation pour épargner les autres, doivent être indemnisés.
Oui, c'est ce que nous essayons de mettre en oeuvre dans le cadre du projet européen.
Pour caricaturer, je dirais que nous ne pouvons pas tout protéger. L'expérience montre que cela est très difficile. Or, nous pouvons considérer le problème différemment en priorisant les zones à protéger absolument, et en définissant d'autres zones qui pourraient être inondées au bénéfice des premières, contre compensation. Nous essayons de travailler de concert aux différentes granulométries du territoire.
Il existe un autre exemple intéressant de gestion des inondations dans la vallée de la Bièvre. La récupération, la création et une gestion hydraulique de lacs et de bassins a permis d'absorber les afflux d'eaux provenant des orages et d'éviter les crues de la Bièvre depuis 1982.
Néanmoins, ces deux exemples ne concernent pas des zones densément urbanisées, au contraire de certains quartiers du Var.
Enfin, je souhaite rappeler le rôle essentiel des prévisions météorologiques qui permettent de donner l'alerte au sujet des précipitations.

Si je vous comprends bien, il n'est pas vraiment pertinent de remplacer les matériaux de construction, étant donné le coût prohibitif des travaux à l'exception du moment de la conception ou de la transformation.
Il n'existe pas de solution qui fonctionne à 100 %.
L'un de partenaires allemands du projet SMARTeST travaille sur le bâti. Il essaie de poser des couches étanches. Or, cette solution qui permettrait de limiter les dégâts pendant quelques semaines de la durée de vie d'un bâtiment risque de créer en permanence des problèmes secondaires, tels que les moisissures.
Il existe, bien entendu, d'autres solutions temporaires telles que les jupes plastiques à poser autour du bâtiment, mais l'eau pénètrera par le sol.

Dans des zones où le risque d'inondation existe mais où les constructions restent autorisées, existe-t-il, en l'état actuel de l'avancement des techniques, une manière de construire tout en réduisant les risques et les nuisances inhérents aux inondations, voire en les éliminant complètement ?
Il existe des aménagements qui vont dans le bon sens, comme la mise ne place des commandes électriques au-dessus d'un mètre au-dessus du niveau du sol et d'un réseau électrique descendant. Ces mesures peuvent être intégrées à un projet de rénovation par exemple. Mais, rien ne protège à 100 % des inondations. Un bâtiment est très complexe et reste un ouvrage composite qui vieillit.
Quelles sont les difficultés de mise en oeuvre des solutions existantes ?
Nous ne sommes pas à court de solution pour prévenir les dégâts dus aux inondations, mais elles ne sont pas mises en oeuvre pour différentes raisons :
- L'absence de mémoire du risque,
- L'absence de connaissance et de conscience du risque,
- Le problème d'acceptation du risque et de sa propre vulnérabilité : le déni et l'incrédulité,
- Le sentiment d'être protégé,
- La déresponsabilisation des acteurs étant données les nombreuses strates administratives,
- Une coordination perfectible entre les administrations locales et nationales,
- Dans une moindre mesure, le manque de concertation avec les professionnels du bâtiment faute de solution idéale,
- Une politique nationale peu lisible localement,
- Le défaut de l'entretien de la mémoire rappelant les crues, même si des repères de crue sont encore visibles par exemple à Paris, Béziers ou Florence.
Je n'ai volontairement pas parlé de résilience parce que j'ai l'impression que ce mot est parfois utilisé en lui attribuant des vertus quasi magiques qui le rendraient vecteur de la solution idéale. Mon opinion, à titre personnel, est que la résilience des matériaux n'empêchera pas les dommages constatés à chaque inondation et qui imposent de nettoyer et remettre en état. Nous travaillons à la notion de système résilient dans le cadre du projet SMARTeST mais il faut bien constater une difficulté réelle de définition de ce qui en serait attendu.

Il existe tout de même des lieux, tels que Sommières, où les habitants vivent avec les inondations. Néanmoins, la position officielle est de ne pas construire dans les zones à risque d'inondation.
La vallée de Sommières a pourtant été aménagée, dès les Romains.

Certes, dès lors qu'un risque d'inondation existe, est-il illusoire de croire en des solutions techniques permettant de diminuer significativement l'impact des dégâts ? Si c'est le cas, pourquoi réaliser des guides de construction en zone à risque ?
Mon diagnostic ne serait pas aussi tranché. Diverses mesures permettent de limiter les dégâts des inondations modérées et il convient de les mettre en oeuvre quand c'est possible.
Néanmoins, nous sommes assez démunis dans le cas d'inondations violentes avec des ruissellements.
À ce propos, il existe un guide de construction en zone de crues torrentielles.
J'ai participé modestement à la relecture de ce guide. Il permet de réfléchir à des mesures de protection du bâtiment.
Je souhaitais, en outre, commenter les différentes étapes de l'inondation pour démontrer qu'il est possible de se préparer en amont, à des situations telles que l'inondation, par les actions suivantes :
- En amont de l'inondation, il convient d'informer, d'anticiper, de s'entraîner, de crédibiliser le risque et de sensibiliser à la culture du risque,
- Avant l'inondation, il faut se préparer dès l'alerte, mettre en oeuvre une solution adaptée au type d'inondation annoncée,
- Pendant l'inondation, la priorité est de permettre l'intervention, faciliter les secours et la gestion de crise,
- Après l'inondation, il faut nettoyer et remettre en état,
- En aval, il est important de procéder à un retour d'expérience.

Une alternative à l'interdiction pure et simple de la construction en zone inondable est-elle envisageable ?
En outre, nous déplorons la lenteur d'application des mesures visant à tout protéger et des PPRI.
Votre diagnostic au sujet des matériaux pourrait tout à fait être repris au compte des mesures de protection. Pour reprendre l'exemple de Sommières, des travaux gigantesques ont été réalisés en 1958 par le département afin de remédier durablement aux inondations. Or, la crue de 2002 a montré que les problèmes n'ont pas été tout à fait résolus.
Quelle que soit la solution mise en oeuvre, il existe une limite de la montée des eaux au-delà de laquelle cette solution n'est plus efficace. Il n'existe pas de miracle pour remédier à toutes les crues. Nous devons raisonner en termes de probabilité.
Qu'il s'agisse d'eau ou de vent, le problème est mécanique. Or, l'inondation n'a pas fait l'objet de la même attention probablement parce que la question ne relève pas essentiellement de la mécanique.

Est-il possible d'inverser cette tendance étant donnée l'ampleur du risque d'inondation en France ?
Lorsque l'on souhaite vendre sa maison, l'on est soumis à de nombreuses expertises, mais aucun ne concerne les inondations.
À Hambourg, le port a été réaménagé. Des dispositions ont été prises pour construire des bâtiments neufs plus hauts que le niveau de l'eau.
Les systèmes d'assurance ont aussi une incidence sur la perception de ce qu'il est possible de construire ou non. Si les constructions au bord de l'eau étaient réalisées aux risques et périls du propriétaire, la situation serait bien différente.
À Hambourg, des passerelles très hautes d'évacuation ont été installées dans des quartiers neufs. Certains parkings sont inondables. Or, le risque existe bel et bien.